LABORATOIRE KASTLER BROSSEL
Thèse de Doctorat de l’Université Paris VI
Spécialité : Physique Quantique
Présentée par
Yassine Hadjar
Pour obtenir le titre de Docteur de l’Université Paris VI
Sujet de la thèse :
Etude du couplage optomécanique dans une cavité
de grande finesse.
Observation du mouvement Brownien d’un miroir
Soutenue le 25 novembre 1998 devant le jury composé de :
| M. Philippe TOURRENC | Président | |
| M. Antoine HEIDMANN | Directeur de thèse | |
| M. Ariel LEVENSON | Rapporteur | |
| M. Michel PINARD | ||
| M. Jacques ROBERT | ||
| M. Jean-Yves VINET | Rapporteur |
Le présent travail a été effectué au laboratoire Kastler Brossel durant la période 1994-1998. Je remercie Michèle Leduc de m’avoir accueilli dans son laboratoire et le directeur du Département de Physique Serge Haroche que j’ai souvent sollicité dans les moments difficiles. Je voudrais aussi remercier Elisabeth Giacobino et Claude Fabre pour m’avoir accueilli au sein du groupe d’Optique Quantique.
Cette thèse a été financée par le M.E.N.E.S.R. et j’ai aussi bénéficié d’une bourse de l’Association Louis de Broglie d’Aide à la Recherche. Je remercie les responsables de l’Association et en particulier Jacques Robert pour l’intérêt qu’il a porté à ce travail et pour la sympathie qu’il m’a manifestée.
J’ai eu l’immense plaisir de travailler dans la ”jeune” équipe ”optomécanique” dirigée par Antoine Heidmann et Michel Pinard. J’ai eu en particulier la chance de contribuer à la naissance de l’expérience. J’ai pu remarquer et apprécier l’efficacité redoutable avec laquelle Antoine et Michel abordaient les problèmes aussi bien théoriques qu’expérimentaux. Par le soin qu’ils portaient aux détails, il m’ont encouragé à faire toujours mieux, plus efficace, plus précis et ”plus compact” dans mon travail. Je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu’ils m’ont apporté durant ces quatre dernières années et je pense sincèrement que les mots ne pourront pas exprimer ce que je leur dois et devrai toujours. Je tiens aussi à remercier Antoine pour les nombreuses fois où j’ai dû le solliciter pour des problèmes administratifs et personnels. Il a en effet dû faire face non seulement aux difficultés liées à l’expérience mais celles aussi liées à mon statut ”d’étranger”. Pour tout cela, Randa et moi tenons à le remercier de tout coeur.
Pierre-François Cohadon a commencé sa thèse dans l’équipe en 1996. Sa gentillesse, sa disponibilité et son enthousiasme (sans oublier ses commentaires et ses notes d’humour à la PF), ont beaucoup apporté à ce travail. Sa contribution m’a permis de rédiger la thèse dans des conditions idéales et je l’en remercie vivement.
Je voudrais remercier l’équipe du professeur Claude Boccara de l’E.S.P.C.I. qui a caractérisé l’état de surface de nos substrats, l’équipe de Jean-Marie Mackowski du Service des Matériaux Avancés de l’I.P.N. à Lyon qui a réalisé le traitement de haute réflectivité de nos miroirs, et François Bondu qui nous a fourni le programme CYPRES. Un grand merci à François Biraben et François Nez qui nous ont beaucoup aidés pour la construction de notre laser Titane Saphir. Merci à Bernard Rodriguez pour toutes les pièces mécaniques (je n’ose pas les compter) qu’il a réalisées avec une précision digne d’un ”horloger suisse” et en particulier pour les supports de la cavité.
Je remercie Jean Michel Courty qui m’a fait bénéficier de sa grande culture générale à travers les nombreuses discussions que nous avons eues. Je le remercie aussi pour ses critiques souvent très constructives qui m’ont été utiles pour la rédaction ainsi que pour la présentation orale. Je tiens à remercier Serge Reynaud qui, malgré ses nombreuses responsabilités, a toujours été très disponible; sa présence amicale m’a beaucoup aidé durant la thèse (merci pour le email du 25-11 à 22h30).
Je remercie Philippe Tourrenc, Ariel Levenson, Jean Yves Vinet et Jacques Robert d’avoir accepté de faire partie du jury malgré leurs nombreuses occupations et de m’avoir montré de ce fait l’intérêt qu’ils portent à ce travail.
Durant ce travail de thèse j’ai bénéficié de la superbe ambiance qui règne dans le groupe d’Optique Quantique et je remercie particulièrement Francesca Grassia, Astrid Lambrecht, Pascal El Khoury, Antonio Zelaquett-Khoury, Paulo Souto Ribeiro, Laurent Vernac et Agnès Maître pour avoir prêté une oreille attentive (et même plus) à tous mes problèmes et mes inquiétudes. Je leur en suis très reconnaissant.
Un grand merci collectif à : Thomas Coudreau, Catherine Schwob et Alberto Bramati pour les nombreuses discussions, leurs encouragements, leur aide et leur camaraderie; Gaëtan Messin, Hichem Eleuch, Jean-Pierre Hermier, Cedric Begon, Katsuyuki Kasai, Gaëtan Hagel, Stéphane Boucard et Matthias Vaupel pour la chaleureuse ambiance qui règne dans les couloirs du laboratoire.
Je voudrais remercier toute l’équipe technique du laboratoire sans qui ce travail n’aurait pas été possible : Jean-Pierre Plaut, Guy Flory, Francis Tréhin, Sylvain Pledel, Alexis Poizat, Jean-Claude Bernard, Jean-Pierre Okpisz, Philippe Pace et Mohamed Boujrad. Je remercie beaucoup Blandine Moutiers et Karine Gautier pour leur aide dans les différentes démarches administratives ainsi que pour leur bonne humeur et leur gentillesse. Un grand merci à Marie-Claire Rigolet pour sa gentillesse et son travail formidable.
Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux qui m’ont encouragé et aidé dans les moments difficiles de ma vie en France : Kaci Hadjar qui a subvenu à mes besoins le temps que je m’adapte à la vie parisienne; Hassib Khoury sans qui je n’aurais jamais pu obtenir ma première carte de séjour; Laure Homberg et ses parents à qui je dois beaucoup; Edwidge Ghazal pour les heures de cours grâce auxquelles j’ai pu manger et payer le loyer; Regis Ledu qui a toujours répondu présent à mes SOS; Laurent Vernac (tu sais pourquoi); Jean-Philippe Poizat, Pierre-François et Valérie pour leur gentillesse; Francesca et Arne pour leur soutien; Astrid et Pascal pour l’intérêt qu’ils ont toujours porté à mes problèmes.
Je tiens à dédier cette thèse à : tous mes amis d’Alger (oulad el houma) et en particulier à ceux qui y sont toujours et y vivent dans des conditions très pénibles, à Mohamed et Djouher que je considère comme des parents sur qui je peux compter en toutes circonstances et à Louness et Meryam qui ont toujours préservé la mémoire de ma mère. Le dernier mot va à ma soeur Soraya et mes frères Belaïd et Omar, la seule vraie famille qui me reste.
Table des matières
toc
Chapter 1 INTRODUCTION
1.1 Présentation générale
Les mesures optiques ont atteint aujourd’hui une très grande sensibilité. Les avancées technologiques dans différents domaines de la physique (optique, physique des matériaux, électronique . . .) ont permis de réduire considérablement les sources de bruit classique. Ainsi beaucoup de dispositifs optiques sont limités par le bruit quantique de la lumière. La nature quantique de la lumière impose en effet l’existence de fluctuations du champ électromagnétique. Si ces fluctuations sont connues depuis les fondements de la mécanique quantique[1], ce n’est qu’à partir des années 1970 que les physiciens ont été réellement confrontés aux limitations induites par ces fluctuations sur la précision d’une mesure. Depuis lors, un grand nombre d’expériences s’est développé afin de modifier ou de contrôler ces fluctuations. Des progrès marquants ont été réalisés dans ce domaine grâce à la mise en évidence expérimentale d’états comprimés (squeezed states)[2], pour lesquels les fluctuations d’une quadrature du champ sont inférieures à celles du vide, et grâce à la réalisation de mesures qui ne perturbent pas le signal mesuré (Quantum Non Demolition Measurements)[3, 4].
Ces recherches ont été motivées en partie par les projets de détection des ondes gravitationnelles à l’aide de grands interféromètres (projet franco-italien VIRGO ou LIGO aux USA)[5]. Les effets induits par le passage d’une onde gravitationnelle étant très petits, ces interféromètres doivent avoir des bras très longs (de l’ordre de quelques kilomètres) afin d’atteindre une sensibilité suffisante. Même si les générations actuelles d’antennes gravitationnelles sont essentiellement limitées par le bruit thermique des suspensions et des miroirs[5, 6], il n’est pas exclu que les projets futurs de détecteurs soient confrontés au bruit quantique de la lumière. La limite imposée par ce bruit peut cependant être contournée grâce à l’utilisation d’états comprimés, comme cela a été démontré expérimentalement en 1987[7].
Une seconde limitation liée à la nature quantique de la lumière est due à la pression de radiation exercée par la lumière sur les miroirs de l’interféromètre. Certains effets associés aux fluctuations quantiques de la force de pression de radiation sont maintenant bien connus. Par exemple, la pression de radiation exercée par les fluctuations du vide est à l’origine de la force de Casimir, qui a été observée à la fin des années 50[8]. Dans le cas des mesures interférométriques, la force de pression de radiation exercée par la lumière déplace les miroirs et rend la longueur des bras de l’interféromètre sensible aux fluctuations quantiques du champ. Il existe ainsi deux sources de bruit liées à la nature quantique de la lumière : le bruit propre du faisceau lumineux qui diminue lorsque l’intensité du champ augmente, et le bruit de pression de radiation qui est proportionnel à l’intensité lumineuse. Un compromis entre ces deux effets conduit à une limite quantique standard pour une mesure de position. Malgré les travaux théoriques consacrés à l’étude de cette limite quantique standard[9], aucune mise en évidence expérimentale n’a été réalisée jusqu’à présent. Les fluctuations quantiques de la pression de radiation agissent en effet très peu sur un objet macroscopique tel qu’un miroir, et une telle expérience est difficile à mettre en oeuvre.
Plus récemment, des études théoriques ont montré que la pression de radiation devrait permettre de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière, en utilisant une cavité Fabry-Perot dont un miroir est susceptible de se déplacer. Le déplacement du miroir sous l’effet de la force de pression de radiation modifie le désaccord entre le champ et la cavité : on obtient ainsi l’équivalent d’un effet Kerr d’origine purement mécanique, puisque le champ intracavité subit un déphasage qui dépend de son intensité. Cet effet non linéaire a pour conséquence de rendre la cavité bistable[10], comme cela a été démontré expérimentalement à l’aide d’une cavité dont un miroir était attaché à un dispositif pendulaire[11]. Un milieu Kerr placé dans une cavité permet par ailleurs de réduire le bruit de photon de la lumière en dessous du bruit quantique standard[12], comme l’ont montré des expériences utilisant des atomes comme milieu Kerr[13]. Dans le cas d’une cavité vide à miroir mobile, il se produit un effet de redistribution temporelle des photons par la cavité, lié à la variation de longueur physique de la cavité induite par la pression de radiation[14]. Ce dispositif devrait donc se comporter comme un mangeur de bruit quantique, le bruit de photon à la sortie de la cavité étant réduit en dessous du bruit de photon standard.
La pression de radiation a aussi pour effet de créer des corrélations entre les fluctuations quantiques du champ et le mouvement du miroir. L’une des applications de ces corrélations consiste à réaliser une mesure quantique non destructive, c’est à dire une mesure qui ne perturbe pas l’intensité. Pour mesurer la position du miroir, on peut utiliser soit une détection capacitive, soit une détection optique[15]. La première méthode consiste à déposer le miroir sur un cristal piézoélectrique, et à utiliser un circuit électrique résonnant pour détecter la charge induite par la variation de longueur du cristal. Il apparaît ainsi des corrélations quantiques entre l’intensité du faisceau et le courant électrique. La seconde méthode consiste à envoyer un second faisceau moins intense dans la cavité, pour mesurer la position du miroir. On crée alors des corrélations quantiques entre l’intensité du premier faisceau et la phase du faisceau de mesure.
Nous présentons dans ce mémoire un dispositif constitué d’une cavité Fabry-Perot de grande finesse à une seule entrée-sortie, dont l’un des miroirs est susceptible de se déplacer sous l’effet de la force de pression de radiation du champ intracavité. La grande finesse de cette cavité permet de rendre le faisceau réfléchi par la cavité sensible à des très petits déplacements du miroir mobile. Par ailleurs, la réponse mécanique du miroir mobile est optimisée de façon à exalter les effets induits par les fluctuations quantiques de la pression de radiation. En particulier, la masse du miroir est choisie aussi petite que possible. Grâce à ces caractéristiques, il est possible d’étudier de manière générale les conséquences du couplage optomécanique, tant pour les fluctuations quantiques du champ que pour la dynamique du miroir.
Les objectifs principaux du dispositif expérimental décrit dans ce mémoire sont donc la mise en évidence des effets quantiques du couplage optomécanique sur le champ, et plus généralement sur le système couplé champ-miroir mobile. Cependant, un tel dispositif est capable de mesurer des déplacements du miroir mobile avec une sensibilité extrême, du même ordre que celle des antennes gravitationnelles. Cette sensibilité peut être mise à profit pour étudier le mouvement Brownien du miroir mobile. Une étude expérimentale précise de ce bruit thermique est importante car il est responsable de la limite actuelle de sensibilité pour les grands interféromètres de détection des ondes gravitationnelles[6].
Une autre application de la très grande sensibilité de la cavité est la mesure des déplacements produits par une onde gravitationnelle sur une barre de Weber[16, 17]. Notre dispositif devrait permettre d’améliorer de façon significative la sensibilité de la mesure par rapport aux meilleurs dispositifs de détection actuels, qui sont basés sur une mesure capacitive du déplacement[18].
1.2 Organisation de la thèse
L’objectif de ce mémoire est de présenter une étude générale des propriétés du couplage optomécanique et la réalisation expérimentale d’un dispositif en vue d’une mise en évidence des effets quantiques de ce couplage. Le chapitre II est consacré à une introduction générale sur le couplage optomécanique. Nous présenterons dans un premier temps les concepts de base en utilisant un système simple, constitué d’un miroir mobile sur lequel se réfléchit un faisceau laser. Nous décrirons ensuite le dispositif qui permettra de mettre en évidence les effets du couplage optomécanique, c’est à dire une cavité optique de grande finesse dont un miroir est mobile. Nous présenterons les applications de ce dispositif, telles que la production d’états comprimés et la mesure de petits déplacements. Cette étude sera réalisée dans le cadre d’un modèle théorique simple, où le champ est décrit comme une onde plane et le miroir mobile comme un oscillateur harmonique. Cette introduction nous permettra néanmoins de dégager les paramètres essentiels du système afin d’optimiser les effets du couplage optomécanique.
Dans le chapitre III, nous décrirons le miroir mobile utilisé dans l’expérience. Ce miroir est formé de couches multidiélectriques déposées sur la face plane d’un résonateur mécanique constitué d’un substrat plan-convexe en silice pure. Pour étudier le couplage entre la lumière et le mouvement mécanique du résonateur, nous développerons dans ce chapitre un modèle théorique qui tient compte de la présence de différents modes acoustiques dans le résonateur et de la structure tridimensionnelle du résonateur et du faisceau lumineux. Nous montrerons qu’il est possible de se ramener à une description monodimensionnelle, en intégrant la structure spatiale dans une susceptibilité effective qui décrit l’effet sur le champ de la réponse mécanique du résonateur à la pression de radiation intracavité. Nous généraliserons alors les résultats obtenus dans le chapitre II au cas du résonateur plan-convexe, et nous montrerons l’importance de l’adaptation spatiale entre le faisceau lumineux et les modes acoustiques. Nous verrons en particulier que la masse effective du résonateur qui décrit l’amplitude du couplage optomécanique dépend de la section du faisceau et peut être beaucoup plus petite que la masse totale du miroir.
Le chapitre IV est consacré à la description du montage expérimental qui est essentiellement constitué de quatre parties : la cavité à miroir mobile,qui est une cavité linéaire de grande finesse à une seule entrée sortie, la source laser, qui est constituée d’un laser titane saphir stabilisé en fréquence et en intensité, le système de détection homodyne, et enfin un dispositif qui permet d’exciter optiquement les modes acoustiques du résonateur afin de caractériser la réponse mécanique du miroir. Nous présenterons les caractéristiques ainsi que les performances obtenues pour chacun de ces éléments.
Dans le chapitre V nous présenterons les résultats expérimentaux qui ont permis de caractériser le couplage optomécanique dans notre dispositif. Nous démontrerons l’extrême sensibilité de la cavité à des petits déplacements du miroir mobile, grâce à l’observation du mouvement Brownien du miroir. Nous déterminerons enfin cette sensibilité et effectuerons une comparaison avec les résultats théoriques.
Chapter 2 LE COUPLAGE OPTOMECANIQUE
Nous présentons dans ce chapitre les caractéristiques générales du couplage optomécanique. Nous introduisons les concepts de base à l’aide d’un système simple, constitué d’un miroir mobile sur lequel se réfléchit un faisceau laser (partie 2.1). L’étude de ce système permet de comprendre aisément les effets quantiques induits par la pression de radiation exercée par la lumière. Nous présentons ensuite le dispositif qui est le coeur du montage expérimental, c’est-à-dire une cavité optique de grande finesse dont un miroir est mobile (partie 2.2). Les deux dernières parties sont consacrées aux applications du couplage optomécanique : la production d’états comprimés (partie 2.3) et la mesure de très petits déplacements (partie 2.4).
2.1 Système avec un seul miroir mobile
Les effets du couplage optomécanique peuvent être mis en évidence en considérant le système simple où un faisceau lumineux se réfléchit sur un miroir mobile[19] (figure 1). On utilisera dans cette partie une description corpusculaire de la lumière. Ceci nous permettra de donner des images physiques simples des phénomènes qui interviennent au cours de l’interaction.
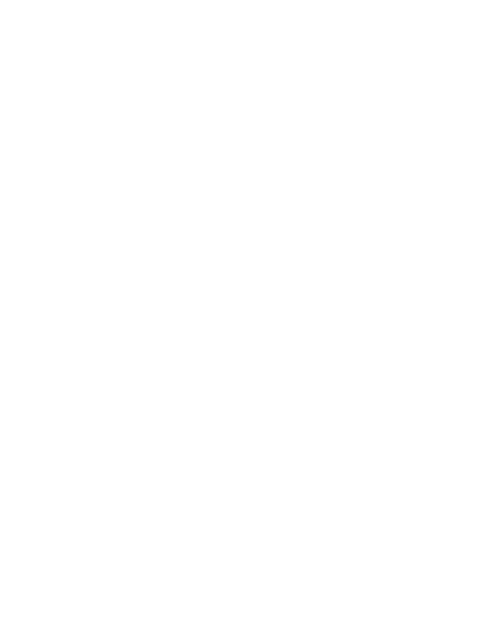
Nous allons tout d’abord décrire le bruit de photon de la lumière dans le cadre du modèle corpusculaire. Nous présenterons ensuite les deux aspects complémentaires du couplage optomécanique, c’est à dire le déplacement du miroir sous l’effet de la force de pression de radiation exercée par la lumière, et la modification du bruit quantique de la lumière due à ce mouvement.
2.1.1 Le bruit de photon
Le faisceau incident, issu d’une source laser cohérente, est caractérisé par une distribution aléatoire des photons dans le temps. On peut décrire un tel faisceau à l’aide d’un modèle corpusculaire où le flux de photons arrivant sur le miroir est traité comme un processus stochastique ponctuel. Chaque photon est considéré comme un évènement discret, localisé dans le temps, et l’intensité du faisceau est définie comme le taux de comptage de ces événements. Plus précisément, l’intensité peut s’écrire sous la forme:
| (2.1) |
où correspond à l’instant d’arrivée du -ième photon sur le miroir. Pour un faisceau cohérent, les temps sont répartis de façon aléatoire dans le temps.
On peut caractériser la statistique de photon d’un faisceau cohérent de plusieurs manières [20]. Par exemple, le nombre de photons comptés pendant un intervalle de temps est une variable aléatoire dont la distribution de probabilité obéit à la loi de Poisson :
| (2.2) |
où est le nombre moyen de photons comptés dans l’intervalle de temps , relié à l’intensité moyenne par:
| (2.3) |
Il apparaît ainsi que le nombre de photons comptés sur un intervalle de temps donné n’est pas constant. En particulier, la variance est égale, pour une telle loi Poissonienne, à :
| (2.4) |
Ces fluctuations sont à l’origine d’un bruit de ”grenaille” lors de la mesure de l’intensité du faisceau lumineux. Ce bruit, qui est de nature quantique car il est lié à la discrétisation sous forme de photons de la lumière, n’est autre que le bruit quantique standard, ou shot noise.
Une autre caractérisation d’un faisceau cohérent consiste à utiliser la fonction délai entre deux photons successifs : ces délais sont des variables aléatoires indépendantes obéissant à une loi de probabilité exponentielle. On peut utiliser cette propriété pour réaliser une simulation numérique du bruit de photon. Les temps d’arrivée des photons sont déterminés par récurrence, en tirant numériquement les délais entre photons successifs à l’aide d’un générateur pseudo-aléatoire obéissant à une loi de distribution exponentielle. Le résultat de la simulation est représenté sur la première courbe de la figure 2.

Chaque pulse représente un temps d’arrivée d’un photon sur le miroir. Cette courbe simule très bien le signal fourni par un photomultiplicateur placé en face d’un faisceau peu intense : chaque photon détecté se traduit par un pulse électrique. L’irrégularité dans les temps d’arrivée des pulses est une manifestation du bruit quantique de la lumière.
2.1.2 Effet de la pression de radiation sur un miroir mobile
Chaque réflexion d’un photon sur le miroir mobile se traduit par un transfert de quantité de mouvement égal à où est le vecteur d’onde de la lumière. Ce transfert produit une force de pression de radiation qui s’exerce sur le miroir. Cette force est égale à la quantité de mouvement échangée par photon, multipliée par le nombre de photons réfléchis par seconde:
| (2.5) |
Cette force induit un déplacement du miroir, et la position du miroir est ainsi corrélée à l’intensité lumineuse.
Dans le cadre du modèle simple décrit ici, on suppose que le mouvement du miroir est harmonique, caractérisé par une fréquence de résonance mécanique (il s’agit par exemple d’un miroir suspendu à un pendule). La simulation numérique, représentée par la seconde courbe de la figure 2, montre que le mouvement du miroir est sensible aux fluctuations d’intensité du faisceau incident. Lorsque le nombre de photons arrivant sur le miroir est important, ce dernier a tendance à être poussé, alors qu’il tend à revenir vers sa position d’équilibre lorsque le flux diminue. La position du miroir reproduit ainsi les fluctuations d’intensité incidente, filtrées par la réponse mécanique du miroir. L’existence de ces corrélations quantiques peut être mise à profit pour réaliser une mesure quantique de l’intensité du faisceau lumineux. Il faut pour cela disposer d’un appareil de mesure capable de détecter les très petits déplacements du miroir sans pour autant perturber ce mouvement, et extraire ensuite toute l’information sur les fluctuations d’intensité du faisceau incident. Nous décrirons par la suite un système capable de réaliser une telle mesure (section 2.4.3).
2.1.3 Effet du mouvement du miroir sur le bruit de photon
Le mouvement du miroir agit à son tour sur le bruit de photon en modifiant le chemin optique suivi par la lumière. Les photons sont ainsi plus ou moins retardés lors de leur réflexion sur le miroir. Comme on peut le voir sur la dernière courbe de la figure 2, la distribution des photons réfléchis est modifiée, et dans certains cas il est possible de réguler le flux réfléchi.
Cette régulation peut s’interpréter de la manière suivante : lorsque le flux incident est trop important, le miroir est poussé vers l’arrière, ce qui a pour effet de retarder les photons. Le flux réfléchi est donc réduit par rapport au flux incident. L’effet inverse se produit lorsque le flux incident est trop faible. Bien que ce raisonnement ne soit pas tout à fait exact car il ne tient pas compte de la dynamique du miroir, il permet de comprendre l’effet de régulation temporelle du flux de photons.
Il apparaît ainsi que le couplage optomécanique est basé sur deux effets complémentaires. Tout d’abord, le miroir se déplace sous l’effet de la pression de radiation. La position du miroir effectue en quelque sorte une ”mesure” de l’intensité de la lumière. Ensuite, le mouvement modifie le chemin optique suivi par la lumière. La combinaison de ces deux effets permet de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière.
2.1.4 Régime de flux intense
Afin d’agir efficacement sur le bruit quantique, le flux incident doit être suffisamment intense pour produire des déplacements importants du miroir. La figure 3 montre le résultat de la simulation numérique pour un régime de flux intense. On ne peut plus dans ce cas représenter chaque photon par un pulse individuel. Afin de visualiser le flux de photons, on divise le temps en petits canaux de durée et on compte le nombre de photons dans chaque canal. On obtient ainsi un signal d’intensité moyenne non nulle auquel vient se rajouter des fluctuations , qui sont associées à la variation du nombre de photons par canal au cours du temps. L’intensité s’écrit:
| (2.6) |

La première courbe de la figure 3 montre le flux de photons incidents. Cette courbe simule très bien le signal électrique obtenu à l’aide d’une photodiode placée en face d’un faisceau lumineux intense. On voit nettement sur la troisième courbe de la figure 3 la régulation temporelle du flux de photons, qui se traduit par une réduction du bruit d’intensité du faisceau réfléchi.
2.1.5 Spectre de bruit
La représentation temporelle que nous avons utilisée jusqu’ici présente l’inconvénient de ne pas mettre en évidence la dynamique du miroir mobile. On peut étudier la réponse dynamique du système en se plaçant dans l’espace des fréquences (espace de Fourier). Dans cet espace, le bruit d’intensité est caractérisé par son spectre et le miroir mobile par sa réponse mécanique à une force extérieure.
Le spectre de bruit d’intensité, noté , représente la puissance de bruit de l’intensité . Il est par définition la transformée de Fourier à la fréquence de la fonction d’autocorrélation CI(t) :
| (2.7) |
où les crochets représentent une moyenne sur la statistique des photons. On peut aussi exprimer le spectre d’intensité en fonction de la transformée de Fourier des fluctuations d’intensité :
| (2.8) |
Cette définition du spectre est tout à fait générale et s’applique en fait à n’importe quelle variable aléatoire stationnaire. On peut ainsi définir le spectre de bruit de position du miroir mobile en fonction des fluctuations de position (transformée de Fourier de ) :
| (2.9) |
D’autre part, la réponse mécanique du miroir mobile permet de relier la position du miroir à la force de pression de radiation. Dans le cas de petits déplacements, la théorie de la réponse linéaire[21] montre qu’il existe une relation de proportionnalité dans l’espace de Fourier entre la position et la force appliquée:
| (2.10) |
où est la susceptibilité mécanique
du miroir mobile. Pour un oscillateur harmonique de fréquence de
résonance , cette susceptibilité est décrite par
une Lorent-
zienne qui a la forme suivante:
| (2.11) |
où est la masse du miroir et le facteur de qualité de la résonance. A l’aide de l’expression (2.10) et celle de la force de pression de radiation (équation 2.5), on peut obtenir une relation simple entre les spectres de position et d’intensité incidente :
| (2.12) |
Cette relation montre clairement que la position du miroir reproduit les fluctuations d’intensité, filtrées par la réponse mécanique du miroir mobile.
La simulation Monte Carlo permet de déterminer les spectres de bruit d’intensité, par transformée de Fourier numérique des flux de photons. La figure 4 montre le résultat de cette simulation, pour les spectres de bruit des faisceaux incident et réfléchi[19].

Le faisceau incident, caractérisé par une statistique Poissonienne, a un bruit plat en fréquence (shot noise) :
| (2.13) |
La simulation numérique montre que le spectre de bruit d’intensité du faisceau réfléchi n’est plus plat en fréquence mais qu’il est réduit en dessous de la limite quantique standard. La réduction dépend de la réponse en fréquence du miroir, qui agit comme un filtre pour les fluctuations quantiques de la lumière autour de la fréquence de résonance mécanique . Ce système permet ainsi de contrôler les fluctuations quantiques de la lumière et de produire des états non classiques, ou états comprimés (squeezed states)[2]. Nous décrirons par la suite plus en détail les caractéristiques de ces états non classiques.
2.1.6 Quelques ordres de grandeurs
Nous allons maintenant donner quelques ordres de grandeurs concernant d’une part les déplacements nécessaires pour agir sur les fluctuations quantiques de la lumière et d’autre part les déplacements du miroir mobile produits par la force de pression de radiation. Nous allons utiliser pour cela des raisonnements simples, certes incomplets, mais qui nous permettront de garder une image physique des phénomènes mis en jeu.
2.1.6.1 Déplacements nécessaires pour corriger les fluctuations quantiques de l’intensité lumineuse
On peut comprendre le phénomène de régulation temporelle à partir de la figure 5.
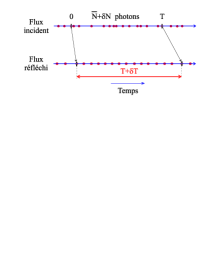
Considérons un intervalle de temps au cours duquel on compte photons dans le flux incident. Le miroir, en se déplaçant, retarde les photons. Les photons se retrouvent ainsi dans le flux réfléchi répartis sur un intervalle de temps différent, égal à où est proportionnel au déplacement du miroir :
| (2.14) |
( est la vitesse de la lumière). Le miroir régule le flux de photons si la variation temporelle est telle que le nombre de photons est proche du nombre moyen de photons attendu dans l’intervalle de temps :
| (2.15) |
On en déduit que le miroir doit se déplacer au cours du temps d’une quantité égale à :
| (2.16) |
On trouve ainsi l’écart type des déplacements nécessaires à partir de la variance donnée par l’équation (2.4) :
| (2.17) |
Le temps de mesure est typiquement de l’ordre de la période de résonance mécanique. C’est en effet au voisinage de la fréquence de résonance que la réduction de bruit est la plus importante (figure 4). On arrive alors à l’expression suivante pour les déplacements que doit effectuer le miroir pour corriger les fluctuations quantiques de la lumière :
| (2.18) |
Pour déterminer un ordre de grandeur de ces déplacements, on peut considérer un miroir fixé à un système pendulaire. Dans ce cas, la fréquence de résonance mécanique est au plus de l’ordre de . L’intensité moyenne est reliée à la puissance lumineuse par l’intermédiaire de l’énergie d’un photon :
| (2.19) |
Pour une puissance lumineuse de et une longueur d’onde de , on obtient une intensité moyenne égale à . Ces chiffres conduisent à des déplacements du miroir de l’ordre de , soit .
2.1.6.2 Déplacements dus à la force de pression de radiation
La force de pression de radiation s’écrit, d’après les équations (2.5) et (2.6), comme la somme d’une force moyenne associée à l’intensité moyenne du faisceau et d’un terme fluctuant lié au bruit de photon. Le miroir subit donc à la fois un recul moyen et des fluctuations de position . Nous allons voir que ces deux quantités correspondent en fait à de très petits déplacements.
Afin de déterminer le déplacement moyen, on écrit qu’à l’équilibre, la force moyenne de rappel de l’oscillateur harmonique est égale à la force de pression de radiation moyenne . On obtient alors l’expression suivante :
| (2.20) |
Pour une masse du miroir mobile égale à , on trouve un déplacement moyen beaucoup plus petit que la longueur d’onde, de l’ordre de .
Pour évaluer à présent le déplacement dû aux fluctuations de la force de pression de radiation, nous allons déterminer la variance qui est par définition l’intégrale du spectre de position . D’après les équations (2.12) et (2.13), cette variance s’exprime simplement en fonction de la susceptibilité mécanique du miroir, c’est-à-dire comme l’intégrale d’une Lorentzienne (équation 2.11). On obtient ainsi :
| (2.21) |
Pour un facteur de qualité , ce déplacement est de l’ordre de .
Ce très petit déplacement est bien sûr insuffisant pour agir efficacement sur le bruit quantique, puisqu’il est environ fois plus faible que le déplacement nécessaire [22]. Il semble par ailleurs difficile d’augmenter de façon significative les déplacements produits par les fluctuations de pression de radiation : ces fluctuations quantiques induisent sur un objet macroscopique tel qu’un miroir des déplacements petits devant la longueur d’onde.
Il faut cependant noter qu’il est envisageable de détecter d’aussi petites variations de position, en particulier grâce aux progrès réalisés dans le domaine des mesures interférométriques destinées à détecter des ondes gravitationnelles[5]. En fait, la phase du champ électromagnétique est beaucoup plus sensible que l’intensité à une variation de position du miroir. S’il est nécessaire de déplacer le miroir de pour changer l’intensité d’une quantité de l’ordre du bruit quantique, un déplacement de l’ordre de induit une variation de phase de . Il suffit donc de déplacer le miroir d’une très petite fraction de longueur d’onde pour induire sur le faisceau une variation de phase de l’ordre de ses fluctuations quantiques.
En conclusion, si le système présenté dans cette partie permet de comprendre les principes de base du couplage optomécanique, il est nécessaire d’utiliser un dispositif plus complexe, où la phase joue un rôle, pour espérer agir sur le bruit quantique de la lumière. Les parties suivantes de ce chapitre ont pour but de décrire un tel système.
2.2 Cavité Fabry-Perot à miroir mobile
Nous avons vu que les déplacements induits par les fluctuations de la force de pression de radiation sont très petits (de l’ordre de ). Il sont par conséquent insuffisants pour agir directement sur les fluctuations quantiques de l’intensité lumineuse. Par ailleurs, la phase du champ électromagnétique est beaucoup plus sensible aux déplacements du miroir mobile. Pour mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique, il faut donc disposer d’un système capable de coupler les fluctuations de phase à celles de l’intensité. Il suffit en fait de rajouter un miroir fixe de transmission non nulle devant le miroir mobile de façon à former une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie (figure 6). Nous allons décrire dans cette partie les propriétés générales de ce système, les effets sur le faisceau lumineux et quelques applications qui en découlent. Nous étudierons plus en détail ces applications dans les parties suivantes.

2.2.1 Cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie
On va s’intéresser au système constitué d’une cavité Fabry-Perot dont un miroir est mobile (figure 6). Une telle cavité présente des résonances pour des longueurs précises de la cavité. Le champ intracavité est en effet la somme d’une infinité d’ondes qui interfèrent de façon constructive pour des longueurs multiples de la demi longueur d’onde lumineuse . Il apparaît de ce fait un maximum d’intensité à chaque fois que la longueur est un multiple de . Lorsqu’on s’écarte de ces résonances en déplaçant par exemple le miroir mobile, l’intensité dans la cavité diminue en décrivant un pic d’Airy qui a la forme d’une Lorentzienne pour une cavité de grande finesse (figure 7a).
Un paramètre important d’une cavité Fabry-Perot est sa finesse , définie par la largeur à mi-hauteur des pics d’Airy. La finesse ne dépend que de la transmission et des pertes des deux miroirs. Elle détermine aussi l’amplification de l’intensité intracavité moyenne à résonance qui est reliée à l’intensité moyenne incidente par la relation :
| (2.22) |
Dans le cas d’une cavité sans perte optique, tous les photons incidents finissent par ressortir de la cavité après un certain temps de stockage. Le faisceau réfléchi a donc la même intensité moyenne que le faisceau incident. Par contre il subit une variation de phase qui dépend de la longueur de la cavité, et donc de la position du miroir mobile. La figure 7b montre que cette variation de phase est de l’ordre de pour un déplacement du miroir égal à la largeur du pic d’Airy. A résonance, la pente de la courbe est maximale et vaut . Un petit déplacement du miroir mobile autour de la résonance produit une variation de phase égale à:
| (2.23) |
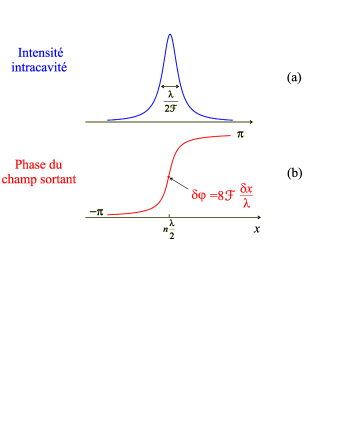
On peut comparer cette sensibilité à celle obtenue avec un seul miroir mobile. Pour le système étudié dans la partie 2.1, un déplacement du miroir induit une modification du chemin optique de la lumière. Le champ réfléchi subit donc un déphasage égal à . La présence de la cavité augmente ainsi la sensibilité de ce déphasage par un facteur de l’ordre de la finesse de la cavité.
Une cavité de grande finesse devrait donc permettre de mesurer des déplacements du miroir correspondants à une très petite fraction de la longueur d’onde. Nous étudierons dans la partie 2.2.3 la possibilité de réaliser des mesures de très faibles déplacements, qu’ils soient dus aux fluctuations quantiques de la pression de radiation, ou qu’ils soient liés à d’autres sources, comme le bruit thermique du miroir mobile.
Une autre application de la très grande sensibilité de la cavité à des petits déplacements consiste à contrôler les fluctuations quantiques du champ. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi induites par le couplage optomécanique peuvent en effet être du même ordre de grandeur que les fluctuations quantiques. Il est ainsi possible de modifier ces fluctuations, et en particulier de les réduire de façon à obtenir des états comprimés. Nous étudierons dans la partie suivante la possibilité de produire de tels états avec une cavité à miroir mobile.
2.2.2 Compression du champ par couplage optomécanique
En électrodynamique quantique, le champ électromagnétique se décompose en une somme de modes équivalents à des oscillateurs harmoniques indépendants. Nous allons supposer ici que le champ peut être décrit par un seul mode, caractérisé par des opérateurs d’annihilation et de création et indépendants du temps. Ces opérateurs obéissent à la relation de commutation:
| (2.24) |
Comme dans le cas d’un oscillateur matériel caractérisé par les deux observables de position et de quantité de mouvement , on introduit pour le champ électromagnétique deux observables et , appelées quadratures du champ, qui sont associées aux parties réelle et imaginaire du champ :
| (2.25a) | |||||
| (2.25b) | |||||
Ces deux observables ne commutent pas et leurs variances et vérifient une inégalité de Heisenberg:
| (2.26) |
Cette inégalité traduit l’existence de fluctuations quantiques. Pour étudier ces fluctuations, nous allons utiliser la méthode semi-classique qui va permettre de leur associer une représentation géométrique dans l’espace des phases.
2.2.2.1 Représentation semi-classique des fluctuations quantiques
La méthode semi-classique consiste à représenter les fluctuations quantiques par une distribution de quasi-probabilité de Wigner[23]. On associe ainsi des variables classiques aléatoires et ( étant le complexe conjugué de ) aux opérateurs du champ et . La distribution de Wigner, qui est une fonction des variables et , décrit la loi de distribution de ces variables. Ainsi toute moyenne quantique des opérateurs et rangés dans l’ordre symétrique est égale à la moyenne classique de la même combinaison des variables et , pondérée par la distribution de Wigner.
L’un des intérêts de la distribution de Wigner est qu’elle est positive pour les états usuels du champ. Elle peut donc être considérée comme une véritable distribution de probabilité, et les variables et représentent les valeurs possibles du champ. La figure 8a montre la distribution de Wigner pour un état cohérent. Le plan horizontal représente l’espace des phases dont les axes sont définis par les parties réelle et imaginaire du champ. La distribution de Wigner est une Gaussienne dont la variance dans toutes les directions est égale à .
Une représentation plus commode à deux dimensions (figure 8b) est obtenue en faisant une projection de la distribution dans le plan {}. Les fluctuations du champ sont alors décrites par un disque délimité par la courbe d’isoprobabilité à de la Gaussienne. Chaque point à l’intérieur du disque représente une réalisation possible du champ. Le champ électromagnétique peut ainsi s’écrire comme la somme d’un champ moyen et d’un champ fluctuant qui décrit les fluctuations quantiques:
| (2.27) |
Le bruit sur chaque quadrature et est donné par la projection de la distribution sur les axes horizontal et vertical. Pour un état cohérent, on trouve que les variances et sont toutes deux égales à . Un état cohérent est donc un état minimal pour lequel le produit de ces variances a la valeur minimale autorisée par l’inégalité de Heisenberg (équation 2.26).
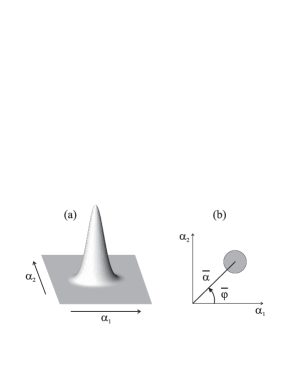
De manière générale, on peut définir une quadrature quelconque du champ par l’expression:
| (2.28) |
Les quadratures et correspondent respectivement à et . Les fluctuations pour la quadrature sont obtenues en projetant la distribution sur l’axe faisant un angle avec l’horizontale dans l’espace des phases. Pour un état cohérent, toutes les quadratures ont donc le même bruit, la variance étant égale à quelle que soit la valeur de .
On peut aussi déterminer les bruits d’intensité et de phase. Pour un champ monomode et indépendant du temps, l’intensité est caractérisée par le nombre de photons dans le mode. Ce nombre de photons et la phase sont reliés au champ par la relation:
| (2.29) |
En linéarisant les fluctuations autour des valeurs moyennes, on trouve que les fluctuations d’intensité et de phase sont reliées respectivement à la quadrature d’amplitude et à la quadrature orthogonale , où est la phase du champ moyen:
| (2.30a) | |||||
| (2.30b) | |||||
Les bruits d’intensité et de phase sont donc associés à la projection de la distribution sur les axes parallèle et perpendiculaire au champ moyen. Pour un état cohérent, on trouve que le bruit d’intensité correspond au bruit quantique standard, puisque la variance est égale au nombre moyen de photons. Par contre, la variance des fluctuations de phase est inversement proportionnelle au nombre moyen de photons:
| (2.31) |
Ce résultat peut s’interpréter de la manière suivante : la dispersion de phase correspond à l’angle sous lequel on voit la distribution depuis l’origine; elle est donc d’autant plus petite que l’amplitude moyenne du champ est grande. Notons enfin qu’il existe une relation de Heisenberg entre les fluctuations d’intensité et de phase:
| (2.32) |
Un état cohérent est un état minimal vis-à-vis de cette inégalité.
2.2.2.2 La méthode semi-classique
Nous venons d’associer une représentation semi-classique aux fluctuations quantiques. Ceci permet de décrire les champs entrants dans le système à l’aide de variables classiques aléatoires. Afin de déterminer les fluctuations des champs sortants, il est nécessaire de décrire les effets de l’interaction avec le système.
Dans le cas d’un régime de champ intense où les fluctuations sont petites devant la valeur moyenne du champ, on peut linéariser l’équation d’évolution de la distribution de Wigner. On obtient alors une équation tout à fait similaire à celle décrivant l’évolution classique du système[24]. La méthode semi-classique consiste donc à remplacer les fluctuations quantiques des champs par une distribution semi-classique dans l’espace des phases, puis à étudier l’évolution de cette distribution à l’aide des équations classiques décrivant le système.
Notons que la méthode présentée ici correspond à une analyse statique du système: on s’intéresse à la variance des fluctuations du champ, le système étant dans un état stationnaire. On peut bien sûr généraliser la méthode semi-classique pour tenir compte de la dynamique du système. On s’intéresse alors aux fluctuations du champ à une fréquence d’analyse . La méthode semi-classique permet d’obtenir une relation d’entrée-sortie pour ces fluctuations, relation qui fait intervenir la réponse dynamique du système. Cette relation permet de déterminer les spectres de bruit des fluctuations sortantes. Nous aurons l’occasion de présenter cette approche dynamique dans la partie (2.3).
2.2.2.3 Production d’états comprimés par couplage optomécanique
Nous allons expliquer de façon simple comment le couplage optomécanique peut permettre de comprimer les fluctuations du champ. Une étude plus rigoureuse est présentée dans la partie 2.3. Nous négligeons ici la dynamique du système, ce qui revient à ne considérer que les fluctuations à fréquence nulle. Dans le cadre de cette analyse statique, on peut considérer que le champ est monomode et indépendant du temps.
Nous avons vu au début de cette partie que le champ réfléchi par la cavité subit un déphasage qui dépend de la longueur de la cavité (figure 7b). Cette longueur est modifiée par le mouvement du miroir mobile sous l’effet de la force de pression de radiation exercée par le champ intracavité. Le champ à la sortie subit donc un déphasage qui dépend de l’amplitude du champ. Dans l’espace des phases, ce déphasage se traduit par une rotation du champ (figure 9). La méthode semi-classique permet alors d’appliquer cette transformation classique à l’ensemble de la distribution du champ cohérent incident (disque de la figure 9). Chaque réalisation possible du champ subit une rotation qui dépend de son amplitude, ce qui a pour effet de modifier la forme de la distribution qui devient elliptique[12]. On obtient ainsi un état du champ dont le bruit sur la composante est réduit (). Afin de conserver l’inégalité de Heisenberg, le bruit sur la composante est augmenté.

Dans ce système, le champ subit une transformation unitaire, et la surface de la distribution est conservée. Le champ sortant de la cavité est donc dans un état minimal vis-à-vis de l’inégalité de Heisenberg. Un tel état est un état non classique du champ appelé état comprimé (squeezed state). Il est caractérisé par la distribution de Wigner de la figure 10. La distribution est toujours une Gaussienne, mais la variance pour une quadrature quelconque varie selon la quadrature considérée.
Nous venons de montrer, de manière simple et géométrique, que la cavité à miroir mobile est capable de produire un état comprimé du champ[14]. Nous exposerons dans la partie 2.3 une étude plus détaillée de ce système. En particulier nous nous intéresserons au spectre de bruit du champ réfléchi par la cavité.
2.2.3 Mesure de petits déplacements
La phase du champ réfléchi par la cavité est sensible à de très petits déplacements du miroir mobile. L’équation (2.23) montre qu’un déplacement du miroir mobile provoque une variation de la phase du champ réfléchi. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi reflètent donc les déplacements du miroir, auxquels se superposent le bruit propre du faisceau. Nous verrons dans la partie 2.4 que pour une cavité résonnante avec le champ, ce bruit quantique est de l’ordre du bruit de phase du faisceau incident:
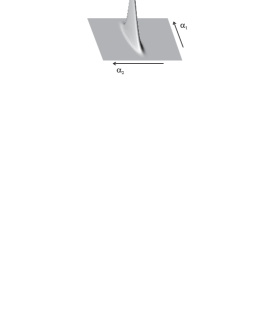
| (2.33) |
Le spectre des fluctuations de phase du faisceau réfléchi reproduit donc le spectre de position du miroir mobile. La sensibilité est limitée par le bruit propre du faisceau incident. Pour un faisceau cohérent ce bruit est inversement proportionnel à l’intensité moyenne (relation similaire à l’équation 2.31):
| (2.34) |
On trouve ainsi le plus petit déplacement mesurable :
| (2.35) |
Pour une cavité de finesse et une puissance incidente de ( photons/s), on obtient une sensibilité égale à . L’unité en est celle utilisée pour décrire une amplitude de bruit de position. Cette amplitude correspond en effet à la racine carrée de la puissance de bruit , qui s’exprime en (puissance de bruit par bande spectrale d’analyse).
Cette sensibilité est tout à fait remarquable puisqu’elle est comparable, ou même meilleure, que celle des dispositifs les plus sensibles à l’heure actuelle. L’essentiel des efforts concernant la mesure de petits déplacements se concentre aujourd’hui autour des projets de détection des ondes gravitationnelles, qu’il s’agisse des projets optiques (projets VIRGO[25], LIGO[26]), ou mécaniques (barres de Weber[16]).
La détection optique des ondes gravitationnelles est basée sur l’utilisation d’un interféromètre de Michelson. Chaque bras de l’interféromètre, d’environ de long, est constitué d’une cavité Fabry-Perot de finesse . Grâce à un dispositif de recyclage de la lumière, la puissance lumineuse envoyée dans l’interféromètre est de l’ordre de . Le passage d’une onde gravitationnelle se traduit par une variation apparente de la longueur des bras, équivalente à un déplacement des miroirs des cavités Fabry-Perot, qui induit un défilement des franges d’interférence à la sortie de l’appareil.
La sensibilité prévue pour VIRGO est indiquée sur la figure 11[27]. On distingue essentiellement trois sources de bruit. A basse fréquence, la sensibilité est limitée par le bruit thermique des suspensions des miroirs. Entre et , le bruit thermique des modes de vibration interne des miroirs devient dominant. A haute fréquence la limite est fixée par le bruit de photon, filtré par la bande passante de des cavités Fabry-Perot. La figure 11 montre que la sensibilité de l’interféromètre est au mieux de l’ordre de .

La sensibilité atteinte avec une cavité de grande finesse peut aussi être comparée à celle obtenue par les dispositifs capacitifs placés sur les barres de Weber. Une barre de Weber est constituée d’un corps massif, généralement de forme cylindrique. Le matériau utilisé peut être du niobium, du saphir, de l’aluminium ou encore de la silice, et le poids de la barre peut atteindre plusieurs tonnes. Elle est soigneusement isolée du monde extérieur : elle est suspendue par des fils dans le vide, à l’intérieur d’un cryostat à très basse température (jusqu’à ). Le passage d’une onde gravitationnelle se traduit par une excitation d’un mode de vibration mécanique de la barre. L’amplitude du mouvement attendu est extrêmement faible. Le transducteur utilisé pour détecter ces oscillations est constitué d’un résonateur mécanique de faible masse couplé mécaniquement à la barre et capacitivement à un circuit électrique résonnant. On atteint ainsi une sensibilité comprise entre et [18].
Une cavité de grande finesse devrait donc permettre de réaliser une mesure de déplacement avec une sensibilité meilleure que celle des dispositifs actuels[17]. Nous présenterons dans la suite de cette section deux applications de cette sensibilité extrême: la mesure du mouvement Brownien du miroir, et la mesure quantique non destructive de l’intensité de la lumière.
2.2.3.1 Mesure du bruit thermique
Comme le montre la figure 11, le bruit thermique est la limitation essentielle dans les dispositifs de détection interférométrique des ondes gravitationnelles. D’après les théories astrophysiques actuelles, le nombre attendu d’évènements varie brutalement avec la sensibilité atteinte par les interféromètres. Il est de ce fait important de déterminer avec précision les différentes sources de bruit pouvant limiter cette sensibilité.
Les mécanismes de dissipation thermique dans les solides sont cependant mal connus. Une cavité à miroir mobile, utilisée à température ambiante, devrait permettre de caractériser l’amplitude et la distribution spectrale du bruit thermique du miroir. Le principe de la mesure consiste à envoyer un faisceau laser dans la cavité à miroir mobile, le laser étant à résonance avec la cavité. Les fluctuations de phase du faisceau réfléchi reflètent alors les déplacements du miroir mobile, auxquels se superposent le bruit propre du faisceau (équation 2.33). A température ambiante, et pour des puissances incidentes raisonnables, les effets de pression de radiation sont négligeables devant le mouvement Brownien du miroir : le déplacement est donc pour l’essentiel dû au bruit thermique du miroir mobile.
On peut mesurer expérimentalement le bruit du faisceau réfléchi en utilisant une détection homodyne (figure 12)[28]. Une grande partie du faisceau incident est prélevée à l’aide d’une lame séparatrice afin de fournir un faisceau de référence (oscillateur local). Après un aller et retour dans un bras dont la longueur est soigneusement contrôlée, ce faisceau est mélangé au niveau d’une seconde lame parfaitement semi-réfléchissante avec le faisceau réfléchi par la cavité. Les faisceaux transmis et réfléchi par la lame sont détectés à l’aide de deux photodiodes de grande efficacité quantique. Lorsque la longueur du bras de l’oscillateur local est tel que le champ réfléchi par la cavité et le faisceau de référence sont en quadrature de phase, la différence des deux photocourants est proportionnelle aux fluctuations de phase du faisceau réfléchi. On obtient alors le spectre de bruit de phase à l’aide d’un analyseur de spectres.
On peut noter la grande similitude du dispositif schématisé sur la figure 12 avec un interféromètre de Michelson. La différence essentielle est la dissymétrie entre les deux bras de l’interféromètre. La présence de la cavité permet d’amplifier l’effet du déplacement du miroir sur la lumière. D’autre part, pour mesurer les fluctuations de la quadrature de phase du champ réfléchi, il est nécessaire que l’intensité dans le bras de l’oscillateur local soit grande devant celle du faisceau envoyé dans la cavité.

2.2.3.2 Mesure quantique non destructive de l’intensité
La détection des ondes gravitationnelles à l’aide d’une barre de Weber est basée sur une mesure continue de la position du résonateur mécanique. Pour détecter une onde gravitationnelle, il faut mesurer la position du résonateur avec une grande précision, pendant le temps de passage de l’onde. Cette mesure se heurte à une limite fondamentale imposée par l’inégalité de Heisenberg. En effet, une mesure initiale de la position du résonateur avec une précision perturbe inévitablement son impulsion d’une quantité . Après une évolution libre pendant un temps , la position du résonateur présente une dispersion , où est la masse de la barre. Cette dispersion peut masquer l’effet du passage d’une onde gravitationnelle. Un compromis entre les deux mesures conduit à une limite quantique standard pour la précision d’une mesure de position du résonateur :
| (2.36) |
Il est cependant possible de s’affranchir de cette limite en utilisant une technique de mesure qui reporte tout le bruit de la mesure sur une grandeur découplée de l’évolution libre de l’observable à mesurer[3]. On peut par exemple mesurer l’énergie du résonateur mécanique sans perturber son évolution temporelle, le bruit associé à la mesure étant reporté sur la phase (grandeur conjuguée de l’énergie).
Ce concept de mesure quantique non destructive (Quantum Non Demolition Measurement) peut se généraliser à d’autres systèmes que les résonateurs mécaniques. La plupart des réalisations expérimentales ont d’ailleurs été effectuées en optique[4]. Deux critères doivent être satisfaits pour qualifier une mesure de QND. La mesure ne doit tout d’abord pas altérer l’observable à mesurer : l’excès de bruit lié à la mesure est reporté sur la composante conjuguée. Il faut de plus que le signal fourni par la mesure contienne le maximum d’informations sur l’observable mesurée, ce qui impose d’avoir de fortes corrélations quantiques entre l’appareil de mesure et l’observable mesurée.
Une cavité à miroir mobile devrait permettre de réaliser une mesure QND de l’intensité d’un faisceau lumineux[15]. Le principe de la mesure consiste à utiliser les corrélations quantiques qui existent entre l’intensité du faisceau incident et la position du miroir mobile de la cavité. On envoie simultanément deux faisceaux dans la cavité comme le montre la figure 13. Le premier faisceau, le faisceau signal dont on veut mesurer l’intensité, déplace le miroir sous l’effet de la pression de radiation. Le second faisceau, le faisceau de mesure, est beaucoup moins intense de façon à pouvoir négliger son influence sur le mouvement du miroir. Ce faisceau est cependant sensible au déplacement du miroir provoqué par le faisceau signal.

Pour satisfaire au premier critère QND, la mesure ne doit pas altérer l’intensité du signal. Ceci se produit lorsque le faisceau signal est à résonance avec la cavité : le point de fonctionnement de la cavité est alors au maximum du pic d’Airy, là où l’intensité du faisceau réfléchi n’est plus sensible à des petites variations de longueur de la cavité.
Le second critère QND impose un maximum de corrélations quantiques entre l’intensité du signal et le faisceau de mesure. Pour cela, on met également le faisceau de mesure à résonance avec la cavité, puisque la phase du faisceau réfléchi est alors la plus sensible aux variations de longueur de la cavité. L’efficacité de la mesure QND est alors caractérisée par les corrélations quantiques entre les fluctuations d’intensité du signal et les fluctuations de phase du faisceau de mesure. Ces fluctuations de phase peuvent être détectées à l’aide d’un système de mesure homodyne, comme celui présenté pour la mesure du bruit thermique du miroir mobile (section 2.2.3.1). Bien sûr, l’observation de ces corrélations quantiques nécessite de placer la cavité à basse température, de façon à rendre le bruit thermique négligeable par rapport aux effets de pression de radiation. Une étude détaillée de ce dispositif est présentée dans la partie 2.4.
2.3 Génération d’états comprimés par couplage optomécanique
L’existence de fluctuations quantiques est connue depuis le début de la mécanique quantique. Mais ce n’est que depuis une vingtaine d’années que les physiciens se sont trouvés confrontés aux limitations imposées par ces fluctuations sur la précision d’une mesure. Le développement des projets de détection des ondes gravitationnelles ont amené les physiciens à étudier le bruit quantique et ses conséquences sur la sensibilité d’une mesure. On s’est ainsi rendu compte que le bruit quantique standard ne constitue pas une limite fondamentale et qu’il est possible d’améliorer la sensibilité d’une mesure en utilisant des états comprimés[9].
Bien que le concept d’état comprimé soit tout à fait général, c’est dans le domaine de l’optique qu’a été menée la plupart des études expérimentales. Les mesures optiques présentent en effet des caractéristiques qui permettent d’atteindre le niveau quantique plus facilement que dans d’autres domaines. Les signaux optiques sont naturellement protégés des perturbations extérieures et la qualité des dispositifs optiques permet d’atteindre un bruit instrumental très faible.
De nombreuses mises en évidence expérimentales d’états comprimés ont été réalisées ces dernières années[2]. Des facteurs de réduction du bruit quantique de l’ordre de ont été obtenus aussi bien avec des oscillateurs paramétriques optiques [29] qu’avec des diodes laser[30]. La production d’un état comprimé est généralement basée sur une interaction non linéaire entre la lumière et un milieu matériel. Ces processus non linéaires sont obtenus par mélange à trois ou à quatre ondes (nonlinéarité de type ou ). Lorsqu’un milieu non linéaire de type est placé dans une cavité, la lumière subit un déphasage non linéaire puisque l’indice du milieu dépend de l’intensité de la lumière[13]. Le rôle principal joué par le milieu est donc de rendre la longueur optique de la cavité dépendante de l’intensité lumineuse. On peut obtenir le même effet en modifiant la longueur physique de la cavité. Nous nous proposons dans cette partie de montrer qu’une cavité vide dont un miroir est mobile permet de produire des états comprimés[14]. Après avoir décrit la configuration du système, nous déterminerons les équations de base liant les champs entrant et sortant en fonction du mouvement du miroir (sections 2.3.1 et 2.3.2). Nous analyserons ensuite les effets statiques (section 2.3.3) puis dynamiques (sections 2.3.4 et 2.3.5) du couplage optomécanique sur le champ sortant de la cavité.
2.3.1 Evolution du champ dans la cavité
Le système considéré est constitué d’une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie dans laquelle est envoyé un faisceau laser cohérent de fréquence . Le miroir d’entrée a une très grande réflectivité , avec . Il est de plus supposé sans perte, de sorte que sa transmission est égale à . On suppose que le miroir mobile est totalement réfléchissant et sans perte. Dans ces conditions, les pertes totales de la cavité sont uniquement dues à la transmission du miroir d’entrée et la finesse de la cavité est d’autant plus grande que est petit.
Nous nous limiterons dans cette partie à une description monodimensionnelle du champ et de la cavité. Le champ est traité comme une onde plane se propageant uniquement selon l’axe de la cavité (figure 14).

Chaque onde lumineuse peut être décrite par une amplitude complexe , qui est une fonction lentement variable du temps . La cavité est entièrement déterminée par sa longueur où est le déplacement du miroir mobile.
La conservation de l’énergie au niveau du miroir d’entrée entraîne l’existence de relations linéaires et unitaires entre les champs incident , réfléchi et les champs dans la cavité et (figure 14):
| (2.37a) | |||||
| (2.37b) | |||||
| La première relation montre que le champ intracavité est la somme du champ incident au même instant et du champ intracavité qui a effectué un aller et retour dans la cavité. La seconde relation signifie que le champ sortant résulte de l’interférence entre le champ incident directement réfléchi et le champ intracavité transmis par le miroir. | |||||
La propagation du champ dans la cavité permet de relier le champ revenant sur le miroir au champ :
| (2.38) |
est le temps moyen mis par la lumière pour parcourir un aller et retour dans la cavité () et est le déphasage subi par le champ:
| (2.39) |
où est le vecteur d’onde du champ. Pour écrire l’équation (2.38), nous avons négligé les effets de retard temporel subis par le champ[31] : pour des petits déplacements du miroir mobile, le champ est essentiellement déphasé d’une quantité , et la variation du temps avec la position du miroir peut être négligée.
Pour une cavité quasi résonnante et de grande finesse (, ), l’enveloppe du champ varie peu sur un tour. En combinant les équations (2.37) et (2.38), on obtient alors l’équation d’évolution du champ intracavité et l’expression du champ sortant:
| (2.40a) | |||||
| (2.40b) | |||||
| Ces équations sont identiques à celles obtenues pour une cavité usuelle à une seule entrée-sortie, avec toutefois un déphasage dépendant du déplacement : | |||||
| (2.41) |
où est le déphasage entre le champ et la cavité en absence de déplacement du miroir.
2.3.2 Mouvement du miroir mobile
Pour des petits déplacements, la théorie de la réponse linéaire[21] permet de relier la transformée de Fourier du déplacement à la force appliquée:
| (2.42) |
où est la susceptibilité mécanique du miroir. La force appliquée est la somme de la force due à la pression de radiation et de la force de Langevin décrivant le couplage du miroir avec un bain thermique. Comme nous l’avons vu dans la partie (2.1), la force de pression de radiation est proportionnelle à l’intensité du champ:
| (2.43) |
La force de Langevin a une valeur moyenne nulle et son spectre de bruit est relié à la susceptibilité mécanique par le théorème fluctuation-dissipation[21]:
| (2.44) |
où est la température du bain thermique et la constante de Boltzmann.
2.3.3 Etat stationnaire et bistabilité
Les valeurs moyennes des champs et du déplacement du miroir mobile s’obtiennent en considérant le régime stationnaire dans les équations d’évolution précédentes. Ainsi le déplacement moyen est donné par l’équation (2.42) à fréquence nulle :
| (2.45) |
où est l’intensité moyenne du champ intracavité. Le déphasage moyen du champ dans la cavité est alors donné par l’équation (2.41):
| (2.46) |
où est le déphasage non linéaire lié au déplacement du miroir sous l’effet de la pression de radiation moyenne:
| (2.47) |
Ces relations montrent que l’effet de la pression de radiation moyenne correspond à un effet Kerr, comme celui produit par un milieu non linéaire de type placé dans une cavité : le champ dans la cavité subit un déphasage proportionnel à son intensité moyenne . Comme nous le verrons par la suite, le déphasage non linéaire est le paramètre essentiel pour décrire l’amplitude des effets optomécaniques : le couplage optomécanique agit de façon appréciable sur les fluctuations quantiques lorsque le déphasage non linéaire est de l’ordre des pertes de la cavité.
La valeur moyenne des champs s’obtient en posant dans l’équation (2.40a):
| (2.48a) | |||||
| (2.48b) | |||||

Si l’on oublie la variation du déphasage total avec l’intensité intracavité, on retrouve ici les expressions usuelles des champs pour une cavité Fabry-Perot à une seule entrée-sortie. La cavité étant supposée sans perte, le champ réfléchi a la même intensité que le champ incident (équation 2.48b). Le champ subit simplement un déphasage qui se traduit par une rotation dans l’espace des phases, avec un angle qui dépend de . L’intensité intracavité est donnée par le module carré de l’équation (2.48a). Il apparaît une résonance Lorentzienne autour de . La largeur de ce pic d’Airy est égale à et l’intensité intracavité à résonance est égale à l’intensité incidente , amplifiée par un facteur . On déduit de ces résultats l’expression de la finesse de la cavité :
| (2.49) |
Notons enfin que tous les champs sont définis à une phase globale près. Dans toute la suite, on choisira cette phase de telle manière que le champ intracavité soit réel. Si l’on tient compte de la variation du déphasage avec l’intensité intracavité, la présence du déphasage non linéaire entraîne une déformation du pic d’Airy. La figure 15a montre comment varie l’intensité intracavité lorsque le déphasage est balayé, par exemple en modifiant la fréquence optique du faisceau incident. Cet effet est responsable du comportement bistable de la cavité[10] : pour certaines valeurs du déphasage, il existe plusieurs solutions pour l’intensité intracavité.
Le phénomène de bistabilité peut se comprendre de la façon suivante. Lorsqu’on balaye la fréquence du faisceau incident de manière à augmenter , l’intensité suit la branche basse de la résonance jusqu’à atteindre le point tournant . A partir de ce point, l’intensité augmente brusquement et passe sur la branche haute. Lorsqu’on balaye dans le sens inverse, l’intensité suit d’abord la branche haute de la résonance jusqu’à atteindre le second point tournant , à partir duquel l’intensité chute brusquement pour passer sur la branche basse. On obtient ainsi un cycle d’hystérésis caractéristique des systèmes bistables.
On peut aussi observer la bistabilité en faisant varier l’intensité incidente , pour un déphasage fixé (figure 15b). L’intensité est en effet solution d’une équation du troisième degré que l’on obtient à partir des équations (2.46) à (2.48a) :
| (2.50) |

Cette relation montre qu’il peut exister, pour une valeur donnée de l’intensité incidente, trois solutions stationnaires de l’intensité intracavité. L’une des solutions se trouve sur la branche instable qui relie les deux points tournants de la courbe de bistabilité[10]. Un raisonnement similaire à celui fait pour la figure (15a), montre que le système parcourt un cycle d’hystérésis lorsqu’on fait varier l’intensité incidente. Cette bistabilité d’origine mécanique a déjà été observée expérimentalement[11]. Le montage utilisé dans cette expérience était constitué d’une cavité de finesse dont l’un des miroirs es déposé sur une plaque en quartz, pesant et suspendue par deux fils en tungstène. La fréquence de résonance mécanique de ce pendule est de l’ordre de quelques Hertz. La figure 16 montre le cycle d’hystérésis observé expérimentalement, en faisant varier la puissance incidente . L’axe vertical représente la puissance de la lumière résiduelle transmise par le second miroir de la cavité. Cette puissance est directement proportionnelle à l’intensité intracavité. Dans cette expérience, les points tournants de la bistabilité correspondent à des puissances incidentes de et .
2.3.4 Evolution des fluctuations quantiques
Pour étudier les fluctuations quantiques, nous utilisons la méthode semi-classique dont les principes ont été exposés dans la partie 2.2[24]. Elle consiste à écrire le champ sous la forme où est la valeur moyenne du champ et est une variable aléatoire classique, associée aux fluctuations quantiques par l’intermédiaire de la distribution de Wigner. Plus précisément, la distribution de Wigner pour un champ dépendant du temps est une fonction d’un ensemble de variables et , qui sont les transformées de Fourier des variables et :
| (2.51a) | |||||
| (2.51b) | |||||
| Notons que n’est pas le complexe conjugué de , puisque les deux variables évoluent à la même fréquence . On a en fait la relation: | |||||
| (2.52) |
La distribution de Wigner pour un état cohérent est une Gaussienne dont la largeur est définie par les valeurs moyennes[24]:
| (2.53) |
Les principes de la méthode semi-classique présentés dans la partie 2.2 se généralisent alors pour un champ dépendant du temps. Une quadrature quelconque du champ est définie par ses composantes spectrales , reliées aux variables et par une relation similaire à (2.28):
| (2.54) |
Le bruit de cette quadrature n’est plus défini par une variance mais par un spectre :
| (2.55) |
A partir des relations (2.53), on retrouve que pour un état cohérent, le spectre est égal à quelque soit l’angle .
Les bruits d’intensité et de phase sont toujours reliés aux quadratures d’amplitude et de phase , où est la phase du champ moyen:
| (2.56a) | |||||
| (2.56b) | |||||
| Pour un état cohérent, ces bruits sont indépendants de la fréquence et ne dépendent que de l’intensité moyenne : | |||||
| (2.57) |
Ces différentes relations permettent d’associer une représentation semi-classique aux fluctuations quantiques. Comme dans le cas d’un champ indépendant du temps, l’évolution de ces fluctuations depuis l’entrée jusqu’à la sortie de la cavité est obtenue en linéarisant les équations classiques autour du point de fonctionnement moyen. A partir des équations (2.40) à (2.42), on trouve pour la cavité à miroir mobile:
| (2.58a) | |||||
| (2.58b) | |||||
| (2.58c) | |||||
| où est la susceptibilité normalisée à à fréquence nulle. On peut éliminer les variables et dans ce système d’équations. On obtient alors une relation d’entrée-sortie pour les fluctuations, qui donne les fluctuations sortantes en fonction des fluctuations entrantes et : | |||||
| (2.59) |
où les coefficients , et dépendent des paramètres du système
| (2.60a) | |||||
| (2.60b) | |||||
| (2.60c) | |||||
| avec: | |||||
| (2.61) |
2.3.5 Spectre de bruit quantique
La relation d’entrée-sortie des fluctuations établie dans la section précédente (équation 2.59) permet de relier le spectre pour n’importe quelle quadrature du champ réfléchi aux fluctuations entrantes et . Ces fluctuations étant indépendantes, tous les termes croisés du type sont nuls. On suppose d’autre part que le champ incident est dans un état cohérent. Les fluctuations incidentes sont alors caractérisées par les fonctions de corrélations d’ordre deux données par les équations (2.53). Enfin, la force de Langevin est caractérisée par le spectre de bruit thermique (équation 2.44). On obtient alors:
| (2.62) |
où les quantités et s’expriment en fonction des coefficients , , et
| (2.63a) | |||||
| (2.63b) | |||||
| Cette expression permet de déterminer le spectre de n’importe quelle quadrature du champ sortant. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au bruit d’intensité et au spectre de bruit optimum. Ce dernier correspond au spectre obtenu en choisissant, à chaque fréquence , la quadrature qui a le bruit minimum. | |||||
Les fluctuations d’intensité sont reliées à la quadrature d’amplitude (équation 2.56a):
| (2.64) |
où est la phase moyenne du champ sortant, donnée par:
| (2.65) |
A partir des équations (2.62) et (2.63), on obtient alors:
| (2.66) |
Les quantités et sont données par:
| (2.67a) | |||||
| (2.67b) | |||||
| où et sont respectivement les parties réelle et imaginaire de la susceptibilité normalisée . | |||||
Lorsque et sont nuls, comme c’est le cas à fréquence nulle, le spectre de bruit d’intensité est égal à l’intensité moyenne , c’est-à-dire au bruit quantique standard. Le fait que le bruit d’intensité n’est pas modifié à fréquence nulle peut se comprendre à partir de la représentation de la distribution de Wigner dans l’espace des phases (figure 9, page 9). Chaque point de la distribution du faisceau incident subit en effet une rotation autour de l’origine, et la projection de la distribution sur l’axe du champ moyen n’est pas modifiée. La conservation de la distribution en intensité à fréquence nulle est liée à la conservation du nombre de photons sur des temps longs par rapport au temps de stockage de la cavité.
A fréquence non nulle, et sont en général non nuls, et le bruit de photon du champ réfléchi n’est plus égal au bruit quantique standard. On peut remarquer que et sont proportionnels au rapport entre le déphasage non linéaire et les pertes de la cavité : le bruit de photon n’est modifié de manière appréciable que si ce rapport est de l’ordre de . D’autre part, le paramètre est associé au bruit thermique du miroir mobile et il est toujours positif : le mouvement Brownien du miroir mobile induit toujours une augmentation du bruit de photon du faisceau réfléchi par la cavité. Par contre, le paramètre peut être négatif, si le désaccord est négatif. Comme nous allons le montrer, on peut alors trouver des conditions de fonctionnement pour lesquels le bruit de photon est réduit en-dessous du bruit quantique standard. Pour cela, nous allons nous placer dans le cas simple où le mouvement du miroir est harmonique. La susceptibilité mécanique est alors donnée par la relation (2.11).
2.3.5.1 Réduction du bruit de photon à température nulle
Nous supposons que le miroir mobile est caractérisé par les mêmes paramètres que dans la partie 2.1 : fréquence de résonance mécanique , masse et facteur de qualité . Nous supposons d’autre part que la cavité a une finesse (soit ) et une bande passante égale à . L’efficacité de la compression du champ dépend beaucoup de l’écart entre le point de fonctionnement de la cavité et les points tournants de la bistabilité. C’est en effet au voisinage de ces points tournants que les effets non linéaires, responsables de la modification du bruit quantique, sont les plus importants. On peut montrer que le bruit de photon à basse fréquence est directement proportionnel à la pente de la courbe de bistabilité, pente qui s’annule aux points tournants (voir courbe 15b, page 15)[12]. A partir de l’équation (2.50), on peut exprimer cette pente en fonction du point de fonctionnement de la cavité (déphasage et déphasage non linéaire ):
| (2.68) |
La pente peut s’annuler pour des valeurs positives du déphasage non linéaire à condition que le déphasage soit inférieur à . On choisit donc un déphasage égal à . Dans ces conditions, les deux points tournants de la bistabilité (points et de la figure 15b) correspondent à des déphasages non linéaires égaux à et . On choisit alors un point de fonctionnement situé sur la branche basse de la courbe de bistabilité, au voisinage du point tournant , en prenant . En d’autres termes, la pression de radiation moyenne exercée sur le miroir mobile déplace celui-ci d’une quantité égale à la moitié de la largeur de la résonance, soit environ .
Le choix du déphasage et du déphasage non linéaire fixe le point de fonctionnement sur la courbe de bistabilité (croix sur la figure 15). On peut aussi définir le point de fonctionnement par le déphasage global , égal à . Ces paramètres correspondent à une puissance lumineuse incidente que l’on peut déduire des équations (2.47) et (2.48a):
| (2.69) |
Avec les paramètres choisis, on trouve une puissance incidente de ().
Le spectre d’intensité et le spectre optimum obtenus à température nulle sont représentés sur la figure 17.

On peut distinguer deux domaines de fréquences : à basse fréquence () et au voisinage de la résonance mécanique (). A basse fréquence, le comportement du système est similaire à celui d’un milieu Kerr idéal placé dans une cavité[12]. Dans cette plage de fréquence, la susceptibilité mécanique peut en effet être considérée comme constante et égale à sa valeur statique . Le déphasage non linéaire subi par le champ est alors tout à fait équivalent à celui produit par un milieu Kerr idéal.
On peut comprendre le comportement des spectres de la figure 17 à l’aide de la représentation de la distribution de Wigner dans l’espace des phases. La figure 18 montre l’évolution avec la fréquence de la distribution du champ réfléchi, depuis la fréquence nulle (ellipse noire), jusqu’à une fréquence voisine de la bande passante de la cavité (ellipse blanche). Le premier effet est une diminution de l’excentricité de l’ellipse lorsque la fréquence augmente. La cavité se comporte en effet comme un filtre passe bas pour les fluctuations, et l’efficacité de la non linéarité diminue au fur et à mesure que la fréquence augmente. Le bruit optimum , qui est en fait relié à la longueur du petit axe de l’ellipse, croît avec la fréquence.
Le second effet est une rotation de l’ellipse avec la fréquence. Le petit axe de l’ellipse peut alors devenir parallèle au champ moyen (ellipse grise sur la figure 18). Ainsi le bruit d’intensité, qui est relié à la projection de la distribution sur le champ moyen, est réduit pour des fréquences non nulles : partant du bruit quantique standard à fréquence nulle, le bruit de photon diminue jusqu’à rejoindre le bruit optimum. Pour des fréquences supérieures, le petit axe n’est plus aligné avec le champ moyen et le bruit de photon remonte au dessus du bruit optimum.

A haute fréquence (), les deux spectres rejoignent le bruit quantique standard, puisque la distribution tend vers un disque identique à la distribution du champ incident. Ce comportement est toutefois perturbé au voisinage de la résonance mécanique (), où la dynamique du miroir mobile joue un rôle important. Dans cette région, le bruit optimum est plus réduit qu’avec un milieu Kerr idéal. Cependant le spectre d’intensité présente un fort excès de bruit.
2.3.5.2 Effets du bruit thermique
A température non nulle, le bruit thermique du miroir mobile agit sur les fluctuations quantiques du champ. On peut voir sur l’expression du bruit d’intensité (paramètre dans l’équation 2.66), mais aussi sur l’expression générale du spectre (dernier terme dans l’équation 2.62), que le bruit thermique augmente toujours le bruit du faisceau réfléchi.
En utilisant l’expression du spectre de bruit thermique (équation 2.44), on montre que la contribution du bruit thermique au spectre d’intensité est donnée par :
| (2.70) |
où représente le nombre de phonons thermiques à la fréquence de résonance mécanique :
| (2.71) |
Pour minimiser les effets du bruit thermique, il est nécessaire de se placer à basse température et d’utiliser un oscillateur mécanique ayant un grand facteur de qualité . La figure 19 montre l’effet du bruit thermique sur le spectre de bruit d’intensité du champ sortant, à des températures de et .

Pour des températures très basses, inférieures à , l’excès de bruit à basse fréquence reste modéré puisque le bruit de photon est toujours réduit en dessous du bruit quantique standard. Cependant le bruit thermique masque complètement les effets quantiques dès que la température s’élève : à une température aussi basse que , le bruit du faisceau réfléchi est largement au dessus du bruit de photon standard.
Il est donc nécessaire d’optimiser les paramètres du système de façon à réduire l’influence du bruit thermique. L’équation (2.71) montre que le bruit thermique est inversement proportionnel à la fréquence de résonance mécanique . On peut réduire les effets du bruit thermique en augmentant cette fréquence. Ceci ne peut être fait avec un système pendulaire, mais plutôt en utilisant un résonateur mécanique, comme par exemple les résonateurs piézoélectriques en quartz. De tels résonateurs ont des fréquences de résonance mécanique bien supérieures à .

La figure 20 montre les spectres de bruit obtenus pour une fréquence de résonance égale à , les autres paramètres étant identiques à ceux de la figure 19 (, ). Le bruit thermique est essentiellement concentré au voisinage de la résonance mécanique. A basse fréquence, l’excès de bruit reste modéré même à une température de .
Augmenter la fréquence de résonance permet donc de rendre les effets quantiques dominants devant les effets thermiques pour des températures raisonnables. Notons cependant que cela présente plusieurs inconvénients. Tout d’abord, il est nécessaire d’augmenter dans les mêmes proportions la bande passante de la cavité de façon à limiter l’effet de filtrage produit par celle-ci. Etant donné les finesses mises en jeu, cela impose de construire une cavité très courte, de l’ordre de de longueur. D’autre part, pour conserver la condition , il est nécessaire de diminuer la masse du résonateur et d’augmenter l’intensité lumineuse (voir équation 2.69). Pour un résonateur de masse égale à , la puissance incidente doit être de l’ordre de .
2.4 Mesures de petits déplacements
A l’aide des résultats obtenus dans la partie précédente, nous pouvons à présent mener une étude plus détaillée de la limite de sensibilité lors d’une mesure de déplacement du miroir de la cavité. Nous commencerons cette partie en établissant de manière générale l’expression de la sensibilité optimale du dispositif (section 2.4.1). Nous appliquerons ensuite le résultat obtenu à la mesure du bruit thermique du miroir mobile (section 2.4.2) et nous présenterons les spectres de bruit pour deux modèles de dissipation thermique. Nous terminerons cette partie par une étude du dispositif permettant de réaliser une mesure quantique non destructive de l’intensité d’un faisceau lumineux (section 2.4.3).
2.4.1 Sensibilité optimale d’une mesure optique de déplacement
Nous avons vu dans les sections 2.2.1 et 2.2.3 que la phase du champ réfléchi par la cavité est sensible aux déplacements du miroir mobile. Cette sensibilité atteint son maximum lorsque le faisceau est à résonance avec la cavité. Les champs moyens intracavité et réfléchi sont alors donnés par les équations (2.48) avec :
| (2.72) |
Le champ intracavité étant choisi réel, on en déduit qu’à résonance tous les champs sont réels et le champ réfléchi est égal au champ incident.
Nous supposons que le miroir est soumis à une variation de position . Nous allons maintenant déterminer comment ce déplacement se traduit sur le spectre du faisceau réfléchi par la cavité. Nous nous intéresserons dans la suite aux deux composantes d’amplitude et de phase du champ , que l’on notera respectivement et . Dans le cas d’un champ réel, l’amplitude et la phase s’identifient aux deux quadratures et définies dans la section 2.2.2:
| (2.73) |
En substituant le déphasage du champ intracavité par dans les équations (2.58a) et (2.58b), on obtient les fluctuations des champs intracavité et réfléchi en fonction des fluctuations du champ incident et de la position du miroir mobile:
| (2.74a) | |||||
| (2.74b) | |||||
| (2.74c) | |||||
| (2.74d) | |||||
| Les équations (2.74a) et (2.74c) montrent qu’à résonance, les fluctuations d’amplitude ne sont couplées ni aux fluctuations de phase, ni aux variations de position du miroir. En particulier, le spectre de bruit d’amplitude du faisceau réfléchi est égal au spectre de bruit incident : | |||||
| (2.75) |
Pour un champ incident cohérent, le champ réfléchi a donc un spectre de bruit d’amplitude égal à , c’est à dire un spectre de bruit d’intensité égal au bruit quantique standard (équation 2.64). Nous verrons dans la section 2.4.3 que la relation (2.75) est indispensable si l’on veut réaliser une mesure quantique non destructive.
Par contre, les fluctuations de phase en sortie sont liées non seulement au bruit de phase incident mais aussi aux variations de position du miroir (équation 2.74d). Pour déterminer le spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi, il est nécessaire de faire des hypothèses supplémentaires sur les corrélations entre les variations de position du miroir et les fluctuations de phase du champ incident. Nous supposons ici que ces fluctuations sont décorrélées. Nous verrons que cette hypothèse est justifiée dans les deux configurations que nous étudions (mesure du bruit thermique du miroir, mesure QND de l’intensité). On obtient alors l’expression suivante pour le spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi:
| (2.76) |
où est le spectre de bruit de phase du champ incident, égal à pour un état cohérent, et désigne le spectre de position du miroir mobile. Le spectre de phase en sortie apparaît donc comme la somme d’un terme de ”bruit”, égal au bruit de la composante de phase du champ incident, et d’un ”signal”, lié au spectre des déplacements du miroir, et filtré par la bande passante de la cavité.
On peut à présent donner une estimation de la sensibilité d’une mesure de position. est l’amplitude de bruit de position du miroir qui fournit un signal du même ordre de grandeur que le bruit (rapport signal à bruit égal à ). Pour un faisceau incident cohérent () et des fréquences petites devant la bande passante de la cavité (), on obtient une relation qui donne, en , le plus petit déplacement détectable du miroir mobile:
| (2.77) |
On retrouve ici l’expression obtenue à partir de raisonnements physiques simples dans la partie 2.2 (équation 2.35, page 2.35). On obtient ainsi une sensibilité optimale pour une finesse et une puissance incidente .
Notons enfin que nous avons supposé que le mouvement du miroir est décorrélé des fluctuations de phase du faisceau incident. Si ce n’est pas le cas, il est possible de réduire le bruit du faisceau réfléchi en produisant un état comprimé comme nous l’avons montré dans la partie 2.3. Ceci peut permettre d’augmenter encore la sensibilité de la mesure. Nous reviendrons sur ce point dans la section 2.4.3.3.
2.4.2 Mesure du bruit thermique
Nous nous proposons dans cette section de montrer que la sensibilité de la cavité est suffisante pour mesurer le spectre des fluctuations thermiques du miroir. Afin d’obtenir une expression analytique du spectre, nous nous placerons dans le cas simple où le mouvement du miroir est décrit par un oscillateur harmonique amorti et nous présenterons deux modèles d’amortissement : l’amortissement visqueux et l’amortissement interne. Nous donnerons l’allure des spectres de bruit qui correspondent à chacun de ces deux modèles. Nous nous placerons à température ambiante et nous supposerons l’intensité incidente suffisamment faible pour pouvoir négliger les effets de pression de radiation sur le miroir mobile : le déplacement du miroir correspond au mouvement Brownien associé au couplage avec le bain thermique. Ce déplacement est donc décorrélé des fluctuations du champ incident et le spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi est donné par l’équation (2.76).
2.4.2.1 Théorème fluctuation-dissipation
Les fluctuations de position liées au bruit thermique peuvent être décrites à l’aide d’une force de Langevin appliquée au miroir mobile. Les fluctuations de position sont alors égales au produit de la susceptibilité par la force de Langevin, dont le spectre de bruit est donné par le théorème fluctuation-dissipation (équation 2.44). Le spectre des fluctuations thermiques de position du miroir s’écrit alors:
| (2.78) |
Le théorème fluctuation-dissipation permet de relier le spectre de bruit thermique du miroir à la partie dissipative (partie imaginaire) de la susceptibilité qui décrit l’amortissement. Malheureusement, il n’existe pas de modèle théorique satisfaisant capable de décrire l’ensemble des effets de dissipation thermique dans les solides. Nous allons dans la suite considérer le cas d’un miroir harmonique amorti, ce qui nous permettra de donner une expression simple du spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi.
2.4.2.2 Oscillateur harmonique amorti : amortissements visqueux et interne
L’équation qui régit le mouvement d’un oscillateur harmonique libre de masse , ayant une force de rappel égale à , s’écrit:
| (2.79) |
où est une force extérieure appliquée à l’oscillateur harmonique. La dynamique de ce dernier est alors décrite par la susceptibilité mécanique :
| (2.80) |
où la fréquence de résonance est définie par . Lorsque l’oscillateur harmonique est faiblement couplé à son environnement, il est nécessaire de rajouter à la susceptibilité un terme imaginaire pour tenir compte de l’amortissement issu de ce couplage. La susceptibilité d’un oscillateur harmonique amorti peut donc s’écrire sous la forme:
| (2.81) |
où est une fonction a priori quelconque de la fréquence, qui doit néanmoins s’annuler à fréquence nulle car la susceptibilité est réelle. On supposera dans la suite que l’amortissement est faible, c’est à dire que est petit devant . En comparant les dénominateurs des deux expressions (2.80) et (2.81), on voit qu’il suffit de rajouter un terme imaginaire à la constante de raideur de l’oscillateur libre pour tenir compte de la dissipation:
| (2.82) |
Si on applique à l’oscillateur harmonique une force sinusoïdale, on montre alors que est lié à la fraction d’énergie dissipée durant chaque cycle, d’où l’appellation usuelle d’angle de perte pour . Notons aussi que dans le cas où l’angle de perte varie peu au voisinage de la résonance mécanique, on peut relier l’angle de perte à résonance au facteur de qualité :
| (2.83) |
La dépendance en fréquence de l’angle de perte n’est pas simple à déterminer car elle dépend des nombreux processus de dissipation qui se manifestent lorsqu’un corps est couplé à son environnement. Si l’on considère, par exemple, un miroir mobile fixé à un système pendulaire, le mouvement harmonique du pendule est amorti de la même manière qu’une particule Brownienne plongée dans un liquide : le pendule est soumis à une force de friction proportionnelle à sa vitesse. Ceci revient à rajouter au dénominateur de la susceptibilité une partie imaginaire proportionnelle à la fréquence. Dans le cadre de ce modèle d’amortissement visqueux[32], l’angle de perte est donc une fonction linéaire de la fréquence:
| (2.84) |
Ce modèle ne permet pas cependant de décrire de façon satisfaisante la dissipation dans un solide. Plusieurs processus de dissipation peuvent coexister dans un solide. Citons par exemple la dissipation thermoélastique qui est due aux effets couplés des déformations et des gradients de température. Lors d’une excitation d’un mode de vibration interne, les zones dilatées du solide se refroidissent et les zones contractées se réchauffent. La thermalisation entre ces régions entraîne un effet de dissipation. Un autre type de dissipation est lié à la propagation de dislocations dues à la présence d’impuretés dans le solide. Ces impuretés absorbent une partie de l’énergie apportée par une excitation d’un mode de vibration interne du solide. On peut enfin citer la dissipation par pertes de recul qui est due au contact du solide avec son support. En général la masse du support n’est pas infinie et une partie de l’énergie stockée dans le solide peut être dissipée sous forme d’une excitation du support. Il existe encore d’autres processus de dissipation, et la diversité de ces processus rend difficile l’identification de la source principale de dissipation pour un matériau ou pour une géométrie donnée d’un solide.
Les modèles théoriques actuels ne permettent donc pas de décrire de façon complète les différent processus de dissipation. Il existe cependant une approximation raisonnable, basée sur des résultats expérimentaux, qui consiste à décrire l’ensemble des processus de dissipation par un angle de perte qui varie peu avec la fréquence[33]. Un modèle simple basé sur la théorie anélastique dans les solides décrit assez bien ce comportement de la dissipation[34]. Cette approximation prédit donc un angle de perte constant sur une large bande de fréquence, et égal d’après l’équation (2.83) à:
| (2.85) |
2.4.2.3 Spectre de bruit thermique
Pour un oscillateur harmonique amorti, il est possible d’exprimer de manière simple le spectre de bruit de phase du champ réfléchi . En utilisant les relations (2.76), (2.78) et (2.81) on trouve:
| (2.86) |
On obtient une expression qui ressemble beaucoup à celles obtenues dans la partie précédente, telles que l’équation (2.70) qui décrit la contribution du bruit thermique au spectre d’intensité du faisceau réfléchi. On retrouve ici les mêmes paramètres : le rapport entre le déphasage non linéaire et les pertes de la cavité, et le rapport entre le nombre de phonons thermiques et le facteur de qualité . Ces deux paramètres fixent l’amplitude globale de la contribution du bruit thermique au bruit de phase du faisceau réfléchi. La dépendance en fréquence est pour l’essentiel liée à la susceptibilité normalisée et à un terme de filtrage dû à la bande passante de la cavité. Le dernier paramètre fait intervenir explicitement l’angle de perte et dépend crucialement du modèle de dissipation choisi.

La figure 21 montre les spectres de bruit obtenus à température ambiante pour les deux modèles de dissipation (amortissement visqueux et constant). Les paramètres sont identiques à ceux choisis dans la partie précédente (fréquence de résonance , masse , facteur de qualité , finesse de la cavité ). Pour pouvoir négliger les effets de pression de radiation devant les effets thermiques, le déphasage non linéaire est égal à ce qui correspond à une puissance incidente de (équation 2.69). Enfin la bande passante de la cavité est choisie égale à de façon à réduire l’effet de filtrage du bruit thermique.
Du fait de la très grande dynamique du bruit thermique (le terme dans l’équation (2.86) prend des valeurs comprises entre à basse fréquence et à résonance), les spectres sont représentés en échelle logarithmique (décibel). L’axe vertical représente et la valeur correspond au bruit de photon standard (). On voit que le bruit thermique est essentiellement concentré au voisinage de la résonance mécanique. Il est toutefois possible d’observer le bruit thermique même très loin de la résonance mécanique, puisqu’à basse fréquence le niveau de bruit est supérieur d’au moins par rapport au bruit de photon. Notons que les techniques de mesure homodyne permettent de mesurer des écarts par rapport au bruit de photon standard avec une précision de l’ordre de .
On voit que les deux modèles de dissipation se distinguent l’un de l’autre au niveau des ailes de la résonance : à basse fréquence, le modèle visqueux prévoit un ”fond” de bruit thermique beaucoup plus faible que le modèle constant. Il apparaît ainsi qu’une cavité à miroir mobile atteint une sensibilité suffisante pour étudier quantitativement le niveau et la distribution spectrale du bruit thermique du miroir mobile.
2.4.3 Mesure quantique non destructive de l’intensité lumineuse
Nous avons montré dans la partie précédente que le spectre de phase d’un faisceau interagissant avec la cavité de manière résonnante reproduit le bruit thermique du miroir mobile lorsque ce dernier est à température ambiante. On peut donc penser utiliser cette grande sensibilité pour sonder le mouvement du miroir mobile lorsqu’il est soumis à une force extérieure autre que la force de Langevin. Cette force extérieure peut être produite par les fluctuations quantiques de la pression de radiation d’un second faisceau (faisceau signal) qui interagit aussi avec la cavité (voir figure 13, page 13).
Pour un faisceau signal suffisamment intense, le mouvement du miroir reproduit les fluctuations d’intensité du faisceau. On crée ainsi des corrélations quantiques entre l’intensité du faisceau signal et la phase du faisceau de mesure. Nous avons vu dans la section 2.2.3.2 que ce système permet de réaliser une mesure QND de l’intensité sous certaines conditions. Il faut d’une part que les deux faisceaux soient résonnants avec la cavité et d’autre part que toutes les sources de bruit telles que le bruit thermique et le bruit de pression de radiation du faisceau de mesure soient négligeables devant les fluctuations de la pression de radiation du faisceau signal.
Nous allons dans cette section étudier en détail ce dispositif. Nous examinerons successivement les deux critères d’une mesure QND, à savoir les perturbations induites par la mesure sur le faisceau signal et les corrélations entre les faisceaux signal et mesure. La fin de la section est consacrée à une situation particulière où le faisceau de mesure, tout en assurant la détection de l’intensité du faisceau signal, est comprimé par la cavité.
2.4.3.1 Perturbations du faisceau signal
Les faisceaux signal et mesure étant résonnants avec la cavité, leurs quadratures d’amplitude et de phase vérifient les relations établies au début de cette partie (équations 2.72 et 2.74). On trouve en particulier que les quadratures d’amplitude ne sont pas modifiées : une cavité résonnante se comporte comme un dispositif transparent pour l’intensité du champ. Aussi bien l’intensité moyenne que le spectre de bruit d’intensité du faisceau signal ne sont pas modifiés par la cavité:
| (2.87) |
L’appareil de mesure ne perturbe donc pas le signal mesuré. En fait, tout le bruit de la mesure est reporté sur la variable conjuguée, c’est à dire la quadrature de phase du champ réfléchi. On trouve en effet à partir des équations (2.74) que les quadratures des deux champs signal et mesure vérifient la relation:
| (2.88) |
Le déplacement du miroir dépend de la présence des deux champs dans la cavité. Le miroir est soumis à trois forces : les forces de pression de radiation de chacun des deux champs et la force de Langevin associée au bruit thermique. Le mouvement du miroir est donc décrit par la relation:
| (2.89) |
Les quantités représentent les fluctuations d’intensité des deux champs intracavité (équation 2.56a). Nous avons supposé d’autre part que les deux champs intracavité n’interfèrent pas entre eux, par exemple en choisissant des polarisations orthogonales. A partir de l’équation (2.74a), on peut relier le déplacement du miroir aux fluctuations incidentes et :
| (2.90) |
et sont les déphasages non linéaires produits respectivement par les pressions de radiation moyennes des faisceaux signal et mesure (équation 2.47):
| (2.91) |
Les relations (2.88) et (2.90) montrent que les quadratures de phase des faisceaux réfléchis sont modifiées par la cavité. En ce qui concerne le faisceau de mesure, cela correspond au processus même de mesure, puisque cela conduit à des corrélations entre le signal et la phase du faisceau de mesure. Pour le faisceau signal, ces relations traduisent la perturbation provoquée par le processus de mesure : tout le bruit est reporté sur la phase du faisceau réfléchi. Le dispositif est donc non destructif pour l’intensité du faisceau signal.
2.4.3.2 Corrélations signal-mesure
L’efficacité quantique de la mesure dépend du niveau de corrélation entre les fluctuations de la quadrature de phase du faisceau de mesure réfléchi et les fluctuations d’amplitude du faisceau signal incident. A partir des équations (2.88) et (2.90), on voit apparaître dans l’expression de un terme en qui est à l’origine de ces corrélations. Les autres termes apparaissent comme des sources de bruit qui tendent à réduire l’efficacité de la mesure. Le premier terme de l’équation (2.88) correspond au bruit de phase du faisceau de mesure incident. Les deux derniers termes de l’équation (2.90) décrivent les bruits liés au mouvement du miroir mobile sous l’effet des fluctuations de la pression de radiation du faisceau de mesure et des fluctuations thermiques.
Nous allons à présent estimer l’efficacité de la mesure en exprimant la fonction de corrélation entre l’intensité du signal et la phase du faisceau de mesure. Cette fonction de corrélation est définie par:
| (2.92) |
La fonction varie de lorsque les fluctuations ne sont pas corrélées, à pour des fluctuations parfaitement corrélées. Puisque les champs incidents sont dans des états cohérents, toutes les sources de bruit qui apparaissent dans l’expression de sont indépendantes, avec un spectre de bruit égal à pour les champs incidents et à pour les fluctuations thermiques (équation 2.44). Le spectre des fluctuations de phase du faisceau de mesure réfléchi et la fonction de corrélation peuvent ainsi s’écrire sous la forme:
| (2.93a) | |||||
| (2.93b) | |||||
| où le ”signal” décrit la contribution des fluctuations d’intensité du signal et celle des différentes sources de bruit: | |||||
| (2.94a) | |||||
| (2.94b) | |||||
Les relations(2.93) montrent que la fonction est égale à la contribution relative du signal au spectre total du faisceau de mesure. Le signal est proportionnel au produit des intensités moyennes des deux champs (terme ) alors que le bruit ne dépend pas de . On peut donc obtenir des corrélations arbitrairement grandes en prenant un faisceau signal suffisamment intense. On retrouve dans l’expression du bruit la contribution des trois sources de bruit qui interviennent dans le processus de mesure. Le premier terme est associé au bruit quantique standard du faisceau de mesure incident et les deux derniers termes sont associés aux fluctuations de position du miroir dues respectivement au bruit de pression de radiation du faisceau de mesure et au bruit thermique.
La figure 22 montre l’évolution en fréquence de la fonction de corrélation, en supposant que le mouvement du miroir peut être décrit par un oscillateur harmonique et pour des paramètres similaires à ceux choisis pour la mesure du bruit thermique (fréquence de résonance , masse , facteur de qualité , finesse de la cavité , bande passante de la cavité ). Afin de réduire les sources de bruit, on suppose la température égale à (nombre de phonons thermiques ). Les corrélations sont d’autant plus importantes que le faisceau signal est intense. On choisit donc un déphasage non linéaire pour le signal égal à . Les corrélations dépendent aussi de l’intensité du faisceau de mesure. Si le déphasage non linéaire est trop petit, le bruit de phase du faisceau de mesure (terme dans ) devient dominant devant le signal, qui est proportionnel à . Par contre, si est trop grand, la pression de radiation du faisceau de mesure (terme en dans ) n’est plus négligeable, ce qui conduit à une diminution des corrélations. La figure 22 a été tracée pour un déphasage égal à . Pour une masse de , ces déphasages correspondent à des puissances incidentes de pour le faisceau signal et de pour le faisceau de mesure.

Les corrélations signal-mesure reproduisent la dépendance en fréquence de la réponse mécanique du miroir. Elles sont maximales à résonance, où des valeurs supérieures à sont atteintes. On voit d’autre part que la largeur des corrélations est beaucoup plus grande que la largeur de la résonance mécanique. Ceci peut s’expliquer par la dépendance en fréquence des différentes sources de bruit. Si l’on néglige l’effet de filtrage de la cavité qui n’est pas significatif au voisinage de la résonance mécanique, les expressions de et (équations 2.94) se simplifient:
| (2.95a) | |||||
| (2.95b) | |||||
| où est le nombre de phonons thermiques donné par l’équation (2.71). Notons que l’on retrouve ici les paramètres essentiels du couplage optomécanique : les effets de pression de radiation dépendent du rapport entre les déphasages non linéaires et les pertes de la cavité, tandis que les effets thermiques sont proportionnels au rapport . | |||||
Les bruits associés au mouvement du miroir (deuxième et
troisième termes dans l’équation 2.95b) ont la même
dépendance en fréquence que le signal et représentent une petite perturbation au signal (environ du
signal pour les paramètres utili-
sés). En dehors de la résonance
mécanique, les corrélations sont donc essentiellement limitées
par le bruit de phase du faisceau de mesure incident (premier terme de
l’équation 2.95b). Les corrélations sont importantes si le
signal est supérieur au bruit du faisceau de mesure, c’est à dire , ou encore . Cette condition peut être satisfaite sur une bande de
fréquence beaucoup plus grande que la largeur de la résonance
mécanique, définie par .
2.4.3.3 Mesure QND avec un faisceau auto-comprimé
Nous venons de montrer que les corrélations signal-mesure peuvent être très importantes au voisinage de la fréquence de résonance mécanique. En dehors de cette plage de fréquence, les corrélations sont limitées par le bruit propre du faisceau de mesure, qui est égal au bruit du faisceau incident lorsque celui-ci est résonnant avec la cavité. Cette condition de résonance apparaît en fait comme une configuration optimale dans le cas où l’intensité du faisceau de mesure est faible. Dans un régime de forte intensité (déphasage de l’ordre de ), on sait que le couplage optomécanique peut produire un faisceau de mesure dans un état comprimé, c’est à dire un faisceau réfléchi dont le bruit propre est réduit (voir partie 2.3). Un choix judicieux du désaccord de la cavité et de la quadrature utilisée pour réaliser la mesure devrait donc permettre d’améliorer les corrélations signal-mesure. Bien sûr, le faisceau signal doit quant à lui rester résonnant avec la cavité, de façon à ce que son intensité ne soit pas perturbée par la mesure.
Comme nous l’avons vu dans la partie 2.3, on peut exprimer le spectre de bruit du faisceau réfléchi pour n’importe quelle quadrature (équation 2.62) en fonction des différentes sources de bruit. Il faut tenir compte ici de la présence d’une source de bruit supplémentaire due à la pression de radiation du faisceau signal. L’action de cette force fluctuante sur le faisceau de mesure est tout à fait similaire à celle exercée par la force de Langevin . Il est donc possible de faire une équivalence entre le système à un seul faisceau, étudié dans la partie 2.3, et celui à deux faisceaux. Pour déterminer l’expression du spectre de bruit de la composante du faisceau de mesure réfléchi, il suffit de substituer le terme dans la relation (2.62) par le terme où le spectre décrit le bruit de pression de radiation du faisceau signal, que l’on peut déduire de l’équation (2.90):
| (2.96) |
On obtient ainsi l’expression du spectre de bruit du faisceau de mesure en fonction des fluctuations de la force de pression de radiation du signal , du bruit thermique et des coefficients et donnés par les équations (2.63):
| (2.97) |
Le premier terme représente le bruit propre du faisceau réfléchi, équivalent aux deux premiers termes de l’expression de trouvée dans la section précédente (équation 2.95b). Selon le point de fonctionnement choisi et la quadrature mesurée, ce bruit propre peut être plus petit que . Le deuxième terme représente l’effet du bruit thermique (équivalent au dernier terme de ). Le dernier terme est à l’origine des corrélations quantiques signal-mesure. La contribution relative de ce terme au spectre est par définition égale à la fonction de corrélation :
| (2.98) |
La figure 23 montre la fonction de corrélation obtenue pour les mêmes paramètres que dans le cas résonant, sauf pour l’intensité du faisceau de mesure qui est égale à l’intensité du signal (), et pour le désaccord de la cavité égal à . Ces valeurs correspondent au même point de fonctionnement de la cavité que celui choisi dans la partie 2.3.

Les trois courbes sont obtenues pour différentes quadratures du faisceau de mesure réfléchi.
On peut comparer ces courbes à celles de la figure 24 qui représentent le spectre de bruit pour les mêmes quadratures, en absence de signal et à température nulle. La figure 24 montre en fait le bruit propre du faisceau réfléchi, donné par le terme dans l’expression de (équation 2.97). Les fréquences pour lesquelles le bruit propre est inférieur au bruit quantique standard dépendent de la quadrature que l’on considère. Il est de ce fait possible d’atteindre un niveau de bruit propre du faisceau de mesure inférieur à sur l’ensemble de la bande passante de la cavité en variant l’angle (courbe en tirets de la figure 24). En comparant les deux figures, on constate que les corrélations sont maximales lorsque le bruit propre du faisceau réfléchi est minimum.
On parcourt ainsi la fonction de corrélation optimale (courbe en tirets de la figure 23) lorsqu’on choisit à chaque fréquence la quadrature qui présente le bruit minimal.

Contrairement à la configuration utilisant un faisceau de mesure résonnant et de faible intensité (figure 22), où les corrélations sont essentiellement concentrées autour de la résonance mécanique, on peut obtenir ici de fortes corrélations sur toute la plage de fréquence définie par la bande passante de la cavité.
2.5 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre les propriétés générales du couplage optomécanique. Nous avons montré qu’une cavité de grande finesse dont un miroir est mobile peut être utilisée pour mettre en évidence les effets quantiques dus à la pression de radiation. Il est ainsi possible de contrôler les fluctuations de la lumière en produisant un état comprimé, ou encore de créer des corrélations quantiques entre la position du miroir mobile et l’intensité lumineuse. D’autre part, une telle cavité permet de mesurer de très petits déplacements du miroir mobile. Il devrait ainsi être possible de mesurer le bruit thermique du miroir mobile ou encore de réaliser une mesure quantique non destructive de l’intensité de la lumière.
Nous avons cherché à dégager les paramètres physiques importants. Malgré le grand nombre de caractéristiques du système pouvant intervenir (propriétés optiques de la cavité et caractéristiques mécaniques du miroir mobile), l’efficacité du couplage optomécanique dépend essentiellement de deux paramètres :
- Les effets liés à la pression de radiation sont significatifs lorsque le déphasage non linéaire est de l’ordre des pertes de la cavité, c’est à dire lorsque le déplacement moyen du miroir produit par la pression de radiation est de l’ordre de la largeur de la résonance optique.
- Les effets thermiques sont proportionnels au rapport entre le nombre de phonons thermiques à la fréquence de résonance mécanique et le facteur de qualité de la résonance.
Afin de réduire les effets thermiques, le résonateur doit avoir un grand facteur de qualité (). Il est aussi nécessaire de travailler à basse température et avec un miroir mobile dont la fréquence de résonance est élevée : pour une température de et une fréquence de résonance de , le nombre de phonons thermiques est de l’ordre de .
La condition est plus difficile à évaluer. Elle fait intervenir à la fois les caractéristiques optiques (finesse de la cavité, puissance lumineuse incidente) et mécaniques (réponse à basse fréquence du résonateur). Nous avons jusqu’à présent utilisé un modèle d’oscillateur harmonique pour décrire la réponse mécanique du résonateur. Dans le cadre de ce modèle, la réponse à basse fréquence dépend essentiellement de la masse du résonateur, qui doit être aussi petite que possible ().
Ces différentes contraintes nous ont amenés à choisir un résonateur mécanique cons- titué d’un substrat en silice de structure plan-convexe, plutôt qu’un système pendulaire. Ceci doit permettre d’atteindre des fréquences de résonance élevées et une faible masse. Le prochain chapitre est consacré à l’étude théorique de ce résonateur. Nous verrons en particulier que la complexité de la réponse mécanique d’un tel résonateur peut être intégrée dans la définition d’une susceptibilité effective. On peut alors définir une masse effective qui caractérise la réponse à basse fréquence du résonateur. Cette masse effective dépend de la géométrie du système et peut être inférieure au milligramme.
Chapter 3 LE RESONATEUR MECANIQUE
Nous avons présenté dans le chapitre précédent les caractéristiques générales du couplage optomécanique, en supposant que le miroir subit un mouvement d’ensemble cara-ctérisé par un déplacement global . Ceci nous a permis de simplifier la description du système puisqu’à la fois le champ et la cavité à miroir mobile peuvent être décrits dans le cadre d’un modèle monodimensionnel.

Nous avons montré cependant que la principale limitation à l’observation d’effets quantiques est due au mouvement thermique du miroir, même à très basse température. Afin de réduire ces effets, il est nécessaire d’utiliser un système mécanique ayant de grands facteurs de qualité et des fréquences de résonance élevées, de l’ordre du mégahertz. Des fréquences aussi élevées ne peuvent pas correspondre à un mouvement d’ensemble du miroir : ces fréquences correspondent aux résonances des modes acoustiques internes du résonateur, qui induisent des déformations de la surface du miroir.
Nous utilisons dans l’expérience un résonateur mécanique constitué d’un substrat en silice très pure, de structure plan-convexe (figure 25). Le miroir est formé de couches multidiélectriques déposées sur la face plane du résonateur. Le mouvement du miroir est dû aux déformations de la face plane du résonateur produites par les modes de vibrations acoustiques internes du substrat. Le choix de la géométrie plan-convexe permet un confinement radial des modes acoustiques au centre du résonateur. Cette propriété permet d’obtenir des facteurs de qualité mécaniques élevés, indépendamment de la façon dont le résonateur est tenu sur son bord extérieur cylindrique.
Ce chapitre est consacré à l’étude du dispositif représenté sur la figure 25. Nous allons montrer qu’il est possible de se ramener à une description monodimensionnelle, en intégrant la structure spatiale dans une susceptibilité effective qui décrit l’effet sur le champ de la réponse mécanique du miroir à la pression de radiation du faisceau lumineux. Nous commencerons par étudier l’effet d’une déformation du résonateur sur le champ (partie 3.1). Nous montrerons que le déphasage subi par le champ ne dépend que du déplacement du miroir moyenné sur la section du faisceau lumineux. Nous étudierons ensuite le mouvement du résonateur lorsque sa face plane est soumise à une force extérieure, en décomposant ce mouvement sur l’ensemble des modes acoustiques (partie 3.2). Nous définirons alors la susceptibilité effective qui décrit la réponse mécanique du résonateur sous l’effet de la pression de radiation du champ intracavité (partie 3.3). Nous pourrons alors généraliser les résultats obtenus dans le chapitre précédent au cas du résonateur plan-convexe, et relier le comportement du résonateur à basse fréquence à sa masse effective (partie 3.4).
3.1 Effet d’une déformation du résonateur sur le champ
Nous allons décrire dans cette partie l’effet d’une déformation quelconque de la face plane du résonateur sur le champ dans la cavité. Etant donné la symétrie du système, on utilise des coordonnées cylindriques d’axe dont l’origine se situe sur la face plane du résonateur (figure 25). Une déformation longitudinale de cette face peut être décrite par un déplacement selon en tout point de la surface.
La structure spatiale du champ électromagnétique se déduit de
l’équation de pro-
pagation du champ électrique dans le vide à laquelle on impose des
conditions aux limites liées à la présence des miroirs de la
cavité optique. Pour cela nous nous plaçons dans l’approximation
paraxiale : nous supposons que l’onde se propage essentiellement suivant
et on utilise la condition de transversalité du champ qui permet de
négliger la composante du champ selon . Dans ces conditions, les
modes de la cavité sont les modes gaussiens qui forment une base orthonormée sur laquelle on peut
décomposer le champ intracavité[35]. Contrairement à
une onde plane, un faisceau gaussien est défini par une taille
transversale finie et un rayon de courbure du front d’onde, qui
dépendent de la position . Les nombres radial et angulaire
repèrent les différents modes transverses du champ alors que le
nombre , qui est associé à la condition de périodicité
sur la longueur de la cavité, repère les différents modes
longitudinaux du champ.
En pratique, nous supposons que l’écart entre les modes longitudinaux est très grand comparé à celui entre les modes transverses, et que le champ incident sur la cavité est parfaitement adapté à un mode , c’est à dire à un mode gaussien fondamental où l’indice est fixé et les indices et sont nuls. Ce mode fondamental est caractérisé au niveau de la face plane du résonateur (en ) par un rayon de courbure infini et un col (waist en Anglais) qui détermine l’extension radiale minimale du faisceau. La structure spatiale du mode est donnée dans ce plan par la gaussienne[35]:
| (3.1) |
où le col dépend des paramètres géométriques de la cavité, c’est à dire de sa longueur et du rayon de courbure du miroir d’entrée:
| (3.2) |
Nous allons déterminer l’effet sur ce mode d’une déformation du miroir mobile. Au niveau du résonateur, dans le plan , le champ avant réflexion s’écrit:
| (3.3) |
où est l’amplitude lentement variable du champ et la fréquence optique, reliée à l’indice et à la longueur de la cavité par :
| (3.4) |
En suivant les trajets optiques, on constate qu’en tout point le champ subit un déphasage proportionnel au déplacement du miroir. Après réflexion totale, il devient donc:
| (3.5) |
Cette expression montre que le champ réfléchi ne se réduit plus uniquement à sa composante fondamentale mais qu’il présente des composantes sur l’ensemble des modes de la cavité. On peut en effet écrire le champ réfléchi sous la forme:
| (3.6) |
où les crochets représentent l’intégrale de recouvrement dans le plan :
| (3.7) |
Ce phénomène de diffusion du mode fondamental dans les autres modes propres de la cavité est lié à la déformation du front d’onde du champ, qui reproduit après réflexion la forme de la face du résonateur. Cette diffusion devient cependant négligeable pour une cavité non dégénérée et de grande finesse. Dans ce cas, l’écart entre les fréquences de résonance des différents modes est grand par rapport à la bande passante de la cavité. Tous les modes apparaissant dans la somme (3.6) évoluent à des fréquences voisines de la résonance fondamentale de la cavité, c’est à dire à des fréquences très éloignées de leur propre fréquence de résonance (on suppose que les fréquences d’évolution des déplacements du miroir restent de l’ordre de grandeur de la bande passante de la cavité). Ces modes sont donc fortement filtrés par la cavité et ne peuvent pas se propager dans celle-ci. La cavité inhibe ainsi la diffusion dans les autres modes et seul le mode fondamental subsiste dans la somme (3.6)[36]:
| (3.8) |
Pour des petits déplacements, on obtient à l’ordre le plus bas:
| (3.9) |
Le champ subit essentiellement un déphasage lorsqu’il se réfléchit sur le résonateur. Ce déphasage est égal au déphasage en tout point du résonateur, pondéré par la structure spatiale du mode fondamental. Le désaccord entre le champ et la cavité défini dans le chapitre précédent est alors donné par une équation similaire à (2.41), à condition de remplacer le déplacement monodimensionnel par un déplacement , égal à la moyenne du déplacement sur la section du faisceau lumineux:
| (3.10a) | |||||
| (3.10b) | |||||
| En conclusion, l’analyse monodimensionnelle des effets du mouvement du miroir sur le champ exposée dans le chapitre précédent peut se généraliser au cas du résonateur plan-convexe : il suffit pour cela de moyenner le déplacement du résonateur sur la structure transverse du champ. Par exemple le bruit de phase du champ réfléchi, lorsque celui-ci est résonnant avec la cavité, est donné par une expression similaire à l’équation (2.76) en remplaçant le spectre de position par le spectre . | |||||
3.2 Mouvement du résonateur
Nous allons maintenant déterminer le mouvement du résonateur lorsqu’il est à l’équilibre thermodynamique ou lorsqu’il est soumis à la force de pression de radiation du faisceau lumineux. Nous commencerons par étudier les modes acoustiques du résonateur, c’est à dire le mouvement du résonateur libre, en absence de force extérieure. Tout mouvement du résonateur peut se décomposer sur ces modes, et nous étudierons l’évolution de ces modes lorsqu’une force est appliquée sur la face plane du résonateur.
3.2.1 Modes acoustiques
Le résonateur étant en silice pure, on considère que le milieu est élastique et isotrope. Pour des petites déformations du résonateur, les mouvements considérés dans la théorie de l’élasticité sont des petites vibrations élastiques ou ondes acoustiques. Une onde acoustique quelconque est définie par son vecteur de déformation , qui obéit à une équation de propagation ainsi qu’à des conditions aux limites liées aux contraintes extérieures appliquées au résonateur. Il y a dans le résonateur deux types d’ondes, les ondes de compression, qui provoquent des déplacements selon la direction , et les ondes de cisaillement, qui induisent des déplacements transverses de la face plane du résonateur. Comme le faisceau n’est sensible qu’aux déplacements longitudinaux du résonateur, nous nous intéresserons seulement aux ondes de compression. L’équation de propagation d’une onde de compression dans le résonateur est donnée par[37]:
| (3.11) |
où la vitesse de propagation de l’onde est:
| (3.12) |
et étant les constantes de Lamé du résonateur et sa masse volumique.
Le mouvement doit aussi satisfaire les conditions aux limites qui s’écrivent, en l’absence de force sur les faces du résonateur:
| (3.13) |
en tout point de la surface où le vecteur normal à la surface est , étant le tenseur des contraintes dans le résonateur, lié au tenseur de déformation par la loi de Hooke[37]:
| (3.14a) | |||||
| (3.14b) | |||||
Puisque les ondes de compression vérifient une équation de propagation identique à celle d’un champ électromagnétique se propageant dans le vide, on peut chercher une solution de la forme où est la fréquence d’évolution de l’onde. En reportant cette expression dans l’équation de propagation (3.11), on obtient:
| (3.15) |
Les solutions de cette équation avec les conditions aux limites (3.13) sont les modes propres du résonateur. L’ensemble de ces modes propres forme une base orthogonale de l’ensemble des solutions du système d’équations (3.13) et (3.15), le produit scalaire étant défini comme l’intégrale sur tout le volume du résonateur. Comme nous le verrons dans la partie 3.4, un avantage du résonateur plan-convexe est qu’il est possible d’obtenir des expressions analytiques pour ces modes propres, expressions en tout point similaires à celles des modes gaussiens en optique. Cependant, l’étude que nous menons ici ne dépend pas de la forme explicite de ces modes et peut être appliquée à d’autres géométries du résonateur. Le seul point important pour l’étude du mouvement du résonateur est l’existence d’une base de modes propres , chaque mode étant caractérisé par une fréquence d’évolution .
Cette base permet de décomposer tout déplacement sous la forme:
| (3.16) |
où désigne l’amplitude du mode acoustique . A l’aide de cette décomposition, nous allons déterminer l’évolution de chaque mode lorsqu’une force extérieure est appliquée sur la face plane du résonateur.
3.2.2 Mouvement du résonateur en absence de dissipation
Nous nous intéressons tout d’abord au cas d’un résonateur libre, soumis à aucune contrainte extérieure. Afin de caractériser le mouvement, on peut calculer l’énergie associée au déplacement . Cette énergie est égale à la somme des intégrales sur tout le volume du résonateur des densités d’énergie cinétique et potentielle. L’énergie cinétique s’écrit:
| (3.17) |
En utilisant la décomposition (3.16) et la propriété d’orthogonalité des modes propres , on obtient alors:
| (3.18) |
où le paramètre est la masse du mode acoustique , donnée par:
| (3.19) |
Cette masse apparaît comme le produit de la masse volumique par le volume du mode acoustique, c’est à dire le volume de la partie du résonateur mise en mouvement lors d’une excitation du mode acoustique.
L’énergie potentielle est reliée aux constantes de Lamé et du résonateur et au tenseur des déformations (équation 3.14b)[38]:
| (3.20) |
Cette expression peut être transformée par intégration par partie. On trouve pour une onde de compression:
| (3.21) |
En utilisant la décomposition en modes propres (3.16) et l’équation de propagation (3.15), on trouve que l’énergie potentielle s’écrit:
| (3.22) |
où est la fréquence d’évolution du mode propre . En additionnant les deux contributions des énergies cinétique et potentielle, on obtient finalement l’expression suivante pour l’énergie totale :
| (3.23) |
On reconnaît dans cette expression la somme des énergies d’oscillateurs harmoniques non amortis de masse et de pulsation propre . Le mouvement du résonateur libre en absence de dissipation interne peut donc se décomposer sur l’ensemble des modes propres acoustiques dont les amplitudes sont décrites comme des oscillateurs harmoniques indépendants. Cette décomposition est tout à fait générale et correspond à une description du mouvement en terme de phonons.
3.2.3 Effet d’une force extérieure
Nous allons à présent déterminer l’équation du mouvement du résonateur en présence d’une force extérieure. On s’intéressera au cas d’une force appliquée sur la face plane du résonateur (en ) et parallèle à l’axe . L’énergie totale du résonateur est donnée par la relation (3.23) à laquelle on rajoute un terme supplémentaire lié au travail des forces de contraintes internes qui s’opposent à la force extérieure. Ce travail est égal et opposé au travail accompli par la force extérieure sur toute la surface plane du résonateur:
| (3.24) |
où est la force par unité de surface appliquée au point . En utilisant la décomposition en modes propres (3.16), on obtient:
| (3.25) |
où les crochets représentent l’intégrale de recouvrement dans le plan (équation 3.7). L’énergie totale s’écrit alors :
| (3.26) |
Cette énergie est équivalente à celle d’un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépendants. Chaque oscillateur est soumis à une force , égale à la projection spatiale de la force extérieure sur le mode considéré. En d’autres termes, le mouvement du résonateur se décompose sur l’ensemble des modes acoustiques, l’amplitude de chaque mode étant régie par l’équation du mouvement d’un oscillateur harmonique forcé:
| (3.27) |
Dans l’espace de Fourier, l’amplitude de chaque mode peut s’écrire sous la forme:
| (3.28) |
où est la susceptibilité mécanique d’un oscillateur harmonique non amorti, de masse et de fréquence propre .
3.2.4 Mouvement Brownien du résonateur mécanique
Jusqu’à présent, nous avons supposé le résonateur non amorti. On peut tenir compte de l’amortissement et du couplage avec le bain thermique en généralisant l’approche utilisée dans le chapitre précédent (section 2.4.2). Chaque mode acoustique est en effet équivalent à un oscillateur harmonique et on peut décrire le couplage avec un bain thermique par des forces de Langevin appliquées à chaque oscillateur et par un angle de perte. Pour simplifier, nous supposerons que l’angle de perte ne dépend pas du mode acoustique considéré. Ceci découle en fait du modèle de Navier-Stokes ou du modèle constant, et cette hypothèse semble justifiée lorsque les mécanismes de dissipation sont internes (les mécanismes de dissipation par contact avec le support peuvent dépendre de l’extension spatiale des modes acoustiques). En présence d’amortissement les susceptibilités des modes acoustiques s’écrivent alors:
| (3.29) |
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les mécanismes de dissipation dans les solides sont mal connus et on ne dispose pas de modèle théorique satisfaisant pour décrire le comportement de l’angle de perte en fonction de la fréquence. Les deux approches que nous considérons sont les modèles de Navier-Stokes, basé sur une dissipation de type visqueuse, et le modèle constant qui associe à tout processus de dissipation un angle de perte constant. Dans le cadre du modèle de Navier-Stokes[32], l’angle de perte est donné par une relation similaire à (2.84):
| (3.30) |
où et sont respectivement le facteur de qualité et la fréquence de résonance du mode acoustique fondamental du résonateur.
Le second modèle, basé sur des constatations expérimentales, prédit un angle de perte constant en fréquence. En utilisant le résultat de la section 2.4.2.2 (équation 2.85), on obtient:
| (3.31) |
Une autre conséquence du couplage avec le bain thermique est la présence de forces de Langevin pour chaque mode acoustique. Ces forces sont indépendantes les unes des autres et vérifient le théorème fluctuation-dissipation. Le spectre de la force est donc relié à la partie imaginaire de la susceptibilité par:
| (3.32) |
En conclusion, le mouvement du résonateur en présence d’une force extérieure est décrit par l’ensemble des amplitudes des modes acoustiques, reliées à la force appliquée par la relation:
| (3.33) |
Ce résultat présente certaines analogies avec la description monodimensionnelle du mouvement présenté dans le chapitre précédent (équation 2.42). Les diférences sont liées à la présence de multiples modes acoustiques et au fait que la force appliquée pour chaque mode est la projection de la force sur la structure spatiale du mode.
3.3 Effet de la pression de radiation et susceptibilité effective
Pour déterminer l’effet du faisceau lumineux sur le mouvement du résonateur, il suffit d’identifier la force extérieure à la pression de radiation exercée par le champ intracavité. Cette pression est proportionnelle à l’intensité du champ dont l’amplitude présente une distribution spatiale gaussienne (équation 3.3). La force par unité de surface qu’exerce le champ sur le résonateur est donc une gaussienne qui s’écrit:
| (3.34) |
où est donné par la relation (3.1) et est l’intensité du champ (nombre de photons par seconde intégré sur toute la section du faisceau), reliée à l’amplitude du champ par:
| (3.35) |
Nous allons à présent déterminer l’expression du déplacement moyen (équation 3.10b) auquel est sensible le champ dans la cavité. Ce déplacement est obtenu en utilisant la décomposition (3.16) de en fonction des amplitudes et l’équation du mouvement (3.33) de chaque mode. Dans l’espace de Fourier ce déplacement est donné par:
| (3.36) |
Cette relation peut être écrite de façon condensée, sous une forme similaire à celle présentée dans le cadre de l’analyse monodimensionnelle (équations 2.42 et 2.43):
| (3.37) |
où la susceptibilité effective est égale à la somme des susceptibilités de tous les modes acoustiques du résonateur, pondérées par leur recouvrement avec le mode optique:
| (3.38) |
Dans la relation (3.37), représente une force de Langevin effective qui s’exprime en fonction des forces de Langevin de tous les modes acoustiques:
| (3.39) |
On peut déterminer le spectre de en utilisant l’expression des spectres de chaque force de Langevin (équation 3.32). On trouve alors que la force vérifie le théorème fluctuation-dissipation:
| (3.40) |
En d’autres termes, le résonateur dans son ensemble est à l’équilibre thermodynamique en absence de faisceau lumineux.
En conclusion, nous avons défini une susceptibilité effective qui permet de relier le déplacement moyen du miroir mobile à l’intensité lumineuse et à une force de Langevin (équation 3.37) de la même manière que dans le cas d’un oscillateur harmonique (équation 2.42) : le couplage optomécanique entre le résonateur et le champ gaussien intracavité est complètement décrit par la susceptibilité effective qui intègre l’ensemble des propriétés spatiales du couplage. Cette susceptibilité tient compte de la contribution de tous les modes acoustiques du résonateur ainsi que de leur adaptation spatiale avec le faisceau lumineux. Tous les résultats obtenus dans le cadre de l’approche monodimensionnelle sont donc valables à condition de remplacer la susceptibilité d’un seul oscillateur harmonique par la susceptibilité effective .
3.4 Couplage optomécanique avec un résonateur plan-convexe
La démarche qui a été suivie dans le chapitre 2 pour mesurer le bruit thermique et pour réaliser une mesure QND de l’intensité lumineuse peut se généraliser au cas d’un résonateur plan-convexe. Nous allons tout d’abord déterminer la structure des modes acoustiques pour un tel résonateur, afin d’expliciter les différents paramètres intervenant dans la susceptibilité effective (section 3.4.1). Nous présenterons ensuite le spectre du bruit thermique du résonateur plan-convexe (section 3.4.2) ainsi que la fonction de corrélation d’une mesure QND (section 3.4.3).
3.4.1 Modes acoustiques d’un résonateur plan-convexe
Les modes acoustiques longitudinaux sont solutions de l’équation de propagation (3.15) avec les conditions aux limites (3.13). Pour un résonateur plan-convexe, ces équations sont similaires à celles obtenues en optique pour une cavité Fabry-Perot constituée d’un miroir plan et d’un miroir courbe. On peut alors obtenir des expressions analytiques approchées pour les modes acoustiques, valides dans le cadre de l’approximation paraxiale[39]. Chaque mode est défini par trois indices (,,) et le déplacement est caractérisé par une amplitude selon l’axe dont l’expression est similaire à celle des modes gaussiens en optique:
| (3.41) |
où désigne un polynôme de Laguerre généralisé et est l’épaiseur du résonateur à une distance radiale , reliée à l’épaisseur au centre et au rayon de courbure de la face convexe par la relation:
| (3.42) |
lorsque . Le col acoustique est donné par:
| (3.43) |
où désigne le col du mode fondamental. L’évolution temporelle du mode acoustique est fixée par la fréquence propre que l’on déduit de la condition de périodicité sur l’épaisseur du résonateur:
| (3.44) |
On voit ainsi que l’indice repère les différentes harmoniques, le nombre radial donne le nombre de zéros de la fonction radiale, tandis que est le nombre angulaire. On peut aussi exprimer les fréquences propres en fonction de la fréquence caractéristique qui représente la fréquence longitudinale fondamentale du résonateur:
| (3.45) |
Ces modes propres acoustiques sont très similaires aux modes gaussiens optiques[35]. Ils diffèrent cependant par la condition de validité de l’approximation paraxiale. En règle générale, cette approximation est valable lorsque la composante transverse du vecteur d’onde est très petite devant la composante longitudinale . En optique, cette condition est vérifiée dès que la longueur de la cavité est grande comparée à la longueur d’onde, ce qui est généralement le cas. En acoustique, cette condition n’est pas réalisée. Les composantes du vecteur d’onde sont données par:
| (3.46) |
Les ordres des différentes harmoniques (nombre ) pouvant être du
même ordre de grandeur que les nombres et associés aux modes
transverses , l’approximation para-
xiale impose de prendre .
Parmis tous les modes acoustiques , seuls nous intéressent ceux qui contribuent au déplacement moyen . Pour des raisons de symétrie, les modes concernés sont invariants par rotation autour de l’axe de propagation . On ne considère donc que les modes dont le déplacement est non nul dans le plan , modes que l’on peut écrire sous la forme:
| (3.47) |
Ces modes sont caractérisés par des fréquences de résonance données par l’équation (3.45) avec .
La forme explicite de l’amplitude du mode acoustique permet de déterminer les paramètres intervenant dans la susceptibilité effective, c’est à dire la masse du mode et le recouvrement avec le faisceau lumineux. On peut calculer la masse à l’ordre le plus bas en (approximation paraxiale), en remplaçant l’épaisseur au point par l’épaisseur au centre . On se ramène ainsi à une intégrale simple de polynomes de Laguerre, qui donne[40]:
| (3.48) |
Cette relation montre bien que la masse est reliée au volume du mode, égal à l’épaisseur du résonateur par la section du mode. Cette masse est plus petite que la masse totale du résonateur, et décroit lorsque augmente.
3.4.2 Mesure du bruit thermique du résonateur plan-convexe
Pour mesurer le spectre des fluctuations thermiques du résonateur, on
utilise un faisceau de mesure résonnant avec la cavité et
d’intensité suffisamment faible pour nég-
liger les effets de pression de radiation (voir section 2.4.2). Le spectre
de bruit de phase du faisceau réfléchi est alors donné par la
relation (2.76) en remplaçant le spectre
par . Les fluctuations de position du miroir sont reliées uniquement à la force de Langevin
(équation 3.37) et le spectre
est donné par:
| (3.50) |
On obtient finalement pour le spectre des fluctuations de phase du faisceau réfléchi :
| (3.51) |
où est la susceptibilité effective normalisée à à fréquence nulle et est le déphasage non linéaire lié au déplacement de la face plane du résonateur sous l’effet de la pression de radiation moyenne. Ce déphasage s’écrit, d’après les relations (2.47), (3.29) et (3.38):
| (3.52) |
Par rapport au cas simple de l’oscillateur harmonique, l’expression du déphasage non linéaire est plus difficile à évaluer puisqu’elle fait intervenir ici la contribution d’une infinité d’oscillateurs harmoniques pondérés par leur recouvrement spatial avec le mode optique. Nous reviendrons sur ce point dans la section 3.4.4.
On peut relier le spectre de bruit de phase à l’angle de perte qui décrit la dissipation dans le résonateur:
| (3.53) |
où est le nombre de phonons thermiques à la fréquence fondamentale (équation 2.71). On obtient ainsi une expression similaire à celle obtenue dans la section 2.4.2 (équation 2.86). La contribution du bruit thermique au spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi est caractérisée par les mêmes paramètres, à savoir le rapport qui décrit l’amplitude du couplage optomécanique, le rapport qui décrit l’amplitude du bruit thermique et enfin le terme faisant intervenir l’angle de perte qui décrit la dissipation dans le résonateur. La seule différence avec l’oscillateur harmonique est le terme de somme dans lequel apparaît la contribution de tous les modes acoustiques (terme ). Cette contribution est pondérée par un terme qui tient compte de la contribution relative du mode considéré à la susceptibilité effective à fréquence nulle.
Le spectre de phase en sortie peut être déterminé en calculant numériquement la double somme dans l’équation (3.53). La figure 26 montre les spectres de bruit obtenus à température ambiante pour les deux modèles de dissipation (amortissement visqueux et constant). Les paramètres optiques de la cavité sont identiques à ceux utilisés dans la section 2.4.2 : finesse et bande passante . Pour pouvoir négliger les effets de pression de radiation devant les effets thermiques, on garde aussi le même déphasage non linéaire . Le résonateur mécanique, caractérisé par une épaisseur au centre et un rayon de courbure , est constitué d’un substrat en silice fondue de masse volumique et de vitesse de propagation longitudinale du son . Le col du mode acoustique fondamental est ainsi égal à (équation 3.43) et la fréquence de résonance est égale à . Le facteur de qualité du fondamental est choisi égal à .

La figure 26 montre que le spectre de bruit thermique présente plusieurs pics associés aux modes acoustiques du résonateur : chaque mode contribue au spectre de bruit thermique par une réponse Lorentzienne à la fréquence . On distingue sur cette figure les différents modes longitudinaux du résonateur, correspondant à la fréquence et à ses harmoniques. Chaque mode longitudinal est suivi d’une série de modes transverses , excepté le mode fondamental. La contribution de chaque mode dépend en fait de la façon dont ils sont adaptés au mode optique. L’expression du recouvrement spatial (équation 3.49) montre qu’un mode acoustique longitudinal (, ) est parfaitement adapté au mode optique si la relation est satisfaite : le terme de recouvrement est alors maximum. Dans ce cas, l’intégrale de recouvrement est nulle pour les modes transverses associés à ce mode longitudinal. Les spectres de la figure 26 sont tracés dans le cas où le faisceau incident est adapté au mode acoustique fondamental, c’est-à-dire pour . On voit que les modes acoustiques transverses du fondamental ne sont pas couplés au faisceau lumineux et ne contribuent pas au spectre. Par contre, les autres modes acoustiques longitudinaux ne sont pas parfaitement adaptés au faisceau lumineux et le spectre fait apparaître pour ces modes un peigne de modes transverses d’amplitude décroissante : on peut montrer à partir de l’équation (3.49) que le recouvrement des modes transverses est d’autant plus faible que l’ordre du mode est élevé.
L’allure du spectre de bruit de phase dépend donc beaucoup de l’adaptation spatiale entre les modes acoustiques et optique. La figure 27 montre le spectre de bruit de phase en sortie dans le cas d’un amortissement visqueux, pour un col optique plus petit, égal à . Le faisceau lumineux n’est plus adapté spatialement au mode fondamental et il est ainsi couplé à un grand nombre de ses modes transverses, si bien que les séries de modes transverses associées aux différents modes longitudinaux se recouvrent.

En conclusion, nous avons montré que le spectre de bruit du faisceau réfléchi par la cavité peut fournir des informations sur le mouvement Brownien du résonateur plan-convexe. Cette étude montre d’autre part l’importance de l’adaptation spatiale entre le faisceau lumineux et les modes acoustiques du résonateur. En modifiant la taille du faisceau lumineux, il est possible de modifier le couplage avec les modes acoustiques, et ainsi de modifier l’influence dans le signal optique du bruit thermique de certains modes acoustiques.
3.4.3 Mesure QND de l’intensité lumineuse
Le principe de la mesure QND décrit dans la partie 2.4 reste valable pour un résonateur plan-convexe. Le faisceau signal et le faisceau de mesure sont tous deux résonnants avec la cavité et adaptés spatialement à son mode fondamental . Dans ces conditions l’intensité du signal n’est pas dégradée par la mesure et elle est corrélée à la quadrature de phase du faisceau de mesure réfléchi. Les deux faisceaux étant gaussiens, le déplacement auquel est sensible la phase du faisceau de mesure réfléchi est donné par l’équation (3.37) dans laquelle l’intensité intracavité est égale à la somme des intensités des deux faisceaux (on suppose les deux faisceaux polarisés orthogonalement). L’expression de est obtenue en remplaçant dans la relation (2.88) le déplacement par , ce qui revient à substituer dans les résultats de la section 2.4.3 la susceptibilité harmonique par la susceptibilité effective qui prend en compte la structure spatiale du système.

L’expression de la fonction de corrélation signal-mesure est donc donnée par la relation (2.93b) en remplaçant la susceptibilité harmonique dans les équations (2.94) par la susceptibilité . Le spectre des corrélations est ensuite obtenu en calculant numériquement la double somme qui apparaît dans l’expression de . La figure 28 montre le résultat du calcul dans le cas où les deux faisceaux sont adaptés spatialement au mode acoustique fondamental (). Les paramètres de la cavité sont les mêmes que dans la section 2.4.3; en particulier les déphasages non linéaires et sont égaux à et . Les caractéristiques du résonateur mécanique sont les mêmes que dans la section précédente.
Comme dans le cas du modèle harmonique (figure 22, page 22), les corrélations quantiques reproduisent la dépendance en fréquence de la réponse mécanique du miroir mobile. Dans le cas du résonateur plan-convexe, la réponse est caractérisée par plusieurs résonances et les corrélations signal-mesure sont maximales aux fréquences de résonances acoustiques du résonateur. Comme dans le cas monodimensionnel, on observe l’effet de filtrage de la cavité qui limite les corrélations pour des fréquences supérieures à la bande passante de la cavité.
On retrouve dans le cas du résonateur plan-convexe les paramètres essentiels du couplage optomécanique que nous avions précisés dans le chapitre précédent. L’efficacité du couplage dépend des rapports et qui décrivent respectivement les effets de pression de radiation et du bruit thermique. A basse température, les effets thermiques sont réduits grâce aux valeurs élevées de la fréquence de résonance fondamentale et du facteur de qualité du résonateur. Les effets quantiques liés à la pression de radiation sont significatifs lorsque les déphasages non linéaire sont de l’ordre des pertes de la cavité.
3.4.4 Masse effective
Le déphasage non linéaire est un paramètre important qui intervient dans la caractérisation du couplage optomécanique. Nous allons étudier maintenant comment il est relié aux paramètres physiques du système. Nous allons montrer en particulier que le déphasage non linéaire produit par un résonateur plan-convexe est beaucoup plus grand que dans le cas d’un simple oscillateur harmonique de même masse totale.
Le déphasage non linéaire dépend de la réponse mécanique à fréquence nulle du résonateur (équation 3.52). Cette réponse est reliée à la réponse de l’ensemble des modes acoustiques:
| (3.54) |
En fait, l’effet du résonateur à basse fréquence est similaire à celui d’un simple oscillateur harmonique de fréquence de résonance égale à la fréquence fondamentale du résonateur, mais de masse effective différente de la masse totale du résonateur. On peut définir cette masse effective en identifiant la réponse à basse fréquence à celle d’un seul oscillateur harmonique:
| (3.55) |
La masse effective est donc reliée aux masses des modes acoustiques et dépend du recouvrement spatial avec le faisceau lumineux.
A partir des expressions du col , de la fréquence de résonance , de la masse et du recouvrement spatial (équations 3.43, 3.44, 3.48, 3.49), on peut exprimer la masse effective en fonction de la masse du mode acoustique fondamental et du rapport entre les cols du mode acoustique fondamental et du mode optique:
| (3.56) |
La courbe en trait plein de la figure 29 montre l’évolution de la masse effective en fonction du rapport , en gardant les mêmes paramètres géométriques du résonateur que ceux utilisés dans la partie précédente ( et ). Le mode fondamental a alors une masse et un col . La masse effective est d’autant plus petite que le col optique est petit devant le col acoustique et elle peut atteindre une valeur de seulement pour un col optique égal à , soit . La masse effective peut donc être deux à trois ordres de grandeur plus petite que la masse totale du résonateur, qui est de l’ordre de , augmentant dans les mêmes proportions les effets du couplage optomécanique. Pour une masse effective de , il suffit d’une puissance lumineuse incidente de pour avoir un déphasage non linéaire égal à .

On peut par ailleurs donner une estimation simple, notée , de la masse effective à la limite . On peut alors négliger la dépendance en dans le dernier terme de l’expression (3.56). Cela revient à supposer tous les modes transverses dégénérés (). La somme sur est alors une simple série géométrique, et on obtient:
| (3.57) |
En utilisant l’expression de (équation 3.48) on trouve finalement:
| (3.58) |
Le terme entre parenthèses représente la masse optique, qui correspond à la masse du volume du résonateur délimité par le faisceau lumineux. La courbe en traits tiretés de la figure 29 décrit la variation de la masse en fonction du col du faisceau dans la cavité. Comme on peut le voir, cette masse optique fournit une bonne estimation de la masse effective .
3.5 Conclusion
Nous avons étudié dans ce chapitre les caractéristiques du couplage optomécanique entre un miroir mobile déposé sur un résonateur plan-convexe et un faisceau lumineux gaussien. Nous avons montré qu’une déformation du miroir est équivalente pour le champ à un déplacement suivant l’axe de la cavité, déplacement égal à la moyenne spatiale de la déformation sur la section du faisceau lumineux.
Nous avons ensuite déterminé le déplacement du miroir lorsque le résonateur est soumis à la force de pression de radiation du faisceau lumineux tout en étant en contact avec un bain thermique. Pour cela nous avons utilisé l’équivalence entre le résonateur mécanique et un ensemble d’oscillateurs harmoniques associés aux modes acoustiques propres du résonateur. Chaque mode acoustique contribue au mouvement du miroir dans une proportion qui dépend de sa susceptibilité mécanique et du recouvrement spatial entre le mode acoustique et le faisceau lumineux.
Nous avons montré qu’il est possible de rendre compte de la complexité de la réponse mécanique du résonateur en définissant une susceptibilité effective . Cette susceptibilité permet de généraliser les résultats obtenus dans le chapitre précédent pour un seul oscillateur harmonique. Nous avons ainsi étudié les possibilités de mesurer le mouvement Brownien du résonateur et de réaliser une mesure quantique non destructive. Les spécificités liées à l’utilisation d’un résonateur plan-convexe apparaissent essentiellement dans la présence de multiples fréquences de résonance acoustiques et dans l’importance de l’adaptation spatiale entre la lumière et les modes acoustiques.
Les paramètres physiques essentiels du couplage optomécanique restent cependant les mêmes. Les effets liés à la pression de radiation sont significatifs lorsque le déphasage non linéaire est de l’ordre des pertes de la cavité. Les effets thermiques sont proportionnels au rapport entre le nombre de phonons thermiques à la fréquence de résonance fondamentale du résonateur et le facteur de qualité de cette résonance.
Nous avons enfin défini une masse effective qui permet de décrire les effets du couplage optomécanique à basse fréquence. Un résonateur plan-convexe est équivalent à un oscillateur harmonique dont la masse effective est de l’ordre de la masse optique, c’est à dire la masse du volume du résonateur éclairé par le faisceau lumineux. On obtient ainsi une masse effective très petite, inférieure au milligramme, lorsque la section du faisceau lumineux est suffisamment petite. Ceci devrait permettre d’observer les effets du couplage optomécanique pour des puissances lumineuses incidentes raisonnables, de l’ordre de quelques milliwatts.
Notons enfin que cette étude n’est pas limitée à la seule géométrie plan-convexe. Le choix d’une géométrie pour le résonateur modifie simplement la structure spatiale des modes acoustiques. Des études similaires à celle présentée ici ont été réalisées pour caractériser le bruit thermique des modes de vibrations internes des miroirs des interféromètres VIRGO et LIGO[6]. Ces miroirs ont une structure cylindrique et il est nécessaire d’utiliser des méthodes de calcul numérique par éléments finis pour déterminer la structure spatiale des modes acoustiques ainsi que leur fréquences propres. On trouve alors que la masse effective est à fois plus petite que la masse totale du miroir. C’est finalement grâce au confinement radial des modes acoustiques qu’il est possible d’obtenir avec un résonateur plan-convexe une masse effective beaucoup plus petite.
Chapter 4 LE MONTAGE EXPERIMENTAL
L’expérience que nous allons décrire dans ce chapitre a débuté en décembre 1994. Nous avons réalisé au cours de ces dernières années le montage expérimental qui doit permettre de mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique présentés dans les chapitres précédents. Ce montage est essentiellement composé de quatre parties comme le montre la figure 30 :

- La cavité à miroir mobile constitue le coeur de l’expérience car ses caractéristiques imposent des contraintes sévères pour le reste du montage. La cavité est composée d’un miroir qui sert de coupleur d’entrée-sortie et du miroir mobile de haute réflectivité déposé sur un résonateur mécanique de structure plan-convexe. L’ensemble forme une cavité linéaire de grande finesse à une seule entrée-sortie.
- La source laser est constituée d’un laser titane saphir stabilisé en fréquence et en intensité. Etant donné la grande finesse de la cavité à miroir mobile, la source laser doit présenter une très grande stabilité en fréquence et en intensité. Ceci a nécessité la réalisation de systèmes de stabilisation très performants. D’autre part, le faisceau à la sortie du laser présente un certain astigmatisme. Pour le supprimer, le faisceau laser est filtré spatialement à l’aide d’une cavité résonnante, ce qui permet d’adapter précisément le faisceau au mode fondamental de la cavité à miroir mobile.
- Pour mesurer les fluctuations du faisceau réfléchi par la cavité, on utilise un système de détection homodyne qui permet de mesurer le bruit de n’importe quelle quadrature du faisceau réfléchi, à l’échelle des fluctuations quantiques.
- Le dernier élément est un dispositif permettant d’exciter les modes acoustiques du résonateur, afin de caractériser la réponse mécanique du miroir mobile. On utilise une partie du faisceau laser, modulée en intensité à une fréquence variable. Ce faisceau se réfléchit par l’arrière sur le miroir mobile et exerce ainsi une force de pression de radiation dont l’amplitude est modulée.
Dans la suite nous allons décrire ces différentes parties et présenter pour chacune d’entre elles les performances obtenues sur notre montage.
4.1 La cavité à miroir mobile
La cavité à miroir mobile est une cavité linéaire d’une longueur comprise entre et . La longueur de la cavité ainsi que le parallélisme et le centrage des deux miroirs sont fixés grâce à deux pièces cylindriques en cuivre parfaitement centrées, dans lesquelles viennent se loger les miroirs. Pour éviter d’endommager les miroirs, l’ensemble est serré par des lames de chrysocale de forme cylindrique qui appliquent une contrainte uniforme sur la périphérie des miroirs. La figure 31 montre une photo de la cavité vue du côté du miroir mobile. On distingue la lame de chrysocale fixée par six vis au support en cuivre. L’ensemble est placé dans un support en dural, monté sur platines de translation.

Le miroir mobile (au premier plan sur la figure 31) a été réalisé par le Service des Matériaux Avancés de l’Institut de Physique Nucléaire à Lyon. Cette équipe travaille à la réalisation des miroirs destinés à l’interféromètre Virgo. Le miroir de très haute réflectivité et à faible perte est déposé sur un substrat plan-convexe en silice fondue très pure, de petite dimension ( d’épaisseur et de diamètre). Le miroir qui sert de coupleur d’entrée pour la cavité présente une transmission plus importante mais est aussi à faible perte.
Nous allons présenter dans cette partie les caractéristiques de la cavité. Nous commencerons par décrire le miroir mobile en présentant les spécifications fournies par les fabricants (section 4.1.1). Nous décrirons ensuite le coupleur d’entrée (section 4.1.2), la cavité optique (section 4.1.3) et les caractéristiques (bande passante, intervalle entre ordres, finesse, perte et transmission des miroirs) que nous avons mesurées (section 4.1.4).
4.1.1 Le miroir mobile
Le miroir mobile est réalisé en deux étapes distinctes : la fabrications du substrat et le dépôt des couches multidiélectriques. En ce qui concerne le substrat, ses caractéristiques (matériau utilisé, géométrie, état de surface) déterminent non seulement la qualité optique du miroir mais aussi les propriétés mécaniques du résonateur. Nous avons choisi d’utiliser des substrats en silice fondue. Ce matériau synthétique présente plusieurs avantages, tant sur le plan optique que mécanique. Etant utilisé depuis de nombreuses années comme substrat pour la réalisation de miroirs, les techniques de polissage et de dépot de couches multidiélectriques sur ce matériau sont parfaitement maîtrisées. Ceci permet d’obtenir des miroirs ayant des pertes de l’ordre du (une part par million) et une excellente tenue au flux. Les caractéristiques mécaniques de ce matériau sont aussi très bonnes, puisque les facteurs de qualité intrinsèque de la silice à basse température sont supérieurs à .
Le substrat a une géométrie plan-convexe. Grâce au confinement des modes acoustiques au centre du résonateur, cette structure devrait permettre d’obtenir des facteurs de qualité mécanique proche de sa valeur intrinsèque. Ce type de géométrie a déjà été utilisée dans le cas de résonateurs en quartz pour étudier les propriétés des modes de cisaillement. Les expériences réalisées ont montré un excellent accord avec la théorie tant en ce qui concerne la fréquence de résonance que la structure spatiale des modes. En particulier, des expériences de diffraction de rayons X ont permis de visualiser la structure gaussienne de ces modes et leur confinement[41]. D’autres expériences ont montré que le facteur de qualité de ces résonances peut atteindre sous vide et à basse température des valeurs proches de [42].
Nos substrats ont été réalisés par la société Maris Delfour. Nous disposons ainsi d’un ensemble de substrats d’épaisseur au centre et de différents rayons de courbure (, et ). Nous avons aussi des substrats plan-plan pour étudier les caractéristiques des modes acoustiques dans le cas où les modes ne sont pas confinés. La figure 32 montre la géométrie précise de nos substrats. La partie périphérique du substrat plan-convexe de de diamètre est prolongée de de façon à former un anneau de d’épaisseur. Cet anneau permet de tenir le résonateur sans endommager le traitement déposé sur la face plane. En tenant ainsi le miroir sur les bords, on diminue aussi l’effet des contraintes sur les caractéristiques des modes acoustiques (fréquence de résonance et facteur de qualité).

4.1.1.1 Etat de surface des substrats
Les caractéristiques optiques du miroir mobile qui sont importantes en vue de la réalisation d’une cavité de grande finesse sont la transmission résiduelle, les pertes et la tenue au flux. Les deux premiers paramètres peuvent être définis par des coefficients et égaux respectivement aux rapports entre l’énergie lumineuse transmise ou perdue et l’énergie lumineuse incidente. Par conservation de l’énergie, ces paramètres sont reliés au coefficient de réflexion en intensité par:
| (4.1) |
Le coefficient de perte est lui-même la somme des pertes par absorption et des pertes par diffusion :
| (4.2) |
Enfin, la tenue au flux est caractérisée par la puissance maximale admissible par unité de surface.
La plupart de ces paramètres dépendent de la qualité des couches multi-diélectriques. Cependant, les pertes par diffusion sont pour l’essentiel liées à l’état de surface des substrats. On définit la rugosité du substrat comme la moyenne des écarts quadratiques des irrégularités de la surface du substrat par rapport à une surface idéale. Le coefficient de diffusion est alors donné par[43]:
| (4.3) |
La société Maris Delfour qui a réalisé nos substrats garantit un poli de la surface à traiter correspondant à une rugosité de l’ordre de , ce qui induit des pertes par diffusion inférieures à , pour une longueur d’onde de .
Nous avons caractérisé la rugosité de nos substrats au Laboratoire de l’Ecole Supérieure de Physico-Chimie Industrielle (E.S.P.C.I.) en utilisant un dispositif développé par P. Gleyzes et C. Boccara[44]. Ce dispositif permet de mesurer le déphasage entre deux faisceaux réfléchis par deux points de l’échantillon, mesure qui donne accès à la dénivellation entre ces deux points. Le principe du dispositif est le suivant : un faisceau de lumière issu d’une diode laser traverse un prisme de Wollaston qui le sépare angulairement en deux faisceaux de même intensité et de polarisations orthogonales. Ces deux faisceaux sont ensuite focalisés en deux points de l’échantillon écartés d’un micron. Après réflexion sur l’échantillon, les deux faisceaux sont recombinés par le Wollaston. A cause du déphasage induit par le cube et par la différence de marche des deux points analysés, le faisceau résultant a une polarisation elliptique. La mesure de l’ellipticité permet donc de déterminer la différence de hauteur entre les deux points. Afin d’améliorer le rapport signal à bruit, cette mesure utilise une technique de modulation de la polarisation qui permet de mesurer des dénivellations inférieures à . Une microplatine permet de déplacer l’échantillon et d’acquérir des valeurs du profil différentiel sur des intervalles de quelques centaines de microns avec un pas d’échantillonnage égal à . Ces valeurs sont stockée puis traitées afin d’en déduire le profil réel de la surface échantillonnée. La figure 33 (a) montre la topographie au centre de l’un de nos substrats : les points sombres et clairs représentent des ”bosses” ou des ”creux”. La figure 33 (b) représente l’histogramme des valeurs du profil obtenu avec le même substrat. On obtient pour ce substrat une rugosité de l’ordre de , soit une valeur trois fois plus élevée que celle annoncée par le fabriquant.

Dans l’ensemble, cette caractérisation a montré que la rugosité de nos meilleurs substrats est plutôt de l’ordre de l’Ångstrom et que les surfaces présentent des défauts importants, sous forme de longues rayures ou bosses. Les pertes par diffusion attendues seront donc au moins de l’ordre de quelques . A terme, si l’on veut mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique, il sera nécessaire de disposer de substrats ayant un meilleur état de surface. La qualité de ces substrats est cependant suffisante pour la première étape de l’expérience qui consiste à caractériser le couplage optomécanique et mesurer le bruit thermique du résonateur. Nous verrons que les pertes des miroirs réalisés avec ces substrats sont suffisamment faibles pour construire une cavité optique de grande finesse.
L’état de surface de la face convexe intervient aussi au niveau du facteur de qualité des résonances acoustiques du résonateur mécanique. Cette face est polie optiquement à ce qui est largement suffisant pour éviter toute dégradation du facteur de qualité mécanique.
4.1.1.2 Les traitements multidiélectriques
Les pertes par absorption dans les couches multidiélectriques peuvent être limitées par un choix approprié des matériaux et aussi par la méthode utilisée pour déposer les couches. Nos miroirs ont été réalisés et caractérisés par l’équipe de J. M. Mackowski du Service des Matériaux Avancés de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon qui réalise les miroirs de Virgo dont les spécifications sont très sévères. La technique de dépôt utilisée est la pulvérisation réactive par double faisceau d’ions (Dual Ion Beam Sputtering)[45]. Cette technique de dépôt permet d’obtenir des couches minces très denses et parfaitement isotropes.
Dans ce procédé, on utilise un faisceau énergétique d’ions argon pour bombarder une cible constituée du matériau que l’on veut déposer sur les substrats. Les espèces pulvérisées sont émises dans le demi-espace face à la cible et viennent se condenser sur le substrat pour former le film mince. Tel quel, le film présente des microstructures qui peuvent constituer des sources d’absorption importantes, limitant ainsi la tenue au flux du traitement. C’est pourquoi le substrat est soumis à un autre faisceau d’ions d’oxygène peu énergétique afin d’assister la croissance du film. On obtient ainsi des couches très compactes avec un niveau d’absorption très bas (inférieur au ) assurant une tenue au flux supérieure à . Le nombre de couches multidiélectriques, qui est égal à , est tel que le niveau de transmission est pratiquement nul.
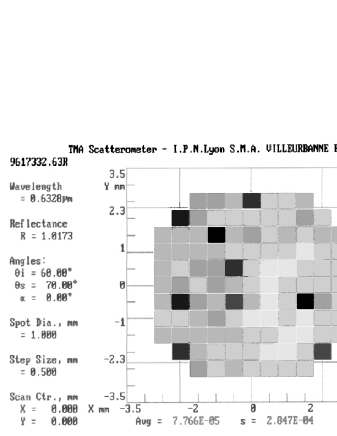
La qualité du traitement dépend beaucoup de l’état de surface de la face traitée du substrat. En fait, les pertes totales de nos miroirs sont essentiellement dues à la diffusion liée à la rugosité relativement importante des substrats qui impose la reproduction des défauts couche après couche. Le système utilisé à l’I.P.N. pour mesurer les pertes par diffusion est un diffusomètre de type C.A.S.I. (complete angle scan instrument)[46]. Le miroir, monté sur un support orientable, est éclairé par un faisceau laser de section et la lumière diffusée est détectée à l’aide d’un photomultiplicateur porté par le bras mobile d’un goniomètre. On peut ainsi faire varier l’angle d’incidence du faisceau incident par rapport au miroir et l’angle de diffusion correspondant au détecteur.
Ce dispositif donne accès à la fonction BRDF (bidirectional reflectance distribution function), définie comme le rapport entre l’énergie totale diffusée par unité d’angle solide et le produit de l’énergie incidente par le cosinus de l’angle de diffusion . En d’autres termes, le produit est le flux diffusé par unité de surface et d’angle solide, normé au flux incident. Ainsi, en déplaçant le miroir dans son plan on obtient la fonction BRDF en plusieurs points de sa surface pour une direction de diffusion donnée. La figure 34 montre une cartographie de diffusion d’une surface d’environ au centre du miroir pour des angles et fixés. Ce type de cartographie permet seulement d’avoir une idée générale concernant les pertes par diffusion auquel on doit s’attendre dans notre cavité à miroir mobile. En effet, pour une position donnée, le taux de diffusion obtenu est en fait une moyenne sur la section du miroir éclairée par le faisceau, section qui est relativement importante (). D’autre part, la diffusion dans une direction donnée n’est pas nécessairement représentative de la diffusion totale.
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant où sont repérés les miroirs que nous avons utilisé (lignes grisées). La troisième colonne indique la valeur de la fonction BRDF pour une direction de diffusion donnée, et moyennée sur toute la surface analysée. La quatrième colonne donne la valeur de la fonction au centre du miroir (section ). Enfin, les pertes totales par diffusion (cinquième colonne) sont obtenues en intégrant la courbe angulaire de la fonction BRDF dans le demi-espace, en supposant que la diffusion est la même dans toutes les directions. Ceci suppose des propriétés isotropes du traitement multidiélectrique. Les résultats obtenus montrent que les pertes par diffusion de nos miroirs sont importantes, ce qui est probablement lié à l’état de surface des substrats qui ne permet d’atteindre qu’au mieux des pertes de l’ordre de .
![[Uncaptioned image]](/html/quant-ph/0402145/assets/x35.png)
Il est important de noter que cette caractérisation ne nous permet pas de fixer une valeur assez précise pour la diffusion puisque dans le cas de notre expérience, la taille du faisceau au niveau du miroir mobile est au plus de l’ordre de . D’autre part, étant donné l’état de surface de nos substrats, la condition d’isotropie du traitement n’est probablement pas satisfaite ce qui peut induire un écart non négligeable par rapport aux valeurs obtenues. Nous verrons que nos mesures sur la cavité à miroir mobile permettent de donner des valeurs plus précises pour les pertes de nos miroirs.
Notons pour terminer que ces miroirs sont très fragiles : le dépôt de poussière augmente très rapidement les pertes par diffusion, jusqu’à des valeurs supérieures à . D’autre part, ces miroirs ne peuvent pas être nettoyés par les techniques usuelles employées pour des miroirs moins performants. C’est pourquoi nous avons installé l’ensemble de l’expérience sous un flux laminaire qui assure une propreté au niveau de la table optique correspondant à une salle blanche de classe .
4.1.2 Le coupleur d’entrée
La cavité optique est constituée du miroir mobile et d’un miroir qui sert de coupleur d’entrée et qui présente une transmission plus grande, mais néanmoins assez faible pour assurer une finesse élevée. Nous avons choisi d’utiliser des miroirs commerciaux fabriqués par Micro-controle Newport sous la dénomination de ”SuperMirrors” de série haute finesse. D’après les spécifications du constructeur, ces miroirs présentent une transmission de , des pertes (diffusion et absorption) du même ordre et une tenue au flux supérieure à . La taille de ces miroirs est beaucoup plus grande que celle des miroirs mobiles puisqu’ils ont une épaisseur de et un diamètre de . Le rayon de courbure de la face traitée est de .
Les pertes totales de la cavité sont égales à la somme des transmission , et des pertes , du miroir mobile et du coupleur Newport:
| (4.4) |
D’après les spécifications des miroirs fournies par les fabricants, ont devrait donc obtenir des cavités dont les pertes sont comprises entre et environ (soit des finesses comprises entre et ). Nous verrons dans les sections suivantes comment on peut déterminer ces pertes en mesurant les caractéristiques de la cavité telles que la bande passante, l’intervalle spectral libre et le coefficient de réflexion.
4.1.3 La cavité optique

Les deux miroirs de la cavité Fabry Perot sont montés dans un support en cuivre qui assure le centrage et le parallélisme des miroirs. Pour fixer la longueur de la cavité, nous avons utilisé un espaceur en cuivre, solidaire du support, de d’épaisseur. La figure 35 montre comment sont montés les différents éléments de la cavité. Les éléments , et sont des pièces en cuivre qui servent de support aux deux miroirs (miroir mobile) et (coupleur d’entrée). L’ensemble est tenu grâce à des lames de chrysocale qui exercent une contrainte uniforme sur les bords des miroirs, assurant ainsi une fixation stable des miroirs sans pour autant risquer de les endommager lors du serrage.
Une attention toute particulière doit être portée au parallélisme des deux faces du support sur lesquelles reposent les deux miroirs. En effet, un défaut de parallélisme d’un angle se traduit par un décalage de l’axe optique de la cavité d’une quantité par rapport au centre des miroirs ( est le rayon de courbure du coupleur d’entrée). Ceci a pour effet de modifier le recouvrement spatial entre le mode optique et les modes acoustiques du résonateur. Pour minimiser cet effet, le décalage doit être petit devant la taille des cols des premiers modes acoustiques, en particulier le col du mode fondamental qui est égal à pour un rayon de courbure du résonateur de (équation 3.43). On se fixe donc une tolérance sur le décalage inférieure au millimètre, ce qui impose un parallélisme entre les surface de la pièce meilleur que , c’est à dire une variation d’épaisseur sur le diamètre du miroir mobile inférieure à . Nous n’avons pas constaté de décentrage notable de l’axe optique de la cavité avec les pièces réalisées par B. Rodriguez à l’atelier de mécanique du laboratoire, mais cette contrainte rend difficile l’usinage d’une pièce en cuivre avec un espaceur d’épaisseur inférieure au millimètre.
Pour obtenir une cavité de longueur avec un parallélisme correct entre les deux miroirs, nous avons construit un autre support de cavité dans lequel on utilise un espaceur en silice de d’épaisseur et de même diamètre que le miroir mobile. Dans cette configuration, les deux miroirs sont séparés par l’espaceur qui est en contact direct avec les deux miroirs. Selon les spécifications du fabriquant Maris Delfour, on obtient ainsi un parallélisme inférieur à . Notons cependant que le montage de cette cavité est plus délicat du fait de la faible épaisseur de l’espaceur en silice qui peut facilement se casser lors du montage de l’ensemble de la cavité.
Nous avons enfin construit un troisième support pour une cavité utilisant deux miroirs Newport courbes. L’espaceur est en cuivre, formant ainsi une cavité bi-convexe () de d’épaisseur. Comme nous le verrons plus loin, l’étude de cette cavité permet de déterminer séparément les caractéristiques des coupleurs Newport et du miroir mobile.
4.1.4 Caractéristiques de la cavité
Nous allons maintenant présenter les mesures qui nous ont permis de déterminer les caractéristiques de la cavité. Nous avons utilisé trois miroirs mobiles (notés , , sur le tableau de la page 4.1.1.2) et deux miroirs Newport de rayon de courbure d’un mètre (notés et ). Cet ensemble de miroirs nous a permis de réaliser plusieurs cavités en combinant un coupleur Newport avec l’un des miroirs mobiles, ainsi qu’une cavité utilisant les deux miroirs Newport. Pour chaque cavité nous avons mesuré la bande passante, l’intervalle spectral libre et le coefficient de réflexion à résonance. Ces mesures nous ont permis de déterminer la finesse et la longueur de chaque cavité, les pertes totales des miroirs et la transmission du coupleur d’entrée. La combinaison de ces résultats permet en outre de déterminer pour chaque miroir les pertes et le coefficient de transmission.
4.1.4.1 Alignement et adaptation de la cavité
La cavité présente des résonances longitudinales auxquelles sont associées une série de résonances transversales. Dans l’approximation paraxiale la structure spatiale des modes propres est gaussienne et le mode fondamental est caractérisé par un col situé au niveau du miroir plan et dont la taille est donnée par[49]:
| (4.5) |
où est le rayon de courbure du miroir Newport et est la longueur de la cavité, égale à ou . Selon la longueur de la cavité, la taille du col est comprise entre et . La longueur de la cavité définit l’écart en fréquence entre deux résonances longitudinales successives. Cet intervalle spectral libre est donné par:
| (4.6) |
L’intervalle spectrale libre est de pour une longueur de et de pour une longueur de . La position relative en fréquence des modes transverses associés au fondamental dépend non seulement de la longueur mais aussi du rayon de courbure [49]:
| (4.7) |
Cette relation montre que les modes transverses correspondant à des valeurs différentes de () ont des fréquences de résonance différentes. La dégénérescence en () est liée à la symétrie cylindrique de la cavité.
Comme nous le verrons dans la section 4.2.4, le faisceau issu de la source laser est filtré spatialement de façon à ce que sa structure spatiale soit parfaitement gaussienne . On dispose d’un système à deux lentilles de focales et qui permet de transformer le faisceau pour que son col soit égal à et situé au niveau du miroir mobile de la cavité. On utilise enfin un système de deux miroirs montés dans des supports réglables pour aligner le faisceau sur la cavité. On réalise un pré-alignement en observant la structure de la lumière transmise par la cavité. Etant donnée la faible intensité transmise par le miroir mobile, on utilise une caméra infrarouge directement placée derrière la cavité : une tâche unique centrée sur le miroir indique un alignement correct.
Pour optimiser l’adaptation spatiale, il est nécessaire de balayer le désaccord entre le faisceau incident et la cavité. Pour des raisons de stabilité, les cavités que nous utilisons sont rigides et ne disposent pas de cale piézoélectrique permettant de balayer la longueur de la cavité. Il est donc nécessaire de balayer la fréquence de la source laser sur une plage d’au moins pour trouver les résonances de la cavité. Comme nous le verrons dans la partie suivante consacrée à la source laser, nous disposons de trois dispositifs de balayage : le bilame du laser titane saphir permet de faire un balayage continu sur plusieurs dizaines de gigahertz, tandis que des sauts de fréquence de ou peuvent être réalisés avec l’étalon mince ou le filtre de Lyot. Un lambdamètre de résolution égale à permet de se repérer au cours du balayage. On contrôle l’adaptation spatiale du faisceau incident en mesurant l’intensité transmise à l’aide d’une photodiode placée derrière la cavité. En balayant continuement la fréquence du laser, on visualise les pics de transmission associés aux différents modes transverses de la cavité.

La figure 36 montre le résultat obtenu avec la cavité constituée par le miroir mobile (voir tableau page 4.1.1.2) et le miroir Newport , séparés par l’espaceur en silice de . On observe un grand pic qui correspond au mode fondamental de la cavité suivi des premiers modes transverses fortement atténués du fait de l’adaptation entre le faisceau et le mode fondamental. Le balayage en fréquence a été réalisé en appliquant une rampe linéaire sur le bilame du laser titane saphir. Ce balayage a été étalonné en utilisant une cavité de référence (cavité de filtrage de la source laser). On observe que l’écart entre le fondamental et les deux modes transverses et est de , ce qui correspond bien au résultat obtenu en utilisant la relation (4.7). Un agrandissement autour des pics permet de visualiser la forme des résonances, et en particulier la levée de dégénérescence des modes transverses liée sans doute à une dissymétrie du rayon de courbure du coupleur. Par ailleurs, le rapport entre la hauteur des modes transverses et celle du fondamental permet d’évaluer l’adaptation spatiale entre le faisceau incident et le mode fondamental. Seuls les deux premières harmoniques transverses sont visibles et leur hauteur est atténuée d’un facteur supérieur à par rapport au fondamental. La puissance lumineuse couplée au mode fondamental de la cavité est donc de l’ordre de de la puissance incidente.
La figure 36 permet par ailleurs d’évaluer la bande passante de la cavité. Il s’agit ici simplement d’une évaluation, le pic étant légèrement dissymétrique, sans doute à cause d’effets thermiques dans la cavité lors du passage à résonance. Nous verrons plus loin comment la bande passante peut être déterminée plus précisément. La largeur à mi-hauteur du pic d’Airy sur la figure 36 est de l’ordre de à , correspondant à une bande passante de à . On peut alors estimer la finesse sachant que l’intervalle spectral libre est égal à . On trouve une finesse comprise entre et . Une détermination plus précise est présentée dans la section suivante.
Nous avons par ailleurs cherché à caractériser la tenue au flux des miroirs. La cavité {, } supporte une puissance incidente de , sans dégradation des caractéristiques ni dommage pour les miroirs. La puissance intracavité est dans ce cas de l’ordre de quelques Watts et le flux de photon est de l’ordre de quelques dizaines de kilowatts par centimètre carré. La tenue au flux est donc bien meilleure que les valeurs annocées par le fabricant ( pour le coupleur Newport).
4.1.4.2 Mesure de la bande passante de la cavité
L’intensité intracavité est maximum lorsque la fréquence du faisceau incident coïncide avec une résonance de la cavité. Lorsqu’on s’écarte de part et d’autre de cette position en modulant par exemple la fréquence du laser, l’intensité diminue en décrivant une lorentzienne de largeur à mi-hauteur égale à , où est la bande passante de la cavité. On retrouve ce comportement dans l’intensité transmise par la cavité puisque celle-ci est proportionnelle à l’intensité intracavité. Par ailleurs, la bande passante est reliée à la finesse de la cavité par la relation:
| (4.8) |
Cette relation permet de déterminer la finesse à partir de la mesure de la bande passante et de la longueur de la cavité. Pour mesurer la bande passante, on utilise une cavité Fabry-Perot de référence dont on connaît la bande passante et on compare les deux largeurs des résonances pour en déduire celle de la cavité à miroir mobile. Nous verrons dans la section 4.2.4 comment nous avons mesuré la bande passante de la cavité de référence, qui est en fait la cavité de filtrage spatial de la source laser. Le résultat de la mesure donne une bande passante égale à pour cette cavité de référence.
On observe les résonances de la cavité en modulant la fréquence du laser à et en détectant l’intensité transmise par la cavité de référence puis celle transmise par la cavité à miroir mobile. La première mesure permet de calibrer la modulation de fréquence du laser. La figure 37 montre d’une part la résonance de la cavité de référence de largeur à mi-hauteur égale à et la résonance de la cavité à miroir mobile constituée du couple de miroirs {, } séparés par l’entretoise en silice de d’épaisseur. On obtient une bande passante égale à , correspondant à une finesse de . Nous avons repris la même procédure de mesure en utilisant différents miroirs mobiles tout en gardant le même coupleur , et on obtient globalement des finesses comprises entre et . Nous avons aussi mesuré la finesse de la cavité formée des deux miroirs Newport {, } et on obtient une finesse de .

Cette mesure de la finesse permet d’évaluer les pertes totales dans la cavité, c’est à dire la somme des transmissions et des pertes des deux miroirs (équation 4.4). A ce stade, il n’est pas possible de discriminer entre les transmissions et les pertes de chaque miroir. Si on veut déterminer séparément les caractéristiques des miroirs, il est nécessaire de réaliser d’autres mesures, en particulier la mesure du coefficient de réflexion à résonance de la cavité.
4.1.4.3 Mesure du coefficient de réflexion de la cavité
Nous avons vu dans la partie 2.3 que le champ réfléchi par une cavité à une seule entrée-sortie a la même intensité que le champ incident. Ceci n’est vrai que pour une cavité sans perte : en présence de pertes, l’intensité réfléchie présente un pic d’Airy en absorption au voisinage de la résonance. On peut calculer l’intensité réfléchie en décrivant chaque miroir par un coefficient de réflexion en amplitude, un coefficient de transmission et un coefficient de perte (les carrés de ces coefficients sont égaux aux paramètres , , introduits dans la section 4.1.1). La conservation de l’énergie au niveau des deux miroirs se traduit par la relation:
| (4.9) |
Les champs moyens sont reliés par des équations similaires aux relations (2.37) et (2.38):
| (4.10a) | |||||
| (4.10b) | |||||
| (4.10c) | |||||

où est le champ intracavité revenant sur le miroir d’entrée (figure 38) et le déphasage moyen du champ dans la cavité. En éliminant les champs intracavité et , on obtient la relation d’entrée-sortie pour le champ moyen:
| (4.11) |
où est le coefficient de transmission en intensité du miroir d’entrée et représente les pertes totales de la cavité, reliées aux coefficients de transmission et de perte en intensité des deux miroirs par l’équation (4.4).
On obtient ainsi l’expression du coefficient de réflexion en intensité à résonance , que l’on peut exprimer en fonction de la finesse et du coefficient de transmission du coupleur d’entrée:
| (4.12) |
Ce résultat montre que l’on peut déterminer la transmission du coupleur si on mesure à la fois la finesse et le coefficient de réflexion de la cavité.
Le coefficient de réflexion est obtenu expérimentalement en faisant le rapport entre l’intensité réfléchie lorsque la cavité est à résonance avec le faisceau incident et l’intensité incidente . En dehors de la résonance, le faisceau incident est totalement réfléchi par la cavité et dans ce cas l’intensité réfléchie est égale à l’intensité incidente. Il suffit donc de balayer la fréquence du laser autour de la résonance et de mesurer l’intensité réfléchie à résonance et loin de la résonance pour en déduire le coefficient de réflexion . Cette méthode permet en outre de s’affranchir des pertes subies par le faisceau incident, comme par exemple la réflexion sur la face avant du miroir d’entrée, et des pertes dans le système de détection.
Par contre, cette expression du coefficient de réflexion ne tient pas compte de l’adaptation spatiale entre le faisceau et la cavité. En fait, le faisceau incident ne se projette pas seulement sur le mode fondamental de la cavité, mais sur l’ensemble des modes propres que l’on peut caractériser par une base orthonormée {}:
| (4.13) |
L’adaptation est définie par le paramètre qui est égal à la proportion de la puissance lumineuse incidente qui se projette sur le mode fondamental.
Au voisinage de la résonance du mode fondamental, seul le terme dans la somme (4.14) est modifié, les autres termes () étant totalement réfléchis. On trouve ainsi pour les intensités réfléchies à résonance et hors résonance les expressions suivantes:

| (4.14a) | |||||
| (4.14b) | |||||
| Le coefficient de réflexion à résonance que l’on mesure expérimentalement s’écrit alors en fonction du coefficient (équation 4.12) et du coefficient d’adaptation spatiale : | |||||
| (4.15) |
Pour une adaptation parfaite (), l’expression de se réduit à celle de . Par contre, dès que est inférieur à , la valeur mesurée est différente de la valeur théorique donnée par l’équation (4.12). Etant donné la qualité de l’adaptation spatiale réalisée dans l’expérience (), cet écart se traduit par une modification de l’évaluation du coefficient de transmission de quelques seulement. Nous avons donc tenu compte de l’adaptation spatiale à l’aide de l’équation (4.15), mais sans chercher à déterminer plus précisément le coefficient .
La figure 39 montre l’intensité réfléchie par la cavité , lorsqu’on balaye la fréquence du faisceau incident. On mesure à partir de ce résultat les intensités et , qui correspondent à un coefficient de réflexion égal à et un coefficient théorique de . En utilisant l’expression (4.12) et la valeur obtenue précédemment pour la finesse (), on trouve que le coefficient de transmission du coupleur Newport est égal à . Nous avons répété cette mesure pour différentes cavités, constituées de différents miroirs mobiles mais toujours avec le même coupleur d’entrée . Nous avons obtenu des valeurs de la transmission du coupleur comprises entre et . Nous avons aussi mesuré la transmission du coupleur Newport et nous avons trouvé une transmission de . Ces résultats sont en très bon accord avec les valeurs annoncées par le fabriquant.
La mesure de la finesse et du coefficient de réflexion à résonance permettent donc de déterminer la transmission du coupleur d’entrée. A partir de l’équation (4.4), on peut aussi déterminer la somme des pertes totales (transmission plus pertes) du miroir mobile et des pertes du coupleur Newport. Ainsi pour la cavité {, }, on trouve:
| (4.16) |
Ces mesures ne permettent pas cependant de séparer les pertes du miroir mobile de celles du coupleur d’entrée.
4.1.4.4 Mesure des pertes du miroir mobile
Il est possible de séparer les pertes du miroir mobile de celles du coupleur d’entrée en répétant les mesures précédentes pour différentes cavités. On utilise en fait trois miroirs, le miroir mobile et les deux coupleurs Newport et . On peut ainsi former les trois cavités {, }, {, } et {, }, et mesurer leur bande passante et leur coefficient de réflexion à résonance . Le tableau suivant résume les mesures effectuées:
![[Uncaptioned image]](/html/quant-ph/0402145/assets/x41.png)
Nous avons utilisé pour ces mesures les supports de cavité avec espaceur en cuivre, dont la longueur est environ . Pour déterminer précisément la longueur de la cavité, nous avons mesuré l’intervalle spectral libre de chaque cavité. Pour cela on fait varier la longueur d’onde de la source laser de façon à passer d’un mode de la cavité au suivant. On parcourt ainsi un intervalle spectral libre de la cavité et on peut déduire la longueur de la cavité en mesurant la variation de longueur d’onde à l’aide d’un lambdamètre dont la précision est de (la longueur d’onde est de l’ordre de ).
Les trois premières colonnes du tableau présentent les résultats des mesures concernant la bande passante de la cavité déterminée par comparaison avec la cavité de référence, le coefficient de réflexion à résonance et la variation de la longueur d’onde correspondant à un intervalle spectral libre. La quatrième colonne donne la longueur de la cavité déduite de la mesure de . Notons que les valeurs obtenues sont en bon accord avec une longueur de l’espaceur de , à condition de tenir compte de la courbure des miroirs Newport. La distance selon l’axe de la cavité entre le centre du miroir Newport et son bord est en effet de .
La cinquième colonne du tableau présente la finesse de la cavité obtenue à partir des équations (4.6) et (4.8), en utilisant les valeurs de la bande passante et la longueur de la cavité. Les deux dernières colonnes présentent la transmission du coupleur d’entrée et la somme des pertes du miroir arrière et du coupleur, déduites de la finesse et du coefficient de réflexion à résonance mesuré avec une adaptation spatiale de .
On voit que la dernière colonne fournit des valeurs pour des combinaisons linéaires différentes des pertes , et des trois miroirs, à partir desquelles on peut déterminer les valeurs de chacune de ces pertes. On trouve ainsi que les pertes totales du miroir mobile sont égales à , alors que les pertes des coupleurs Newport sont respectivement et . Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats de nos mesures pour tous les miroirs que nous avons utilisés:
![[Uncaptioned image]](/html/quant-ph/0402145/assets/x42.png)
On constate que les caractéristiques des miroirs Newport sont conformes aux spécifications du constructeur. Par contre les pertes des miroirs mobiles sont plus importantes que prévu. Ceci pourrait être dû à un mauvais état de surface des substrats, qui induirait des déformations des couches multidiélectriques. Ces déformations peuvent entraîner une absorption plus importante dans les couches multidiélectriques et une augmentation de la transmission de l’ensemble des couches.
Notons que le désaccord apparent entre les valeurs mesurées ici et les pertes par diffusion mesurées à l’Institut de Physique Nucléaire (tableau page 4.1.1.2) peut s’expliquer en comparant le principe des deux méthodes : ici on mesure les pertes totales du miroir pour un faisceau lumineux de rayon inférieur à , alors que le diffusomètre mesure les pertes diffusées dans une direction donnée, pour un faisceau incident de section égale à .
On peut enfin estimer la précision de nos mesures. Les résultats n’ont de sens que si la qualité des miroirs est suffisamment homogène au voisinage du centre des miroirs. Le col du faisceau lumineux étant inférieur à , la zone du miroir sur laquelle se réfléchit la lumière peut être différente d’une cavité à l’autre. Nous n’avons pas cependant constaté de variations appréciables lors de nos différents essais de cavité. A partir de toutes les mesures que nous avons effectuées et des recoupements que l’on peut faire entre elles, on peut conclure que l’incertitude sur la mesure des pertes est de l’ordre de .
4.2 La source laser
Du fait des contraintes imposées par la cavité à miroir mobile, nous avons été amenés à concevoir une source laser adaptée à nos besoins. Cette source doit pouvoir fonctionner selon trois régimes distincts :
- Pour trouver la résonance de la cavité à miroir mobile, il est nécessaire de balayer la fréquence de la cavité sur une plage d’au moins . Ce balayage n’a cependant pas besoin d’être effectué en continu. Lors de la procédure de réglage de l’adaptation spatiale du faisceau sur la cavité, celle-ci présente un peigne large de résonances correspondants aux différents modes transverses. Il suffit en fait de pouvoir balayer en continu quelques intervalles entre modes transverses (typiquement ), et de faire des sauts de fréquence discontinus pour explorer l’ensemble du peigne. On dispose aussi d’un lambdamètre de façon à repérer à tout instant la longueur d’onde du faisceau laser.
- Une fois l’adaptation spatiale réalisée, on utilise une rampe de modulation de la fréquence du laser afin de parcourir le pic d’Airy de la résonance. Ceci permet en particulier de déterminer la finesse de la cavité. Cette rampe doit avoir une excursion plus large que la bande passante de la cavité (typiquement à ) et une fréquence de modulation de l’ordre de .
- En fonctionnement normal, la fréquence du laser doit être contrôlée de façon à correspondre à la résonance de la cavité à miroir mobile. Il est ainsi nécessaire de réduire les fluctuations de fréquence du laser à une valeur petite devant la bande passante de la cavité, et de contrôler les dérives lentes entre la fréquence du laser et celle de la cavité à miroir mobile. D’autre part, nous avons vu dans la partie 2.3 que la cavité est un système bistable : à cause du terme de déphasage non linéaire, le désaccord entre la résonance de la cavité et la fréquence du laser dépend de l’intensité incidente. Il faut par conséquent contrôler l’intensité de la source laser, de façon à pouvoir ajuster l’intensité moyenne à une valeur précise et réduire ses fluctuations basse fréquence. Enfin le faisceau doit être parfaitement adapté spatialement au mode fondamental de la cavité.
Ces contraintes nous ont amenés à choisir un laser titane saphir. Ce laser est facilement balayable, de manière répétitive et contrôlée. La longueur d’onde de notre laser se situe aux alentours de , valeur pour laquelle on sait faire d’excellents miroirs ayant une bonne tenue au flux. Ce laser fournit une puissance importante, de l’ordre du Watt, ce qui permet de l’utiliser aussi pour l’excitation optique des modes acoustiques du résonateur. Enfin le laser titane saphir fournit un faisceau dont le bruit technique reste modéré : les fluctuations d’intensité et de phase se réduisent aux fluctuations quantiques pour des fréquences supérieures à , et l’excès de bruit à plus basse fréquence n’excède pas à . La situation aurait été différente avec des diodes lasers par exemple, qui présentent un bruit de phase important même à haute fréquence. Ce bruit aurait pu être préjudiciable pour une mesure précise de la quadrature de phase du faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile. Il est par ailleurs important pour l’étude des effets quantiques du couplage optomécanique que l’intensité du faisceau incident soit au niveau du bruit de photon standard aux fréquences d’analyse. Nous verrons dans la partie 4.5 comment la cavité de filtrage spatial du faisceau laser peut être utilisée pour réduire le bruit technique basse fréquence du faisceau.
L’ensemble de notre source lumineuse comporte essentiellement cinq
éléments comme le montre la figure 40.
L’élément principal est le laser titane saphir (I) qui produit un
faisceau lumineux monomode, balayable, et de forte puissance. Les fluc-
tuations de fréquence du mode laser (jitter) étant importantes, on
utilise un système de stabilisation en fréquence (II) qui réduit
considérablement ces fluctuations. Les deux éléments (III) et
(IV) assurent respectivement la stabilité en intensité du faisceau
et le filtrage spatial. On obtient ainsi à l’entrée de la cavité
à miroir mobile un faisceau monomode balayable, stable en
fréquence et en intensité. Enfin, une boucle d’asservissement
supplémentaire (V) vient se rajouter au système de stabilisation en
fréquence pour maintenir le laser à résonance avec la cavité
à miroir mobile. Nous allons présenter plus en détail dans les
sections suivantes ces cinq éléments.

4.2.1 Le laser titane saphir
Nous avons construit le laser titane saphir selon le modèle développé au laboratoire par F. Biraben[47]. Comme le montre la figure 41, il s’agit d’une cavité en anneau dans laquelle sont disposés les différent éléments optiques. La cavité a une longueur de , ce qui correspond à un intervalle spectral libre de . Les miroirs à sont totalement réfléchissants () alors que le miroir sert de coupleur de sortie et a une transmission de . Le miroir est monté sur une cale piézoélectrique utilisée pour des corrections lentes de l’asservissement en fréquence. Le cristal Titane-Saphir - (① sur la figure 41), taillé à l’angle de Brewster, est pompé par un laser à Argon ionisé continu (Coherent INNOVA 400), utilisé en mode multiraies avec une puissance de . Les miroirs sphériques et ( de rayon de courbure) sont dichroïques avec un coefficient de transmission pour les raies de l’Argon égal à . Le rayon de courbure des miroirs est choisi de façon à focaliser le faisceau au niveau du cristal ce qui permet d’augmenter l’émission stimulée par rapport à l’émission spontanée.

Parmi les éléments placés dans la cavité, on trouve le rotateur de Faraday (② sur la figure 41) constitué d’une lame de verre Hoya ayant une forte constante de Verdet, d’épaisseur et d’un aimant créant un champ magnétique de environ. Le rôle du rotateur de Faraday est de forcer le sens de propagation du faisceau lumineux. Dans un laser en anneau, il y a a priori deux ondes progressives se propageant en sens inverse. Le rotateur de Faraday fait tourner la polarisation du faisceau d’un angle indépendant du sens de propagation du faisceau. Il est associé à un système formé des miroirs non coplanaires , et ( est situé au dessus du plan du laser) pour assurer un fonctionnement unidirectionnel du laser : ces miroirs compensent la rotation de polarisation due à l’effet Faraday pour un sens de propagation et l’augmentent pour l’autre. Du fait de la présence d’éléments polarisants (lames à incidence de Brewster), le faisceau se propageant dans le second sens subit des pertes. La différence des pertes entre les deux sens de propagation est suffisante pour que la compétition entre modes assure un fonctionnement monodirectionnel stable, dans la direction indiquée par une flèche sur la figure 41.
Les autres éléments servent essentiellement à la sélection de la fréquence d’émission du laser. La courbe de fluorescence du cristal Titane-Saphir est très large comparée à l’intervalle entre les modes longitudinaux de la cavité laser, ce qui se traduit par une émission laser multimode. Pour rendre ce comportement monomode, on utilise trois éléments sélectifs en fréquence. Le premier est le filtre de Lyot (③ sur la figure 41) qui sélectionne une bande de fréquence de quelque centaines de gigahertz. Ce filtre est constitué de quatre lames biréfringentes placées à incidence de Brewster. Afin que toutes les lames sélectionnent la même longueur d’onde, leurs axes optiques sont parallèles et leur épaisseur sont choisies dans les rapports 1, 2, 4, 16, la lame la plus mince faisant d’épaisseur. Ces lames sont placées dans un support qui peut tourner dans le plan des lames grâce à un moteur électrique, modifiant ainsi la zone de fréquence sélectionnée.
Le second élément sélectif est l’étalon mince (④ sur la figure 41) qui est constitué d’une lame en silice d’indice , non traitée optiquement et de d’épaisseur. Cet élément joue le rôle d’une cavité Fabry-Perot d’intervalle spectral libre égal à . La lame est placée sur un support que l’on peut incliner par rapport au faisceau laser grâce à un système de bras de levier commandé par un moteur. On modifie ainsi l’épaisseur optique de la lame et donc la fréquence sélectionnée. Lorsqu’on effectue un balayage de la fréquence du laser, l’intensité transmise par la lame diminue tandis que l’intensité réfléchie augmente. Pour maintenir la lame à résonance (transmission maximale) durant un tel balayage, on utilise un asservissement qui pilote le moteur de façon à minimiser l’intensité réfléchie. Le signal d’erreur est obtenu en faisant la différence entre l’intensité détectée en réflexion sur la lame et celle détectées à la sortie du laser. Un équilibrage électronique entre ces deux intensités permet de fixer le point de fonctionnement de l’asservissement au voisinage du minimum d’intensité réfléchie.
Le dernier élément sélectif en fréquence est l’étalon épais qui est en fait une cavité Fabry-Perot (⑤ sur la figure 41). Il est formé par deux prismes dont les faces en regard sont traitées pour avoir un coefficient de réflexion d’environ . L’épaisseur de ce Fabry-Perot est d’environ , correspondant à un intervalle spectral libre de . L’un des deux prismes est monté sur une cale piézoélectrique afin de modifier la fréquence de résonance. Cette fréquence est asservie sur la fréquence du mode laser grâce à une détection synchrone. Le principe de cet asservissement consiste à moduler la longueur du Fabry-Perot à une fréquence de . Ceci induit une modulation de l’intensité en sortie du laser, dont l’amplitude est proportionnelle au désaccord entre la résonance de l’étalon épais et la fréquence du mode laser sélectionné. Ce signal est détecté par une photodiode placée à la sortie du laser et envoyé dans une détection synchrone. Le signal d’erreur pilote la cale piézoélectrique de l’étalon épais.
Le fonctionnement monomode du laser est assuré lorsque ces trois éléments sélectifs sont centrés sur un mode de la cavité laser. Lorsque ces éléments sont réglés et que les asservissements du Fabry-Perot épais et de l’étalon mince sont verrouillés, on obtient à la sortie du laser titane saphir un faisceau monomode d’une puissance de sur une plage de longueur d’onde comprise entre et . Les caractéristiques spatiales du faisceau, mesurées à l’aide d’un analyseur de modes (mode master Coherent), correspondent à un col égal à situé à environ du miroir de sortie du laser et à une longueur de Raighley égale à . Notons aussi que le faisceau présente un astigmatisme relativement important (environ ) lié essentiellement à des effets de lentille dus à l’échauffement du cristal Titane-Saphir qui absorbe une partie importante du faisceau pompe. Du fait de cet astigmatisme, le faisceau à la sortie du laser n’est pas parfaitement gaussien et nous verrons par la suite comment obtenir un faisceau gaussien en utilisant une cavité de filtrage.
Le dernier élément (⑥ sur la figure 41) est un bilame qui permet de balayer de manière continue la fréquence du laser. Ce dispositif est constitué de deux lames de d’épaisseur placées au voisinage de l’incidence de Brewster. Un système mécanique motorisé permet de faire tourner les lames de manière symétrique, ce qui a pour effet de varier la longueur optique de la cavité et donc la fréquence du laser, sans déplacer le faisceau. Les asservissements de la cavité permettent un balayage continu de la fréquence du laser sur plusieurs dizaines de gigahertz. On peut par ailleurs effectuer des excursions de par saut de modes de l’étalon épais en inclinant l’étalon mince, ou encore de par saut de modes de l’étalon mince en tournant les lames du Lyot. Pour se repérer lors de ces sauts de modes, on mesure la longueur d’onde du faisceau à l’aide d’un lambdamètre. Cette procédure permet de parcourir facilement un intervalle spectral libre de la cavité à miroir mobile, qui est de pour une longueur de .
4.2.2 Stabilisation en fréquence
Le faisceau issu du laser titane saphir est monomode et balayable en fréquence, mais il présente d’importantes fluctuations de fréquence (jitter) liées aux vibrations mécaniques des différents éléments optiques de la cavité laser. Ces fluctuations de fréquence ont une amplitude de l’ordre du mégahertz et elles ne permettent pas de définir un point de fonctionnement précis de la cavité à miroir mobile. Il est donc impératif de réduire ces fluctuations de telle sorte qu’elles soient négligeables devant la bande passante de la cavité qui est de l’ordre de . On utilise pour cela une cavité extérieure très stable mécaniquement et on asservit la fréquence du laser sur la résonance de cette cavité.
4.2.2.1 Cavité Fabry-Perot externe
La stabilisation en fréquence du laser est réalisée à l’aide d’un asservissement utilisant la méthode des bandes latérales[48] en réflexion sur une cavité Fabry-Perot externe (FPE). Cette cavité est formée d’un coupleur d’entrée plan fixé sur une cale piézoélectrique et d’un miroir de fond sphérique () de grande réflectivité. Les coefficients de réflexion des deux miroirs sont respectivement égaux à et . La cavité est montée sur un barreau en invar (de coefficient de dilatation très faible) de de long. Elle est isolée des vibrations mécaniques de la table grâce à une boite cylindrique en laiton à l’intérieur de laquelle la cavité est suspendue par des tiges élastiques. L’intervalle spectral libre de la cavité est de et sa finesse est égale à .
Une petite partie du faisceau est prélevée à la sortie du laser par une lame pour être envoyée dans la cavité FPE (figure 42). Pour adapter spatialement le faisceau laser au mode fondamental de la cavité FPE, on utilise un système de deux lentilles convergentes. Le but de l’adaptation est de transformer le col du laser en un col qui correspond au mode fondamental de la cavité FPE. D’après les caractéristiques géométriques de la cavité FPE, ce col se trouve au niveau du miroir plan et il est égal à (équation 4.5). En fonction de l’emplacement de la cavité FPE par rapport au laser titane saphir, nous avons choisi une première lentille de focale placée à du col . La seconde lentille de focale est placée plus loin sur un support micrométrique qui permet d’ajuster la position de la lentille selon l’axe de propagation. En variant la distance entre les deux lentilles, on change à la fois la taille et la position du col image. Cependant, le choix des focales est tel que seul la taille du col image varie de façon appréciable lorsqu’on translate la seconde lentille. L’alignement du faisceau sur la cavité est réalisé à l’aide de deux miroirs montés sur des supports micrométriques (, sur la figure 42). En jouant sur la distance entre les deux lentilles et l’alignement du faisceau, on arrive à adapter assez précisément le faisceau sur la cavité, puisque le recouvrement du faisceau avec le mode fondamental de la cavité est de l’ordre de .
Avant d’être envoyé dans la cavité FPE, le faisceau traverse un dispositif constitué d’un cube séparateur de polarisation et d’une lame (figure 42). Le faisceau incident sur la cavité a ainsi une polarisation circulaire. Le faisceau réfléchi retourne sur le cube avec une polarisation linéaire orthogonale à la polarisation incidente et il est éjecté par le cube. Ce dispositif permet donc de séparer le faisceau réfléchi du faisceau incident, afin de mesurer l’intensité réfléchie à l’aide d’une photodiode.
4.2.2.2 Signal d’erreur produit par la méthode des bandes latérales

Le principe de l’asservissement par bandes latérales est schématisé sur la figure 42. Il consiste à créer une courbe en dispersion ayant à la fois une pente importante au voisinage de la résonance et une large plage de capture en fréquence. Le faisceau incident traverse un modulateur électro-optique (EO) piloté par un synthétiseur afin de moduler la phase du faisceau (de fréquence optique ) à une fréquence égale à . La fréquence de modulation est choisie de façon à être grande par rapport à la bande passante de la cavité FPE et petite devant l’intervalle entre modes transverses de la cavité (). Lorsque l’amplitude de modulation est suffisamment faible, on obtient à l’entrée de la cavité un champ qui présente deux raies latérales de fréquences en quadrature de phase par rapport à la porteuse de fréquence ( et sont supposés réels):
| (4.17) |
Au voisinage de la résonance, la porteuse est réfléchie avec un coefficient de réflexion qui dépend de son désaccord avec la cavité et dont l’expression est donnée par l’équation (4.11). Les deux bandes latérales sont quand à elles directement réfléchies puisqu’elles se trouvent en dehors de la résonance. Le champ réfléchi par la cavité s’écrit alors:
| (4.18) |
Le faisceau réfléchi est détecté par une photodiode qui fournit un signal proportionnel à l’intensité du champ . Le signal est amplifié puis filtré, pour éliminer les éventuelles harmoniques de la modulation à , avant d’être envoyé sur un mélangeur qui démodule le signal à la fréquence en utilisant comme signal de référence la modulation utilisée pour piloter l’électro-optique (figure 42). La phase relative entre les deux entrées du mélangeur est ajustée en modifiant la longueur du câble coaxial reliant le synthétiseur au mélangeur. Le signal à la sortie du mélangeur est alors proportionnel à la composante de fréquence de l’intensité du faisceau réfléchi, c’est à dire au battement entre les bandes latérales et la porteuse:
| (4.19) |
où et sont respectivement la transmission du coupleur d’entrée et les pertes totales de la cavité. Cette expression montre que le signal d’erreur reproduit en fonction du désaccord une courbe de dispersion qui s’annule à résonance en changeant de signe. Le signal d’erreur obtenu à la sortie du mélangeur est à nouveau filtré (filtre passe-bas à ) pour éliminer tout résidu à la fréquence de modulation .

En pratique, le modulateur électro-optique est un modèle New Focus résonnant à , monté sur une platine de positionnement New Focus de façon à l’aligner précisément sur le faisceau. Le synthétiseur et le mélangeur ont été réalisés au laboratoire à partir d’éléments Mini Circuit. Le synthétiseur fournit une puissance de modulation de sur chacune de ses voies, la voie pilotant l’électro-optique étant réglable de façon à ajuster la profondeur de modulation. Le bloc photodiode est un système rapide et à faible bruit composé d’une photodiode () suivi par un préamplificateur transimpédance architecturé autour d’un . Ce dispositif est similaire à ceux utilisés pour la détection du faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile; il est présenté plus en détail dans la section 4.3.3.
La figure 43 représente le signal à la sortie du mélangeur lorsque la longueur de la cavité FPE est balayée autour de la résonance, à l’aide d’une rampe de tension appliquée sur la cale piézoélectrique du miroir plan. L’écart de entre les bandes latérales permet d’étalonner l’axe horizontal. On constate sur cette figure que le signal d’erreur présente une très grande pente au voisinage de la résonance (environ pour ). Ainsi le signal d’erreur est très sensible à des petites fluctuations de fréquence autour de la résonance. D’autre part, la plage de capture est très large, de l’ordre de autour de la résonance. On est ainsi assuré que l’asservissement sera capable de ramener la fréquence du laser à résonance avec la cavité FPE dès que le désaccord est inférieur à .
4.2.2.3 Stabilisation en fréquence du laser
Le signal d’erreur est utilisé pour agir sur la fréquence du laser titane saphir de façon à maintenir celle-ci à résonance avec la cavité FPE. On agit en fait sur la longueur de la cavité laser en pilotant la cale piézoélectrique du miroir (figure 41). Pour corriger des fluctuations à haute fréquence, on agit aussi sur l’électro-optique interne du laser (⑦ sur la figure 41), ce qui a pour effet de modifier la longueur optique de la cavité.
Afin de réaliser un asservissement efficace sur une large plage de fréquence, nous avons construit un dispositif à trois boucles d’asservissement en parallèle. Un schéma général de l’électronique de commande est présenté sur la figure 44. Le signal d’erreur obtenu à l’aide de la méthode des bandes latérales est envoyé dans un préamplificateur qui fournit trois signaux , et . La voie lente pilote la cale piézoélectrique du miroir du titane saphir, par l’intermédiaire d’un amplificateur haute tension capable de fournir de grandes amplitudes (-). Du fait du poids du miroir , la fréquence de résonance de cette voie se situe aux alentours du kilohertz. Cette boucle d’asservissement permet donc de corriger à basse fréquence d’importantes variations de longueur de la cavité laser. Cet amplificateur a aussi une entrée qui permet de moduler à faible vitesse la fréquence du laser (entrée modulation lente sur la figure 44). Comme expliqué dans l’introduction de cette partie, cette entrée est utilisée pour parcourir le pic d’Airy de la cavité à miroir mobile. Bien sûr, cette entrée n’est utilisée que lorsque le laser n’est pas asservi sur la cavité FPE.

La voie intermédiaire est envoyée sur un amplificateur rapide qui pilote l’une des deux voies de l’électro-optique du titane saphir. Cet amplificateur est capable de réaliser des excursions en tension de à des fréquences allant jusqu’à . Cet asservissement permet aussi de compenser la modulation de fréquence induite par l’asservissement de l’étalon épais. Nous avons vu (section 4.2.1) que la longueur de l’étalon épais est modulée à une fréquence de afin de produire une modulation d’intensité à la sortie du laser. Ce signal pilote l’asservissement de l’étalon épais et s’annule lorsqu’il est à résonance avec le laser. Il reste néanmoins une petite modulation de fréquence du laser à car la modulation de longueur de l’étalon épais est en fait équivalente à une variation de la longueur optique de la cavité laser. Cet effet est compensé en appliquant sur l’électro-optique la modulation de référence à fourni par la détection synchrone. Ce signal est auparavant précisément ajusté en phase et en amplitude à l’aide d’un déphaseur de gain variable.
Enfin, la voie rapide pilote directement la seconde voie de l’électro-optique. Elle permet de contrôler des fluctuations de faible amplitude ( maximum à l’entrée de l’électro-optique) jusqu’à des fréquences de l’ordre du mégahertz.
Le préamplificateur détermine les fonctions de transfert de chacune des trois boucles d’asservissement. La figure 45 montre le schéma du système de préamplification. La voie rapide est obtenue en amplifiant le signal d’erreur à l’aide de deux étages amplificateurs. Le premier étage utilise un (⑨) qui assure une amplification de gain à faible bruit et sur une large bande de fréquence. Cet amplificateur opérationnel présente néanmoins l’inconvénient de saturer pour de faibles tensions. C’est pourquoi nous utilisons dans le second étage un (⑩) en gain qui permet d’obtenir à la sortie des tensions suffisamment élevées pour piloter l’électro-optique du laser. Ces deux étages ont un gain plat en fréquence jusqu’à des fréquences de l’ordre du mégahertz. La fonction de transfert de la voie rapide se comporte toutefois comme un filtre passe-bas puisque l’électro-optique est équivalent à un condensateur de . La fréquence de coupure de ce filtre est de l’ordre de . Ceci permet de régler le gain global de cette voie de manière à ce que l’asservissement agisse au dessous de , en évitant l’entrée en oscillation aux alentours du mégahertz.
Pour les deux autres voies, le signal d’erreur est amplifié (étages ① à ③) puis intégré (étage ④), ce qui assure une pente constante de . La voie lente subit en plus un filtrage passe-bas à partir de , du fait de la résistance de sortie de l’amplificateur haute tension () et de la capacité de la cale piézoélectrique (). Ces différentes réponses en fréquence et les potentiomètres placés dans le préamplificateur permettent d’assurer un fonctionnement correct des trois voies de l’asservissement : la voie lente est dominante à basse fréquence (-), la voie intermédiaire agit de à et la voie rapide est prépondérante au delà de .

Un commutateur double à trois positions permet de commander l’asservissement. En position , les trois boucles sont ouvertes : le laser est non asservi. En position , toutes les boucles sont fermées. La position de l’interrupteur rajoute au signal un intégrateur agissant jusqu’à . La présence de cet intégrateur assure un bon fonctionnement de l’asservissement à basse fréquence en augmentant le gain de la boucle lente.
Notons enfin la présence d’une entrée modulation sur la voie rapide (figure 45). Cette entrée permet de moduler la fréquence du laser sur une petite amplitude (typiquement quelques kilohertz) mais à grande vitesse : comme le signal est directement envoyé sur l’électro-optique du laser, il est possible d’appliquer une modulation dont la fréquence est de quelques mégahertz. Nous verrons dans le chapitre que cette entrée est utilisée pour calibrer les mesures de petits déplacements réalisées par la cavité à miroir mobile.
L’efficacité de l’asservissement est illustrée sur la figure 46. La courbe (a) montre le signal d’erreur à résonance lorsque les trois voies de l’asservissement sont désactivées. L’amplitude de variation du signal traduit les fluctuations de fréquence du laser (jitter) qui peuvent être évaluées à partir de la sensibilité du signal d’erreur qui est de : ces fluctuations sont de l’ordre de . L’oscillation visible sur la courbe (a) est due à la modulation à de l’étalon épais. La courbe (b) montre le signal d’erreur lorsque les voies lente et moyenne sont activées. On voit que le bruit est notablement réduit puisque l’amplitude du signal d’erreur reste inférieure à . Ceci correspond à des fluctuations de fréquence de l’ordre de . Notons par ailleurs qu’une partie importante du signal correspond au résidu de la modulation de l’étalon épais à , qui n’est pas parfaitement compensée par le signal appliqué sur l’électro-optique à travers le déphaseur (figure 44).

Le gain global est limité par la résonance à de la voie intermédiaire et il n’est pas possible de l’augmenter pour améliorer l’efficacité de l’asservissement. La mise en service de la voie rapide permet d’augmenter nettement le gain global des voies lente et intermédiaire puisque la fréquence d’oscillation de l’asservissement est repoussé à . Lorsque les gains des trois boucles sont optimisés, on obtient le signal d’erreur représenté sur la courbe (c) de la figure 46. L’amplitude des fluctuations est de l’ordre de , ce qui correspond à des fluctuations de fréquence inférieures à . On constate aussi que l’asservissement supprime totalement la modulation de l’étalon épais qui était encore présente sur la courbe (b).
4.2.3 Stabilisation en intensité
Le faisceau issu du laser titane saphir présente d’importantes fluctuations d’intensité à basse fréquence. Celles-ci sont essentiellement liées aux vibrations mécaniques des différents éléments optiques du laser, bien que l’ensemble du laser soit rigidement fixé à une dalle en marbre posée sur la table optique par l’intermédiaire d’amortisseurs en caoutchouc. Comme nous l’avons souligné au début de cette partie, le point de fonctionnement de la cavité à miroir mobile dépend de l’intensité incidente. Il est donc important de contrôler précisément cette intensité. C’est le rôle de l’asservissement d’intensité qui permet de fixer l’intensité moyenne à une valeur donnée et de réduire les fluctuations à basse fréquence.
4.2.3.1 Régulation de l’intensité lumineuse à basse fréquence
Le principe de l’asservissement consiste à utiliser un atténuateur variable piloté par une boucle électronique de contre-réaction qui contrôle l’intensité transmise par l’atténuateur. Le faisceau à la sortie du laser étant polarisé linéairement, on utilise un électro-optique dont les lignes neutres sont tournés de par rapport à la polarisation incidente. Les deux composantes du champ qui correspondent aux projections sur les deux lignes neutres subissent des déphasages différents, qui dépendent de la tension appliquée sur l’électro-optique. Le faisceau transmis par l’électro-optique a donc une polarisation elliptique dont l’ellipticité dépend de la tension appliquée. Pour réaliser un atténuateur variable, il suffit de faire suivre l’électro-optique par un polariseur parallèle à la polarisation du faisceau incident. L’intensité transmise par ce dispositif est donnée par:
| (4.20) |
où est la différence des déphasages subis par les polarisations propres, qui dépend linéairement de la tension appliquée. Nous utilisons un électro-optique Gzänger , monté sur un support New Focus qui permet d’aligner précisément l’électro-optique sur le faisceau. On obtient l’extinction () pour une tension appliquée de et la transmission maximale (de l’ordre de ) pour une tension de . Ces valeurs permettent de piloter l’électro-optique avec une amplificateur rapide d’excursion , identique à celui utilisé dans la voie intermédiaire de l’asservissement en fréquence du laser. On est ainsi assuré de pouvoir agir sur les fluctuations d’intensité jusqu’à des fréquences de plusieurs dizaines de kilohertz.
Le schéma général du dispositif de régulation d’intensité est représenté sur la figure 47.

Ce dispositif comporte une partie optique, constituée de l’électro-optique associé à un polariseur et une partie électronique pour piloter l’électro-optique à l’aide d’une boucle de contre-réaction. Le signal d’erreur est fourni par une photodiode qui mesure l’intensité d’une petite partie du faisceau prélevée à la sortie du dispositif par un miroir de réflexion . A l’aide d’un amplificateur différentiel, ce signal est comparé à une tension de référence très stable dont on peut faire varier la valeur : ceci permet de modifier l’intensité moyenne du faisceau réfléchi par le miroir. La fonction de transfert de l’électronique est déterminée par un premier intégrateur de pente globale , suivi par un deuxième intégrateur pour des fréquences inférieures à , qui permet d’augmenter le gain à basse fréquence.
On peut noter sur la figure 47 que la cavité de filtrage, décrite dans la section suivante, est placée entre l’atténuateur variable et le miroir . Ainsi l’asservissement contrôle l’intensité directement à la sortie du dispositif et rend celle-ci indépendante des perturbations qui pourraient être induites par la cavité de filtrage.
Pour avoir un gain global suffisant de la boucle de contre-réaction, il est préférable de faire travailler l’électro-optique au voisinage de la mi-transmission. C’est en effet autour de ce point de fonctionnement que la transmission est la plus sensible à une variation de la tension appliquée (équation 4.20). Ce choix du point de fonctionnement dépend de l’intensité incidente sur l’électro-optique et du point de consigne de l’intensité transmise déterminée par la tension de référence. Le fait de travailler à mi-transmission présente l’inconvénient de perdre la moitié de la puissance lumineuse dans l’asservissement. Ceci n’est cependant pas très gênant dans notre cas puisque la puissance nécessaire à la sortie du dispositif est de l’ordre de quelques dizaines de milliwatts. Elle est donc bien inférieure à la puissance disponible à la sortie du laser. D’autre part ce choix permet de faire fonctionner l’amplificateur rapide dans des conditions optimales puisque la tension moyenne de sortie reste voisine de .

La figure 48 montre les fluctuations de l’intensité transmise autour de sa valeur moyenne, sans asservissement (trace a) et avec asservissement (trace b). Sachant que l’intensité moyenne transmise correspond à une tension moyenne de , on peut estimer les fluctuations relatives d’intensité du faisceau. On trouve que l’asservissement permet de réduire ces fluctuations relatives de quelques pourcent à environ .
La figure 49 montre l’action de l’asservissement en fonction de la fréquence. Plus précisément, les deux courbes représentent les spectres de puissance de bruit de l’intensité, avec et sans asservissement. Ces courbes sont obtenues par transformée de Fourier numérique () de l’évolution temporelle de l’intensité transmise. Sans asservissement (trace ), les fluctuations d’intensité sont très importantes en dessous de . La trace () montre que l’asservissement réduit très efficacement ce bruit basse fréquence: la réduction est de l’ordre de jusqu’à . D’autre part, l’asservissement est efficace jusqu’à des fréquences supérieures à . On observe un léger excès de bruit au voisinage de . Ce bruit est difficile à supprimer; il est sans doute lié à des déphasages dans la boucle de contre-réaction qui inversent l’effet de l’asservissement dans cette plage de fréquence où le gain est encore important. Le gain optimal de l’asservissement est choisi de façon à réduire efficacement le bruit à basse fréquence tout en ayant un excès de bruit raisonnable au voisinage de . On remarquera aussi que l’asservissement ne rajoute pas de bruit à des fréquences supérieures à .

4.2.3.2 Bruit technique du laser
L’un des points importants en vue de l’étude des effets quantiques du couplage optomécanique est la qualité du faisceau laser à la fréquence d’analyse. Comme nous l’avons souligné au début de cette section, l’intensité du faisceau à la sortie du titane saphir présente d’importantes fluctuations à basse fréquence liées à des sources de bruit technique du laser. A des fréquences plus élevées, ce bruit technique devient de moins en moins important et les fluctuations d’intensité se réduisent aux fluctuations quantiques (shot noise). Pour mettre en évidence les corrélations quantiques entre l’intensité lumineuse et la position du miroir mobile (voir les sections 2.4.3 et 3.4.3), il est indispensable que le bruit d’intensité du faisceau incident sur la cavité soit égal au bruit quantique standard pour des fréquences voisines de la fréquence de résonance mécanique fondamentale (typiquement ).
Nous avons donc cherché à caractériser le bruit technique du laser. Pour cela, nous avons utilisé le système de détection placé normalement sur le faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile, en modifiant légèrement son fonctionnement de façon à mesurer l’intensité et non la quadrature de phase du faisceau. Les éléments constitutifs du dispositif sont cependant les mêmes et ils sont décrits en détail dans la section 4.3.3. Le principe de la mesure est représenté sur la figure 50. Le faisceau issu de la source laser est divisé en deux parties de même intensité à l’aide d’une lame demi-onde et d’un cube séparateur de polarisation. L’intensité de chacun des deux faisceaux est mesurée à l’aide de deux photodiodes équilibrées. Les signaux sont préamplifiés puis ils peuvent être additionnés ou soustraits avant d’être envoyés sur un analyseur de spectre.

En position sommateur, on mesure la somme des intensités des deux faisceaux. En d’autres termes, l’analyseur de spectre fournit le spectre d’intensité du faisceau incident sur le cube, que l’on peut écrire:
| (4.21) |
où le facteur de Mandel représente la proportion d’excès de bruit par rapport au bruit de photon standard[50]. En position soustracteur, on mesure en fait les corrélations quantiques entre les deux faisceaux issus du cube. Du fait de la répartition statistique aléatoire des photons induite par le cube, ces corrélations sont nulles et l’analyseur de spectre fournit le spectre de bruit de photon standard[51]:
| (4.22) |
La comparaison des deux spectres (équations 4.21 et 4.22) permet donc de déterminer le facteur de Mandel , c’est à dire le bruit technique de notre source laser. La figure 51 montre le résultat de la mesure. Les traces () et () représentent les spectres et alors que la trace () donne le bruit électronique du système de détection, obtenu en coupant le faisceau lumineux. L’intensité présente un excès de bruit important ( à ) pour des fréquences inférieures à . Par contre, le bruit d’intensité rejoint le bruit de photon standard à partir de environ. Notons que ce résultat dépend de l’intensité moyenne du faisceau laser. En effet, si cette intensité est atténuée par un facteur , le spectre d’intensité devient[50]:
| (4.23) |
Ainsi le facteur de Mandel est réduit dans les mêmes proportions que l’intensité moyenne. Les résultats de la figure 51 ont été obtenus pour une puissance lumineuse de .

Ces résultats sont donc satisfaisants pour observer les effets du couplage optomécanique à des fréquences d’analyse voisines de . Comme nous le verrons dans la partie 4.5, ces caractéristiques peuvent être améliorées en utilisant une cavité de filtrage spatial de grande finesse. Une telle cavité a pour effet de filtrer le bruit technique du laser pour des fréquences supérieures à sa bande passante.
4.2.4 Filtrage spatial
L’adaptation spatiale entre le faisceau lumineux et la cavité à miroir mobile joue un rôle important dans l’observation des effets quantiques du couplage optomécanique. Dans les chapitres précédents nous avons supposé une adaptation parfaite. Si ce n’est pas le cas, seule la partie du faisceau incident qui se projette sur le mode fondamental de la cavité interagit avec celle-ci. La partie restante du faisceau se réfléchit directement sur le miroir d’entrée et n’interagit pas avec le miroir mobile. Comme le dispositif de mesure détecte l’ensemble du faisceau réfléchi, l’inadaptation spatiale est équivalente à des pertes pour le faisceau réfléchi puisqu’elle réduit les corrélations entre le faisceau et le miroir mobile. La mise en évidence des corrélations quantiques nécessite donc une adaptation spatiale aussi bonne que possible.
Le faisceau issu du laser présente un astigmatisme non négligeable, lié à des effets de lentille thermique dans le cristal Titane-Saphir et à la présence dans la cavité de nombreux éléments optiques placés à incidence de Brewster. Ainsi la position et la taille des cols du faisceau dans les directions horizontale et verticale sont différentes. L’écart entre les positions des deux cols est de l’ordre de , soit de la longueur de Rayleigh . De même, l’assymétrie entre les tailles des cols est de l’ordre de . L’astigmatisme dépend en plus des conditions de fonctionnement du laser et peut varier d’un jour à l’autre. Le faisceau a ainsi un profil elliptique qu’il est difficile d’adapter correctement à la cavité à miroir mobile. C’est pourquoi nous avons réalisé un dispositif de filtrage spatial qui donne au faisceau un profil gaussien et cylindrique, plus facilement adaptable au mode fondamental de la cavité à miroir mobile.
Ce dispositif est constitué d’une cavité Fabry-Perot non dégénérée, dans laquelle est envoyé le faisceau laser. La longueur de la cavité est contrôlée de telle manière que la fréquence de résonance d’un mode de la cavité coïncide avec la fréquence du laser. La cavité transmet alors la partie du faisceau incident qui est adaptée à son mode propre fondamental et elle réfléchit toutes les autres composantes du faisceau incident. Ce dispositif transmet donc un faisceau dont la structure est uniquement déterminée par la géométrie de la cavité.
Nous allons présenter dans cette section les différents éléments du dispositif de filtrage. Nous commencerons par décrire et caractériser la cavité Fabry Perot de filtrage (FPF). Nous présenterons ensuite les différents éléments de l’asservissement, qui permet de maintenir la cavité FPF à résonance avec le faisceau incident. Nous terminerons en décrivant la mesure de la bande passante de la cavité qui, comme nous l’avons vu dans la section 4.1.4, sert de référence pour déterminer la finesse de la cavité à miroir mobile.
4.2.4.1 La cavité de filtrage
La cavité de filtrage spatial est constituée d’un miroir d’entrée plan et d’un miroir de sortie courbe de rayon de courbure égal à . La cavité a deux entrées-sorties, les miroirs ayant le même coefficient de réflexion en intensité égal à . Ceci permet d’avoir une transmission de la cavité maximale à résonance. On montre en effet que la transmission à résonance d’une cavité à deux entrées-sorties est:
| (4.24) |
où les coefficients de transmission et de réflexion des deux miroirs obéissent à la relation de conservation , à condition que les pertes soient négligeables. On voit alors que est maximal lorsque et .
La longueur de la cavité est de . Le support de la cavité est constitué d’un barreau cylindrique en invar, le miroir plan étant monté sur une cale piézoélectrique. Deux fenêtres plan-plan et plan-convexe (de courbure égale à ) sont fixées respectivement à l’entrée et à la sortie de la cavité, afin d’une part d’isoler la cavité et d’autre part de compenser l’effet de lentille divergente dû au miroir courbe.
L’adaptation spatiale du faisceau laser sur la cavité de filtrage est réalisée par un dispositif similaire à celui utilisé pour la cavité FPE de l’asservissement en fréquence (section 4.2.2). Un jeu de deux lentilles permet de modifier la taille du col du faisceau. La première lentille, placée à du col du faisceau laser, a une focale égale à , alors que la deuxième lentille, montée sur une platine de translation, est placée à de la première et a une focale de . On obtient ainsi un col de à l’entrée de la cavité FPF, que l’on peut ajuster précisément au col du mode fondamental de la cavité à l’aide de la platine de translation. Un jeu de deux miroirs montés sur des supports micrométriques permet ensuite d’aligner le faisceau sur la cavité.

Le résultat de l’adaptation spatiale apparaît sur la courbe du haut de la figure 52, obtenue en balayant la fréquence du laser. On peut voir deux pics d’Airy associés à deux modes successifs de la cavité, séparés par un intervalle spectral libre qui, pour une longueur de la cavité de , est égal à . Les petits pics correspondent à des modes transverses fortement atténués du fait de l’adaptation spatiale. L’intensité transmise à résonance représente environ de l’intensité incidente. Ces pertes peuvent être attribuées à l’astigmatisme du faisceau incident, mais aussi aux pertes des miroirs de la cavité. L’équation (4.24) n’est en effet valable que dans le cas d’une adaptation spatiale parfaite et pour des miroirs sans perte. Dans le cas contraire, la transmission n’est plus égale à .
La figure 52 permet aussi de déterminer la bande passante de la cavité. Nous utilisons pour balayer la fréquence du faisceau incident une rampe de tension linéaire appliquée sur le moteur du bilame du laser titane saphir, l’asservissement en fréquence étant désactivé. L’intensité transmise par la cavité FPF est détectée puis envoyée vers un oscilloscope digital Tektronix TDS420 qui permet d’acquérir le signal avec un nombre de points élevé ( points). Connaissant l’intervalle spectrale libre , on peut étalonner l’axe horizontal en fréquence. On élargit alors d’un facteur la zone autour de la première résonance. On obtient la courbe du bas sur la figure 52 qui permet de déterminer la bande passante de la cavité de filtrage en réalisant un ajustement lorentzien de la résonance. On trouve que la demi-largeur de la Lorentzienne est comprise entre et . Il est difficile d’obtenir une valeur plus précise étant donnée la légère dissymétrie de la résonance. Celle-ci est sans doute due à des effets thermiques transitoires au niveau des miroirs lorsque la cavité passe à résonance.
4.2.4.2 Asservissement de la cavité FPF sur la fréquence du laser
L’asservissement que nous avons mis au point pour maintenir la cavité FPF à résonance avec le faisceau laser repose sur la technique de détection synchrone déjà utilisée pour l’asservissement de l’étalon épais du laser titane saphir. Le schéma de principe est représenté sur la figure 53. Contrairement à la technique standard qui consiste à détecter l’intensité du faisceau transmis, modulé en intensité par la modulation de longueur de la cavité, on détecte ici l’intensité du faisceau réfléchi. Le choix de cette configuration est lié au fait que la cavité de filtrage se trouve dans la boucle d’asservissement d’intensité (voir figure 47). Cet asservissement a pour effet de supprimer la modulation d’intensité du faisceau transmis.

Plus précisément, on utilise une détection synchrone commerciale dont la fréquence de modulation est égale à . La sortie modulation de la détection synchrone est appliquée à la cale piézoélectrique (PZT) de la cavité FPF par l’intermédiaire d’un amplificateur haute tension . La variation de longueur de la cavité induite par cette modulation est équivalente à une variation du déphasage à la fréquence de modulation , autour du déphasage moyen . On obtient ainsi une modulation des intensités aussi bien en transmission qu’en réflexion. En effet, si la fréquence est petite devant la bande passante de la cavité, ces deux modulations s’écrivent:
| (4.25a) | |||||
| (4.25b) | |||||
| où et sont les coefficients de transmission et de réflexion de la cavité, reliés pour une cavité sans perte et symétrique au coefficient de transmission des miroirs et au déphasage moyen : | |||||
| (4.26) |
On voit ainsi que la modulation d’intensité du faisceau réfléchi est simplement en opposition de phase par rapport à celle du faisceau transmis.
Notons par ailleurs que l’asservissement d’intensité ajoute une modulation du faisceau incident de façon à supprimer la modulation transmise:
| (4.27) |
On constate alors que cela a pour effet d’augmenter la modulation du faisceau réfléchi, par un facteur :
| (4.28) |
Une partie du faisceau réfléchi est détectée par une photodiode puis amplifiée (voir figure 53). Le signal obtenu est envoyé dans la détection synchrone dont la constante de temps est égale à . Le signal est démodulé par la détection synchrone ce qui permet d’obtenir un signal d’erreur proportionnel au désaccord entre le laser et la résonance de la cavité. Entre la sortie de la détection synchrone et l’amplificateur haute tension qui pilote la cale piézoelectrique de la cavité FPF, le signal d’erreur est intégré pour des fréquences inférieures à , ce qui permet d’agir efficacement sur les dérives lentes du désaccord.
Lorsque l’asservissement est verrouillé, la résonance de la cavité FPF est calée sur la fréquence du laser et le faisceau transmis est bien . Nous avons en effet mesuré à l’aide d’un analyseur de mode (Mode Master Coherent), les caractéristiques spatiales du faisceau transmis qui sont, à quelques pourcents près (la marge d’erreur du mode master étant de cet ordre), celles d’un mode parfaitement gaussien . Notons que l’asservissement utilisé ici est relativement simple et que nous n’avons pas eu besoin d’améliorer ses caractéristiques. Les fluctuations à corriger sont en effet assez faibles du fait de la stabilité de la fréquence du laser et de la cavité de filtrage. D’autre part, les imperfections de l’asservissement de la cavité sont automatiquement compensées par l’asservissement d’intensité. Un désaccord non nul entre la fréquence du laser et la résonance de la cavité FPF ne modifie pas ses capacités de filtrage spatial. Par contre, cela se traduit par une modification du point de fonctionnement sur le pic d’Airy de la résonance et donc par une variation de l’intensité transmise par la cavité. Mais cette variation est corrigée par l’asservissement d’intensité qui modifie la puissance incidente sur la cavité de façon à ce que l’intensité transmise soit constante.
On remarque enfin sur la figure 53 la présence d’une entrée modulation lente suivie d’un déphaseur qui pilote la cale piézoélectrique de la cavité. Cette entrée est utilisée lorsqu’on applique une modulation sur l’entrée du laser titane saphir (figure 44). La rampe de modulation de la fréquence du laser a typiquement une excursion de à , et une fréquence de modulation de l’ordre de . L’asservissement de la cavité FPF n’est pas capable de compenser une variation de la fréquence du laser aussi large (plusieurs fois la largeur du pic d’Airy) et aussi rapide (de l’ordre de la constante de temps de la détection synchrone). C’est pourquoi il est nécessaire d’assister l’asservissement afin que la résonance du FPF suive de façon synchrone la modulation du laser. On applique la même rampe de modulation sur l’entrée correspondante de l’asservissement (figure 53) et on règle l’amplitude et la phase du déphaseur de façon à ce que la fréquence du laser reste sur le pic d’Airy de la résonance du FPF. L’asservissement d’intensité se charge alors de supprimer toute variation résiduelle de l’intensité du faisceau transmis. On obtient de cette manière un faisceau transmis parfaitement , modulé en fréquence et dont l’intensité est constante.
4.2.4.3 Mesure de la bande passante de la cavité de filtrage

La mesure de la bande passante de la cavité de filtrage sert de référence de fréquence pour déterminer la bande passante de la cavité à miroir mobile (voir section 4.1.3.1). Nous avons d’ores et déjà déterminé cette bande passante en balayant la fréquence du laser (section 4.1.4.2). Cette méthode présente néanmoins des défauts, liés à des effets thermiques lors du passage à résonance. Ces défauts rendent difficile une détermination précise de la bande passante, et nous avons été amenés à utiliser une méthode de mesure plus performante.
La mesure repose sur une technique de modulation en intensité du faisceau incident, la cavité étant asservie à résonance avec le faisceau. L’intensité du faisceau incident est modulée en appliquant sur l’électro-optique utilisé pour l’asservissement d’intensité une tension sinusoïdale de fréquence variable. La cavité se comporte alors comme un filtre passe-bas de fréquence de coupure égale à . Le signal correspondant à la puissance de modulation du faisceau transmis est relié au signal incident par:
| (4.29) |
On détermine ces deux signaux en plaçant une photodiode rapide avant et après la cavité FPF. Le montage utilisé, constitué d’une photodiode de et d’un préamplificateur rapide transimpédance, est similaire à celui utilisé dans la détection homodyne (section 4.3.3). Les signaux obtenus sont envoyés vers un analyseur de spectre (), et on balaye la fréquence de modulation de façon à obtenir les spectres de modulation incident et transmis . Le rapport des deux spectres donne la fonction de transfert, en éliminant l’influence des réponses en fréquence du modulateur et de la détection. Le résultat est représenté sur la figure 54. Un ajustement Lorentzien de la fonction de transfert obtenue permet de déterminer la bande passante de la cavité FPF que l’on trouve égale à . Cette valeur est en très bon accord avec celle obtenue par la méthode de balayage en fréquence du laser.
4.2.5 Asservissement de la fréquence sur la cavité à miroir mobile
Nous savons qu’une mesure de petits déplacements du miroir mobile ainsi qu’une mesure QND de l’intensité sont optimales lorsque le faisceau de mesure incident est à résonance avec la cavité. Malgré la stabilité du faisceau laser et de la cavité à miroir mobile, on observe une dérive lente du désaccord entre la fréquence du faisceau incident et celle de la cavité. Pour maintenir la fréquence du laser à résonance, nous avons réalisé un asservissement à basse fréquence qui agit non pas sur la cavité à miroir mobile, qui est une cavité rigide, mais sur la fréquence du laser titane saphir. Plus précisément, l’asservissement pilote la cale piézoélectrique de la cavité FPE sur laquelle le laser est asservi (figure 42). L’avantage de ce contrôle indirect de la fréquence du laser est que l’asservissement des fluctuations propres du laser et la compensation des dérives lentes sont découplés. L’asservissement en fréquence du laser est efficace car la cavité FPE est très stable mécaniquement et il est possible d’agir jusqu’à des fréquences très élevées. Par contre, le pilotage du FPE à partir de la cavité à miroir mobile ne peut être aussi efficace : il s’agit d’une boucle de contre-réaction globale sur l’ensemble du dispositif expérimental, qui contrôle la source laser à partir d’un signal issu de la cavité à miroir mobile. Cet asservissement ne peut agir que sur les dérives lentes car tous les éléments intermédiaires du montage (cavité de filtrage, asservissement d’intensité, oscillateur local,…) doivent être capable de supporter cette boucle de contre-réaction globale.
Le principe de l’asservissement est tout à fait similaire à celui utilisé pour maintenir la cavité FPF à résonance avec le faisceau lumineux. Le schéma de l’asservissement est représenté sur la figure 55. On module la fréquence du laser et on mesure à l’aide d’une détection synchrone la modulation induite sur la lumière transmise par la cavité à miroir mobile. Le signal d’erreur ainsi produit contrôle la cale piézoélectrique de la cavité FPE, par l’intermédiaire d’un amplificateur haute tension .
Le choix de la fréquence de modulation est assez critique. Cette fréquence doit être suffisamment élevée pour ne pas réduire la plage de fréquence où l’asservissement agit. Elle doit être suffisamment éloignée de la fréquence de modulation de la cavité de filtrage () pour ne pas perturber son asservissement. Enfin, le faisceau incident sur la cavité à miroir mobile doit être exempt de toute modulation d’intensité synchrone avec la modulation de fréquence du laser. En effet, la modulation d’intensité détectée à la sortie de la cavité ne doit provenir que du désaccord de la résonance de la cavité par rapport à la fréquence du laser : toute modulation incidente se traduirait comme une perturbation pour le signal d’erreur. Malheureusement le faisceau traverse la cavité de filtrage et celle-ci peut induire une modulation d’intensité si sa résonance n’est pas parfaitement calée sur la fréquence du laser. La fréquence de modulation doit donc être suffisamment basse pour que l’asservissement d’intensité puisse corriger toute modulation d’intensité à l’entrée de la cavité à miroir mobile. Pour ces différentes raisons, nous avons choisi une fréquence de modulation de .

Un autre point délicat est la détection du faisceau transmis par la cavité à miroir mobile. Même à résonance, cette intensité est très faible, de l’ordre de pour une intensité incidente de . Notons par ailleurs qu’une partie de la lumière détectée à l’arrière de la cavité provient de la lumière diffusée par les miroirs. En utilisant une caméra infrarouge, on peut voir au centre du miroir mobile un point brillant qui correspond au faisceau directement transmis par la cavité. On observe aussi un anneau de lumière à la périphérie du miroir, qui provient de la lumière diffusée qui traverse, après de multiples réflexions, le substrat du miroir mobile au niveau de sa partie non traitée.
L’intensité transmise est détectée par une photodiode . Le courant obtenu étant très petit (typiquement ), on utilise un montage en transimpédance formé d’un amplificateur et d’une grande résistance de contre-réaction de pour obtenir une tension en sortie raisonnable. Le montage transimpédance présente l’avantage de réduire l’influence de la capacité parasite de la photodiode : ceci permet d’atteindre des bandes passantes suffisamment élevées malgré la grande valeur de la résistance de charge. Le signal est ensuite envoyé dans une détection synchrone identique à celle utilisée pour l’asservissement de la cavité FPF, dont la constante de temps est égale à . Le signal d’erreur produit est intégré pour des fréquences inférieures à , ce qui permet d’augmenter le gain global de l’asservissement à basse fréquence.
On peut voir sur la figure 56 le résultat de l’asservissement sur l’intensité transmise par la cavité à miroir mobile. La trace (a) montre l’évolution temporelle de l’intensité sans asservissement. Le désaccord entre la fréquence du laser et la résonance de la cavité dérive lentement, ce qui se traduit par une variation de l’intensité transmise. On constate que la dérive est lente, puisque le désaccord varie d’une quantité inférieure à la largeur du pic d’Airy en secondes. D’autre part les fluctuations sur le signal restent modérées : cela est dû à la grande stabilité du laser et de la cavité à miroir mobile.

La trace (b) montre l’intensité transmise lorsque l’asservissement est activé. La fréquence du laser est contrôlée de telle manière que le faisceau reste à résonance avec la cavité (maximum du pic d’Airy). Cette courbe démontre l’efficacité de l’asservissement et plus généralement la qualité de notre source laser. En effet, le bruit résiduel de l’intensité transmise est dû à la fois aux fluctuations d’intensité du faisceau incident, aux fluctuations de fréquence du laser et éventuellement aux fluctuations de longueur de la cavité à miroir mobile. La stabilité de la source laser est telle que les fluctuations relatives du faisceau transmis par la cavité à miroir mobile sont inférieures à .
4.2.6 Vue d’ensemble de la source laser
Nous avons présenté dans les sections précédentes les différents éléments de la source laser. Nous allons maintenant décrire rapidement comment ces éléments sont interconnectés. Le schéma général de la source laser est représenté sur la figure 57.
Le laser titane saphir se trouve en haut à gauche sur ce schéma. Il délivre un faisceau à , avec une puissance comprise entre et . Une lame de verre à la sortie du laser permet de prélever, par réflexion sur ses deux faces, deux faisceaux de faible puissance ( chacun). Le premier faisceau est envoyé vers un dispositif de contrôle et d’analyse constitué des deux photodiodes utilisées par les asservissements de l’étalon épais et de l’étalon mince, ainsi que d’un Fabry-Perot confocal qui permet de vérifier que le laser est monomode.
Le second faisceau est envoyé vers la cavité FPE afin d’asservir en fréquence le laser. Il traverse tout d’abord un système de deux lentilles qui permet d’adapter le col du faisceau à celui du mode fondamental de la cavité, puis un atténuateur réglable constitué d’une lame demi-onde suivie d’un cube séparateur de polarisation. Cet atténuateur est réglé de manière à envoyer une puissance raisonnable dans la cavité, de l’ordre de . Le faisceau traverse ensuite l’électro-optique qui crée les bandes latérales à et un système à deux miroirs qui permet l’alignement du faisceau sur la cavité. Un cube séparateur de polarisation et une lame quart d’onde placés avant la cavité permettent de renvoyer le faisceau réfléchi vers la photodiode . Le signal obtenu est traité par l’électronique d’asservissement dont les différentes sorties pilotent la cale piézoélectrique et l’électro-optique interne du laser.
Sur le trajet du faisceau principal nous avons placé un isolateur optique qui évite tout retour de lumière vers le laser titane saphir. Le faisceau traverse ensuite un atténuateur variable constitué d’une lame demi-onde et d’un cube polariseur qui prélève l’essentiel du faisceau (environ ) pour le dispositif d’excitation optique du résonateur mécanique, décrit dans la partie 4.4. Une lame est placée sur le trajet de ce faisceau de façon à prélever un faisceau de , envoyé par fibre optique vers un lambdamètre situé sur une autre table optique. Ce lambdamètre permet de suivre la longueur d’onde du laser lorsqu’on effectue un balayage de sa fréquence. Il permet aussi de retrouver la fréquence de résonance de la cavité à miroir mobile.

La partie du faisceau principal transmise par l’atténuateur variable n’a plus qu’une puissance de et constitue le faisceau qui va interagir avec la cavité à miroir mobile. Il traverse l’électro-optique et le cube polariseur utilisés par l’asservissement en intensité comme atténuateur pilotable. Le point de fonctionnement de cet atténuateur est situé à mi-transmission : lorsque l’asservissement est activé, la puissance lumineuse transmise est égale à . Comme on peut le voir sur la figure 57, cet asservissement contrôle l’intensité après la cavité de filtrage spatial (FPF) puisque la photodiode détecte le faisceau transmis par le miroir de réflexion situé après cette cavité. Cette configuration permet de réduire d’éventuelles fluctuations d’intensité liées à la présence de la cavité FPF. D’autre part, cela évite de placer l’électro-optique après la cavité de filtrage, ce qui risquerait de modifier la structure spatiale du faisceau après le filtrage.
Comme pour la cavité FPE, un dispositif de deux lentilles et deux miroirs permet d’adapter et d’aligner le faisceau sur la cavité FPF. L’un des deux miroirs a un coefficient de réflexion égal à , ce qui permet de détecter une partie du faisceau réfléchi par la cavité. Le signal délivré par la photodiode est utilisé par l’asservissement qui contrôle la résonance de la cavité FPF. Lorsque tous les asservissements sont verrouillés, on dispose à la sortie de la cavité FPF d’un faisceau de parfaitement stable en fréquence, en intensité et de structure spatiale .
Ce faisceau traverse un atténuateur variable qui permet de régler précisément la puissance lumineuse envoyée vers la cavité à miroir mobile et dans le dispositif de détection homodyne (voir partie 4.3). On trouve aussi à la sortie de la source laser deux lentilles et deux miroirs qui permettent d’adapter et d’aligner le faisceau sur la cavité à miroir mobile.
On peut noter enfin la présence sur la figure 57 de l’asservissement sur la cavité à miroir mobile qui pilote la cale piézoélectrique de la cavité FPE (en bas à gauche sur la figure), ainsi que le dispositif de modulation lente (en haut sur la figure). Ce dispositif est simplement constitué d’un générateur sinusoïdal à dont l’amplitude de modulation est réglable. Il pilote à la fois le laser titane saphir et la cavité de filtrage, comme nous l’avons expliqué dans les sections 4.2.2.3 et 4.2.4.2.
L’un des points remarquables de notre source laser est sa stabilité à long terme. L’intensité envoyée vers la cavité à miroir mobile est uniquement déterminée par la tension de référence de l’asservissement d’intensité. La structure spatiale, le pointé et stabilité de pointé sont liés à la géométrie de la cavité de filtrage. Ces caractéristiques sont donc complètement indépendantes du laser titane saphir et de son état de fonctionnement. On est ainsi assuré de retrouver d’un jour à l’autre les mêmes caractéristiques.
Les opérations de maintenance de la source laser sont de ce fait très simples. Il suffit d’optimiser la puissance du laser en réajustant la cavité laser (à l’aide du miroir de la figure 41) et l’étalon épais. On s’assure ensuite de l’alignement du faisceau sur les divers éléments constituant la source laser. On dispose pour cela de deux miroirs montés dans des supports micrométriques directement à la sortie du titane saphir, et de deux diaphragmes qui permettent de repérer le bon alignement. Une fois ces opérations réalisées, il reste à choisir la longueur d’onde du laser en s’aidant du lambdamètre et d’activer tous les asservissements pour retrouver les mêmes caractéristiques du faisceau de sortie.
4.3 La détection homodyne
Afin de mesurer les fluctuations de la lumière au niveau du bruit quantique, un soin tout particulier doit être porté au système de détection. Le dispositif que nous allons décrire dans cette partie repose sur une technique d’homodynage entre le faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile, dont on veut mesurer les fluctuations, et un faisceau de référence appelé oscillateur local. Le principe de ce type de mesure consiste à utiliser un oscillateur local issu de la même source laser que le faisceau signal de façon à fixer une référence de phase entre les deux champs. Cette phase relative peut être contrôlée en variant le chemin optique suivi par l’oscillateur local. Le mélange homodyne est réalisé en divisant en deux parties égales les deux faisceaux et en recombinant chacune des parties sur deux photodiodes de haut rendement quantique parfaitement identiques. Les photocourants obtenus sont amplifiés à l’aide de deux chaînes d’amplification soigneusement équilibrées et à faibles bruit. En utilisant un oscillateur local beaucoup plus intense que le faisceau réfléchi et en faisant la différence des photocourants, on obtient un signal proportionnel aux fluctuations de la quadrature du champ réfléchi en phase avec l’oscillateur local. La visualisation et l’acquisition des signaux est réalisée à l’aide d’un analyseur de spectre dont les données sont traitées par un ordinateur.
Dans les expériences usuelles d’optique quantique telles que l’observation d’états comprimés du champ, la longueur du bras de l’oscillateur local est modulée de façon à parcourir l’ensemble des quadratures du champ. Dans notre expérience, nous désirons mesurer en continu une composante précise du champ réfléchi par la cavité, en général la quadrature de phase. C’est pourquoi nous avons réalisé un asservissement de la longueur du bras de l’oscillateur local de façon à contrôler la quadrature mesurée.
La figure 58 montre une photo de l’ensemble du dispositif. On reconnaît sur la droite les derniers éléments de la source laser décrite dans la partie précédente : la seconde lentille d’adaptation montée dans un support qui peut être translaté dans les trois directions, et deux miroirs d’alignement montés dans des supports Microcontrole. Le faisceau traverse ensuite une lame demi-onde et un cube séparateur de polarisation qui permettent de séparer l’oscillateur local du faisceau incident sur la cavité à miroir mobile. L’oscillateur local est renvoyé vers le cube à l’aide d’un miroir monté sur une cale piézoélectrique. Deux lames quart d’onde placées dans chacun des deux bras constituent avec le cube polariseur un circulateur optique qui envoie l’oscillateur local et le faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile vers le dispositif de détection constitué d’un séparateur optique et de deux photodiodes.

Nous allons présenter dans cette partie les caractéristiques et les performances de ce dispositif de détection homodyne. Nous commencerons par une description du principe de la détection homodyne (section 4.3.1). Nous décrirons ensuite les deux éléments complémentaires du dispositif, c’est à dire l’oscillateur local (section 4.3.2) et le système de détection équilibrée (section 4.3.3).
4.3.1 Principe de la mesure homodyne
Le schéma de principe de la mesure homodyne réalisée dans notre expérience est représenté sur la figure 59. Le faisceau incident, de polarisation linéaire, traverse un dispositif constitué d’une lame demi-onde () et d’un cube séparateur de polarisation (). Ce dispositif permet, par rotation de la autour de son axe, de faire varier les intensités relatives de l’oscillateur local et du faisceau qui interagit avec la cavité à miroir mobile. En pratique, la puissance du faisceau incident est réglée par l’atténuateur variable situé dans la source laser, à une valeur de l’ordre de , et seulement sont envoyés dans la cavité. Ainsi, l’oscillateur local a une puissance fois plus grande que celle du faisceau qui interagit avec la cavité.

Avant d’être envoyé dans la cavité à miroir mobile, le faisceau transmis traverse une lame quart d’onde () tournée d’un angle de par rapport à l’horizontale. Le faisceau incident sur la cavité a ainsi une polarisation circulaire. Le faisceau réfléchi par la cavité retourne alors sur le cube avec une polarisation linéaire verticale, et il est totalement réfléchi par le cube . De la même manière l’oscillateur local traverse une , se réfléchit sur un miroir et retourne sur le cube avec une polarisation horizontale. Il est donc totalement transmis par le cube . Le miroir de l’oscillateur local est monté sur une cale piézoélectrique qui permet de contrôler le déphasage relatif entre les deux faisceaux. On obtient ainsi à la sortie du cube deux champs : le champ réfléchi par la cavité à miroir mobile de polarisation verticale et l’oscillateur local de polarisation horizontale (les amplitudes moyennes et de ces deux champs sont choisies réelles).
Ces deux champs sont envoyés dans un second dispositif constitué d’une lame demi-onde et d’un cube séparateur de polarisation (). La est tournée d’un angle de par rapport à l’horizontale, ce qui a pour effet de tourner de la polarisation des deux champs. Le cube sépare alors chacun des faisceaux en deux parties d’égale intensité, l’une étant transmise avec une polarisation horizontale et l’autre étant réfléchie avec une polarisation verticale. Notons que les polarisations de l’oscillateur local et du faisceau réfléchi par la cavité sont identiques dans les deux voies de sortie du cube et que ces champs peuvent maintenant interférer. Les champs transmis et réfléchis par le cube s’écrivent:
| (4.30a) | |||||
| (4.30b) | |||||
L’ensemble se comporte en fait comme une lame semi-réfléchissante puisqu’il sépare et mélange les deux faisceaux incidents. Cependant, la lame mélange les deux champs de même polarisation entrants par les deux faces de la lame. Ici, le dispositif mélange les deux champs entrants par le même côté du cube et de polarisations orthogonales[52]. De manière plus générale, l’ensemble du dispositif représenté sur la figure 59 est similaire au système de mesure interférométrique schématisé sur la figure 12, page 12, où les lames séparatrices sont remplacées par des cubes séparateurs de polarisation.
Les photocourants issus des photodiodes et placées dans les deux voies de sortie du cube sont proportionnels aux intensités et . A partir des relations (4.30), on obtient les expressions suivantes pour la différence et la somme des intensités:
| (4.31a) | |||||
| (4.31b) | |||||
| Ces relations montrent que l’intensité n’est autre que le terme d’interférence entre les deux champs alors que est égal à la somme des intensités et . La partie continue () des voies de détection permet d’accéder aux valeurs moyennes des intensité et : | |||||
| (4.32a) | |||||
| (4.32b) | |||||
| où et sont respectivement les intensités moyennes du champ réfléchi par la cavité à miroir mobile et de l’oscillateur local. La relation (4.32a) montre que la différence des intensités moyennes des champs décrit des franges d’interférences lorsqu’on varie le déphasage relatif entre les deux champs. En particulier, l’intensité est nulle lorsque les deux champs sont en quadrature de phase (), et elle est maximale en valeur absolue lorsque les champs sont en phase ou en opposition de phase ( ou ). Nous verrons dans la section suivante (4.3.2) comment on utilise les intensités moyennes et pour contrôler la longueur du bras de l’oscillateur local, ce qui permet de choisir la quadrature du champ à mesurer. | |||||
Les fluctuations des photocourants sont liées aux fluctuations et des champs. En linéarisant les relations (4.31) autour des valeurs moyennes, on trouve l’expression suivante pour les fluctuations de la différence des intensités :
| (4.33) |
Les termes entre crochets représentent les fluctuations des quadratures d’angle des champs et , que nous avons définies dans la partie 2.2 du chapitre (voir équation 2.28). La quadrature de chacun des deux champs est pondérée par un terme qui n’est autre que l’amplitude moyenne de l’autre champ. Lorsque l’intensité de l’oscillateur local est grande par rapport à celle du champ réfléchi par la cavité, le second terme dans l’équation (4.33) est négligeable devant le premier. Le signal est ainsi proportionnel aux fluctuations de la quadrature d’angle du champ réfléchi , et le spectre des fluctuations s’écrit:
| (4.34) |
où est le spectre de bruit de la quadrature d’angle du champ sortant de la cavité à miroir mobile. La détection homodyne permet ainsi d’avoir accès au spectre de bruit de n’importe quelle quadrature du champ , en faisant varier la longueur du bras de l’oscillateur local. Ce spectre est d’autre part amplifié par l’intensité moyenne de l’oscillateur local. La calibration du spectre est réalisée simplement en coupant le faisceau réfléchi par la cavité à l’aide d’un cache. Le champ est alors remplacé par le vide et on mesure le bruit de photon standard .
Notons que les résultats présentés ici supposent un parfait équilibrage entre les deux voies de détection, aussi bien au niveau de la séparation optique des faisceaux réfléchis et transmis par le cube , que pour le rendement quantique des photodiodes ou les gains électroniques. Tout déséquilibre se traduit par une contamination du signal mesuré par le bruit d’intensité de l’oscillateur local. De plus, un déséquilibre optique est équivalent à des pertes optiques qui ont tendance à ramener le signal mesuré vers le bruit de photon standard. Nous étudierons en détail l’équilibrage du système de détection dans la section 4.3.3.
Notons pour terminer que l’on dispose en fait d’un dispositif soustracteur-sommateur qui permet d’envoyer dans l’analyseur de spectre les signaux et (voir figure 59). Seul le signal est utile pour la détection homodyne. Mais l’ensemble des éléments constitués de la lame , du cube et des deux voies de détection peut être considéré comme un dispositif de détection équilibrée, utilisable à d’autres fins que la mesure homodyne. C’est pourquoi nous avons conçu pour ces éléments un dispositif autonome et compact (décrit en détail dans la section 4.3.3), capable de fournir aussi bien la différence que la somme des intensités. Ce dispositif nous a servi par exemple pour mesurer le bruit d’intensité du faisceau issu de la source laser (voir section 4.2.3.2, page 4.2.3.2). Dans ce cas, un seul faisceau est envoyé dans le système de détection. Le signal fournit le bruit d’intensité du faisceau, alors que donne le bruit de photon standard associé.
4.3.2 L’oscillateur local
L’efficacité de la mesure repose sur un effet d’interférence entre le champ sortant de la cavité et l’oscillateur local. Il est de ce fait indispensable de bien contrôler deux paramètres : le déphasage relatif entre les deux faisceaux et leur recouvrement spatial au niveau des détecteurs. Le déphasage relatif définit, comme nous l’avons vu, la quadrature du champ que l’on mesure à l’aide de la détection homodyne. Pour contrôler précisément ce déphasage, nous avons réalisé un dispositif d’asservissement qui agit sur le chemin optique suivi par l’oscillateur local.
Un mauvais recouvrement spatial entre les deux faisceaux se traduit par des pertes au niveau de la mesure, puisque seule la partie du faisceau réfléchi qui se projette sur l’oscillateur local interfère pour donner un signal. Il faut donc optimiser à la fois la position et l’inclinaison du miroir de renvoi de l’oscillateur local.
4.3.2.1 Asservissement de la longueur du bras
Les fluctuations du déphasage sont essentiellement liées aux fluctuations d’indice de l’air dans lequel se propagent les deux faisceaux et aux vibrations mécaniques des différents supports sur lesquels sont montés les éléments optiques. On observe aussi une dérive lente du déphasage due à des effets de dilatation thermique de ces supports. Pour compenser ces fluctuations de phase relative, nous avons réalisé un asservissement qui agit sur la longueur du bras de l’oscillateur local.
Le signal d’erreur est obtenu en utilisant les tensions issues des voies basse fréquence () des deux chaînes de détection. On dispose ainsi de deux tensions et proportionnelles aux intensités moyennes transmise et réfléchie par le cube CP2, avec le même coefficient de proportionnalité noté lorsque les deux voies sont équilibrées. On peut alors écrire la différence et la somme de ces tensions sous une forme similaire aux relations (4.32):
| (4.35a) | |||||
| (4.35b) | |||||
| On voit que pour fixer le point de fonctionnement de l’interféromètre défini par le déphasage , il suffit de fixer la tension . En fait, on compare à une fraction de , le signal d’erreur étant de la forme où peut varier de à . L’avantage de cette approche est qu’elle rend le fonctionnement de l’asservissement indépendant d’éventuelles fluctuations d’intensité du faisceau incident. En effet le déphasage relatif obtenu par l’annulation du signal d’erreur s’écrit: | |||||
| (4.36) |

Pour obtenir un tel signal d’erreur, on utilise le montage représenté sur la figure 60. Le signal d’interférence est obtenu en utilisant un amplificateur (①) qui fonctionne en soustracteur. Ce signal est utilisé pour visualiser l’amplitude des franges d’interférences sur un oscilloscope. A l’aide des amplificateurs ② et ③, qui fonctionnent respectivement en additionneur et en inverseur, on obtient les tensions et . La tension est envoyée sur un voltmètre, ce qui permet de contrôler l’intensité moyenne totale arrivant sur les photodiodes. Le potentiomètre connecté aux potentiels et permet d’obtenir une tension où le coefficient varie de à . Ce signal de référence est alors comparé au signal d’interférence à l’aide de l’amplificateur ④ qui fonctionne en additionneur. On obtient alors le signal d’erreur voulu, c’est à dire .
Afin de réaliser un contrôle efficace de la phase relative, nous avons construit un asservissement à deux boucles en parallèle. La première boucle agit sur une petite cale piézoélectrique de d’épaisseur sur laquelle est collée un miroir de petite taille ( de diamètre et d’épaisseur). L’ensemble présente une réponse dynamique relativement rapide puisque la fréquence de résonance se situe aux alentours de . Cette boucle permet de contrôler la longueur du bras de l’oscillateur local avec une amplitude maximale de l’ordre de (soit ). La seconde boucle d’asservissement permet de compenser les dérives lentes du déphasage en agissant sur un vérin piézoélectrique Newport adapté à la platine de translation sur laquelle repose le support du miroir. Ce vérin permet d’effectuer des excursions de . Bien sûr, étant donné le poids de l’ensemble du support et du miroir monté sur la platine de translation, ce dispositif ne contrôle la phase relative qu’à des fréquences basses, inférieures à quelques Hertz.

Le schéma du dispositif d’asservissement est représenté sur la figure 61. Le signal d’erreur obtenu à l’aide du montage de la figure 60 est amplifié à basse fréquence par un intégrateur de pente globale et par un intégrateur pour des fréquences inférieures à . Ce signal pilote la petite cale piézoélectrique par l’intermédiaire d’un amplificateur -. Ce signal contrôle aussi le vérin piézoélectrique par l’intermédiaire d’un amplificateur haute tension - bridé à de façon à ne pas endommager le vérin. Etant donné les gains des amplificateurs et la différence de sensibilité entre la petite cale et le vérin, le gain de la boucle pilotant le vérin est environ fois plus grand à basse fréquence que celui de la boucle agissant sur la petite cale. Ainsi l’excursion de la cale reste modérée à basse fréquence et les dérives lentes de la phase relative sont contrôlées par le vérin. Un filtre passe-bas de fréquence de coupure égale à est inséré entre l’amplificateur et le vérin. La petite cale assure ainsi le contrôle de la phase relative pour les fréquences supérieures à environ.

Notons enfin la présence d’une entrée modulation sur l’amplificateur pilotant le vérin piézoélectrique. Cette entrée permet de moduler à très basse fréquence (typiquement de l’ordre du Hertz) la longueur du bras de l’oscillateur local afin de balayer les franges d’interférences que l’on visualise grâce au signal (équation 4.35a).
La figure 62 montre le résultat de l’asservissement sur le signal d’interférence . La trace (a) représente les franges d’interférences lorsqu’on module le vérin piézoélectrique. On parcourt en une oscillation toutes les quadratures du champ réfléchi. L’amplitude crête-crête de l’oscillation détermine, comme nous le verrons par la suite, le taux de recouvrement spatial au niveau des photodiodes entre l’oscillateur local et le faisceau réfléchi par la cavité. Les résultats de la figure 62 ont été obtenus après avoir soigneusement optimisé le recouvrement spatial, ce qui correspond à une amplitude crête-crête de l’oscillation égale à . Les intensités de l’oscillateur local et du faisceau réfléchi sont mesurées en utilisant le voltmètre à la sortie de la voie du dispositif décrit sur la figure 60. On obtient et en masquant respectivement le faisceau réfléchi par la cavité puis l’oscillateur local. Les traces (b) et (c) de la figure 62 représentent la tension lorsque l’asservissement est activé, pour des valeurs de la tension de référence égales respectivement à et (déphasage relatif de et environ). On voit que l’asservissement permet de fixer précisément le déphasage , et par conséquent la quadrature mesurée du champ réfléchi. Afin d’évaluer l’efficacité de l’asservissement, la trace (b) est agrandie selon l’axe vertical par un facteur dans l’insert en bas à droite de la figure. On mesure alors une tension résiduelle de ce qui correspond, d’après la relation (4.35a), à des fluctuations maximales de la quadrature de phase () de l’ordre de degré.
En variant la tension de référence , il est possible de s’asservir à différentes valeurs du déphasage , comme le montrent les traces (b) et (c). On ne peut pas cependant s’approcher aussi près que l’on veut des extrema de la figure d’interférence (trace a) puisqu’en ces points la pente du signal d’erreur est nulle. Cependant, ces positions correspondent à un déphasage égal à ou , c’est-à-dire à une mesure de la quadrature d’amplitude du champ réfléchi par la cavité. Comme nous l’avons vu dans la section 4.2.3.2, on peut réaliser une mesure directe de ce bruit d’intensité en supprimant l’oscillateur local et en utilisant la détection équilibrée en position sommateur.
4.3.2.2 Recouvrement spatial
Le recouvrement spatial entre le faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile et l’oscillateur local définit la proportion de l’intensité lumineuse des deux faisceaux qui interfère au niveau des photodiodes pour donner le signal. Un mauvais recouvrement se traduit par des pertes pour le faisceau réfléchi et induit une dégradation de la mesure de la quadrature. Il se traduit aussi par une réduction des interférences entre les deux faisceaux. La relation (4.35a) qui donne le signal d’interférence ne tient pas compte du recouvrement entre les deux faisceaux. s’écrit en fait:
| (4.37) |
où le paramètre est égal à l’intégrale de recouvrement spatial entre les deux champs.
La procédure d’adaptation consiste à positionner le miroir de renvoi de l’oscillateur local exactement au niveau du col du faisceau incident de façon à adapter les structures des champs, et à orienter ce miroir pour maximiser les interférences. La platine de translation et le support Microcontrole sur lesquels est fixé le miroir permettent d’optimiser ces paramètres. La procédure de réglage est réalisée en appliquant une rampe de tension sur le vérin de translation, et en jouant sur la position et l’orientation du miroir de manière à maximiser l’amplitude crête-crête du signal d’interférence (trace de la figure 62).
Afin de déterminer le coefficient de recouvrement , on mesure cette amplitude crête-crête dont l’expression est donnée par . On mesure aussi à l’aide du voltmètre les tensions et en masquant respectivement l’oscillateur local et le faisceau réfléchi par la cavité. Lorsque l’adaptation spatiale est optimisée, on obtient d’après la courbe (a) de la figure 62 une amplitude crête-crête de pour une tension de et une tension de . Ces valeurs correspondent à un recouvrement spatial égal à .
4.3.3 La détection équilibrée
Comme nous l’avons indiqué au début de cette partie, nous avons conçu un dispositif de détection équilibrée autonome et compact. Ceci présente l’avantage de pouvoir utiliser ce dispositif pour d’autres applications que la mesure homodyne. D’autre part ceci permet d’obtenir un alignement précis et stable des différents éléments optiques. La compacité et la rigidité de l’ensemble confère au dispositif une bonne stabilité et un bon contrôle des paramètres tels que l’équilibrage optique et électronique des deux voies de détection.

Le schéma du montage est représenté sur la figure 63. Tous les éléments optiques de la détection équilibrée sont fixés sur une plaque en dural de dimension . Le faisceau incident traverse tout d’abord une lentille de focale qui permet de faire converger le faisceau au niveau des surfaces photosensibles des deux photodiodes. Il traverse ensuite le dispositif de séparation optique constitué d’une lame et du cube qui divise le faisceau incident en deux parties d’égale intensité. La lame demi-onde est placée dans un support tournant qui permet de régler précisément les axes de la lame par rapport aux polarisations incidentes de l’oscillateur local et du faisceau réfléchi par la cavité. Le cube séparateur de polarisation est fixé sur un support qui permet de l’aligner sur le faisceau incident selon trois axes de rotation. Lorsque le cube est bien aligné, il présente un taux d’extinction de l’ordre de (soit ).
Chaque photodiode et son préamplificateur sont placés dans un boîtier métallique monté sur deux translations verticale et horizontale afin de centrer les photodiodes sur le faisceau. Les photodiodes sont logées dans des pièces en laiton qui assurent un excellent contact de masse en reliant directement la structure métallique de la photodiode au boîtier. Ceci nous a permis de réduire très nettement les sources de bruit parasite à haute fréquence. Ces pièces métalliques permettent d’autre part de fixer de manière identique les photodiodes par rapport à leur boîtier. Les deux boîtiers sont inclinés par rapport au faisceau de façon à récupérer l’intensité réfléchie par la surface photosensible. Une part importante des pertes optiques au niveau des photodétecteurs est en effet due à la réflexion du faisceau sur la photodiode. On utilise donc des miroirs montés sur des supports réglables qui renvoient la lumière réfléchie sur la photodiode. Les préamplificateurs sont constitués d’une voie basse fréquence () qui fournit en particulier les valeurs moyennes des intensités utilisées par l’asservissement de l’oscillateur local, et une voie haute fréquence (). Les deux voies sont envoyées dans le dispositif soustracteur-sommateur.
Nous allons dans la suite présenter plus en détail les éléments constitutifs de la détection équilibrée : les photodiodes, les préamplificateurs et le soustracteur-sommateur. Nous étudierons ensuite le problème de l’équilibrage des deux voies de détection et présenterons les caractéristiques du dispositif.
4.3.3.1 Les photodiodes
Les principales qualités que doivent présenter les photodiodes sont une excellente efficacité quantique et une réponse en fréquence suffisamment large pour observer sans atténuation les fluctuations d’intensité aux fréquences d’analyse. Les photodiodes que nous avons utilisées sont des de . Les sont des photodiodes de très large bande passante (), de faible capacité interne ( à ), et dont la surface photosensible est un disque de diamètre . Leur domaine spectral de fonctionnement optimal est compris entre et , pour une tension de polarisation de . Elles présentent aussi une très grande efficacité quantique, c’est-à-dire un taux de conversion photon-électron supérieur à , avec un bruit propre en courant très faible (de l’ordre de ). Ce rendement quantique peut être augmenté en retirant la fenêtre qui protège la surface photosensible et en utilisant un miroir de renvoi qui permet de récupérer le faisceau directement réfléchi par la surface du détecteur (réflexion spéculaire).
La lentille convergente placée à l’entrée du système de détection (figure 63) assure une focalisation des faisceaux au niveau des détecteurs sur un diamètre de l’ordre de . Cette valeur correspond à un bon compromis entre la taille de la surface photosensible et les problèmes de saturation qui pourraient apparaître lorsque la focalisation est trop importante.
4.3.3.2 Les préamplificateurs
Les photodiodes se comportant comme des générateurs de courant, le rôle du préamplificateur consiste à transformer le photocourant en une tension mesurable sur un domaine de fréquence étendu, incluant le continu. Les qualités requises pour les amplificateurs sont une large bande passante et un faible bruit, afin de ne pas dégrader la mesure des fluctuations quantiques de l’intensité lumineuse. Le schéma du montage préamplificateur est représenté sur la figure 64.

Le préamplificateur est formé de deux étages distincts, l’un pour les signaux basse fréquence (voie ), l’autre pour les hautes fréquences (voie ). La séparation entre les deux voies est réalisée par un filtre constitué par la résistance de charge de la photodiode ( et en série) et par la capacité d’entrée de l’étage (). La fréquence de séparation est de l’ordre de . La résistance de charge est constituée de résistances à couches métalliques à faible bruit (résistances de précision ). D’autre part, la valeur de la résistance est assez élevée de façon à limiter son bruit thermique (bruit Johnson-Nyquist). Le bruit de courant de la résistance vient en effet directement se superposer au photocourant délivré par la photodiode et peut perturber le signal mesuré pour de faibles intensités lumineuses.
La valeur de la résistance est cependant limitée par le photocourant débité en continu par la photodiode. En effet si la résistance est trop grande, la tension à ses bornes peut devenir assez élevée pour réduire de façon appréciable la polarisation de la photodiode. Avec les valeurs choisies, la tension aux bornes de la résistance de charge reste inférieure à pour des puissances lumineuses inférieures à , et la tension de polarisation reste toujours supérieure à .

La voie prélève une partie de la tension aux bornes de la résistance de charge. Elle est constituée d’un filtre en T qui évite tout retour de signaux parasites vers la voie (fréquence de coupure ), suivi par un amplificateur en tension de gain . Le gain est ajustable à l’aide d’une résistance variable placée en contre-réaction de façon à assurer l’équilibrage des voies des deux détecteurs (voir section 4.3.3.4) et d’obtenir un taux de conversion global courant-tension de .
La voie est basée sur un montage transimpédance. Ce type de circuit permet d’éliminer l’influence de la capacité de la photodiode. En effet, la photodiode fonctionne à haute fréquence avec une différence de potentiel constante, puisque sa borne négative se comporte comme une masse virtuelle. La capacité parasite en parallèle avec la photodiode ne limite donc pas la bande passante du circuit. L’amplificateur utilisé (CLC425) est un amplificateur rapide (produit gain-bande égal à ) et faible bruit ( et ). La valeur de la résistance de contre-réaction () résulte d’un compromis entre la bande passante de l’étage et le bruit thermique ajouté. Une petite capacité placée en parallèle permet de modifier la réponse dynamique de l’étage de façon à obtenir une réponse en fréquence la plus constante possible. Un filtre passe-haut est placé en sortie afin d’éliminer toute composante continue (fréquence de coupure de pour une impédance en sortie de ). La résistance de placée entre la broche du CLC425 et la tension d’alimentation négative permet d’optimiser la réponse en fréquence de l’amplificateur.
Le taux de conversion courant-tension de la voie est de l’ordre de pour une impédance de charge de . La figure 65 montre la réponse en fréquence du préamplificateur. La courbe représente en fait la puissance de bruit en sortie de la voie lorsqu’un faisceau de est incident sur la photodiode. Le bruit électronique, obtenu à partir du bruit en sortie sans faisceau incident, a été retranché de la courbe. Le bruit d’intensité du laser est égal au bruit de photon au delà de quelques mégahertz. Il est donc plat en fréquence et la figure représente en fait la fonction de transfert du dispositif. La bande passante à est supérieure à .
4.3.3.3 Système soustracteur-sommateur
Le dispositif soustracteur-sommateur est le dernier élément de la chaîne de détection équilibrée. C’est un système actif qui dispose de deux entrées pour recevoir les signaux envoyés par les voies des deux détecteurs, la sortie fournissant la somme ou la différence des signaux d’entrée. Un soin particulier doit être pris pour la réalisation de ce système puisqu’il doit avoir un faible bruit, une large bande passante et il doit être conçu de manière à présenter le meilleurs équilibrage possible sur une large bande de fréquence.

Le schéma électronique du soustracteur-sommateur est représenté sur la figure 66. Il est construit autour d’un amplificateur rapide et faible bruit CLC425 qui ajoute ou soustrait les deux entrées selon la position des commutateurs du relais. Nous avons utilisé un relais à contact doré plutôt qu’un simple commutateur car il introduit moins de perturbations pour les signaux hautes fréquences (capacités parasites, isolation…). Le montage est conçu de telle manière que la gain électronique soit le même en valeur absolue pour les deux voies, quelque soit la position du relais. Ainsi, en position sommateur l’équilibrage est assuré par la construction symétrique de la boucle de contre-réaction vis-à-vis des deux voies d’entrée, alors qu’en position soustracteur l’équilibrage est ajusté par la résistance variable sur l’entrée de l’amplificateur (valeur théorique ). De même, les valeurs des résistances sont telles que l’impédance d’entrée pour les deux voies est toujours égale à , et les impédances aux entrées et de l’amplificateur sont égales à . Comme nous le verrons dans la section 4.3.3.4, ceci assure un équilibre des gains de l’ordre de sur une plage de fréquence allant jusqu’à .
L’amplificateur est suivi par un filtre passe-haut similaire à celui présenté dans les préamplificateurs des photodiodes (figure 64). Le gain global du soustracteur-sommateur est égal à pour une impédance de charge de .
4.3.3.4 Equilibrage des deux voies de la détection
L’équilibrage des deux voies de détection est particulièrement important pour assurer le bon fonctionnement du dispositif, que ce soit dans le cadre d’une mesure homodyne ou dans celui d’une mesure directe du bruit d’intensité. Un déséquilibre entre les deux voies peut être aussi bien d’origine optique (séparation en deux parties du faisceau incident, rendement quantique des photodiodes) qu’électronique (gains des voies et , dispositif soustracteur-sommateur). Dans la suite nous allons montrer comment l’équilibrage de ces différents éléments est réalisé.
Appariement des photodiodes
Les deux photodiodes doivent présenter une réponse aussi similaire que possible. Parmi les photodiodes dont nous disposons, on en sélectionne deux qui présentent les efficacités quantiques les plus proches. La procédure suivie consiste à choisir une photodiode de référence que l’on place par exemple en transmission du cube (figure 59) alors qu’une seconde photodiode est placée en réflexion. On mesure alors l’écart relatif des tensions , , qui permet d’évaluer l’écart entre les rendements quantiques des deux photodiodes en s’affranchissant des éventuelles fluctuations de l’intensité lumineuse incidente sur le système de détection. On répète cette mesure en remplaçant à chaque fois la photodiode en réflexion et on sélectionne finalement les deux photodiodes qui présentent les variations relatives les plus proches. La réponse des photodiodes que nous avons choisies d’utiliser sont identique à près.
Séparation des faisceaux et gain des voies DC

L’équilibrage de la séparation optique des faisceaux à l’aide de la lame demi-onde et du cube (figure 59), et l’équilibrage des gains électroniques des voies sont réalisés en intervertissant les deux blocs de détection comme le montre la figure 67. En notant le déséquilibre entre les intensités transmise et réfléchie, et l’écart de gain entre les deux voies , on trouve que les tensions et à la sortie des deux blocs s’écrivent pour les deux configurations (à l’ordre en et ):
| (4.38) |
Pour déterminer les facteurs et , on mesure les écarts relatifs dans les deux configurations et dont les expressions sont données par:
| (4.39a) | |||||
| (4.39b) | |||||
| A partir de ces expressions, il est facile de voir que l’équilibrage optique, correspondant à , est réalisé en tournant la lame demi-onde jusqu’à ce que les valeurs mesurées pour et soient égales et de même signe. Par contre, un équilibrage parfait au niveau des détecteurs () s’obtient lorsque et sont égaux en valeur absolue mais de signe contraire. | |||||
En pratique, pour éviter d’intervertir de nombreuses fois les deux blocs détecteurs, on commence par équilibrer les deux voies en modifiant la valeur de la résistance variable de l’un des détecteurs, placée en contre-réaction sur l’amplificateur (figure 64). On mesure tout d’abord à l’aide d’un voltmètre les écarts relatifs et . Ceci permet de déterminer la valeur du déséquilibre des gains qui est égal, d’après les relations (4.39), à , où le gain est fixé initialement à une valeur voisine de . On compense ce déséquilibre en modifiant la valeur de la résistance variable d’une quantité égale à . Pour vérifier le bon équilibrage des gains, on mesure une seconde fois les écarts relatifs et qui, dans le cas d’un équilibre parfait, sont égaux et de signes contraires. Ceci permet de nous assurer que l’on ne compense pas un déséquilibre optique par un déséquilibre électronique. On obtient finalement un équilibrage des voies meilleur que .
Une fois ces opérations réalisées, l’équilibrage de la séparation optique des faisceaux s’effectue simplement en annulant la différence entre les tensions . L’équilibrage obtenu est essentiellement limité à environ par la précision de rotation de la lame .
Gain des voies HF et dispositif soustracteur-sommateur
Pour tester et régler le fonctionnement du système à haute fréquence, on module l’intensité du faisceau incident à une fréquence variable à l’aide d’un électro-optique suivi d’un polariseur. Pour ajuster les gains des voies , nous avons utilisé un soustracteur Mini-Circuit pour mesurer sur l’analyseur de spectre la différence des deux voies. La précision du réglage dépend bien sûr de l’équilibrage du soustracteur qui est de l’ordre de . Notons qu’un déséquilibre résiduel des voies sera compensé par l’équilibrage du dispositif soustracteur-sommateur. On compense dans ce cas un gain électronique par un autre gain électronique, et seul compte pour la qualité du système l’équilibrage global du préamplificateur suivi du soustracteur-sommateur.
Nous avons réalisé ce réglage en modulant l’intensité du faisceau à une fréquence de . On corrige le gain de la voie présentant le plus fort gain en plaçant une résistance de valeur élevée en parallèle avec la résistance de en contre-réaction du CLC425 (figure 64). Nous avons ainsi obtenu un équilibrage des voies à la fréquence de modulation meilleur que .
En ce qui concerne le dispositif soustracteur-sommateur, nous avons tout d’abord testé son fonctionnement en appliquant la même modulation électrique sur ses deux voies d’entrées. La précision de ce test est cependant limitée par le splitter Mini-Circuit utilisé pour envoyer le même signal sur les deux entrées avec une impédance de . Nous avons donc repris ce test en connectant le soustracteur-sommateur aux sorties des voies et en appliquant une modulation d’intensité au faisceau incident. La résistance variable sur l’entrée du CLC425 (figure 66) permet de régler finement l’équilibrage en position soustracteur. Pour cela, on cherche à annuler la modulation dans le signal fourni par le soustracteur. Il est en fait possible de réduire cette modulation jusqu’à une valeur très faible à une fréquence donnée. Nous avons plutôt cherché à obtenir un bon équilibrage sur une large plage de fréquence. Pour la valeur optimale de la résistance variable, on obtient finalement un équilibrage en configuration soustracteur de l’ordre de sur une plage de fréquence allant jusqu’à .
Le résultat de l’équilibrage est représenté sur la figure 68, où la courbe représente l’écart relatif lorsqu’on balaye la fréquence de modulation du faisceau lumineux.

Cette courbe représente en fait l’équilibrage de l’ensemble de la détection équilibrée, incluant les défauts d’équilibrage de la séparation optique du faisceau à l’aide de la et du cube , des photodiodes, des préamplificateurs et du dispositif soustracteur-sommateur. On voit que le déséquilibre global de tous les éléments de la chaîne est très petit puisqu’il est de l’ordre de , soit , et cela sur une large bande de fréquence d’environ . La remontée que l’on peut observer à haute fréquence est sans doute due à une légère différence des réponses en fréquence des voies , ou à un déphasage entre les deux voies d’entrée du dispositif soustracteur-sommateur. Quoiqu’il en soit, l’équilibrage global du système de détection est très largement suffisant pour pouvoir mesurer le bruit quantique de la lumière avec une précision de l’ordre de .
4.3.3.5 Caractéristiques puissance-tension de la détection
Les deux voies de détection doivent présenter un comportement linéaire vis-à-vis de l’intensité lumineuse arrivant sur les photodiodes pour des puissances les plus élevées possibles. En effet, l’efficacité de la mesure homodyne repose en partie sur le fait que l’intensité de l’oscillateur local doit être grande devant celle du faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile. Il est donc important d’éviter tout effet de saturation aussi bien au niveau des photodiodes que des amplificateurs. C’est pourquoi nous avons cherché à caractériser le comportement de la tension fournie par les voies et de la détection en fonction de la puissance incidente.
En ce qui concerne les voies , on mesure à l’aide d’un voltmètre la somme des tensions des voies (figure 60) en fonction de la puissance incidente que l’on mesure en utilisant un microwattmètre placé devant le système de détection équilibrée (avant la lame demi-onde). Les carrés sur la figure 69 représentent les tensions mesurées pour des puissances incidentes allant de à . On voit que ces point sont parfaitement ajustés par une droite, ce qui indique que l’ensemble des éléments constituant les deux voies de la détection ont un comportement parfaitement linéaire sur cette plage de puissance. D’autre part, la pente de la droite permet de déterminer le rendement quantique des photodiodes, défini comme le rapport entre le flux de charges électriques fourni par la photodiode et le flux de photons :
| (4.40) |

Nous pouvons en effet relier le photocourant à la tension de sortie de la voie puisque le taux de conversion courant-tension est égal à . Les intensités et les deux détecteurs étant équilibrés, le rendement quantique est relié à la pente de la droite () sur la figure 69:
| (4.41) |
Pour connaître le rendement quantique des photodiodes uniquement, cette valeur doit être corrigée des pertes optiques au niveau de la lame et du cube , qui sont de l’ordre de . D’autre part, ces mesures ont été réalisées sans les miroirs de renvoi (figure 63) qui permettent de récupérer de l’intensité lumineuse incidente. On trouve ainsi que le rendement quantique des photodiodes est de l’ordre de .
En ce qui concerne le comportement à haute fréquence du système de détection, nous avons testé la linéarité de la puissance du bruit de photon standard vis-à-vis de la puissance lumineuse incidente. Pour cela, on mesure la puissance de bruit sur l’analyseur de spectre à une fréquence d’analyse fixée à , le soustracteur-sommateur étant en configuration soustracteur. On mesure en fait la somme de la puissance du bruit de photon et du bruit électronique , dont on peut déterminer la valeur en masquant le faisceau incident. Les étoiles sur la figure 69 représentent le rapport des puissances de bruit pour différentes valeurs de la puissance lumineuse incidente. L’alignement de ces étoiles montre que le comportement des différents éléments des voies de nos deux détecteurs est parfaitement linéaire. On peut d’autre part déterminer la puissance incidente minimale que l’on peut mesurer. Pour un rapport signal à bruit égal à , c’est-à-dire pour un bruit total au dessus du bruit électronique, la puissance incidente est de l’ordre de .
4.4 Excitation optique du résonateur
Afin d’étudier les modes acoustiques du résonateur et la façon dont ils sont couplés au faisceau lumineux, nous avons développé une technique originale d’excitation optique du résonateur. Les méthodes utilisées pour étudier les modes acoustiques des résonateurs mécaniques en quartz font généralement appel aux propriétés piézoélectriques du matériau : des électrodes sont placées sur le résonateur de façon à l’exciter électriquement. Une telle approche n’est bien sûr pas applicable à notre cas où le résonateur est en silice. On utilise alors la force de pression de radiation pour exciter les modes du résonateur. Plus précisément, un faisceau laser intense est envoyé par l’arrière de la cavité sur le miroir mobile. Ce faisceau est modulé en intensité à l’aide d’un modulateur acousto-optique, à une fréquence fixée par un synthétiseur haute fréquence. En se réfléchissant sur le miroir mobile, le faisceau exerce une force de pression de radiation modulée à la fréquence choisie. En variant l’amplitude et la fréquence de modulation, on peut ainsi déterminer la réponse mécanique du résonateur à une force extérieure. Pour cela, on détecte le mouvement de la face plane du résonateur en mesurant la modulation induite par celui-ci sur la phase du faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile.
Cette excitation optique s’avère moins efficace qu’une excitation piézoélectrique, car la force de pression de radiation est moins intense que l’effet piézoélectrique. Elle permet néanmoins d’accéder à des paramètres autres que la fréquence et le facteur de qualité des modes acoustiques. On peut par exemple faire varier la section du faisceau lumineux et obtenir ainsi des informations sur la structure spatiale des modes acoustiques.
Nous allons présenter dans cette partie l’ensemble des éléments constituant ce dispositif. Comme nous le verrons, un point particulièrement délicat est l’isolation du faisceau arrière du reste du montage (cavité à miroir mobile et système de détection homodyne). En particulier, le faisceau arrière ne doit pas entrer dans la cavité. Sinon la lumière résiduelle transmise vers l’avant peut perturber la détection de phase du faisceau réfléchi en rajoutant au signal un terme de bruit provenant du battement de la lumière résiduelle avec l’oscillateur local.

La figure 70 montre le dispositif d’excitation optique du résonateur. Le faisceau arrière est prélevé à la sortie du laser titane saphir, à l’aide du cube séparateur de polarisation placé juste après l’isolateur optique (voir figure 57, page 57). En fait, l’essentiel de la puissance du laser est réfléchi par ce cube afin de constituer le faisceau arrière, l’intensité du faisceau allant vers la cavité étant beaucoup plus faible (typiquement quelques dizaines de milliwatts). On dispose ainsi d’une puissance de l’ordre de pour exciter le résonateur mécanique, ce qui représente une puissance suffisante pour obtenir une excitation efficace. Sur le trajet du faisceau (figure 70) nous avons placé un cache monté sur un support rabattable afin de pouvoir couper le faisceau arrière. Le faisceau traverse ensuite une lentille convergente de focale égale à qui permet de focaliser le faisceau au niveau du modulateur acousto-optique, avec un col de l’ordre de .
Pour moduler l’intensité du faisceau, on utilise un modulateur acousto-optique plutôt qu’un électro-optique suivi d’un polariseur. Dans un modulateur acousto-optique, le faisceau lumineux interagit avec une onde acoustique qui crée un réseau sur lequel se diffracte l’onde lumineuse. Lorsque l’angle d’incidence du faisceau correspond à l’angle de Bragg, l’intensité de l’onde diffractée dans l’ordre dépend essentiellement de la puissance de l’onde acoustique. Celle-ci est produite par l’intermédiaire d’un générateur radio fréquence dont la puissance de sortie est contrôlée par un signal basse tension (typiquement à ). On peut ainsi moduler en tout ou rien l’intensité du faisceau transmis dans l’ordre jusqu’à des fréquences de modulation de quelques mégahertz. L’obtention d’un résultat équivalent avec un électro-optique nécessiterait une tension de commande de plusieurs centaines de volts.
Un autre avantage de l’acousto-optique est qu’il décale la fréquence optique du faisceau diffracté d’une valeur égale à la fréquence de l’onde acoustique. En pratique, on a utilisé un acousto-optique - (Automates et Automatismes) qui fonctionne à . Le faisceau arrière ayant à l’origine la même fréquence que le faisceau incident sur la cavité à miroir mobile, ce décalage permet de placer le faisceau arrière hors résonance par rapport à la cavité. Comme ce décalage est grand comparé à la bande passante de la cavité (de l’ordre de ), le faisceau arrière ne peut pas se propager dans la cavité. Ceci permet donc de limiter les perturbations induites par le faisceau arrière sur la mesure homodyne du faisceau réfléchi par la cavité.
Notons que ce filtrage en fréquence n’est toutefois pas suffisant pour assurer une isolation totale entre le faisceau arrière et le système de détection homodyne. En effet, le filtrage induit par la cavité correspond à une atténuation par un facteur de l’ordre de de l’intensité transmise. Etant donné la dissymétrie entre les transmissions des deux miroirs de la cavité à miroir mobile (quelques pour le miroir mobile et pour le coupleur Newport), le coefficient de transmission de la cavité pour le faisceau arrière est de l’ordre de (voir équation 4.24). La puissance résiduelle du faisceau arrière qui interagit avec le système de détection est donc de l’ordre de , soit environ cent fois moins que le faisceau réfléchi par la cavité dont la puissance est de l’ordre de . D’autre part, le faisceau arrière présente une forte modulation d’intensité, puisque la profondeur de modulation peut atteindre , alors que la modulation de phase attendue sur le faisceau réfléchi est très petite : les déplacements du miroir mobile devraient induire une modulation de phase dont la profondeur ne dépasse pas . Il apparaît ainsi que le faisceau arrière constitue toujours, malgré le filtrage en fréquence, une perturbation importante pour le système de mesure. Nous verrons dans la suite comment cet effet a pu être éliminé grâce à un filtrage spatial.
L’intensité lumineuse diffractée par l’acousto-optique est déterminée par un signal de commande pilotant le générateur radio fréquence. Lorsque l’amplitude de ce signal varie de à , l’intensité lumineuse diffractée dans l’ordre varie de à une intensité maximale qui correspond à l’efficacité de l’acousto-optique (intensité lumineuse diffractée dans l’ordre , rapportée à l’intensité incidente). La modulation d’intensité est obtenue en appliquant sur cette entrée de commande une tension sinusoïdale issue d’un synthétiseur haute fréquence. La figure 71 montre le schéma de l’électronique de commande. Un amplificateur permet d’obtenir une modulation haute fréquence avec une amplitude supérieure à . Un ensemble de filtres mélange cette modulation avec une tension continue de façon à fournir une tension modulée comprise entre et . Une diode zener et une diode germanium permettent de limiter l’excursion du signal de commande. Notons la présence d’un filtre en dans la voie . Il permet d’éviter tout retour de la modulation haute fréquence dans l’alimentation continue. Sans ce filtre, l’alimentation émettait un fort rayonnement à la fréquence de modulation, rayonnement qui était capté par le système de détection homodyne.

L’efficacité de l’acousto-optique dépend beaucoup de l’alignement du réseau acoustique par rapport au faisceau lumineux incident. Pour optimiser cette efficacité, nous avons fixé l’acousto-optique sur un support réglable à trois axes de rotation, monté sur un ensemble de translations horizontale et verticale. Lorsque le faisceau incident est parfaitement focalisé au niveau du réseau et que l’alignement est optimisé, on arrive à une efficacité de l’ordre de .
Les éléments placés après l’acousto-optique permettent de déterminer la position et la géométrie du faisceau arrière par rapport au miroir mobile (voir figure 70). On trouve tout d’abord un ensemble de deux miroirs montés sur supports micrométriques qui permettent de positionner le faisceau au centre du miroir mobile, puis un atténuateur variable constitué d’une lame demi-onde et d’un cube séparateur de polarisation qui sert à contrôler l’intensité moyenne du faisceau arrière. On contrôle enfin la taille du faisceau arrière en utilisant un jeu de deux lentilles comme nous l’avons déjà fait pour nos différentes cavités (FPE, FPF et cavité à miroir mobile). Il n’est pas nécessaire ici d’adapter en taille et en position le col du faisceau arrière à celui de la cavité : la pression de radiation ne dépend pas de la courbure du faisceau gaussien et seule importe la section du faisceau au niveau du miroir mobile, que l’on veut pouvoir faire varier dans des proportions importantes de façon à étudier l’influence sur le couplage optomécanique de l’adaptation spatiale. Nous avons choisi une première lentille de focale égale à placée à de l’acousto-optique. La seconde lentille de même focale est placée plus loin sur une platine de translation qui permet de varier la distance entre les deux lentilles. Avec ce dispositif, la taille du col image est toujours très petite, inférieure à , mais sa position peut être déplacée par rapport au miroir mobile qui se trouve à environ de la seconde lentille. Du fait de la divergence importante du faisceau, on fait varier de cette manière la section du faisceau au niveau du miroir mobile. Nous avons mesuré cette section à l’aide d’une barette de photodiodes. En variant la distance entre les deux lentilles d’environ , la taille du faisceau au niveau du miroir mobile varie de moins de à plus de .
Enfin, comme le montre le schéma de la figure 70, le faisceau excitateur est envoyé, à l’aide d’un miroir monté sur un support micrométrique, sur le miroir mobile avec un angle d’incidence non nul, de l’ordre de . C’est en effet un moyen simple d’exciter le résonateur mécanique sans perturber la transmission résiduelle de la cavité à miroir mobile qui sert à maintenir le faisceau de mesure à résonance avec la cavité. D’autre part, on réalise ainsi un filtrage spatial très efficace du faisceau arrière. En effet, l’intégrale de recouvrement spatial entre le faisceau arrière et le mode fondamental de la cavité est proportionnelle à où est l’angle de divergence du mode fondamental (). Le faisceau arrière n’est donc pratiquement pas couplé au mode fondamental de la cavité, et on élimine ainsi toute lumière parasite qui pourrait perturber le fonctionnement du dispositif de mesure homodyne.
4.5 Cavité de filtrage de grande finesse
Comme nous l’avons vu dans la section 4.2.3, le faisceau issu du laser titane saphir présente d’importantes fluctuations d’intensité à des fréquences inférieures à (voir figure 51, page 51). Cette caractéristique ne permet pas d’observer les effets quantiques du couplage optomécanique pour des fréquences d’analyse inférieures à . Le dispositif de stabilisation d’intensité placé dans la source laser permet de réduire efficacement les fluctuations d’intensité en dessous de quelques dizaines de kilohertz (figure 49, page 49). Il semble toutefois très difficile de réaliser une boucle d’asservissement électronique qui puisse agir efficacement à des fréquences plus élevées sans rajouter un excès de bruit au dessus de . Nous avons alors envisagé une méthode de réduction du bruit d’intensité basée sur une technique optique, qui utilise l’effet de filtrage en transmission d’une cavité Fabry-Perot résonnante. En effet, lorsque le faisceau incident est à résonance avec la cavité, la fonction de transfert de celle-ci filtre toutes les composantes de bruit pour des fréquences supérieures à sa bande passante: plus la bande passante est étroite et plus le filtrage est efficace. En utilisant une cavité ayant une faible bande passante et donc une grande finesse, on devrait ainsi être capable de réduire l’excès de bruit technique du laser pour des fréquences comprises entre et . On notera enfin que cette cavité joue aussi un rôle de filtrage spatial comme nous l’avons déjà vu pour la cavité FPF : à terme, cette cavité de grande finesse remplacera dans le montage expérimental la cavité FPF.
4.5.1 Principe du filtrage
La cavité que nous utilisons est symétrique, ce qui permet d’avoir une transmission de la cavité maximale à résonance. Un traitement complet des effets d’une telle cavité sur les fluctuations du champ doit tenir compte des fluctuations du vide qui sont couplées au champ intracavité par la deuxième entrée (voir figure 72). Dans le cas d’une cavité sans perte et de grande finesse, les relations d’entrée-sortie pour les fluctuations sont similaires à celles obtenues dans la section 2.3.4. En tenant compte du couplage avec les fluctuations du vide dans l’équation d’évolution du champ intracavité (2.58a), on peut déduire l’expression à résonance des fluctuations du champ transmis par la cavité en fonction des fluctuations du champ entrant et des fluctuations du vide:

| (4.42) |
où et sont les coefficient de transmission et de réflexion en amplitude de la cavité. Pour une cavité résonnante sans pertes et de grande finesse, ces coefficients s’expriment simplement en fonction du coefficient de transmission des miroirs:
| (4.43) |
Puisque les fluctuations et qui apparaîssent dans l’expression (4.42) sont indépendantes, le spectre des fluctuations d’intensité du faisceau transmis peut s’écrire en fonction du spectre de bruit d’intensité du faisceau incident :
| (4.44) |
où et correspondent respectivement aux fonctions de transfert en transmission et en réflexion de la cavité, et , sont les intensités moyennes incidente et transmise. On notera que la conservation de l’énergie dans la cavité est vérifiée puisque la somme des fonctions et est égale à quelque soit la fréquence d’analyse.
Si le faisceau incident présente un excès de bruit d’intensité par rapport au bruit de photon standard, nous avons vu dans la section 4.2.3 (équation 4.21) que l’on peut tenir compte de cette caractéristique à l’aide du facteur de Mandel :
| (4.45) |
En substituant cette expression dans la relation (4.44) et en utilisant la condition de conservation de l’énergie vérifiée par les fonctions de transfert, on obtient l’expression suivante pour le spectre d’intensité :
| (4.46) |
Le second terme de cette relation montre que le faisceau transmis présente toujours un excès de bruit mais qu’il est filtré par la fonction de transfert en transmission de la cavité. La cavité se comporte donc comme un filtre passe-bas de forme lorentzienne et de fréquence de coupure égale à sa bande passante : pour des fréquences très supérieures à la bande passante, les fluctuations incidentes ne sont plus couplées au champ intracavité. Ainsi, les fluctuations du faisceau laser sont directement réfléchies par le miroir d’entrée, alors que les fluctuations du faisceau transmis reproduisent les fluctuations du vide réfléchies par le miroir de sortie.
Il apparaît ainsi que l’efficacité du filtrage de la cavité est d’autant plus grande que la bande passante est faible. La valeur de la bande passante est déterminée par la longueur de la cavité et par sa finesse. Pour des longueurs raisonnables, il est nécessaire d’utiliser une cavité de grande finesse, c’est-à-dire des miroirs ayant une grande réflectivité et de faibles pertes. Dans ces conditions, la valeur minimale de la bande passante est limitée par la tenue au flux des miroirs et par la puissance maximale du faisceau que l’on veut envoyer dans la cavité.
4.5.2 Caractéristiques de la cavité
La cavité de filtrage que nous avons testée est constituée d’un miroir d’entrée plan monté sur une cale piézoélectrique et d’un miroir de sortie courbe de rayon de courbure égal à . Les miroirs que nous avons utilisés ont été fabriqués par (Research Electro-Optics). Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les caractéristiques des miroirs déterminent à la fois l’effet de filtrage et la puissance lumineuse admissible par la cavité. Nous avons choisi des miroirs ayant un coefficient de transmission égal à et des pertes inférieures à . La finesse théorique de la cavité est ainsi égale à . Etant donné la tenue au flux des miroirs qui est au moins de , la puissance du faisceau lumineux peut être supérieure à . Cette valeur est suffisante pour que cette cavité puisse remplacer la cavité FPF placée dans la source laser. Par ailleurs, la longueur de la cavité est déterminée par un barreau cylindrique en invar, de de long, sur lequel sont montés les miroirs. On obtient ainsi une bande passante théorique de . Enfin, la taille des miroirs est relativement petite ( de diamètre et d’épaisseur), ce qui permet d’optimiser la dynamique de la cale piézoélectrique qui sert à l’asservissement de la cavité.
Pour tester la cavité, on a utilisé l’un des deux faisceaux réfléchis par la lame de verre qui prélève le faisceau envoyé vers le lambdamètre (voir figure 57, page 57). Pour adapter spatialement ce faisceau sur le mode fondamental de la cavité, on utilise comme pour les cavités précédentes un jeu de deux lentilles convergentes. Nous avons choisi une première lentille de focale placée à du col du laser. La seconde lentille de focale est placée plus loin sur une platine de translation qui permet d’ajuster le col image. On obtient ainsi un col de à de la seconde lentille, là où se trouve le miroir plan de la cavité. L’alignement du faisceau sur la cavité est réalisé à l’aide de deux miroirs montés sur des supports micrométriques.

Nous avons mesuré la bande passante de cette cavité en utilisant la même technique de modulation d’intensité du faisceau incident que pour la cavité FPF (voir section 4.2.4.3). On obtient la fonction de transfert en faisant le rapport des spectres de modulation d’intensité transmis et incident , la cavité étant maintenue à résonance avec le faisceau. Le résultat est représenté sur la figure 73. Un ajustement Lorentzien permet de déterminer la bande passante de la cavité, que l’on trouve égale à . Cette mesure expérimentale de la bande passante permet par ailleurs d’estimer la finesse de la cavité , sachant que l’intervalle spectral libre est égal à . On trouve une finesse égale à , en bon accord avec la valeur théorique de .
4.5.3 Asservissement et effet de filtrage
L’efficacité du filtrage du bruit d’intensité par la cavité Fabry-Perot dépend aussi de la qualité de l’asservissement qui sert à maintenir la cavité à résonance avec le faisceau incident. L’asservissement que nous avons mis au point repose sur la technique des bandes latérales que nous avons déjà utilisée pour la stabilisation en fréquence du laser sur la cavité FPE (voir section 4.2.2). Le schéma de principe de cet asservissement est tout à fait similaire à celui représenté sur la figure 42 page 42. La seule différence réside dans le fait que l’asservissement agit sur la cale piézoélectrique de la cavité de filtrage et non sur la fréquence du laser titane saphir.
L’électro-optique utilisé pour moduler la phase du faisceau est un modèle New Focus résonnant à , monté sur une platine de positionnement New Focus . Le choix de cette fréquence de modulation est lié aux caractéristiques de la cavité de filtrage : elle est grande par rapport à la bande passante de la cavité et petite devant l’intervalle spectral entre modes transverses (). D’autre part, il est préférable de choisir une fréquence assez éloignée de la fréquence de utilisée pour l’asservissement en fréquence du laser titane saphir, afin d’éviter d’éventuelles interférences. Le synthétiseur qui pilote l’électro-optique, le mélangeur et le bloc photodiode sont similaires à ceux utilisés pour la cavité FPE, les filtres étant adaptés à la fréquence de modulation de . Le signal d’erreur obtenu à la sortie du mélangeur est utilisé pour agir sur la longueur de la cavité de filtrage de façon à maintenir celle-ci à résonance avec la fréquence du faisceau incident. L’électronique de commande qui pilote la cale piézoélectrique de la cavité est constituée d’un premier intégrateur de pente , suivi par un deuxième intégrateur pour des fréquences inférieures à , afin d’augmenter le gain à basse fréquence. Le signal est enfin envoyé sur un amplificateur haute tension (-) qui pilote la cale piézoélectrique. La résistance de sortie de l’amplificateur haute tension () est choisie de manière à constituer avec la capacité de la cale piézoélectrique () un filtre passe-bas de fréquence égale à .

Lorsque l’asservissement est activé, l’intensité transmise devrait présenter un bruit technique réduit par rapport à celui du faisceau incident. Pour observer cet effet de filtrage du bruit d’intensité, nous avons mesuré les spectres de bruit d’intensité incident et transmis, pour la même intensité moyenne. Les spectres sont obtenus en plaçant un bloc photodiode rapide ( et préamplificateur rapide transimpédance) avant et après la cavité. La figure 74 montre le résultat de la mesure. La trace (a) représente le spectre de bruit d’intensité du faisceau incident pour une puissance de . Comme nous l’avons déjà vu (figure 51), on retrouve ici un bruit technique important pour des fréquences inférieures à et le bruit d’intensité du faisceau n’atteint le bruit de photon standard qu’à des fréquences supérieures à . La trace (b) représente le spectre de bruit d’intensité du faisceau transmis par la cavité pour la même intensité moyenne. Ce spectre montre bien l’effet du filtrage de la cavité sur le bruit technique du faisceau incident. On observe en particulier une réduction de l’ordre de à la fréquence de coupure () de la fonction de transfert de la cavité. Au-delà, l’effet de filtrage devient de plus en plus important jusqu’à atteindre pour des fréquences voisines de . On obtient ainsi à la sortie de la cavité de filtrage un faisceau de puissance égale à et dont le bruit d’intensité rejoint le bruit de photon standard à partir de . Notons enfin que ce résultat dépend de l’intensité moyenne du faisceau (voir équation 4.23) et que l’on peut atteindre la limite du bruit quantique à des fréquences inférieures au mégahertz pour des puissances plus faibles.
Chapter 5 RESULTATS EXPERIMENTAUX
Nous avons décrit dans le chapitre précédent les différents éléments du montage expérimental et leurs principales caractéristiques. Comme nous l’avons indiqué dans la partie 4.1, la finesse de la cavité à miroir mobile n’est pas suffisante pour mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique. Par ailleurs, une telle mise en évidence nécessite de réduire le bruit thermique du miroir mobile. Un cryostat, spécifiquement adapté à notre cavité, est en cours de réalisation. Notre montage nous a cependant permis de réaliser la première étape de l’expérience qui consiste à caractériser le couplage optomécanique dans la cavité. Cette étude est importante afin d’optimiser les caractéristiques optiques et mécaniques de la cavité.
Nous avons aussi pu mettre en évidence l’extrême sensibilité de notre dispositif à des petits déplacements du miroir mobile. Nous avons en particulier observé le mouvement Brownien du miroir mobile. Ce résultat démontre qu’il est possible d’utiliser une cavité de grande finesse pour mener une étude quantitative du bruit thermique d’un résonateur mécanique. Etant donné la sensibilité atteinte, un tel dispositif constitue aussi une alternative intéressante aux dispositifs capacitifs placés sur les barres de Weber[17].
Nous présentons dans ce chapitre l’ensemble de ces résultats expérimentaux. Nous commencerons par présenter le spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile. Ce spectre nous a permis de mettre en évidence le mouvement Brownien du résonateur (partie 5.1). Nous présenterons ensuite les résultats concernant la caractérisation de la réponse mécanique du résonateur (partie 5.2). La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la détermination de la sensibilité de la cavité à des petits déplacements du miroir mobile (partie 5.3).
5.1 Observation du bruit thermique
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2 (sections 2.2.3 et 2.4.2), une application de notre montage consiste à mesurer le spectre des fluctuations thermiques du résonateur mécanique à température ambiante. La sensibilité de la cavité devrait nous permettre d’observer non seulement les pics de bruit thermique associés aux résonances acoustiques du résonateur mais aussi le bruit de fond entre ces résonances. Pour réaliser cette étude, le faisceau laser est maintenu à résonance avec la cavité à l’aide de l’asservissement décrit dans la section 4.2.5. L’intensité du faisceau entrant dans la cavité, qui est égale à , est suffisamment faible pour pouvoir négliger les effets de pression de radiation du champ intracavité. On mesure alors les fluctuations de phase du faisceau réfléchi induites par les variations de longueur de la cavité, en verrouillant l’asservissement de l’oscillateur local de manière à ce que les deux faisceaux soient en quadrature de phase : le signal à la sortie du système de détection équilibrée en configuration soustracteur est proportionnel aux fluctuations de phase du faisceau réfléchi (équation 4.34, page 4.34). Le spectre de bruit ainsi obtenu est la somme du bruit de photon standard correspondant au bruit de phase du faisceau incident et de la contribution associée au déplacement du miroir mobile (voir équation 2.76, page 2.76).
5.1.1 Acquisition des spectres
L’acquisition de spectres que nous devons réaliser pour observer les pics de bruit thermique est relativement délicate. Ces pics sont en effet étroits : pour une fréquence de résonance de et un facteur de qualité de , la largeur du pic est égale à . Par ailleurs, on veut pouvoir explorer systématiquement une large plage de fréquence, supérieure à la bande passante de la cavité à miroir mobile. Ainsi une simple acquisition directe par un analyseur de spectre n’est pas adaptée à cette mesure. Le nombre de points fournis par l’analyseur de spectre que nous utilisons () est limité à , et cela quelque soit sa bande d’analyse (span) : dans une plage de fréquence de ceci correspond à une résolution spectrale d’environ point tous les .
Pour améliorer cette résolution, on peut diviser la largeur totale d’analyse en plusieurs intervalles plus petits. Mais il faudrait environ intervalles de de large pour atteindre une résolution d’un point tous les . C’est pourquoi nous avons préféré utiliser une méthode d’acquisition plus élaborée, qui permet de réaliser une acquisition sur une plage de fréquence de de large avec la résolution souhaitée. Le principe de cette méthode consiste à récupérer le signal fourni par l’analyseur de spectre sur un oscilloscope digital () synchronisé avec l’analyseur de spectre. Le nombre de points élevé de l’oscilloscope ( points) permet de réduire considérablement le nombre d’intervalles, puisque l’on passe à seulement intervalles de largeur égale à , pour parcourir la plage de fréquence de à tout en gardant une résolution d’un point tous les .
Pour gérer cette acquisition, on utilise un programme informatique qui pilote à la fois l’analyseur de spectre et l’oscilloscope, connectés à un ordinateur PC par une liaison GPIB. Le signal issu du soustracteur-sommateur est envoyé dans l’analyseur de spectre qui fonctionne en mode d’acquisition déclenché (single sweep), ce qui permet de contrôler le déclenchement du balayage à partir du programme. On utilise la sortie vidéo de l’analyseur de spectre pour récupérer le spectre sur l’oscilloscope. Pour une résolution spectrale (rbw) de l’analyseur de spectre supérieure à , cette sortie vidéo fournit un signal analogique qui représente le spectre de bruit. La fréquence d’analyse est balayée de manière linéaire en fonction du temps, la plage de fréquence totale () étant parcourue durant le temps de balayage de l’analyseur de spectre. Le signal fourni à un instant donné correspond à la puissance de bruit à la fréquence d’analyse associée. Ce signal est compris entre et , avec un taux de conversion de , le niveau correspondant au niveau de référence (reference level) de l’analyseur.
L’acquisition par l’oscilloscope de ce signal est réalisée de manière synchrone en déclenchant ce dernier à partir de la voie de sortie trigger de l’analyseur de spectre. Le temps de balayage de l’oscilloscope est choisi un peu plus grand que celui de l’analyseur de spectre, ce qui permet de récupérer le spectre sur toute la plage de fréquence. Dès que l’oscilloscope termine son acquisition, le programme déclenche à nouveau le balayage de l’analyseur de spectre et un nouveau cycle d’acquisition commence. Cette procédure est répétée un certain nombre de fois de façon à moyenner la trace au niveau de l’oscilloscope (qui fonctionne en mode average). Le programme sauvegarde ensuite les données dans un fichier, après avoir converti le signal fourni par l’oscilloscope en . Enfin, le programme relance toute la procédure d’acquisition pour l’intervalle de fréquence suivant, en augmentant de la fréquence centrale de l’analyseur. La boucle globale d’acquisition se termine lorsque toute la bande de fréquence (de à ) a été balayée.
En pratique, la configuration des paramètres de l’analyseur de spectre est la suivante : résolution spectrale (rbw) de , bande de fréquence d’analyse (span) de , filtre vidéo (video filter) de , temps de balayage (sweep time) de secondes. En ce qui concerne l’oscilloscope, on choisit une base de temps de , ce qui permet d’acquérir les points en secondes, c’est à dire en un temps un peu plus long que le temps de balayage de l’analyseur de spectre. L’oscilloscope fonctionne d’autre part en mode moyennage (average). En choisissant un nombre de moyennes égal à , on obtient un spectre de de large en minutes. Pour parcourir l’ensemble de l’intervalle de à par tranches de , il est nécessaire d’acquérir spectres, ce qui correspond à un temps total d’acquisition de heures. Notons que tous les asservissements sont suffisamment efficaces pour assurer une compensation des dérives lentes et un fonctionnement stable du montage durant ce laps de temps.
5.1.2 Spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi
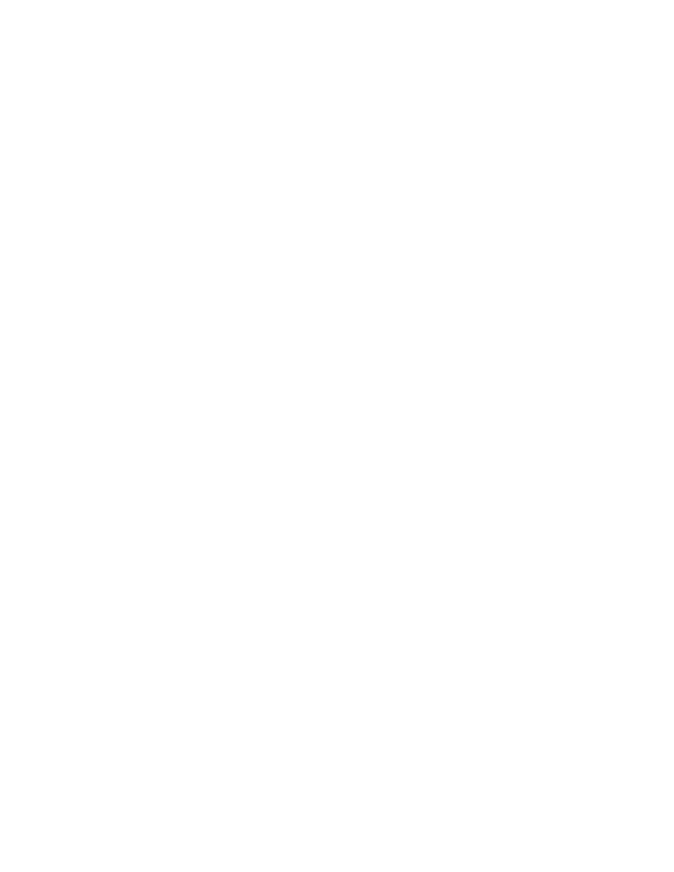
Un point important pour une mesure de spectre de bruit consiste à calibrer le bruit de photon standard. Dans une mesure homodyne, ce bruit correspond au bruit de photon de l’oscillateur local, auquel on a accès en masquant le faisceau réfléchi par la cavité à miroir mobile (voir équation 4.34, page 4.34). Par ailleurs, nous avons vérifié que le bruit de phase du faisceau réfléchi, lorsque la cavité n’est pas à résonance avec le laser, est égal au bruit de photon standard. Ainsi toute déviation par rapport au bruit de photon standard que l’on observe dans le bruit de phase du faisceau réfléchi par la cavité à résonance est liée à l’interaction du faisceau avec la cavité.
Le spectre de bruit de phase normalisé au bruit de photon standard, obtenu à résonance avec la cavité à miroir mobile est représenté sur la figure 75a. On constate la présence de nombreux pics de bruit thermique dans la plage de fréquence étudiée, de à . On peut noter aussi la très grande sensibilité de la mesure, puisque les pics sont plusieurs milliers de fois plus grands que le bruit de photon standard. Ce point sera étudié plus en détail dans la partie 5.3.
Ce spectre présente de nombreux pics, en particulier pour des fréquences inférieures à la fréquence de résonance du modes acoustique fondamental du miroir mobile, dont la valeur théorique est de l’ordre de . Cela signifie que le faisceau intracavité est sensible au bruit thermique d’éléments autres que le miroir mobile. On peut incriminer essentiellement deux éléments dont les vibrations mécaniques sont susceptibles de modifier la longueur de la cavité : il s’agit du coupleur Newport d’entrée et de l’espaceur entre les deux miroirs. Nous avons cherché à déterminer quels pics sont dus à chacun de ces élements, en comparant les spectres obtenus avec différentes cavités. Nous avons ainsi utilisé la cavité avec différents espaceurs (cuivre, silice et plexiglass) sans noter de différence appréciable entre les spectres. Par contre le spectre obtenu avec la cavité reproduit la plupart des pics du spectre de la figure 75a, mais le pic le plus élevé, dont la fréquence est voisine de , a disparu. Ces résultats semblent indiquer que la plupart des pics sont dus au mouvement Brownien du coupleur d’entrée, tandis que le pic aux alentours de est dû au mode fondamental du miroir mobile. Une confirmation de ce résultat sera présentée dans la partie suivante, grâce à l’étude de la réponse mécanique à une excitation optique du miroir mobile et du coupleur d’entrée.
Le spectre de la figure 75b représente le pic de bruit thermique dont la fréquence est voisine de . Il a été obtenu directement à l’aide de l’analyseur de spectre, dont la plage de balayage ainsi que la résolution spectrale ont été réduites afin d’améliorer la définition de la résonance. Ainsi, pour une plage de fréquence de autour de la résonance et une résolution spectrale égale à , on peut visualiser la forme de cette résonance. Ce spectre montre par ailleurs qu’il est possible d’observer le bruit thermique même très loin sur les ailes de la résonance puisque ce bruit est toujours bien supérieur au bruit de photon standard. La sensibilité atteinte dans notre montage devrait donc permettre de mener une étude exhaustive du bruit thermique et des mécanismes de dissipation des modes acoustiques internes du résonateur.
5.2 Réponse mécanique du résonateur
Afin d’améliorer la caractérisation des modes acoustiques des miroirs de la cavité, nous avons développé une méthode d’excitation optique utilisant le faisceau arrière dont l’implémentation dans l’expérience a été décrite dans la partie 4.4. Ce faisceau est modulé en intensité à une fréquence variable, ce qui permet d’exciter sélectivement les différents modes acoustiques du miroir arrière de la cavité. On détecte alors l’effet du mouvement du miroir sur la phase du faisceau réfléchi par la cavité, lorsque celle-ci est résonnante avec le faisceau incident. L’effet du mouvement apparaît au niveau du spectre de phase sous la forme d’un pic de modulation lorsqu’on fait varier la fréquence du synthétiseur qui pilote le modulateur acousto-optique autour d’une fréquence de résonance acoustique. Nous présentons dans cette partie les résultats obtenus pour des fréquences voisines du pic de bruit thermique observé dans la partie précédente (section 5.2.1). Nous décrivons ensuite les résultats concernant les réponses mécaniques du miroir mobile et du coupleur d’entrée, étudiées sur une large plage de fréquence (section 5.2.2).
5.2.1 Le mode acoustique fondamental
Pour déterminer avec précision la réponse mécanique du mode acoustique fondamental du miroir mobile, on mesure à l’aide du système de détection homodyne l’amplitude de modulation pour différentes valeurs de la fréquence de modulation, que l’on fait varier dans une petite bande de fréquence autour de la résonance acoustique. Le résultat obtenu est représenté sur la figure 76a où chaque carré représente la puissance de la modulation de la phase du faisceau réfléchi par la cavité, sur une plage de fréquence de autour de la résonance. Les valeurs obtenues sont normalisées par rapport au bruit de photon standard de l’oscillateur local. La présence de ce pic de modulation révèle l’existence d’une résonance mécanique du miroir mobile et confirme le fait que le pic de bruit thermique observé sur la figure 75b est bien dû au miroir mobile.
Le spectre de la figure 76b, reproduit ce pic de bruit thermique, normalisé au bruit de photon standard. Comparé au spectre de la figure 75b, la méthode d’acquisition a été améliorée. En particulier, le nombre de moyennage a été augmenté jusqu’à , grâce à un programme qui pilote l’analyseur de spectre et qui effectue un moyennage sur l’ordinateur. La comparaison des deux résonances de la figure 76 indique clairement qu’elles correspondent au même mode acoustique du miroir mobile, puisqu’elles se situent à la même fréquence de résonance et elles ont des largeurs comparables.

Ces résultats permettent d’autre part d’obtenir des informations précises sur les caractéristiques du mode acoustique. La courbe en trait continu de la figure 76a est un ajustement lorentzien des points expérimentaux. On trouve alors que la réponse mécanique est caractérisée par une fréquence de résonance égale à et une largeur à mi-hauteur égale à , ce qui correspond à un facteur de qualité de .
5.2.2 Spectre de modulation
Comme nous venons de le voir, le dispositif d’excitation optique associé au système de détection homodyne permet d’observer avec une grande efficacité la réponse mécanique du résonateur pour des fréquences voisines de la fréquence de résonance d’un mode acoustique. Nous avons généralisé cette méthode afin d’observer la réponse mécanique du résonateur sur une plage de fréquence beaucoup plus large. Ceci permet de rechercher systématiquement les fréquences des modes acoustiques du résonateur. Pour cela on utilise un programme informatique pour piloter à la fois le synthétiseur HF et l’analyseur de spectre. Ce programme permet d’automatiser l’étude de la réponse du résonateur à une excitation optique en contrôlant la fréquence de modulation du faisceau arrière et la fréquence de l’analyseur de spectre. En pratique, le programme fait varier la fréquence du synthétiseur d’une valeur minimale à une valeur maximale, avec un pas donné. Pour chaque fréquence, il lance l’acquisition de l’analyseur de spectre en mode zero span, tout d’abord avec la modulation activée, puis sans modulation. Le programme récupère ces deux spectres et en déduit, par moyennage des deux traces, la puissance de bruit thermique et la puissance de modulation. Le processus est répété pour la fréquence suivante, jusqu’à parcourir l’ensemble de la plage de fréquence désirée. On obtient finalement deux spectres qui correspondent au bruit thermique et à la puissance de modulation.

Les spectres (a) et (b) de la figure 77 représentent le résultat obtenu pour la cavité à miroir mobile pour des fréquences allant de à avec un pas de . On notera que tous les pics qui apparaissent dans le spectre de modulation du miroir mobile sont aussi présent dans le spectre de bruit thermique, ce qui permet d’identifier les pics de bruit thermique associés au miroir mobile. Nous avons aussi étudié les modes acoustiques du coupleur d’entrée en utilisant la cavité où le miroir est placé à l’arrière de la cavité. Le faisceau arrière excite alors les modes du miroir . Le spectre de modulation résultant est représenté sur la figure 77c. Il apparaît ainsi que la plupart des pics de bruit thermique du spectre (a) sont en fait dus au coupleur d’entrée Newport de la cavité.
En conclusion, l’excitation optique par le faisceau arrière permet de réaliser une étude détaillée des modes acoustiques des miroirs de la cavité. Cette étude est complémentaire de l’observation directe du bruit thermique. En ce qui concerne notre cavité à miroir mobile, cette étude a montré que la plupart des pics de bruit thermique sont en fait liés aux modes acoustiques du coupleur d’entrée. D’autre part, le mouvement Brownien du miroir mobile ne semble pas correspondre à celui prévu par le calcul théorique présenté dans la section 3.4.2. Seul le mode acoustique fondamental a une influence notable sur le champ intracavité et son facteur de qualité n’est pas aussi élevé que la valeur prévue pour un résonateur en silice pure. Ceci pourrait être dû à la façon dont sont tenus les miroirs de la cavité. La fixation peut jouer un rôle important dans le comportement mécanique des miroirs, en modifiant la structure des modes et en induisant des processus de dissipation par l’intermédiaire du support. En vue de l’observation des effets quantiques du couplage optomécanique, il est nécessaire d’améliorer le support de la cavité, par exemple en ne tenant les miroirs qu’en trois points situés à l’un de l’autre sur la circonférence du miroir. Quoi qu’il en soit, les méthodes que nous avons développées (observation du bruit thermique et excitation optique du résonateur) s’avèrent des outils performants pour optimiser les caractéristiques mécaniques de la cavité.
5.3 Détermination de la sensibilité
Comme nous l’avons souligné dans les chapitres précédents, la grande finesse de la cavité à miroir mobile permet d’atteindre une très grande sensibilité aux variations de longueur de la cavité. Nous avons cherché à mesurer avec précision cette sensibilité en utilisant une méthode de modulation de fréquence du faisceau incident sur la cavité à miroir mobile. Cette modulation de fréquence se traduit par une modulation de phase du faisceau réfléchi équivalente à l’effet produit par une variation de longueur de la cavité. La phase du faisceau réfléchi est en effet sensible au déphasage du champ dans la cavité. Ainsi, une modulation de la fréquence du laser est équivalente à un déplacement du miroir mobile:
| (5.1) |
où est la longueur de la cavité. Le principe de la mesure de la sensibilité consiste donc à comparer les déplacements mesurés à l’effet d’une modulation de fréquence. Cette modulation de fréquence est étalonnée à l’aide d’une cavité de référence qui n’est autre que la cavité de filtrage FPF de la source laser.
5.3.1 Etalonnage de la modulation de fréquence
Pour moduler la fréquence du laser nous utilisons un générateur HF (-) qui fournit une tension sinusoïdale d’amplitude et de fréquence variables. Ce signal pilote l’électro-optique interne du laser titane saphir par l’intermédiaire de l’entrée modulation rapide prévue à cet effet dans le système de préamplification de l’asservissement en fréquence de la source laser (voir figure 45, page 45). On module ainsi la longueur optique de la cavité laser, ce qui se traduit à la sortie du laser titane saphir par une modulation de la fréquence du faisceau avec une amplitude qui dépend linéairement de la tension (dans la plage de tension où le fonctionnement de l’électro-optique est linéaire).
La première étape de la mesure de la sensibilité de la cavité à miroir mobile consiste à déterminer le coefficient de proportionnalité qui relie l’amplitude de modulation à la tension du générateur HF. Afin de réaliser cet étalonnage, on utilise comme cavité de référence la cavité Fabry-Perot FPF dont on connaît précisément la bande passante (voir section 4.2.4). Lorsque la fréquence du faisceau incident est modulée, on observe en transmission une modulation de l’intensité dont l’amplitude dépend de l’amplitude , du point de fonctionnement de la cavité et de l’effet de filtrage lié à la bande passante de la cavité. Plus précisément, le désaccord du champ dans la cavité FPF est modulé à la fréquence selon la relation:
| (5.2a) | |||||
| (5.2b) | |||||
où est la longueur de la cavité et est l’amplitude de modulation à la fréquence du désaccord autour du désaccord moyen qui définit le point de fonctionnement de la cavité. Le champ intracavité est lui-même modulé autour du champ moyen . Cette modulation obéit à l’équation différentielle suivante, déduite des équations (2.40a) et (5.2a):
| (5.3) |
où représente les pertes totales de la cavité ( est égal à la transmission en amplitude pour chacun des miroirs dans le cas d’une cavité symétrique et sans perte). Cette équation permet de déterminer la modulation du champ transmis et celle de l’intensité transmise :
| (5.4) |
avec
où est le temps d’aller et retour dans la cavité. Cette relation permet de déterminer l’amplitude de modulation de la fréquence du laser, en fonction de la profondeur de modulation du faisceau transmis et du point de fonctionnement . La pente reliant la modulation de fréquence à la tension de modulation appliquée sur le laser est donnée par:
| (5.5) |
En pratique, la cavité est maintenue à mi-transmission (). Pour cela, nous avons modifié légèrement le fonctionnement de la source laser : l’asservissement de la cavité FPF à résonance est désactivé. On désactive aussi l’asservissement d’intensité et on utilise son électronique (la photodiode placée à la sortie de la cavité FPF et les préamplificateurs, voir figures 47 et 57) pour piloter la cale piézoélectrique de la cavité FPF. Cet asservissement contrôle donc la longueur de la cavité de sorte que l’intensité transmise soit égale à la moitié de sa valeur à résonance. Comme l’intensité incidente est relativement stable, on assure ainsi la stabilité du point de fonctionnement de la cavité. Nous avons vérifié qu’au cours du processus de mesure, aussi bien l’intensité transmise (mesurée sur ) que le point de fonctionnement ne varient pas de plus d’un pour cent.
Nous avons effectué les mesures pour une fréquence de modulation de . La modulation résultante sur le faisceau transmis est mesurée sur l’analyseur de spectre depuis la photodiode qui sert aussi à mesurer le niveau continu . Nous avons étalonné sa réponse en fréquence en la comparant à celle d’une photodiode FND100 suivie par un amplificateur transimpédance CLC425 (montage similaire à la voie HF de la figure 64, sans capacité de façon à avoir un gain plat entre et ). On obtient ainsi un gain à environ fois plus grand que le gain en continu. Le tableau suivant montre les résultats obtenus pour différentes tensions de modulation :
![[Uncaptioned image]](/html/quant-ph/0402145/assets/x81.png)
La modulation de fréquence et la pente sont calculées à partir de l’équation (5.5), sachant que l’intensité transmise moyenne correspond à en sortie de et que le point de fonctionnement de la cavité est égal à . Les tensions en sont converties en grâce à la formule:
| (5.6) |
puisque correspond à une puissance d’un milliwatt dans une résistance de charge de . Les valeurs mesurées de sont en plus multipliées par le facteur correctif de entre les gains à et en continu.
La figure 78 montre le résultat des mesures. Les carrés représentent les valeurs de la pente pour les différentes valeurs de l’amplitude . On voit que la modulation de fréquence est pratiquement linéaire en fonction de l’amplitude , avec une pente moyenne égale à . On notera que la précision de ces mesures est très bonne puisque l’écart des points obtenus par rapport à cette valeur moyenne est au plus de . Cet étalonnage permet donc de connaître avec précision l’amplitude de modulation de fréquence de la source laser produite par une tension quelconque appliquée à la source laser.

5.3.2 Sensibilité de la cavité de grande finesse
Pour évaluer la sensibilité de la cavité aux variations de sa longueur, on utilise la modulation de fréquence dont l’amplitude a été préalablement étalonnée. Cette modulation de fréquence du faisceau incident se traduit par une modulation de la phase du faisceau réfléchi que l’on peut mesurer grâce au système de détection homodyne. On peut de cette façon déterminer l’évolution de l’amplitude de cette modulation en fonction de la tension appliquée au laser. La connaissance de la pente permet alors d’associer une amplitude de modulation de phase du faisceau réfléchi à une tension qui correspond, comme nous l’avons vu dans la section précédente, à une amplitude de modulation de fréquence bien définie. Nous savons par ailleurs que cette modulation de fréquence est équivalente à une amplitude de modulation de la longueur de la cavité (équation 5.1):
| (5.7) |
Il est donc possible, connaissant et , de déterminer la variation de longueur équivalente associée à un niveau de bruit de phase quelconque du faisceau réfléchi par la cavité.
La pente caractérise la sensibilité de la cavité à une modulation de fréquence du laser. Elle dépend donc de la puissance du faisceau incident et des caractéristiques de la cavité, telles que la finesse et la bande passante. Nous avons mesuré pour une cavité constituée par un miroir Newport plan à l’entrée (noté ) et le miroir Newport , déjà utilisé comme coupleur pour la cavité à miroir mobile. Les caractéristiques de cette cavité ont été déterminées en suivant les procédures décrites dans la section 4.1.4. La bande passante est égale à , le coefficient de réflexion à résonance est égal à et l’intervalle spectral libre vaut . Ces valeurs permettent de déterminer la finesse de la cavité , sa longueur , le coefficient de transmission du miroir plan et les pertes totales de la cavité . Le tableau suivant présente les mesures réalisées avec cette cavité, pour une puissance incidente de :
![[Uncaptioned image]](/html/quant-ph/0402145/assets/x83.png)
Les valeurs de en sont mesurées à l’aide de l’analyseur de spectre, à la fréquence de modulation de , avec une résolution spectrale de . Ces valeurs sont converties en (troisième colonne du tableau) à partir de l’équation (5.6), en retranchant la puissance de bruit thermique donnée par la première ligne (sans modulation).
Les valeurs résultantes de la pente sont représentées par des carrés sur la figure 79. A partir de ces valeurs on peut déduire la pente qui correspond à la valeur moyenne représentée par la droite en tirets. On obtient une pente égale à . Ces résultats permettent de calibrer les mesures effectuées par l’analyseur de spectre. D’après l’équation (5.7), une tension sur l’analyseur correspond à un déplacement des miroirs de la cavité donnée par:
| (5.8) |

Grâce à cette calibration, il est maintenant possible de déterminer la sensibilité de la mesure du bruit thermique présentée dans la partie 5.1. Cette mesure est en effet limitée par le bruit de photon standard de l’oscillateur local. Nous avons mesuré la tension de bruit correspondant à ce bruit quantique en plaçant la cavité hors résonance. L’analyseur de spectre ayant une résolution spectrale de , la valeur mesurée sur l’analyseur en correspond en fait à une tension de bruit qui s’exprime en . On trouve ainsi une tension de bruit égale à . A partir de l’équation (5.8), on en déduit que la limite de sensibilité de la mesure du bruit thermique correspond à un déplacement des miroirs:
| (5.9) |
Cette sensibilité est pratiquement comparable à celle prévue pour l’interféromètre gravitationnel VIRGO. On peut noter par ailleurs qu’il est possible d’améliorer encore cette sensibilité en utilisant des miroirs de qualité optique supérieure à celle des miroirs commerciaux Newport afin d’augmenter la finesse de la cavité, ou en augmentant la puissance lumineuse incidente.
5.3.3 Comparaison avec la théorie
On peut comparer la valeur mesurée de à celle obtenue théoriquement en utilisant le résultat des calculs effectués dans la partie 2.4. Les calculs théoriques que nous avons menés supposent cependant que la cavité est sans perte, ce qui n’est pas le cas expérimentalement. La présence de pertes réduit l’influence des déplacements des miroirs dans le spectre de bruit de phase du faisceau réfléchi. Les pertes peuvent être modélisées par une transmission non nulle du miroir arrière de la cavité. Les équations d’entrée-sortie des fluctuations du champ (équations 2.58a et 2.58b, page 2.58) s’écrivent alors à résonance:
| (5.10a) | |||||
| (5.10b) | |||||
où est la transmission du coupleur d’entrée, représente les pertes dans la cavité, et sont les fluctuations du vide couplées à la cavité par l’intermédiaire des pertes. Le champ intracavité moyen est relié au champ incident par l’équation:
| (5.11) |
Les fluctuations de la quadrature de phase du champ réfléchi (équation 2.73, page 2.73) sont reliées au déplacement et aux fluctuations incidentes et :
| (5.12) |
Cette équation permet de déterminer le spectre de phase du champ réfléchi, sachant que les spectres et des fluctuations incidentes et sont tous deux égaux à :
| (5.13) |
La sensibilité à une fréquence d’analyse correspond au déplacement qui fournit un signal du même ordre de grandeur que le bruit de photon standard (terme dans l’équation 5.13):
| (5.14) |
Comparée à l’expression obtenue pour la cavité sans perte (équation 2.77, page 2.77), la sensibilité est diminuée dans la proportion de la transmission du coupleur d’entrée comparée aux pertes totales de la cavité.
En utilisant les valeurs expérimentales des paramètres de la cavité, on obtient une sensibilité optimale à une fréquence de égale à . Si on compare cette valeur théorique à celle obtenue expérimentalement (équation 5.9), on constate un écart de moins d’un pourcent. Ceci montre que l’ensemble de nos mesures expérimentales, que ce soit la mesure de la sensibilité ou celle des paramètres de la cavité, sont très précises.
Notons enfin que la bande passante de la cavité réduit la sensibilité à haute fréquence (équation 5.14) : à , la sensibilité est environ fois moins bonne qu’à basse fréquence. Nous avons donc repris l’ensemble de la procédure de mesure de la sensibilité à une fréquence de modulation égale à . D’après l’expression (5.14), on devrait obtenir à cette fréquence une sensibilité égale à . L’étalonnage sur la cavité FPF donne une pente égale à . La mesure de la modulation de phase réfléchie par la cavité donne une pente égale à , tandis que le niveau du bruit de photon standard est égal à . On trouve ainsi que la sensibilité mesurée à est égale à:
| (5.15) |
On remarque ici encore l’excellent accord avec la valeur théorique, qui prouve la précision de nos mesures expérimentales.
Notons pour terminer qu’afin de faciliter la comparaison entre la théorie et l’expérience, la tension de bruit correspond au bruit de photon seulement. En fait, le bruit du bloc de détection intervient aussi dans la détermination de la sensibilité expérimentale. A , ce bruit électronique correspond à une tension de . La tension de bruit correspondant au bruit total (électronique plus bruit de photon standard) est donc de . Ceci a pour effet d’augmenter légèrement la valeur du déplacement correspondant à la sensibilité expérimentale. On trouve ainsi, pour les deux fréquences étudiées:
| (5.16a) | |||||
| (5.16b) | |||||
La prise en compte du bruit électronique du bloc de détection modifie de moins de la valeur mesurée de la sensibilité. Il est par ailleurs possible de réduire l’influence du bruit électronique en augmentant l’intensité de l’oscillateur local. Ceci a pour effet d’augmenter le niveau du bruit de photon et de rendre la contribution du bruit électronique encore plus faible.
Chapter 6 CONCLUSION
Nous avons présenté une étude théorique et expérimentale du couplage optomécanique dans une cavité de grande finesse dont l’un des miroirs est susceptible de se déplacer sous l’effet de la pression de radiation du champ intracavité. Nous avons tout d’abord mené une étude théorique de ce couplage dans le cadre d’un modèle monodimensionnel, où le champ est décrit comme une onde plane et le miroir mobile comme un oscillateur harmonique (système pendulaire). Nous avons montré qu’un tel dispositif peut être utilisé pour mettre en évidence les effets quantiques dus à la pression de radiation. Il est ainsi possible de contrôler les fluctuations de la lumière en produisant des états comprimés, ou encore de créer des corrélations quantiques entre la position du miroir mobile et l’intensité lumineuse. Nous avons d’autre part montré la grande sensibilité d’une telle cavité à des petits déplacements du miroir mobile. Une application directe de cette sensibilité consiste à mesurer le bruit thermique du miroir ou encore à réaliser une mesure quantique non destructive de l’intensité lumineuse.
Cette étude nous a permis de dégager les paramètres essentiels qui caractérisent l’efficacité du couplage optomécanique. Nous avons ainsi montré que les effets liés à la pression de radiation sont significatifs lorsque le déplacement moyen du miroir mobile produit par la pression de radiation moyenne est de l’ordre de la largeur de la résonance optique. Cette condition fait intervenir à la fois les caractéristiques optiques et mécaniques de la cavité. Elle impose en particulier une grande finesse, une puissance lumineuse incidente élevée, et une masse du miroir aussi petite que possible. La contribution des effets thermiques au déplacement du miroir mobile doit aussi être négligeable comparée à celle liée aux fluctuations quantiques de la pression de radiation. Afin de réduire le bruit thermique, il est nécessaire de travailler à basse température, avec un miroir mobile dont le facteur de qualité et la fréquence de résonance sont élevés.
L’ensemble de ces contraintes nous a amené à choisir comme miroir mobile un résonateur mécanique constitué d’un substrat en silice de structure plan-convexe de d’épaisseur. Nous avons présenté dans ce mémoire les caractéristiques du couplage optomécanique avec un tel résonateur, en développant un modèle théorique qui tient compte de la présence des différents modes acoustiques internes du résonateur et de la structure tridimensionnelle du résonateur et du faisceau gaussien. Nous avons montré qu’il est possible de se ramener à une description monodimensionnelle, en intégrant la structure spatiale dans une susceptibilité effective qui décrit l’effet sur le champ de la réponse mécanique à la pression de radiation intracavité. Nous avons mis en évidence l’importance de l’adaptation spatiale entre les modes optique et acoustique, et nous avons défini la masse effective du résonateur qui décrit l’amplitude du couplage optomécanique à basse fréquence. Cette masse dépend de la section du faisceau et peut être beaucoup plus petite que la masse totale du miroir.
Au cours de ce travail de thèse, nous avons réalisé une expérience qui doit permettre de mettre en évidence les effets quantiques du couplage optomécanique. Le montage expérimental est composé d’une cavité de grande finesse à miroir mobile, d’une source laser très stable construite autour d’un laser titane saphir, d’un système de détection homodyne qui permet de mesurer le bruit quantique de n’importe quelle quadrature du faisceau réfléchi, et enfin d’un dispositif permettant d’exciter optiquement les modes acoustiques du résonateur. Un ensemble de mesures nous a permis de déterminer avec une grande précision les caractéristiques optiques de la cavité. Nous avons ainsi mesuré la finesse de la cavité, la transmission et les pertes du coupleur d’entrée et les pertes totales du miroir mobile. Les finesses obtenues avec les différents miroirs que nous avons utilisés sont comprises entre et .
Nous avons pu démontrer l’extrême sensibilité de notre cavité pour la mesure de petits déplacements du miroir mobile. Nous avons en particulier observé le bruit thermique du miroir mobile. Nous avons aussi mis en évidence la présence de nombreux pics de bruit thermique qui indiquent que le champ intracavité est sensible au mouvement Brownien d’éléments autres que le miroir mobile. En comparant les spectres obtenus avec différentes cavités, nous avons montré que la plupart des pics sont dus au mouvement Brownien du coupleur d’entrée. Pour déterminer avec certitude quels pics sont dus au miroir mobile et au coupleur d’entrée, nous avons réalisé une étude de la réponse mécanique des deux miroirs à une excitation optique. En excitant sélectivement les différents modes acoustiques du miroir, on obtient des informations précises sur les caractéristiques de ces modes. Nous avons en particulier déterminé la fréquence de résonance du mode acoustique fondamental du miroir mobile ainsi que son facteur de qualité.
Nous avons enfin déterminé la sensibilité de la mesure du bruit thermique. Pour cela, nous avons utilisé une modulation de fréquence du faisceau incident dont l’amplitude a été préalablement étalonnée. Les résultats obtenus permettent d’associer un déplacement équivalent (en ) à une tension de bruit mesurée sur la phase du faisceau réfléchi. On trouve que le plus petit déplacement observable, dans une plage de fréquence comprise dans la bande passante de la cavité, est de . Cette sensibilité est pratiquement comparable a celle prévue pour les interféromètres gravitationnels. Elle peut par ailleurs être améliorée en utilisant des miroirs de meilleure qualité optique. Nous avons aussi comparé la valeur mesurée de la sensibilité à celle obtenue théoriquement en tenant compte des caractéristiques de la cavité. Le très bon accord entre ces deux valeurs montre que l’ensemble de nos mesures expérimentales sont très précises.
Les méthodes expérimentales que nous avons développées s’avèrent des outils performants pour déterminer les caractéristiques optiques et mécaniques de la cavité à miroir mobile. Les résultats obtenus permettent d’identifier les paramètres à optimiser en vue d’une mise en évidence expérimentale des effets quantiques du couplage optomécanique. Les améliorations à apporter au montage expérimental concernent essentiellement la qualité optique et la réponse mécanique des miroirs.
La finesse de la cavité est limitée par les pertes des miroirs, qu’il s’agisse des coupleurs commerciaux ou des miroirs mobiles dont l’état de surface ne permet pas d’atteindre le niveau de perte souhaité de quelques . L’utilisation de miroirs de meilleurs qualité optique devrait permettre d’atteindre des finesses de l’ordre de . D’autre part, la puissance lumineuse incidente est limitée à quelques centaines de microwatts, du fait de la faible tenue au flux des coupleurs d’entrée. Les traitements multidiélectriques récents ont une tenue au flux bien meilleure, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilowatts par centimètre carré. Ces améliorations devraient non seulement augmenter les effets de pression de radiation mais aussi la sensibilité de la cavité aux déplacements du miroir.
En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques de la cavité, les études réalisées sur le bruit thermique du résonateur montrent que la réponse mécanique du miroir mobile ne correspond pas à celle prévue par la théorie, aussi bien en ce qui concerne la présence des différents modes acoustiques que pour le facteur de qualité du mode fondamental. La fixation du miroir joue certainement un rôle important dans le comportement mécanique du résonateur puisqu’elle modifie la structure des modes et elle induit des processus de dissipation par l’intermédiaire du support. C’est pourquoi il semble nécessaire de modifier le système de fixation du miroir mobile. On peut par exemple tenir le miroir sur sa circonférence par trois point situés à l’un de l’autre.
L’observation du bruit thermique pour les différentes cavités que nous avons réalisées montre par ailleurs que le fond thermique est pour l’essentiel dû au coupleur Newport. On peut déterminer théoriquement l’apport relatif des deux miroirs au fond thermique. Le bruit thermique à basse fréquence est en effet proportionnel à la susceptibilité effective. Les résultats du chapitre 3 montrent que la susceptibilité effective du miroir mobile est égale à alors que celle du coupleur d’entrée est égale à [53]. En supposant l’angle de perte identique pour les deux miroirs, le fond thermique dû au miroir mobile devrait donc être environ fois plus grand que celui induit par le coupleur Newport. Ce désaccord avec l’expérience traduit ici encore le fait que les modes acoustiques du miroir mobile sont modifiés par le système de fixation. L’amélioration de la fixation devrait donc permettre d’accroître la réponse mécanique du miroir mobile, et en comparaison de rendre celle du coupleur d’entrée négligeable. Notons enfin qu’il est possible d’éliminer complètement les problèmes causés par le coupleur d’entrée en utilisant une cavité constituée de deux miroirs mobiles, dont la face plane aurait un rayon de courbure de l’ordre du mètre de façon à obtenir une cavité optique stable. Ceci aurait pour effet de supprimer tous les pics de bruit thermique dûs actuellement au coupleur Newport.
Grâce à ces améliorations, il devrait être possible de réaliser une étude plus précise du bruit thermique et des mécanismes de dissipation, en excitant optiquement le résonateur très loin sur les ailes des résonances acoustiques. On pourra en particulier avoir accès à l’évolution de l’angle de perte en fonction de la fréquence. Enfin, l’amélioration de la qualité optique des miroirs et de la réponse mécanique du résonateur devrait permettre de rendre observable, à basse température, les effets quantiques de la pression de radiation.
Bibliographie
-
[1]
Les conséquences du formalisme quantique et
l’existence des fluctuations quantiques ont été discutées
dès les années 1930 par Bohr, Heisenberg ou encore Von Neumann. Voir
par exemple:
”Quantum theory and measurement”, Eds. J. A. Wheeler and W. H. Zurek (Princeton University Press, 1983). -
[2]
On peut trouver une description des
propriétés des états non classiques du champ
électromagnétique dans les articles de revue et numéros
spéciaux suivants:
a- D.F. Walls, ”Squeezed states of light”, Nature (London) 306, 141 (1983).
b- J. Mod. Opt. 34, 709 (1987), special issue on ”Squeezed Light”, eds. R. Loudon and P. Knight.
c- J. Opt. Soc. Am. B4, 1449 (1987), special issue on ”Squeezed States of the Electromagnetic Field”, eds. H.J Kimble and D.F Walls.
d- Appl. Phys. B55, N∘3 (1992), special issue on ”Quantum Noise Reduction in Optical Systems”, eds. E. Giacobino and C. Fabre.
e- S. Reynaud, A. Heidmann, E. Giacobino and C. Fabre, ”Quantum fluctuations in optical systems”, Progress in Optics XXX, ed. E. Wolf (North-Holland, 1992), p. 1. -
[3]
Introduction aux mesures quantiques non destructives et
application à la détection mécanique des ondes gravitationnelles
(barre de Weber):
a- V. B. Braginsky, Yu. I. Vorontsov, ”Quantum-mechanical limitations in macroscopic experiments and modern experimental technique”, Sov. Phys. Usp. 17, 644 (1975) [Usp. Fiz. Nauk. 114, 41 (1974)]
b- V. B. Braginsky, ”Resolution in macroscopic measurements : progress and prospects”, Sov. Phys. Usp. 31, 836 (1988) [Usp. Fiz. Nauk. 156, 93 (1988)].
c- V. B. Braginsky, Y. I. Vorontsov and K. S. Thorne, ”Quantum Non Demolition Measurements”, Science 209, 547 (1980).
d- C. M. Caves, K. S. Thorne, R. W. P. Drever, V. D. Sandberg, and M. Zimmermann, ”On the measurement of weak classical force coupled to a quantum-mechanical oscillator. I. Issues of principle”, Rev. Mod. Phys. 52, 341 (1980).
e- W. G. Unruh, ”Quantum nondemolition and gravity-wave detection”, Phys. Rev. D19, 2888 (1979). -
[4]
Les références qui suivent
présentent les premières expériences de mesure QND dans le
domaine de l’optique. Les milieux non linéaire utilisés sont
respectivement une fibre optique, un amplificateur paramétrique optique
et un jet atomique:
a- M. D. Levenson, R. M. Shelby, M. Reid and D. F. Walls, ”Quantum Nondemolition Detection of Optical Quadrature Amplitudes”, Phys. Rev. Lett. 57, 2473 (1986).
b- A. La Porta, R.E. Slusher and B. Yurke, ”Back-Action Evading Measurements of an Optical Field Using Parametric Down Conversion”, Phys. Rev. Lett. 62, 28 (1989).
c- P. Grangier, J-F. Roch and G. Roger, ”Observation of Backaction-Evading Measurement of an Optical Intensity in a Three-Level Atomic Nonlinear System”, Phys. Rev. Lett. 66, 1418 (1991). -
[5]
Les différentes techniques de
détection interférométrique des ondes gravitationnelles sont
présentées dans les articles et livres suivants. Les deux
dernières références décrivent plus spécifiquement les
projets VIRGO et LIGO:
a- K. S. Thorne, ”Gravitational-Waves research : Current status and future prospects”, Rev. Mod. Phys. 52, 285 (1980).
b- ”Quantum Optics, Experimental Gravity, and Measurement Theory”, eds. P. Meystre and M. O. Scully (Plenum Press, New York, 1983).
c- P. Hello, ”Optical aspects of interferometric gravitational-wave detectors”, Progress in Optics XXXVIII, ed. E. Wolf (North-Holland, 1998).
d- C. Bradaschia et al, ”The VIRGO project : A wide band antenna for gravitationnal wave detection”, Nucl. Instrum. Meth. A289, 518 (1990).
e- A. Abramovici et al, ”The Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory”, Science 256, 325 (1992). -
[6]
Etude théorique du bruit thermique des modes
de vibration interne des miroirs dans un interféromètre:
a- F. Bondu, J.-Y. Vinet, ”Mirror thermal noise in interferometric gravitational-wave detectors”, Phys. Lett. A198, 74 (1995).
b- A. Gillespie and F. Raab, ”Thermally excited vibrations of the mirrors of laser interferometer gravitational-wave detectors”, Phys. Rev. D52, 577 (1995).
c- F. Bondu, P. Hello, J.-Y. Vinet, ”Thermal noise in mirrors of interferometric gravitational wave antennas”, Phys. Lett. A246, 227 (1998). -
[7]
Utilisation des états comprimés pour
améliorer la sensibilité d’une mesure
interférométrique:
a- M. Xiao, L. Wu, and J. Kimble, ”Precision Measurement beyond the Shot-Noise Limit”, Phys. Rev. Lett. 59, 278 (1987).
b- P. Grangier, R. E. Slusher, B. Yurke, and A. LaPorta, ”Squeezed-Light-Enhanced Polarization Interferometer”, Phys. Rev. Lett. 59, 2153 (1987). - [8] M. J. Sparnaay, ”Measurements of attractive forces between flat plates”, Physica XXIV, 751 (1958).
-
[9]
Etude théorique de la limite quantique dans
les mesures interférométriques:
a- C. M. Caves, ”Quantum-Mechanical Radiation-Pressure Fluctuations in an Interferometer”, Phys. Rev. Lett. 45, 75 (1980).
b- C. M. Caves, ”Quantum-mechanical noise in an interferometer”, Phys. Rev. D23, 1693 (1981).
c- M. T. Jaekel and S. Reynaud, ”Quantum Limits in Interferometric Measurements”, Europhys. Lett. 13, 301 (1990). - [10] L. Lugiato, ”Theory of optical bistability”, Progress in Optics XXI, ed. E. Wolf (North-Holland, 1984), p. 71.
-
[11]
Etude expérimentale et théorique de la
bistabilité induite par la pression de radiation dans une cavité
Fabry-Perot:
a- A. Dorsel, J. D. McCullen, P. Meystre and E. Vignes, ”Optical bistability and mirror confinement induced by radiation pressure”, Phys. Rev. Lett. 51, 1550 (1983).
b- P. Meystre, E. M. Wright, J. D. McCmullen and E. Vignes, ”Theory of radiation-pressure-driven interferometers”, J. Opt. Soc. Am. B2, 1830 (1985). - [12] S. Reynaud, C. Fabre, E. Giacobino, and A. Heidmann, ”Photon noise reduction by passive optical bistable systems”, Phys. Rev. A40, 1440 (1989).
-
[13]
Production d’état comprimé par
mélange à quatre ondes:
a- R. E. Slusher, L. W. Hollberg, B. Yurke, J. C. Mertz and J. F. Valley, ”Observation of Squeezed States Generated by Four-Wave Mixing in an Optical Cavity”, Phys. Rev. Lett. 55, 2409 (1985).
b- A. Lambrecht, T. Coudreau, A. M. Steinberg and E. Giacobino, ”Squeezing with cold atoms”, Europhys. Lett. 36, 93 (1996). - [14] C. Fabre, M. Pinard, S. Bourzeix, A. Heidmann, E. Giacobino, and S. Reynaud, ”Quantum noise reduction using a cavity with a movable mirror”, Phys. Rev. A49, 1337 (1994).
-
[15]
Les deux références qui suivent
présentent deux schémas possibles de mesure QND de l’intensité
avec une cavité à miroir mobile. Le premier schéma utilise une
détection capacitive, alors que le second utilise une détection
optique :
a- M. Pinard, C. Fabre and A. Heidmann, ”Quantum-nondemolition measurement of light by a piezoelectric crystal”, Phys. Rev. A51, 2443 (1995).
b- A. Heidmann, Y. Hadjar, M. Pinard, ”Quantum nondemolition measurement by optomechanical coupling”, Appl. Phys. B64, 173 (1997). - [16] J. Weber, ”Detection and generation of gravitational waves”, Physical review 177, 306 (1960).
-
[17]
Proposition d’utiliser une cavité optique de
grande finesse comme transducteur sur les barres de Weber:
L. Conti et al, ”Optical transduction chain for gravitational wabe bar detectors”, Rev. Sci. Instrum. 69, 554 (1998). -
[18]
On pourra trouver une description des
différents transducteurs capacitifs, et une liste complète de
références dans:
M. F. Bocko and R. Onofrio, ”On the measurement of a weak classical force coupled to a harmonic oscillator: experimental progress”, Rev. Mod. Phys. 68, 755 (1996). -
[19]
A. Heidmann and S. Reynaud, ”Photon
noise reduction by reflection from a mo-
vable mirror”, Phys. Rev. A50, 4237 (1994). -
[20]
Représentation corpusculaire de la lumière
et étude de ses propriétés statistiques:
a- M. C. Teich and B. E. A. Saleh, ”Photon bunching and antibunching”, Progress in Optics XXVI, ed. E. Wolf (North-Holland, 1988), p. 1.
b- R. Loudon, ” The Quantum Theory of Light” second edition (Oxford University Press, 1983). - [21] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, ”Cours de physique théorique : physique statistique” (Mir, 1967).
-
[22]
et sont des variances de
nature différentes et il n’est pas tout à fait justifié de les
comparer. Un calcul plus rigoureux des ordres de grandeur montre que doit en fait être de l’ordre de .
Voir:
A. Heidmann, réf. 19. - [23] E. P. Wigner, ”On the Quantum Correction For Thermodynamic Equilibrium”, Phys. Rev. 40, 749 (1932).
-
[24]
On trouvera une présentation de la
méthode semi-classique ainsi que quelques applications dans les articles
suivants:
a- S. Reynaud and A. Heidmann, ”A semiclassical linear input output transformation for quantum fluctuations”, Opt. Comm. 71, 209 (1989).
b- C. Fabre, S. Reynaud, ”Fundamental Systems in Quantum Optics”, 1990 Les Houches Lectures, eds. by J. Dalibard, J.M. Raymond and J. Zinn-Justin (North-Holland, Amsterdam, 1992), p. 675.
c- S. Reynaud et al, réf 2e.
d- A. Ekert and P. Knight, ”Relationship between semiclassical and quantum-mechanical input-output theories of optical response”, Phys. Rev. A43, 3934 (1991). - [25] Voir C. Bradaschia et al, réf. 5d.
- [26] Voir A. Abramovici et al, réf. 5e.
- [27] La courbe de la figure 11 a été tracée en utilisant les résultats de la thèse de F. Bondu, ”Etude du bruit thermique et stabilisation en fréquence du laser du détecteur interférométrique d’ondes gravitationnelles VIRGO”, Thèse de l’université Paris-Sud, janvier 1996.
-
[28]
L’utilisation de la détection homodyne pour mesurer
des fluctuations quantiques de la lumière est présentée
dans:
a- U. Leonhardt and H. Paul, ”Measuring the quantum state of light”, Prog. Quant. Elect. 19, 89 (1995).
b- S. Reynaud et al, réf. 2e. - [29] J. Mertz, T. Debuisschert, A. Heidmann, C. Fabre and E. Giacobino, ”Improvements in the observed intensity correlation of optical parametric oscillator twin beams”, Opt. Lett. 16, 1234 (1991).
- [30] W. H. Richardson, S. Machida, and Y. Yamamoto, ”Squeezed Photon-Number Noise and Sub-Poissonian Electrical Partition Noise in a Semiconductor Laser”, Phys. Rev. Lett. 66, 2867 (1991).
- [31] P. Tourrenc, N. Deruelle, ”Effects of the time delays in a non linear pendular Fabry-Perot”, Ann. Phys. (Paris) 10, 241 (1985).
-
[32]
Pour l’équation de Navier-Stokes dans les
liquides, voir:
a- L. D. Landau, E. M. Lifshitz, ”Mécanique des fluides”, chap II, §15 (Mir, 1971).
Dans les solides, la dissipation liée à une force de frottement visqueux coïncide formellement avec celle dans les liquides:
b- L. D. Landau, E. M. Lifshitz, ”Cours de physique théorique: Théorie de l’élasticité”, chap V, §33, 2e édition (Mir, 1990). -
[33]
Les deux références suivantes
présentent les résultats expérimentaux de la mesure de l’angle
de perte pour les modes de vibration des fil de suspension d’un miroir, et
pour un pendule de torsion:
a- A. Gillespie and F. Raab, ”Suspension losses in the pendula of laser interfe-
rometer gravitational-wave detectors”, Phys. Lett. A190, 213 (1994).
b- G. I. Gonzalez and P. R. Saulson, ”Brownian motion of a torsion pendulum with internal friction”, Phys. Lett. A201, 12 (1995). -
[34]
Le comportement en fréquence de l’angle de
perte peut s’expliquer par un modèle qui repose sur le caractère
anélastique de la réponse dynamique d’un solide à une excitation
extérieure. Voir:
a- C. Zener, ”Elasticité et anélasticité des métaux” (Dunod, Paris, 1955).
b- P. R. Saulson, ”Thermal noise in mechanical experiments”, Phys. Rev. D42, 2437 (1990).
c- A. S. Nowick and B. S. Berry, ”Anelastic Relaxation in Crystalline Solids” (Academic Press, New York, 1972). -
[35]
On trouvera une analyse complète des modes gaussiens
en optique dans:
a- H. W. Kogelnik and T. Li, ”Laser Beams and Resonators”, Appl. Opt. 5, 1550 (1966).
b- H. W. Kogelnik, E. P. Ippen, A. Dienes, and C. V. Shak, ”Astigmatically Compensated Cavities for CW Dye Lasers”, IEEE Journal of Quantum Electronics QE-8, 373 (1972). -
[36]
On peut montrer que la diffusion dans les autres modes
de la cavité se traduit comme des pertes pour le mode fondamental. Ces
pertes sont d’autant plus petites que la finesse de la cavité est
grande. Voir par exemple:
J-M. Courty and A. Lambrecht, ”Transverse-mode coupling in a Kerr medium”, Phys. Rev. A54, 5243 (1996). - [37] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, ”Cours de physique théorique: Théorie de l’élasticité”, 2e édition (Mir, 1990).
-
[38]
L’expression de l’énergie potentielle se
déduit de la densité lagrangienne qui décrit le champ des déplacements de tout élément de
volume du résonateur. Voir par exemple:
L. D. Landau, réf. 37, chap I, §4. -
[39]
Une approche théorique des modes acoustiques
gaussiens, ainsi qu’une comparaison avec les résultats obtenus
expérimentalement par rayons X sont présentés dans:
C. J. Wilson, ”Vibration modes of AT-cut convex quartz resonators”, J. Phys. D: Appl. Phys. 7, 2449 (1974). - [40] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, ”Table of integrals”, series and products (Academic Press, 1981).
-
[41]
Voir par exemple:
a- B. Capelle, J. Detaint, J. Schwartzel, Y. Zheng, A. Zarka, ”Synchrotron radiation X ray topography study of lateral field resonators”, Procedings of the 6th European Frequency and Time Forum, March 1992 (ESA, Netherlands), p. 105.
b- D. S. Stevens and H. F. Tiersten, ”An analysis of doubly rotated quartz resonators utilising essentially thickness modes with transverse variation”, J. Acoust. Soc. Am. 79, 1811 (1986).
c- C. J Wilson, réf. 39. - [42] A. El Hatbi, A. Zarka and F. Bastien, ”Physical limitation on the quality factor of quartz resonators”, J. Acoust. Soc. Am. 94, 917 (1993).
-
[43]
Une théorie scalaire reliant la
rugosité à la diffusion à été proposée
par:
H. E. Bennett and J. O. Porteus, ”Relation between surface roughness and specular reflectance”, J. Opt. Soc. Am. 51, 123 (1961). -
[44]
On trouvera une description détaillée du
dispositif interférométrique ainsi que de nombreuses
références concernant d’autres dispositifs utilisés pour mesurer
la rugosité des surfaces superpolies dans:
P. Gleyzes et A. C. Boccara, ”Profilométrie picométrique par interférométrie de polarisation. I. L’approche monodétecteur”, J. Optics (Paris) 25, 207 (1990). -
[45]
Description de la méthode D.I.B.S. et étude des
propriétés des couches déposées:
M. Cervo, G. Carter, ”Ion-beam and dual ion-beam sputter deposition of tantalum oxide films”, Opt. Eng. 34, 596 (1995). - [46] C. Amra, ”Calculs et mesures de diffusion appliqués à l’étude de la rugosité dans les traitements optiques multicouches”, J. Optics (Paris) 21, 83 (1990).
- [47] F. Biraben et P. Labastie, ”Balayage d’un laser à colorant continu monomode sur ”, Opt. Comm. 41, 49 (1982).
- [48] R. W. P. Drever, J. L. Hall, F. V. Kowalski, P. Hough, G. M. Ford, A. J. Munley, H. Ward, ”Laser Phase and Frequency Stabilization using an Optical Resonator”, Appl. Phys. 31, 97 (1983).
- [49] Voir H. W. Kogelnik and T. Li, réf. 35a.
-
[50]
De manière générale le facteur de
Mandel décrit les corrélations temporelles
entre les photons. Il décrit aussi bien un excès de bruit (
pour une statistique super-Poisonienne) qu’une réduction de bruit (
pour une statistique sub-Poisonienne) par rapport au bruit de photon
standard. Voir:
- S. Reynaud et al, réf. 2e, p. 37.
- M. C. Teich, réf. 20a, p. 104. -
[51]
La mesure du bruit de photon standard à
l’aide d’une détection équilibrée peut aussi s’interpréter
en tenant compte des fluctuations du vide entrant par la 2seconde
entrée du cube séparateur de polarisation. Voir par
exemple:
S. Reynaud et al, réf. 2e, p. 7. - [52] La seconde voie d’entrée du cube CP2 sépare de la même manière les composantes de polarisations orthogonales des fluctuations du vide. Celles-ci ne sont cependant pas couplées aux champs lumineux car elles sont orthogonales aux faisceaux lumineux dans chacune des voies de sortie.
- [53] La susceptibilité effective du coupleur d’entrée a été déterminée à l’aide du programme CYPRES développé par F. Bondu et J.-Y. Vinet. Voir : F. Bondu et al, réf 6a.