Université de Tunis
Institut Supérieur de Gestion
École Doctorale Sciences de Gestion
![[Uncaptioned image]](/html/1810.07116/assets/x1.png)
Motifs corrélés rares : Caractérisation et nouvelles représentations concises
Mémoire en vue de l’obtention du Mastère en
Informatique Appliquée à la Gestion
Présenté par :
Souad BOUASKER
Sous la direction de :
Mr. Sadok BEN YAHIA
Mr. Tarek HAMROUNI
Année Universitaire 2010/2011
Dédicaces
À la mémoire de mon père qui est toujours présent dans mon esprit et mon coeur. À ton âme papa, et la mémoire du grand amour que tu m’as offert, je dédie ma réussite.
À ma chére mère à qui je dois tout et dont l’amour, l’affection, les encouragements et la patience ont été pour moi le meilleur gage de réussite. En témoignage de ma reconnaissance et mon attachement.
À ma famille, à qui je dois tout mon bonheur et ma prospérité
À mes maîtres, à qui je tiens à leur montrer que je suis et je reste à l’hauteur de
leur espérances
Et enfin à tous ceux qui m’ont soutenu de prés ou de loin durant mes études
Je dédie ce modeste travail
Souad
Remerciements
Au terme de ce travail, je commence tout d’abord par saluer vivement les membres du jury pour l’honneur qu’ils me font en acceptant d’évaluer ce modeste travail.
Mes remerciements les plus cordiaux s’adressent à mon directeur de mémoire Monsieur Sadok BEN YAHIA, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Tunis, pour son implication, sa disponibilité incessante et ses conseils rigoureux. Puissent ces lignes être l’expression de ma plus profonde reconnaissance.
Mes remerciements les plus sincères et ma gratitude s’adressent à mon co-directeur de mémoire Monsieur Tarek HAMROUNI, Assistant à l’Institut Supérieur des Arts Multimédias de La Mannouba. Sa patience, sa disponibilité, sa rigueur scientifique, son sens critique m’ont été d’une aide précieuse et ses judicieux conseils qui ont contribué à l’amélioration de ce mémoire.
Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail.
Liste des Algorithmes
loa
Introduction générale
L’extraction des règles d’association est une technique très répandue dans la fouille de données et répond aux besoins des experts dans plusieurs domaines d’application [Ayouni et al., 2010, Hamrouni et al., 2008, Ben Othman et Ben Yahia, 2008].Plusieurs travaux se sont ainsi focalisés sur la dérivation des règles d’association à partir des motifs fréquents. Toutefois, l’utilisation de ces motifs ne constitue pas une solution intéressante pour certaines applications, telles que la détection d’intrusions, la détection des fraudes, l’identification des valeurs extrêmes dans les bases de données, l’analyse des données criminelles, l’analyse du désordre génétique à partir des données biologiques, l’analyse des maladies rares à partir des données médicales, l’analyse des données d’apprentissage en ligne, etc. [Booker, 2009, He et Xu, 2005, Koh et Rountree, 2010, Mahmood et al., 2010, Manning et al., 2008, Romero et al., 2010, Szathmary et al., 2010, Gasmi et al., 2007].
En effet, dans de telles situations, un comportement fréquent peut être sans valeur ajoutée pour l’utilisateur final. Par contre, les événements peu fréquents sont les plus intéressants parce qu’ils indiquent qu’un événement inattendu, une exception par exemple [Taniar et al., 2008], est survenue. Une étude doit alors continuer afin de déterminer les causes possibles de ce changement peu commun du comportement normal.
La fouille des motifs rares s’est alors avérée d’une réelle valeur ajoutée [Koh et Rountree, 2010, Yun et al., 2003, Weiss, 2004]. En effet, ces motifs, ayant une fréquence d’apparition dans la base inférieure à un certain seuil donné, permettent de cerner les événements rares, peu communs, inattendus, exceptionnels, cachés, etc. [Berberidis et Vlahavas, 2007, Padmanabhan et Tuzhilin, 2006, Weiss, 2004]. En effet, la détection des valeurs extrêmes est une tache utile dans plusieurs applications réelles comme la détection des fraudes des cartes de crédit, la découverte des activités criminelles dans le commerce électronique et le marketing.
Comme illustration des applications des motifs rares dans le domaine de la sécurité informatique [Brahmi et al., 2010], étant donné un fichier log qui représente les tentatives de connexions effectuées sur un serveur Web d’authentification, ces motifs véhiculent les informations liées aux tentatives d’attaques à savoir par exemple l’origine des attaques, les ports les plus attaqués et les services les plus visés. Considérons par exemple la table 1 qui représente un échantillon réduit d’un tel fichier V dénote Valide, NV dénote Non Valide, et une date d’accès. Par exemple, si le motif (197.1.104.19, 1221, NV) s’avère rare, l’adresse 197.1.104.19 peut étre considérée à l’origine d’une attaque sur le port 1221. Une analyse détaillée de ses accés est alors à effectuer.
| Adresse IP | Port | Authentification | Date |
|---|---|---|---|
| 197.2.123.87 | 23 | NV | |
| 197.1.104.19 | 1221 | NV | |
| 194.23.22.2 | 80 | V | |
| 197.1.104.19 | 225 | V | |
| 197.2.123.29 | 21 | V | |
| 197.1.104.19 | 1221 | NV | |
| 197.1.156.27 | 145 | V |
Dans la pratique, l’exploitation des motifs rares est confrontée à diverses contraintes dont les principales sont : () l’extraction complexe de ces motifs qui ne bénéficient pas des propriétés des motifs fréquents et par conséquent les critères d’élagage appliqués pour ces derniers ne sont pas exploitables; () le nombre très important des motifs rares qui ne sont pas aussi rares, dans les applications réelles, que laisserait présager leur qualificatif; et () la qualité des motifs rares extraits et qui peuvent comporter des items qui n’ont aucun lien sémantique entre eux. Par exemple, le motif composé par les items “” et “” est un motif rare. Cependant, aucune corrélation n’existe entre le produit “” très fréquemment acheté et le produit “” cher et rarement acheté.
Afin que l’exploitation des motifs extraits soit fructueuse, leur nombre relativement réduit et leur qualité intéressante sont deux critères importants que doit chercher à faire émerger un processus de fouille. Dans le domaine médical ou encore dans la sécurité des réseaux informatiques par exemple, une information exacte et précise est exigée. Ainsi, l’idée d’extraire les motifs rares tout en intégrant les mesures de corrélations est d’une grande utilité. En effet, l’intégration de telles mesures permet de limiter l’ensemble extrait aux motifs rares ayant une corrélation entre leurs items dépassant un certain seuil de corrélation. Ces motifs corrélés rares offrent ainsi un fort lien sémantique entre les items les composant.
Dans [Hamrouni et al., 2011], les auteurs ont proposé des représentations concises sans perte d’information, appelées aussi exactes, des motifs rares sans aucune considération des mesures de corrélations dans le processus de fouille. Une étude des représentations concises des motifs fréquents [Calders et al., 2005] a été alors menée afin de proposer celles des motifs rares. Elle a prouvé l’intérêt de considérer la notion de classe d’équivalence, associée à l’opérateur de fermeture conjonctive [Ganter et Wille, 1999], permettant de réduire la redondance au sein des motifs en regroupant ensemble ceux caractérisant un même ensemble de transactions. Les éléments minimaux et maximaux de la classe, les générateurs minimaux (appelé aussi itemsets libres) et les itemsets fermés [Pasquier et al., 2005] respectivement, sont ainsi à la base des représentations des motifs rares proposées. Par ailleurs, un des résultats clés de cette étude est que les représentations basées sur les règles de déduction [Calders et al., 2005] et celles basées sur les identités d’inclusion-exclusion [Casali et al., 2005, Hamrouni et al., 2009] ne sont pas adaptées à la fouille des motifs rares.
D’autre part, l’approche présentée dans [Ben Younes et al., 2010a, Ben Younes et al., 2010a] utilise la mesure de corrélation bond [Omiecinski, 2003] pour l’extraction de représentations concises exactes des motifs corrélés fréquents. Ceci a permis de ne retenir qu’un sous-ensemble des motifs fréquents, constitué par les motifs présentant une forte corrélation entre les items les constituant. Le choix de cette mesure a été effectué sur la base d’une étude de ses propriétés qui se sont avérées plus intéressantes que celles d’autres mesures de corrélation. Toutefois, l’intégration d’une mesure de corrélation est d’une utilité encore plus grande dans le cas de la fouille des motifs rares. En effet, elle permet d’éviter l’extraction de motifs contenant des items n’ayant aucun lien sémantique entre eux ce qui expliquerait en quelque sorte pourquoi ces motifs sont rares. Ainsi, sans l’utilisation d’une mesure de corrélation, un motif rare peut ne représenter aucune information utile s’il est composé d’items faiblement corrélés entre eux. Un motif rare intéressant serait donc celui qui apparaît un nombre très faible de fois dans la base tout en ayant des items qui sont fortement liés, c-.é.-d. que l’apparition de l’un dépend de celles des autres.
Ainsi, dans ce mémoire, nous allons nous intéresser à l’extraction des représentations concises exactes des motifs corrélés rares. Dans ce cadre, nous nous intéressons à la mesure de corrélation bond correspondant au rapport entre le support conjonctif d’un motif et son support disjonctif. Notre choix de cette mesure est motivé par le cadre théorique dont elle bénéficie [Omiecinski, 2003] ainsi que l’étude structurelle qui a été effectuée dans [Ben Younes et al., 2010a, Ben Younes et al., 2010a]. En plus, il a été prouvé dans [Surana et al., 2010] que la mesure bond vérifie les propriétés théoriques que toute mesure de qualité dédiée aux règles d’association rares doit avoir. La mesure bond a été aussi utilisée dans l’approche de fouille de motifs corrélés proposée dans [Segond et Borgelt, 2011]. L’extraction des motifs corrélés a été alors montrée plus complexe tout en étant plus informative que celle des motifs fréquents [Segond et Borgelt, 2011]. Il est toutefois important de noter qu’aucune étude de l’ensemble des motifs corrélés rares n’a été effectuée dans [Segond et Borgelt, 2011, Surana et al., 2010].
Grace à cette propriété d’anti-monotonie, les motifs corrélés, selon la mesure bond, induisent un idéal d’ordre dans le treillis des motifs (tout sous-ensemble d’un motif corrélé est aussi corrélé). Par opposition à ces derniers, les motifs rares induisent un filtre d’ordre et vérifient une contrainte monotone (tout sur-ensemble d’un motif rare est aussi rare). Par conséquent, l’ensemble des motifs corrélés rares que nous visons à extraire résulte de l’intersection des deux théories [Mannila et Toivonen, 1997] associées respectivement aux contraintes de corrélation et de rareté.
La nature opposée de ces contraintes permet de différencier l’ensemble des motifs corrélés rares de l’ensemble des motifs induit par une ou plusieurs contraintes de même type [Boulicaut et Jeudy, 2010] [Pei et Han, 2004]. Cette caractéristique rend plus complexe l’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares. À cet égard, nous proposons dans ce mémoire une caractérisation de cet ensemble moyennant la notion de classe d’équivalence. Dans notre cas, les classes d’équivalence seront induites par l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond. Ces classes jouent un rôle clé dans l’élimination de la redondance entre les motifs. Une fois la caractérisation effectuée, nous proposons des représentations exactes des motifs corrélés rares. Ces représentations permettent d’une part de réduire significativement le nombre de motifs corrélés rares extraits. Elles améliorent aussi leur qualité et ce en évitant la redondance entre motifs puisqu’elles ne maintiennent qu’un sous-ensemble sans perte d’information de l’ensemble total des motifs corrélés rares. D’autre part, elles assurent la régénération aisée et efficace de l’ensemble des motifs corrélés rares. Il est aussi important de noter que les représentations proposées permettent non seulement la dérivation du support conjonctif mais aussi des supports disjonctif et négatif des motifs corrélés rares. Ceci permet par exemple d’utiliser ces motifs comme base pour l’extraction des règles généralisées ou les connecteurs de disjonction et de négation sont utilisés en plus de celui classique de conjonction [Hamrouni et al., 2010].
Au meilleur de notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée dans la littérature dans le but de proposer une représentation concise des motifs corrélés rares. Par ailleurs, une autre originalité de ce travail consiste en la nature des contraintes manipulées et la caractérisation de l’ensemble résultant moyennant une relation d’équivalence. Nous signalons aussi que l’approche proposée dans ce travail n’est pas restreinte aux motifs corrélés rares selon cette mesure. En effet, elle est générique dans le sens qu’elle s’applique à tout ensemble de motifs corrélés rares selon toute mesure de corrélation vérifiant les mêmes propriétés structurelles que la mesure bond telle que par exemple la mesure all-confidence [Omiecinski, 2003] 111Mathématiquement équivalente à la mesure h-confidence [Xiong et al., 2006].. Il est toutefois à noter que la mesure bond a pour avantage de permettre la dérivation des supports disjonctif et négatif, ce que ne peut pas permettre les autres mesures.
Structure du mémoire
La synthèse des travaux de recherches effectués sera présentée dans le cadre de ce mémoire et répartie dans cinq chapitres comme suit.
Dans le premier chapitre, nous présentons les notions de base qui seront utilisées tout au long de ce travail. Ces notions de bases incluent les notions préliminaires relatives à l’extraction des motifs intéressants et des représentations concises exactes de ces derniers. Les caractéristiques des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond y seront aussi présentés. De plus, nous intégrons la présentation des opérateurs de fermetures et nous spécifions précisément l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond.
Le deuxième chapitre décrit les approches d’extraction des motifs rares et les différentes approches d’extraction des motifs corrélés sous contraintes. Nous y étudions et analysons aussi les algorithmes d’extraction de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés.
Dans le troisième chapitre, nous définissons et étudions profondément les propriétés de l’ensemble des motifs corrélés rares selon la mesure bond. Nous présentons aussi les spécificités des classes d’équivalence corrélées rares. Ensuite, nous exposons les nouvelles représentations concises exactes des motifs corrélés rares selon la mesure bond à savoir , et . Nous clôturons ce chapitre avec la définition et l’étude de la représentation concise approximative .
Dans le quatrième chapitre, nous introduisons le nouvel algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble total des motifs corrélés rares dans un premier temps. Ensuite, nous présentons l’algorithme CRPR_Miner d’extraction des représentations concises proposées. Nous démontrons ses propriétés théoriques de validité et de terminaison. Par ailleurs, nous décrivons les stratégies d’interrogation et de régénération des motifs corrélés rares à partir de la représentation concise exacte et nous proposons et décrivons les algorithmes dédiés.
Le cinquième chapitre présente les études expérimentaux menées sur des bases “benchmark”. Cette étude s’étalera sur deux principaux axes. Le premier axe concerne la quantification et l’analyse des taux de compacité des différentes représentations concises proposées. Le deuxiéme axe concerne la comparaison et l’analyse de la variation des coéts d’extraction des différentes représentations proposées. De plus, nous décrivons le processus d’extraction des régles de classification corrélées rares à partir de la représentation concise exacte . Nous évaluons expérimentalement l’efficacité de la classification basée sur ces régles dans le cadre de la détection d’intrusions.
Ce mémoire se termine par une conclusion générale récapitulant l’ensemble de nos contributions et cernant les principales perspectives futures de travaux de recherche.
Chapitre 1 Notions de base
1.1 Introduction
Nous repérons, dans ce chapitre, les notions de base que nous estimons primordiales dans la présentation de nos approches. À cet égard, la première section sera consacrée à l’introduction des notions préliminaires sur laquelle est basée l’extraction des motifs. Nous enchaînons, dans la deuxième section, avec la présentation des propriétés des motifs rares. Ensuite, la troisième section sera dédiée à la présentation des motifs corrélés selon la mesure de corrélation bond. La quatrième section sera consacrée à la présentation de l’opérateur de fermeture [Ben Younes et al., 2010a] associé à la mesure bond. Ce chapitre sera clôturé avec une définition des représentations concises associés à un ensemble de motifs.
1.2 Extraction des motifs
Nous commençons par présenter l’ensemble des notions de base relatives à l’extraction des motifs, qui seront utilisés tout au long de ce travail. Définissons d’abord une base de transactions à partir de laquelle se fait l’extraction des motifs intéressants.
Définition 1
(Base de transactions) Une base de transactions (appelée aussi contexte d’extraction ou simplement contexte) est représentée sous la forme d’un triplet = () dans lequel et sont, respectivement, des ensembles finis de transactions (ou objets) et d’items (ou attributs), et est une relation binaire entre les transactions et les items. Un couple (, ) dénote le fait que la transaction contient l’item .
Exemple 1
Un exemple d’une base de transactions () (resp. contexte d’extraction ()) est donné par la table 1.1. Dans cette base (resp. ce contexte), l’ensemble de transactions (resp. d’objets ) et l’ensemble d’items A, B, C, D, E,. Le couple (2, B) car la transaction 2 contient l’item B .
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Remarque 1
Nous notons, par souci de précision, que les notations de base de transactions et de contexte d’extraction seront les mêmes dans la suite. Ils seront notés .
Définition 2
Itemset ou Motif
Une transaction , avec un identificateur
communément noté TID (Tuple
IDentifier), contient un ensemble, non vide, d’items de
. Un sous-ensemble de ou
est appelé un -motif ou simplement un
motif, et représente la cardinalité de
Le nombre de transactions d’une base contenant un motif ,
, est appelé support absolu de et noté
par la suite . Le support
relatif de ou la fréquence de , notée
, est le quotient de son support absolu
par le nombre total de transactions de ,
c.-é.-d.,
.
Remarque 2
Nous signalons que dans ce travail, nous nous intéressons à la classe des motifs formée par des itemsets, c.-é.-d., des ensembles d’items. Par conséquent, nous employons dans la suite une forme sans séparateur pour dénoter les itemsets. Par exemple,AC représente l’ensemble d’items A, C.
Introduisons à ce stade la notion de treillis des motifs.
Définition 3
(Treillis des motifs) Un treillis des motifs est un regroupement conceptuel et hiérarchique des motifs. Il est aussi dit treillis d’inclusion ensembliste. Toutefois, l’ensemble des parties de est ordonné par inclusion ensembliste dans le treillis des motifs. Le treillis des motifs associé au contexte donné par la table 1.1 est représenté par la figure 1.1.
Toutefois, plusieurs mesures sont utilisées pour évaluer l’intérêt d’un motif, dont les plus connues sont présentées à travers la définition 4.
Définition 4
(Supports d’un motif) Soient = () une base de transactions et un motif non vide . Nous distinguons trois types de supports correspondants à :
- Le support conjonctif : Supp() = : (, )
- Le support disjonctif : Supp() = : (, )
- Le support négatif : Supp() = : (, )
Il est à noter que la loi de De Morgan assure la transition entre le support disjonctif et le support négatif de comme suit : Supp(I) = - Supp(I).
Exemple 2
Considérons la base de transactions illustrée par la table 1.1 et qui sera utilisée dans la suite pour les différents exemples. Nous avons Supp(AD) = 1 = , Supp(AD) = 1, 3, 5 = , et, Supp((AD)) = 2, 4 = 111Nous employons une forme sans séparateur pour les ensembles d’items : par exemple, AD représente l’ensemble A, D..
Dans la suite, s’il n’y a pas de risque de confusion, le support conjonctif sera simplement appelé support. La définition suivante présente le statut de fréquence d’un motif, fréquent ou infréquent, étant donné un seuil minimal de support [Agrawal et Srikant, 1994].
Définition 5
(Motif fréquent/rare) Soit une base de transactions = , un seuil minimal de support conjonctif minsupp, un motif est dit fréquent si Supp() minsupp. est dit infréquent ou rare sinon.
Exemple 3
Soit minsupp = 2. Supp(BCE) = 3, le motif BCE est un motif fréquent. Cependant, le motif CD est non fréquent ou rare puisque Supp(CD) = 1 2.
Outre la contrainte de fréquence minimale traduite par le seuil minsupp, d’autres contraintes peuvent étre intégrées dans le processus d’extraction des motifs. Ces contraintes admettent différents types, dont les deux principaux sont définis dans ce qui suit [Pei et Han, 2004].
Définition 6
(Contrainte anti-monotone/monotone)
Une contrainte est anti-monotone si , : satisfait satisfait .
Une contrainte est monotone si , : satisfait satisfait .
Exemple 4
La contrainte de fréquence, c.-é.-d. avoir un support supérieur ou égal à minsupp, est une contrainte anti-monotone. En effet, , , si et Supp() minsupp, alors Supp() minsupp puisque Supp() Supp().
D’une maniére duale, la contrainte de rareté, c.-é.-d. avoir un support strictement inférieur à minsupp, est monotone. En effet, , , si et Supp() minsupp, alors Supp() minsupp puisque Supp() Supp().
Soit l’ensemble de tous les sous-ensembles de . Dans ce qui suit, nous introduisons les notions duales d’idéal d’ordre et de filtre d’ordre [Ganter et Wille, 1999] définis sur .
Définition 7
(Idéal d’ordre) Un sous-ensemble de est un idéal d’ordre s’il vérifie les propriétés suivantes :
-
—
Si , alors : .
-
—
Si , alors : .
Définition 8
(Filtre d’ordre) Un sous-ensemble de est un filtre d’ordre s’il vérifie les propriétés suivantes :
-
—
Si , alors : .
-
—
Si , alors : .
Une contrainte anti-monotone telle que la contrainte de fréquence induit un idéal d’ordre. D’une maniére duale, une contrainte monotone telle que la contrainte de rareté forme un filtre d’ordre. L’ensemble des motifs satisfaisant une contrainte donnée est appelé théorie dans [Mannila et Toivonen, 1997]. Cette théorie est délimitée par deux bordures, une dite bordure positive et l’autre appelée bordure négative, et qui sont définies comme suit.
Définition 9
(Bordure positive/négative) [Bonchi et Lucchese, 2006]
Pour le cas d’une contrainte anti-monotone ,
la bordure correspond à l’ensemble des motifs dont tous les sous ensembles satisfont cette contrainte et dont tous les sur-ensembles ne la satisfont pas.
Soit un ensemble de motifs am satisfaisant une contrainte anti-monotone , la bordure est formellement définie comme suit :
(am) = : am et : am
Pour le cas d’une contrainte monotone , la bordure correspond à l’ensemble des motifs dont tous les sur-ensembles satisfont cette contrainte et dont tous les sous ensembles ne la satisfont pas. Soit un ensemble de motifs m satisfaisant une contrainte monotone , la bordure est formellement définie comme suit :
(m) = : m et : m
Cependant, il est à distinguer entre la bordure positive et la bordure négative pour une contrainte donnée. Soit un ensemble de motifs satisfaisant une contrainte . La bordure positive ) correspond à l’ensemble des motifs appartenant à la bordure ) et qui satisfont la contrainte . La bordure négative ) correspond à l’ensemble des motifs appartenant à la bordure ) et qui ne satisfont pas la contrainte . Ces bordures sont formellement définies comme suit :
= ) ,
= ) .
Exemple 5
Considérons le contexte donné par la table 1.1. L’ensemble des motifs fréquents maximaux est composé des motifs fréquents dont tous les sur-ensembles sont des motifs rares et est égal é, = AC, BCE. Les motifs fréquents maximaux représentent à la fois la bordure positive des motifs vérifiant la contrainte anti-monotone de fréquence et la bordure négative des motifs vérifiant la contrainte monotone de rareté.
Comme dans ce travail, nous nous intéressons principalement aux motifs rares qui sont aussi corrélés, nous présentons certaines propriétés utiles des motifs rares et des motifs corrélés.
1.3 Motifs rares
L’ensemble des motifs rares, correspondant aux motifs vérifiant la contrainte de rareté, est défini comme suit :
Définition 10
(Motifs rares) L’ensemble des motifs rares est défini par : = Supp() minsupp. Ou d’une maniére équivalente : = Supp() maxsupp avec maxsupp correspond au seuil maximal du support conjonctif, maxsupp = minsupp - 1.
Comme indiqué plus haut, cet ensemble forme un filtre d’ordre dans . Il en résulte que tous les sur-ensembles d’un motif rare sont aussi rares.
Exemple 6
Soit minsupp = 4. Le motif BC est rare puisque Supp(BC) = 3 4, BC . Aussi, ABC puisque BC ABC.
Remarque 3
Un motif est dit fréquent si son support est supérieur ou égal au seuil minimal de support minsupp, et il est rare ou non fréquent si son support est strictement inférieur au seuil minsupp ou autrement dit son support est inférieur ou égal au seuil maxsupp. Dans ce qui suit nous considérons que le seuil maxsupp est calculé à partir du seuil minsupp et est égal à minsupp - . Il peut exister un intervalle de valeur entre minsupp et maxsupp [Szathmary, 2006], cependant , nous optons pour le cas général c.-é.-d., un motif est rare s’il n’est pas fréquent. Ceci implique l’existence d’une seule bordure entre les motifs fréquents et ceux rares.
Nous soulignons que, nous ne considérons pas les motifs rares de support égal à zéro. En effet, ces motifs n’apparaissent jamais dans la base et ne représentent donc pas un événement rare.
Dans la suite, nous aurons besoin des motifs rares les plus petits, par rapport à la relation d’inclusion ensembliste. Ces motifs forment la bordure positive de l’ensemble des motifs rares et correspondent aux motifs rares dont tous les sous-ensembles sont fréquents [Hamrouni et al., 2011]. Ils sont définis comme suit :
Définition 11
(Motifs rares minimaux) L’ensemble des motifs rares minimaux correspond aux motifs rares n’ayant aucun sous-ensemble strict rare. Cet ensemble est défini par : = : , ou d’une maniére équivalente : = : Supp() minsupp.
Exemple 7
Considérons la base illustrée par la table 1.1 pour minsupp = 3. Le motif AB puisque Supp(AB) = 2 3 et, d’autre part, Supp(A) = 3 3 et Supp(B) = 4 3. Il en est de même pour D et AE. Ainsi, dans ce cas, = D, AB, AE. L’ensemble ainsi que l’ensemble se tous les motifs rares sont schématisés par la figure 1.1. Le support indiqué en haut à gauche de chaque cadre représentant un motif est son support conjonctif
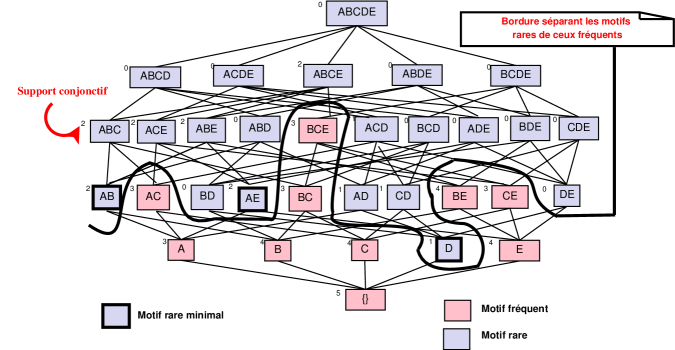
Aprés avoir présenté les motifs rares, nous étudions dans ce qui suit les propriétés des motifs corrélés selon la mesure bond.
1.4 Motifs corrélés selon la mesure bond
La mesure bond [Omiecinski, 2003] est mathématiquement équivalente aux mesures coherence [Lee et al., 2003], coefficient de Tanimoto [Tanimoto, 1958] et Jaccard [Jaccard, 1901]. Elle a été redéfinie dans [Ben Younes et al., 2010a] comme suit :
Définition 12
(Mesure bond) Soit . La mesure bond de est définie par :
bond( ) =
La mesure bond prend ses valeurs sur l’intervalle [0, 1]. En considérant l’univers d’un motif [Lee et al., 2003], c.-é.-d. l’ensemble des transactions contenant un sous-ensemble non-vide de , la mesure bond véhicule l’information concernant le taux d’apparition simultanée des items d’un motif dans son univers. Ainsi, plus les items du motif sont dispersés dans son univers (c.-é.-d. faiblement corrélés), plus sera faible la valeur de bond puisque Supp() serait nettement plus petit que Supp(). Inversement, plus les items de dépendent les uns des autres (c.-é.-d. fortement corrélés), plus sera élevée la valeur de bond puisque Supp() serait proche de Supp().
Aprés avoir présenté la mesure bond, nous définissons maintenant les motifs corrélés selon cette mesure.
Définition 13
(Motifs corrélés selon la mesure bond) Soit minbond un seuil minimal de corrélation. L’ensemble des motifs corrélés selon la mesure bond est défini par : = bond() minbond
Exemple 8
Considérons la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,5, Nous avons bond(AB) = = 0,4 0,5. Le motif AB est alors non corrélé. Par contre, bond(BCE) = = 0,6 0,5. Ainsi, le motif BCE est corrélé.
Il a été démontré dans [Ben Younes et al., 2010a] que la mesure bond présente diverses propriétés intéressantes. En effet, cette mesure : () est symétrique puisque , , bond() = bond(); () est descriptive c.-é.-d. insensible au changement du nombre de transactions; () vérifie la propriété de cross support [Xiong et al., 2006]. Gréce à cette derniére propriété, pour un motif et pour un seuil minimal de corrélation minbond, s’il existe un couple d’items , tel que minbond, alors n’est pas corrélé puisque bond( ) minbond. vérifie alors la propriété de cross-support pour le seuil minbond; et () induit une contrainte anti-monotone du moment que le seuil minimal minbond est fixé. En effet, , , si , alors bond() bond(). Ainsi, l’ensemble des motifs corrélés forme un idéal d’ordre. Autrement dit, si un motif est corrélé, alors tous ses sous-ensembles sont aussi corrélés.
La proposition suivante présente une relation intéressante entre la valeur de la mesure bond et les valeurs des supports conjonctifs et disjonctifs pour chaque couple de deux motifs et tel que [Ben Younes et al., 2010a].
Proposition 1
Soient , et . Si bond() = bond(), alors Supp() = Supp() et Supp() = Supp().
D’aprés la proposition précédente, si bond() =
bond(), alors Supp() =
Supp(). En effet, et ont le même support disjonctif et, par la loi de De Morgan, nous avons le lien suivant entre les supports disjonctif et négatif d’un motif : Supp() = - Supp(). D’autre part, si bond()
bond(), alors
Supp()
Supp() ou
Supp()
Supp() (c.-é.-d. un des deux supports est différent ou les deux à la fois).
Exemple 9
Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. Nous avons bond(ACD) = bond(CD) = . Les motifs ACD et CD ont les mêmes supports conjonctifs et disjonctifs, Supp(ACD) = Supp(CD) = 1 et Supp(ACD) = Supp(CD) = 4. Nous avons bond(ABCE) = bond(BCE) = . En effet, les motifs ABCE et BCE n’ont pas le même support conjonctif, Supp(ABCE) = 2 Supp(BCE) = 3.
Dans la suite, nous aurons besoin de l’ensemble des motifs corrélés maximaux défini formellement comme suit.
Définition 14
(Motifs corrélés maximaux) L’ensemble des motifs corrélés maximaux constitue la bordure positive des motifs corrélés et correspond aux motifs corrélés n’admettant aucun sur-ensemble strict corrélé. Cet ensemble est défini par : = : , ou d’une maniére équivalente : = : bond() minbond.
Exemple 10
Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,2, nous avons = ACD, ABCE. En effet, quelque soit le sur-ensemble strict de ACD ou de ABCE, ce sur-ensemble n’est pas corrélé.
Nous avons ainsi présenté les notions préliminaires des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond. Dans la suite, nous enchaénons avec l’opérateur de fermeture associé à la mesure bond. Cet opérateur permettra de caractériser les motifs gréce aux classes d’équivalence induites.
1.5 Opérateur de fermeture associé à la mesure bond
Définissons d’abord le concept de l’opérateur de fermeture.
Définition 15
Opérateur de fermeture [Ganter et Wille, 1999]
Soit un ensemble partiellement ordonné
(, ). Une application de
(, ) dans
(, ) est appelée un opérateur de
fermeture, si et seulement si elle posséde les propriétés
suivantes. Pour tout sous-ensemble :
1. Isotonie :
2. Extensivité :
3. Idempotence :
L’opérateur de fermeture associé à la mesure bond est défini comme suit [Ben Younes et al., 2010a] :
Définition 16
(Opérateur )
L’opérateur a été démontré d’étre un opérateur de fermeture [Ben Younes et al., 2010a]. En effet, il vérifie les propriétés d’isotonie, d’extensivité et d’idempotence [Ganter et Wille, 1999]. Le motif fermé d’un motif par , c.-é.-d. ), est ainsi l’ensemble maximal d’items contenant et ayant la même valeur de la mesure bond que .
Exemple 11
Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minbond = 0,2, nous avons bond(AB) = , bond(ABC) = , bond(ABE) = . Ainsi, C (AB), et E (AB). Par contre, bond(ABD) = = 0. Ainsi, D (AB). Par conséquent, (AB) = ABCE.
Illustrons les différentes propriétés d’un opérateur de fermeture. Pour la propriété d’isotonie, nous avons AB B, (AB) = ABCE et (B) = BE. Concernant la propriété d’extensivité, nous avons par exemple, (CD) = ACD, CD (CD). Pour la propriété d’idempotence de l’opérateur de fermeture , nous notons l’exemple du motif fermé ABCE, ((ABCE)) = ABCE.
L’application de l’opérateur partitionne l’ensemble des parties de en des classes d’équivalence disjointes définies comme suit.
Définition 17
(Classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture ) Une classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture contient un ensemble de tous les motifs possédant la même fermeture par .
Chaque classe d’équivalence est caractérisée par un élément maximal – un motif fermé – et un ou plusieurs éléments minimaux – des motifs minimaux corrélés. Nous définissons formellement ces motifs.
Définition 18
(Motifs fermés corrélés) L’ensemble des motifs fermés corrélés par est défini par : = : bond() = bond(, ou d’une maniére équivalente : = : ) = .
Exemple 12
Soit la base illustrée par la table 1.1 pour minbond = 0,2. Le motif ACD est corrélé puisque bond(ACD) = = 0,25 0,2. Il est aussi fermé puisque il n’admet pas de sur-ensemble strict de même valeur de bond. En effet, bond(ABCD) = 0, bond(ACDE) = 0, et par conséquent bond(ABCDE) = 0.
Définition 19
(Motifs minimaux corrélés) L’ensemble des motifs minimaux corrélés est défini par : = : bond() = bond(, ou d’une maniére équivalente : = : ) = .
Exemple 13
Soit la base illustrée par la table 1.1 pour minbond = 0,2. Le motif AB est corrélé puisque bond(AB) = = 0,4 0,2. Il est aussi minimal puisque bond(A) = bond(B) = 1.
Nous introduisons dans ce qui suit une propriété intéressante de l’idéal d’ordre des motifs minimaux corrélés.
Propriété 1
L’ensemble des motifs minimaux corrélés forme un idéal d’ordre.
Toutefois, l’ensemble des motifs minimaux corrélés contient les motifs vérifiant la contrainte anti-monotone “étre minimal dans sa classe d’équivalence et étre corrélé” [Ben Younes et al., 2010a]. En effet, cette derniére résulte de la conjonction de deux contraintes anti-monotones, à savoir “étre un motif minimal” et “étre un motif corrélé”. Par conséquent, la contrainte “étre un motif minimal corrélé” est anti-monotone et l’ensemble des motifs minimaux corrélés forme ainsi un idéal d’ordre dans le treillis des motifs.
Nous avons à ce stade présenté les motifs fermés et minimaux corrélés associés à une classe d’équivalence induite par . Nous introduisons dans la proposition suivante les propriétés communes à deux motifs appartenant à une même classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture .
Proposition 2
Soit une classe d’équivalence associée à l’opérateur de fermeture et et . Nous avons : a) ) = ), b) bond() = bond(), c) Supp() = Supp(), d) Supp() = Supp(), et, e) Supp() = Supp().
Preuve.
- a)
-
Gréce à la définition 17, et ont la même fermeture par . Soit cette fermeture.
- b)
-
Comme l’opérateur de fermeture préserve la valeur de la mesure bond d’un motif (cf. Définition 16), et puisque et ont la même fermeture , nous avons bond() = bond(), et bond() = bond(). Ainsi, bond() = bond().
- c), d), et e)
-
Comme et bond() = bond(), d’aprés la proposition 1, et admettent les mêmes supports conjonctif, disjonctif, et négatif. Il en est de même pour et . Ainsi, et ont les mêmes supports conjonctif, disjonctif, et négatif.
Exemple 14
Soit la base illustrée par la table 1.1 et minbond = 0,2. Considérons la classe d’équivalence dont le motif fermé corrélé est ABCE. Les motifs minimaux corrélés associés sont AB et AE. Les motifs corrélés, qui ne sont ni des fermés ni des minimaux, sont ABE, ABC, et ACE. Chacun de ces derniers est compris entre un motif minimal et le fermé corrélé. Les motifs de cette classe d’équivalence, partagent la même valeur de la mesure bond égale à , le même support conjonctif égal à 2, le même support disjonctif égal à 5 et le même support négatif égal à 0.
Ainsi, tous les motifs d’une classe d’équivalence induite par apparaissent dans les mêmes transactions (gréce à l’égalité du support conjonctif). En plus, les items associés aux motifs de la classe caractérisent les mêmes transactions. En effet, chacune de ces derniéres contient nécessairement un sous-ensemble non vide de chaque motif de la classe (gréce à l’égalité du support disjonctif). Cet opérateur de fermeture lie ainsi l’espace de recherche conjonctif et celui disjonctif [Ben Younes et al., 2010a]. Le motif fermé de la classe offre ainsi l’expression la plus spécifique caractérisant ces transactions, tandis qu’un des motifs minimaux représente une des expression les plus générales. Nous avons ainsi cerné les propriétés des motifs rares et des motifs corrélés ainsi que les différentes caractéristiques de l’opérateur de fermeture associé à la mesure bond. Dans ce qui suit, nous décrivons briévement la notion de représentations concises d’un ensemble donné de motifs.
1.6 Représentations concises d’un ensemble de motifs
En effet, l’extraction des motifs intéressants peut étre coéteuse en espace mémoire et en temps de calcul à cause du nombre important des candidats générés. À cet égard, l’idée consiste à extraire des ensembles de taille plus réduite mais capables de régénérer l’ensemble total de motifs, ces ensembles sont dits “Représentations concises”. Dans le cas oé la régénération s’effectue sans perte d’information alors la représentation concise est dite exacte, sinon elle est dite approximative. Ces représentations sont formellement définies dans ce qui suit.
Définition 20
Représentations concises [Mannila et Toivonen, 1997]
Une représentation concise de l’ensemble des itemsets intéressants est un ensemble représentatif de l’ensemble total permettant de le caractériser d’une maniére exacte ou approximative. D’une maniére générale, une représentation constitue une couverture parfaite d’un ensemble si et seulement si sa taille ne dépasse jamais la taille de l’ensemble à représenter.
Exemple 15
Soit une représentation concise d’un ensemble de motifs fréquents. est dite représentation concise exacte, si à partir de , nous sommes capables de déterminer pour un motif quelconque s’il est fréquent ou non et de retrouver son support exact s’il est fréquent. Par exemple, les motifs fermés fréquents [Pasquier et al., 2005] constituent une représentation concise exacte de l’ensemble des motifs fréquents.
Cependant, la représentation est dite représentation concise approximative, si elle est incapable de déterminer d’une maniére exacte le support de tous les motifs de l’ensemble à représenter. Elle retourne alors une valeur approximative de ce dernier. Par exemple, les motifs fréquents maximaux [Roberto et Bayardo, 1998] constituent une représentation concise approximative de l’ensemble des motifs fréquents. En effet, les motifs fréquents maximaux permettent de déterminer la nature de fréquence (fréquent ou rare) d’un motif quelconque mais ne peuvent pas dériver exactement son support.
Toutefois nous nous intéressons, dans ce mémoire, à l’extraction des représentations concises des motifs corrélés rares. Ces derniers vérifient à la fois la contrainte monotone de rareté et anti-monotone de corrélation. Par souci de précision, nous signalons que la terminologie “motifs corrélés rares” est équivalente à la terminologie “motifs rares corrélés”.
1.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons cerné l’ensemble des notions de bases relatives à l’extraction des motifs. Ensuite, nous avons étudié les propriétés des motifs rares et des motifs corrélés selon la mesure bond. Nous avons, de plus, détaillé les caractéristiques des classes d’équivalence induites par l’opérateur de fermeture associé à la mesure de corrélation bond. Cet opérateur constitue un élément important qui va nous servir dans l’extraction des représentations concises des motifs corrélés rares par rapport à la mesure bond. Le chapitre suivant est dédié à la présentation de l’état de l’art des approches traitant de l’extraction des motifs sous contraintes.
Chapitre 2 État de l’art de la fouille des motifs sous contraintes
2.1 Introduction
Le processus d’extraction de motifs intéressants souffre souvent de la taille élevée de ces motifs extraits. À cet égard, il s’est avéré nécessaire d’intégrer des contraintes dans le processus d’extraction afin de réduire le nombre de motifs extraits. Ces contraintes sont traduites par des traitements qui peuvent étre effectués avant, en cours, ou aprés l’étape de fouille.
Étant donné que dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons aux motifs corrélés rares, alors nous jugeons intéressant de consacrer ce chapitre à la présentation et l’étude des approches de l’état de l’art s’inscrivant dans le cadre de notre problématique. Il est important de noter que, dans cette étude, nous nous intéressons principalement aux contraintes monotones et aux contraintes anti-monotones. En effet, les motifs corrélés rares que nous étudions dans ce travail correspondent à la conjonction entre la contrainte anti-monotone de corrélation et monotone de rareté.
Dans ce chapitre, nous abordons ainsi dans la premiére section la présentation des approches d’extraction des motifs rares. Dans la deuxiéme section, nous effectuons un survol des différentes mesures de corrélation et nous étudions les approches d’extraction des motifs corrélés sous contraintes. La troisiéme section sera consacrée à l’étude des algorithmes d’extraction de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés.
2.2 État de l’art de la fouille des motifs rares
2.2.1 Extraction des motifs rares
Toutefois, l’ensemble des motifs rares forme un filtre d’ordre dans le treillis des motifs [Szathmary et al., 2010] et induit une contrainte monotone. En effet, tous les sur-ensembles d’un motif rare sont rares. Cette propriété de monotonie rends l’extraction des motifs rares plus difficile que l’extraction d’un ensemble vérifiant une contrainte anti-monotone. À cet égard, différents algorithmes [Szathmary et al., 2007, Haglin et Manning, 2007, Adda et al., 2007, Kiran et Reddy, 2010, Szathmary et al., 2010, Okubo et Haraguchi, 2010] ont été dédié à l’extraction d’un sous ensemble ou de l’ensemble total de tous les motifs rares ont été proposés.
Nous citons par exemple, les approches MSApriori [Liu et al., 1999] et RSAA [Yun et al., 2003]. Toutefois, l’idée de l’approche MSApriori 111MSApriori est l’acronyme de Multiple Support Apriori. consiste à définir un seuil minimal de support conjonctif minsupp pour chaque item par l’utilisateur et à extraire l’ensemble des motifs fréquents par rapport aux seuils minimaux posés. À cet égard, une partie de l’ensemble des motifs rares sera récupérée pour des seuils bas de minsupp.
Exemple 16
Considérons la base de transaction donnée par la table 1.1. Dans le cas oé nous considérons, minsupp(A) = , minsupp(C) = et minsupp(D) = . Le support de l’itemset AD est égal à , Supp(AD) = . Ainsi, l’itemset AD est rare puisque Supp(AD) minsupp(A), minsupp(D) = , = . Le motif AC est cependant fréquent, Supp(AC) = minsupp(A), minsupp(C) = , = .
Cette approche opére à la Apriori et les itemsets rares ne seront ainsi identifiés que pour des seuils de minsupp trés bas. Dans ce cas, le nombre de régles d’association générées sera énorme. De plus, un probléme lié au choix du seuil minsupp adéquat pour chaque item et aux coéts d’évaluation d’un candidat par rapport aux différents seuils, est toujours posé.
Dans le but de pallier cet inconvénient, Yun et al. ont proposé dans [Yun et al., 2003] une nouvelle approche intitulée RSAA 222RSAA est l’acronyme de Relative Support Apriori Algorithm.. Cette approche permet de générer des régles d’association englobant des itemsets rares. La technique proposée est basée sur la notion de support relatif et permet de générer des régles d’association dont le support relatif dépasse un seuil minimal donné. Le support relatif RSupp d’un itemset I de la forme (, , , ) est noté RSupp(I) et correspond é,
RSupp(, , , ) = ( , , , ).
Exemple 17
Considérons la base de transaction donnée par la table 1.1. RSupp(ACE) = (, , ) = ( , , ) = . Nous avons RSupp(ACE) = , ainsi pour un seuil minimal de support relatif minsuppR = , le motif ACE est fréquent. Cependant, pour un seuil minsuppR = , le motif ACE est considéré comme rare.
L’algorithme RSAA permet de repérer une partie des motifs rares tout en résolvant le probléme lié à la définition de plusieurs seuils minimaux posé par l’approche MSApriori. Cependant, pour des seuils minimaux de supports relatifs trés bas le nombre d’itemsets générés risque d’exploser et d’engendrer ainsi des coéts énormes d’extraction.
L’approche Apriori-Inverse [Koh et Rountree, 2005] s’inscrit aussi dans ce même cadre. En effet, Apriori-Inverse est un algorithme opérant en largeur et permet moyennant un parcours du treillis du bas vers le haut d’extraire pour chaque niveau les motifs rares de taille dont tous les sous-ensembles sont rares. Ces motifs sont dits “motifs parfaitement rares”. Toutefois, l’ensemble extrait n’englobe pas tous les motifs rares puisqu’il élimine les motifs rares minimaux, c.-é.-d. les motifs rares dont tous les sous-ensembles sont fréquents.
Exemple 18
Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. Pour un seuil minsupp = 4. L’algorithme Apriori-Inverse permet d’extraire uniquement les itemsets rares dont le support est à la fois non nul et inférieur à minsupp et dont tous les sous-ensembles sont rares. Par conséquent, seuls les itemsets rares D, A et AD seront extraits.
D’autres approches traitant la problématique des motifs rares ont été aussi proposé. Nous citons par exemple, les approches Apriori-Rare et Mrg-Exp [Szathmary et al., 2006, Szathmary et al., 2007] permettant aussi le repérage d’un sous-ensemble des motifs rares composé uniquement des motifs rares minimaux (cf. Définition 11 page 11), formant la bordure séparatrice entre les motifs fréquents et les motifs rares. Ces approches effectuent l’exploration du treillis des itemsets du bas vers le haut, en commenéant par l’ensemble vide jusqu’é la localisation de la bordure des motifs rares minimaux.
Les approches Apriori-Rare et Mrg-Exp se reposent sur le même principe cependant l’approche Mrg-Exp se différe de l’approche Apriori-Rare par l’intégration d’un critére d’élagage davantage. Ce critére consiste à éliminer les motifs rares minimaux aprés leur identification de l’ensemble des motifs candidats afin de ne générer des candidats qu’é partir des motifs fréquents.
Considérons, par exemple, le contexte d’extraction donné par la table 1.1 pour minsupp = 3. L’ensemble des motifs récupérés par les algorithmes Apriori-Rare et Mrg-Exp correspond é, = D, AB, AE.
Une fois cet ensemble est identifié, l’ensemble de tous les motifs rares est alors extrait, moyennant l’approche Arima et ce en générant par tailles croissantes les sur-ensembles des motifs appartenant à la bordure composée par les motifs rares minimaux.
Exemple 19
Par exemple, considérons l’ensemble = D, AB, AE précédemment identifié. L’ensemble de tous les motifs rares correspond é, = D, AD, CD, ABC, ABE, ACE, les motifs rares de support nul, à savoir BD, DE, ABD, BCD, BDE, ADE et CDE, ne feront pas parti du résultat final.
Nous notons que dans [Romero et al., 2010], les approches Apriori-Inverse et Apriori-Rare ont été appliquées sur des données concernant des étudiants dans un site d’apprentissage en ligne. Les régles d’association générées permettent de nous renseigner quant au lien entre les activités en ligne de l’étudiant (navigation sur le site, consultation des forums, durée de navigation) et la mention obtenue (Excellent, Bien, Moyen). Les régles d’association rares permettent de détecter les comportements infréquents des étudiants et leurs relation avec la mention finale.
L’approche Afirm proposée dans [Adda et al., 2007] s’inscrit aussi dans ce même cadre. Cependant, elle différe des approches proposées par Szathmary et al. dans la nature du parcours de l’espace de recherche. En effet, l’approche Afirm suggére un parcours du haut vers le bas du treillis c.-é.-d du plus grand motif, par rapport à la relation d’inclusion ensembliste, jusqu’é la localisation des motifs rares minimaux.
Exemple 20
Considérons le contexte d’extraction de la table 1.1 pour minsupp = 3. L’algorithme Afirm extrait les motifs rares comme suit. Initialement, les plus grands motifs rares seront extraits, 4 = ABCE, ABCD, BCDE, ABDE. Ensuite, leurs sous-ensembles rares seront générés et nous aurons, 3 = ABE, ABD, BCD, CDE, BDE, ADE,ACD. Les motifs de support nul ne sont pas considérés, donc nous aurons, 4 = ABCE, 3 = ABE, ACD. 2 = AB, AE, CD, AD et 1 = D.
L’approche Minit 333Minit est l’acronyme de Minimal Infrequent Itemset. [Haglin et Manning, 2007], a été aussi proposée et permet de récupérer aussi les motifs rares minimaux dont la taille ne dépasse pas un certain seuil de cardinalité maximale S. L’idée de l’algorithme Minit se déroule de la maniére suivante. D’abord, les items sont triés selon l’ordre croissant du support. Ensuite, nous commenéons par traiter l’item ayant le plus petit support en lui associant son sous-contexte et en identifiant la liste des items triés appartenant à ce sous-contexte et un appel récursif de l’algorithme Minit sera réalisé et le seuil sera décrémenté. Cette procédure se termine lorsque le seuil devient égal à 1.
Exemple 21
Considérons le contexte donné par la table 1.1. Pour minsupp = et S = , le déroulement de l’algorithme Minit est donné par la figure 2.1. Les motifs rares minimaux de cardinalité inférieur à seront ainsi extraits. Initialement, l’item D ne sera pas considéré puisqu’il ne donne pas naissance à un motif rare minimal de taille . Ensuite, nous considérons l’item A et le contexte associé Base D(A) sera crée et la variable S sera décrémentée S = 2. Les items retenus sont B et E, l’item C ne sera pas retenu puisqu’il appartient à toutes les transactions du contexte Base D(A). Les motifs rares minimaux ainsi identifiés sont AE et AB de support chacun. Par la suite, la variable S sera décrémentée, S = , alors l’algorithme identifie le seul item rare D de support . Les motifs rares minimaux ainsi récupérés correspondent é, = (AE, 2), (AB, 2), (D, 1).
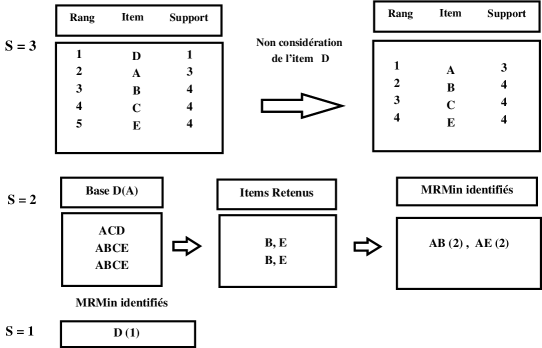
Nous avons ainsi passé en revue les approches les plus représentatives traitant la problématique d’extraction d’un sous-ensemble ou de l’ensemble total des motifs rares. Toutefois, la fouille des motifs rares souffre d’un deuxiéme probléme lié au nombre des motifs rares qui risque d’étre trés élevé. L’explosion du nombre des motifs rares empéche certainement une exploitation efficace des connaissances cachées dans ces motifs. Pour pallier cet inconvénient, deux représentations concises exactes des motifs rares ont été défini dans [Hamrouni et al., 2011] et sont basées sur la notion de classe d’équivalence. La premiére représentation concise exacte est composée des éléments minimaux des classes d’équivalences à savoir les générateurs minimaux rares et est extraite gréce à l’algorithme GMRare. La deuxiéme représentation est composée des éléments maximaux des classes d’équivalences à savoir les motifs fermés rares et est extraite moyennant l’algorithme MFRare.
2.2.2 Discussion
Nous récapitulons dans le tableau 2.1 les caractéristiques des différentes approches étudiées. Cette comparaison couvre les axes suivants :
-
1.
Motifs extraits : Cette propriété décrit les motifs générés par l’algorithme.
-
2.
Caractéristiques : Cette propriété décrit les caractéristiques de l’approche en question.
| Algorithme | Motifs | Caractéristiques |
|---|---|---|
| d’extraction | extraits | |
| MSApriori | Uniquement une | Approches non dédiées |
| [Liu et al., 1999] | partie des motifs rares | é la fouille des motifs rares |
| RSAA | est extraite pour | Seule une partie de ces |
| [Yun et al., 2003] | un minsupp faible | derniers est récupérée |
| Définition compliquée | ||
| de la formule du support relatif | ||
| Apriori-Inverse | Motifs parfaitement | Coéts d’extraction élevés |
| [Koh et Rountree, 2005] | rares | cependant seuls les motifs |
| parfaitement rares seront extraits. | ||
| Apriori-Rare | Motifs | Parcours coéteux de |
| [Szathmary et al., 2006] | rares minimaux | l’ensemble de tous les motifs fréquents |
| Mrg-Exp | La nécessité d’un deuxiéme algorithme | |
| [Szathmary et al., 2007] | pour la récupération de tous les motifs rares | |
| Arima | Motifs rares | Dans le cas oé le |
| [Szathmary et al., 2006] | le nombre de motifs rares | |
| est réduit, ces derniers | ||
| sont localisés dans le plus haut | ||
| du treillis ainsi le parcours | ||
| du bas vers le haut proposé | ||
| n’est pas efficace. | ||
| Afirm | Motifs rares | Nécessité de machines |
| [Adda et al., 2007] | de hautes capacités afin de | |
| pouvoir exécuter l’algorithme | ||
| Minit(S) | Motifs rares | Extraction d’une partie |
| [Haglin et Manning, 2007] | minimaux de taille | des motifs rares minimaux et |
| inférieur a S | non la totalité | |
| MFRare | Motifs fermés | Les représentations concises proposées |
| [Hamrouni et al., 2011] | et motifs rares | sont sans perte d’information. |
| GMRare | Générateurs minimaux. | |
| [Hamrouni et al., 2011] | rares |
D’aprés l’étude des approches de l’état de l’art que nous venons de présenter, nous concluons qu’il n’existe pas dans la littérature un algorithme efficace d’extraction de l’ensemble de tous les motifs rares pour tous les types des contextes ou même pour un type particulier de contextes. Ceci est dé à la difficulté de localiser la bordure séparant les motifs rares de ceux fréquents dans le treillis. En effet, cette bordure est dépendante du contexte et du seuil minimal du support minsupp. La problématique liée à l’explosion du nombre de motifs rares a été aussi abordée dans la littérature. En effet, deux représentations concises exactes des motifs rares ont été proposées dans [Hamrouni et al., 2011]. Ces derniéres autorisent une réduction sans perte d’information de l’ensemble total des motifs rares, et constituent ainsi une alternative au probléme de nombre élevé des motifs rares.
Toutefois, un autre probléme lié à l’absence de corrélation entre les motifs rares retenus, est toujours posé. Par exemple, le motif composé par les items “” et “” est un motif rare cependant aucune corrélation n’existe entre le produit “” trés fréquemment acheté et le produit “” cher et rarement acheté. En effet, l’information extraite à partir des motifs rares est souvent appelée à présenter une valeur ajoutée aux experts dans plusieurs domaines. Nous citons comme exemple, la détection des pannes dans les réseaux informatiques [Ma et Hellerstein, 2001], la découverte des irrégularités dans les actions boursiéres, la détection de fraudes dans les systémes financiers [Cohen et al., 2000], la détection d’intrusions dans les systémes informatiques.
Ainsi, il est intéressant d’intégrer les mesures de corrélation dans l’extraction des motifs rares. Ceci permet, d’une part, d’améliorer la qualité des motifs extraits en ayant un ensemble plus réduit contenant des motifs intéressants qui sont rares mais fortement corrélés. D’autre part, ceci renforce la qualité des régles d’association dérivées à partir de ces motifs corrélés rares. Par exemple, le motif composé par les items “Collier en or” et “Boucles d’oreilles” ou aussi l’exemple de “Télévision” et “Lecteur DVD” correspondent à des motifs corrélés rares. Ces derniers présentent des articles chers dont la vente est bénéfique pour les commeréants.
Nous constatons, ainsi, que la fouille des motifs corrélés rares est une piste trés intéressante à exploiter. De plus, cette problématique n’a pas été abordée auparavant dans la littérature. Par conséquent, nous proposons dans ce mémoire d’étudier profondément les caractéristiques des motifs corrélés rares selon la mesure de corrélation bond et de proposer de nouvelles représentations concises exactes de ces motifs.
Comme nous avons passé en revue les différentes approches de fouille des motifs rares dans cette section. Nous nous focalisons alors, dans la section suivante, sur la présentation des approches de fouille des motifs corrélés.
2.3 État de l’art de la fouille des motifs corrélés
Dans cette section, nous étudions les différentes approches d’extraction des motifs corrélés. Nous commenéons d’abord par un survol non exhaustif des différentes mesures de corrélations et de leurs propriétés. Nous nous sommes principalement basés sur l’étude des mesures de corrélations présentée dans [Ben Younes et Hamrouni, 2010].
2.3.1 Mesures de corrélation
L’intégration des mesures de corrélations dans le processus d’extraction de motifs permet
de réduire le nombre de motifs extraits tout en améliorant leur qualité.
En effet, seuls les motifs véhiculant le maximum d’informations concernant la corrélation entre les items les composant seront maintenus. À cet égard, différentes mesures de corrélation ont été proposé dans la littérature.
La mesure de corrélation any-confidence [Omiecinski, 2003]
Cette mesure est définie, pour tout motif non vide comme suit :
any-conf() =
La mesure any-confidence ne conserve pas les propriétés intéressantes d’anti-monotonie et de cross-support [Ben Younes et Hamrouni, 2010].
Exemple 22
Considérons la base des transactions illustrée par la table 1.1. Pour un seuil minimal de any-confidence de 0,80. La valeur de la mesure any-confidence du motif AB est égal é, any-confidence(AB) = = = 0,66. Le motif AB ne satisfait le seuil de any-confidence, par conséquent il n’est pas un motif corrélé alors que le motif AD est corrélé et sa valeur de la mesure any-confidence est égale à 1. Nous avons aussi, = 0,75 0,80, cependant, any-confidence(AD) 1 0,80. Cet exemple illustre la non conservation des propriétés d’anti-monotonie et de cross-support.
La mesure de corrélation all-confidence [Omiecinski, 2003]
La mesure all-confidence est définie pour tout motif non vide comme suit :
all-conf() =
La mesure all-confidence conserve la propriété d’anti-monotonie [Omiecinski, 2003] ainsi que la propriété de cross-support [Xiong et al., 2006].
Exemple 23
Considérons la base des transactions illustrée par la table 1.1. Pour un seuil minimal de all-confidence de 0,40. La valeur de la mesure all-confidence du motif ABCE est égal é, all-confidence(ABCE) = = = 0,50. Le motif ABCE est corrélé selon la mesure all-confidence. Tous ses sous-ensembles directs sont aussi des motifs corrélés. Nous avons all-confidence(ABE) = all-confidence(ACE) = = 0,50, all-confidence(BCE) = = 0,75.
Pour le motif AD, nous avons = 0,33 0,40 et nous avons all-confidence(AD) = = 0,33. Le motif AD ne vérifie pas la propriété de cross-support et il n’est ainsi pas corrélé. Cet exemple illustre la conservation des propriétés d’anti-monotonie et de cross-support.
La mesure de corrélation hyper-confidence [Xiong et al., 2006]
La mesure hyper-confidence notée h-conf d’un motif , , …, est définie comme suit :
h-conf() = min Conf(), …, Conf().
Avec Conf fait référence à la mesure confiance associée aux régles d’association 444Soit une régle d’association : , avec , : Conf() = ..
La mesure hyper-confidence est équivalente à la mesure all-confidence et vérifie ainsi les propriétés de d’anti-monotonie et de cross-support.
Le coefficient de corrélation [Brin et al., 1997]
Le coefficient d’un motif , avec et , est défini comme suit 555 = désigne le support relatif de . :
()
Exemple 24
Tout motif corrélé selon la mesure , tous ses sur-ensembles sont aussi corrélés. Le calcul de la valeur de pour un motif donné nécessite la construction de la table de contingence associée. Considérons par exemple, le motif AC, la table de contingence qui lui est associée est donnée par la table 2.2. Par et , nous entendons respectivement la somme de la ligne et la somme de la colonne.
Nous avons (AC) . = + + + = 2,325
| 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 5 |
D’autres mesures de corrélation existent aussi, comme par exemple la mesure bond [Ben Younes et al., 2010a] que nous avons décrit dans le premier chapitre, la mesure cosine [Huynh et al., 2005], la mesure lift [Brin et al., 1997], le coefficient de corrélation , appelé aussi coefficient de corrélation de Pearson [Xiong et al., 2004].
Nous avons ainsi présenté quelques mesures de corrélation existantes dans la littérature. Nous enchaénons, dans ce qui suit, avec quelques approches d’extraction des motifs corrélés.
2.3.2 Extraction des motifs corrélés
Trés peu d’approches de la littérature ont abordé la problématique de la fouille des motifs rares corrélés. Toutefois, une premiére idée naéve de récupération des motifs corrélés rares, consiste à extraire l’ensemble de tous les motifs corrélés sans aucune intégration de la contrainte de minsupp. Cet ensemble englobe bien évidemment tous les motifs corrélés, ceux qui sont rares et ceux qui sont fréquents.
L’approche proposée dans [Cohen et al., 2000] est fondée sur ce principe. Cette approche permet d’extraire les paires d’items corrélés selon la mesure de corrélation Similarity. En effet, la mesure Similarity permet de mesurer la similarité entre deux items et correspond au rapport entre le nombre d’apparitions simultanée des deux items et le nombre de leurs apparitions complémentaires. Par conséquent, la mesure Similarity est équivalente à la mesure de corrélation bond. Cependant aucune analyse des propriétés de cette mesure n’a été menée. Toutefois, l’approche proposée permet d’extraire les paires d’items corrélés sans calculer leurs supports. En effet, elle affecte à chaque item une signature composée par la liste des identificateurs des transactions auxquelles il appartient. Ensuite, la valeur de la similarité de chaque paire d’items, correspond au nombre d’intersections de leurs signatures divisé par leur union. Nous notons que, la contrainte de support minimum n’a pas été intégrée et ceci afin d’avoir les itemsets qui sont fortement corrélés et ayant un faible support. À partir de ces derniers, les régles d’association de confiances élevées et de supports faibles seront générées. Ces régles englobent des pépites de connaissances qui trés intéressantes dans plusieurs domaines. Par exemple, l’algorithme proposé a été appliqué sur des articles de presse afin d’extraire les paires de mots apparaissant ensemble et permettant de fournir des informations pertinentes quant au contenu de l’article en question.
Dans ce même cadre, nous citons aussi l’algorithme DiscoverMPatterns proposé dans [Ma et Hellerstein, 2001]. En effet, cet algorithme permet d’extraire tous les motifs corrélés selon la mesure all-confidence. Ces motifs vérifient la propriété d’anti-monotonie. En effet, une premiére version de l’approche proposée permet d’extraire tous les motifs corrélés sans restriction de la valeur du support conjonctif afin de récupérer les motifs rares fortement corrélés. Ensuite, dans une deuxiéme version de l’approche, la contrainte anti-monotone de support minimum a été intégrée dans la fouille des motifs corrélés. Par conséquent, l’ensemble de tous les motifs fréquents corrélés résultant de la jointure entre les deux contraintes anti-monotones de fréquence et de corrélation est récupéré.
Une autre idée de récupération d’une partie des motifs corrélés rares consiste é extraire l’ensemble de tous les motifs fréquents pour un seuil de minsupp trés bas. Cet ensemble englobe une partie des motifs corrélés qui sont trés peu fréquents.
Xiong et al. se sont basés sur ce principe et ont introduit l’algorithme HypercliqueMiner dans [Xiong et al., 2006]. Ce dernier permet d’extraire d’une maniére efficace l’ensemble des motifs fréquents corrélés pour des valeurs faibles du seuil minimal minsupp. Par conséquent, une partie de l’ensemble des motifs corrélés rares sera récupérée parmi les motifs extraits.
En effet, les performances considérables de cet algorithme sont justifiés par les propriétés d’anti-monotonie et de cross-support vérifiées par la mesure de corrélation hyper-confidence. Toutefois, ces deux propriétés permettent d’élaguer significativement les candidats et de réduire les coéts inutiles d’évaluation de la contrainte de corrélation.
Dans ce même cadre, se situe aussi l’approche proposée dans [Sandler et Thomo, 2010]. Cette approche permet d’extraire des itemsets fréquents et fortement corrélés de taille deux. C’est une approche naéve dont l’idée consiste à extraire d’abord tous les motifs fréquents de taille deux pour un minsupp trés faible gréce à une solution paralléle. Ensuite, un post traitement a été effectué afin de ne garder que les itemsets présentant une forte corrélation entre les deux items les composants. En effet, le post traitement permet de ne maintenir que les itemsets pour lesquelles la probabilité conditionnelle d’apparition d’un de ses items en fonction de l’autre dépasse un seuil minimal défini. Cette probabilité correspond, en effet, à la mesure all-confidence. Nous citons aussi l’algorithme FT-Miner [Hu et Li, 2009] d’extraction des motifs fréquents corrélés par rapport à une mesure de corrélation, nommée N-confidence, équivalente à la mesure all-confidence. Cet algorithme permet d’extraire ces motifs pour des seuils de minsupp trés bas et effectue l’extraction des régles associatives à partir de ces motifs.
L’algorithme Partition [Omiecinski, 2003] a été aussi introduit afin d’extraire les motifs qui satisfont soit le seuil minimal de all-confidence soit le seuil minimal de bond et ce en fonction de l’exigence de l’utilisateur. Cet algorithme, dont le principal atout est d’allier deux mesures, permet d’extraire tous les motifs corrélés indépendamment de leur statut de fréquence.
D’autres travaux de la littérature se sont intéressés à la fouille des motifs corrélés qui respectent la contrainte de fréquence. À cet égard, nous citons l’algorithme CoMine [Lee et al., 2003]. Cet algorithme permet de récupérer l’ensemble des motifs corrélés fréquents. Deux versions de l’algorithme CoMine sont à distinguer. La premiére version considére la mesure de corrélation all-confidence alors que la deuxiéme version traite la mesure bond. Dans ce même cadre, nous citons aussi l’algorithme récent Jim [Segond et Borgelt, 2011]. Jim permet d’extraire selon le choix de l’utilisateur, les motifs fréquents corrélés, les motifs fréquents corrélés maximaux et les motifs fermés fréquents corrélés. Les auteurs proposent la mesure de corrélation bond et onze autre mesures de corrélations qui sont toutes anti-monotones et l’extraction des motifs se fait selon la mesure de corrélation choisit par l’utilisateur.
La mesure de corrélation bond a été aussi utilisée dans les travaux proposés dans [Okubo et al., 2010]. En effet, les auteurs dans [Okubo et al., 2010] recourent à la mesure de corrélation bond et à la notion de la fermeture conjonctive afin d’introduire un algorithme en profondeur permettant de récupérer les motifs fermés conjonctifs rares. Toutefois, les auteurs se sont basés sur le fait qu’un motif faiblement corrélé par rapport à la mesure bond est généralement rare dans la base d’extraction. À cet égard, la contrainte de la rareté est exprimée en fonction de la mesure bond comme suit, bond() , avec un seuil de corrélation maximal fixé par l’utilisateur. Cette contrainte de corrélation maximale est monotone puisqu’elle correspond à l’opposée de la contrainte anti-monotone de corrélation.
Dans le but d’atténuer l’explosion du nombre de motifs rares extraits et afin de se débarrasser des motifs qui sont trés rares dans la base c.-é.-d. les motifs qui représentent juste des exceptions et ne sont pas informatifs, les auteurs ont posé une restriction quant à la rareté des motifs extraits. Cette restriction est traduite pour tout motif par une fonction reliant son support conjonctif et le support minimal de ses items, Freq() = Supp() + Supp(), avec et sont deux coefficients fixés par l’utilisateur. L’idée consiste à extraire les premiers motifs respectant la contrainte de corrélation et maximisant la contrainte de fréquence posées. Ces motifs correspondent aux motifs rares les plus informatifs dans la base.
Nous avons ainsi passé en revue différents algorithmes d’extraction de motifs corrélés. Néanmoins, les ensembles des motifs corrélés extraits risque d’étre de taille élevée. Ce qui constitue un obstacle pour une bonne exploitation des connaissances offertes par ces motifs. À cet égard, l’idée de concevoir des approches réductrices de l’ensemble des motifs corrélés est d’une grande pertinence. Dans ce sens, nous discutons dans ce qui suit les algorithmes proposés en vue d’extraire des représentations concises des motifs corrélés fréquents.
2.3.3 Extraction des représentations concises des motifs corrélés fréquents
Rares sont les travaux de la littérature traitant la problématique d’extraction des représentations concises des motifs corrélés. Nous citons dans ce cadre uniquement deux approches. Premiérement, l’algorithme CCMine [Kim et al., 2004] qui permet ainsi d’extraire une représentation concise exacte des motifs corrélés fréquents associés à la mesure all-confidence. La représentation concise extraite est basée sur les motifs fermés corrélés fréquents. Le deuxiéme algorithme CCPR_Miner a été proposé dans [Ben Younes et al., 2010a]. Cet algorithme permet d’extraire une nouvelle représentation concise exacte des motifs fréquents corrélés associée à la mesure bond. Cette représentation est composée des motifs fermés corrélés fréquents munis de leurs supports conjonctifs et disjonctifs. Elle permet de dériver, pour tout motif corrélé fréquent, exactement le support conjonctif, le support disjonctif et par conséquent la valeur de la mesure bond égale au rapport des deux supports conjonctifs et disjonctifs.
Dans ce qui suit nous étudions les algorithmes traitant de la fouille de motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés.
2.3.4 Extraction des motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés
Dans [Brin et al., 1997] les auteurs ont étudié les caractéristiques des motifs contenants des items qui sont fortement dépendants selon la mesure . Afin de réduire l’explosion du nombre de candidats, les auteurs proposent d’intégrer la contrainte de fréquence dans la fouille de ces motifs corrélés. Étant donné que la mesure est monotone, l’ensemble des motifs fréquents corrélés extraits résulte ainsi de la jointure de deux contraintes de types opposés à savoir la contrainte monotone de corrélation selon la mesure et la contrainte anti-monotone de fréquence. Cependant, la problématique d’extraction de l’ensemble total des motifs satisfaisant les deux contraintes de types différents n’a pas été traitée. En effet, les auteurs se sont limités à l’extraction des motifs minimaux corrélés fréquents uniquement. Pour ce faire, un algorithme par niveau effectuant un parcours du bas vers le haut, jusqu’é la localisation de ces motifs minimaux, a été mis en place.
Cet algorithme intitulé
BMS 666BMS est l’acronyme de
Beyond Market Baskets.,
a constitué la base de l’approche proposée dans [Grahne et al., 2000].
En effet, les auteurs dans [Grahne et al., 2000]
proposent d’étendre l’approche proposée dans [Brin et al., 1997]. Ils étudient la problématique des motifs fréquents corrélés selon la mesure et qui satisfont aussi un ensemble de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones.
Ils définissent deux ensembles particuliers de motifs. Le premier est composé des motifs minimaux corrélés et qui sont valides quant à l’ensemble des contraintes. Quant au deuxiéme, il englobe
les motifs minimaux qui satisfont l’ensemble de contraintes c.-é.-d les motifs minimaux valides et qui sont corrélés.
Afin d’extraire le premier ensemble, deux algorithmes BMS+ et BMS++ ont été proposé.
L’algorithme BMS+ est une approche naéve qui consiste à extraire l’ensemble des motifs minimaux corrélés fréquents moyennant le noyau de l’algorithme proposé dans [Brin et al., 1997] puis à effectuer un post traitement afin de ne garder que les motifs minimaux corrélés et qui satisfont l’ensemble de contraintes posées. Cependant, l’idée de l’algorithme BMS++
consiste à intégrer, dans le processus de fouille, les contraintes de corrélation minimale et de fréquence avec l’ensemble des contraintes posées et à extraire les motifs qui répondent à toutes ces contraintes à la fois.
De plus, les algorithmes BMS* et BMS** ont été introduit afin de récupérer l’ensemble formée par les motifs minimaux satisfaisant l’ensemble de contraintes et qui sont corrélés. Quant à l’algorithme BMS*, il est basée sur l’idée naéve d’extraire l’ensemble de tous les motifs minimaux valides par rapport à l’ensemble de contraintes puis de filtrer les motifs corrélés de cet ensemble. Par opposition à ce dernier, l’algorithme BMS** est basé sur la même idée stratégique de l’algorithme BMS++ qui consiste à intégrer l’ensemble des contraintes dans le processus de fouille.
Nous avons à ce stade, présenté et analysé les différentes approches d’extraction des ensembles des motifs corrélés sous contraintes.
2.3.5 Discussion
L’étude des approches de l’état de l’art que nous avons présenté dans cette section a été menée selon trois principaux axes. Nous avons dans un premier temps analysé les approches d’extraction des motifs corrélés. Nous constatons que la majorité de ces approches opérent sur la base des mesures bond et all-confidence. Ces derniéres vérifient la propriété d’anti-monotonie. Cette propriété est pertinente dans le processus de fouille, vu sa capacité à réduire l’espace de recherche et à optimiser le temps d’extraction ainsi que la consommation des ressources matérielles. Ainsi, l’ensemble des motifs corrélés fréquents extraits résulte de la jointure de deux contraintes de même type, à savoir la contrainte anti-monotone de corrélation et la contrainte anti-monotone de fréquence.
Toutefois, la récupération de l’ensemble des motifs qui sont à la fois trés peu fréquents et fortement corrélés est basée sur l’idée naéve d’extraire l’ensemble de tous les motifs fréquents pour un seuil de minsupp trés bas puis de filtrer ces motifs par la contrainte de corrélation. Cette opération est trés coéteuse en temps de traitement et en consommation de la mémoire à cause de l’explosion du nombre de candidats à évaluer. D’ailleurs, l’approche proposée dans [Sandler et Thomo, 2010] est fondée sur ce principe. Une autre stratégie d’extraction des motifs rares fortement corrélés, consiste é extraire l’ensemble de tous les motifs corrélés sans aucune intégration de la contrainte de support. Cette idée permet de récupérer les motifs rares fortement corrélés comme c’est le cas des algorithmes proposés dans [Ma et Hellerstein, 2001] et dans [Cohen et al., 2000].
Nous déduisons pour toutes ces approches, que la contrainte monotone de rareté n’a été jamais incorporée dans la fouille afin de récupérer l’ensemble des motifs rares fortement corrélés.
Dans un deuxiéme volet de cette analyse, nous avons mis l’accent sur les approches d’extraction des motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de types opposés. Nous avons analysé les algorithmes proposés dans [Brin et al., 1997] et [Grahne et al., 2000]. Ces derniers permettent d’intégrer l’ensemble des contraintes dans le processus de fouille. Ils exploitent ainsi les différentes opportunités d’élagage offertes par l’ensemble des contraintes posées et bénéficient du pouvoir sélectif de chaque type de contrainte. Cependant, ces approches se limitent à l’extraction d’un sous ensemble restreint composé uniquement des motifs minimaux valides c.-é.-d. satisfaisant l’ensemble de contraintes posées. De plus, aucune représentation concise des motifs corrélés retenus n’a été proposée.
D’ailleurs, les uniques représentations concises des motifs corrélés ont été proposées dans [Kim et al., 2004] et dans [Ben Younes et al., 2010a]. Ces derniéres, offrent des approches réductrices sans perte d’information de l’ensemble des motifs fréquents corrélés respectivement selon les mesures all-confidence et bond.
Les tableaux 2.3 et 2.4 récapitulent les caractéristiques des différentes approches étudiées. Cette récapitulation couvrira les axes suivants :
-
1.
Mesures de corrélation : Cette propriété décrit la ou les mesures de corrélation traitée(s) par l’algorithme.
-
2.
Type de motifs extraits : Cette propriété décrit le type de motifs générés par l’algorithme. Par “Valide”, nous entendons que le motif respecte l’ensemble des contraintes posées.
-
3.
Natures des contraintes : Cette propriété décrit les types des contraintes manipulées par l’algorithme.
-
4.
Nature de l’algorithme : Cette propriété décrit la nature de l’algorithme. Nous distinguons les algorithmes approximatifs, algorithmes paralléles et les algorithmes exacts. Pour les algorithmes exacts, nous spécifions aussi la stratégie d’exploration de l’espace de recherche. Autrement dit, la maniére avec laquelle l’espace de recherche sera parcouru par l’algorithme. Ceci peut étre réalisé en profondeur c.-é.-d. en étendant le candidat en cours de traitement par un item qu’il ne contient pas déjé. Ou en largeur (appelé aussi par niveau) et englobe deux type de parcours. Le premier se réalise du bas vers le haut du treillis c.-é.-d. par taille croissante des itemsets en commenéant par l’ensemble vide. Le deuxiéme se réalise du haut vers le bas du treillis c.-é.-d. par taille décroissante en commenéant par le plus grand motif jusqu’a l’ensemble vide.
-
5.
Principe de déroulement : Cette propriété est spécifiée uniquement pour les approches d’extraction de motifs corrélés sous la conjonction de contraintes de natures opposés. La valeur Par post traitement indique qu’un seul type de contraintes a été intégré dans la fouille et l’ensemble de motifs intéressant est obtenu par post traitement selon le deuxiéme type de contraintes. Cependant, la valeur Par intégration de contraintes indique que les contraintes de types opposés ont été intégrées dans la fouille.
| Algorithme | Mesure(s) de | Type de motifs | Nature de(s) | Nature de |
|---|---|---|---|---|
| d’extraction | corrélation | extraits | contrainte(s) | l’algorithme |
| L’approche de | bond | Tous les motifs | anti-monotones | Approximatif |
| [Cohen et al., 2000] | corrélés de taille deux | |||
| DiscoverMPattern | all-confidence | Tous les motifs | anti-monotones | Exact |
| [Ma et Hellerstein, 2001] | corrélés | en largeur | ||
| Partition | all-confidence | Tous les motifs | anti-monotone | Exact |
| [Omiecinski, 2003] | bond | corrélés | en largeur | |
| CoMine() | all-confidence | corrélés fréquents | anti-monotones | Exact |
| [Lee et al., 2003] | en profondeur | |||
| CoMine() | bond | corrélés fréquents | anti-monotones | Exact |
| [Lee et al., 2003] | en profondeur | |||
| HypercliqueMiner | h-confidence | corrélés fréquents | anti-monotones | |
| [Xiong et al., 2006] | et une partie des motifs | Exact | ||
| corrélés rares | en largeur | |||
| L’approche de | all-confidence | corrélés fréquents | ||
| [Sandler et Thomo, 2010] | et une partie des | anti-monotones | Algorithme | |
| motifs corrélés rares | Paralléle | |||
| L’approche de | bond | faiblement corrélés | monotones | Exact |
| [Okubo et al., 2010] | en profondeur | |||
| CCMine | all-confidence | fermés | anti-monotones | Exact |
| [Kim et al., 2004] | corrélés fréquents | en profondeur | ||
| CCPR_Miner | bond | fermés | anti-monotones | Exact |
| [Ben Younes et al., 2010b] | corrélés fréquents | en largeur |
| Algorithme | Mesure(s) de | Type de motifs | Nature de(s) | Stratégie | Principe |
|---|---|---|---|---|---|
| d’extraction | corrélation | extraits | contrainte(s) | d’exploration | de déroulement |
| BMS | minimaux corrélés | monotones | largeur | Par intégration | |
| [Brin et al., 1997] | fréquents | et anti-monotones | de contraintes | ||
| BMS+ | minimaux corrélés | ||||
| valides | monotones | largeur | Par post | ||
| BMS* | minimaux valides | et anti-monotones | traitement | ||
| [Grahne et al., 2000] | corrélés | ||||
| BMS++ | minimaux corrélés | ||||
| valides | monotones | largeur | Par intégration | ||
| BMS** | minimaux valides | et anti-monotones | de contraintes | ||
| [Grahne et al., 2000] | corrélés |
Nous avons ainsi présenté dans cette section les différentes approches de fouille de motifs corrélés sous contraintes de types opposés. Dans la section suivante, nous tenons à présenter un état de l’art des approches de la littérature traitant de la conjonction entre les contraintes monotones et les contraintes anti-monotones.
2.4 État de l’art des approches traitant de la conjonction de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones
Lors de processus de fouille de motifs, il est plus complexe de localiser les motifs vérifiant des contraintes de natures différentes que de localiser ceux associés à des contraintes de même nature. En effet, la nature opposée des contraintes fait que les stratégies d’élagage ne sont applicables que pour une partie des contraintes et pas pour les autres. Ceci augmente les coéts des traitements à effectuer afin de déterminer si un motif donné fait partie de l’ensemble désiré ou non.
Beaucoup de travaux ont été proposés dans la littérature afin de prendre en considération des contraintes de natures différentes lors du processus de fouille de motifs intéressants [Boulicaut et Jeudy, 2010, Pei et Han, 2004]. Toutefois, nous nous limitons dans notre étude aux contraintes monotones et aux contraintes anti-monotones.
Les différentes approches de la littérature traitant de la conjonction de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones peuvent étre classés en cinq grandes catégories en fonction de leurs principe de résolution du probléme de fouille. Nous proposons dans ce qui suit une analyse des différentes catégories d’approches.
2.4.1 L’approche DualMiner
Le premier algorithme se situant dans ce cadre est intitulé DualMiner [Bucila et al., 2003]. DualMiner est une approche générique de résolution du probléme d’extraction de motifs sous la conjonction de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones. Cet algorithme effectue la réduction de l’espace de recherche en incorporant à la fois les contraintes monotones ainsi que les contraintes anti-monotones. En effet, DualMiner extrait des familles de solutions valides par rapport à l’ensemble des contraintes. Chacune de ses familles, est représentée par le couple , avec représente l’élément maximal correspondant à l’union de tous les éléments de cette famille et représente l’élément minimal et correspond é é l’intersection de tous les éléments de cette famille. Considérons un exemple illustratif dans ce qui suit.
Exemple 25
Considérons le contexte donné par la table 1.1. La contrainte anti-monotone correspond à Supp() minsupp et la contrainte monotone correspond é Supp() maxsupp avec minsupp = 2 et maxsupp = 3. Par conséquent, tout motif satisfaisant les contraintes anti-monotone et monotone doit vérifier, 2 Supp() 3. Lors d’un premier parcours de treillis des motifs, l’item D ne vérifie pas la contrainte anti-monotone ainsi il sera supprimé ainsi que tous ses sur-ensembles. Ensuite, l’itemset BE ne vérifie pas la contrainte monotone , ainsi, il sera supprimé ainsi que ses sous-ensembles B et E. L’item C sera plus considéré puisqu’il viole la contrainte monotone. Par conséquent, la seule partie du treillis correspond à la famille dont l’élément minimal est A et l’élément maximal est ABCE. Il est à remarquer que le motif A respecte la contrainte monotone , Supp(A) = 3 3, ainsi, tous ses sur-ensembles le sont aussi. Quant au motif ABCE, il vérifie la contrainte anti-monotone , Supp(ABCE) = 2 2. Par conséquent, la famille de solution délimitée par A et ABCE est une famille de solution valide. Cette exécution est représentée par la figure 2.2.
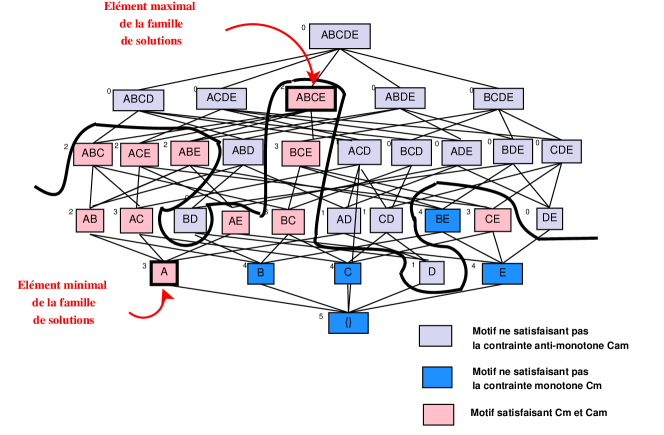
Toutefois, DualMiner souffre aussi d’une limite liée au nombre d’évaluation de contraintes. En effet, le temps d’exécution de l’algorithme DualMiner augmente en fonction de la taille de l’espace d’intersection entre les deux contraintes incorporées. Or, cette taille peut augmenter d’une maniére exponentielle en fonction de la taille du probléme [Boley et Gärtner, 2009] ce qui présente une des limites de cette approche.
2.4.2 Les approches MCP et ACP
La problématique de fouille de motifs sous contraintes de types opposés a été abordée aussi dans les travaux de Boulicaut et Jeudy, qui ont proposé l’approche MCP 777MCP est l’acronyme de Monotone Constraint Pushing. [Boulicaut et Jeudy, 2000]. MCP est une approche permettant l’extraction de motifs satisfaisant à la fois un ensemble de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones. Cependant, MCP est basée sur l’hypothése que les motifs minimaux satisfaisant la contrainte monotone sont facilement récupérables et constituent un paramétre d’entrée de l’approche MCP. Alors que cette hypothése n’est pas toujours valide [Bucila et al., 2003]. Toutefois, l’ensemble des motifs minimaux valides par rapport à la contrainte monotone est difficilement repérable vu la propriété de filtre d’ordre induite par toute contrainte monotone.
Dans ce même sens, Bonchi et al. ont proposé l’approche ACP 888ACP est l’acronyme de Adaptive Constraint Pushing. dans [Bonchi et al., 2003]. En effet, l’approche ACP permet d’intégrer é la fois les contraintes monotones et les contraintes anti-monotones dans un algorithme par niveau. Par opposition à l’approche MCP, l’algorithme ACP permet dans un premier temps d’extraire la bordure positive de la contrainte monotone et ensuite de générer les candidats qui correspondent aux sur-ensembles des motifs de cette bordure. Puisque, les sur-ensembles des motifs de cette bordure vérifient la contrainte monotone, ils seront ainsi évalués uniquement par rapport à la contrainte anti-monotone.
La particularité de l’approche ACP réside dans le fait qu’elle adopte un comportement adaptatif pour renforcer l’élagage selon une contrainte par rapport à une autre afin de maximiser l’efficacité. En effet, l’adaptativité se traduit par l’introduction d’un paramétre , initialisé lors du premier balayage de la base puis il est mis à jour à chaque niveau en fonction de l’ensemble des nouvelles connaissances collectées lors de l’itération précédente. Cependant, aucune indication quant à l’initialisation et la mise à jour du paramétre n’a été présentée.
Exemple 26
Soit minsupp le seuil minimal de support conjonctif, la contrainte monotone correspondant à “Supp(X) minsupp”. Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1 pour minsupp = 3. Les motifs minimaux satisfaisant la contrainte monotone extraits moyennant l’approche MCP correspondent aux motifs rares minimaux. = D, AB, AE.
La contrainte anti-monotone est formulée pour chaque itemset en fonction des prix de ses items , “(.prix) 4”. Les prix des items A, B, C, D, E correspondent respectivement é 5, 4, 6, 3 et 10.
L’ensemble des motifs de support non nul et satisfaisant les contraintes et peut étre récupéré gréce aux approches MCP et ACP et est composé des motifs suivants, = D, AD, CD, ACD.
2.4.3 Les approches VST et FAVST
D’autres travaux ont essayé aussi d’étudier cette problématique, comme par exemple l’algorithme VST [De Raedt et al., 2002] d’extraction de motifs de chaénes de caractéres sous la conjonction de contraintes de types différents. Cet algorithme parcourt l’espace de recherche par niveau à la Apriori [Agrawal et Srikant, 1994]. Il se déroule en deux phases principales. La premiére consiste à effectuer un parcours du bas vers le haut permettant l’élagage des motifs candidats selon la contrainte anti-monotone. Puis, la deuxiéme phase assure un parcours par niveau du haut vers le bas pour l’élagage des motifs candidats selon la contrainte monotone. Chacune des deux phases inclut ainsi le cycle de génération, évaluation et élagage des candidats. Le cycle se termine quand il n’y a plus de candidats à générer. À la fin de ces deux phases, les motifs retenus sont valides par rapport à l’ensemble des contraintes considérées. Toutefois, dans le cas oé la contrainte monotone est trés sélective alors plusieurs évaluations inutiles des candidats selon la contrainte anti-monotone auraient été déjé menés lors de la premiére phase inutilement. De plus, l’algorithme VST souffre d’une limite liée au nombre de balayages de la base de données. En effet, il réalise au plus parcours de la base avec correspond à la taille de la plus grande chaéne valide par rapport à la contrainte anti-monotone. À cet égard, l’algorithme FAVST [Lee et De Raedt, 2004] a été introduit afin d’améliorer les performances de l’algorithme VST. L’algorithme FAVST assure une extraction efficace des chaénes de caractéres satisfaisant les contraintes posées et offre de meilleures performances que l’algorithme VST.
Exemple 27
Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. Soient la contrainte anti-monotone correspondant à la conjonction de deux contraintes anti-monotones. La premiére concerne la longueur minimale de la chaéne, Taille() 3 et la deuxiéme est traduite par un support non nul, Supp() 0. La contrainte monotone permet de ne retenir que les chaénes englobant le caractére A, Appartient(A, ). Les approches VST et FAVST permettent d’extraire l’ensemble des motifs satisfaisant à la fois les contraintes et . Lors de la premiére phase, tous les motifs satisfaisant la contrainte sont extraits, = ABC, ABE, ACD, ACE, BCE. Lors de la deuxiéme phase, les motifs ne respectant pas la contrainte monotone seront élagués. Nous avons ainsi, = ABC, ABE, ACD, ACE. Nous remarquons, que seul le candidat BCE est élagué puisqu’il n’englobe pas l’item A.
2.4.4 Les approches Dpc-Cofi et Bifold-Leap
D’autres travaux visant à améliorer les performances des algorithmes traitant de contraintes de types différents ont aussi vu le jour, tel que Dpc-Cofi 999Dpc-Cofi est l’acronyme de Dual Pushing of Constraint in Cofi. [El-Hajj et Zaïane, 2005] et BifoldLeap [El-Hajj et al., 2005]. Ces deux approches permettent d’extraire l’ensemble des motifs fréquents satisfaisant un ensemble de contraintes monotones et anti-monotones. Ces approches mettent en place une nouvelle stratégie qui se réalise en deux principales phases. La premiére phase consiste à extraire tous les motifs fréquents maximaux moyennant l’algorithme COFI* [El-Hajj et Zaïane, 2004]. La contrainte monotone est intégrée lors de la premiére phase afin d’élaguer tous les items qui ne vérifient pas cette contrainte puisque tous leurs sur-ensembles ne la vérifient bien évidement pas. Puis, lors de la deuxiéme phase tous les sous ensembles valides des motifs fréquents maximaux seront générés selon le principe suivant. Tout motif fréquent maximal ne satisfaisant pas la contrainte monotone, sera élagué puisque tous ses sous ensembles ne la satisfont pas. Pour tout motif fréquent maximal satisfaisant la contrainte anti-monotone, alors tous ses sous ensemble satisfont cette contrainte et seront ainsi générés et évalués par rapport à la contrainte monotone. À la fin de ce traitement, tous les motifs fréquents valides par rapport aux contraintes monotones et anti-monotones posées, seront extraits. Les deux algorithmes proposés présentent des performances meilleures que l’algorithme DualMiner gréce aux techniques de réductions du nombre d’évaluations des contraintes adoptées.
Exemple 28
Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1. La contrainte anti-monotone correspond à la contrainte de corrélation minimale par rapport à la mesure bond, bond() 0,30. La contrainte monotone correspond, Supp() 3.
La premiére phase consiste à extraire l’ensemble des motifs maximaux de support non nul, nous avons = (ABCE, 2), (ACD, 1). La contrainte de fréquence est traduite par Supp() 1.
Lors de la deuxiéme étape, le motif ACD ne satisfait pas la contrainte anti-monotone de corrélation, vu que bond(ACD) = = 0,25 0,30. Ainsi, tous ses sous-ensembles ne sont pas corrélés, il est ainsi élagué. Par contre, le motif ABCE est corrélé, bond(ABCE) = = 0,40 0,30 et il est rare aussi, Supp(ABCE) = 2 3. Donc tous ses sous-ensembles sont corrélés, ils seront ainsi générés et évalués uniquement par rapport à la contrainte monotone de rareté. Nous avons ainsi, = (ABC, 2), (ABE, 2), (BCE, 3). Le motif BCE n’est pas rare, il sera élagué, L’ensemble des motifs résultats correspond é, = (ABCE, 2), (ABC, 2), (ABE, 2). Les motifs ABC et ABE seront maintenus et tous leurs sous-ensembles sont générés, = (AB, 2), (AC, 3), (BC, 3), (AE, 2), (BE, 4). Les motifs rares seront ajoutés à l’ensemble résultat de tous les motifs corrélés rares, = (ABCE, 2), (ABC, 2), (ABE, 2) (AE, 2), (AB, 2).
2.4.5 L’approche ExAminer
L’algorithme ExAMiner [Bonchi et al., 2005] a été aussi proposé pour la fouille des motifs
fréquents sous une contrainte monotone. Les auteurs de cet algorithme prouvent l’existence d’une synergie réelle entre les contraintes de natures opposés. En effet, les contraintes anti-monotones permettent la réduction de l’espace de recherche gréce à la propriété de fermeture vers le bas, tandis que les contraintes monotones permettent d’éliminer des transactions de la base de transactions. L’élagage des transactions de la base qui ne satisfont pas une contrainte monotone est effectué par l’algorithme
ExAnte.
En effet, la réduction de la base de transaction est justifiée par le fait qu’aucun sous-ensemble d’une transaction élaguée ne satisfait la contrainte monotone considérée.
La synergie est ainsi traduite par le fait que les deux stratégies d’élagages se renforcent en réduisant l’espace de recherche, et simplifient par conséquent la dimension du probléme de fouille.
Il est toutefois important de noter que ces stratégies de réduction du contexte d’extraction,
souffrent d’une limite liée aux coéts des opérations d’entrée et de sortie réalisées lors des processus itératifs de réécriture de la base sur le disque [El-Hajj et al., 2005].
De plus, ces approches ne sont pas applicables pour le cas d’une contrainte monotone sensible au changement du nombre de transactions. Ceci est le cas de la contrainte de rareté que nous traitons dans ce travail.
Exemple 29
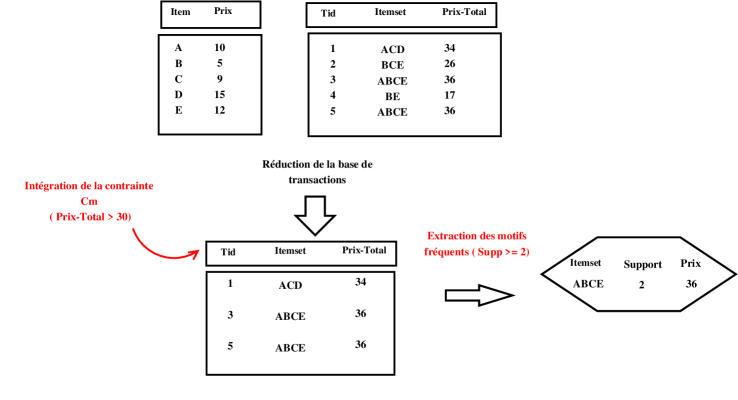
Nous avons ainsi analysé différentes approches de la littérature abordant la problématique de fouille de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés. Dans ce qui suit, nous passons en revue les algorithmes d’extraction de représentations concises de motifs fréquents sous la conjonction de contraintes.
2.4.6 Les approches d’extraction de représentations concises de motifs fréquents sous la conjonction de contraintes de types opposés
Trés peu d’approches traitants la problématique d’extraction de représentations concises de motifs fréquents sous la conjonction de contraintes de types opposés ont vu le jour. En effet, nous distinguons uniquement trois approches. La premiére approche a été proposée dans [Boulicaut et Jeudy, 2001] et consiste en une approche d’extraction d’une représentation concise basée sur les générateurs minimaux dits aussi “itemsets libres” fréquents et qui satisfont un ensemble donné de contraintes monotones et de contraintes anti-monotones. En effet, l’algorithme proposé constitue une variation de l’algorithme A-Close [Pasquier et al., 2005] avec l’incorporation des contraintes dans la phase d’extraction des motifs. De plus, les motifs libres extraits constituent une représentation concise avec perte d’information [Bonchi et Lucchese, 2006], autrement dit l’ensemble total des motifs fréquents respectant les contraintes posées, ne peut pas étre dérivé à partir de l’ensemble des motifs libres retenus. À cet égard, des approches d’extraction de représentations concises sous contraintes basée sur les motifs fermés fréquents ont aussi émergé. Nous citons dans ce cadre, l’approche introduite dans [Lei et al., 2003] et l’algorithme CCI-Miner [Bonchi et Lucchese, 2006]. Toutefois, l’algorithme proposé dans [Lei et al., 2003] opére par post traitement. En effet, tous les motifs fermés fréquents sont extraits dans un premier temps puis, ils sont filtrés par post traitement afin de ne maintenir que les fermés fréquents qui sont valides par rapport à l’ensemble de contraintes posées. Par opposition à ce dernier, CCI-Miner est une approche sophistiquée qui consiste en un algorithme en profondeur basée sur le principe d’incorporation de toutes les contraintes à la fois. En effet, CCI-Miner repose sur l’intégration de l’algorithme FP-Bonsai [Bonchi et Lucchese, 2006] d’extraction des motifs fréquents sous contraintes monotones avec l’algorithme Closet d’extraction de motifs fermés fréquents. Ces motifs retournés par CCI-Miner constituent une représentation concise sans perte d’information de l’ensemble de tous les motifs fréquents répondants aux contraintes posées. En outre, dans [Bonchi et Lucchese, 2006] les auteurs ont prouvé expérimentalement que les approches naéves opérants par post-traitement engendrent une perte d’information considérable. Nous proposons dans ce qui suit un exemple illustratif des différentes représentations concises proposées.
Exemple 30
Considérons le contexte d’extraction donné par la table 1.1 et la table des prix des items utilisée dans l’exemple 29. Pour un motif donné , la contrainte anti-monotone de fréquence est traduite par, Supp() 2 et la contrainte monotone est traduite par, Prix() 12.
L’approche proposée dans [Boulicaut et Jeudy, 2001] permet d’extraire l’ensemble des générateurs minimaux fréquents. Chaque itemset de cet ensemble ne posséde aucun sous-ensemble de même support conjonctif que lui. Nous avons, pour minsupp = 2, l’ensemble des générateurs minimaux fréquents muni chacun de son support. = (E, 4, 12), (B, 4, 5), (AB, 2, 15), (AE, 2, 22), (C, 4, 9), (BC, 3, 14), (EC, 3, 21), (A, 3, 10). Tous les éléments de cet ensemble vérifient la contrainte anti-monotone de fréquence, les itemsets ne vérifiant pas la contrainte monotone traduite par le prix minimal seront élagués. Ainsi, nous avons = (E, 4, 12), (AB, 2, 15), (AE, 2, 22), (BC, 3, 14), (EC, 3, 21). L’ensemble englobe ainsi tous les générateurs minimaux fréquents satisfaisants la contrainte monotone. L’ensemble de tous les motifs fréquents répondant à la contrainte monotone ne peut pas étre dérivé à partir de l’ensemble . Traitons à présent l’ensemble des motifs fermés fréquents extraits gréce à l’approche CCI-Miner [Bonchi et Lucchese, 2006] ou moyennant l’approche proposée dans [Lei et al., 2003]. Tout motif de l’ensemble ne posséde aucun sur-ensemble de même support que lui. Nous avons l’ensemble de ces motifs munis chacun de son support et de son prix. = (ABCE, 2, 36), (BCE, 3, 26), (BE, 4, 17), (AC, 3, 19). L’ensemble englobe ainsi tous les motifs fermés fréquents dont le prix dépasse 12. L’ensemble de tous les motifs fréquents vérifiant la contrainte monotone de prix minimal peut étre dérivé en générant pour chaque motif fermé, les sous-ensembles appartenant à la même classe d’équivalence que lui c.-é.-d. possédant le même support que lui. = (ABCE, 2, 36), (ABC, 2, 24), (ABE, 2, 27), (AB, 2, 15), (AE, 2, 22), (BCE, 3, 26), (BC, 3, 14), (CE, 3, 21), (BE, 4, 17), (E, 4, 12), (AC, 3, 19).
Nous avons ainsi montré que les représentations concises proposées par [Bonchi et Lucchese, 2006] et [Lei et al., 2003] autorisent une dérivation compléte de l’ensemble de tous les motifs fréquents satisfaisant la contrainte monotone de prix minimal.
2.4.7 Discussion
D’aprés l’étude des différentes approches de la littérature présentée dans cette section, nous constatons que les approches sophistiquées et les approches opérants par post traitement constituent deux solutions pour la problématique d’extraction de motifs sous contraintes.
Les approches opérants par post traitement, consistent à extraire tous les motifs vérifiant la contrainte anti monotone puis à effectuer un post traitement pour filtrer ces motifs par rapport à la contrainte monotone. Autrement dit, aucune intégration de la contrainte monotone n’est réalisée et l’exploration de l’espace de tous les motifs ne vérifiant pas la contrainte monotone s’effectue ainsi inutilement. De plus, les algorithmes actuels risquent de se bloquer à cause de la consommation excessive de la mémoire centrale.
Quant aux approches sophistiquées, ces derniéres intégrent l’ensemble des contraintes anti-monotones et monotones dans la fouille. Toutefois, l’intégration des contraintes monotones engendre la réduction des opportunités d’élagage de candidats selon la propriété de l’idéal d’ordre des contraintes anti-monotones. En effet, les contraintes anti-monotones sont plus faciles à intégrer dans la réduction de l’espace de recherche en exploitant la propriété trés intéressante de l’idéal d’ordre. Alors que les contraintes monotones sont plus compliquées et difficiles à incorporer dans le processus de fouille. De plus, elles sont moins efficaces dans la réduction de l’espace de recherche que les contraintes anti-monotones.
Nous constatons, que le choix de la meilleure approche dépend des caractéristiques de la base de données et des spécificités des contraintes posées.
Le tableau 2.5 récapitule les caractéristiques des différentes approches étudiées. Cette récapitulation couvrira les axes suivants :
-
1.
Type de motifs extraits : Cette propriété décrit le type de motifs générés par l’algorithme. Par Motifs valides, nous entendons les motifs qui satisfont l’ensemble des contraintes monotones et anti-monotones posées.
-
2.
Caractéristiques : Cette propriété décrit les principales caractéristiques de l’algorithme en question.
| Algorithme | Type de motifs | Caractéristiques |
|---|---|---|
| d’extraction | extraits | |
| DualMiner | tous les | Temps d’exécution élevé |
| [Bucila et al., 2003] | motifs valides | vu la nature duale |
| du parcours | ||
| MCP | tous les | La bordure positive de la contrainte |
| [Boulicaut et Jeudy, 2000] | motifs valides | monotone doit passer |
| en paramétre | ||
| ACP | tous les | La notion d’adaptativité proposée |
| [Bonchi et al., 2003] | motifs valides | n’est pas spécifiée |
| rigoureusement | ||
| VST | chaénes de | Nombre élevé de balayage |
| [De Raedt et al., 2002] | caractéres valides | de la base |
| Évaluations | ||
| inutiles des contraintes | ||
| FAVST | chaénes de | Approche plus efficace |
| [Lee et De Raedt, 2004] | caractéres valides | que VST. |
| DpcCofi | ||
| [El-Hajj et Zaïane, 2005] | motifs fréquents | Approches sophistiquées |
| BifoldLeap | valides | et plus efficaces que Dual-Miner |
| [El-Hajj et al., 2005] | ||
| ExAminer | motifs fréquents | Coéts élevées |
| [Bonchi et al., 2005] | valides | de réécriture de la base |
| Approche applicable que | ||
| pour les contraintes | ||
| monotones insensibles | ||
| au changement de la base | ||
| CCIMiner | motifs fermés | Approche sophistiquée |
| [Bonchi et Lucchese, 2006] | fréquents valides | Représentation concise |
| et sans perte d’information | ||
| L’approche de | motifs fermés | Approche par |
| [Lei et al., 2003] | fréquents valides | post traitement |
| et engendre une | ||
| perte d’information | ||
| L’approche de | générateurs minimaux | Représentation concise |
| [Boulicaut et Jeudy, 2001] | fréquents valides | avec perte d’information |
Au meilleur de notre connaissance, aucune étude dans la littérature n’a été réalisée afin d’extraire des représentations concises de l’ensemble des motifs corrélés rares selon la mesure bond résultant de la conjonction de la contrainte anti-monotone de corrélation et de la contrainte monotone de rareté. À cet égard, nous introduisons dans le chapitre suivant nos approches d’extraction de nouvelles représentations exactes de ces motifs corrélés rares.
2.5 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons donné un aperéu de l’extraction des motifs rares et nous avons analysé l’approche récente d’extraction de représentations concises exactes des motifs rares. Ensuite, nous avons détaillé les approches d’extraction des motifs corrélés fréquents et de leurs représentations concises. Nous avons aussi étudié les algorithmes traitants de d’extraction des motifs corrélés sous contraintes de types opposés. Nous avons, par la suite, analysé la panoplie d’approches constituant le cadre générique de la problématique de fouille de motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés. Nous avons, à cet égard, étudié les caractéristiques de ces approches et discuté leurs avantages et limites. Dans le chapitre suivant, nous allons caractériser l’ensemble des motifs corrélés rares selon la mesure bond et nous présenterons de nouvelles représentations concises de ces motifs.
Chapitre 3 Nouvelles représentations concises des motifs corrélés rares
3.1 Introduction
Nous consacrons ce chapitre à la présentation de nos contributions dans la réduction des motifs corrélés rares. Pour ce faire, nous étudions profondément les propriétés des motifs corrélés rares dans la premiére section. Ensuite, nous décrivons dans la deuxiéme section les caractéristiques des classes d’équivalence associées à ces motifs. Quant à la troisiéme section, elle sera dédiée à la justification de nos motivations quant à l’extraction des représentations concises des motifs corrélés rares. Ensuite nous proposons, de nouvelles représentations concises des motifs corrélés rares [Bouasker et al., 2011] à savoir les représentations concises exactes , et , ainsi que la représentation concise approximative .
3.2 Caractérisation des motifs corrélés rares
Nous commenéons dans la sous-section suivante par définir l’ensemble des motifs rares corrélés selon la mesure bond.
3.2.1 Définition des motifs corrélés rares
Définition 21
(Motifs corrélés rares associés à la mesure bond) [Bouasker et al., 2011]
étant donnés les seuils minimaux de support conjonctif et de corrélation minsupp et minbond, respectivement, l’ensemble des motifs corrélés rares, dénoté , est défini comme suit : = Supp() minsupp et bond() minbond.
Exemple 31
Considérons la base illustrée par la table 1.1 pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. L’ensemble est composé des motifs suivants oé chaque triplet représente le motif, sa valeur de support et sa valeur de bond : = (A, 3, ), (D, 1, ), (AB, 2, ), (AC, 3, ), (AD, 1, ), (AE, 2, ), (BC, 3, ), (CD, 1, ), (CE, 3, ), (ABC, 2, ), (ABE, 2, ), (ACD, 1, ), (ACE, 2, ), (BCE, 3, ), (ABCE, 2, ). Cet ensemble est schématisé par la figure 3.1. Le support indiqué en haut à gauche de chaque cadre représentant un motif est son support conjonctif. Comme le montre cette figure, l’ensemble des motifs corrélés rares correspond aux motifs localisés en dessous de la bordure de la contrainte anti-monotone associée aux motifs corrélés, et au dessus de la bordure de la contrainte monotone associée aux motifs rares.
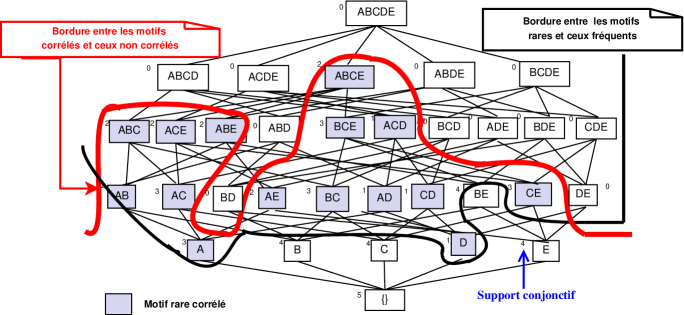
Il résulte de la définition précédente que l’ensemble correspond à l’intersection de l’ensemble des motifs corrélés et de l’ensemble des motifs rares : = . La proposition suivante découle de ce résultat.
Proposition 3
Soit . Nous avons :
-
—
D’aprés l’idéal d’ordre de l’ensemble des motifs corrélés selon la mesure bond, :
-
—
D’aprés le filtre d’ordre de l’ensemble des motifs rares, : .
La preuve découle des propriétés induites par les contraintes de corrélation et de rareté. L’ensemble , dont les éléments vérifient la contrainte “étre un motif corrélé rare”, résulte ainsi de l’intersection de deux ordres résultant de deux contraintes de natures opposés. Cet ensemble n’est ainsi ni un idéal ni un filtre d’ordre. Dans le treillis des motifs, l’espace de recherche des motifs corrélés rares est ainsi délimité, d’une part, par les éléments maximaux vérifiant la contrainte de corrélation et qui sont rares, c.-é.-d. les motifs rares parmi l’ensemble des motifs corrélés maximaux (cf. Définition 14) et, d’autre part, par les éléments minimaux vérifiant la contrainte de rareté et qui sont corrélés, c.-é.-d. les motifs corrélés parmi l’ensemble des motifs rares minimaux (cf. Définition 11). Ainsi, tout motif corrélé rare est nécessairement compris entre un élément de chacun des deux ensembles susmentionnés.
Exemple 32
Considérons la figure 3.1 pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. L’espace des motifs corrélés rares est délimité par : d’une part les motifs corrélés maximaux pour minbond = 0,2, à savoir ACD et ABCE (cf. Exemple 10), et, d’autre part, par les motifs rares minimaux pour minsupp = 4, à savoir A, D, BC et CE. Par exemple, le motif AD est un motif corrélé rare étant donné qu’il est compris entre un motif rare minimal à savoir D et un motif corrélé maximal à savoir ACD.
Cet espace est ainsi plus difficile à localiser que les ensembles associés à des contraintes de même nature. En effet, la conjonction de contraintes anti-monotones (resp. monotones) est une contrainte anti-monotone (resp. monotone) [Bonchi et Lucchese, 2006]. Par exemple, la contrainte “étre un motif corrélé non rare (c.-é.-d. fréquent)” est une contrainte anti-monotone puisque elle est résultante de la conjonction des contraintes anti-monotones “étre un motif corrélé” et “étre un motif fréquent”. Elle induit donc un idéal d’ordre [Ben Younes et al., 2010a]. La contrainte “étre un motif non corrélé rare” est une contrainte monotone et l’ensemble associé forme un filtre d’ordre dans le treillis des motifs.
D’un point de vue taille, et étant données les natures des contraintes induites par les seuils minimaux de support et de corrélation, à savoir respectivement minsupp et minbond, la taille de l’ensemble des motifs corrélés rares varie de la maniére indiquée dans la proposition suivante.
Proposition 4
a) Soient minsupp1 et minsupp2 deux seuils minimaux de support et et les deux ensembles des motifs corrélés rares associés pour une même valeur de minbond. Nous avons : si minsupp1 minsupp2, alors et par conséquent .
b) Soient minbond1 et minbond2 deux seuils minimaux de corrélation et et les deux ensembles des motifs corrélés rares associés pour une même valeur de minsupp. Nous avons : si minbond1 minbond2, alors et par conséquent .
Preuve.
- La preuve de a) dérive du fait que pour , si Supp() minsupp1, alors Supp() minsupp2. Ainsi, , . Il en résulte que .
- La preuve de b) dérive du fait que pour , si bond() minbond2, alors bond() minbond1. Ainsi, , . Par conséquent, .
Ainsi, la taille de est proportionnelle à minsupp et inversement proportionnelle à minbond. Il est toutefois à noter que, dans le cas général, nous ne pouvons rien décider quand les deux seuils varient en même temps et non seulement un à la fois.
Nous avons ainsi analysé la variation de la taille de l’ensemble . La question qui se pose à ce stade est, comment pouvons nous caractériser les motifs corrélés rares à travers leurs sous-ensembles directs? Autrement dit, pouvons nous affirmer la corrélation et ou la rareté d’un motif quelconque, étant donné la connaissance de ses sous-ensemble? Cette problématique sera étudiée dans ce qui suit.
3.2.2 Étude des propriétés spécifiques des motifs corrélés rares
Toutefois, deux cas sont à distinguer lors de l’affirmation de la nature de corrélation et de rareté d’un motif quelconque connaissant ses sous-ensembles. Le premier cas se réalise lorsque le motif posséde un sous-ensemble direct corrélé rare. Quand au deuxiéme cas, il se réalise lorsque le motif ne posséde aucun sous ensemble corrélé rare. Analysons chaque cas à part.
Dans le premier cas, le motif posséde un sous-ensemble direct corrélé rare. Ce motif est ainsi rare corrélé comme le justifie la proposition suivante,.
Proposition 5
Soit est un motif corrélé. Si et = alors le motif est un motif corrélé rare.
La preuve de cette proposition découle de la propriété de filtre d’ordre des motifs rares. En effet, tout motif corrélé qui est sur-ensemble d’un motif rare est forcément rare corrélé.
Cependant, dans le deuxiéme cas, c.-é.-d. lorsque le motif ne posséde aucun sous ensemble appartenant à l’ensemble . Plus précisément, tous les sous-ensembles du motif sont des motifs corrélés fréquents, alors nous ne pouvons rien décider quant à la nature de fréquence de ce motif. La proposition suivante présente une condition nécessaire et suffisante à l’affirmation de la nature de fréquence d’un motif corrélé.
Proposition 6
Soit est un motif corrélé. Désignons par minbond le seuil minimal de corrélation selon la mesure bond et par minsuppRel le seuil minimal de support relatif correspondant à . Si bond() minsuppRel alors le motif corrélé est un motif corrélé rare.
Preuve. Désignons par SuppRel() le support relatif d’un motif . Nous avons SuppRel() = et bond() = .
Or, Supp( ) donc . Ainsi, nous avons .
Ceci est équivalent é, bond( ) SuppRel(). Le motif étant corrélé, alors bond() minbond.
Dans le cas oé minbond minsuppRel et minbond bond() minsuppRel, nous avons alors SuppRel() bond() minsuppRel. Ce qui implique, SuppRel() minsuppRel.
Par conséquent, SuppRel() minsuppRel . Ceci est équivalent é,
Supp() minsupp, le motif est par conséquent rare.
D’aprés la proposition précédente, nous concluons qu’un motif corrélé ,
pour qu’il soit corrélé rare, il faut que sa valeur de mesure bond soit strictement inférieur au seuil minsuppRel. Cependant, lorsque la valeur de mesure bond
dépasse le seuil minsuppRel, alors nous ne pouvons pas affirmer la rareté du motif . Ceci est justifié gréce à la proposition suivante.
Proposition 7
Pour bond() minsuppRel, nous pouvons rien affirmer quant à la fréquence du motif corrélé .
Preuve. Nous avons Supp(X) , ceci est équivalent é Supp(X) bond().
Pour
bond() minsuppRel, nous avons
Supp(X) bond() minsuppRel.
Ceci donne,
minsuppRel Supp(X) et
minsuppRel minsupp.
Par conséquent, nous ne pouvons rien conclure quant à la fréquence ou la rareté du motif corrélé candidat .
D’aprés les propositions 6 et 7, nous concluons qu’un motif corrélé , pour qu’il soit corrélé rare, il faut que sa valeur de mesure bond soit strictement inférieur au seuil minsuppRel. Toutefois, dans le cas oé tous les sous-ensembles du motif sont fréquents corrélés, nous ne pouvons pas cerner sa valeur de la mesure bond et par conséquent nous ne pouvons toujours pas, comme l’illustre la proposition suivante, décider de sa fréquence ou de sa rareté.
Proposition 8
Soit un motif corrélé. Si tous les sous-ensembles de sont corrélés fréquents alors nous pouvons rien affirmer quant à la fréquence du motif corrélé .
Preuve. Tous les sous-ensembles d’un motif corrélé sont des motifs corrélés fréquents, ainsi nous avons pour tout motif et = , bond() minbond et SuppRel() minsuppRel.
Or, bond() SuppRel(Y) donc bond() minsuppRel.
Comme , alors bond() bond() d’aprés la propriété d’anti-monotonie des motifs corrélés.
Puisque bond() minsuppRel, alors deux cas sont possibles :
(i) bond() minsuppRel bond() : Le motif corrélé candidat est ainsi rare d’aprés la proposition 6.
(ii) minsuppRel bond() bond() : Nous ne pouvons rien décider quant à fréquence ou à la rareté du motif corrélé candidat d’aprés la proposition 7.
Il est clair d’aprés la proposition précédente, que même dans le cas oé, tous les sous-ensembles d’un motif corrélé sont fréquents corrélés, nous devons l’évaluer par rapport à la contrainte de rareté afin de confirmer sa nature.
Nous avons ainsi analysé minutieusement les propriétés des motifs corrélés rares. Dans ce qui suit, nous étudions le mécanisme d’intégration des contraintes dans le processus de fouille.
3.3 Mécanisme d’intégration des contraintes de rareté et de corrélation
L’ordre d’évaluation des contraintes est d’une importance majeure vu la nature opposée des contraintes anti-monotone de corrélation et monotone de rareté que nous considérons dans ce travail. Deux scénarios sont ainsi à distinguer :
- Scénario 1 : Appliquer la contrainte de rareté, l’opérateur de fermeture associé, et ensuite la contrainte de corrélation, ou,
- Scénario 2 : Appliquer la contrainte de corrélation, l’opérateur de fermeture associé, et ensuite la contrainte de rareté.
Ces deux scénarios sont analysés dans ce qui suit afin de justifier le choix du scénario adéquat dans les approches que nous allons proposer.
3.3.1 Premier scénario
Dans ce cas, l’extraction des motifs rares est effectuée en premier lieu. Ensuite, les motifs retenus seront filtrés en ne gardant que les motifs rares, dont la valeur de la mesure bond dépasse le seuil minimal minbond. Dans cette situation, afin de réduire la redondance entre les motifs, l’application de l’opérateur de fermeture conjonctive associé au support conjonctif [Ganter et Wille, 1999] permet de partitionner le treillis en des classes d’équivalence oé, pour un motif donné, cette fermeture ne préserve que le support conjonctif. Il en résulte que tous les motifs qui apparaissent dans les mêmes transactions seront regroupés dans une même classe d’équivalence. Ils ont ainsi le même support conjonctif et la même fermeture conjonctive, mais ont des supports disjonctifs éventuellement différents. Dans ce cas, les classes d’équivalence rares, c.-é.-d. celles contenant les motifs rares, seront ensuite évaluées par la contrainte anti-monotone de corrélation. Les motifs d’une même classe seront ainsi divisés en des motifs corrélés rares et des motifs rares non corrélés, comme le montre la figure 3.2.
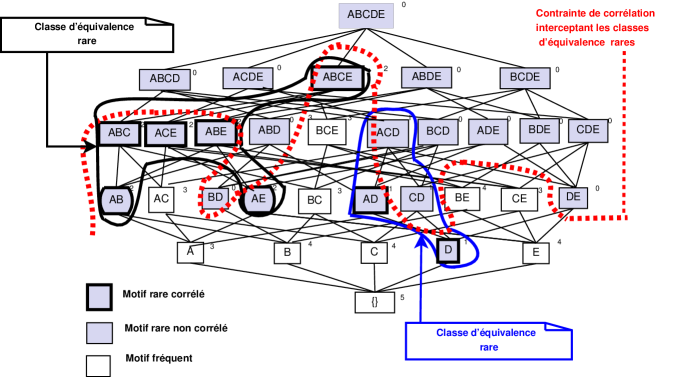
Exemple 33
Soit le contexte illustré par la table 1.1. Pour minsupp = 3, nous distinguons les deux classes d’équivalence rares et schématisées par la figure 3.2 et qui sont comme suit :
-
—
contient les motifs D, AD, CD et ACD. Elle admet comme support conjonctif 1 et comme fermeture conjonctive ACD.
-
—
contient les motifs AB, AE, ABC, ABE, ACE, et ABCE. Elle admet comme support conjonctif 2 et comme fermeture conjonctive ABCE.
En appliquant la contrainte de corrélation à travers un seuil minimal minbond = 0,3, pour la classe , seuls les motifs (D, 1, ), (AD, 1, ) seront rares corrélés alors que (CD, 1, ), (ACD, 1, ) sont des éléments rares non corrélés. Ceci revient au fait que les motifs de n’admettent pas le même support disjonctif. Par contre, tous les motifs de la classe sont corrélés rares.
3.3.2 Deuxiéme scénario
Le deuxiéme scénario consiste à extraire tous les motifs corrélés et les répartir en des classes d’équivalence moyennant l’opérateur de fermeture puis à les filtrer par rapport à la contrainte de rareté. En fait, les éléments d’une même classe d’équivalence partagent bien évidemment la même valeur de la mesure bond. Par conséquent, en considérant uniquement la contrainte anti-monotone de corrélation nous distinguons deux types de classes d’équivalence à savoir les classes corrélées et les classes non corrélées. La question qui se pose à ce stade, est quel est l’effet de l’ajout de la contrainte monotone de rareté sur ces classes d’équivalence? Autrement dit, Comment s’affectent ces classes d’équivalence lorsqu’elles seront interceptées par la contrainte monotone de rareté?
En effet, pour chaque classe d’équivalence, la conservation de la valeur de la mesure bond conserve bien évidemment le support conjonctif, le support disjonctif et le support négatif. Par conséquent, les éléments d’une même classe d’équivalence ont le même comportement quant aux contraintes de corrélation et de rareté. À cet égard, pour une classe d’équivalence corrélée, c.-é.-d. celle contenant des motifs corrélés, les éléments sont tous rares ou sont tous fréquents. Il en est de même pour une classe d’équivalence non corrélée, c.-é.-d. dont les motifs associés sont non corrélés. Ainsi, ces classes d’équivalence ne seront pas affectées comme le montre la figure 3.3. À cet égard, nous distinguons les classes corrélés fréquentes, les classes non corrélés fréquentes, les classes corrélés rares et les classes non corrélés rares.
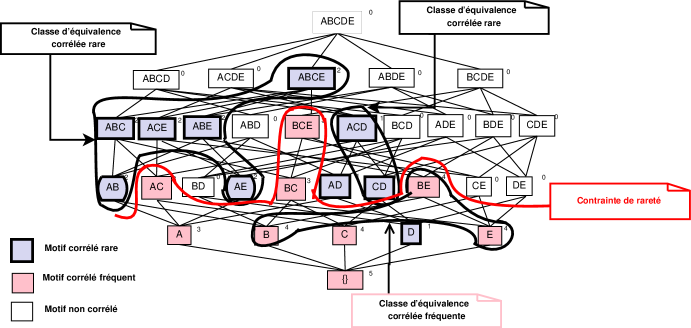
3.3.3 Synthése des deux scénarios
La caractéristique des classes d’équivalence induites par précédemment analysée, est trés intéressante. En effet, ceci n’est pas le cas de tous les opérateurs de fermeture. Par exemple, l’application de l’opérateur de fermeture associé au support conjonctif, c.-é.-d. l’opérateur de fermeture conjonctive [Ganter et Wille, 1999], induit des classes d’équivalence oé le comportement d’un motif d’une classe donnée vis-é-vis de la contrainte de corrélation n’est pas représentatif du comportement du reste des motifs de la classe. Pour une classe donnée, chaque motif doit ainsi étre testé indépendamment des autres de la même classe pour savoir s’il est corrélé ou non. Toutefois, contrairement à la fermeture conjonctive, l’opérateur de fermeture préserve non seulement le support conjonctif d’un motif mais aussi son support disjonctif, et par conséquent sa valeur de la mesure bond. À cet égard, nous optons pour le deuxiéme scénario lors de la conception de l’ensemble des approches que nous proposons. Dans ce qui suit, nous présentons l’étude de ces classes d’équivalence proposée dans [Bouasker et al., 2011].
3.4 Caractérisation des classes d’équivalence corrélées rares
Nous commenéons par présenter un exemple illustratif des classes d’équivalence corrélées rares.
Exemple 34
Considérons la base illustrée par la table 1.1 pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. Les classes d’équivalence corrélées rares dont les éléments de chacune sont récapitulés comme suit :
-
—
contient le motif A. Elle admet pour support conjonctif 3 et pour valeur de bond 1.
-
—
contient le motif D. Elle admet pour support conjonctif 1 et pour valeur de bond 1.
-
—
contient les motifs AB, AE, ABC, ABE, ACE, et ABCE. Elle admet pour support conjonctif 2 et pour valeur de bond . ABCE est le fermé corrélé de cette classe.
-
—
contient le motif AC. Elle admet pour support conjonctif 3 et pour valeur de bond .
-
—
contient le motif AD. Elle admet pour support conjonctif 1 et pour valeur de bond .
-
—
contient les motifs CD et ACD. Elle admet pour support conjonctif 1 et pour valeur de bond . ACD est le fermé corrélé de cette classe.
-
—
contient les motifs BC, CE et BCE. Elle admet pour support conjonctif 3 et pour valeur de bond . BCE est le fermé corrélé de cette classe.
L’ensemble des motifs corrélés rares est ainsi partitionné en classes disjointes, les classes d’équivalence corrélées rares. Dans chaque classe, un motif fermé corrélé rare est alors le motif le plus large au sens de l’inclusion dans la classe. Par contre, les plus petits motifs sont les motifs minimaux corrélés rares incomparables selon la relation d’inclusion. Les motifs minimaux et fermés seront formellement définis dans ce qui suit.
Définition 22
(Motifs fermés corrélés rares) L’ensemble des motifs fermés corrélés rares est défini par : = : bond() bond(
En fait, l’ensemble résulte de l’intersection entre l’ensemble des motifs corrélés rares et l’ensemble des motifs fermés corrélés. Ainsi, = .
Définition 23
(Motifs minimaux corrélés rares) L’ensemble des motifs minimaux corrélés rares est défini par : = : bond() bond(.
Cet ensemble, , résulte de l’intersection entre l’ensemble des motifs corrélés rares et l’ensemble des motifs minimaux corrélés. Ainsi, = .
Exemple 35
Soit la base illustrée par la table 1.1 pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. Le motif ACD . En effet, il est fermé corrélé (cf. Exemple 12). Il est aussi rare (cf. Exemple 31). Par ailleurs, le motif AB . En effet, il est minimal corrélé (cf. Exemple 13). Il est aussi rare (cf. Exemple 31).
En se référant aux diverses classes d’équivalence corrélées rares, nous avons l’ensemble composé des éléments maximaux de ces classes c.-é.-d. A, D, AC, AD, ACD, BCE et ABCE. Par ailleurs, l’ensemble est composé des éléments minimaux de ces classes c.-é.-d. A, D, AB, AC, AD, AE, BC, CD et CE. Les motifs A, D, AC et AD sont à la fois des motifs fermés et minimaux. Leurs classes associées se réduisent donc chacune à un unique élément.
Nous avons ainsi détaillé les propriétés des classes d’équivalence corrélées rares. Sur la base de ces derniéres, nous décrivons les différentes représentations proposées. Justifions d’abord nos motivations quant à l’extraction des représentations concises exactes des motifs corrélés rares.
3.5 Motivations de l’extraction des représentations concises exactes des motifs corrélés rares
Notre choix d’extraire des représentations concises, et non la totalité de l’ensemble total des motifs corrélés rares, a été motivé par deux principales raisons. Premiérement, l’extraction des représentations concises est possible et plus efficace dans un certain nombre de cas que l’extraction de l’ensemble total . L’extraction de ce dernier est souvent coéteuse en espace mémoire et en temps d’exécution.
Une représentation exacte des motifs corrélés rares doit permettre de déterminer si un motif arbitraire est corrélé rare ou non, et s’il est corrélé rare, la représentation doit permettre de dériver sans perte d’information son support et sa valeur de la mesure bond. Dans ce sens, les représentations proposées dans ce travail seront montrées comme étant toujours de taille plus réduite que l’ensemble total des motifs corrélés rares. Elles permettent ainsi une meilleure exploitation des connaissances extraites. En plus, étant sans perte d’information, elles permettent la dérivation quand ceci est nécessaire de tous les motifs corrélés rares non retenus dans une représentation donnée.
Afin de proposer les représentations concises des motifs corrélés rares, nous nous basons sur les classes d’équivalence. Ces classes permettent de ne retenir que les motifs non-redondants. En effet, parmi les motifs d’une classe donnée, seuls ceux nécessaire à la régénération de l’ensemble total des motifs corrélés rares seront retenus dans une représentation donnée. Le reste des motifs de la classe ne sera donc pas maintenu, ce qui réduit la redondance dans les connaissances extraites. Ces classes d’équivalence facilitent aussi l’exploration de l’espace de recherche des motifs corrélés rares. En effet, l’application d’un opérateur de fermeture permet de passer de l’élément minimal d’une classe à son élément maximal sans avoir à parcourir les niveaux intermédiaires.
Aprés avoir introduit les propriétés des classes d’équivalence corrélées rares, nous introduisons dans la suite les représentations concises proposées.
3.6 Représentations concises exactes des motifs corrélés rares
Une premiére idée intuitive afin de proposer une représentation concise exacte des motifs corrélés rares serait de voir si les éléments minimaux ou les éléments maximaux des classes d’équivalence associées permettraient de représenter sans perte d’information cet ensemble. Dans ce sens, il est important de rappeler que l’ensemble des motifs corrélés rares résulte de l’intersection de l’idéal d’ordre des motifs corrélés et du filtre d’ordre des motifs rares. Cet ensemble ne forme donc ni un idéal d’ordre ni un filtre d’ordre. Dans cette situation, pris chacun indépendamment de l’autre, est ce que l’ensemble ou l’ensemble peut constituer une représentation concise exacte des motifs rares corrélés?
Analysons dans ce qui suit chacun de ces deux ensembles :
- Commenéons par l’ensemble des minimaux des classes d’équivalence corrélées rares. De part la nature de ses éléments – minimaux de leurs classes d’équivalence – cet ensemble permet pour un motif donné de vérifier s’il est rare ou non. En effet, il suffit de trouver un élément , tel que pour décider que est un motif rare. Si ce n’est pas le cas, alors n’est pas un motif rare. Toutefois, l’ensemble ne permet pas de déterminer dans le cas général si est corrélé ou non (ceci n’est possible que si ). En effet, même s’il existe , tel que , et même sachant que est corrélé, nous ne pouvons rien décider quant au statut de vis-é-vis de la contrainte de corrélation puisque cette derniére est anti-monotone (le fait que est corrélé n’implique pas que l’est aussi). Ainsi, ne peut pas constituer une représentation exacte de .
- Traitons maintenant le cas de l’ensemble des maximaux des classes d’équivalence corrélées rares. D’une maniére duale à , les éléments de permettent de déterminer pour un motif s’il est corrélé ou non. Il suffit qu’il soit inclus dans un motif , et sinon n’est pas corrélé. Toutefois, de part leur nature, les fermés appartenant à ne permettent pas dans le cas général de dériver l’information concernant le statut de rareté d’un motif quelconque (ceci n’est possible que si ). En effet, même s’il existe , tel que , et même sachant que est rare, nous ne pouvons pas savoir si est rare ou non puisque la contrainte de rareté est monotone (le fait que est rare n’implique pas que l’est aussi). Ainsi, ne peut pas constituer une représentation exacte de . Il résulte de l’analyse que nous venons d’effectuer que la complémentarité entre et peut constituer une représentation exacte des motifs corrélés rares. Cette premiére alternative est étudiée dans la sous-section qui suit, et qui sera suivie par deux optimisations afin de ne retenir que les éléments indispensables à la régénération sans perte d’information des éléments de .
3.6.1 La représentation concise exacte
La premiére représentation que nous proposons est définie comme suit.
Définition 24
(Représentation ) [Bouasker et al., 2011]
Soit la représentation concise exacte des motifs corrélés rares basée sur l’ensemble des motifs fermés corrélés rares et sur l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares. La représentation est définie comme suit : = . Chaque élément de est muni de son support, Supp(), et sa mesure bond, bond().
Exemple 36
Considérons la base de transactions donnée dans la table 1.1, pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. En considérant les ensembles et (cf. Exemple 35), la représentation est composée par : (A, , ), (D, , ), (AB, , ), (AC, , ), (AD, , ), (AE, , ), (BC, , ), (CD, , ), (CE, , ), (ACD, , ), (BCE, , ) et (ABCE, , ).
Le théoréme suivant montre que les éléments de représentent sans perte d’information les motifs corrélés rares.
Théoréme 1
La représentation est une représentation concise exacte de l’ensemble des motifs corrélés rares.
Preuve. Soit un motif . Trois cas se présentent :
a) Si , alors est un motif corrélé rare et nous avons son support et sa valeur de la mesure bond.
b) Si tel que ou tel que , alors puisque n’appartient à aucune classe d’équivalence corrélée rare.
c) Sinon, . En effet, d’aprés la proposition 3, est corrélé puisque inclus dans un motif corrélé, à savoir . Il est aussi rare puisque englobant un motif rare, à savoir . Dans ce cas, il suffit de localiser la fermeture de par , disons . appartient nécessairement à puisque est un motif corrélé rare et inclut l’ensemble des motifs fermés corrélés rares. Par conséquent, = { }. Comme l’opérateur préserve la mesure bond et par conséquent le support conjonctif (cf. Proposition 2), nous avons : bond() = bond() et
Supp() = Supp().
Exemple 37
Considérons la représentation donnée dans l’exemple précédent. Illustrons chacun des trois cas. Le motif AD . Ainsi, nous avons son support égal à 1 et sa valeur de la mesure bond égale à .
Considérons le motif BE. Bien qu’il soit inclus dans deux motifs de , à savoir BCE et ABCE, BE puisque aucun élément de n’est inclus dans BE. Soit maintenant le motif ABC. Il existe deux motifs de qui vérifient la condition faisant de ABC un motif corrélé rare, à savoir AB et ABCE, puisque AB ABC ABCE. Le plus petit motif de couvrant ABC, c.-é.-d. sa fermeture, est ABCE. Ainsi, bond(ABC) = bond(ABCE) = , et Supp(ABC) = Supp(ABCE) = 2.
Il est important de noter que la représentation est une couverture parfaite de l’ensemble . En effet, la taille de la représentation ne dépasse jamais celle de l’ensemble quelle que soit la base et les valeurs de minsupp et de minbond considérées. En effet, nous avons toujours ( ) .
Remarque 4
Il est important de noter que nous sommes obligés de maintenir, pour un motif de la représentation, à la fois le Supp() et bond(). D’une part, la valeur de bond() étant un rapport entre le support conjonctif et celui disjonctif de ne permet pas de dériver le support conjonctif de . D’autre part, ayant le support conjonctif d’un motif , ceci n’est pas suffisant pour calculer la valeur de sa mesure bond. En effet, ceci nécessite la connaissance de son support disjonctif. Ce dernier ne peut étre dérivé moyennant les identités d’inclusion-exclusion que connaissant les supports conjonctifs de tous les sous-ensembles de [Galambos et Simonelli, 2000]. Toutefois, si est un motif corrélé rare, tous ses-ensembles ne le sont pas forcément et par conséquent nous n’avons pas accés à leurs supports conjonctifs respectifs. Ainsi, il faut retenir le support conjonctif et la valeur de la mesure bond pour chaque élément de la représentation. C’est aussi la raison pour laquelle les représentations concises basées sur les régles de déduction [Calders et al., 2005] et celles basées sur les identités d’inclusion-exclusion [Casali et al., 2005, Hamrouni et al., 2009] ne sont pas applicables pour représenter l’ensemble des motifs corrélés rares. En effet, ces représentations nécessitent pour un motif donné la connaissance du support conjonctif ou disjonctif, suivant la représentation, associé à tous ses sous-ensembles. Ceci est exigé que ce soit pour retenir les éléments de la représentation ou pour la dérivation des informations associées aux éléments non-retenus dans la représentation.
Dans cette situation, les motifs fermés et minimaux des classes d’équivalence offrent comme montré précédemment une solution intéressante pour représenter d’une maniére concise l’ensemble des motifs corrélés rares. En effet, la localisation de tels motifs nécessite un voisinage restreint, les sur-ensembles immédiats et les sous-ensembles immédiats respectivement, et non tous leurs sous-ensembles respectifs, comme c’est le cas par exemple des motifs non-dérivables [Calders et Goethals, 2007]. En plus, la dérivation des supports des motifs à partir des fermés et des minimaux est réalisée d’une maniére directe, contrairement par exemple aux motifs essentiels [Casali et al., 2005] et aux motifs non-dérivables qui nécessitent tous les sous-ensembles du motif dérivé.
Remarque 5
Il est aussi intéressant de signaler que le fait de considérer, dans , l’union entre les ensembles et permet d’éviter la redondance – à cause de la duplication d’un motif donné – qui peut apparaétre dans la représentation si nous considérons chacun des ensembles et séparément. Par exemple, si nous considérons l’exemple 36, nous remarquons que les éléments (A, 3, ), (D, 1, ), (AC, 3, ) et (AD, 1, ) appartiennent à la fois à l’ensemble et . Toutefois, un avantage de la gestion de chaque ensemble à part est la réduction de certains tests d’inclusion lors de l’interrogation de la représentation. Le choix entre tolérer une certaine duplication et réduire éventuellement le coét de la régénération dépend de la nature de l’application oé il sera éventuellement question de privilégier soit l’espace mémoire soit les temps de dérivation. Notons qu’une solution intermédiaire serait de localiser dans un premier groupe les éléments qui sont à la fois des motifs fermés et des motifs minimaux tels que A, D, AC et AD dans notre cas, dans un second le reste des minimaux à part, et le reste des fermés formeront un troisiéme groupe. Le premier et le second groupe seront utilisés pour les traitements oé les minimaux seront utiles, tandis que le premier et le troisiéme seront utilisés pour les traitements nécessitant les fermés.
Nous proposons dans la suite de cette section deux optimisations de permettant de réduire encore plus le nombre de motifs à retenir dans la représentation tout en garantissant la non-perte d’information concernant l’ensemble des motifs corrélés rares.
3.6.2 La représentation concise exacte
Cette premiére optimisation se base sur le fait que l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares augmenté seulement des maximaux, par rapport à l’inclusion ensembliste, parmi les motifs fermés corrélés rares est suffisant pour représenter d’une maniére exacte l’ensemble . L’ensemble des motifs fermés corrélés rares maximaux est défini comme suit :
Définition 25
L’ensemble est donc restreint aux éléments de qui sont aussi rares (en plus d’étre les plus grands motifs corrélés).
Exemple 38
Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minsupp = 4 et minbond = 0,2, = A, D, AD, ACD, BCE, ABCE (cf. Exemple 36). Par ailleurs, pour minbond = 0,2, = ACD, ABCE (cf. Exemple 10). Ainsi, = = ACD, ABCE. En effet, les fermés corrélés A, D et AD ne sont pas retenus puisqu’ils sont inclus dans ACD. Le fermé BCE sera aussi éliminé puisqu’il est inclus dans ABCE.
La définition suivante présente la représentation des motifs corrélés rares basée sur cette optimisation.
Définition 26
(Représentation ) [Bouasker et al., 2011]
Soit la représentation basée sur l’ensemble et l’ensemble . Nous avons = . Chaque élément de est muni de son support, Supp(), et de sa mesure bond, bond().
Exemple 39
Considérons la base de transactions donnée dans la table 1.1. Pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. La représentation est composée par : (A, , ), (D, , ), (AB, , ), (AD, , ), (AE, , ), (CD, , ), (BC, , ), (CE, , ), (AC, , ), (ACD, , ), et (ABCE, , ). Nous remarquons que, pour cet exemple, le seul élément appartenant é la représentation et non à la représentation est le motif BCE. En effet, ceci est dé au fait que les motifs fermés éliminés de sont eux mêmes des minimaux corrélés rares, à savoir D, A, AC et AD. Toutefois, la représentation serait plus réduite que si les ensembles et sont gérés séparément (cf. Remarque 5). En effet, il n’y aura plus de duplication de A, D, AC et de AD.
Le théoréme 2 montre que ax couvre sans perte d’information l’ensemble .
Théoréme 2
La représentation est une représentation concise exacte de l’ensemble des motifs corrélés rares.
Preuve. Soit un motif . Trois cas se présentent :
a) Si , alors est un motif corrélé rare et nous avons son support et sa valeur de la mesure bond.
b) Si tel que ou tel que , alors puisque n’appartient à aucune classe d’équivalence corrélée rare.
c) Sinon, . En effet, d’aprés la proposition 3, est corrélé puisque inclus dans un motif corrélé, à savoir . Il est aussi rare puisque englobant un motif rare, à savoir . Comme est un motif corrélé rare et la représentation inclut l’ensemble contenant les éléments minimaux des différentes classes d’équivalence corrélées rares, cette représentation contient au moins un élément de la classe d’équivalence de , en particulier tous les motifs minimaux de la classe.
Comme le support conjonctif et la mesure bond décroissent avec la taille des motifs, les valeurs du support conjonctif et de la mesure bond de sont égales aux valeurs minimales des mesures associées à ses sous-ensembles appartenant à . Il en résulte que :
Supp() = Supp() et , et,
bond() = bond() et .
Exemple 40
Soit la représentation donnée dans l’exemple précédent. Le traitement du premier et du second cas est semblable à ceux des deux premiers cas de la représentation (cf. Exemple 37).
Considérons donc le motif ABE pour illustrer le troisiéme cas. Il existe deux motifs de qui vérifient la condition faisant de ABE un motif corrélé rare, à savoir AB et ABCE (AB ABE ABCE). Les motifs de inclus dans ABE sont AB et AE. Par conséquent, Supp(ABE) = Supp(AB), Supp(AE) = 2, 2 = 2, et bond(ABE) = bond(AB), bond(AE) = , = .
Étant incluse dans , qui a été montrée comme étant une couverture parfaite de , la représentation est aussi une couverture parfaite de .
La sous-section suivante présente une autre optimisation de la représentation .
3.6.3 La représentation concise exacte
D’une maniére duale à la représentation précédente, il suffit de retenir dans que les motifs minimaux, par rapport à l’inclusion ensembliste, parmi ceux de l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares. L’élagage des autres éléments de sera prouvé comme étant sans perte d’information lors de la régénération de l’ensemble des motifs corrélés rares. L’ensemble des motifs minimaux parmi ceux de est défini comme suit :
Définition 27
L’ensemble est donc restreint aux éléments de qui sont aussi corrélés (en plus d’étre les plus petits motifs rares).
Exemple 41
Soit la base illustrée par la table 1.1. Pour minsupp = 4 et minbond = 0,2, = A, D, AB, AD, AE, CD, AC, BC, CE (cf. Exemple 36). Par ailleurs, pour minsupp = 4, = A, D, BC, CE. Ainsi, = = A, D, BC, CE. Les motifs minimaux corrélés rares AB, AD, AE et AC ne sont pas retenus puisqu’ils englobent le motif A. De même pour le motif CD, il sera éliminé puisqu’il englobe le motif D.
Remarque 6
Il est important de noter que dans l’exemple précédent, nous avons . Toutefois, ceci n’est pas le cas d’une maniére générale. En effet, un motif rare minimal peut bien évidemment ne pas étre corrélé et donc ne pas appartenir à . Cette remarque s’applique aussi pour le cas de l’exemple 38 oé . En effet, un motif corrélé maximal peut ne pas étre rare et donc ne pas appartenir à .
La définition 28 présente la représentation résultante de l’utilisation de .
Définition 28
(Représentation ) [Bouasker et al., 2011]
Soit la représentation basée sur l’ensemble et l’ensemble . Nous avons = . Chaque élément de est muni de son support, Supp(), et sa mesure bond, bond().
Exemple 42
Considérons la base de transactions donnée dans la table 1.1, pour minsupp = 4 et minbond = 0,2. La représentation est composée par : (A, 3, ), (D, 1, ), (AC, 3, ), (AD, 1, ), (BC, 3, ), (CE, 3, ), (ACD, 1, ), (BCE, 3, ), et (ABCE, 2, ).
Nous remarquons que, comparée à , cette représentation admet trois éléments en moins à savoir AB, AE et CD.
Le théoréme suivant prouve que cette troisiéme représentation est aussi sans perte d’information de l’ensemble des motifs corrélés rares.
Théoréme 3
La représentation est une représentation concise exacte de l’ensemble des motifs corrélés rares.
Afin de démontrer ce théoréme, nous adoptons le même principe de démonstration que les
deux autres théorémes précédents.
Preuve. Soit un motif . Trois cas se présentent :
a) Si , alors est un motif corrélé rare et nous avons son support et sa valeur de la mesure bond.
b) Si tel que ou tel que , alors puisque n’appartient à aucune classe d’équivalence corrélée rare.
c) Sinon, . En effet, d’aprés la proposition 3, est corrélé puisque inclus dans un motif corrélé, à savoir . Il est aussi rare puisque englobant un motif rare, à savoir . Comme l’ensemble appartient à , il suffit de localiser le fermé corrélé de , disons , égal à : = { }. Ainsi, bond() = bond() et
Supp() = Supp().
Exemple 43
Soit la représentation donnée dans l’exemple précédent. Le traitement du premier et du second cas est semblable à ceux des deux premiers cas de la représentation (cf. Exemple 36).
Considérons donc le motif ABC pour illustrer le troisiéme cas. Il existe deux motifs ABCE et BC tel que (BC ABC et ABC ABCE). Nous concluons donc que le motif ABC est un motif corrélé rare. Le fermé associé au motif ABC correspond à ABCE. Par conséquent, Supp(ABC) = Supp(ABCE) = 2 et bond(ABC) = bond(ABCE) = .
Étant incluse dans , est comme les deux précédentes représentations une couverture parfaite de .
Nous avons, ainsi, décrit et analysé les caractéristiques des différentes représentations concises exactes des motifs corrélés rares. Dans ce qui suit, nous présentons une représentation concise approximative résultante de la jointure entre les deux représentations concises exactes et .
3.7 La représentation concise approximative
En se basant sur les deux représentations concises exactes et précédemment décrites, nous définissons la représentation concise approximative -.
Cette derniére est composée de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares maximaux (cf. Définition 25) et de l’ensemble des éléments minimaux de l’ensemble (cf. Définition 27). Nous définissons cette représentation formellement comme suit.
Définition 29
(Représentation ) [Bouasker et al., 2011]
Soit la représentation basée sur
l’ensemble et sur l’ensemble .
Nous avons = .
Chaque élément de est muni de son support, Supp(), et de sa valeur de la mesure bond, bond().
Exemple 44
La représentation offre une meilleure réduction que les représentations concises exactes , et . Dans cet exemple, la représentation posséde six éléments de moins que la représentation concise exacte , onze éléments de moins que la représentation concise exacte et un élément de moins que la représentation concise exacte . Cependant, cette représentation n’offre pas le même degré d’exactitude que les représentations concises exactes précédemment citées. En effet, elle ne permet pas, comme l’illustre le théoréme suivant, de dériver d’une maniére exacte les données de tout motif corrélé rare.
Théoréme 4
La représentation n’est qu’une représentation concise approximative de l’ensemble des motifs corrélés rares.
Preuve. En effet, pour un motif arbitraire , cette représentation permet de déterminer si est corrélé rare ou non. Il suffit de trouver deux motifs et appartenant à la représentation tel que . Si ou n’existe pas alors . Toutefois, les informations concernant le support et la mesure bond de ne peuvent étre exactement dérivées que si . Dans le cas contraire, cette représentation ne permet pas de les dériver d’une maniére exacte étant donné qu’elle peut ne contenir aucun élément représentatif de la classe d’équivalence de (c.-é.-d. ni le fermé associé s’il n’appartient pas à ni les minimaux associés s’il n’appartiennent pas à ). Seule une approximation des supports de et de sa valeur de bond peut étre effectuée dans ce cas.
À cet égard, nous définissons les bornes maximales et minimales du support conjonctif, du support disjonctif et de la valeur de la mesure bond d’un motif corrélé rare .
Soient,
R1 = Supp(), ,
R2 = Supp(), ,
R3 = Supp(), et
R4 = Supp(), .
Alors nous définissons les bornes minimales et maximales du support conjonctif du motif en fonction de R1 et de R2 comme suit. Désignons par MinConj la borne minimale du support conjonctif du motif , MinConj = (R1, R2) et désignons par MaxConj la borne maximale du support conjonctif du motif , MaxConj = (R1, R2).
Concernant le support disjonctif du motif , nous définissons les bornes minimales et maximales du support disjonctif du motif en fonction de R3 et de R4 comme suit. Désignons par MinDisj la borne minimale du support disjonctif du motif , MinDisj = (R3, R4) et désignons par MaxDisj la borne maximale du support disjonctif du motif , MaxDisj = (R3, R4).
Par conséquent le support conjonctif de tout motif corrélé rare identifié par la représentation , sera compris entre MinConj et MaxConj. Formellement, Supp() MinConj, MaxConj. Le support disjonctif du motif sera tout de même cerné par la borne minimale MinDisj et la borne maximale MaxDisj, Supp() MinDisj, MaxDisj.
Ainsi, les bornes minimales et maximales de la valeur de la mesure bond du motif corrélé rare seront définis en fonction de MinConj, MinDisj, MaxConj et MaxDisj comme suit.
Puisque MinDisj Supp() MaxDisj, ainsi .
Comme Supp(I) 0 alors nous déduisons que, . Ceci est équivalent é, bond() . Or, MinConj Supp( ) Ceci implique, bond(). De plus, Supp() MaxConj ainsi bond() . Nous avons ainsi, bond() .
Désignons par Minbond la borne minimale de la valeur de la mesure bond, Minbond = et par Maxbond la borne maximale de la valeur de la mesure bond, Maxbond = .
Nous concluons de ce qui précéde, que la valeur de la mesure bond du motif appartient à l’intervalle borné par Minbond et Maxbond, bond()
Minbond, Maxbond.
Exemple 45
Considérons l’exemple 44.
Prenons le cas du motif ABE, les deux motifs qui font que l’itemset ABE est un motif corrélé rare sont A et ABCE (A ABE ABCE). Ainsi le motif ABE est un motif corrélé rare, ses supports conjonctif, disjonctif et sa valeur de la mesure bond seront estimés comme suit.
R1 = Supp(ABCE) = 2,
R2 = Supp(A) = 3,
R3 = Supp(ABCE) = 5,
R4 = Supp(A) = 5.
Ainsi, nous avons MinConj = (R1, R2) = (2, 3) = 2, MaxConj = (R1, R2) = (2, 3) = 3, et (R3, R4) = (R3, R4) = (5, 5) = (5, 5) = 5. Donc pour cet exemple, MinDisj = MaxDisj = 5. Ce qui implique que, Minbond = = et Maxbond = = .
Par conséquent, nous avons Supp(ABE) 2, 3, Supp(ABE) 5, 5 alors Supp(ABE) = 5 et bond(ABE) , .
Nous remarquons d’aprés le contexte donné par la table 1.1, que les valeurs des supports conjonctif, disjonctif et la valeur de la mesure bond du motif ABE correspondent respectivement à 2, 5 et . Ces valeurs ne contredisent pas les valeurs approximées précédemment calculées. Nous avons ainsi affirmé que le mécanisme d’approximation offert par la représentation concise approximative est valide.
3.8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les caractéristiques des motifs corrélés rares selon la mesure bond et nous avons décrit minutieusement les spécificités des classes d’équivalence corrélées rares. Ensuite, nous avons introduit les différentes représentations concises des motifs corrélés rares selon la mesure bond et nous avons prouvé leurs propriétés théoriques d’exactitude et de compacité. Ce chapitre a été cléturé avec la définition et l’analyse de la représentation concise approximative. Cette derniére sacrifie l’exactitude des résultats au profit d’une meilleure réduction. Dans le chapitre suivant, nous présenterons l’ensemble des algorithmes dédiés à l’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares et des différentes représentations concises proposées.
Chapitre 4 Approches d’extraction des motifs corrélés rares et des représentations proposées
4.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous introduisons dans la premiére section l’algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares. La deuxiéme section sera consacrée à la présentation de l’algorithme CRPR_Miner d’extraction de la représentation concise exacte . Nous enchaénons ensuite avec la démonstration de ses propriétés théoriques. Par ailleurs, nous suggérons deux algorithmes d’interrogation et de régénération, à partir de la représentation . Le premier, intitulé Regenerate, permettant le requétage de cette représentation. Quant au second algorithme, CRPRegeneration, il rends possible la dérivation de tous les motifs corrélés rares à partir de la représentation .
4.2 CRP_Miner : Algorithme d’extraction de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares
Dans cette section, nous introduisons l’algorithme CRP_Miner 111CRP_Miner est l’acronyme de Correlated Rare Patterns_Miner. dédié à l’extraction de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares à partir d’un contexte d’extraction donné. Les notations utilisées dans l’algorithme CRP_Miner sont récapitulées dans la table 4.1.
4.2.1 Description de l’algorithme CRP_Miner
L’ensemble des motifs corrélés rares est extrait gréce à l’algorithme CRP_Miner dont le pseudo-code est donné par l’algorithme 1. En effet, l’ensemble résulte de la conjonction de la contrainte monotone de rareté et de la contrainte anti-monotone de corrélation. Ainsi l’espace de recherche des motifs corrélés rares est délimité d’une part, par les motifs rares parmi l’ensemble des motifs corrélés maximaux (cf. Définition 14) et, d’autre part, par les motifs corrélés parmi l’ensemble des motifs rares minimaux (cf. Définition 11).
| : | Motif de taille . | |
|---|---|---|
| .Conj | : | Support conjonctif du motif . |
| .Disj | : | Support disjonctif du motif . |
| .bond | : | Valeur de mesure de corrélation bond du motif . |
| : | Ensemble des motifs candidats de taille . | |
| : | Ensemble des motifs corrélés rares. | |
| : | Ensemble des motifs corrélés maximaux. | |
| : | Ensemble des motifs corrélés maximaux rares. | |
| : | Ensemble des motifs corrélés maximaux fréquents. |
Toutefois, il est intéressant de signaler que le repérage de la bordure d’un ensemble donné de motifs est un probléme NP-complet, le temps d’exécution des algorithmes de fouille dédiés est toujours élevé [Boley et Gärtner, 2009]. En effet, il n’existe pas un algorithme permettant de résoudre ce probléme en un temps polynomial. Par conséquent, le probléme d’extraction des motifs corrélés rares, localisés entre deux bordures, est un probléme complexe.
À cet égard, nous nous sommes basés sur l’idée d’extraire une des bordures de cet ensemble dans un premier temps puis de dériver le reste des motifs corrélés rares à partir de cette bordure. En effet, les éléments de la bordure formée par les motifs rares minimaux corrélés permet de nous renseigner quant à la nature de fréquence d’un candidat donné. Tout candidat englobant un motif rare minimal corrélé sera un motif rare gréce à la propriété de filtre d’ordre des motifs rares. Cependant, on ne peux rien confirmer quant à sa corrélation. Toutefois, la bordure composée par les motifs corrélés maximaux rares est plus intéressante quant à l’identification des motifs corrélés rares potentiels. En effet, tout candidat inclut dans un motif de l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares est corrélé gréce à la propriété d’idéal d’ordre des motifs corrélés. Ainsi, les candidats seront évalués uniquement par rapport à la contrainte de rareté. Par conséquent, nous jugeons intéressant de récupérer la bordure composée par les motifs corrélés maximaux rares moyennant un algorithme dédié puis de dériver le reste des motifs corrélés rares à partir de cette bordure. Cette idée constitue le fondement de la conception de l’algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares que nous proposons.
Ce dernier prend en entrée une base de transactions , un seuil minimal de support minsupp, ainsi qu’un seuil de corrélation minimale minbond et offre en sortie l’ensemble de tous les motifs corrélés rares munis de leurs supports conjonctifs et de leur valeur de la mesure bond.
L’algorithme CRP_Miner se déroule en trois principales étapes. La premiére consiste à extraire l’ensemble des motifs corrélés maximaux puis à filtrer, par rapport à minsupp, les motifs maximaux corrélés rares et ceux fréquents. Ensuite, l’ensemble des motifs corrélés rares sera initialisé à l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares. La deuxiéme principale étape consiste à extraire les items corrélés rares. Ensuite, la derniére phase correspond à l’extraction des motifs corrélés rares de taille supérieure ou égale à deux.
En effet, les stratégies d’élagage mises en place correspondent à :
(i)
L’élagage de tout candidat non inclu dans un motif corrélé maximal rare, puisqu’il sera non corrélé rare.
(ii)
L’élagage de tout candidat inclu dans un motif corrélé maximal fréquent, puisqu’il sera corrélé fréquent d’aprés la propriété de l’idéal d’ordre des motifs corrélés fréquents.
(iii)
L’élagage par rapport à la propriété de cross support vérifiée par la mesure bond. En effet, tout candidat possédant deux items vérifiant la propriété de cross-support sera élagué puisqu’il est non corrélé. Expliquons à présent le déroulement de chaque étape de l’algorithme CRP_Miner.
4.2.2 Étape 1 : Extraction des motifs corrélés maximaux
Lors de la premiére étape, l’ensemble des motifs corrélés maximaux est récupéré gréce à l’algorithme Algorithme_Extraction_MCMax. Les motifs maximaux corrélés extraits seront filtrés par la contrainte de minsupp. Les motifs rares seront insérés dans l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares et ceux fréquents seront insérés dans l’ensemble des motifs corrélés maximaux fréquents (cf. ligne 1 et ligne 1 de l’algorithme 1). Ensuite, les motifs maximaux corrélés rares seront insérés dans l’ensemble des motifs corrélés rares selon leur taille (cf.ligne 1 de l’algorithme 1).
4.2.3 Étape 2 : Extraction des items corrélés rares
Cette étape consiste à extraire les items corrélés rares. L’ensemble des motifs candidats de taille est composé de l’ensemble de tous les items (cf. ligne 1 de l’algorithme 1). Ensuite, les items rares seront insérés dans l’ensemble des motifs corrélés rares 1 (cf. ligne 1 de l’algorithme 1), puisque la valeur de la mesure bond de tout item est égale à dépassant ainsi tout seuil minimal de bond. L’étape suivante correspond à l’extraction des motifs corrélés rares de taille supérieure ou égale à deux.
4.2.4 Étape 3 : Extraction des motifs corrélés rares de taille supérieure ou égale à deux
Cette étape se réalise moyennant un parcours par niveau du bas vers le haut du treillis et englobe quatre phases, que nous détaillons dans ce qui suit.
(a) La génération des motifs candidats
La premiére phase correspond à la phase de génération des motifs candidats de taille avec est égale à . Étant donné que les motifs corrélés rares ne forment pas un idéal d’ordre. C’est à dire pour un motif corrélé rare de taille , ses sous-ensemble ne sont pas forcément tous corrélés rares.
Plutét, tous ses sous-ensembles doivent étre corrélés.
Ainsi, l’ensemble des motifs candidats de taille sera généré moyennant la phase combinatoire d’Apriori-Gen à partir de l’ensemble des motifs corrélés de taille (cf. ligne 1 de l’algorithme 1).
(b) L’élagage des motifs candidats
L’élagage des motifs candidats se réalise selon deux propriétés. D’abord, l’élagage sera effectué par rapport à la propriété de cross support vérifiée par la mesure bond. Cependant, la vérification de la propriété de cross-support pour un candidat donné est conditionné par la valeur du seuil minbond comme le montre la proposition suivante.
Proposition 9
Désignons d’abord par MinS la plus petite valeur du support conjonctif des items d’un contexte donné, MinS = Supp() , par MaxS la plus grande valeur du support conjonctif des items d’un contexte donné, MaxS = Supp() et par MinR la valeur du rapport entre MinS et MaxS, MinR = . Pour minbond MinR, aucune paire d’items ne vérifie la propriété de cross-support.
Preuve. Soit un contexte d’extraction (). Soient et deux items quelconques de . Nous avons MinS Supp() MaxS et MinS Supp() MaxS. Ainsi, . Puisque, Supp( ) , donc nous avons . Ainsi pour toute paire d’items et , nous avons MinR. Par conséquent, dans le cas oé le seuil minimal de corrélation minbond MinR, nous avons minbond MinR , ainsi minbond .
D’une maniére plus sémantique, nous concluons que si minbond MinR, alors aucune paire d’items ne vérifie la propriété de cross-support traduite par
minbond.
Il est à déduire, d’aprés la proposition précédente, que la vérification de la propriété de cross-support pour un candidat donné ne doit se réaliser que si le seuil minimal de corrélation minbond
est strictement supérieur au rapport MinR.
Dans le cas échéant, tout candidat possédant deux items vérifiant la propriété de cross-support sera élagué [Ben Younes et al., 2010a] puisqu’il est non corrélé
(cf. ligne 1 de l’algorithme 1).
Le deuxiéme critére d’élagage correspond à l’élimination de tout candidat non inclut dans un élément de l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares (cf. ligne 1 de l’algorithme 1). À ce stade, l’ensemble des motifs candidats maintenus sont tous corrélés. Cependant, nous ne pouvons rien déduire quant à la nature de fréquence de ces candidats. En effet, les candidats qui sont inclus dans un élément de l’ensemble des motifs corrélés maximaux fréquents seront fréquents. À cet égard, ses candidats seront élagués, (cf. ligne 1 de l’algorithme 1).
(c) L’évaluation des motifs candidats
L’évaluation des candidats maintenus se réalise par la fonction dédiée (cf. ligne 1 de l’algorithme 1), décrite par l’algorithme 2. Cette fonction est invoquée afin de retourner l’ensemble des motifs corrélés rares de taille . Ensuite, la variable sera incrémentée (cf. ligne 1 de l’algorithme 1) et de nouveaux candidats de taille seront générés à partir des motifs corrélés de taille (cf. ligne 1 de l’algorithme 1). La boucle itérative s’arréte lorsque l’ensemble des motifs candidats est vide (cf. ligne 1 de l’algorithme 1) alors l’algorithme CRP_Miner marque sa fin d’exécution et retourne l’ensemble de tous les motifs corrélés rares (cf. ligne 1 de l’algorithme 1).
Expliquons, à présent, le déroulement de la fonction Calcul_Supports_Bond dont le pseudo code est donné par l’algorithme 2. Cette fonction prend en entrée le contexte d’extraction , le seuil minsupp et l’ensemble des candidats de taille et fournit en sortie l’ensemble n des motifs corrélés rares de taille .
Cette fonction opére de la maniére suivante. D’abord, le contexte d’extraction est parcouru d’une maniére séquentielle. Pour chaque transaction du contexte, nous parcourons l’ensemble de tous les motifs corrélés rares.
Pour chaque candidat de l’ensemble
(cf. ligne 2 de l’algorithme 2), le support conjonctif, le support disjonctif seront mis à jour.
En effet, nous désignons par l’ensemble des items appartenant à une transaction et par l’ensemble des items commun entre et le candidat .
Deux cas sont alors possibles.
(i)
Si contient au moins un seul item du motif candidat
alors le support disjonctif .Disj sera incrémenté
(cf. ligne 2 de l’algorithme 2).
(ii)
Si contient tous les items composant le candidat
alors le support conjonctif .Conj sera incrémenté
(cf. ligne 2 de l’algorithme 2).
Aprés le balayage de tout le contexte, les supports disjonctifs et conjonctifs de tous les candidats sont calculés. L’étape suivante consiste é parcourir l’ensemble des candidats et é vérifier la rareté du candidat en cours (cf. ligne 2 de l’algorithme 2). Dans le cas oé, le candidat en cours est rare alors sa valeur de la mesure bond sera calculée (cf. ligne 2 de l’algorithme 2) et le candidat sera inséré dans l’ensemble n des motifs corrélés rares de taille (cf. ligne 2 de l’algorithme 2). Lorsque tous les candidats sont évalués, la fonction Calcul_Supports_Bond marque sa fin d’exécution et retourne l’ensemble n (cf. ligne 5 de l’algorithme 2) des motifs corrélés rares de taille .
Nous avons ainsi analysé les différentes étapes de l’algorithme CRP_Miner. Nous enchaénons, dans ce qui suit, par la trace d’exécution de cet algorithme appliquée à la base de transaction de la table 1.1.
4.2.5 Trace d’exécution de l’algorithme CRP_Miner
Considérons la base de transactions illustrée par la table 1.1. Pour minsupp = 3 et minbond = 0,20, l’application de l’algorithme CRP_Miner pour l’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares se réalise de la maniére suivante : Initialement, les motifs maximaux sont extraits gréce à l’algorithme Algorithme_Extraction_MCMax, = (ACD, 1, ), (ABCE, 2, ). Étant donné que tous les motifs de l’ensemble sont rares, ils sont donc insérés dans l’ensemble et répartis en fonction de leur taille comme suit. 3 = (ACD, 1, ), 4 = (ABCE, 2, ).
Ensuite, un balayage de la base de transactions est réalisé et l’ensemble des motifs candidats est initialisé,
= A, B, C, D, E.
Le seul item rare est identifié,
1 = (D, 1, ).
L’ensemble des motifs candidats de taille 2 est égal é,
= AB, AC, AD, AE, BC, BE, BD, CE, CD, DE.
Itération 1 :
La propriété de cross-support n’élaguera aucun des candidats de l’ensemble .
Cependant, les candidats BD et DE sont élagués vu qu’ils ne sont inclus dans aucun
motif maximal corrélé rare. Ainsi, nous avons
= AB, AC, AD, AE, BC, BE, CE, CD.
Ensuite, les supports conjonctifs, disjonctifs et les valeurs de mesure bond des candidats retenus sont calculés par la fonction Calcul_Supports_Bond. Ainsi nous distinguons l’ensemble
2 = (AD, 1, ),
(CD, 1, ),
(AB, 2, ),
(AE, 2, ).
La variable sera ensuite incrémentée, = 3 et les candidats de taille trois sont générés.
= ABC, ABD, ABE, ACD,
ACE, ADE, BCD, BCE, CDE.
Itération 2 :
Les candidats ABD, BCD, CDE et ADE sont élagués
puisqu’ils ne sont pas inclus dans un motif corrélé maximal rare.
Toutefois, le motif ABCE appartient à l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares et il est déjé inséré dans l’ensemble , donc il sera élagué.
= ABC, ABE, ACE, BCE.
Pour les candidats retenus, nous calculons
les supports conjonctifs, disjonctifs et la valeur de la mesure bond et nous identifions les motifs corrélés rares suivants,
3 = (ACD, 1, ),
(ABC, 2, ),
(ABE, 2, ),
(ACE, 2, ).
Le déroulement de la boucle itérative se poursuit encore,
la variable sera incrémentée, = 4, et les candidats de taille 4 sont générés.
= ABCD, ACDE, ABCE, ABDE.
Itération 3 :
Lors de cette itération, tous les candidats sont élagués puisqu’ils ne sont pas des sous ensembles stricts d’aucun motif corrélé maximal.
Toutefois, le motif ABCE appartient à l’ensemble des motifs corrélés maximaux rares et il est déjé inséré dans l’ensemble , donc il ne sera pas retraité.
Ensuite la variable sera incrémentée, = 5. L’ensemble des candidats de taille 5 est vide, =
alors l’algorithme marque sa fin d’exécution donnant ainsi comme résultat l’ensemble des motifs corrélés rares.
=
(D, 1, ),
(AD, 1, ),
(AB, 2, ),
(AE, 2, ),
(CD, 1, )
(ACD, 1, ),
(ABC, 2, ),
(ABE, 2, ),
(ACE, 2, ),
(ABCE, 2, ).
Il est à remarquer que dans cet exemple d’exécution de l’algorithme CRP_Miner, aucun candidat généré n’a été élagué par la propriété de cross-support. En effet, nous avons pour cet exemple d’exécution MinS = , MaxS = et MinR = = = . Or, minbond = MinR = 0,25. Ainsi, d’aprés la proposition 9 aucune paire d’items ne vérifie la propriété de cross-support.
Nous avons ainsi présenté et analysé l’algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares. Dans la suite, nous présentons l’algorithme CRPR_Miner d’extraction de la représentation concise exacte .
4.3 CRPR_Miner : Algorithme d’extraction de la représentation concise exacte
Dans cette section, nous nous concentrons uniquement sur l’approche d’extraction de la représentation concise exacte puisque les autres représentations concises exactes , et la représentation concise approximative peuvent y étre facilement dérivées.
À cet égard, nous introduisons l’algorithme CRPR_Miner 222CRPR_Miner est l’acronyme de Correlated Rare Patterns Representation Miner. dédié à l’extraction de la représentation concise exacte . Les notations utilisées dans cet algorithme sont récapitulées dans la table 4.2.
4.3.1 Description de l’algorithme CRPR_Miner
La représentation concise exacte (cf. Définition 24 page 24) composée de l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares et de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares est extraite gréce à l’algorithme CRPR_Miner.
Cet algorithme, dont le pseudo-code est donné par l’algorithme 3, prend en entrée un contexte d’extraction , un seuil minimal de support conjonctif minsupp ainsi qu’un seuil minimal de corrélation minbond. L’algorithme CRPR_Miner permet de déterminer, à partir du contexte , l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares et l’ensemble des motifs fermés corrélés rares munis de leurs supports conjonctifs et de leurs valeurs de mesure bond.
Les stratégies d’élagage des motifs candidats mises en place sont les suivantes :
(i)
L’élagage de tout candidat non inclu dans un motif corrélé maximal rare, puisqu’il sera non corrélé rare.
(ii)
L’élagage de tout candidat inclu dans un motif corrélé maximal fréquent, puisqu’il sera corrélé fréquent d’aprés la propriété de l’idéal d’ordre des motifs corrélés fréquents.
(iii)Élagage par rapport à la propriété de cross-support vérifiée par la mesure de corrélation bond. En effet, tout candidat contenant deux items qui vérifient la propriété de cross-support par rapport au seuil minimal minbond est un motif non corrélé et sera ainsi élagué de l’ensemble des motifs candidats.
(iv) Élagage par rapport à la propriété d’idéal d’ordre des motifs minimaux corrélés. En
effet, les motifs minimaux corrélés vérifient la propriété de l’idéal d’ordre. Ainsi, tout candidat corrélé possédant un sous-ensemble non minimal corrélé, sera non minimal corrélé et il sera ainsi élagué.
| : | Motif de taille . | |
| .Conj | : | Support conjonctif du motif . |
| .Disj | : | Support disjonctif du motif . |
| .bond | : | Valeur de mesure de corrélation bond du motif . |
| . | : | fermé conjonctif du motif . |
| . | : | fermé disjonctif du motif . |
| .CmpDisj | : | Ensemble des items n’appartenant à aucune transaction contenant au |
| moins un item du motif . | ||
| . | : | fermé associé à la mesure bond du motif . |
| : | Ensemble des motifs candidats de taille . | |
| : | Ensemble des motifs maximaux corrélés. | |
| : | Ensemble des motifs maximaux corrélés rares. | |
| : | Ensemble des motifs maximaux corrélés fréquents. | |
| : | Ensemble des motifs minimaux corrélés rares de taille . | |
| : | Ensemble des motifs fermés corrélés rares de taille . |
Nous détaillons dans ce qui suit minutieusement chaque étape de l’algorithme CRPR_-Miner.
4.3.2 Étape 1 : Extraction des motifs corrélés maximaux
Cette premiére étape se réalise d’une maniére similaire à celle de la premiére étape de l’algorithme CRP_Miner. En effet, l’ensemble des motifs corrélés maximaux est récupéré gréce à l’algorithme Algorithme_Extraction_MCMax. Ces derniers seront filtrés par la contrainte de minsupp et insérés selon leur natures dans les ensembles et . Ensuite, les motifs maximaux corrélés rares seront insérés dans l’ensemble des motifs corrélés rares selon leur taille.
4.3.3 Étape 2 : Extraction de tous les motifs minimaux et fermés corrélés rares
La deuxiéme étape consiste à réaliser un parcours par niveau du bas vers le haut du treillis afin d’extraire les motifs minimaux corrélés rares et de calculer leurs fermetures. Premiérement, l’ensemble des motifs candidats de taille est composé de l’ensemble de tous les items (cf. ligne 3 de l’algorithme 3). Ensuite, les items rares seront insérés dans l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares 1 et leurs fermetures seront calculés moyennant la fonction Calcul_Supports_Fermetures (cf. ligne 3 de l’algorithme 3).
La phase de génération de candidats s’effectue d’une maniére similaire à celle de l’algorithme CRP_Miner. Toutefois, l’ensemble des motifs candidats de taille sera généré moyennant la phase combinatoire d’Apriori-Gen à partir de l’ensemble (cf. ligne 3 de l’algorithme 3). Par la suite, les candidats vérifiant la propriété de cross-support seront élagués (cf. ligne 3 de l’algorithme 3). De plus, tout candidat non inclu dans un motif maximal corrélé rare sera élagué (cf. ligne 3 de l’algorithme 3) puisqu’il n’est pas corrélé d’aprés la proposition 3. Ensuite, tout candidat inclu dans un motif corrélé maximal fréquent sera élagué, (cf. ligne 3 de l’algorithme 3). Un autre élagage basé sur la propriété de l’idéal d’ordre des motifs minimaux corrélés est réalisé. En effet, tous les sous-ensembles d’un motif minimal corrélé doivent étre des motifs minimaux corrélés d’aprés la propriété 1. À cet égard, tout candidat de taille possédant un sous-ensemble de taille non minimal corrélé, sera élagué (cf. ligne 3 de l’algorithme 3).
À ce stade, l’ensemble des motifs candidats de taille englobe tous les motifs minimaux corrélés potentiels. L’étape suivante consiste donc à identifier les motifs minimaux corrélés qui sont rares et à calculer leur fermetures par . Ceci est réalisé gréce à la fonction Calcul_Supports_Fermetures(cf. ligne 3 de l’algorithme 3). Cette fonction est invoquée afin d’extraire l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares de taille , de calculer leurs fermetures et mettre à jour l’ensemble des motifs fermés corrélés rares. Ensuite, la variable sera incrémentée et de nouveaux candidats de taille seront générés à partir des motifs corrélés de taille (cf. ligne 3 de l’algorithme 3). La boucle itérative s’arréte lorsque l’ensemble des motifs candidats est vide (cf. ligne 3 de l’algorithme 3) alors l’algorithme CRPR_Miner marque sa fin d’exécution et retourne la représentation concise exacte composée par l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares et de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares (cf. ligne 3 de l’algorithme 3).
Décrivons, à présent, le déroulement de la fonction
Calcul_Supports_Fermetures dont le pseudo code est donné par l’algorithme 4. Cette fonction prend en entrée le contexte d’extraction , le seuil minsupp et l’ensemble de candidats de taille et fournit en sortie l’ensemble
n des motifs minimaux corrélés rares de taille et l’ensemble
des motifs fermés corrélés rares.
Cette fonction opére d’une maniére similaire à la fonction
Calcul_Supports_Bond. De plus du calcul des supports conjonctifs, disjonctifs et la valeur bond, la fonction Calcul_Supports_Fermetures
assure le calcul des fermetures conjonctives, disjonctives et par conséquent la fermeture par des candidats retenus.
À cet égard, le contexte d’extraction est parcouru d’une maniére séquentielle. Pour chaque transaction du contexte, nous désignons par l’ensemble des items appartenant à cette transaction et par l’ensemble des items commun entre et le candidat en cours .
En effet,
Trois cas sont alors possibles.
(i)
Si est vide, autrement dit aucune intersection n’existe entre le motif candidat et la transaction . Alors, le complément de la fermeture disjonctive .CmpDisj, correspond aux items
n’appartenant à aucune transaction contenant au moins un item du candidat ,
reéoit l’ensemble des items
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
(ii)
Si contient au moins un seul item du motif candidat
alors le support disjonctif .Disj sera incrémenté
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
(iii)
Si contient tous les items composant le candidat
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4)
alors le support conjonctif .Conj sera incrémenté
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4)
et la fermeture conjonctive du motif candidat . si elle est vide alors elle sera initialisée à
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4)
sinon elle sera mise à jour
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Aprés le balayage de tout le contexte, les supports disjonctifs, conjonctifs, les fermetures conjonctives et les compléments de la fermeture disjonctive de tous les candidats sont mis à jour.
L’étape suivante consiste à parcourir l’ensemble des candidats maintenus afin d’identifier les motifs minimaux corrélés rares.
Nous testons d’abord la rareté de chaque candidat
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Si le candidat en cours est rare alors nous
calculons sa valeur de la mesure bond
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
et nous procédons à la vérification de sa minimalité.
En effet, d’aprés la définition
19, un motif minimal corrélé ne doit pas étre inclut dans la fermeture de ses sous-ensembles directs. Autrement dit, un motif minimal corrélé ne doit posséder aucun sous-ensemble direct de même valeur de mesure bond que lui
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Dans le cas échéant, le motif candidat est ainsi minimal corrélé rare et sera inséré
dans l’ensemble n des motifs minimaux corrélés rares de taille
(cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Nous calculons, ensuite, son fermé disjonctif . dans la ligne 20. Le fermé ., résultant de l’intersection entre la fermeture conjonctive . et la fermeture disjonctive ., sera ensuite dérivé (cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Les motifs fermés calculés lors de chaque itération seront insérés dans l’ensemble des motifs fermés corrélés rares et répartis selon leur taille. À cet égard, nous sauvegardons la taille de chaque motif fermé, = . (cf. ligne 4 de l’algorithme 4). Par conséquent, chaque motif fermé de taille sera inséré dans l’ensemble l des motifs fermés corrélés rares de taille (cf. ligne 4 de l’algorithme 4). L’ensemble de tous les motifs fermés corrélés rares sera, par la suite, mis à jour (cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
À la fin de l’exécution de la fonction Calcul_Supports_Fermetures, l’ensemble n des motifs minimaux corrélés rares de taille sera extrait et l’ensemble des motifs fermés corrélés rares sera mis à jour (cf. ligne 4 de l’algorithme 4).
Nous avons ainsi analysé les différentes étapes de l’algorithme CRPR_Miner. Nous enchaénons dans ce qui suit par sa trace d’exécution appliquée au contexte d’extraction donné par la table 1.1.
4.3.4 Trace d’exécution de l’algorithme CRPR_Miner
Considérons la base de transactions 1.1 pour minsupp = 3 et minbond = 0,20. En utilisant l’algorithme CRPR_Miner, l’extraction de la représentation se fait de la maniére suivante : Initialement, les motifs maximaux sont récupérés gréce à l’algorithme Algorithme_Extraction_MCMax, = (ACD, 1, ), (ABCE, 2, ). Étant donné que tous les motifs de l’ensemble sont rares, ils seront ainsi tous insérés dans l’ensemble des motifs maximaux corrélés rares, = (ACD, 1, ), (ABCE, 2, ).
Ensuite, la base de transactions est parcourue et l’ensemble des motifs candidats est initialisé,
= A, B, C, D, E.
La fonction Calcul_Supports_Fermetures est ensuite invoquée.
Le seul item rare est identifié,
et il est inséré dans l’ensemble 1 = (D, 1, ).
Nous avons D. = ACD. = D et
D. = D. Le motif fermé D est inséré dans l’ensemble 1,
1 = (D, 1, ).
L’ensemble des motifs candidats de taille 2 est égal é,
= AB, AC, AD, AE, BC, BE, BD, CE, CD, DE.
Alors nous commenéons la premiére itération de l’algorithme.
Itération 1 :
Tous les candidats vérifient la propriété de l’idéal d’ordre des motifs minimaux corrélés. De plus, la propriété de cross-support n’élaguera aucun des candidats de l’ensemble .
Cependant, seuls les candidats BD et DE sont élagués vu qu’ils ne sont inclus dans aucun motif maximal corrélé rare.
Ainsi, nous avons
= AB, AC, AD, AE, BC, BE, CE, CD.
Les supports conjonctifs et disjonctifs des candidats sont calculés.
Pour les candidats rares AB, AD, AE et CD, la valeur de la mesure bond est calculée.
Tous ces candidats sont des motifs minimaux corrélés rares, ainsi ils ont insérés dans
l’ensemble 2.
2 = (AB, 2, ),
(AE, 2, ), (AD, 1, ), (CD, 1, ).
Nous calculons par la suite leurs fermetures et nous avons
4 = (ABCE, 2, ),
3 = (ACD, 1, ),
2 = (AD, 1, ). La variable sera ensuite incrémentée, = 3 et les candidats de taille trois sont générés.
= ABC, ABD, ABE, ACD,
ACE, ADE, BCD, BCE, CDE.
Itération 2 :
Lors de la deuxiéme itération, aucun des candidats générés ne sera élagué par la propriété de cross-support. Cependant, les candidats ABD, BCD, CDE, et ADE sont élagués puisqu’ils ne sont pas inclus dans un motif corrélé maximal rare.
= ABC, ABE, ACD, ACE, BCE. Alors, nous calculons les supports conjonctifs et disjonctifs et la valeur bond pour les candidats rares retenus à savoir (ABC, 2, ), (ACD, 1, ), (ABE, 2, ), (ACE, 2, ). Nous remarquons qu’aucun de ses candidats n’est rare minimal corrélé. En effet, les candidats (ABC, 2, ) et (ABE, 2, ) ont le sous ensemble (AB, 2, ) de même mesure bond qu’eux. Pour le candidat (ACE, 2, ), il est sur-ensemble du motif (AE, 2, ) et ont la même valeur de la mesure bond. Le candidat (ACD, 1, ) posséde le sous-ensemble (CD, 1, ), avec qui il partage la même valeur de la mesure bond. Ainsi l’ensemble 3 est vide, 3= . La variable sera ensuite incrémentée = 4 et l’ensemble des candidats de taille 4 est vide, = alors la boucle itérative marque sa fin d’exécution donnant ainsi comme résultat les motifs minimaux corrélés rares = (D, 1, ), (AB, 2, ), (AE, 2, ), (AD, 1, ), (CD, 1, ) et leurs fermés = (D, 1, ), (AD, 1, ), (ACD, 1, ), (ABCE, 2, ). Les éléments de la représentation concise exacte extraits sont représentés par la table 4.3.
| Type () | Supp() | bond() | Type () | Supp() | bond() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | MMCR et MFCR | 1 | AB | MMCR | 2 | ||
| AD | MMCR et MFCR | 1 | AE | MMCR | 2 | ||
| CD | MMCR | 1 | ABCE | MFCR | 2 | ||
| ACD | MFCR | 1 |
Nous avons ainsi présenté et analysé les différentes étapes de l’algorithme CRPR_Miner d’extraction de la représentation concise exacte . Nous signalons que l’extraction des représentations concises exactes et et de la représentation concise approximative sont possibles moyennant l’algorithme CRPR_Miner. À cet égard, nous détaillons ce point dans ce qui suit.
4.3.5 Extraction de la représentation concise exacte
En effet, la représentation est composée de l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares et de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares maximaux
(cf. Définition 26 page 26).
Or, lors de chaque itération l’algorithme CRPR_Miner permet de mettre à jour l’ensemble des motifs fermés corrélés rares.
Ainsi l’idée consiste à intégrer dans l’algorithme CRPR_Miner l’instruction permettant de filtrer les éléments maximaux de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares générés.
Or, un motif fermé corrélé rare maximal ne doit posséder aucun sur-ensemble corrélé. Á cet égard,
l’extraction des motifs fermés corrélés rares maximaux de taille nécessitent la reconnaissance de leurs sur-ensembles de taille
et seront ainsi extraits pendant l’itération gréce à l’instruction suivante.
n-1 :=
n-1 avec et .bond minbond
4.3.6 Extraction de la représentation concise exacte
Considérons maintenant la représentation concise exacte composée de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares et de l’ensemble des éléments minimaux de l’ensemble des motifs rares (cf. Définition 28 page 28). En effet, l’ensemble est composé des motifs qui sont à la fois minimaux corrélés et rares minimaux. Ces derniers correspondent aux motifs minimaux corrélés dont tous leurs sous ensembles directs sont des motifs fréquents. Par conséquent, nous intégrons l’instruction suivante permettant de filtrer ces motifs à partir de l’ensemble .
:= n , .Conj minsupp
À présent, nous avons introduit et décrit les instructions permettant d’extraire les représentations concises exactes et . Par conséquent, la représentation concise approximative (cf. Définition 29 page 29) résultante de l’union des ensembles et sera aisément dérivée gréce aux deux instructions précédemment décrites.
Nous avons, à ce stade, présenté l’algorithme CRPR_Miner d’extraction de la représentation et introduit les instructions à y intégrer afin d’extraire les autres représentations concises proposées. Dans la suite nous démontrons les propriétés théoriques de l’algorithme CRPR_Miner.
4.3.7 Preuves théoriques
Dans cette section, nous démontrons les propriétés de validité et de terminaison de l’algorithme CRPR_Miner.
Proposition 10
L’algorithme CRPR_Miner génére tous les motifs minimaux et fermés corrélés rares munis de leurs supports conjonctifs et de leurs valeurs de la mesure bond.
Preuve. L’algorithme CRPR_Miner est un algorithme par niveau permettant d’extraire avec exactitude tous les éléments de la représentation concise exacte . En effet, lors du premier parcours de la base de transactions, les items rares sont identifiés séparément. Les items rares constituent les motifs minimaux corrélés rares de taille et leurs fermés par seront calculés d’une maniére exacte. Ensuite les éléments minimaux de l’ensemble des motifs minimaux corrélés rares seront extraits et leurs fermés respectifs seront calculés d’une maniére itérative. En effet, lors de chaque itération, un ensemble de candidats de taille est généré à partir des motifs fréquents de taille . Ces candidats ne doivent contenir aucun sous ensemble rare non corrélé. De plus, ils ne doivent pas englober des items qui vérifient la propriété de cross-support.
Ensuite, les supports conjonctifs, les supports disjonctifs, les fermetures conjonctives et les fermetures disjonctives de tous les candidats seront calculés moyennant un balayage de
la base de transactions. Les candidats fréquents seront sauvegardés dans l’ensemble des motifs fréquents. Cependant, nous calculons la valeur de la mesure bond pour les motifs candidats vérifiant la contrainte monotone de rareté. Dans le cas oé la valeur de bond d’un motif rare dépasse le seuil minimal minbond, alors nous vérifions la minimalité du candidat en cours. En effet, s’il ne posséde aucun sous ensemble direct de même mesure bond que lui, alors le candidat en cours est minimal corrélé rare.
Par conséquent, le motif fermé par correspondant au motif minimal corrélé rare en cours, sera calculé. Il résulte, en effet, de l’intersection entre son fermé conjonctif et son fermé disjonctif.
Étant donné que les supports conjonctifs, disjonctifs et la mesure bond d’un fermé sont égaux à ceux du motif minimal correspondant, alors nous déduisons que les caractéristiques de chaque fermé par l’opérateur de fermeture sont attribués d’une maniére exacte.
La boucle itérative d’extraction des éléments minimaux de l’ensemble et de calcul de leurs fermés respectifs se termine lorsqu’il n’y a plus de motifs candidats à générer. À la fin de cette étape l’ensemble est composé de tous les motifs qui sont minimaux corrélés et rares minimaux à la fois et leurs fermés respectifs sont inclus dans l’ensemble .
L’étape suivante consiste à effectuer un traitement itératif afin de dériver le reste des motifs minimaux corrélés rares à partir des motifs minimaux extraits lors de l’étape précédente et à calculer leurs fermés par .
En effet, lors de chaque itération, un ensemble de candidats de taille est généré à partir des motifs minimaux corrélés rares de taille . Ces candidats sont tous rares puisqu’ils sont des sur-ensembles de motifs rares. Ainsi, ils seront testés par rapport à la propriété de cross support et par rapport à la contrainte anti-monotone des motifs minimaux corrélés. Les candidats rares de taille qui sont minimaux corrélés seront insérés dans l’ensemble n. Par la suite, leurs fermés par seront calculés et insérés dans l’ensemble des motifs fermés corrélés rares. L’algorithme CRPR_Miner marque sa fin d’exécution lorsque l’ensemble de motifs candidats est vide.
Nous concluons que CRPR_Miner permet d’extraire avec exactitude tous les éléments des ensembles et munis de leurs supports conjonctifs et de leurs valeurs de mesure bond exacts. Il est donc correct et complet.
Ainsi, l’ensemble ne contient que les motifs minimaux corrélés rares de taille et l’ensemble ne contient que les fermés corrélés rares de taille .
Proposition 11
L’algorithme CRPR_Miner se termine correctement.
Preuve. Le nombre des motifs générés par CRPR_Miner est fini. En effet, le nombre de motifs candidats pouvant étre générés à partir d’une base de transactions ayant items distincts, est au plus égal à . De plus, le nombre d’opérations effectuées, afin de traiter chaque motif est fini. Par conséquent, l’algorithme CRPR_Miner se termine correctement.
Nous avons, ainsi, prouvé les propriétés théoriques de validité et de terminaison de l’algorithme CRPR_Miner d’extraction de la représentation concise exacte . Dans la section suivante, nous introduisons les algorithmes d’interrogation et de régénération des motifs corrélés rares à partir de la représentation concise exacte .
4.4 Algorithmes d’interrogation et de régénération des motifs corrélés rares à partir de la représentation
Nous introduisons, dans cette section, les deux stratégies de régénération à savoir la régénération d’un seul motif corrélé rare et la régénération de l’ensemble total de tous les motifs corrélés rares à partir de la représentation concise exacte . Les notations utilisées dans les algorithmes de régénération proposés sont introduites dans le tableau 4.4.
| .Conj | : | Support conjonctif du motif . |
| .Disj | : | Support disjonctif du motif . |
| .Neg | : | Support négatif du motif . |
| .bond | : | Valeur de la mesure bond du motif I. |
| : | Fermeture du motif par . |
4.4.1 Interrogation de la représentation concise exacte
Nous introduisons, à présent, l’algorithme Regenerate permettant l’interrogation de la représentation .
-
1.
Un motif .
-
2.
Le nombre de transactions .
-
3.
La représentation = .
Étant donné que nous avons démontré, dans la section précédente, la correction et la complétude de l’algorithme CRPRMiner d’extraction de la représentation . Cette régénération correspond à l’interrogation de la représentation afin de déterminer la nature d’un motif quelconque. Dans le cas oé il s’agit d’un motif corrélé rare, alors ses données (support conjonctif, disjonctif, négatif et la valeur de mesure bond) seront régénérés gréce à la représentation .
Cette opération est achevée gréce à l’algorithme Regenerate dont le pseudo-code est donné par l’algorithme 5.
Ce dernier prend en entrée le nombre de transactions , la représentation composée des ensembles et et le motif en question et fournit en sortie les données
(le support conjonctif, disjonctif, négatif et la valeur de mesure bond) du
motif passé en paramétre si’il est corrélé rare sinon il retourne l’ensemble vide.
Ainsi, afin de vérifier la nature du motif passé en paramétre, trois cas se présentent.
Dans le cas oé, le motif appartient à la représentation
(cf. ligne 5 de l’algorithme 5), alors il est rare corrélé. Nous disposons, alors, de son support conjonctif et de sa valeur de la mesure bond. Quant à son support disjonctif il correspond au rapport de son support conjonctif par la valeur de bond
(cf. ligne 5 de l’algorithme 5)
et son support négatif est extrait à partir de son support disjonctif
(cf. ligne 5 de l’algorithme 5). L’algorithme retourne alors les différents supports du motif ainsi que sa valeur de bond
(cf. ligne 5 de l’algorithme 5).
Le deuxiéme cas se réalise lorsque le motif n’appartient pas à la représentation mais il est compris entre deux éléments de la représentation
(cf. ligne 5). Ainsi, le motif fermé associé à l’itemset
correspond au plus petit, selon l’inclusion ensembliste, sur-ensemble du motif appartenant à la représentation
(cf. ligne 5 de l’algorithme 5). Le motif partage ainsi les mêmes valeurs des différents supports et de bond que son fermé identifié
(cf. ligne 5).
Cependant, lorsque le motif
n’appartient pas à la représentation et il n’est pas compris entre deux éléments de la
représentation alors le motif n’est pas corrélé rare et l’algorithme retourne l’ensemble vide (cf. ligne 5 de l’algorithme 5).
Ainsi nous avons décrit le déroulement de l’algorithme Regenerate, nous enchaénons par la suite avec un exemple d’exécution.
Exemple 46
Considérons la représentation présentée par la table 4.3
et considérons le motif ACE.
En comparant ACE avec les éléments de la représentation , nous remarquons que
AE ACE et ACE ABCE. Ainsi, le motif ACE
est corrélé rare et son fermé est ABCE. Par conséquent,
ACE.Conj = ABCE.Conj = 2,
ACE.Disj = ABCE.Disj = 5,
ACE.Neg = - ACE.Disj = 5 - 5 = 0 et
ACE.bond = ABCE.bond = .
Prenons le cas du motif BC. En effet, BC n’appartient pas à la représentation
et il n’est pas inclu entre deux éléments de la représentations . Ainsi, l’algorithme retourne l’ensemble vide pour indiquer que le motif BC n’est pas un motif corrélé rare.
Dans ce qui suit nous présentons la procédure de régénération de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares é partir de la représentation concise exacte .
4.4.2 Régénération de l’ensemble total de tous les motifs corrélés rares
La régénération de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares à partir de la représentation concise exacte s’effectue gréce à l’algorithme CRP_Regeneration dont le pseudo-code est donné par l’algorithme 6.
Cet algorithme prend en entrée la représentation concise exacte et fournit en sortie l’ensemble des motifs corrélés rares munis de leurs supports conjonctifs et de leurs valeurs de mesure bond. En effet, la procédure de régénération s’effectue de la maniére suivante.
D’abord, tous les éléments de la représentation
seront insérés dans l’ensemble
(cf. ligne 6 de l’algorithme 6). Par la suite,
l’algorithme parcours d’une maniére séquentielle l’ensemble des motifs minimaux et
affecte à chaque minimal son fermé
(cf. ligne 6 de l’algorithme 6).
Puis l’ensemble de motifs compris entre le minimal et son fermé est généré
(cf. ligne 6 de l’algorithme 6).
Chaque élément de cet ensemble est un motif corrélé rare et partage le même support conjonctif et la même valeur
de bond que son fermé et sera inséré, si’il n’existe pas déjé, dans
l’ensemble
(cf. ligne 6 de l’algorithme 6).
Lorsque tous les motifs générés sont insérés dans l’ensemble , alors
l’algorithme marque sa fin et retourne, ainsi, l’ensemble total des motifs corrélés rares
(cf. ligne 6 de l’algorithme 6).
Nous avons ainsi analysé l’algorithme CRP_Regeneration, nous enchaénons dans ce qui suit par la trace d’exécution.
Exemple 47
Reconsidérons la représentation concise exacte donnée par la table 4.3. La régénération de tous les motifs corrélés rares par l’algorithme CRPRegeneration se réalise de la maniére suivante. D’abord, l’ensemble des motifs corrélés rares est initialisé à l’ensemble vide. Ensuite, tous les éléments de la représentation concise exacte seront insérés dans l’ensemble . Ainsi, = (D, 1, ), (AB, 2, ), (AD, 1, ), (AE, 2, ), (CD, 1, ), (ABCE, 2, ), (ACD, 1, ). Par la suite, nous générons les motifs ABE et ABC compris entre le minimal (AB, 2, ) et son fermé (ABCE, 2, ) et le motif ACE compris entre le minimal (AE, 2, ) et son fermé (ABCE, 2, ). Les motifs ABE, ABC et ACE générés auront ainsi le même support conjonctif et la même valeur de bond que leur motif fermé ABCE et seront alors insérés dans l’ensemble . Ce dernier est par conséquent mis à jour et englobe tous les motifs corrélés rares. = (D, 1, ), (AD, 1, ), (CD, 1, ), (ACD, 1, ), (AE, 2, ), (AB, 2, ), (ACE, 2, ), (ABE, 2, ), (ABC, 2, ), (ABCE, 2, ).
4.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble de tous les motifs corrélés rares. Ensuite, nous avons introduit l’algorithme CRPR_Miner permettant d’extraire la représentation concise exacte . Toutefois, la contrainte monotone de rareté et la contrainte anti-monotone de corrélation sont simultanément intégrées dans le processus de fouille offert par l’algorithme CRPR_Miner. Les critéres pertinents de l’élagage des candidats et de l’optimisation de l’espace de recherche ont été soigneusement incorporés dans cet algorithme. Ce chapitre a été cloturé avec la présentation des stratégies d’interrogation et de régénération des motifs corrélés rares à partir de la représentation . Dans le chapitre suivant, nous présenterons les expérimentations réalisées grace aux quelles nous mesurons l’apport bénéfique des représentations concises proposées en terme de taux de réduction et nous étudions également leurs couts d’extractions.
Chapitre 5 Étude expérimentale
5.1 Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avons présenté l’algorithme CRP_Miner d’extraction de l’ensemble des motifs corrélés rares ainsi que l’algorithme CRPR_Miner dédié à l’extraction de la représentation concise exacte basée sur les motifs minimaux et les motifs fermés corrélés rares. Dans ce chapitre, nous présentons les expérimentations faites sur des bases “benchmark”. À cet égard, nous comptabilisons les cardinalités de l’ensemble et des différentes représentations concises proposées. Nous visons à travers ces expérimentations à prouver les taux de compacité offerts par les représentations concises proposées. De plus, nous évaluons les performances de l’algorithme CRPR_Miner et comparons les coéts d’extraction des différentes représentations. Nous décrivons également le processus de classification basé sur les régles associatives de classification et appliqué dans le cadre de la détection d’intrusions.
5.2 Environnement d’expérimentations
L’ensemble des expérimentations présentées dans ce chapitre ont été réalisées sur une machine munie d’un processeur Intel Dual Core avec de mémoire cache, ayant une fréquence d’horloge de et de mémoire vive tournant sur une plateforme Linux Ubuntu . L’ensemble des algorithmes proposés dans le chapitre précédent ont été implantés en langage C++ et les programmes ont été compilés avec le compilateur gcc 4.3.3. Nous commenéons dans la suite par la présentation des expérimentations faites sur des bases de test “benchmark”.
5.3 Évaluation expérimentale pour des bases de test “benchmark”
5.3.1 Description des bases de test
Les expérimentations, que nous exposons dans cette section, ont été menées sur les bases “benchmark” 111Ces bases sont disponibles à l’adresse suivante : http://fimi.cs.helsinki.fi/data. denses Chess, Connect, Mushroom, Pumsb, Pumsb* BMS-Web-View1 et sur les bases éparses Retail, Accidents, T10I4D100K et T40I10D100K. Tous les résultats expérimentaux sont repérés en détail dans les tableaux des annexes. Les caractéristiques des ces différentes bases sont décrites dans le tableau 5.1. Ce tableau décrit pour chaque base, le type, le nombre de transactions, le nombre d’items et la taille moyenne des transactions. Par “Base dense”, nous entendons que les transactions de la base sont fortement corrélées, tandis que, par “Base éparse”, nous entendons que les transactions de la base sont faiblement corrélées.
| Base | Type de | Nombre | Nombre de | Taille moyenne |
|---|---|---|---|---|
| la base | d’items | transactions | des transactions | |
| Chess | Dense | 75 | 3 196 | 37,00 |
| Connect | Dense | 129 | 67 557 | 43,00 |
| Mushroom | Dense | 119 | 8 124 | 23,00 |
| Pumsb | Dense | 7 117 | 49 046 | 74,00 |
| Pumsb* | Dense | 7 117 | 49 046 | 50,00 |
| BMS-Web-View1 | Dense | 497 | 59 602 | 2,51 |
| Retail | Éparse | 16 470 | 88 162 | 10,00 |
| Accidents | Éparse | 468 | 340 183 | 33,81 |
| T10I4D100K | Éparse | 870 | 100 000 | 10,10 |
| T40I10D100K | Éparse | 942 | 100 000 | 39,61 |
Nous enchainons dans la suite avec l’étude quantitative des cardinalités. Cette étude s’étalera sur deux principaux axes et ce suivant la nature de la base considérée. Ainsi, nous distinguons l’étude des cardinalités pour des bases denses et l’étude des cardinalités pour des bases éparses.
5.3.2 Étude des cardinalités pour des bases denses
Étudions d’abord la variation de la taille de l’ensemble en fonction de la variation des seuils minbond et minsupp de corrélation et de fréquence respectifs.
5.3.2.1 Analyse de la variation de la taille de l’ensemble
Lors des expérimentations réalisées, nous avons comptabilisé, d’une part,
la cardinalité de l’ensemble de tous les motifs corrélés
rares et la cardinalité de l’ensemble de tous les motifs corrélés
fréquents pour différentes valeurs des seuils minbond et minsupp.
a. Effet de la variation du seuil minsupp
Nous étudions, dans un premier temps, la variation de la taille de l’ensemble en fonction de la variation de l’ensemble .
Nous concluons d’aprés les résultats donnés par les tableaux A.1 et A.3 de l’annexe A, d’une part, que la taille de l’ensemble varie dans le sens opposé que la taille de l’ensemble qui contient les motifs corrélés qui sont fréquents. Ces derniers correspondent aux motifs corrélés dont le support conjonctif dépasse le seuil minimal minsupp.
Prenons le cas de la base Mushroom pour minbond = 0,15. Pour le seuil minsupp = 5, = 361, = 100 906. Cependant, pour minsupp = 20, le nombre des motifs corrélés rares augmente, = 48 056 alors que le nombre de motifs corrélés fréquents diminue presque de 50, = 53 211.
Pour la base Chess pour minbond = 0,60. Pour le seuil minsupp = 20, = 21, = 255 023. Cependant, pour minsupp = 70, = 206 075 et = 48 969.
Toutefois, nous remarquons que pour un seuil de corrélation minbond fixe, la cardinalité augmente en diminuant le seuil minimal minsupp et diminue en l’augmentant.
Considérons la base Connect pour minbond = 0,80. Pour un seuil minsupp faible, minsupp 20, la taille est égale à 534 012. Cependant, en variant le seuil minsupp de 20 à 86, sa taille diminue significativement et passe é = 105 031.
Nous constatons aussi que, la taille de l’ensemble varie selon la base. Par exemple considérons les seuils minbond = 0,80 et minsupp = 50. Pour la base Connect, nous avons = 91. Cependant, pour ces mêmes seuils de minbond et de minsupp, et pour la base Pumsb, la taille de l’ensemble est beaucoup plus importante, nous notons = 3 521.
Dans ce même sens, nous avons constaté aussi que pour un seuil de corrélation minbond fixe, la taille de l’ensemble est proportionnelle au seuil minimal de fréquence minsupp.
Par exemple, pour le cas de la base Mushroom pour minbond = 0,15. Pour le seuil minsupp = 5, = 361. Cependant, pour minsupp = 20, = 48 056.
De même pour la base Chess et pour minbond = 0,60. Pour le seuil minsupp = 20, = 21. Cependant, pour minsupp = 70 la taille de cet ensemble augmente considérablement et est égale é, = 206 075. Ces résultats expérimentaux obtenus renforcent la propriété théorique relative à la taille de l’ensemble donnée par la proposition 4(cf. page 4).
Toutefois, le nombre de motifs corrélés rares augmente en augmentant le seuil minsupp et diminue dans le cas opposé. Il est aussi important de remarquer que l’augmentation considérable de la taille de l’ensemble des motifs corrélés rares pour un seuil minsupp strictement supérieur au seuil minbond.
Par exemple, pour le cas de la base Mushroom pour minbond = 0,15. Pour le seuil minsupp = 15 nous avons = 3 038, cependant en augmentant légérement minsupp de 5, nous aurons minsupp = 20, = 48 056. Cette constatation est valide aussi pour la base Connect pour minbond = 0,80. En effet, la taille de l’ensemble varie de 171 motifs pour minsupp = 80 é 212 291 motifs pour minsupp = 82.
Toutefois pour les seuils minbond minsupp, les motifs corrélés rares correspondent aux motifs corrélés dont la valeur de corrélation ne dépasse pas le seuil minsupp. D’une maniére formelle, minbond bond () minsupp (cf. proposition 6 de la page 6 ).
Cette variation pertinente de la taille de l’ensemble , s’explique par le fait que la valeur de la corrélation d’une grande tranche de motifs corrélés ne dépasse pas le seuil minsupp.
Par exemple, considérons la base Pumsb pour minbond = 0,80. Pour minsupp = 85, = 125 420. Autrement dit, nous avons 125 420 motifs corrélés dont la valeur de la mesure bond est supérieure ou égale à 0,80 mais ne dépasse pas 0,85. Pour minsupp = 90, = 143 345. Ainsi, nous avons 143 345 motifs corrélés rares, dont la corrélation entre 80 et 90. À cet égard, nous déduisons que seuls 17 925 (correspondant à 143 345 - 125 420) de motifs présentent un degré de corrélation important compris entre 85 et 90.
Il est cependant clair que, pour la base Pumsb*, la taille de l’ensemble ne présente pas une transition aigué lors de la variation du seuil minsupp qu’on a constaté précédemment. En effet, pour minbond = 0,50, pour minsupp = 50, nous avons = 91 546 et en augmentant minsupp de 5, le nombre de motifs corrélés rares est de 91 868. Ainsi, cette augmentation de 322 itemsets uniquement est relativement négligeable par rapport à la variation aigué que présentent les autres bases Pumsb, Chess, Connect et Mushroom.
Quant à la base BMS-Web-View1, elle présente un comportement insensible quant à la variation du seuil
minsupp. En effet, pour un seuil minbond fixé à 0,90, nous remarquons que plus de 99 des motifs corrélés sont rares et leurs supports conjonctifs sont compris entre 1 et 8. En effet, pour minsupp = 1, nous avons 60 002 motifs corrélés rares et uniquement 68 motifs corrélés fréquents et pour minsupp = 8, tous les motifs corrélés sont rares et aucun motif corrélé n’est fréquent, = 60 070 et = 0.
b. Effet de la variation du seuil minbond
Nous étudions, à ce stade pour un seuil minsupp fixe, l’effet de la variation du seuil minbond sur la variation de la taille des ensembles et . Nous nous basons sur les résultats donnés par le tableau A.5 de l’annexe A.
Il nous est clair que la variation de la taille de l’ensemble est disproportionnelle à la variation du seuil minbond. Toutefois, le nombre de motifs corrélés rares augmente en diminuant le seuil minbond et diminue en augmentant minbond. Considérons la base Mushroom pour minsupp = 30. Pour un seuil minbond = 0,25, nous avons = 4 120 et pour minbond = 0,30, nous avons = 674.
Nous remarquons aussi que, la taille de l’ensemble est aussi disproportionnelle à la variation du seuil minbond. Nous avons par exemple, pour la base Pumsb pour minsupp = 80. Le nombre de motifs corrélés fréquents est de 142 156 pour un seuil minbond = 0,80. Ce nombre diminue largement et atteint 20 550 pour une légére augmentation de 5 du seuil minbond.
Nous déduisons donc que la taille des ensembles et varient dans le même sens pour un seuil minsupp fixe. Ceci s’explique par le fait que ces deux ensembles doivent vérifier la contrainte de corrélation minimale et présentent donc des comportements similaires lors de la variation du seuil minimal minbond.
Cependant, nous remarquons pour la base BMS-Web-View1, que tous les motifs corrélés sont rares. Pour un seuil minsupp fixé à 10, nous avons pour minbond = 0,10, = 60 161 et = 0. Une augmentation considérable du seuil minbond de 0,10 à 1, engendre une diminution négligeable de la taille de l’ensemble . En effet, pour minbond = 1, = 60 070 et le nombre de motifs corrélés fréquents est toujours nul. Nous déduisons que, cette base présente une forte insensibilité quant à la variation du seuil minbond.
Nous avons ainsi discuté la variation des cardinalités des ensembles et en fonction de la variation des seuils minbond et minsupp. De plus, nous avons étudié, pour différentes bases, le lien de dépendance entre les tailles de ces deux ensembles.
Dans ce qui suit, nous abordons l’analyse de la cardinalité de la représentation concise exacte .
5.3.2.2 Analyse de la variation de la taille de la représentation
Nous nous focalisons à présent sur l’étude de la cardinalité de la représentation concise exacte . Nous discutons aussi le taux de compacité offert par cette derniére, que nous désignons par Tx-. Ce taux est donné en pourcentage et correspond à la formule suivante : Tx- = 1 - .
En effet, nous avons comptabilisé la taille de la représentation concise . Nous avons tout de même spécifié d’une maniére séparée, afin que l’analyse soit minutieusement établie, la taille des ensembles des motifs minimaux corrélés rares et des motifs fermés corrélés rares. Ces cardinalités sont données par les tableaux A.2, A.4 et A.6 de l’annexe A.
Ces données expérimentaux confirment que la représentation concise exacte est une couverture parfaite de l’ensemble des motifs corrélés rares. En effet, nous pouvons constater que, pour toutes les bases et pour tous les seuils minimaux minsupp et minbond, la taille de la représentation ne dépasse jamais celle de l’ensemble . Par exemple, pour la base Mushroom pour minsupp = 35 et minbond = 0,15, nous avons = 1 810 = 100 156. La taille de la représentation est ainsi réduite par rapport à la taille de l’ensemble et le taux de réduction est ainsi trés important, Tx- = 98. Ceci s’explique par la nature des classes d’équivalence induites dans ce cas. En effet, nous avons = 1 412 et = 652. Comme la représentation correspond à l’union sans redondance des ensembles et , nous avons donc toujours + .
Cependant, nous constatons d’aprés les résultats obtenus que le taux de réduction de la représentation différe selon la base considérée. Par exemple, pour la base Connect et pour minsupp = 80 et minbond = 0,80, le taux de réduction est moyen, Tx- = 35. Cependant, pour la base Chess, pour un seuil minsupp de 70 et un seuil minbond de 0,6, nous avons = 862 et = 206 075. Ainsi le taux de réduction est important, Tx- = 99.
Nous remarquons que pour la base BMS-Web-View1, la taille de la représentation est relativement élevée et égale à la taille de l’ensemble . En effet, nous avons pour minsupp = 10 et minbond = 0,90 : = 60 070 = 60 070. Ceci est dé à la nature des classes d’équivalence induites par l’opérateur . En effet, tous les motifs minimaux sont aussi des fermés dans leurs classes d’équivalence. Par exemple, pour ces mêmes seuils de minsupp et minbond, nous avons = = 60 070 et même en variant le seuil minbond, cela est toujours valide. Nous avons pour minsupp = 10 et minbond = 0,30, = = 60 074. Ceci implique que le taux Tx- offert pour cette base est nul.
Il est a constater aussi que pour toutes les bases et pour tous les seuils de minsupp et de minbond, le nombre de motifs fermés corrélés rares noté ne dépasse jamais le nombre des motifs minimaux corrélés rares noté . Considérons, par exemple la base Pumsb pour minsupp = 30 et minbond = 0,80. Nous avons = 451 = 2 090. Il en est de même pour la base Pumsb*, pour minsupp = 20 et minbond = 0,50 : = 882 = 2 155. Cependant, pour la base Connect, pour minsupp = 20 et minbond = 0,80 : = 70.
Toutefois, ceci s’explique par la nature de l’opérateur de fermeture qui permet de regrouper, dans des classes d’équivalence, les motifs ayant les mêmes caractéristiques. En effet, chaque classe d’équivalence est représentée par un seul motif fermé corrélé et un ou plusieurs minimaux corrélés rares.
Nous avons ainsi présenté et analysé quantitativement la représentation concise exacte .
Nous enchaénons par la suite avec l’analyse et la comparaison des autres représentations concises exactes proposées.
5.3.2.3 Analyse de la variation des tailles des représentations concises exactes
et
Nous nous focalisons à présent sur l’étude des cardinalités des représentations concises exactes et . Nous discutons aussi les taux de compacité offerts par ces derniéres. Nous désignons par Tx- le taux de réduction de la représentation concise exacte et par Tx- le taux de réduction de la représentation concise exacte . Ces taux sont donnés en pourcentage et correspondent é, Tx- = 1 - et Tx- = 1 - .
Toutefois, nous avons comptabilisé les cardinalités de ces représentations. Nous avons aussi spécifié la taille de l’ensemble des éléments minimaux de l’ensemble et la taille de l’ensemble des motifs fermés corrélés rares maximaux. Ces cardinalités sont données par les tableaux A.2, A.4 et A.6 de l’annexe A. Il est à remarquer que les tailles des représentations concises exactes et ne dépassent jamais la taille de la représentation concise exacte .
Par exemple, pour la base Mushroom, pour minsupp = 35 et minbond = 0,15, nous avons = 1 810 = 1 421 = 667. Il en est de même pour la base Pumsb. En effet, pour minsupp = 40 et minbond = 0,80 : = 2 168 = 2 136 = 2 108.
Ces résultats sont justifiés par les définitions mêmes des représentations concises exactes et . En effet, la représentation basée sur l’ensemble des minimaux corrélés rares et sur l’ensemble des motifs fermés corrélés rares maximaux.
Toutefois, nous remarquons que la taille de l’ensemble ne dépasse jamais la taille de l’ensemble . Par exemple, pour la base Pumsb pour minsupp = 30 et pour minbond = 0,80, nous avons = 112 = 451. Par conséquent, nous avons toujours .
Concernant la représentation concise , elle est basée sur l’ensemble des éléments minimaux de l’ensemble et sur l’ensemble des motifs fermés corrélés rares. En effet, nous remarquons que la taille de l’ensemble ne dépasse jamais la taille de l’ensemble . Par exemple, pour la base Mushroom pour minsupp = 40 et pour minbond = 0,15, nous avons : = 98 = 1 491. Pour la base Chess, minsupp = 20 et minbond = 0,60 : = 21. À cet égard, nous déduisons que dans ce cas, la taille de la représentation est égale à la taille de la représentation , .
Toutefois, nous déduisons, d’après les résultats obtenus, que les représentations et offrent d’une manière générale des taux de réduction plus intéressants que la représentation .
Par exemple, la base Mushroom présente des taux de réduction intéressants. Pour minsupp = 10 et minbond = 0,15 : Tx- = 29, Tx- = 48, Tx- = 56.
Ces taux peuvent étre trés proches et des fois égaux, comme le cas de la base Pumsb* pour minsupp = 40 et minbond = 0,65, nous avons Tx- = 84, Tx- = 85 et Tx- = 86.
Il est important de signaler que nous ne pouvons pas affirmer laquelle de ces deux représentations est plus réduite. Toutefois, la représentation la plus concise varie en fonction de la base et des seuils minimaux de corrélation et de fréquence posés. D’ailleurs, pour les exemples considérés précédemment, nous remarquons que la représentation est la plus concise. Cependant, dans d’autres cas c’est la représentation qui offre le plus de réduction. Considérons la base Pumsb pour minbond = 0,80. Nous avons pour minsupp = 10, est inférieure é , = 2 041 alors que = 2 045.
Nous avons ainsi analysé les cardinalités des représentations et par rapport à la représentation . Dans la suite nous nous focalisons sur l’étude de la représentation .
5.3.2.4 Analyse de la cardinalité de la représentation approximative
Nous constatons d’aprés les résultats expérimentaux présentés par les tableaux A.2, A.4 et A.6 de l’annexe A, que pour les différentes bases denses testées et pour tous les seuils de minsupp et de minbond, la taille de la représentation concise approximative ne dépasse pas la taille de la représentation concise exacte ou celle de la représentation concise exacte .
Par exemple, pour la base Mushroom, minsupp = 35 et minbond =
0,15, nous avons = 104
= 667
= 1 421.
Pour la base Connect,
minsupp = 86 et minbond =
0,8 : = 111
= 263
= 395.
Ces résultats sont justifiés par le fait que la représentation concise approximative correspond à l’union sans redondance des ensembles et . Ce qui implique que + . Or + + donc ne dépasse jamais .
De plus, + , donc . Nous déduisons ainsi que la représentation concise approximative est la plus concise.
Désignons par Tx- le taux de réduction de la représentation . Ce taux est donné en pourcentage et correspond é, Tx- = 1 - .
Nous constatons d’après les résultats obtenus que, ce taux diffère d’une base à une autre. Par exemple, la base Mushroom présente des taux de réduction intéressants. Pour minsupp = 5 et minbond = 0,15 : Tx- = 78. La base Pumsb présente des taux de réduction aussi importants. Pour minsupp = 60 et minbond = 0,80 : Tx- = 43. Cependant, la base Connect présente un taux de réduction nul pour minsupp = 50 et minbond = 0,80.
Nous avons ainsi étudié les cardinalités des représentations proposées pour différentes bases denses. Dans ce qui suit, nous nous focalisons sur l’étude des représentations proposées pour des bases éparses.
5.3.3 Étude des cardinalités pour des bases éparses
Dans cette section, nous analysons et comparons les cardinalités de l’ensemble
et des différentes représentations concises proposées pour les bases éparses T10I4D100K, T40I10D100K, Accidents et Retail. Nous soulignons que
nous nous limitons à une récapitulation de l’analyse de la variation des différentes représentations vu que cette variation est similaire à celle pour des bases denses.
5.3.3.1 Effet de la variation du seuil minsupp
En effet, d’aprés les résultats expérimentaux présentés par le tableau A.7 de l’annexe A, nous constatons que la taille de l’ensemble pour les bases éparses est relativement réduite par comparaison à sa taille pour les bases denses. Toutefois, la taille ne dépasse pas 2 703 pour T10I4D100K et 4 703 pour la base T40I10D100K. Ces valeurs réduites sont dues à la nature éparse des bases T40I10D100K et T10I4D100K. Cependant, la taille de l’ensemble est plus importante pour les bases Accidents et Retail. En effet, cet ensemble englobe 29 834 motifs pour la base Retail pour un seuil minsupp de 20 et pour un seuil minbond faible de 0,10. Pour la base Accidents, le nombre de motifs corrélés rares est plus élevé. Nous avons pour minsupp = 50 et minbond = 0,30, = 142 275.
Nous constatons aussi que pour un seuil minbond fixe, la taille de l’ensemble croit en augmentant minsupp. Par exemple, pour la base T40I10D100K, pour minsupp = 5 et minbond 0,10, nous avons = 4 387 et pour minsupp = 30 et minbond = 0,10, nous avons = 4 703.
Il est à remarquer aussi, que la taille de l’ensemble varie légèrement pour une variation importante du seuil minsupp pour les bases T40I10D100K, T10I4D100K et Retail. Cependant la base Accidents, présente un comportement différent. En effet, elle assure une meilleure sensibilité quant au seuil minsupp. Par exemple, pour minbond = 0,30 nous avons pour minsupp = 40, = 117 805 et pour minsupp = 50 nous avons = 142 275.
Analysons à présent les cardinalités des différentes représentations proposées en se basant sur les résultats donnés par le tableau A.8 de l’annexe A.
Nous constatons que les cardinalités des différentes représentations sont presque stables pour chacune des trois bases T10I4D100K, T40I10D100K et Retail. Par conséquent, les taux de réduction de ces représentations ne présentent pas une variation marquante. Prenons l’exemple de la base Retail pour un seuil minbond fixe à 0,15. Nous avons pour minsupp = 5, = 19 791 et = 18 898. Ainsi nous avons les taux suivants, Tx- = 13 et Tx- = 9. En augmentant le seuil minsupp 0 50, nous aurons = 19 802 et = 18 909. Ainsi, les taux demeurent toujours constants, Tx- = 13 et Tx- = 9.
Il est aussi remarquable que les cardinalités des différentes représentations sont relativement plus variable pour la base Accidents. En effet, une petite augmentation du seuil minsupp engendre une augmentation considérable des cardinalités des différentes bases.
Par exemple, pour un seuil minbond fixe à 0,30.
Nous avons pour minsupp = 30,
= 686 et = 614.
Ainsi nous avons les taux suivants, Tx- = 12 et
Tx- = 22.
En augmentant le seuil minsupp de 10, nous aurons
= 1 722 et = 754.
Ainsi les taux augmentent, Tx- = 98 et
Tx- = 99.
5.3.3.2 Effet de la variation du seuil minbond
Nous nous basons dans cette partie sur les résultats expérimentaux donnés par les tableaux A.9 et A.10 de l’annexe A.
Nous constatons, pour toutes les bases éparses, qu’en augmentant le seuil minbond pour un seuil fixe de minsupp, la taille de l’ensemble diminue. Par exemple, considérons la base T40I10D100K pour minsupp = 25. Pour minbond = 0,05, nous avons = 40 533. En augmentant minbond de 0,50 uniquement, la taille décroét presque de 90, nous avons pour minbond = 0,10, = 4 702.
L’augmentation du seuil minbond engendre aussi une diminution des cardinalités des différentes représentations proposées. Par conséquent, les taux de réduction se dégradent. Considérons, par exemple la base Accidents pour minsupp = 50. Pour minbond = 0,20, nous avons Tx- = 100. Ce taux diminue progressivement, pour minbond = 0,30, nous avons Tx- = 98 et pour minbond = 0,40, nous avons Tx- = 95.
Par opposition à la base Accidents, les bases éparses T10I4D100K, T40I10D100K et Retail présentent toujours des taux de réduction stables même pour une variation importante du seuil minbond.
Par exemple, la base T40I10D100K, pour minsupp = 25 et minbond = 0,15 : Tx- = 1, Tx- = 8, Tx- = 9 et Tx- = 38. Ces valeurs sont trés proches pour la base T10I4D100K. Pour minsupp = 25 et minbond = 0,15 : Tx- = 1, Tx- = 8, Tx- = 9 et Tx- = 40.
Nous remarquons aussi que pour une même base de données, les taux Tx- et Tx- sont plus intéressants que le taux Tx-. Le taux Tx- est dans la majorité des cas plus élevé que les deux taux précédents.
Considérons par exemple la base Retail pour minsupp = 20. Pour minbond = 0,10, nous avons Tx- = 26, Tx- = 31, Tx- = 31 et Tx- = 45.
Nous avons ainsi analysé les cardinalités et les taux de réduction des représentations proposées pour différentes bases “benchmark”. Dans ce qui suit, nous étudions les performances de l’algorithme CRPR_Miner. Nous soulignons que nous présentons uniquement les temps d’extraction des différentes représentations concises proposées afin de comparer ces différents couts d’extraction.
5.4 Étude des temps d’extraction des représentations concises proposées
Nous notons que nous nous limitons à l’étude des temps d’extraction uniquement pour les deux bases denses Mushroom et Pumsb et pour la base éparse T40I10D100K. Ceci est justifié par le fait que les coûts d’extraction pour les différentes bases évaluées présentent des variations similaires. En effet, nous constatons d’après les résultats obtenus, que pour une base donnée, les temps d’extraction des différentes représentations concises proposées sont proches. Nous désignons par Tps-, Tps-, Tps- et par Tps- les temps d’extraction des représentations , , et respectivement.
Nous remarquons que les temps d’extraction diminuent avec l’augmentation de minbond et augmentent avec l’augmentation de minsupp étant donné que les tailles des différentes représentations varient dans ce sens aussi. Considérons par exemple la base Pumsb pour un seuil fixe minsupp = 10 et pour minbond = 0,10, nous avons Tps- = Tps- = Tps- = Tps- = 1 627 secondes. Cette durée d’extraction diminue en augmentant le seuil minbond de 0,10, nous avons ainsi Tps- = Tps- = Tps- = Tps- = 385 secondes. Nous constatons aussi que les coéts d’extraction des différentes représentations pour les bases Mushroom et Pumsb sont plus élevés que ceux de la base T40I10D100K. Ceci s’explique par le fait que toutes les représentations proposées présentent des cardinalités plus élevées pour les bases denses que pour les bases éparses et le coét d’extraction de la représentation est proportionnelle à sa taille en nombre de motifs. Autrement dit, plus la taille de la représentation est élevé plus son extraction est coéteuse. Nous affirmons ainsi le compromis existant entre le taux de réduction offert par une représentation concise donnée et son coét d’extraction. Dans ce qui suit, nous proposons une application de la représentation concise exacte dans le cadre de la détection d’intrusions.
5.5 Application de la représentation concise exacte dans le cadre de la détection d’intrusions
Dans cette section nous présentons le processus d’application de la représentation concise exacte sur des données réelles de détection d’intrusions. Décrivons d’abord les bases de données utilisées.
5.5.1 Description des bases de données
Les expérimentations ont été menées sur des bases de données de détection d’intrusions Darpa 1998 222Ces bases sont disponibles dans l’adresse suivante : http://www.ll.mit.edu/mission /communications/ist/corpora/ideval/data/1998data.html.. Nous nous sommes principalement basés sur la description de ces bases présentée dans [Brahmi, 2008]. Toutefois, ces bases de données sont issues du trafic réseau Darpa 1998 (Defense Advanced Research Projects Agency) et sont orientées détection d’intrusion. Dans chaque base de données, chaque ligne (ou connexion) code un flot de données (entre deux instants définis) entre une source et une destination (identifiée chacune par son adresse IP) sous un protocole donné (TCP, UDP). Chaque connexion est caractérisée par dix attributs que nous listons dans la table 5.2.
Les bases de données Darpa 1998 recensent 35 types d’attaques. Ces derniéres sont groupées en quatre catégories. Ces catégories sont décrites dans [Ben Amor et al., 2006] comme suit.
Le déni de service (DOS) : Les attaques de type déni de service (Denial of service). Il s’agit d’empécher les utilisateurs légitimes d’un service de l’utiliser.
Comme exemples d’attaque DOS, nous citons “Neptune”, “Smurf”, “Apache2” et “Pod”.
Les attaques de reconnaissance (Probing) : Ces actions ne sont pas destructrices. En effet, elles permettent d’acquérir des informations importantes afin de mener plutard une vraie attaque.
Un exemple d’outils de reconnaissance est “Satan” (Security Administrator Tool for Analyzing Networks) qui est un analyseur de ports TCP/IP et effectue la recherche des failles de sécurité et les défauts de configuration courants.
Les attaques de type Remote to Local Access (R2L) : Ce type d’attaque consiste à exploiter la vulnérabilité du systéme afin de contréler la machine distante. Comme exemple de ce type d’attaques, il y a les attaques qui visent les failles des protocoles IMAP (Internet Message Acess Protocol), nous citons aussi “Httptunnel” et “Perl”.
Les attaques de type User to Root (U2R) : Ce type d’attaque se réalise lorsque l’attaquant
essaie d’avoir les droits d’accés à partir d’un poste afin d’accéder au systéme. Comme exemple de ce type d’attaques, nous citons Rootkit, Ftpwrite, Guesspasswd et Guest. Les différentes attaques appartenant à chacune de ces catégories sont présentées dans [Ben Amor et al., 2006].
5.5.2 Description du processus de traitement des bases de détection d’intrusion
Nous proposons une application de la représentation concise exacte proposée dans le cadre de la détection d’intrusions. Nous décrivons à cet égard la démarche suivie depuis l’extraction de la représentation concise jusqu’à l’étape de la classification basée sur les règles d’association corrélées rares. Ce processus est donné par la figure 5.1 et se réalise en cinq principales phases :
| : | Identifiant de la connexion. | |
| : | Date de la connexion. | |
| : | Instant de début de la connexion. | |
| : | Instant de fin de la connexion. | |
| : | Service. | |
| : | Adresse source de port. | |
| : | Adresse destination de port. | |
| : | Adresse source. | |
| : | Adresse destination. | |
| : | Label de la connexion. |
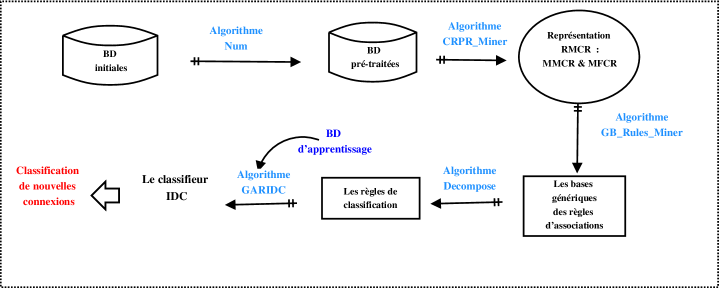
Étape 1 : Pré-traitement des bases de données
Nous recourons à l’algorithme Num [Brahmi, 2008] afin
de pré-traiter les données en les transformant en des données énumératives ordonnées. Par exemple, la discrétisation de l’attribut “Service” http, ftp, tcpmux, private, http correspond à : 1, 2, 3, 4, 1. Les caractéristiques des bases pré-traitées sont décrites dans la table 5.3.
| Base | Nombre | Nombre de | Taille des |
|---|---|---|---|
| d’items | transactions | transactions | |
| Dos | 30 128 | 212 774 | 6 |
| Probe | 24 353 | 18 018 | 6 |
| Normal | 12 743 | 59 481 | 6 |
| U2R | 329 | 466 | 6 |
| R2L | 1 294 | 1 289 | 6 |
Étape 2 : Extraction de la représentation concise exacte
Ces bases pré-traitées sont communiquées à l’algorithme CRPR_Miner afin d’extraire la représentation concise exacte . Les motifs minimaux et les motifs fermés corrélés rares sont identifiés d’une maniére séparée. Nous désignons par - l’ensemble des motifs fermés corrélés rares qui ne sont pas des minimaux. Ces itemsets seront utilisés plutard dans la phase de génération des régles génériques. Les résultats des expérimentations menées sur les différentes bases utilisées sont donnés par la table 5.4.
| Base | Minsupp() | Minbond | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos | 20 | 0,80 | 31 208 | 30 133 | 815 | 801 |
| Probe | 50 | 0,70 | 39 688 | 25 546 | 4 835 | 3 097 |
| Normal | 60 | 0,60 | 12 910 | 12 763 | 4 664 | 51 |
| R2L | 60 | 0,60 | 1 404 | 1 308 | 200 | 54 |
| U2R | 60 | 0,60 | 434 | 348 | 101 | 45 |
Étape 3 : Extraction des régles d’association génériques
Cette étape consiste à extraire les régles d’association génériques à partir des ensembles et - précédement identifiés. Désignons par un motif minimal et par un motif fermé corrélé rare, toutes les régles d’association de la forme seront extraites gréce à l’algorithme GBRulesMiner. Cet algorithme prend en entrée les ensembles et et offre en sortie toutes les régles d’association à prémisse minimale et à conclusion maximale (en terme de nombre d’items) munie chacune de la valeur de son support et de sa confiance.
Les régles exactes, ayant une valeur de la confiance égale à forment
la base générique des régles exactes, tandis que les régles approximatives, ayant une valeur de la confiance inférieure à forment la base informative des régles approximatives. Toutefois, l’extraction des régles génériques a été motivé par les avantages que présentent ces derniéres en terme de compacité et d’informativité [Brahmi, 2008]. Ces régles étant génériques, elles permettent de convoyer le maximum d’informations. Nous proposons un exemple dans ce qui suit.
R1 : service = http port-source = 35.
R2 : service = tcpmux et port-destination = 80 attaque = Neptune.
R3 : protocole = tcp attaque = Dos.
R4 : service = private et IP-destination = 209.051.071.32 IP-source = 172.016.118.48.
R5 : port-destination = 80 attaque = Neptune.
Étape 4 : Génération des régles associatives de classification
Cette étape consiste à générer les régles de classification à partir des
régles associatives génériques moyennant l’algorithme Decompose [Brahmi et al., 2008].
En effet, cet algorithme permet de filtrer les régles associatives générées lors de la phase précédente afin de ne garder que les régles les plus intéressantes c.-é.-d. celles ayant le label de la classe dans la partie conclusion. En effet, les régles retenues seront encore filtrées afin de ne garder que les régles de classification ayant la prémisse la plus minimale. Ce genre de régles est plus générique et supporte plus de connexions de la base de données. À la fin de cette phase, les régles maintenues correspondent aux régles dont la conclusion englobe la classe voulue et la prémisse est la plus minimale.
Par exemple, parmi les régles R1, R2, R3, R4 et R5 précédemement proposées, seules les régles R2, R3 et R5 seront maintenues.
R2 : service = tcpmux et protocole = udp et port-destination = 80 attaque = Neptune.
R3 : protocole = tcp attaque = Dos.
R5 : port-destination = 80 et protocole = udp attaque = Neptune.
Nous remarquons que les régles R2 et R5 ont la même conclusion (attaque = Neptune) et que la prémisse de la régle R5 est plus minimale que celle de R2. Ainsi, la régle R5 est plus générique que R2, elle sera gardée alors que la régle R2 sera supprimée.
Étape 5 : Construction du classifieur à partir des régles génériques de classification
Cette phase consiste à constuire le classifieur IDC à partir des régles génériques de classification moyennant l’algorithme GARIDC [Brahmi et al., 2008]. En effet,
l’ensemble des régles génériques de classification et la base de données d’apprentissage seront communiqués à l’algorithme GARIDC afin d’alimenter le classifieur.
À cet égard, l’ensemble d’apprentissage est parcouru d’une maniére séquentielle et pour chaque connexion nous sélectionons la premiére régle qui couvre cette connexion.
Autrement dit, la régle dont la prémisse est incluse ou égale aux attributs de la connexion courante et dont la conclusion est égale à l’étiquette de la connexion courante sera ajoutée au classifieur IDC. À la fin de cette étape, le classifieur englobe toutes les régles qui couvrent toute la base d’apprentissage.
Étape 6 : Classification de nouvelles connexions
La phase de la classification de nouvelles attaques consiste à affecter à une nouvelle connexion la classe de l’attaque qui lui est associée. En effet, les régles de classification dont la prémisse est incluse dans la connexion seront extraites. Ensuite, le score de chacune de ces régles sera calculé [Brahmi, 2008] en fonction des valeurs des mesures du support et du lift. La classe attribuée à la connexion correspond à la conclusion de la régle présentant la valeur maximale du score. Par exemple, désignons par une nouvelle connexion, : port-destination = 80 et protocole = udp et IP-source = 010.200.030.040. En considérant les régles R3 et R5 extraites lors de la quatriéme phase, la classe Neptune sera affectée à la connexion .
5.5.3 Évaluation expérimentale de l’efficacité de la classification basée sur les régles d’association corrélées rares
Nous évaluons à présent expérimentalement l’efficacité de la classification basée sur les régles génériques de classification corrélées rares. Les résultats des expérimentations menées sur les différentes bases sont décrites par la table 5.5 et 5.6.
| Base | Minsupp() | Minconf | Nombre de régles | Nombre de régles | Nombre de régles |
|---|---|---|---|---|---|
| génériques | génériques | génériques | |||
| exactes | approximatives | de classification | |||
| Dos | 20 | 0,80 | 1 601 | 6 | 5 |
| Probe | 50 | 0,60 | 8 514 | 201 | 7 |
| Normal | 60 | 0,90 | 105 | 17 | 2 |
| R2L | 60 | 0,70 | 111 | 15 | 4 |
| U2R | 60 | 0,80 | 95 | 11 | 7 |
Nous constatons d’aprés les résultats donnés par la table 5.5 que, le nombre de régles génériques de clasification est plus réduit que le nombre des régles génériques approximatives et exactes. Toutefois, les régles d’association génériques peuvent englober des régles inutiles et non porteuses d’informations. À cet égard, seules les régles intéressantes et qui contribuent à l’amélioration de la téche de classification seront maintenues.
| Base | Taux de détection TD() | Taux de fausses alarmes TFA() |
|---|---|---|
| Dos | 98,99 | 1,00 |
| Probe | 88,01 | 11,98 |
| Normal | 100,00 | 0,00 |
| R2L | 88,05 | 11,94 |
| U2R | 90,12 | 9,87 |
La table 5.6 présente les taux de détection ainsi que les taux de fausses alarmes. Le taux de détection est équivalent au pourcentage de classifications correctes (PCC) et est défini ainsi, PCC = avec correspond au nombre d’instances correctement classées et correspond au nombre total d’instances classées. Tandis que le taux de fausses alarmes (TFA) est défini ainsi, TFA = avec correspond au nombre d’instances mal classées.
Nous constatons d’aprés les résultats donnés par la table 5.6 que les taux de détection de vraies attaques sont intéressants et les taux de fausses alarmes sont faibles pour les cinq catégories de connexions et pour les différentes seuils de minsupp et de minconf. Nous présentons dans ce qui suit une comparaison entre les taux de détection fournis par les régles génériques corrélées rares de classification et les différentes approches de la littérature.
Il est clair d’aprés les résultats donnés par la table 5.7 que les taux offerts par les régles génériques corrélées rares sont plus intéressants que ceux des régles génériques fréquentes pour les bases Dos, Probe et R2L. Toutefois, pour les bases Normal et U2R les régles génériques fréquentes présentent les mêmes taux de précision que les régles corrélées rares.
Nous remarquons aussi que la classification basée sur la base IGB des régles fréquentes [Brahmi et al., 2008] présente des taux de précision trés proches des taux fournis par les régles corrélées rares pour les classes Normal, Dos et U2R. Ces régles fréquentes ont été générées à partir des bases de données Darpa 1998 et différent de notre approche dans le choix des régles à extraire.
Au cas oé nous faisons abstraction des conditions d’expérimentations et nous nous limitons aux taux de détection pour chacune des classes d’attaques, les résultats obtenus dans nos expérimentations sont globalement meilleurs que ceux des approches proposées dans [Farid et al., 2010] et dans [Ben Amor et al., 2006]. Ces approches traitent la base de données Kdd 1999. En particulier, notre approche présente de meilleurs résultats que l’approche proposée dans [Farid et al., 2010] pour les classes d’attaques Normal et Dos. Pour les approches discutées dans [Ben Amor et al., 2006], nos résultats sont plus intéressants pour les classes d’attaques U2R, R2L, Normal et DOS.
| Base | Les régles | Les régles | La base IGB |
|---|---|---|---|
| génériques | génériques | des régles fréquentes | |
| corrélées rares | fréquentes | [Brahmi et al., 2008] | |
| Dos | 98,99 | 98,60 | 99,28 |
| Probe | 88,01 | 68,20 | 99,66 |
| Normal | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2L | 88,05 | 88,00 | 98,99 |
| U2R | 90,12 | 90,12 | 91,41 |
Nous présentons aussi le taux de détection moyen offert par l’approche Wifi Miner [Rahman et al., 2008]. Cette derniére est basée sur les motifs rares pour la détection d’intrusions dans les réseaux informatiques sans fil. Nous constatons d’aprés les résultats donnés par la table 5.8, que le taux moyen de détection assuré par les régles corrélées rares est plus intéressant que celui de l’approche Wifi Miner. Nous concluons ainsi que les régles génériques corrélées rares constituent un outil de classification efficace dans le cadre de la détection d’intrusions dans les réseaux informatiques.
| Les régles génériques | L’approche Wifi Miner | |
|---|---|---|
| corrélées rares | [Rahman et al., 2008] | |
| Taux moyen | 93,03 | 86,00 |
| de détection TD() | ||
| Taux moyen | 06,95 | 14,00 |
| de fausses alarmes TFA() |
5.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons mené une étude expérimentale des deux algorithmes CRP_Miner et CRPR_Miner sur des bases “benchmark” communément utilisées. Nous avons prouvé expérimentalement que les représentations proposées permettent de réduire considérablement le nombre de motifs corrélés rares générés. Nous avons par la suite effectué la génération des régles d’association de classification à partir de ces représentations. La classification basée sur ces régles corrélées rares a présenté de bons résultats et a prouvé l’utilité des représentations concises extraites dans le cadre de la détection d’intrusions.
Conclusion générale
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la fouille des motifs corrélés rares associés à la mesure bond. Ces motifs résultent de la conjonction de deux contraintes de types opposés, à savoir la contrainte anti-monotone de la corrélation et la contrainte monotone de la rareté. Cette nature opposée des contraintes traitées dans ce travail rend complexe la localisation de l’ensemble des motifs corrélés rares. Cet ensemble se différe ainsi de l’ensemble des motifs induit par une ou plusieurs contraintes de même type. Cette caractéristique constitue la principale originalité de notre contribution. À cet égard, nous avons proposé, dans ce mémoire, une caractérisation de cet ensemble moyennant la notion de classe d’équivalence et nous avons proposé de nouvelles représentations concises de cet ensemble. En effet, nous avons entamé ce mémoire avec la présentation des notions préliminaires relatives aux motifs rares et aux motifs corrélés selon la mesure bond. Nous avons tout de même décrit les spécificités des classes d’équivalence induites par l’opérateur de fermeture associé à la mesure bond. Ensuite, nous avons étudié les différentes approches de la littérature traitant de l’extraction des motifs rares ainsi que les approches traitant la problématique de la fouille des motifs corrélés sous contraintes. Nous avons, par la suite, enchaéné avec l’analyse et la critique des approches génériques d’extraction des motifs sous la conjonction de contraintes de types opposés. Une revue profonde des approches réductrices des motifs extraits a été également présentée.
Dans ce sens, nous avons défini rigoureusement l’ensemble des motifs rares corrélés selon la mesure bond. Nous avons étudié profondément ses propriétés spécifiques. Par la suite, nous nous sommes basés sur les éléments minimaux et maximaux des classes d’équivalence corrélées rares, afin d’introduire de nouvelles représentations concises des motifs corrélés rares. En effet, nous avons proposé les représentations concises exactes , et ainsi que la représentation concise approximative . Une étude minutieuse des propriétés théoriques de ces approches a été également menée. Toutefois, ces représentations permettent d’une part de réduire significativement le nombre de motifs corrélés rares extraits. Elles améliorent aussi leur qualité et ce en évitant la redondance entre les motifs puisqu’elles ne maintiennent qu’un sous-ensemble sans perte d’information de l’ensemble total des motifs corrélés rares. D’autre part, elles assurent la régénération aisée et efficace de l’ensemble des motifs corrélés rares. Nous avons présenté également l’approche CRP_Miner d’extraction de l’ensemble total des motifs corrélés rares et l’approche CRPR_Miner d’extraction des différentes représentations concises proposées. Nous avons aussi démontré les propriétés théoriques de validité, de complétude et de terminaison de l’algorithme CRPR_Miner et calculé sa complexité théorique. Par ailleurs, nous avons décrit les deux stratégies de régénération à partir de la représentation concise exacte . À cet égard, nous avons suggéré l’algorithme Regenerate, permettant l’interrogation de cette représentation ainsi que l’algorithme CRPRegeneration permettant la dérivation de tous les motifs corrélés rares à partir de la représentation . Nous avons prouvé, gréce aux expérimentations réalisées sur différentes bases de test, l’apport bénéfique en terme de compacité des différentes représentations concises proposées. Nous avons effectué la génération des régles d’association de classification à partir de ces représentations. La classification basée sur ces régles corrélées rares a présenté des résultats intéressants et a prouvé l’utilité des représentations concises extraites dans le cadre de la détection d’intrusions.
Les perspectives de travaux futurs concernent :
-
—
L’extraction et l’application dans des cas réels des formes généralisées de régles d’association présentant des conjonctions, des disjonctions, et des négations d’items corrélés rares en prémisse ou en conclusion. Dans cette situation, les représentations proposées offrent l’information concernant les différents supports d’un motif en plus de sa mesure bond.
-
—
L’extension de l’approche proposée dans ce travail pour les motifs corrélés rares selon toute autre mesure de corrélation vérifiant les mêmes propriétés que la mesure bond, telle que la mesure all-confidence [Omiecinski, 2003] par exemple. L’évaluation sur la base d’une application réelle de la qualité des motifs corrélés rares associés à chacune de ces mesures est alors une perspective intéressante.
-
—
L’optimisation des algorithmes proposés et la comparaison de leurs performances avec celles des algorithmes de la littérature.
Références
- [Adda et al., 2007] Adda, M., Wu, L. et Feng, Y. (2007). Rare itemset mining. In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2007), Cincinnati, Ohio, USA, pages 73–80.
- [Agrawal et Srikant, 1994] Agrawal, R. et Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules in large databases. In Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 1994), Santiago, Chile, pages 487–499.
- [Ayouni et al., 2010] Ayouni, S., Laurent, A., Ben Yahia, S. et Poncelet, P. (2010). Mining closed gradual patterns. In International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC) (1), pages 267–274. Springer.
- [Ben Amor et al., 2006] Ben Amor, N., Benferhat, S. et Elouedi, Z. (2006). Rèseaux bayésiens naïfs et arbres de décision dans les systèmes de détection d’intrusions. Technique et Science Informatiques, pages 167–196.
- [Ben Younes et Hamrouni, 2010] Ben Younes, N. et Hamrouni, T. (2010). Une revue critique des mesures et algorithmes d’extraction des motifs corrélés de l’état de l’art. Dans la 10 Colloque Africain sur la Recherche en Informatique et en Mathématiques Appliquées (CARI 2010), Yamoussoukro, Cote d’Ivoire, pages 397–404.
- [Ben Younes et al., 2010a] Ben Younes, N., Hamrouni, T. et Ben Yahia, S. (2010a). Bridging conjunctive and disjunctive search spaces for mining a new concise and exact representation of correlated patterns. In Proceedings of the 13th International Conference Discovery Science (DS 2010), LNCS, volume 6332, Springer-Verlag, Canberra, Australia, pages 189–204.
- [Ben Younes et al., 2010b] Ben Younes, N., Hamrouni, T. et Ben Yahia, S. (2010b). Extraction efficace d’une nouvelle représentation concise des motifs corrélés à travers la mesure bond. In 12 Conférence Francophone sur l’Apprentissage Automatique (CAp 2010), Clermont-Ferrand, France, pages 317–320.
- [Berberidis et Vlahavas, 2007] Berberidis, C. et Vlahavas, I. P. (2007). Detection and prediction of rare events in transaction databases. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 16(5):829–848.
- [Boley et Gärtner, 2009] Boley, M. et Gärtner, T. (2009). On the complexity of constraint-based theory extraction. In Proceedings of the 12th International Conference Discovery Science (DS 2009), LNCS, volume 5808, Springer-Verlag, Porto, Portugal, pages 92–106.
- [Bonchi et al., 2003] Bonchi, F., Giannotti, F., Mazzanti, A. et Pedreschi, D. (2003). Adaptive constraint pushing in frequent pattern mining. In Proceedings of the 7th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases,(PKDD 2003), Cavtat-Dubrovnik, Croatia, pages 47–58.
- [Bonchi et al., 2005] Bonchi, F., Giannotti, F., Mazzanti, A. et Pedreschi, D. (2005). Efficient breadth-first mining of frequent pattern with monotone constraints. Knowledge and Information Systems, 8(2):131–153.
- [Bonchi et Lucchese, 2006] Bonchi, F. et Lucchese, C. (2006). On condensed representations of constrained frequent patterns. Knowledge and Information Systems, 9(2):180–201.
- [Booker, 2009] Booker, Q. E. (2009). Improving identity resolution in criminal justice data: An application of NORA and SUDA. Journal of Information Assurance and Security, 4:403–411.
- [Bouasker et al., 2011] Bouasker, S., Hamrouni, T. et Ben Yahia, S. (2011). Motifs corrélés rares : caractérisation et nouvelles représentations concises exactes. A paraitre dans le Numéro spécial de la RNTI: Qualité des Données et des Connaissances / Évaluation des m éthodes d’Extraction de Connaissances dans les Données.
- [Boulicaut et Jeudy, 2000] Boulicaut, J. F. et Jeudy, B. (2000). Using constraints during frequent set mining: Should we prune or not ? In Actes des 16èmes Journées Bases de Données Avancées, (BDA 2000), Blois, France, pages 221–237.
- [Boulicaut et Jeudy, 2001] Boulicaut, J.-F. et Jeudy, B. (2001). Mining free itemsets under constraints. In Proceedings of the 5th International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS 01), IEEE Computer Society Press, Grenoble, France, pages 322–329.
- [Boulicaut et Jeudy, 2010] Boulicaut, J.-F. et Jeudy, B. (2010). Constraint-based data mining. In Data Mining and Knowledge Discovery Handbook (2nd edition), Springer, pages 339–354.
- [Brahmi, 2008] Brahmi, I. (2008). Détection d’intrusions dans les réseaux informatiques avec les règles génériques de classification.
- [Brahmi et al., 2010] Brahmi, I., Ben Yahia, S. et Poncelet, P. (2010). MAD-IDS: novel intrusion detection system using mobile agents and data mining approaches. In Pacific-Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics (PAISI), pages 73–76. Springer.
- [Brahmi et al., 2008] Brahmi, I., Ben Yahia, S. et Slimani, Y. (2008). Ids-garc : Détection d’intrusions baséé sur les régles associatives génériques de classification. Dans le Colloque Africain sur la Recherche en Informatique et en Mathématiques Appliquées (CARI 2008), Rabat, Maroc.
- [Brin et al., 1997] Brin, S., Motwani, R. et Silverstein, C. (1997). Beyond market baskets: generalizing association rules to correlations. In Proceedings of the ACM-SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD 1997), Washington D. C., USA, pages 265–276.
- [Bucila et al., 2003] Bucila, C., Gehrke, J., Kifer, D. et White, W. M. (2003). DualMiner: A dual-pruning algorithm for itemsets with constraints. Data Mining knowledge Discovery, 7(3):241–272.
- [Calders et Goethals, 2007] Calders, T. et Goethals, B. (2007). Non-derivable itemset mining. Data Mining and Knowledge Discovery, 14(1):171–206.
- [Calders et al., 2005] Calders, T., Rigotti, C. et Boulicaut, J.-F. (2005). A survey on condensed representations for frequent sets. In Constraint Based Mining and Inductive Databases, LNAI, volume 3848, Springer-Verlag, pages 64–80.
- [Casali et al., 2005] Casali, A., Cicchetti, R. et Lakhal, L. (2005). Essential patterns: A perfect cover of frequent patterns. In Proceedings of the 7th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (DaWaK 2005), LNCS, volume 3589, Springer-Verlag, Copenhagen, Denmark, pages 428–437.
- [Cohen et al., 2000] Cohen, E., Datar, M., Fujiwara, S., Gionis, A., Indyk, P., R.Motwani, Ullman, J. D. et Yang, C. (2000). Finding interesting associations without support pruning. In Proceedings of the 16th International Conference on Data Engineering (ICDE 2000), IEEE Computer Society Press, San Diego, California, USA, pages 489–499.
- [De Raedt et al., 2002] De Raedt, L., Jaeger, M., Lee, S. D. et Mannila, H. (2002). A theory of inductive query answering. In Proceedings of the 2nd International Conference on Data Mining (ICDM 2002), IEEE Computer Society Press, Maebashi City, Japan, pages 123–130.
- [El-Hajj et Zaïane, 2004] El-Hajj, M. et Zaïane, O. R. (2004). Cofi approach for mining frequent itemsets revisited. In Proceedings of the 9th ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery, (DMKD 2004), Paris, France, June 2004.
- [El-Hajj et Zaïane, 2005] El-Hajj, M. et Zaïane, O. R. (2005). Mining with constraints by pruning and avoiding ineffectual processing. In Proceedings of the 18th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence (AI 2005), LNCS, volume 3809, Springer-Verlag, Sydney, Australia, pages 1001–1004.
- [El-Hajj et al., 2005] El-Hajj, M., Zaïane, O. R. et P.Nalos (2005). Bifold constraint-based mining by simultaneous monotone and anti-monotone checking. In Proceedings of the IEEE 2005 International Conference on Data Mining, Houston, Texas., pages 1001–1004.
- [Farid et al., 2010] Farid, M., Harbi, N., Bahri, E., Rahman, M. et Rahman, C. (2010). Attacks classification in adaptive intrusion detection using decision tree. In Proceedings of the International Conference on Computer Science (ICCS’10), Rio De Janeiro, Brazil.
- [Galambos et Simonelli, 2000] Galambos, J. et Simonelli, I. (2000). Bonferroni-type inequalities with applications. Springer.
- [Ganter et Wille, 1999] Ganter, B. et Wille, R. (1999). Formal Concept Analysis. Springer.
- [Gasmi et al., 2007] Gasmi, G., Ben Yahia, S., Nguifo, E. M. et Bouker, S. (2007). Extraction of association rules based on literalsets. In International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (DaWaK), pages 293–302. Springer.
- [Grahne et al., 2000] Grahne, G., Lakshmanan, L. V. S. et Wang, X. (2000). Efficient mining of constrained correlated sets. In Proceedings of the 16th International Conference on Data Engineering (ICDE 2000), IEEE Computer Society Press, San Diego, California, USA, pages 512–521.
- [Haglin et Manning, 2007] Haglin, D. J. et Manning, A. M. (2007). On minimal infrequent itemset mining. In Proceedings of the International Conference on Data Mining (DMIN 2007), Las Vegas, Nevada, USA, pages 141–147.
- [Hamrouni et al., 2011] Hamrouni, T., Ben Chaabene, S. et Ben Yahia, S. (2011). Réduire pour mieux exploiter : représentations concises et exactes des motifs rares. In Actes du 7 Atelier Qualité des Données et des Connaissances, en conjonction avec la 11 Conférence Internationale Francophone Extraction et Gestion des Connaissances (EGC 2011), 25 - 28 Janvier, Brest, France, pages 1–12.
- [Hamrouni et al., 2008] Hamrouni, T., Ben Yahia, S. et Mephu Nguifo, E. (2008). Succinct minimal generators: Theoretical foundations and applications. International journal of foundations of computer science, 19(02):271–296.
- [Hamrouni et al., 2009] Hamrouni, T., Ben Yahia, S. et Mephu Nguifo, E. (2009). Sweeping the disjunctive search space towards mining new exact concise representations of frequent itemsets. Data & Knowledge Engineering, 68(10):1091–1111.
- [Hamrouni et al., 2010] Hamrouni, T., Ben Yahia, S. et Mephu Nguifo, E. (2010). Generalization of association rules through disjunction. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 59(2):201–222.
- [He et Xu, 2005] He, Z. et Xu, X. (2005). Fp-outlier: Frequent pattern based outlier detection. Computer Science Information System, 2(1):103–118.
- [Hu et Li, 2009] Hu, J. et Li, X. (2009). Association rules mining including weak-support modes using novel measures. WSEAS Transactions on Computer, 8:559–568.
- [Huynh et al., 2005] Huynh, X., Guillet, F. et Briand, H. (2005). Une plateforme exploratoire pour la qualité des régles d’association : Apport pour l’analyse implicative. In Proceedings de la 3 Rencontre Internationale Analyse Statistique Implicative 2005, pages 339–349.
- [Jaccard, 1901] Jaccard, P. (1901). étude comparative de la distribution orale dans une portion des Alpes et des Jura. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 37:547–579.
- [Kim et al., 2004] Kim, W. Y., Lee, Y. K. et Han, J. (2004). CCMine: efficient mining of confidence-closed correlated patterns. In Proceedings of the 8th International Pacific-Asia Conference on Knowledge Data Discovery (PAKDD 2004), Sydney, Australie, pages 569–579.
- [Kiran et Reddy, 2010] Kiran, R. U. et Reddy, P. K. (2010). Mining rare association rules in the datasets with widely varying items’ frequencies. In Proceedings of the 15th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2010), LNCS, volume 5981, Springer-Verlag, Tsukuba, Japan, pages 49–62.
- [Koh et Rountree, 2005] Koh, Y. et Rountree, N. (2005). Finding sporadic rules using Apriori-Inverse. In Proceedings of the 9th Pacific-Asia Conference on Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Hanoi, Vietnam, May, 2005, volume 3518 of Lecture Notes in Computer Science, volume 3518, pages 97–106.
- [Koh et Rountree, 2010] Koh, Y. S. et Rountree, N. (2010). Rare Association Rule Mining and Knowledge Discovery: Technologies for Infrequent and Critical Event Detection. IGI Global Publisher.
- [Lee et De Raedt, 2004] Lee, S. D. et De Raedt, L. (2004). An efficient algorithm for mining string databases under constraints. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Knowledge Discovery in Inductive Databases (KDID 2004), LNCS, volume 3377, Springer-Verlag, Pisa, Italy, pages 108–129.
- [Lee et al., 2003] Lee, Y. K., Kim, W. Y., Cai, Y. D. et Han, J. (2003). CoMine: efficient mining of correlated patterns. In Proceedings of the 3rd International Conference on Data Mining (ICDM 2003), IEEE Computer Society Press, Melbourne, Florida, USA, pages 581–584.
- [Lei et al., 2003] Lei, J., Renqing, P. et Dingyu, P. (2003). Tough constraint-based frequent closed itemsets mining. In Proceedings of the 18th Symposium on Applied Computing (SAC 03), ACM Press, New York, USA, pages 416–420.
- [Liu et al., 1999] Liu, B., Hsu, W. et Y.Ma (1999). Mining association rules with multiple minimum supports. In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD -99), August, 1999, San Diego, CA, USA.
- [Ma et Hellerstein, 2001] Ma, S. et Hellerstein, J. L. (2001). Mining mutually dependent patterns. In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2001), San Jose, California, USA, pages 409–406.
- [Mahmood et al., 2010] Mahmood, A. N., Hu, J., Tari, Z. et Leckie, C. (2010). Critical infrastructure protection: Resource efficient sampling to improve detection of less frequent patterns in network traffic. Journal of Network and Computer Applications, 33(4):491–502.
- [Mannila et Toivonen, 1997] Mannila, H. et Toivonen, H. (1997). Levelwise search and borders of theories in knowledge discovery. Data Mining and Knowledge Discovery, 3(1):241–258.
- [Manning et al., 2008] Manning, A. M., Haglin, D. J. et Keane, J. A. (2008). A recursive search algorithm for statistical disclosure assessment. Data Mining and Knowledge Discovery, 16(2):165–196.
- [Okubo et Haraguchi, 2010] Okubo, Y. et Haraguchi, M. (2010). An algorithm for extracting rare concepts with concise intents. In Proceedings of the 8th International Conference on Formal Concept Analysis (ICFCA 2010), LNCS, volume 5986, Springer-Verlag, Agadir, Morocco, pages 145–160.
- [Okubo et al., 2010] Okubo, Y., Haraguchi, M. et Nakajima, T. (2010). Finding rare patterns with weak correlation constraint. In Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW 2010), Sydney, Australia, December 2010, pages 822–829.
- [Omiecinski, 2003] Omiecinski, E. (2003). Alternative interest measures for mining associations in databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 15(1):57–69.
- [Ben Othman et Ben Yahia, 2008] Ben Othman, L. B. et Ben Yahia, S. (2008). Yet another approach for completing missing values. In Concept Lattices and Their Applications, pages 155–169. Springer.
- [Padmanabhan et Tuzhilin, 2006] Padmanabhan, B. et Tuzhilin, A. (2006). On characterization and discovery of minimal unexpected patterns in rule discovery. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 18(2):202–216.
- [Pasquier et al., 2005] Pasquier, N., Bastide, Y., Taouil, R., Stumme, G. et Lakhal, L. (2005). Generating a condensed representation for association rules. Intelligent Information Systems, 24(1):25–60.
- [Pei et Han, 2004] Pei, J. et Han, J. (2004). Constrained frequent pattern mining: a pattern-growth view. ACM-SIGKDD Explorations, 4(1):31–39.
- [Rahman et al., 2008] Rahman, A., Ezeife, C. et Aggarwal, A. (2008). Wifi miner: An online apriori-infrequent based wireless intrusion system. In Proceedings of the second international Workshop on Knowledge Discovery from Sensor Data, (Sensor-KDD 2008), Las Vegas, USA.
- [Roberto et Bayardo, 1998] Roberto, J. et Bayardo, J. (1998). Efficiently mining long patterns from databases. In Proceedings of the 1998 ACM-SIGMOD International Conference on Management of Data, pages 85–93.
- [Romero et al., 2010] Romero, C., Romero, J. R., Luna, J. M. et Ventura, S. (2010). Mining rare association rules from e-learning data. In Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Data Mining (EDM 2010), Pittsburgh, PA, USA, pages 171–180.
- [Sandler et Thomo, 2010] Sandler, I. et Thomo, A. (2010). Mining frequent highly-correlated item-pairs at very low support levels. In Proceedings of the SDM’10 Workshop on High Performance Analytics - Algorithms, Implementations, and Applications (PHPA’10), Columbus, Ohio, USA.
- [Segond et Borgelt, 2011] Segond, M. et Borgelt, C. (2011). Item set mining based on cover similarity. In Proceedings of the 15th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2011), Shenzhen, China (À paraétre, accessible à http://www.borgelt.net/papers/pakdd_11.pdf).
- [Surana et al., 2010] Surana, A., Kiran, R. U. et Reddy, P. K. (2010). Selecting a right interestingness measure for rare association rules. In Proceedings of the 16th International Conference on Management of Data (COMAD 2010), Nagpur, India, pages 115–124.
- [Szathmary, 2006] Szathmary, L. (2006). Méthodes symboliques de fouille de données avec la plate-forme Coron. Ph.D. Thesis, École Doctorale IAEM Lorraine, Université Henri Poincaré Nancy 1, France.
- [Szathmary et al., 2006] Szathmary, L., Maumus, S., Petronin, P., Toussaint, Y. et Napoli, A. (2006). Vers l’extraction de motifs rares. In Actes des 6èmes journées Extraction et Gestion des Connaissances (EGC 2006), RNTI, Cépaduès-Éditions, Lille, France, pages 499–510.
- [Szathmary et al., 2007] Szathmary, L., Napoli, A. et Valtchev, P. (2007). Towards rare itemset mining. In Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2007), IEEE Computer Society, 2007, Patras, Greece, Volume 1, pages 305–312.
- [Szathmary et al., 2010] Szathmary, L., Valtchev, P. et Napoli, A. (2010). Generating rare association rules using the minimal rare itemsets family. International Journal of Software and Informatics, 4(3):219–238.
- [Taniar et al., 2008] Taniar, D., Rahayu, W., Lee, V. et Daly, O. (2008). Exception rules in association rule mining. Applied Mathematics and Computation, 205(2):735–750.
- [Tanimoto, 1958] Tanimoto, T. T. (1958). An elementary mathematical theory of classification and prediction. Technical Report, I.B.M. Corporation Report.
- [Weiss, 2004] Weiss, G. M. (2004). Mining with rarity: A unifying framework. ACM-SIGKDD Explorations, 6(1):7–19.
- [Xiong et al., 2004] Xiong, H., Shekhar, S., Tan, P.-N. et Kumar, V. (2004). Exploiting a support-based upper bound of pearson’s correlation coefficient for efficiently identifying strongly correlated pairs. In Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2004), Seattle, WA, USA, pages 334–343.
- [Xiong et al., 2006] Xiong, H., Tan, P. N. et Kumar, V. (2006). Hyperclique pattern discovery. Data Mining and Knowledge Discovery., 13(2):219–242.
- [Yun et al., 2003] Yun, H., Ha, D., Hwang, B. et Ryu, K. (2003). Mining association rules on significant rare data using relative support. The Journal of Systems and Software, 67:181–191.
Annexe
Annexe A Tableaux des résultats expérimentaux
Dans cet annexe, nous présentons les résultats obtenus suite aux différentes expérimentations réalisées dans l’objectif de comparer les cardinalités des différents ensembles et représentations proposés dans ce travail.
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | || | || |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushroom | 5 | 0,15 | 361 | 100 906 | 205 | 167 | 49 | 29 |
| 10 | 0,15 | 913 | 100 354 | 451 | 386 | 73 | 33 | |
| 15 | 0,15 | 3038 | 98 229 | 709 | 558 | 85 | 15 | |
| 20 | 0,15 | 48 056 | 53 211 | 974 | 578 | 92 | 8 | |
| 25 | 0,15 | 95 876 | 5 391 | 1 223 | 624 | 85 | 9 | |
| 30 | 0,15 | 98 566 | 2 701 | 1 318 | 633 | 91 | 9 | |
| 35 | 0,15 | 100 156 | 1 111 | 1 412 | 652 | 95 | 9 | |
| 40 | 0,15 | 100 736 | 531 | 1 491 | 648 | 98 | 9 | |
| 45 | 0,15 | 100 960 | 307 | 1 574 | 670 | 102 | 9 | |
| 50 | 0,15 | 101 114 | 153 | 1 616 | 684 | 106 | 9 | |
| 55 | 0,15 | 101 170 | 97 | 1 639 | 694 | 109 | 9 | |
| 60 | 0,15 | 101 216 | 51 | 1 657 | 702 | 111 | 9 | |
| Chess | 10 | 0,60 | 14 | 255 030 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 20 | 0,60 | 21 | 255 023 | 21 | 21 | 21 | 19 | |
| 30 | 0,60 | 25 | 255 019 | 25 | 25 | 25 | 22 | |
| 40 | 0,60 | 35 | 255 009 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
| 50 | 0,60 | 40 | 255 004 | 40 | 40 | 38 | 30 | |
| 60 | 0,60 | 94 | 254 950 | 86 | 86 | 41 | 22 | |
| 70 | 0,60 | 206 075 | 48 969 | 739 | 188 | 51 | 7 | |
| 80 | 0,60 | 246 762 | 8 282 | 1 135 | 280 | 55 | 7 | |
| 90 | 0,60 | 254 416 | 628 | 1 359 | 355 | 62 | 7 | |
| 95 | 0,60 | 254 966 | 78 | 1 424 | 389 | 66 | 7 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | |
| Mushroom | 5 | 0,15 | 361 | 255 | 220 | 184 | 78 |
| 10 | 0,15 | 913 | 650 | 478 | 406 | 106 | |
| 15 | 0,15 | 3 038 | 1 061 | 724 | 587 | 100 | |
| 20 | 0,15 | 48 056 | 1 300 | 982 | 608 | 100 | |
| 25 | 0,15 | 95 876 | 1 621 | 1 232 | 640 | 94 | |
| 30 | 0,15 | 98 566 | 1 704 | 1 327 | 648 | 100 | |
| 35 | 0,15 | 100 156 | 1 810 | 1 421 | 667 | 104 | |
| 40 | 0,15 | 10 0736 | 1 890 | 1 500 | 663 | 107 | |
| 45 | 0,15 | 100 960 | 1 985 | 1 583 | 685 | 111 | |
| 50 | 0,15 | 101 114 | 2 043 | 1 625 | 699 | 115 | |
| 55 | 0,15 | 101 170 | 2 076 | 1 648 | 709 | 118 | |
| 60 | 0,15 | 101 216 | 2 099 | 1 666 | 717 | 120 | |
| Chess | 10 | 0,60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 0,60 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 30 | 0,60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 40 | 0,60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 50 | 0,60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | |
| 60 | 0,60 | 94 | 94 | 92 | 86 | 61 | |
| 70 | 0,60 | 206 075 | 862 | 746 | 188 | 58 | |
| 80 | 0,60 | 246 762 | 1 355 | 1 142 | 280 | 62 | |
| 90 | 0,60 | 254 416 | 1 648 | 1 366 | 355 | 69 | |
| 95 | 0,60 | 254 966 | 1 742 | 1 431 | 389 | 73 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | || | || |
| Pumsb | 10 | 0,80 | 2 052 | 143 091 | 1 993 | 787 | 1 978 | 302 |
| 20 | 0,80 | 2 077 | 143 876 | 2 018 | 812 | 2 002 | 304 | |
| 30 | 0,80 | 3 260 | 142 693 | 2 090 | 451 | 2 028 | 112 | |
| 40 | 0,80 | 3 395 | 142 558 | 2 126 | 403 | 2 042 | 20 | |
| 50 | 0,80 | 3 521 | 142 432 | 2 181 | 412 | 2 061 | 19 | |
| 60 | 0,80 | 3 655 | 142 298 | 2 208 | 361 | 2 074 | 20 | |
| 70 | 0,80 | 3 736 | 142 217 | 2 240 | 386 | 2 079 | 21 | |
| 80 | 0,80 | 3 797 | 142 156 | 2 270 | 411 | 2 088 | 10 | |
| 85 | 0,80 | 125 420 | 20 533 | 2 498 | 486 | 2 089 | 6 | |
| 90 | 0,80 | 143 345 | 2 608 | 2 754 | 539 | 2 093 | 6 | |
| Connect | 10 | 0,80 | 56 | 534 026 | 56 | 56 | 56 | 38 |
| 20 | 0,80 | 70 | 534 012 | 70 | 70 | 70 | 45 | |
| 30 | 0,80 | 83 | 533 999 | 83 | 83 | 83 | 54 | |
| 40 | 0,80 | 88 | 533 994 | 88 | 88 | 88 | 55 | |
| 50 | 0,80 | 91 | 533 991 | 91 | 91 | 91 | 57 | |
| 60 | 0,80 | 93 | 533 989 | 93 | 93 | 93 | 58 | |
| 70 | 0,80 | 99 | 533 983 | 99 | 99 | 99 | 59 | |
| 80 | 0,80 | 171 | 533 911 | 108 | 108 | 101 | 25 | |
| 82 | 0,80 | 212 291 | 321 791 | 223 | 128 | 103 | 6 | |
| 86 | 0,80 | 429 051 | 105 031 | 389 | 158 | 105 | 6 | |
| 90 | 0,80 | 506 975 | 27 107 | 548 | 184 | 108 | 6 | |
| Pumsb* | 5 | 0,50 | 2 087 | 90 086 | 2 020 | 1 082 | 1 942 | 64 |
| 10 | 0,50 | 2 126 | 90 047 | 2 057 | 845 | 1 987 | 64 | |
| 15 | 0,50 | 3 690 | 88 483 | 2 105 | 871 | 1 994 | 28 | |
| 20 | 0,50 | 11 524 | 80 649 | 2 155 | 882 | 2 002 | 1 | |
| 25 | 0,50 | 62 641 | 29 532 | 2 451 | 530 | 2 020 | 1 | |
| 30 | 0,50 | 64 967 | 27 206 | 2 517 | 579 | 2 028 | 1 | |
| 35 | 0,50 | 65 936 | 26 237 | 2 600 | 657 | 2 033 | 1 | |
| 40 | 0,50 | 82 413 | 9 760 | 2 805 | 579 | 2 042 | 2 | |
| 45 | 0,50 | 90 712 | 1 461 | 3 051 | 710 | 2 050 | 2 | |
| 50 | 0,50 | 91 546 | 627 | 3 156 | 700 | 2 062 | 2 | |
| 55 | 0,50 | 91 868 | 305 | 3 206 | 686 | 2 069 | 2 | |
| 60 | 0,50 | 92 006 | 167 | 3 237 | 683 | 2 074 | 2 | |
| BMS-Web- | 1 | 0,90 | 60 002 | 68 | 60 002 | 60 002 | 60 002 | 53 366 |
| View1 | ||||||||
| 2 | 0,90 | 60 049 | 21 | 60 049 | 60 049 | 60 049 | 53 366 | |
| 4 | 0,90 | 60 065 | 5 | 60 065 | 60 065 | 60 065 | 53 366 | |
| 6 | 0,90 | 60 067 | 3 | 60 067 | 60 067 | 60 067 | 53 366 | |
| 8 | 0,90 | 60 070 | 0 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 53 366 | |
| 10 | 0,90 | 60 070 | 0 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 53 366 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | |
| Pumsb | 10 | 0,80 | 2 052 | 2 045 | 2 041 | 2 045 | 2 036 |
| 20 | 0,80 | 2 077 | 2 070 | 2 066 | 2 070 | 2 061 | |
| 30 | 0,80 | 3 260 | 2 126 | 2 110 | 2 083 | 2 055 | |
| 40 | 0,80 | 3 395 | 2 168 | 2 136 | 2 108 | 2 054 | |
| 50 | 0,80 | 3 521 | 2 240 | 2 192 | 2 149 | 2 074 | |
| 60 | 0,80 | 3 655 | 2 267 | 2 220 | 2 162 | 2 088 | |
| 70 | 0,80 | 3 736 | 2 315 | 2 253 | 2 187 | 2 094 | |
| 80 | 0,80 | 3 797 | 2 354 | 2 280 | 2 212 | 2 098 | |
| 85 | 0,80 | 125 420 | 2 665 | 2 504 | 2 287 | 2 095 | |
| 90 | 0,80 | 143 345 | 2 985 | 2 760 | 2 342 | 2 099 | |
| Connect | 10 | 0,80 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 20 | 0,80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 30 | 0,80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 40 | 0,80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 50 | 0,80 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 60 | 0,80 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 70 | 0,80 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 80 | 0,80 | 171 | 111 | 111 | 111 | 104 | |
| 82 | 0,80 | 212 291 | 224 | 229 | 231 | 109 | |
| 86 | 0,80 | 429 051 | 437 | 395 | 263 | 111 | |
| 90 | 0,80 | 506 975 | 620 | 554 | 292 | 114 | |
| Pumsb* | 5 | 0,80 | 2 087 | 2 074 | 2 037 | 2 064 | 1 973 |
| 10 | 0,80 | 2 126 | 2 113 | 2 074 | 2 103 | 2 018 | |
| 15 | 0,80 | 3 690 | 2 167 | 2 111 | 2 129 | 2 009 | |
| 20 | 0,80 | 11 524 | 2 230 | 2 156 | 2 140 | 2 003 | |
| 25 | 0,80 | 62 641 | 2 548 | 2 452 | 2 162 | 2 021 | |
| 30 | 0,80 | 64 967 | 2 652 | 2 518 | 2 211 | 2 029 | |
| 35 | 0,80 | 65 936 | 2 801 | 2 601 | 2 289 | 2 034 | |
| 40 | 0,80 | 82 413 | 3 012 | 2 807 | 2 302 | 2 044 | |
| 45 | 0,80 | 90 712 | 3 369 | 3 053 | 2 421 | 2 054 | |
| 50 | 0,80 | 91 546 | 3 473 | 3 158 | 2 437 | 2 064 | |
| 55 | 0,80 | 91 868 | 3 552 | 3 208 | 2 471 | 2 071 | |
| 60 | 0,80 | 92 006 | 3 589 | 3 239 | 2 484 | 2 076 | |
| BMS-Web- | 1 | 0,90 | 60 002 | 60 002 | 60 002 | 60 002 | 60 002 |
| View1 | |||||||
| 2 | 0,90 | 60 049 | 60 049 | 60 049 | 60 049 | 60 049 | |
| 4 | 0,90 | 60 065 | 60 065 | 60 065 | 60 065 | 60 065 | |
| 6 | 0,90 | 60 067 | 60 067 | 60 067 | 60 067 | 60 067 | |
| 8 | 0,90 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | |
| 10 | 0,90 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | || | || |
| Mushroom | 30 | 0,10 | 578 359 | 2 701 | 1 798 | 700 | 91 | 6 |
| 30 | 0,15 | 98 566 | 2 701 | 1 318 | 633 | 91 | 9 | |
| 30 | 0,20 | 52 237 | 2 701 | 917 | 522 | 91 | 14 | |
| 30 | 0,25 | 4 120 | 2 701 | 611 | 448 | 91 | 30 | |
| 30 | 0,30 | 674 | 2 701 | 382 | 322 | 91 | 28 | |
| 30 | 0,35 | 319 | 1 258 | 240 | 230 | 91 | 31 | |
| 30 | 0,40 | 223 | 635 | 176 | 162 | 91 | 20 | |
| 30 | 0,50 | 167 | 204 | 135 | 120 | 91 | 18 | |
| 30 | 0,60 | 134 | 83 | 105 | 92 | 91 | 22 | |
| 30 | 0,70 | 126 | 56 | 97 | 84 | 91 | 22 | |
| 30 | 0,80 | 123 | 47 | 94 | 81 | 91 | 23 | |
| 30 | 0,90 | 122 | 34 | 93 | 80 | 91 | 32 | |
| 30 | 1 | 119 | 28 | 91 | 79 | 91 | 32 | |
| Pumsb | 80 | 0,75 | 536 153 | 142 194 | 2 127 | 461 | 2 028 | 2 |
| 80 | 0,80 | 3 797 | 142 156 | 2 270 | 411 | 2 088 | 10 | |
| 80 | 0,85 | 2 987 | 20 550 | 2 197 | 375 | 2 088 | 24 | |
| 80 | 0,90 | 2 760 | 2 634 | 2 148 | 350 | 2 088 | 58 | |
| 80 | 0,95 | 2 288 | 188 | 2 108 | 331 | 2 088 | 82 | |
| 80 | 1 | 2 220 | 29 | 2 088 | 339 | 2 088 | 206 | |
| Pumsb* | 40 | 0,45 | 448 318 | 10 674 | 3 088 | 657 | 2 042 | 2 |
| 40 | 0,50 | 82 413 | 9 760 | 2 805 | 597 | 2 042 | 2 | |
| 40 | 0,55 | 39 171 | 4 571 | 2 564 | 553 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,60 | 27 084 | 3 015 | 2 436 | 498 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,65 | 15 499 | 2 616 | 2 344 | 465 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,70 | 7 057 | 2 042 | 2 253 | 444 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,75 | 4 880 | 1 066 | 2 167 | 421 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,80 | 3 395 | 370 | 2 125 | 403 | 2 042 | 3 | |
| 40 | 0,85 | 2 736 | 251 | 2 090 | 387 | 2 042 | 36 | |
| 40 | 0,90 | 2 615 | 145 | 2 066 | 376 | 2 042 | 171 | |
| 40 | 0,95 | 2 170 | 118 | 2 046 | 371 | 2 042 | 193 | |
| 40 | 1 | 2 166 | 54 | 2 042 | 367 | 2 042 | 208 | |
| BMS-Web- | 10 | 0,10 | 60 161 | 0 | 60 155 | 60 158 | 60 070 | 1 031 |
| View1 | ||||||||
| 10 | 0,30 | 60 074 | 0 | 60 074 | 60 074 | 60 070 | 34 846 | |
| 10 | 0,50 | 60 072 | 0 | 60 072 | 60 072 | 60 070 | 41 931 | |
| 10 | 0,70 | 60 070 | 0 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 53 366 | |
| 10 | 0,90 | 60 070 | 0 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 53 366 | |
| 10 | 1 | 60 070 | 0 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 53 366 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | |
| Mushroom | 30 | 0,10 | 578 359 | 2 251 | 1 804 | 715 | 97 |
| 30 | 0,15 | 98 566 | 1 704 | 1 327 | 648 | 100 | |
| 30 | 0,20 | 52 237 | 1 223 | 931 | 567 | 105 | |
| 30 | 0,25 | 4 120 | 816 | 637 | 463 | 121 | |
| 30 | 0,30 | 674 | 480 | 395 | 337 | 119 | |
| 30 | 0,35 | 319 | 285 | 251 | 245 | 121 | |
| 30 | 0,40 | 223 | 194 | 184 | 177 | 109 | |
| 30 | 0,50 | 167 | 142 | 138 | 135 | 104 | |
| 30 | 0,60 | 134 | 109 | 108 | 107 | 101 | |
| 30 | 0,70 | 126 | 101 | 100 | 99 | 98 | |
| 30 | 0,80 | 123 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| 30 | 0,90 | 122 | 97 | 96 | 95 | 94 | |
| 30 | 1 | 119 | 94 | 93 | 94 | 93 | |
| Pumsb | 80 | 0,75 | 536 153 | 2 167 | 2 129 | 2 093 | 2 030 |
| 80 | 0,80 | 3 797 | 2 354 | 2 280 | 2 212 | 2 098 | |
| 80 | 0,85 | 2 987 | 2 252 | 2 209 | 2 176 | 2 102 | |
| 80 | 0,90 | 2 760 | 2 189 | 2 162 | 2 151 | 2 109 | |
| 80 | 0,95 | 2 288 | 2 143 | 2 124 | 2 132 | 2 110 | |
| 80 | 1 | 2 220 | 2 126 | 2 124 | 2 126 | 2 124 | |
| Pumsb* | 40 | 0,45 | 448 318 | 3 353 | 3 090 | 2 362 | 2 044 |
| 40 | 0,50 | 82 413 | 3 012 | 2 807 | 2 302 | 2 044 | |
| 40 | 0,55 | 39 171 | 2 723 | 2 567 | 2 258 | 2 045 | |
| 40 | 0,60 | 27 084 | 2 547 | 2 439 | 2 203 | 2 045 | |
| 40 | 0,65 | 15 499 | 2 429 | 2 347 | 2 170 | 2 045 | |
| 40 | 0,70 | 7 057 | 2 319 | 2 256 | 2 149 | 2 045 | |
| 40 | 0,75 | 4 880 | 2 219 | 2 170 | 2 126 | 2 045 | |
| 40 | 0,80 | 3 395 | 2 167 | 2 135 | 2 108 | 2 054 | |
| 40 | 0,85 | 2 736 | 2 124 | 2 100 | 2 092 | 2 058 | |
| 40 | 0,90 | 2 615 | 2 097 | 2 094 | 2 081 | 2 077 | |
| 40 | 0,95 | 2 170 | 2 076 | 2 074 | 2 076 | 2 074 | |
| 40 | 1 | 2 166 | 2 072 | 2 072 | 2 072 | 2 072 | |
| BMS-Web- | 10 | 0,10 | 60 161 | 60 161 | 60 161 | 60 158 | 60 157 |
| View1 | |||||||
| 10 | 0,30 | 60 074 | 60 074 | 60 074 | 60 074 | 60 074 | |
| 10 | 0,50 | 60 072 | 60 072 | 60 072 | 60 072 | 60 072 | |
| 10 | 0,70 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | |
| 10 | 0,90 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | |
| 10 | 1 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | || | || |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10I4D100K | 0,1 | 0,10 | 140 | 2 563 | 137 | 137 | 73 | 36 |
| 0,5 | 0,10 | 1 838 | 865 | 1 297 | 1 233 | 301 | 57 | |
| 1 | 0,10 | 2 319 | 384 | 1 635 | 1 500 | 495 | 56 | |
| 5 | 0,10 | 2 693 | 10 | 2 006 | 1 866 | 860 | 56 | |
| 10 | 0,10 | 2 703 | 0 | 2 016 | 1 876 | 870 | 56 | |
| 15 | 0,10 | 2 703 | 0 | 2 016 | 1 876 | 870 | 56 | |
| 20 | 0,10 | 2 703 | 0 | 2 016 | 1 876 | 870 | 56 | |
| T40I10D100K | 5 | 0,10 | 4 387 | 316 | 2 189 | 2 462 | 641 | 21 |
| 10 | 0,10 | 4 621 | 82 | 2 413 | 2 696 | 860 | 21 | |
| 15 | 0,10 | 4 684 | 19 | 2 476 | 2 759 | 923 | 21 | |
| 20 | 0,10 | 4 698 | 5 | 2 490 | 2 773 | 937 | 21 | |
| 25 | 0,10 | 4 702 | 1 | 2 494 | 2 777 | 941 | 21 | |
| 30 | 0,10 | 4 703 | 0 | 2 495 | 2 778 | 942 | 21 | |
| Retail | 5 | 0,15 | 22 835 | 12 | 18 869 | 15 102 | 16 464 | 29 |
| 10 | 0,15 | 22 838 | 9 | 18 872 | 15 105 | 16 465 | 29 | |
| 20 | 0,15 | 22 844 | 3 | 18 878 | 15 111 | 16 468 | 29 | |
| 40 | 0,15 | 22 845 | 2 | 18 879 | 15 112 | 16 468 | 29 | |
| 50 | 0,15 | 22 846 | 1 | 18 880 | 15 113 | 16 469 | 29 | |
| 60 | 0,15 | 22 847 | 0 | 18 881 | 15 114 | 16 470 | 29 | |
| 80 | 0,15 | 22 847 | 0 | 18 881 | 15 114 | 16 470 | 29 | |
| 90 | 0,15 | 22 847 | 0 | 18 881 | 15 114 | 16 470 | 29 | |
| Accidents | 10 | 0,30 | 440 | 149 894 | 428 | 392 | 393 | 70 |
| 20 | 0,30 | 485 | 149 849 | 473 | 437 | 420 | 68 | |
| 30 | 0,30 | 788 | 149 546 | 609 | 569 | 436 | 29 | |
| 40 | 0,30 | 117 805 | 32 529 | 1 485 | 709 | 438 | 23 | |
| 50 | 0,30 | 142 275 | 8 059 | 1 952 | 813 | 444 | 23 | |
| 60 | 0,30 | 148 259 | 2 075 | 2 267 | 923 | 447 | 23 | |
| 70 | 0,30 | 149 805 | 529 | 2 408 | 992 | 452 | 23 | |
| 80 | 0,30 | 150 185 | 149 | 2 520 | 1 051 | 457 | 23 | |
| 90 | 0,30 | 150 303 | 31 | 2 564 | 1 072 | 463 | 23 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | |
| T10I4D100K | 0,1 | 0,10 | 140 | 140 | 139 | 137 | 109 |
| 0,5 | 0,10 | 1 838 | 1 689 | 1 351 | 1 233 | 358 | |
| 1 | 0,10 | 2 319 | 2 087 | 1 690 | 1 500 | 551 | |
| 5 | 0,10 | 2 693 | 2 457 | 2 061 | 1 866 | 916 | |
| 10 | 0,10 | 2 703 | 2 467 | 2 071 | 1 876 | 926 | |
| 15 | 0,10 | 2 703 | 2 467 | 2 071 | 1 876 | 926 | |
| 20 | 0,10 | 2 703 | 2 467 | 2 071 | 1 876 | 926 | |
| T40I10D100K | 5 | 0,10 | 4 387 | 3 409 | 2 210 | 2 462 | 662 |
| 10 | 0,10 | 4 621 | 3 643 | 2 434 | 2 696 | 881 | |
| 15 | 0,10 | 4 684 | 3 706 | 2 497 | 2 759 | 944 | |
| 20 | 0,10 | 4 698 | 3 720 | 2 511 | 2 773 | 958 | |
| 25 | 0,10 | 4 702 | 3 724 | 2 515 | 2 777 | 962 | |
| 30 | 0,10 | 4 703 | 3 725 | 2 516 | 2 778 | 963 | |
| Retail | 5 | 0,15 | 22 835 | 19 791 | 18 898 | 18 031 | 16 493 |
| 10 | 0,15 | 22 838 | 19 794 | 18 901 | 18 034 | 16 494 | |
| 20 | 0,15 | 22 844 | 19 800 | 18 907 | 18 040 | 16 497 | |
| 40 | 0,15 | 22 845 | 19 801 | 18 908 | 18 041 | 16 497 | |
| 50 | 0,15 | 22 846 | 19 802 | 18 909 | 18 042 | 16 498 | |
| 60 | 0,15 | 22 847 | 19 803 | 18 910 | 18 043 | 16 499 | |
| 80 | 0,15 | 22 847 | 19 803 | 18 910 | 18 043 | 16 499 | |
| 90 | 0,15 | 22 847 | 19 803 | 18 910 | 85 043 | 16 499 | |
| Accidents | 10 | 0,30 | 440 | 440 | 436 | 437 | 423 |
| 20 | 0,30 | 485 | 485 | 481 | 482 | 450 | |
| 30 | 0,30 | 788 | 686 | 635 | 614 | 465 | |
| 40 | 0,30 | 117 805 | 1 722 | 1 508 | 754 | 461 | |
| 50 | 0,30 | 142 275 | 2 312 | 1 975 | 858 | 467 | |
| 60 | 0,30 | 148 259 | 2 743 | 2 290 | 968 | 470 | |
| 70 | 0,30 | 149 805 | 2 954 | 2 431 | 1 037 | 475 | |
| 80 | 0,30 | 150 185 | 3 111 | 2 543 | 1 096 | 480 | |
| 90 | 0,30 | 150 303 | 3 167 | 2 587 | 1 117 | 486 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | || | || |
| T10I4D100K | 25 | 0,05 | 7 876 | 0 | 3 275 | 2 552 | 870 | 29 |
| 25 | 0,10 | 2 703 | 0 | 2 016 | 1 876 | 870 | 56 | |
| 25 | 0,15 | 1 548 | 0 | 1 435 | 1 402 | 870 | 64 | |
| 25 | 0,20 | 1 189 | 0 | 1 164 | 1 162 | 870 | 66 | |
| 25 | 0,30 | 994 | 0 | 989 | 989 | 870 | 62 | |
| 25 | 0,40 | 925 | 0 | 925 | 925 | 870 | 54 | |
| 25 | 0,50 | 901 | 0 | 901 | 901 | 870 | 81 | |
| 25 | 0,6 | 886 | 0 | 886 | 886 | 870 | 203 | |
| T40I10D100K | 25 | 0,05 | 40 533 | 1 | 5 129 | 6 623 | 941 | 1 |
| 25 | 0,10 | 4 702 | 1 | 2 494 | 2 777 | 941 | 21 | |
| 25 | 0,15 | 1 652 | 1 | 1 477 | 1 501 | 941 | 77 | |
| 25 | 0,20 | 1 175 | 1 | 1 163 | 1 164 | 941 | 106 | |
| 25 | 0,30 | 991 | 1 | 991 | 991 | 941 | 86 | |
| 25 | 0,40 | 961 | 1 | 961 | 961 | 941 | 280 | |
| 25 | 0,50 | 950 | 1 | 950 | 950 | 941 | 376 | |
| 25 | 0,60 | 945 | 1 | 945 | 945 | 941 | 518 | |
| Retail | 20 | 0,05 | 72 498 | 3 | 25 966 | 17 123 | 16 468 | 10 |
| 20 | 0,10 | 29 834 | 3 | 20 634 | 15 924 | 16 468 | 20 | |
| 20 | 0,15 | 22 844 | 3 | 18 878 | 15 111 | 16 468 | 29 | |
| 20 | 0,20 | 19 515 | 3 | 17 754 | 14 562 | 16 468 | 61 | |
| 20 | 0,30 | 18 160 | 3 | 17 128 | 14 101 | 16 468 | 37 | |
| 20 | 0,50 | 17 231 | 2 | 16 722 | 13 784 | 16 468 | 72 | |
| 20 | 0,70 | 16 736 | 2 | 16 470 | 13 619 | 16 468 | 637 | |
| 20 | 0,90 | 16 734 | 2 | 16 468 | 13 617 | 16 468 | 636 | |
| 20 | 1 | 16 734 | 2 | 16 468 | 13 617 | 16 468 | 636 | |
| Accidents | 50 | 0,20 | 883 311 | 8 059 | 2 711 | 998 | 444 | 53 |
| 50 | 0,30 | 142 275 | 8 059 | 1 952 | 813 | 444 | 23 | |
| 50 | 0,40 | 25 070 | 8 059 | 1 030 | 610 | 444 | 16 | |
| 50 | 0,50 | 516 | 8 058 | 498 | 463 | 444 | 72 | |
| 50 | 0,60 | 461 | 2 105 | 450 | 416 | 444 | 175 | |
| 50 | 0,70 | 456 | 164 | 445 | 411 | 444 | 210 | |
| 50 | 0,80 | 456 | 549 | 445 | 411 | 444 | 210 | |
| 50 | 0,90 | 456 | 50 | 445 | 411 | 444 | 210 | |
| 50 | 1 | 455 | 24 | 444 | 410 | 444 | 221 |
| Base | minsupp | minbond | || | || | || | || | |
| T10I4D100K | 0,05 | 7 876 | 4 387 | 3 304 | 2 552 | 2 552 | |
| 25 | 0,10 | 2 703 | 2 467 | 2 071 | 1 876 | 926 | |
| 25 | 0,15 | 1 548 | 1 539 | 1 464 | 1 402 | 934 | |
| 25 | 0,20 | 1 189 | 1 189 | 1 178 | 1 162 | 936 | |
| 25 | 0,30 | 994 | 994 | 991 | 989 | 932 | |
| 25 | 0,40 | 925 | 925 | 925 | 925 | 899 | |
| 25 | 0,50 | 901 | 901 | 901 | 901 | 897 | |
| 25 | 0,60 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | |
| T40I10D100K | 25 | 0,05 | 40 533 | 10 184 | 5 130 | 6 623 | 942 |
| 25 | 0,10 | 4 702 | 3 724 | 2 515 | 2 777 | 962 | |
| 25 | 0,15 | 1 652 | 1 633 | 1 527 | 1 501 | 1 018 | |
| 25 | 0,20 | 1 175 | 1 175 | 1 173 | 1 164 | 1 047 | |
| 25 | 0,30 | 991 | 991 | 991 | 991 | 979 | |
| 25 | 0,40 | 961 | 961 | 961 | 961 | 957 | |
| 25 | 0,50 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 25 | 0,60 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | |
| Retail | 20 | 0,05 | 72 498 | 28 641 | 25 976 | 20 052 | 16 478 |
| 20 | 0,10 | 29 834 | 22 180 | 20 654 | 18 853 | 16 488 | |
| 20 | 0,15 | 22 844 | 19 800 | 18 907 | 18 040 | 16 497 | |
| 20 | 0,20 | 19 515 | 18 330 | 17 813 | 17 491 | 16 529 | |
| 20 | 0,30 | 18 160 | 17 497 | 17 164 | 17 030 | 16 505 | |
| 20 | 0,50 | 17 231 | 16 906 | 16 783 | 16 713 | 16 540 | |
| 20 | 0,70 | 16 736 | 16 548 | 16 518 | 16 548 | 16 517 | |
| 20 | 0,90 | 16 734 | 16 546 | 16 468 | 16 546 | 16 516 | |
| 20 | 1 | 16 734 | 16 546 | 16 516 | 16 546 | 16 516 | |
| Accidents | 50 | 0,20 | 883 311 | 3 256 | 2 764 | 1 043 | 497 |
| 50 | 0,30 | 142 275 | 2 312 | 1 975 | 858 | 467 | |
| 50 | 0,40 | 25 070 | 1 189 | 1 043 | 655 | 460 | |
| 50 | 0,50 | 516 | 516 | 509 | 508 | 478 | |
| 50 | 0,60 | 461 | 461 | 461 | 461 | 460 | |
| 50 | 0,70 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| 50 | 0,80 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| 50 | 0,90 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| 50 | 1 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |