Math. & Sci. hum. / Mathematics and Social Sciences ( année, n∘ 195, 2011(3), p. 1–7.)
CONSTRUCTION EFFICACE DU TREILLIS DES MOTIFS FERMÉS FRÉQUENTS ET EXTRACTION SIMULTANÉE DES BASES GÉNÉRIQUES DE RÈGLES
Tarek HAMROUNI1, Sadok BEN YAHIA111 URPAH, Département des Sciences de l’Informatique, Faculté des Sciences de Tunis, Université Tunis El Manar, Campus Universitaire, Tunis, Tunisie, tarek.hamrouni@fst.rnu.tn, sadok.benyahia@fst.rnu.tn,, Engelbert MEPHU NGUIFO222 Clermont Universit , Universit Blaise Pascal, LIMOS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France, engelbert.mephu_nguifo@univ-bpclermont.fr,,333 LIMOS, CNRS, UMR 6158, 63173 Aubière, France.
résumé – Durant ces derni res ann es, les quantit s de donn es collect es, dans divers domaines d’application de l’informatique, deviennent de plus en plus importantes. Ces quantit s suscitent le besoin d’analyse et d’interpr tation afin d’en extraire des connaissances utiles. Dans ce travail, nous nous int ressons la technique d’extraction des r gles d’association partir de larges contextes. Cette derni re est parmi les techniques les plus fr quemment utilis es en fouille de donn es. Toutefois, le nombre de r gles extraites est g n ralement important avec en outre la pr sence de r gles redondantes. Dans ce papier, nous proposons un nouvel algorithme, appel Prince, dont la principale originalit est de construire une structure partiellement ordonn e (nomm e treillis d’Iceberg) dans l’objectif d’extraire des ensembles r duits de r gles, appel s bases g n riques. Ces bases forment un sous-ensemble, sans perte d’information, des r gles d’association. Pour r duire le co t de cette construction, le treillis d’Iceberg est calcul gr ce aux g n rateurs minimaux, associ s aux motifs ferm s fr quents. Ces derniers sont simultan ment d riv s avec les bases g n riques gr ce un simple parcours ascendant de la structure construite. Les exp rimentations que nous avons r alis es sur des contextes de r f rence et « pire des cas » ont montr l’efficacit de l’algorithme propos , comparativement des algorithmes tels que Close, A-Close et Titanic.
mots clés – Analyse de concepts formels, G n rateur minimal, Motif ferm , R gle, Treillis
summary – EFFICIENT CONSTRUCTION OF THE LATTICE OF FREQUENT CLOSED PATTERNS AND SIMULTANEOUS EXTRACTION OF GENERIC RULES BASES
In the last few years, the amount of collected data, in various computer science applications, becomes increasingly significant. These large volumes of data pointed out the need to analyze them in order to extract useful hidden knowledge. This work focuses on association rule extraction. This
technique is one of the most popular in data mining. Nevertheless, the number of extracted association rules is often very high, a large part of which is redundant. In this paper, we propose a new algorithm, called Prince. Its main feature is the construction of a partially ordered structure towards extracting subsets of association rules, called generic bases. These subsets form a lossless representation of the whole association rule set. To reduce the cost of such a construction, the partially ordered structure is built thanks to the minimal generators associated to frequent closed patterns. The closed ones are simultaneously derived with generic bases thanks to a simple bottom-up traversal of the obtained structure. The experimentations we carried out on benchmark and « worst case » contexts showed the efficiency of the proposed algorithm, comparatively to algorithms like Close, A-Close and Titanic.
keywords – Association rule, Closed pattern, Formal concept analysis, Lattice, Minimal generator
1. INTRODUCTION ET MOTIVATIONS
La technique d’extraction des r gles d’association [Agrawal & al., 1993, 1994] est une des techniques exploratoires les plus utilis es pour extraire les connaissances partir des donn es collect es dans diff rentes applications. Elle s’applique lorsque les donn es se pr sentent sous forme d’un contexte d’extraction repr sentant un sous-ensemble d’un produit cart sien et tant des ensembles finis. Étant donn s et deux sous-ensembles disjoints de l’ensemble , si le contexte satisfait la formule :
nous disons que le couple() est une r gle d’association (extraite) du contexte . Nous crivons dans la suite ou plus simplement . Les applications de cette notion sont ainsi multiples. Par exemple, si est un ensemble de patients atteints de la m me maladie, l’ensemble des sympt mes de ladite maladie et le contexte l’ensemble des couples () pour lesquels le patient pr sente le sympt me , alors une r gle d’association signifie que, pour la population concern e, l’occurrence des sympt mes regroup s dans s’accompagne toujours de celle des sympt mes dans . La notion de r gle d’association s’ tend naturellement des r gles pond r es par un indice de confiance. Les r gles d’association exactes ou pond r es se r v lent donc utiles dans une vari t de domaines.
Toutefois, le nombre de r gles extraites peut tre si grand qu’il affaiblit l’int r t pratique de la technique. Or, beaucoup sont redondantes. De nombreux travaux, s’inspirant de l’analyse des concepts formels [Ganter, Wille, 1999], ont alors montrer comment se limiter, sans perte d’information, des sous-ensembles de r gles appel s base g n rique.
Une base g n rique est sous-ensemble de l’ensemble total des r gles d’association tel que toute r gle non retenue dans la base peut tre d duite partir de celles retenues par une m thode appropri e. La plupart des bases g n riques, qui ont t propos es dans la litt rature [Ashrafi & al., 2007 ; Bastide, 2000; Ceglar, Roddick, 2006 ; Kryszkiewicz, 2002], v hiculent des r gles d’association qui repr sentent des implications entre des ensembles d’attributs (ou motifs) particuliers savoir les g n rateurs minimaux [Bastide & al., 2000(a)] (appel aussi motifs libres dans [Boulicaut & al., 2003] et motifs cl s dans [Stumme & al., 2002]) et les motifs ferm s [Pasquier & al., 1999(b)]. En effet, il a t montr que ce type de r gles d’association offre le maximum d’informations [Ashrafi & al., 2007 ; Bastide, 2000 ; Kryszkiewicz, 2002 ; Pasquier, 2000]. N anmoins, pour extraire ces bases de r gles, trois composantes primordiales doivent tre calcul es, savoir :
-
(i) l’ensemble des motifs ferm s fr quents, c’est- -dire ceux pr sentant une fr quence d’apparition jug e satisfaisante par l’utilisateur,
-
(ii) la liste des g n rateurs minimaux fr quents associ s chaque motif ferm fr quent,
-
(iii) la relation d’ordre partiel ordonnant les motifs ferm s fr quents.
Une tude critique des algorithmes d’extraction des motifs ferm s fr quents de la litt rature a t men e dans [Ben Yahia & al., 2006]. Le constat essentiel peut tre r sum comme suit :
-
1.
Ces algorithmes se sont concentr s sur l’ num ration des motifs ferm s fr quents. En effet, leur principal but est de r duire le temps d’extraction de ces motifs moyennant l’utilisation de structures de donn es volu es. Leurs performances sont int ressantes sur des contextes qualifi s de denses [Bayardo, 1998]. Cependant, ils pr sentent de modestes performances sur des contextes pars. En effet, calculer les fermetures des motifs dans pareils contextes r duit leurs performances puisque l’espace de recherche des motifs ferm s fr quents tend se superposer avec celui des motifs fr quents.
-
2.
Les algorithmes d’extraction des motifs ferm s fr quents ne tiennent pas compte de l’extraction des bases g n riques de r gles. En effet, d’une part, seule une partie permet d’extraire les g n rateurs minimaux et n cessite un surco t pour les associer leurs ferm s sans redondance444 Un motif ferm peut tre extrait plusieurs fois puisqu’il peut avoir plusieurs g n rateurs minimaux associ s.. D’autre part, aucun de ces algorithmes ne d termine la relation d’ordre. Ceci est argument par le fait qu’ils se sont seulement focalis s sur le calcul efficace des motifs ferm s fr quents.
Pour pallier ces limites, nous proposons dans ce papier un nouvel algorithme, appel Prince, d di l’extraction des bases g n riques de r gles d’association. Prince effectue une exploration par niveau de l’espace de recherche, c’est- -dire en partant de l’ensemble vide vers les motifs de taille 1, ensuite ceux de taille 2, et ainsi de suite. Sa principale caract ristique est qu’il d termine la relation d’ordre partiel entre les motifs ferm s fr quents afin d’extraire les bases g n riques de r gles d’association. Son originalit est que le treillis d’Iceberg est obtenu gr ce des comparaisons entre les g n rateurs minimaux fr quents seulement, et non plus entre les motifs ferm s. Ainsi, les bases g n riques de r gles sont d riv es par un simple balayage de la structure ordonn e obtenue sans avoir calculer les fermetures. De plus, gr ce une gestion efficace des classes d’ quivalence, Prince optimise la construction de la relation d’ordre et vite aussi la redondance dans la d rivation des motifs ferm s et des r gles d’association. Par ailleurs, en adoptant une optimisation issue des caract ristiques des g n rateurs minimaux, la relation d’ordre peut tre facilement d duite. Les r sultats des exp rimentations, men es sur des contextes de r f rence et « pire des cas », sont tr s encourageants. En effet, les performances de Prince, compar es aux algorithmes de r f rence d’exploration par niveau, e.g. Close, A-Close et Titanic, sont largement sup rieures.
Nous n’avons pas compar les performances de Prince celles d’algorithmes plus r cents, e.g. DCI-Closed [Lucchese & al., 2006] et LCM [Uno & al., 2004], consid r s dans l’ tude men e dans [Ben Yahia & al., 2006]. Ceci est argument par le fait que les algorithmes Close, A-Close et Titanic d terminent, en outre des ferm s, l’information cl fournie par l’ensemble des g n rateurs minimaux, ce qui n’est pas le cas pour le reste des algorithmes.
La suite de l’article est organis e comme suit. La Section suivante rappelle bri vement les fondements math matiques de l’analyse de concepts formels ainsi que son lien avec la d rivation des r gles d’association g n riques. La Section 3. discute les travaux li s notre probl matique. La quatri me Section est d di e une pr sentation d taill e de l’algorithme Prince. La Section 5. d taille diff rentes propri t s de l’algorithme propos . Les r sultats des exp rimentations montrant l’utilit de l’approche propos e sont pr sent s dans la sixi me Section.
2. FONDEMENTS MATHÉMATIQUES
Dans ce qui suit, nous pr sentons bri vement quelques r sultats cl s provenant de l’analyse de concepts formels et leur lien avec le contexte de d rivation des r gles d’association g n riques.
2.1. notions de base
Dans la suite du papier, nous utilisons le cadre th orique de l’analyse de concepts formels pr sent dans [Ganter, Wille, 1999]. Dans cette partie, nous rappelons d’une mani re succincte les notions de base de ce cadre th orique.
Contexte d’extraction : un contexte d’extraction est un triplet ) d crivant un ensemble fini d’objets (ou transactions), un ensemble fini d’items (ou attributs) et une relation (d’incidence) binaire (c’est- -dire ). L’appartenance du couple ) d signe le fait que l’objet contient l’item .
Correspondance de Galois : soit le contexte d’extraction ). Soit l’application de l’ensemble des parties de (c’est- -dire l’ensemble de tous les sous-ensembles de ), not par ), dans l’ensemble des parties de , not par ). L’application associe un ensemble d’objets O , l’ensemble des items i communs tous les objets o O.
Soit l’application de l’ensemble des parties de dans l’ensemble des parties de . Elle associe un ensemble d’items I , l’ensemble d’objets o communs tous les items i I :
Le couple d’applications () d finit une correspondance de Galois entre l’ensemble des parties de et l’ensemble des parties de . Les applications et sont appel es les op rateurs de fermeture de la correspondance de Galois [Ganter, Wille, 1999]. L’op rateur de fermeture , tout comme , est caract ris par le fait qu’il est :
-
- Isotone : ) ;
-
- Extensive : ) ;
-
- Idempotent : ).
Nous allons maintenant introduire la notion de motif fr quent et celle de motif ferm .
Motif fr quent : un motif est dit fr quent si son support relatif, Supp, d passe un seuil minimum fix par l’utilisateur not minsupp. Notons que est appel support absolu de .
Il est noter que le support des motifs est anti-monotone par rapport l’inclusion ensembliste, c’est- -dire que si , alors ). Dans la suite et pour simplifier l’explication, Supp() d signera le support absolu du motif .
Motif ferm [Pasquier & al., 1999(b)] : un motif est dit ferm si ). Le motif est un ensemble maximal d’items communs un ensemble d’objets.
Concept formel : un concept formel est une paire , o et sont reli s par les op rateurs de la correspondance de Galois, c’est- -dire et . Les ensembles et sont appel s respectivement extension et intension de .
Un motif ferm est l’intension d’un concept formel alors que son support est la cardinalit de l’extension du concept.
Classe d’ quivalence [Bastide & al., 2000(b)] : l’op rateur de fermeture induit une relation d’ quivalence sur l’ensemble des parties de , c’est- -dire l’ensemble de parties est subdivis en des sous-ensembles disjoints, appel s aussi classes d’ quivalence. Dans chaque classe, tous les l ments poss dent la m me fermeture : soit , la classe d’ quivalence de , d not e [], est : [] = . Les l ments de [] ont ainsi la m me valeur de support.
Deux classes d’ quivalence sont dites comparables si leurs motifs ferm s associ s peuvent tre ordonn s par inclusion ensembliste, sinon elles sont dites incomparables.
La d finition d’une classe d’ quivalence nous am ne celle d’un g n rateur minimal.
G n rateur minimal [Bastide & al., 2000(b) ; Stumme & al., 2002] : soit un motif ferm et [] sa classe d’ quivalence. L’ensemble des g n rateurs minimaux de est d fini comme suit : tel que .
Les g n rateurs minimaux d’une classe sont les l ments incomparables les plus petits (par rapport la relation d’inclusion ensembliste), tandis que le motif ferm est l’ l ment le plus grand de cette classe. Ainsi, tout motif est n cessairement compris entre un g n rateur minimal et un motif ferm . D’apr s la d finition d’une classe d’ quivalence, un g n rateur minimal a un support strictement inf rieur celui de ses sous-ensembles. D’une mani re duale, un motif ferm admet un support strictement sup rieur que celui de ses sur-ensembles.
Nous allons maintenant nous focaliser sur des propri t s structurelles importantes associ es l’ensemble des motifs ferm s et l’ensemble des g n rateurs minimaux.
Treillis de concepts formels (de Galois) : tant donn un contexte d’extraction , l’ensemble de concepts formels , extrait partir de , est un treillis complet ), appel treillis de concepts (ou treillis de Galois), quand l’ensemble est consid r avec la relation d’inclusion ensembliste entre les motifs [Barbut, Monjardet, 1970 ; Ganter, Wille, 1999] : soient et deux concepts formels, si .
Dans le treillis de Galois, chaque l ment est connect aussi bien l’ensemble de ses successeurs imm diats, appel couverture sup rieure (), qu’ l’ensemble de ses pr d cesseurs imm diats, appel couverture inf rieure ().
Treillis d’Iceberg quand nous consid rons seulement l’ensemble des motifs ferm s fr quents extrait partir de et ordonn s par la relation d’inclusion ensembliste, la structure obtenue () pr serve seulement l’op rateur Sup [Ganter, Wille, 1999]. Cette structure forme un sup demi-treillis [Mephu Nguifo, 1994] que, par abus volontaire [Stumme & al., 2002] appelle tout de m me treillis, le treillis d’Iceberg.
exemple 1.
Consid rons le contexte d’extraction donn par la Figure 1 (gauche). Quelques exemples de classes d’ quivalence extraites de ce contexte sont donn s par la Figure 1 (centre). Le treillis d’Iceberg, pour minsupp = 2, est donn par la Figure 1 (droite). Chaque nœud dans le treillis d’Iceberg est form par le motif ferm fr quent et le support correspondant, et est tiquet par la liste de ses g n rateurs minimaux associ s.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |

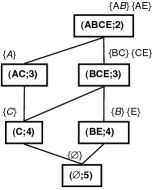
Dans ce qui suit, nous introduisons la notion d’id al d’ordre [Ganter, Wille, 1999] d finie sur l’ensemble des parties d’un ensemble , c’est- -dire .
définition 1.
Un sous-ensemble de est un id al d’ordre s’il v rifie les propri t s suivantes :
-
- Si , alors .
-
- Si , alors .
Le lemme suivant nonce, dans le cas g n ral, une propri t int ressante de l’ensemble des g n rateurs minimaux (ou cl s) associ s un op rateur de fermeture.
lemme 1.
L’ensemble des g n rateurs minimaux d’un op rateur de fermeture est un id al de l’ordre d’inclusion ensembliste.
démonstration 1.
Soit un op rateur de fermeture sur un ensemble . Soit un sous-ensemble g n rateur minimal de , c’est- -dire pour tout , alors . L’objectif est de montrer que tout sous-ensemble propre de est un sous-ensemble g n rateur minimal. Cette propri t est trivialement vraie si est vide ou bien si est un singleton. On suppose donc que contient au moins une paire. Soit un sous-ensemble propre de . On montre par l’absurde que est un sous-ensemble g n rateur minimal. On suppose le contraire. Il existe alors un sous-ensemble propre de tel que . On pose . Par hypoth se, n’est pas vide et . Puisque , on a , donc .
On s’appuie dans la suite de la preuve sur la propri t suivante des op rateurs de fermeture : une application extensive de dans est un op rateur de fermeture ssi :
(2) pour tous sous-ensembles de ) .
Il r sulte par une double application, de la propri t (2), appel e propri t des chemins ind pendants, que si est un op rateur de fermeture, alors :
(3) .
On a :
qui contredit que est un sous-ensemble g n rateur minimal de .
Il d coule du Lemme 1 la proposition suivante :
proposition 1.
L’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents d’un contexte, associ s l’op rateur de fermeture de Galois , est un id al d’ordre pour l’inclusion ensembliste, autrement dit, tout sous-ensemble d’un g n rateur minimal fr quent est un g n rateur minimal fr quent.
La Proposition 1 permet de rejeter tout motif, dont un des sous-ensembles n’est pas un g n rateur minimal fr quent. Un motif est dit candidat si tous ses sous-ensembles sont des g n rateurs minimaux fr quents.
Dans la conception de l’algorithme Prince, nous visons construire le treillis d’Iceberg sans avoir acc der au contexte d’extraction. Ceci n cessite d’extraire dans une tape pr alable une repr sentation concise exacte des motifs fr quents bas e sur les g n rateurs minimaux. Cette repr sentation aura pour but de d terminer si un motif quelconque est fr quent ou non et de d terminer son support s’il est fr quent. Étant donn que l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents, d not , ne constitue pas par lui-m me une repr sentation exacte des motifs fr quents, il doit tre augment par une bordure. Dans cet article, nous l’augmentons par la bordure n gative non fr quente. Nous appelons bordure n gative non fr quente, not e d-, l’ensemble des plus petits (au sens de l’inclusion) motifs qui ne sont pas fr quents et dont tous les sous-ensembles sont des g n rateurs minimaux fr quents. Le lemme suivant indique que les l ments de d- sont des g n rateurs minimaux.
lemme 2.
Les l ments de la bordure n gative non fr quente d- sont des g n rateurs minimaux.
démonstration 2.
Soit . Par d finition, est non fr quent alors que tous ses sous-ensembles sont fr quents. Ainsi, le support de est strictement inf rieur celui de ses sous-ensembles stricts. D’o , est un g n rateur minimal.
L’utilisation de la bordure s’explique donc par le fait que son union avec l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents forme une repr sentation concise exacte de l’ensemble des motifs fr quents [Calders & al., 2005]. Ainsi, en utilisant l’ensemble r sultat de cette union, nous pouvons d terminer le support de tout motif sans effectuer un acc s au contexte d’extraction. Le support d’un motif quelconque sera d riv s’il est fr quent, sinon il sera d tect comme tant non fr quent. Ceci est explicit travers la proposition suivante :
proposition 2.
Soit un motif. Si et alors est non fr quent. Sinon, est fr quent et et .
Les notions de bloqueur minimal et de face nous seront aussi utiles dans la suite :
– Bloqueur minimal : Soit une famille d’ensembles tel que . Un bloqueur de la famille est un ensemble dont l’intersection avec tout ensemble est non vide. Le bloqueur est dit minimal s’il n’existe aucun bloqueur de inclus dans [Pfaltz, Taylor, 2002].
Il est noter que l’union des est un bloqueur.
exemple 2.
Consid rons le contexte d’extraction donn par la Figure 1 (Gauche). Soit la famille d’ensemble , compos e par les g n rateurs minimaux du motif ferm BCE (cf. Figure 1 (Droite)). Ainsi, et . L’union de et de , gale , est un bloqueur de . Il en est de m me pour . Par ailleurs, les ensembles et sont des bloqueurs minimaux de la famille .
– Face : Soient . Si couvre dans le treillis d’Iceberg ) (c’est- -dire , alors la face de par rapport , not e face , est gale : face [Pfaltz, Taylor, 2002].
exemple 3.
Dans ce qui suit, nous pr sentons le cadre g n ral pour la d rivation des r gles d’association, puis nous tablissons son lien avec la th orie des concepts formels.
2.2. d rivation des r gles d’association
Une r gle d’association est une relation entre motifs de la forme , dans laquelle et sont des motifs fr quents, tels que . Les motifs et sont appel s, respectivement, pr misse et conclusion de la r gle. La mesure de support de , d not e , est gale . Une r gle d’association est dite valide [Agrawal & al., 1993] si sa mesure de confiance est sup rieure ou gale un seuil minimal minconf de confiance. Une r gle d’association est dite exacte si sinon elle est dite approximative [Pasquier, 2000].
Le probl me de l’extraction des r gles d’association est r solu par un algorithme fondamental, savoir Apriori [Agrawal, Srikant, 1994]. Cependant, cette approche d’extraction des r gles, fond e sur les motifs fr quents, pr sente deux probl mes majeurs :
-
1.
le co t de l’extraction des motifs fr quents notamment pour des contextes denses ;
-
2.
en g n ral, le nombre de r gles d’association g n r es peut tre excessivement grand, dont une grande partie est redondante [Ashrafi & al., 2007].
Ainsi, une nouvelle approche fond e sur l’extraction des motifs ferm s fr quents [Pasquier, 1999], a vu le jour et a pour ambition de :
-
1.
r duire le co t de l’extraction des motifs fr quents en se basant sur le fait que l’ensemble des motifs ferm s fr quents est un ensemble g n rateur de l’ensemble des motifs fr quents [Pasquier, 1999] ;
-
2.
permettre, sans perte d’information, la s lection d’un sous-ensemble de toutes les r gles d’association, appel base g n rique, partir duquel le reste des r gles pourra tre d riv . Ceci donne la possibilit de pr senter le minimum possible de r gles l’utilisateur afin de lui permettre de mieux les visualiser et les exploiter.
Depuis, plusieurs bases g n riques ont t introduites, dont celles de Bastide & al. [2000(a)] et qui sont d finies dans ce qui suit.
1. La base g n rique de r gles d’association exactes est d finie comme suit :
définition 2.
Soit l’ensemble des motifs ferm s fr quents extrait d’un contexte d’extraction . Pour chaque motif ferm fr quent , nous d signons par l’ensemble de ses g n rateurs minimaux. La base g n rique de r gles d’association exactes est donn e par : et et 555 La condition permet de ne pas retenir les r gles de la forme ..
remarque 1.
Tous les l ments de sont fr quents. Par ailleurs, une r gle exacte est toujours valide puisque sa confiance, gale 1, est toujours sup rieure ou gale minconf.
2. La base g n rique de r gles d’association approximatives appel e base informative de r gles d’association approximatives est d finie comme suit :
définition 3.
Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents extrait d’un contexte d’extraction . La base informative de r gles d’association approximatives est donn e par : et et et .
Afin de r duire encore plus le nombre de r gles approximatives, Bastide et al. proposent une r duction transitive de la base informative [Bastide, 2000 ; Bastide & al., 2000(a)] qui est elle-m me une base pour toutes les r gles approximatives. La r duction transitive est d finie comme suit :
définition 4.
La r duction transitive est donn e par : et et et .
Dans la suite, nous allons consid rer les r gles d’association g n riques form es par l’union de la base g n rique de r gles exactes et la r duction transitive de la base informative . Ces r gles seront d sign es par r gles d’association informatives.
exemple 4.
Consid rons le treillis d’Iceberg donn par la Figure 1 (Droite). À partir de la classe d’ quivalence dont le motif ferm fr quent est ABCE, deux r gles exactes sont obtenues : et . D’autre part, la r gle approximative est g n r e partir des deux classes d’ quivalence dont les sommets respectifs sont les motifs ferm s C et AC.
Il faut noter que les bases consid r es pr sentent plusieurs avantages savoir le fait qu’elles sont form es d’implications pr misse minimale et conclusion maximale, ce qui donne les r gles les plus informatives pour l’utilisateur [Bastide & al., 2000(a) ; Kryszkiewicz, 2002 ; Pasquier, 2000]. En plus, elles satisfont les conditions suivantes [Kryszkiewicz, 2002] :
-
1.
D rivabilit : Le syst me axiomatique propos dans [Ben Yahia, Mephu Nguifo, 2004] afin de d river toutes les r gles valides (redondantes) partir de ces bases est correct (c’est- -dire, le syst me ne permet de d river que les r gles d’association valides) et complet (c’est- -dire, l’ensemble de toutes les r gles valides est d riv ).
-
2.
Informativit : Ces bases g n riques des r gles d’association permettent de d terminer avec exactitude le support et la confiance des r gles d riv es.
Par ailleurs, la r duction transitive regroupe les r gles approximatives minimales ayant des valeurs de confiance lev es et sauf rares exceptions, les r gles les plus int ressantes sont celles de support et confiance lev s [Bastide, 2000]. En outre, un nombre important de travaux de la litt rature t moigne de son utilit dans des cas pratiques.
3. EXTRACTION DES MOTIFS FERMÉS FRÉQUENTS
Il est bien connu que l’ tape la plus complexe et la plus consommatrice en temps d’ex cution est celle du calcul des motifs fr quents. Cette tape peut aussi extraire un nombre important de motifs fr quents, desquels un nombre prohibitif de r gles d’association sera d riv , ce qui rend leur usage tr s difficile. Les algorithmes bas s sur l’extraction des motifs ferm s fr quents sont alors une nouvelle alternative avec la promesse claire de r duire consid rablement la taille de l’ensemble des r gles d’association. Ainsi, seules les r gles d’association informatives devaient tre maintenues tant donn qu’elles permettent une r duction de l’ensemble de toutes les r gles valides, tout en convoyant le maximum d’information. Une tude critique de la litt rature d di e nous a permis de d gager que :
-
1.
Beaucoup d’algorithmes orient s fouille de donn es [Lucchese & al., 2006 ; Pasquier & al., 1999(b) ; Pei & al., 2000 ; Stumme & al., 2002 ; Uno & al., 2004 ; Zaki, Hsiao, 2002] permettent l’extraction des motifs ferm s fr quents. Cependant, seuls certains [Pasquier & al., 1999(a), 1999(b) ; Stumme & al., 2002] se basent sur la notion de g n rateur minimal666 En r alit , ces algorithmes utilisent les g n rateurs minimaux comme tape interm diaire pour extraire les motifs ferm s.. Toutefois, ces algorithmes ne construisent pas la relation d’ordre partiel. Ils n cessitent alors l’ex cution en aval d’un autre algorithme tel que celui propos par [Valtchev & al., 2000].
Les algorithmes (e.g. [Bastide, 2000 ; Pasquier, 2000 ; Pasquier & al., 1999(b)]) permettant d’extraire les r gles formant le couple supposent l’existence des motifs ferm s fr quents ainsi que leurs g n rateurs minimaux respectifs. Ceci n cessite un autre algorithme tel que Close [Pasquier, & al., 1999(b)], A-Close [Pasquier & al., 1999(a)], Gc-Growth [Li & al., 2005] ou une modification de Pascal [Szathmary & al., 2007], etc. Un tel algorithme doit alors associer pour chaque motif ferm fr quent ses g n rateurs minimaux tant donn qu’il peut tre calcul plusieurs fois. La g n ration de la base g n rique des r gles exactes se fait d’une mani re directe. Cependant pour les r gles approximatives formant , des tests d’inclusion co teux, mettant en jeu les motifs ferm s fr quents, sont aussi r alis s pour d terminer les successeurs imm diats de chaque motif ferm fr quent.
-
2.
Les algorithmes orient s concepts formels permettent de g n rer l’ensemble des concepts formels ainsi que la relation d’ordre [Kuznetsov, Obiedkov, 2002]. Toutefois, ils ne g n rent pas l’ensemble des g n rateurs minimaux associ s. Ils n cessitent alors l’application d’un autre algorithme, tel que JEN [Le Floc’h & al., 2003] permettant de d terminer les g n rateurs minimaux tant donn que la relation d’ordre est d j construite. Par ailleurs, leur performance reste limit e dans le cas des contextes r els [Stumme & al., 2002] (cf. aussi [Kuznetsov, Obiedkov, 2002] o les algorithmes n’ont pu tre test s que sur de petits contextes al atoirement produits). De plus, leur consommation en espace m moire est lev e vu que les intensions des concepts sont maintenues. Notons que l’algorithme propos dans [Zaki, Hsiao, 2005] permet d’extraire l’ensemble des motifs ferm s fr quents munis de la relation d’ordre partiel. Ainsi, l’algorithme JEN est aussi applicable dans ce cas pour d river les g n rateurs minimaux.
Les principaux algorithmes permettant l’extraction des motifs ferm s fr quents et leurs g n rateurs minimaux associ s sont Close [Pasquier & al., 1999(b)], A-Close [Pasquier & al., 1999(a)] et Titanic [Stumme & al., 2002]. Ces algorithmes, reposant sur la technique G n rer-et-tester, explorent l’espace de recherche par niveau, c’est- -dire en partant de l’ensemble vide vers les motifs de taille 1, ensuite ceux de taille 2, et ainsi de suite. En plus de l’ lagage bas sur la mesure statistique minsupp, ces algorithmes mettent en oeuvre un lagage efficace, bas sur la propri t d’id al d’ordre de l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents.
Dans la suite, nous allons passer en revue les principaux algorithmes permettant l’extraction des motifs ferm s fr quents ainsi que leurs g n rateurs minimaux associ s. Une tude des algorithmes d di s seulement l’ num ration des motifs ferm s fr quents se trouve dans [Ben Yahia & al., 2006].
3.1. algorithme Close
L’algorithme Close est propos par Pasquier & al. [1999(b)]. À chaque it ration, Close g n re un ensemble de candidats en joignant les g n rateurs minimaux retenus durant l’it ration pr c dente. Close calcule alors leurs supports et leurs fermetures dans une m me tape par le biais d’un acc s au contexte d’extraction. La fermeture d’un candidat g n rateur minimal est calcul e en ex cutant des intersections de l’ensemble des objets auxquelles appartient . Afin de r duire l’espace de recherche, c’est- -dire le nombre de candidats tester, Close utilise des strat gies d’ lagage. Ces derni res sont bas es sur une mesure statistique savoir minsupp et sur l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux ainsi que sur le fait qu’un candidat g n rateur minimal de taille ne doit pas tre couvert par la fermeture d’un de ses sous-ensembles de taille ( - ).
3.2. algorithme A-Close
L’algorithme A-Close est aussi propos par Pasquier & al. [1999(a)]. Il op re en deux tapes successives. D’abord, il d termine tous les g n rateurs minimaux fr quents des diff rentes classes d’ quivalence l’aide des acc s it ratifs au contexte d’extraction. Ensuite, il calcule leurs fermetures de la m me fa on que dans Close. A-Close utilise trois strat gies d’ lagages savoir minsupp, l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux et le fait qu’un candidat g n rateur minimal de taille ne doit pas avoir le m me support qu’un de ses sous-ensembles de taille ( - ). Afin de v rifier cette derni re condition, A-Close effectue un balayage des g n rateurs minimaux retenus de taille ( - ). Pour all ger le calcul des fermetures, l’algorithme A-Close m morise le num ro de la premi re it ration durant laquelle un des candidats s’av re fr quent mais non g n rateur minimal (c’est- -dire ayant un support gal celui d’un de ses sous-ensembles). Le num ro de cette it ration correspond la taille de ce candidat. Il n’est alors pas n cessaire de calculer la fermeture des g n rateurs minimaux fr quents de tailles inf rieures ( - ), puisqu’ils sont tous gaux leurs fermetures.
3.3. algorithme Titanic
L’algorithme Titanic est propos par Stumme & al. [2002]. Titanic d termine dans chaque it ration les g n rateurs minimaux fr quents associ s, moyennant un acc s au contexte d’extraction. Il utilise pour cela les m mes strat gies d’ lagage que A-Close. Cependant, Titanic vite le balayage co teux effectu par A-Close pour v rifier la derni re strat gie d’ lagage. Pour cela, Titanic utilise pour chaque candidat de taille une variable o il stocke son support estim , c’est- -dire le minimum du support de ses sous-ensembles de taille ( - ), et qui doit tre diff rent de son support r el, sinon n’est pas minimal. Ceci est bas sur le lemme suivant :
lemme 3.
Soient . Si et Supp = Supp, alors .
Titanic vite aussi l’acc s au contexte d’extraction pour calculer les fermetures des g n rateurs minimaux fr quents. Ceci est r alis moyennant un m canisme de comptage par inf rence (utilis aussi dans l’algorithme Pascal [Bastide & al., 2000(b)], d di l’extraction des motifs fr quents). Le m canisme employ est fond sur le fait qu’on peut d terminer le support de tout motif fr quent en utilisant la Proposition 2. Titanic cherche alors tendre tout g n rateur minimal fr quent par les items ad quats appartenant sa fermeture.
Les algorithmes d crits dans cette section pr sentent un inconv nient majeur savoir le calcul redondant des fermetures. En effet, un motif ferm fr quent peut admettre plusieurs g n rateurs minimaux et sera donc calcul plusieurs fois, sp cialement dans le cas de contextes denses. Par ailleurs, dans le cas des contextes pars, le calcul des fermetures est g n ralement inutile car les g n rateurs s’av rent aussi ferm s. Il est aussi important de noter que contrairement aux affirmations des auteurs dans [Stumme & al., 2002], Titanic ne construit pas le treillis d’Iceberg. En effet, il ne g n re aucun lien de pr c dence entre motifs ferm s fr quents et se limite simplement leur extraction ainsi que celle des g n rateurs minimaux fr quents, tout comme Close et A-Close. Toutefois, ces algorithmes sont aptes d river les r gles d’association informatives moyennant l’utilisation de la proc dure de g n ration de ces r gles, d crite dans [Pasquier, 2000] et qui prend comme entr e l’ensemble des motifs ferm s fr quents associ s leurs g n rateurs minimaux.
4. DESCRIPTION DE L’ALGORITHME Prince
Dans cette section, nous allons introduire un nouvel algorithme, appel Prince, dont l’objectif principal est de pallier les principales lacunes de ces algorithmes d di s l’extraction des motifs ferm s fr quents, c’est- -dire le co t du calcul des fermetures ainsi que le fait de ne pas construire la relation d’ordre partiel. La principale originalit de Prince r side dans le fait qu’il construit une structure isomorphe au treillis des motifs ferm s. Dans cette structure, le treillis d’Iceberg est construit non plus gr ce aux motifs ferm s fr quents mais moyennant des comparaisons entre g n rateurs minimaux fr quents. Rappelons que le treillis d’Iceberg est une structure qui ordonne partiellement les classes d’ quivalence. Une premi re variante de ce treillis a t d finie dans la sous-section 2.1. (page 2.1.) o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par son motif ferm fr quent, c’est- -dire par le plus grand l ment correspondant. Nous proposons ici une nouvelle variante du treillis d’Iceberg, appel e treillis des g n rateurs minimaux, o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par ses l ments minimaux. Cette variante est d finie comme suit :
définition 5.
Le treillis des g n rateurs minimaux est une variante du treillis d’Iceberg, o chaque classe d’ quivalence est repr sent e par les g n rateurs minimaux qu’elle contient.
L’algorithme Prince met alors en place un m canisme de gestion des classes d’ quivalence permettant de g n rer la liste int grale des motifs ferm s fr quents sans duplication et sans recours aux tests de couvertures. Il permet aussi de r duire d’une mani re notable le co t du calcul des fermetures, en les d rivant simplement gr ce aux notions de bloqueur minimal et de face [Pfaltz, Taylor, 2002]. De plus et gr ce cette structure partiellement ordonn e, Prince permet d’extraire les bases g n riques de r gles sans avoir l’associer avec un autre algorithme. La construction des liens de pr c dence est optimis e gr ce une gestion efficace des classes d’ quivalence ainsi que la d tection d’information pouvant rendre partielle cette construction.
Prince prend en entr e un contexte d’extraction , le seuil minimum de support minsupp et le seuil minimum de confiance minconf. Il donne en sortie la liste des motifs ferm s fr quents et leurs g n rateurs minimaux respectifs ainsi que les bases g n riques de r gles. Prince op re en trois tapes successives :
-
1.
D termination des g n rateurs minimaux ;
-
2.
Construction du treillis des g n rateurs minimaux ;
-
3.
Extraction des bases g n riques de r gles.
Ces tapes sont d crites dans ce qui suit. Leur d roulement partir de l’exemple de la Figure 1 est d taill dans l’exemple 5, page 5.
4.1. d termination des g n rateurs minimaux
En explorant l’espace de recherche par niveau, l’algorithme Prince d termine lors de sa premi re tape l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents ainsi que la bordure n gative non fr quente .
4.1.1. Strat gies d’ lagage adopt es
4.1.2. Pseudo-code de la premi re tape de l’algorithme Prince
Les notations qui seront utilis es dans l’algorithme Prince sont r sum es dans le Tableau 1. Le pseudo-code relatif cette tape est donn par la proc dure Gen-GMs (cf. Algorithme 1). Cette proc dure prend en entr e un contexte d’extraction et le support minimal minsupp. Elle donne en sortie l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de fa on pouvoir les parcourir par ordre d croissant de leurs supports respectifs lors de la deuxi me tape de l’algorithme Prince. L’ensemble est alors consid r comme tant divis en plusieurs sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est caract ris par la m me valeur du support. Ainsi, chaque fois qu’un g n rateur minimal fr quent est d termin , il est ajout l’ensemble repr sentant son support. La proc dure Gen-GMs garde aussi la trace des g n rateurs minimaux non fr quents, formant la bordure , afin de les utiliser lors de la deuxi me tape.
| : un compteur qui indique l’it ration courante. Durant la it ration, tous les g n rateurs minimaux de taille sont d termin s. : ensemble des motifs r sultats de l’application de Apriori-Gen. : ensemble des candidats g n rateurs minimaux de taille . : ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille . : ensemble des g n rateurs minimaux fr quents tri s par ordre d croissant du support. : bordure n gative non fr quente des g n rateurs minimaux fr quents. |
| – Chaque l ment de , ou de est caract ris par les champs suivants : 1. support-r el : support r el de , initialis 0. 2. sous-ens-directs : liste des sous-ensembles de de taille ( - ), initialis l’ensemble vide. – Chaque l ment de est aussi caract ris par un support estim (le champ support-estim ) et qui sera utilis pour liminer les candidats non g n rateurs minimaux. |
| – Chaque l ment de est aussi caract ris par les champs suivants : 1. succs-imm diats : liste des successeurs imm diats de [], initialis l’ensemble vide. 2. iff : motif ferm fr quent correspondant, initialis l’ensemble vide. |
Dans cette proc dure, l’ensemble des candidats g n rateurs minimaux est initialis par l’ensemble des items du contexte d’extraction (ligne 2). Le support des items est alors calcul via un acc s au contexte d’extraction (ligne 3). Le support de l’ensemble vide est gal au nombre d’objets du contexte d’extraction, c’est- -dire (ligne 4). L’ensemble vide, tant le g n rateur minimal fr quent de taille 0, est ins r dans (ligne 5). Pour tout item , nous distinguons les deux cas suivants (lignes 6-14) :
-
1.
si , alors n’est pas un g n rateur minimal (ligne 8) ;
-
2.
sinon est un g n rateur minimal. Il est ajout si (ligne 12), sinon il est ajout (ligne 14)777 Il est noter que l’item peut ne pas tre ajout car il ne sera plus utilis dans la suite. Son ajout a pour seul int r t que d’avoir une bordure compl te..
Ensuite, le calcul est effectu par niveau. Pour cela, nous utilisons la proc dure Gen-GMs-suivants (lignes 15-16), dont le pseudo-code est donn par l’algorithme 2. La proc dure Gen-GMs-suivants prend en entr e l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille et retourne l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille ( + ).
-
1.
L’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents.
-
2.
L’ensemble d- contenant la bordure n gative non fr quente des g n rateurs minimaux fr quents.
-
3.
La fermeture de l’ensemble vide.
1
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
La premi re tape de l’algorithme Prince prend alors fin lorsque l’ensemble des candidats est vide. Cette tape retourne ainsi l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents tri par ordre d croissant du support, et pour un support donn , par ordre lexicographique (ligne 17), ainsi que la bordure n gative non fr quente et la fermeture de l’ensemble vide. Il est important de noter que la consid ration de la fermeture de l’ensemble vide dans le cas de l’algorithme, que nous proposons, est r alis e afin d’obtenir un treillis complet des motifs ferm s (c’est- -dire incluant aussi la fermeture de l’ensemble vide). Toutefois, les arcs de succession imm diate, auxquelles la proc dure de construction Gen-Ordre d di e sera d crite dans la sous-section suivante, peuvent tre d termin s sans avoir ins rer au pr alable l’ensemble vide dans le treillis.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
La premi re phase de la proc dure Gen-GMs-suivants consiste d terminer l’ensemble qui est un sur-ensemble de l’ensemble des candidats de taille ( + ) (lignes 2-3). Chaque l ment de l’ensemble est d riv partir de deux g n rateurs minimaux fr quents de taille ayant ( - ) items en commun. Lors de la deuxi me phase et pour chaque l ment de , nous testons s’il v rifie l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux fr quents (lignes 4-14). En m me temps, nous calculons le support estim de et qui est gal au minimum des supports de ses sous-ensembles de taille (ligne 12). Des liens vers ces derniers sont stock s dans le champ sous-ens-directs et qui seront utilis s dans la seconde tape de l’algorithme Prince (ligne 13). Si ne v rifie pas l’id al d’ordre, alors est limin (lignes 9-11), sinon il est ajout (ligne 14). Une fois le test de l’id al d’ordre effectu , nous entamons la troisi me phase (lignes 15-22). Ainsi, un acc s au contexte d’extraction permettra de calculer les supports r els des candidats retenus dans (ligne 16). Une fois cet acc s effectu , le support r el de chaque candidat de , est compar son support estim (lignes 17-22). Si ces derniers sont gaux, alors n’est pas consid r comme un g n rateur minimal. Sinon, est un g n rateur minimal et la comparaison de son support r el avec minsupp permettra de le classer parmi les g n rateurs minimaux fr quents ou parmi ceux non fr quents (lignes 18-21). Apr s l’ex cution de ces trois phases, la proc dure Gen-GMs-suivants retourne l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille (ligne 23).
4.1.3. Structure de donn es utilis e
Du point de vue structure de donn es, nous avons utilis un unique arbre lexicographique [Bodon, Rónyai, 2003 ; Knuth, 1968] pour stocker les g n rateurs minimaux afin d’acc l rer l’extraction des informations qui seront utilis es lors des prochaines tapes. L’ensemble des g n rateurs minimaux tant un id al pour l’ordre d’inclusion, le chemin de la racine un nœud quelconque de l’arbre repr sente un g n rateur minimal. Ceci a pour avantage de r duire la n cessit en espace m moire compar e l’utilisation d’un arbre lexicographique pour chaque ensemble de g n rateurs minimaux de taille donn e, comme c’est le cas pour les algorithmes Close, A-Close et Titanic. Cette structure de donn es a t privil gi e dans plusieurs travaux, tels que [Bastide, 2000 ; Goethals, 2004]. Il est aussi noter qu’afin de rendre efficace le calcul des supports des motifs candidats, le contexte d’extraction a t lui aussi stock dans une structure d di e permettant d’optimiser l’espace m moire n cessaire au stockage des objets du contexte partageant les m mes items.
Dans la suite, nous allons noter par support, au lieu de support-r el, le champ contenant le support r el de chaque g n rateur minimal tant donn que nous n’avons plus distinguer le support r el et le support estim d’un motif.
4.2. construction du treillis des g n rateurs minimaux
L’objectif de cette tape est d’organiser les g n rateurs minimaux fr quents sous forme d’un treillis des g n rateurs minimaux. Pour construire le treillis, l’ensemble tri est alors parcouru en introduisant un par un ses l ments dans le treillis des g n rateurs minimaux partiellement construit. La couverture sup rieure de chaque classe d’ quivalence sera alors d termin e au fur et mesure. Dans la suite de cette sous-section et tant donn que nous allons construire le treillis d’Iceberg en comparant seulement des g n rateurs minimaux fr quents, chaque classe d’ quivalence sera caract ris e par un g n rateur minimal repr sentant. Ce repr sentant remplace donc le motif ferm associ dans la variante classique du treillis d’Iceberg (cf. la sous-section 2.1., page 2.1.).
Dans la suite, nous d notons par la relation d’ quivalence entre g n rateurs minimaux dans le sens que ssi et sont deux g n rateurs minimaux qui appartiennent la m me classe d’ quivalence (ou d’une mani re quivalente, admettent la m me fermeture de Galois). Les g n rateurs et sont dits quivalents.
Soit un g n rateur minimal fr quent . Nous noterons dans la suite le plus petit l ment, au sens de l’ordre lexicographique , de la classe d’ quivalence de . est gal au g n rateur minimal fr quent qui sera retenu comme repr sentant de la classe de par l’algorithme propos dans cette tape d di la construction du treillis des g n rateurs minimaux. À cet gard, dans la suite, par le terme successeur imm diat, nous entendons un g n rateur minimal fr quent repr sentant sauf indication contraire. Le treillis des g n rateurs minimaux est ainsi une relation d’ordre sur l’ensemble est un g n rateur minimal fr quent}.
4.2.1. D termination des liens de pr c dence
D’une mani re g n rale, afin de d terminer les liens de pr c dence entre les classes d’ quivalence de deux motifs et , nous comparons le support de ces motifs avec celui de leur union. À cet effet, la repr sentation concise des motifs fr quents bas e sur les g n rateurs minimaux fr quents et la bordure n gative non fr quente, extraite lors de l’ tape pr c dente, sera utilis e pour d terminer le support de l’union moyennant la Proposition 2 (cf. page 2). Ceci permet de construire le treillis d’Iceberg sans effectuer un acc s suppl mentaire au contexte d’extraction.
La Proposition 3 regroupe les diff rents cas possibles r sultants de la comparaison des supports de et de et pour lesquels les classes d’ quivalence associ es sont dites comparables. Sa preuve utilise le Lemme 3.
proposition 3.
Soient et deux motifs distincts tels que et leurs classes d’ quivalence respectives.
1. ssi .
2. (resp. est un successeur (resp. pr d cesseur) de ] (resp. ssi et .
démonstration 3.
Dans tous les autres cas, et sont dits incomparables. Le lemme suivant pr sente ces cas.
lemme 4.
et sont incomparables ssi et .
démonstration 4.
(CS) si et alors et ne peuvent v rifier aucune des deux clauses pr c dentes (cf. Proposition 3) ; ils sont donc incomparables.
(CN) soient et incomparables. Ils v rifient donc la conjonction (A) ci-dessous des n gations des deux premi res clauses :
(A) ou ou
et
ou (
et
ou (.
En remarquant que si , alors , et en notant et , la formule (A) se re crit :
(B) ou ou
et
ou
et
ou .
On cherche montrer qu’elle implique et . En d veloppant (B), on obtient la disjonction de 12 formules :
-
(1) et et
-
(2) et et
-
(3) et et
-
(4) et et
-
(5) et et
-
(6) et et
-
(7) et et
-
(8) et et
-
(9) et et
-
(10) et et
-
(11) et et
-
(12) et et
Il est simple de montrer que chacune des formules 1 12 implique la formule et .
Étant donn le tri impos dans l’ensemble par rapport au support de ses l ments, la classe d’ quivalence de chaque g n rateur minimal fr quent en cours de traitement ne peut qu’ tre successeur des classes d’ quivalence d j pr sentes dans le treillis partiellement construit (cf. Proposition 3). Les traitements associ s chaque g n rateur minimal fr quent sont d taill s dans la sous-section suivante.
4.2.2. Traitements associ s chaque g n rateur minimal fr quent
Chaque g n rateur minimal fr quent de taille ( ) est ins r dans le treillis des g n rateurs minimaux en le comparant avec les successeurs imm diats de ses sous-ensembles de taille ( - ). Ceci est bas sur la propri t d’isotonie de l’op rateur de fermeture [Ganter, Wille, 1999]. En effet, si est inclus dans tel que = ( - ) alors la fermeture de , est incluse dans la fermeture de , . Ainsi, la classe d’ quivalence [] de est un successeur – pas forc ment imm diat – de la classe d’ quivalence de .
En comparant la liste des successeurs imm diats de , disons , deux cas sont distinguer. Si est vide, alors sera simplement ajout , sinon, sera compar aux l ments appartenant . Dans ce dernier cas, la Proposition 3 est utilis e, en rempla ant par et par les l ments de . Soit un des l ments de . Nous distinguons alors deux cas lors du calcul du support de :
-
1.
Le support de est directement d riv si cet motif fait partie de la repr sentation extraite lors de la premi re tape. Le motif est alors un g n rateur minimal. Dans ce cas, [] et [] sont incomparables tant donn que est n cessairement strictement inf rieur celui de et celui de car sinon il ne serait pas un g n rateur minimal.
-
2.
Dans le cas o ne fait pas partie de la repr sentation, la Proposition 2 (cf. page 2) est appliqu e. La recherche du support s’arr te alors du moment qu’un g n rateur minimal inclus dans et ayant un support strictement inf rieur celui de et celui de est trouv . Dans ce cas, [] et [] sont incomparables. Si un tel g n rateur minimal n’a pas t trouv , nous nous trouvons alors dans un des deux cas explicit s par la Proposition 3 et il suffit alors de comparer les supports de , et pour savoir la relation r elle entre [] et [].
Dans la suite, nous d notons par l’ensemble des sous-ensembles imm diats de , c’est- -dire ceux de taille .
4.2.3. Gestion efficace des classes d’ quivalence
Lors de ces comparaisons et afin d’ viter une des lacunes des algorithmes adoptant la strat gie G n rer-et-tester, savoir le calcul redondant des fermetures, Prince utilise des traitements qui se compl tent. Ces derniers permettent de maintenir la notion de classe d’ quivalence tout au long du traitement. À cet effet, chaque classe d’ quivalence sera caract ris e par un repr sentant, qui est le premier g n rateur minimal fr quent ins r dans le treillis des g n rateurs minimaux. Tout g n rateur minimal fr quent est initialement consid r comme repr sentant de [] et le restera tant qu’il n’est pas compar un g n rateur minimal fr quent pr c demment ajout dans le treillis des g n rateurs minimaux et appartenant [].
Chaque g n rateur minimal , de taille , est compar avec les listes des successeurs , , …, et associ es respectivement ses sous-ensembles imm diats , , …, et . Lors de la comparaison d’un g n rateur minimal fr quent, disons , avec les l ments d’une liste de successeurs imm diats d’un autre g n rateur minimal fr quent, des traitements d di s la gestion efficace des classes d’ quivalence seront r alis s dans le cas o serait compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence, disons . Ils sont d crits comme suit :
-
1.
Toutes les occurrences de seront remplac es par dans les listes des successeurs imm diats o a t ajout .
-
2.
Les comparaisons de avec le reste des l ments de s’arr tent car elles ont t effectu es avec . Ceci permet de n’avoir que des repr sentants dans les listes des successeurs imm diats et n’affecte en rien le r sultat de la deuxi me tape, tant donn que et appartiennent la m me classe d’ quivalence.
-
3.
Soit le sous-ensemble imm diat de ayant permis sa comparaison avec . Le g n rateur doit tre aussi compar aux listes des successeurs du reste de ses sous-ensembles imm diats ( ). Ces comparaisons seront alors effectu es moyennant et non . Le but de poursuivre les comparaisons avec est de ne maintenir dans la liste des successeurs imm diats d’une classe d’ quivalence donn e que les g n rateurs minimaux fr quents repr sentants de leurs classes respectives. Par ailleurs, si a t d j compar la liste des successeurs d’un des sous-ensembles imm diats de , la comparaison de avec cette liste ne sera pas effectu e. Ceci permet d’ viter de comparer un g n rateur minimal une liste des successeurs imm diats plus d’une fois tant donn que les comparaisons qui en d coulent ne vont pas donner lieu de nouveaux arcs de succession imm diate.
Ainsi, pour chaque classe d’ quivalence, seul son repr sentant figure dans les listes des successeurs imm diats. Ceci permet d’optimiser la gestion des classes d’ quivalence en minimisant les comparaisons inutiles entre g n rateurs minimaux fr quents. Par ailleurs, un traitement d di permet de trouver, pour chaque g n rateur minimal fr quent , le repr sentant de sa classe d’ quivalence. Ceci permettra de compl ter la liste des successeurs imm diats de [], gale [], et qui est stock e au niveau du repr sentant . Ceci permet de n’avoir g rer qu’une seule liste de successeurs imm diats pour chaque classe d’ quivalence.
Ainsi, lors des comparaisons d’un g n rateur minimal fr quent avec les listes des successeurs de ses sous-ensembles imm diats, c’est- -dire les l ments de , deux traitements compl mentaires sont r alis s : un premier traitement leur est appliqu tant que n’est pas compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence. Ensuite, un deuxi me traitement leur est appliqu une fois la comparaison effectu e. La d finition suivante pr sente un sous-ensemble des repr sentants des classes d’ quivalence et qui r sulte de la comparaison d’un g n rateur minimal avec la liste des successeurs de .
définition 6.
Soit un g n rateur minimal de support et un sous-ensemble imm diat de (). est l’ensemble des repr sentants des classes tels que :
soit :
(1a) est de support et
(1b) est un successeur de et
(1c) est quivalent c’est- -dire appartiennent la m me classe d’ quivalence et
(1d) ;
soit :
(2a) est de support et
(2b) ou est un successeur de et
(2c) est successeur de et
(2d) pour tout repr sentant de support tel que est successeur de n’est pas successeur de .
Il est important de noter que l’ensemble s’il contient un l ment de support , il n’en contient qu’un savoir le repr sentant de la classe de . Si est le repr sentant de sa classe, alors ne contient aucun l ment de support , d’apr s (1c), puisque il est faux que . Tout l ment de , autre que le repr sentant de la classe de s’il existe dans cet ensemble, correspond un pr d cesseurs imm diat de r sultant de la comparaison de avec la liste des successeurs de (ou inversement, est un successeur imm diat de ). Soit . Il est noter que n’est jamais vide puisque peut tre confondu avec (condition (2b)) et que , sur-ensemble de , est successeur de .
Les deux lemmes suivants montrent la relation entre et les l ments de pour tout .
lemme 5.
(de validit ). Soit . Tous les couples du produit sont des arcs de succession imm diate, autrement dit, pour tout l ment de , est successeur imm diat de .
lemme 6.
(de compl tude). L’ensemble des arcs de succession imm diate qui « aboutissent » sur est gal au produit .
Rappelons maintenant que chaque classe d’ quivalence est repr sent e dans le treillis des g n rateurs minimaux travers son repr sentant. Ce dernier repr sente donc l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de sa classe dans le treillis et seul lui, parmi les g n rateurs de sa classe, figure dans les listes de succession imm diate. À cet gard, afin que la construction du treillis soit valide, deux conditions doivent tre v rifi es. La premi re consiste dans le fait que chaque classe d’ quivalence doit tre connect e sa couverture inf rieure une fois ses g n rateurs minimaux associ s trait s. La deuxi me condition impose que tous les g n rateurs minimaux fr quents appartenant la m me classe d’ quivalence doivent y tre inclus une fois leur traitement effectu . Le lemme suivant traite de la premi re condition et celui qui le suit de la seconde.
Ainsi, le Lemme 7 montre que tout lien de pr c dence entre deux classes d’ quivalence tel que l’une est successeur imm diat de l’autre sera construit une fois les g n rateurs minimaux associ s introduits dans le treillis des g n rateurs minimaux.
lemme 7.
Soient et les repr sentants de leur classe d’ quivalence. Si est successeur imm diat de , alors il existe un g n rateur minimal , et dans tels que ou est un successeur de .
démonstration 5.
Soit avec . L’item existe n cessairement car sinon serait inclus dans la fermeture de ce qui est en contradiction avec le fait que est un des g n rateurs minimaux d’une classe d’ quivalence successeur imm diat celle de .
Étant donn que est un successeur imm diat de . Il en d coule que .
Soit un g n rateur minimal inclus dans et ayant la m me fermeture que . contient forc ment l’item car sinon ce serait en contradiction avec le fait que soit un g n rateur minimal d’un ferm strictement inclus dans .
Soit le sous-ensemble imm diat de gal (). est un g n rateur minimal puisque l’est aussi. Par ailleurs, .
Deux cas sont alors distinguer :
– si , alors est gal un des sous-ensembles imm diats de , savoir . Il est ainsi vident que .
– si , alors est un des successeurs de . Par cons quent, est aussi un successeur de puisque .
Par cons quent, le lien de pr c dence entre la classe d’ quivalence de et celle de (elle-m me gale la classe d’ quivalence de puisque est construit, en comparant aux successeurs de son sous-ensemble imm diat .
Le lemme suivant prouve que si un g n rateur minimal fr quent n’est pas le repr sentant de sa classe d’ quivalence c’est- -dire , ou d’une mani re quivalente , alors sera compar au repr sentant de sa classe d’ quivalence lors de ses comparaisons avec les successeurs de ses sous-ensembles imm diats. Il est noter que si est l’unique g n rateur minimal de sa classe d’ quivalence ou est son repr sentant, le probl me ne se pose pas car il sera le premier g n rateur minimal de la classe tre trait . Ce lemme permet de montrer donc qu’une fois l’ensemble des g n rateurs minimaux de m me support ins r s dans le treillis, chaque classe d’ quivalence associ e contient tous ses g n rateurs minimaux.
lemme 8.
Si est un g n rateur minimal fr quent tel que , alors il existe un g n rateur minimal quivalent ( ) et pour lequel il existe tel que :
-
—
( est un successeur de )
et -
—
( est un successeur de ) si d signe le plus petit des l ments de au sens de l’ordre .
démonstration 6.
La condition du lemme impose la classe de d’avoir au moins deux l ments. Soit un g n rateur minimal fr quent dont la classe d’ quivalence au moins deux l ments. Elle ne peut donc pas tre la classe singleton contenant le seul g n rateur minimal fr quent vide. On pose le repr sentant de . On a . Puisque et sont minimaux et diff rents, on a : (1) et . Soient et les mots associ s et selon l’ordre 888 Si est un ensemble fini muni d’un ordre total , le mot associ tout sous-ensemble de est l’unique bijection de l’intervalle dans qui respecte l’ordre . Les mots associ s permettent d’ordonner lexicographiquement les parties de ., et . D’apr s la propri t (1) ci-dessus, il existe un unique indice , tel que et pour tout . On pose . On a , sinon on aurait . On consid re le plus petit l ment de au sens de l’ordre . Il est obtenu en enlevant son plus grand l ment au sens de l’ordre . On a donc . L’ensemble , qui peut tre vide, est un g n rateur minimal fr quent puisqu’il est inclus dans le g n rateur minimal fr quent et son support est strictement sup rieur .
On a (propri t des chemins ind pendants)
( et sont quivalents)
(idempotence de .
Puisque . L’ensemble est quivalent mais n’est pas un g n rateur minimal fr quent puisqu’il contient le g n rateur minimal fr quent . Il existe donc un sous-ensemble de tel que l’ensemble (qui est contenu dans ) est un g n rateur minimal fr quent de support , donc quivalent . Il est noter que l’ensemble est vide lorsque est de support . Soit 0, le mot associ au g n rateur minimal fr quent . Par construction, on a, pour tout et . Il en r sulte que . L’ensemble est un l ment de . est donc un g n rateur minimal fr quent de support . Il contient le g n rateur minimal fr quent , donc est un successeur de . Par ailleurs, le g n rateur minimal fr quent contenant le g n rateur minimal fr quent est un successeur de .
4.2.4. Pseudo-code de la deuxi me tape de l’algorithme Prince
Le pseudo-code de la deuxi me tape de l’algorithme Prince est donn par la proc dure Gen-Ordre (cf. Algorithme 3, page 3). Dans ce pseudo-code, gmf est l’abr viation de g n rateur minimal fr quent. À la fin de l’ex cution de la proc dure Gen-Ordre, le treillis des g n rateurs minimaux est construit et est gal la relation d’ordre sur l’ensemble des repr sentants des classes d’ quivalence, c’est- -dire . Le champ succs-imm diats associ un g n rateur minimal fr quent sera alors vide si ce dernier n’est pas le repr sentant de sa classe d’ quivalence ou si appartient une classe d’ quivalence n’ayant pas de successeurs. Sinon, cette liste ne contiendra que des repr sentants. La proc dure Gen-Ordre ins re un g n rateur minimal fr quent dans le treillis des g n rateurs minimaux en le comparant aux listes des successeurs imm diats de ses sous-ensembles de taille ( - ). Cette proc dure implante alors la coupure en deux parties compl mentaires du traitement de l’ num ration de , c’est- -dire avant que ne soit compar au repr sentant de sa classe et apr s.
Les notations utilis es dans le pseudo-code de cette proc dure sont comme suit sachant que le symbole permet de distinguer les objets de programmation des objets math matiques auxquels ils sont li s.
![[Uncaptioned image]](/html/1312.1558/assets/x3.png)
– La primitive parcours permet de parcourir tout ou une partie des l ments d’un ensemble.
– : est l’ensemble des repr sentants des classes.
– : est une application permettant d’associer chaque g n rateur minimal son repr sentant, c’est- -dire l’ l ment de qui lui est quivalent par .
– : est gal la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents par la relation d’ quivalence .
– , : est gal la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents de support n par .
– , : stocke la forme fonctionnelle de la partition des g n rateurs minimaux fr quents de support par .
– : est gal au treillis des g n rateurs minimaux fr quents, c’est- -dire, le treillis sur l’ensemble des repr sentants.
– _ : permet de stocker les pr d cesseurs imm diats de .
– : permet de stocker l’ l ment courant de .
– : permet de stocker le repr sentant de la classe de .
– : permet de stocker l’ l ment courant de , puis de .
Dans ce qui suit, nous d crivons en d tail le d roulement de Gen-Ordre :
-
1.
Dans la colonne de gauche, A.d signifie d but du bloc A et A.f signifie fin du bloc A. Il en est de m me pour les autres lettres.
-
2.
La proc dure Gen-Ordre traite l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents par support d croissant (cf. bloc A) et pour un ensemble de g n rateurs minimaux de m me support, elle les traite par ordre lexicographique (cf. bloc B). Pour chaque g n rateur minimal , les traitements qui lui sont associ s sont divis s en deux parties compl mentaires. La premi re s’int resse aux liens de succession imm diate obtenus avant la comparaison de avec le repr sentant de sa classe (cf. bloc C). La seconde parcours le reste des l ments de en utilisant pour faire les comparaisons avec les listes de successeurs.
-
3.
La proc dure Gen-Ordre a pour effet de calculer les variables $, $ et $treillis. Elles sont initialis es vide (ligne 1). Chaque it ration de la boucle A aura pour effet de prendre en compte les g n rateurs minimaux fr quent de support gal et de calculer les nouvelles valeurs des variables $, $ et $treillis. Les supports sont num r s dans l’ordre d croissant.
-
4.
L’int rieur de l’ num ration B, est en trois parties :
-
—
ligne 2 + bloc C : d but du parcours des l ments de et actions associ es. Le parcours s’arr te soit parce qu’il est arriv son terme, soit parce qu’il a rencontr le repr sentant de la classe de (ligne 6) ;
-
—
bloc E + ligne 10 : actions conclusives de la partie pr c dente ;
-
—
bloc F : suite et fin du parcours des l ments de et actions associ es.
-
—
-
5.
L’ num ration des l ments de est en deux parties distingu es : bloc C et bloc F. Dans le bloc C, l’algorithme ne conna t pas le repr sentant de et travaille avec l’ensemble tandis que, dans le bloc F, il conna t le repr sentant de et travaille avec l’ensemble .
-
6.
À l’int rieur du bloc C, le bloc D parcourt les l ments de ) (bloc D). Si est de support , il s’agit d’un pr d cesseur imm diat de . Il est provisoirement stock comme tel dans la variable $pred_g (ligne 5). Si est de support = , il s’agit du repr sentant de . D s lors le parcours D s’arr te avant son terme (ligne 6) et le parcours C sera alors suspendu (ligne 7) et reprendra plus tard (bloc F).
-
7.
bloc conclusif : le parcours C s’arr te avant son terme lorsque l’ensemble contient le repr sentant de . La variable est alors gale ce repr sentant. L’ensemble $ des l ments quivalents est donc augment de (ligne 8). Dans le cas o le parcours C s’arr te son terme, n’a pas de repr sentant : il devient le repr sentant de sa classe et est donc ajout comme tel l’ensemble $ des repr sentants (ligne 9). Enfin, les affectations la fin de la ligne 8 et la fin de la ligne 9, font qu’en sortie du bloc E, avant la ligne 10, la variable est gale au repr sentant de . La ligne 10 met alors jour la variable $treillis.
-
8.
le bloc F (partie 3) r alise ce qui reste r aliser du parcours des l ments de . À l’int rieur du bloc F, le bloc parcourt les l ments de . Si le support de l’ l ment courant est , il s’agit d’un pr d cesseur imm diat de . La variable $treillis est alors mise jour (ligne 13). Si son support est gal , alors . La ligne 14 arr te le parcours G puisque la comparaison de avec la liste des successeurs a t d j effectu e et ne va donc pas donner lieu de nouveaux liens de succession imm diate.
Il est important de noter le lien entre les objets math matiques et et les objets de programmation $ et $, qui leurs sont respectivement associ s. En effet, les ensembles et d pendent du treillis tout entier. Or, de ce treillis, la proc dure Gen-Ordre n’a que la partie stock e par la variable $treillis. L’id e qui sous-tend cette proc dure est que la partie du treillis stock e par la variable $treillis suffit au calcul des ensembles . À cet gard, nous introduisons les ensembles $). Leur d finition est calqu e sur celle des ensembles . La diff rence est qu’elle utilise l’ordre stock dans $treillis. Dans la d finition ci-dessous, « successeur » signifie « successeur au sens de la Proposition 3 », tandis que « $successeur » signifie « successeur selon l’ordre stock dans la variable $treillis ». La d finition de $ est ainsi comme suit :
définition 7.
Soient un g n rateur minimal de support et un sous-ensemble de de cardinal . Soit $ l’ensemble des de $ tels que :
soit :
(1a) est de support et
(1b) est un $successeur de et
(1c) est quivalent (selon la Proposition 3) et
(1d) ;
soit :
Il en r sulte qu’ la ligne D.d de la proc dure Gen-Ordre, . Par ailleurs, la ligne G.d de la proc dure Gen-Ordre, . On peut donc remplacer dans le pseudo-code, l’occurrence de par $ et celle par $.
remarque 2.
– Si nous avions opt pour n’importe quel autre ordre dans le tri de (par exemple, tri par ordre croissant par rapport aux supports) et si la classe d’ quivalence de est incomparable avec celles des l ments de , les comparaisons de avec les listes des successeurs imm diats des l ments de seraient dans ce cas obligatoires. En effet, deux classes d’ quivalence incomparables (celle de et celle d’un repr sentant appartenant ) peuvent avoir des successeurs en commun, existants d j dans le treillis des g n rateurs minimaux. Ainsi, tout autre choix de tri augmenterait consid rablement le nombre, et par cons quent le co t, des comparaisons pour construire le treillis des g n rateurs minimaux.
– Lors de la premi re tape, Prince adopte l’optimisation introduite par A-Close pour d tecter le niveau partir duquel les g n rateurs minimaux fr quents ne sont plus forc ment des ferm s. Ceci permettra, lors de la seconde tape, d’optimiser encore plus la construction de la relation d’ordre : une partie (ou quasiment la totalit ) du treillis pouvant tre d j construite d s la premi re tape. En effet, lorsque le motif ferm fr quent se confond avec son g n rateur c’est- -dire la classe d’ quivalence associ e ne contient qu’un seul motif), ses pr d cesseurs imm diats seront ses sous-ensembles imm diats. Les liens vers ces derniers tant stock s dans le champ sous-ens-directs, nous avons ainsi les pr misses n cessaires pour extraire les r gles approximatives valides. Par ailleurs, aucune r gle exacte ne peut tre extraite dans ce cas.
Nous allons maintenant d crire les invariants de la proc dure Gen-Ordre. Rappelons qu’un invariant d’un algorithme est un couple () compos d’une propri t liant certaines variables de l’algorithme et d’un endroit, un lieu, dans ledit algorithme tel que la propri t est vraie chaque fois que l’algorithme passe l’endroit . Dans ce sens, l’invariant au d but de la boucle B.d est donn par le lemme suivant.
lemme 9.
Soit ) l’ensemble des pr d cesseurs imm diats de qui sont soit des successeurs de , soit gaux , avec et deux repr sentants de leur classe d’ quivalence ). Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux de support = et treillis la restriction du treillis treillis l’ensemble des repr sentants de support .
L’ galit suivante : max( avec = () est un invariant au d but de la boucle B de la proc dure Gen-Ordre.
Les invariants qui r gissent la relation d’ quivalence entre g n rateurs minimaux fr quents, savoir l’ volution des variables $ et $ sont indiqu s dans le pseudo-code sous forme de couples (, ), dans lesquels identifie un lieu dans l’algorithme et une propri t . Dans ce cadre, les invariants (, ) et (, ) signifient que tous les g n rateurs minimaux trait s avant le g n rateur minimal courant ont t correctement plac s dans leur classe. Le lemme suivant prouve la validit de ces invariants.
lemme 10.
Tous les couples (, ), = , , , sont des invariants de la proc dure Gen-Ordre.
démonstration 7.
(partielle) La preuve du lemme se construit partir de deux r currences imbriqu es l’image de l’imbrication des boucles A et B. La r currence ext rieure tablit que les couples (, ), = , sont des invariants ; la r currence int rieure tablit que, pour une valeur donn e du support , les couples (, ), = , sont des invariants. La seule difficult de la d monstration consiste montrer que si les propri t s sont vraies en , = , , alors les propri t s sont vraies en . Notons aussi que la diff rence entre et est la substitution du signe au signe . Nous d veloppons ici uniquement cette preuve. Elle utilise le Lemme 8. Soit le g n rateur minimal fr quent courant de la boucle B. On suppose que les propri t s sont vraies en , = , . Deux cas se pr sentent selon que est ou n’est pas le repr sentant de sa classe.
cas 1 : est le repr sentant de sa classe, . Dans ce cas, quel que soit dans , l’ensemble ne contient pas . L’instruction 6 n’est donc jamais ex cut e et le parcours D (variable se termine son terme. Il en r sulte que l’instruction 7 n’est jamais ex cut e et que le parcours C (variable se termine lui aussi son terme. Dans le bloc conclusif E, l’instruction 9 est alors ex cut e. Elle augmente la variable $ du g n rateur minimal fr quent et initialise la variable $ avec le singleton . Ces modifications conduisent, partir de (, ), = , (, ), = , .
cas 2 : n’est pas le repr sentant de sa classe. On a , donc est stock dans la variable $, d’apr s l’hypoth se . Il r sulte du Lemme 8 que sera compar . Le parcours D sera donc arr t avant son terme par l’instruction 6 et le parcours C sera suspendu par l’instruction 7. D s lors, l’instruction 8 du bloc conclusif E sera ex cut e. Elle int gre dans sa classe. Il en r sulte que la propri t est v rifi e en . Par ailleurs, la propri t est (trivialement) v rifi e en . En effet, la variable $ n’ tant pas modifi e, la propri t est v rifi e, apr s le bloc conclusif E, en . Or, ( et (() )) .
4.3. extraction des bases g n riques de r gles
Dans cette derni re tape, Prince extrait les r gles g n riques informatives valides form es par l’union de la base g n rique de r gles exactes et de la r duction transitive de la base informative de r gles approximatives.
4.3.1. D rivation des motifs ferm s fr quents et des r gles informatives
Pour chaque classe d’ quivalence du treillis d’Iceberg, Prince d rive simplement le motif ferm fr quent correspondant via l’application de la proposition donn e ci-dessous, dont la preuve utilise le th or me suivant :
théorème 1.
Soient et l’ensemble de ses g n rateurs minimaux. Si tel que couvre dans le treillis d’Iceberg ) alors est un bloqueur minimal de [Pfaltz, Taylor, 2002].
proposition 4.
Soient et tels que couvre dans le treillis d’Iceberg ). Soit l’ensemble des g n rateurs minimaux de . Alors, le motif ferm fr quent est gal :
démonstration 8.
Étant donn que l’union des l ments de est un bloqueur de , la face , qui est un bloqueur minimal pour d’apr s Th or me 1, est incluse dans l’union des l ments de . Ainsi, il suffit de calculer l’union de avec les l ments de pour d river .
Il est noter que la Proposition 4 a pour avantage d’assurer l’extraction sans redondance de l’ensemble des motifs ferm s fr quents. En effet, chaque motif ferm n’est d termin qu’une seule fois.
4.3.2. Pseudo-code de la troisi me tape de l’algorithme Prince
Le pseudo-code de cette tape est donn par la proc dure Gen-BGRs (cf. Algorithme 4)999 BGR est l’acronyme de Base G n rique de R gles.. Dans la proc dure Gen-BGRs, d signe la liste des classes d’ quivalence partir desquelles sont extraites les r gles d’association informatives. Par , nous d signons la liste des classes d’ quivalence qui couvrent celles formant .
-
1.
Le motif ferm fr quent de chaque classe d’ quivalence.
-
2.
La base g n rique de r gles exactes .
-
3.
La r duction transitive des r gles approximatives .
1
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
L’ensemble des r gles informatives exactes est initialement vide(ligne 2). Il en est de m me pour l’ensemble des r gles informatives approximatives (ligne 3). Le parcours du treillis des g n rateurs minimaux s’effectue d’une mani re ascendante en partant de la classe d’ quivalence dont le g n rateur est l’ensemble vide (not e []). Ainsi, est initialis e par ce g n rateur minimal (ligne 4). Rappelons que la fermeture de l’ensemble vide a t d j calcul e d s la premi re tape en collectant les items qui se r p tent dans tous les objets (cf. lignes 7-8 de l’algorithme 1, page 1). La liste est initialement vide (ligne 5). Les traitements de cette tape s’arr tent lorsqu’il n’y a plus de classes d’ quivalence partir desquelles seront extraites des r gles g n riques (ligne 6). Si la fermeture de l’ensemble vide n’est pas nulle, la r gle exacte informative mettant en jeu l’ensemble vide et sa fermeture sera extraite (lignes 8-9). Ayant l’ordre partiel construit, Gen-BGRs extrait les r gles approximatives informatives valides mettant en jeu l’ensemble vide et les motifs ferm s fr quents de la couverture sup rieure de [] (lignes 10-15). Ces fermetures sont d riv es en appliquant la Proposition 4 aux g n rateurs minimaux fr quents de chaque classe d’ quivalence et la fermeture de l’ensemble vide (ligne 10). Cette couverture sup rieure est stock e afin que le m me traitement soit r alis pour les classes d’ quivalence la composant (ligne 11). Une fois les traitements relatifs la classe d’ quivalence de l’ensemble vide termin s, prendra pour valeur le contenu de (ligne 16) afin d’appliquer le m me processus aux classes d’ quivalence qui sont successeurs imm diats de []. est initialis e de nouveau au vide (ligne 17) et contiendra les successeurs imm diats des classes d’ quivalence contenues dans . Étant donn qu’une classe d’ quivalence peut avoir plusieurs pr d cesseurs imm diats, un test est r alis pour v rifier qu’elle n’a pas t d j ins r e dans . Ce test consiste v rifier si le motif ferm fr quent correspondant a t d j calcul (ligne 11). De la m me mani re, Gen-BGRs traite les niveaux sup rieurs du treillis des g n rateurs minimaux jusqu’ atteindre ses sommets (c’est- -dire les classes d’ quivalence n’ayant pas de successeurs). serait alors vide et la condition de la ligne 6 ne sera plus v rifi e. Ainsi, la troisi me tape de l’algorithme Prince prend fin et toutes les r gles g n riques sont extraites.
remarque 3.
Il est important de noter que dans [Zaki, 2004], l’auteur montre que les bases g n riques offrent un facteur de r duction du nombre total de r gles pouvant atteindre , o tant la taille de le motif fr quent le plus long (par rapport au nombre d’items).
exemple 5.
Afin d’illustrer le d roulement de l’algorithme Prince, consid rons le contexte d’extraction donn par la figure 1 (Gauche) pour minsupp = 2 et minconf = 0,50. La premi re tape permet de d terminer l’ensemble des g n rateurs minimaux tri , ainsi que la bordure d-. = (, 5), (B, 4), (C, 4), (E, 4), (A, 3), (BC, 3), (CE, 3), (AB, 2), (AE, 2) et d- = (D, 1). Dans la deuxi me tape, Prince parcourt en comparant chaque g n rateur minimal fr quent de taille aux listes des successeurs imm diats de ses sous-ensembles de taille . L’ensemble vide, n’ayant aucun sous-ensemble, est ins r directement dans le treillis des g n rateurs minimaux (cf. Figure 3.a). Ensuite, B est ajout .succs-imm diats (cf. Figure 3.b), la liste des successeurs imm diats du , initialement vide. Ensuite, C sera compar B. Le motif BC tant un g n rateur minimal, B et C sont alors incomparables et C est ajout .succs-imm diats (cf. Figure 3.c). Le g n rateur minimal fr quent E est alors compar cette liste. En comparant E B, nous avons E.support = B.support = Supp(BE). Ainsi, E B, dont B est le repr sentant (cf. Figure 3.d). Afin de ne maintenir que des repr sentants dans les listes des successeurs imm diats, les occurrences de E s’il y en a seront ainsi remplacer par B dans des listes des successeurs imm diats (dans ce cas, il n’y a aucune occurrence) et les comparaisons seront poursuivre avec B au lieu de E (dans ce cas, il n’y a plus de comparaisons faire via E). Les traitements s’arr tent alors pour E. À ce moment du traitement, .succs-imm diats = B, C. Le g n rateur minimal fr quent A est alors compar B. Comme AB , B et A sont incomparables. Par contre, en comparant A et C, A.support C.support et A.support = Supp(AC) et donc A est un successeur de C. Le g n rateur minimal fr quent A est tout simplement ajout C.succs-imm diats tant donn qu’elle est encore vide (cf. Figure 3.e). Le motif BC est compar aux listes des successeurs imm diats de B et de C. La liste des successeurs imm diats de B est vide, BC est alors ajout . La liste des successeurs imm diats de C contient A. Le g n rateur minimal fr quent BC est alors compar A et comme BC.support = A.support mais BC.support Supp(ABC), BC et A sont incomparables et BC est donc ajout C.succs-imm diats (cf. Figure 3.f). Le motif CE est compar aux listes des successeurs imm diats de C et de E. Celle de C contient A et BC. Les classes d’ quivalence CE et A sont incomparables, puisque CE.support = A.support mais CE.support Supp(ACE). En comparant CE BC, CE.support = BC.support = Supp(BCE) alors le motif CE va tre affect la classe d’ quivalence de BC et les traitements d di s la gestion efficace des classes d’ quivalence sont invoqu es (cf. Figure 3.g). En particulier, les comparaisons de CE aux successeurs imm diats de E seront faites avec BC qui est le repr sentant de la classe associ e. Comme E a pour repr sentant B, BC est donc compar aux l ments de B.succs-imm diats. Cependant, comme B.succs-imm diats ne contient que BC alors les comparaisons se terminent. Le m me traitement est appliqu pour AB et AE. Ainsi, la proc dure de construction de l’ordre partiel prend fin. Le treillis des g n rateurs minimaux obtenu est donn par la Figure 3.h. Pour la d rivation des r gles g n riques, le treillis des g n rateurs minimaux est parcouru d’une mani re ascendante partir de . Comme , il n’y a donc pas de r gle exacte informative relative . Nous avons .succs-imm diats = B, C. Le motif ferm fr quent correspondant B est alors d riv et est gal BE (cf. Figure 3.i). La r gle informative approximative valide de support 4 et de confiance 0,80 sera alors extraite. Il en est de m me pour la r gle , ayant les m mes valeurs de support et de confiance que la pr c dente. De la m me mani re et partir de B et C, le parcours du treillis se fait d’une fa on ascendante jusqu’ extraire toutes les r gles d’association informatives valides.
À la fin de l’ex cution de l’algorithme, nous obtenons le treillis d’Iceberg associ au contexte d’extraction (cf. Figure 3.i)101010 Dans la Figure 3.i, les fl ches indiquent les liens de pr c dence utilis s pour d river les motifs ferm s fr quents. ainsi que la liste les r gles informatives valides, donn e par la Figure 3.
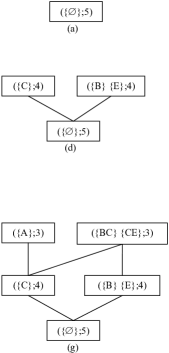
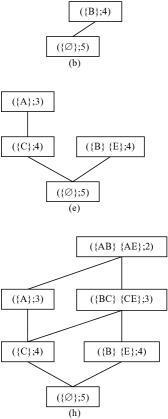
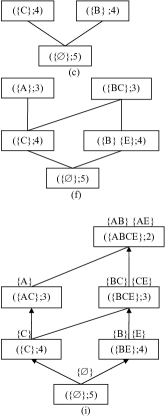
| R gles informatives exactes |
|---|
| : EB (4) |
| : BE (4) |
| : AC (3) |
| : BCE (3) |
| : CEB (3) |
| : ABCE (2) |
| : AEBC (2) |
| R gles informatives approximatives | |
|---|---|
| : BE (4) | : EBC (3) |
| : C (4) | : ABCE (2) |
| : CA (3) | : BCAE (2) |
| : CBE (3) | : CEAB (2) |
| : BCE (3) | |
5. PROPRIÉTÉS DE L’ALGORITHME Prince
Dans ce qui suit, nous allons prouver diff rentes propri t s associ es l’algorithme Prince.
5.1. preuves de validit , de terminaison et de compl tude
Dans cette sous-section, nous allons montrer la validit de l’algorithme Prince, puis sa terminaison et sa compl tude.
proposition 5.
L’algorithme Prince est valide. En effet, il permet de d terminer tous les motifs ferm s fr quents, leurs g n rateurs minimaux associ s ainsi que toutes les r gles g n riques informatives valides.
démonstration 9.
Nous allons montrer la validit de Prince en montrant la validit de chacune des tapes le constituant.
-
1.
premi re tape : D termination des g n rateurs minimaux
Prince d termine tous les g n rateurs minimaux fr quents ainsi que la bordure n gative non fr quente. En effet, Prince parcourt l’espace de recherche par niveau (et donc par taille croissante des candidats g n rateurs minimaux). Tout au long de ce parcours, Prince limine tout candidat ne pouvant pas tre un g n rateur minimal. L’ lagage d’un tel candidat est bas sur la Proposition 1 et le Lemme 3.
-
2.
deuxi me tape : Construction du treillis des g n rateurs minimaux
Chaque g n rateur minimal est ins r dans le treillis des g n rateurs minimaux via sa comparaison avec les listes des successeurs imm diats des classes d’ quivalence auxquelles appartiennent ses sous-ensembles de taille ( - ). Au moment de l’introduction de , les classes d’ quivalence de ses sous-ensembles de taille ( - ) ont t d j ins r es dans le treillis des g n rateurs minimaux. En effet, le support des g n rateurs minimaux fr quents composant chacune de ces classes d’ quivalence est strictement sup rieur celui de . Par ailleurs, lors des comparaisons de avec les l ments des listes des successeurs de l’ensemble (), les diff rents cas possibles sont g r s moyennant la Proposition 3 (cf. page 3).
Ainsi, chaque liste des successeurs imm diats est compar e tous les g n rateurs minimaux fr quents susceptibles d’y appartenir. Les traitements s’arr tent lorsqu’il n’y a plus de g n rateurs minimaux fr quents introduire dans le treillis des g n rateurs minimaux.
-
3.
troisi me tape : Extraction des bases g n riques informatives de r gles
Dans cette tape, le parcours du treillis des g n rateurs minimaux se fait en partant de []. Toute classe d’ quivalence , autre que [], admet au moins un pr d cesseur imm diat. La classe sera donc incluse dans au moins une couverture sup rieure d’une autre classe d’ quivalence. Ceci permettra de l’inclure dans la liste des classes d’ quivalence traiter lors de la prochaine it ration (c’est- -dire dans la liste L2 de l’Algorithme 4, page 4). Les traitements s’arr tent lorsque les couvertures sup rieures des classes d’ quivalence trait es en dernier sont vides. Ainsi, toutes les classes d’ quivalence du treillis d’Iceberg seront trait es. En appliquant la Proposition 4 (cf. page 4), tous les motifs ferm s fr quents sont d riv s au fur et mesure de ce parcours ascendant. Les r gles g n riques informatives valides sont alors extraites d’une mani re directe.
proposition 6.
L’algorithme Prince termine dans tous les cas et son r sultat est complet.
démonstration 10.
Montrons que l’algorithme Prince termine quel que soit le contexte d’extraction donn en entr e et quelles que soient les valeurs de minsupp et minconf. Étant donn que le nombre de couples du contexte d’extraction est fini, le nombre de g n rateurs minimaux fr quents extraits du contexte lors de la premi re tape est fini. Afin de construire le treillis d’Iceberg, les comparaisons entre g n rateurs minimaux sont de nombre fini tant donn que le nombre d’ l ments de chaque liste de successeurs imm diats est fini. Il en est de m me pour le nombre de g n rateurs minimaux fr quents d j ins r s dans le treillis partiellement construit lors du traitement d’un g n rateur donn . De m me le treillis d’Iceberg parcouru lors de la troisi me tape a une taille finie, gale au nombre de ses classes d’ quivalence.
Le r sultat de l’algorithme Prince est complet tant donn que la construction du treillis d’Iceberg assure l’exhaustivit des l ments (les g n rateurs minimaux fr quents) de chaque classe d’ quivalence. De m me, elle assure l’exhaustivit des l ments de la liste des successeurs imm diats de chaque classe d’ quivalence. Les traitements effectu s lors de la troisi me tape prennent ainsi en compte toutes les classes d’ quivalence.
5.2. complexit de l’algorithme Prince
Dans cette sous-section, nous allons tudier la complexit th orique au pire des cas de l’algorithme Prince.
proposition 7.
Dans le pire des cas, la complexit de l’algorithme Prince est , o (resp. ) est le nombre d’items (resp. objets) du contexte d’extraction.
démonstration 11.
Soit un contexte d’extraction = (, , ), le pire des cas est obtenu quand le nombre de g n rateurs minimaux fr quents est gal au nombre de motifs fr quents et est gal au nombre de motifs ferm s fr quents (c’est- -dire 2|I|). En d’autres termes, chaque g n rateur minimal fr quent est aussi un ferm et le treillis des g n rateurs minimaux se confond avec le treillis des motifs fr quents.
Soient = et = . La taille maximale d’un objet est gale au nombre maximum d’items distincts, c’est- -dire . Nous allons consid rer que tous les objets ont pour longueur . Pour chaque objet et dans le pire des cas, nous d terminons ses 2n sous-ensembles afin de calculer les supports des motifs. Nous allons calculer la complexit th orique au pire des cas de l’algorithme Prince en calculant la complexit au pire des cas de chacune des trois tapes le constituant.
-
—
premi re tape : D termination des g n rateurs minimaux
- 1.
-
2.
Le co t du calcul des supports des items est de l’ordre de (ligne 3).
-
3.
Les affectations des lignes 4-5 se font en .
-
4.
Le co t de l’ lagage par rapport aux supports des items est de l’ordre de (lignes 6-14).
-
5.
Le co t de la d termination des g n rateurs minimaux fr quents de tailles sup rieures ou gales 2 (lignes 15-16) est gal la somme des co ts suivants :
- (a)
-
(b)
Le co t de la v rification de l’id al d’ordre, et en m me temps, le calcul du support estim et le stockage des liens vers les sous-ensembles ad quats est de l’ordre de (lignes 4-14) ;
-
(c)
Le co t du calcul des supports des candidats de tailles sup rieures ou gales 2 est de l’ordre de (ligne 16) ;
-
(d)
Le co t de l’ lagage par rapport aux supports des candidats est de l’ordre de (lignes 17-22).
La complexit de cette tape est alors : = = .
Étant donn que 2n est largement sup rieur , alors = = = = .
D’o , = .
-
—
deuxi me tape : Construction du treillis des g n rateurs minimaux
- 1.
-
2.
Pour chaque g n rateur minimal fr quent de support et de taille , la boucle parcours du bloc C se r p te fois tant donn que admet sous-ensembles de taille ( - ) (, le nombre de sous-ensembles, sera largement major par ). Pour chaque sous-ensemble de de taille ( - ), disons , les traitements suivants sont r alis s :
-
(a)
Le co t du rep rage du repr sentant de la classe de est en tant donn que dans le pire des cas, est le seul g n rateur minimal fr quent de sa classe d’ quivalence et est donc son repr sentant ( est gal ()).
-
(b)
Le motif , tant de taille gale ( - ), poss de au maximum - ( - ) - successeurs imm diats, au moment de l’int gration de dans le treillis des g n rateurs minimaux ( - ), le nombre maximal de successeurs imm diats, sera largement major par ). Afin de d terminer l’ensemble (, , ), est ainsi compar chaque l ment de la liste des successeurs imm diats de , c’est- -dire, .succs-imm diats. Le co t de la comparaison de avec est la somme des deux co ts suivants :
-
i.
Le premier co t est relatif l’union de et et qui est, au pire des cas, de l’ordre de . Soit , le motif r sultat de cette union.
-
ii.
Le second co t est relatif la recherche du support ad quat de et qui est, au pire des cas, de l’ordre de . Notons que le motif est un g n rateur minimal fr quent. En effet, est inclus dans le motif contenant tous les items, c’est- -dire le motif . Or, ce dernier – dans le pire des cas – est un g n rateur minimal fr quent et d’apr s la propri t de l’id al d’ordre des g n rateurs minimaux fr quents (cf. Proposition 1, page 1), est un g n rateur minimal fr quent.
Étant donn que l’union de avec tout l ment de .succs-imm diats donne toujours un g n rateur minimal, aucune des deux conditions sp cifi es par la Proposition 3 (cf. page 3) n’est v rifi e. Ainsi, [] est incomparable avec toutes les classes d’ quivalence des repr sentants successeurs imm diats de . Par cons quent, (, , ) contient seulement ( tant repr sentant de sa classe). Le motif est donc ajout en tant que successeur imm diat de en .
-
i.
-
(a)
Ainsi, la complexit de cette tape est de l’ordre de : = = .
D’o , = .
-
—
troisi me tape : Extraction des bases g n riques informatives de r gles
- 1.
-
2.
La condition de la boucle tant que est v rifi e tant qu’il y a des classes d’ quivalence traiter (ligne 6). Dans le pire des cas, chaque g n rateur minimal fr quent ferm forme une classe d’ quivalence. Ainsi, classes d’ quivalence sont trait es. Pour chaque classe d’ quivalence (ligne 7), le co t total de cette tape est gal la somme des deux co ts suivants :
-
(a)
Le premier co t consiste d river la fermeture correspondante . Cette derni re est le r sultat de l’union du g n rateur minimal fr quent de avec la fermeture d’un de ses pr d cesseurs imm diats (lignes 11-13). Ceci est r alis , au pire des cas, en .
-
(b)
Le deuxi me co t est relatif l’extraction des r gles d’association informatives.
-
i.
Étant donn que, le g n rateur minimal fr quent de est gal sa fermeture, la condition de la ligne 8, test e en , n’est pas v rifi e. Ainsi, aucune r gle exacte informative n’est extraite (ligne 9).
-
ii.
Soit la taille de le motif ferm fr quent de . La classe poss de alors pr d cesseurs imm diats. Ainsi, pour une valeur de minconf gale 0, r gles approximatives informatives valides sont extraites (lignes 14-15). Le co t de l’extraction de chacune des r gles approximatives est gal au co t du calcul de la diff rence entre la pr misse et la conclusion et qui est, au pire des cas, de l’ordre de .
Le co t total, pour chaque classe d’ quivalence, est alors de l’ordre de (la taille d’un motif ferm fr quent tant largement major e par ).
-
i.
-
(a)
La complexit de cette tape est alors de l’ordre de : = ).
D’o , = .
Au pire des cas, la complexit totale de l’algorithme Prince est de l’ordre de : = + + = + + = = . D’o , = .
Ainsi, la complexit de Prince est de m me ordre de grandeur que celle des algorithmes d di s l’extraction des motifs ferm s fr quents [Godin & al., 1995 ; Pasquier, 2000 ; Stumme & al., 2002], bien qu’il d termine les trois composantes n cessaires l’extraction des bases g n riques de r gles d’association.
6. ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE
Dans cette section, nous pr sentons les performances de Prince compar es celles des algorithmes Close, A-Close et Titanic. Prince est implant en langage C 111111 Une version de l’algorithme Prince est disponible l’adresse suivante :
http://www.cck.rnu.tn/sbenyahia/software_release.htm. tandis que les trois autres algorithmes le sont en C++. Toutes les exp rimentations ont t r alis es sur un PC muni d’un processeur Pentium IV ayant une fr quence d’horloge de 2,40 GHz et 512 Mo de m moire RAM (avec 2 Go de swap) tournant sous la plate-forme S.u.S.E Linux 9.0. Les programmes ont t compil s avec le compilateur gcc 3.3.1.
Dans le cadre de nos exp rimentations, nous avons comptabilis le temps d’ex cution total des algorithmes sur des contextes de r f rence denses et pars121212 L’ensemble de ces contextes est disponible [Goethals, 2004]. ainsi que sur des contextes « pire des cas » [Hamrouni & al., à paraître]. La d finition d’un contexte « pire des cas » est comme suit :
définition 8.
Un contexte « pire des cas » est un contexte o la taille de l’ensemble des items est gale et celle de l’ensemble des objets est gale ( + ). Dans cette base, chaque item est v rifi par objets diff rents. Chaque objet, parmi les premiers, est v rifi par ( - ) items diff rents. Le dernier objet est v rifi par tous les items. Les objets sont tous diff rents deux deux. Les items sont tous diff rents deux deux.
Les caract ristiques des contextes test s sont r sum es par le Tableau 2. Typiquement, les quatre premiers contextes sont consid r s comme denses, c’est- -dire qu’ils produisent plusieurs motifs fr quents longs m me pour des valeurs de supports lev es [Bayardo, 1998]. Le reste des contextes test s sont consid r s comme pars. T10I4D100K et T40I10D100K sont deux contextes synth tiques g n r es par un programme d velopp dans le cadre du projet dbQuest131313 Le g n rateur des bases synth tiques est disponible l’adresse suivante :
http://www.almaden.ibm.com/software/quest/resources/datasets/data/.. Les autres contextes de r f rence sont r els.
| T | Taille moyenne des objets |
|---|---|
| I | Taille moyenne des motifs maximaux potentiellement fr quents |
| D | Nombre d’objets g n r s |
| Contextes de r f rence | Type du | Nombre | Nombre | Taille moyenne |
|---|---|---|---|---|
| contexte | d’items | d’objets | d’un objet | |
| Pumsb | Dense | 7 117 | 49 046 | 74 |
| Connect | Dense | 129 | 67 557 | 43 |
| Chess | Dense | 75 | 3 196 | 37 |
| Mushroom | Dense | 119 | 8 124 | 23 |
| T10I4D100K | Épars | 1 000 | 100 000 | 10 |
| T40I10D100K | Épars | 1 000 | 100 000 | 40 |
| Retail | Épars | 16 470 | 88 162 | 10 |
| Accidents | Épars | 469 | 340 183 | 33 |
| Contexte « pire des cas » | Épars | + |
Pour l’algorithme Prince et dans toutes les figures qui vont suivre, nous utilisons un minconf gal 0 %, c’est- -dire que nous avons consid r , pour une valeur de minsupp fix e, le pire des cas par rapport au nombre de r gles g n r es. En outre, tout au long de cette section, les figures pr sent es ont une chelle logarithmique. Dans les tableaux comparatifs des temps d’ex cution, nous avons arrondi les valeurs l’entier le plus proche pour les avoir toutes en seconde tant donn les carts dans les temps d’ex cution des algorithmes. Par ailleurs, « / » signifie que l’ex cution ne s’est pas termin e correctement et que le ratio correspondant ne peut tre calcul .
Avant de nous int resser aux performances de Prince, nous donnons titre indicatif un exemple montrant l’utilit du couple de bases (, ) dans la r duction sans perte
d’information du nombre de r gles offertes l’utilisateur. Par exemple, pour le contexte Mushroom et pour un minsupp = 10 %, la taille de (, ) est gale 33 762 alors que celle de l’ensemble de toutes les r gles valides141414 Fourni par l’impl mentation de Bart Goethals disponible :
http ://www.adrem.ua.ac.be/∼goethals/software/. est gale 380 791 946, ce qui constitue un taux de r duction gal 1 127,88 fois. Ceci montre clairement que l’extraction des bases g n riques est plus avantageuse que l’extraction de toutes les r gles et confirme les r sultats obtenus dans d’autres travaux tels que [Ashrafi & al., 2007 ; Ceglar, Roddick, 2006 ; Kryszkiewicz, 2002 ; Zaki, 2004].
6.1. performances de Prince versus Close, A-Close et Titanic
6.1.1. Exp rimentations sur les contextes denses
Les temps d’ex cution de l’algorithme Prince compar s respectivement aux algorithmes Close, A-Close et Titanic sur les contextes denses sont pr sent s par la Figure 4 et le Tableau 3.
- Pumsb : pour cette base, les performances de Prince sont meilleures que celles de Close, A-Close et Titanic pour toutes les valeurs de minsupp. Les performances de Close et A-Close se d gradent consid rablement tant donn qu’ils effectuent des intersections sur un grand nombre d’objets de taille lev e. Le m canisme de comptage par inf rence adopt par Titanic s’av re plus efficace que le calcul des intersections adopt par Close et A-Close. Ceci peut tre expliqu par le nombre r duit d’items fr quents prendre en consid ration lors du calcul de la fermeture d’un g n rateur minimal fr quent. Les performances de Prince peuvent tre expliqu es par le fait que les traitements effectuer pour un g n rateur minimal fr quent sont beaucoup moins co teux que ceux effectu s pour les trois autres algorithmes. Les traitements de gestion des classes d’ quivalence permettent aussi Prince d’ viter le calcul redondant des fermetures. En effet, pour une valeur de minsupp gale 75 %, le nombre de g n rateurs minimaux fr quents ( gal 248 406) est presque gal 2,46 fois le nombre de motifs ferm s fr quents ( gal 101 083).
- Connect : pour cette base, et bien qu’il n’y ait aucun calcul redondant des fermetures pour les trois algorithmes Close, A-Close et Titanic (le nombre de g n rateurs minimaux fr quents tant gal celui des motifs ferm s fr quents), les performances de notre algorithme restent les meilleures. En effet, tout comme Pumsb, Connect est caract ris par un grand nombre d’objets de taille lev e. Ces caract ristiques compliquent la t che des algorithmes Close et A-Close. Prince est alors avantag par un co t r duit des comparaisons effectu es pour un g n rateur minimal fr quent compar aux tentatives d’extension ex cut es pour un g n rateur minimal fr quent dans le cas de Titanic. Il est noter que pour minsupp = 50 %, l’ex cution de Titanic n’a pu se terminer pour manque d’espace m moire.
- Chess : pour cette base, les performances de Prince sont largement meilleures que celles de Close, A-Close et Titanic pour toutes les valeurs de minsupp. Le m canisme de comptage par inf rence adopt par Titanic s’av re plus efficace que le calcul des intersections adopt respectivement par les algorithmes Close et A-Close. Cependant, cette efficacit tend diminuer avec la baisse de la valeur de minsupp. En effet, pour calculer les motifs ferm s fr quents, Titanic n cessite des recherches de supports dont le nombre augmente consid rablement avec l’augmentation du nombre d’items fr quents, au fur et mesure que la valeur de minsupp diminue.
- Mushroom : dans le cas du contexte Mushroom, Prince est encore une fois meilleur que Close, A-Close et Titanic. Prince b n ficie du r le important jou par les traitements de gestion des classes d’ quivalence. En effet, pour une valeur de minsupp gale 0,10 %, le nombre de g n rateurs minimaux fr quents ( gal 360 166) est presque gal 2,20 fois le nombre de motifs ferm s fr quents ( gal 164 117). Ainsi, bien que Close et A-Close b n ficiaient d’un nombre r duit d’objets ainsi qu’une taille moyenne des objets relativement petite sur lesquelles ils ex cutent des intersections, ces deux algorithmes sont handicap s par un calcul redondant des fermetures. De son c t , Titanic est handicap au fur et mesure que la valeur de minsupp diminue par le nombre de recherches des items n cessaires au calcul des fermetures. En effet, pour minsupp = 0,10 %, 116 items sont fr quents parmi 119 possibles alors que la taille maximale d’un g n rateur minimal fr quent est gale 10 items seulement.
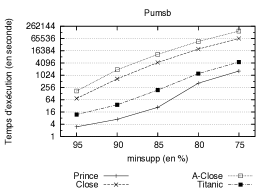
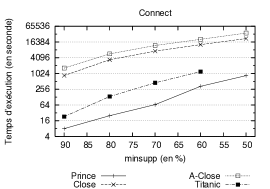
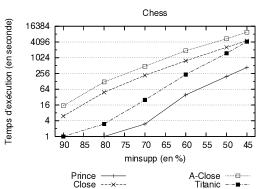
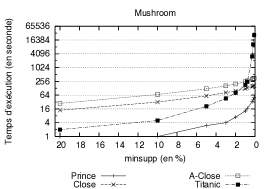
| Contexte | minsupp (%) | Prince | Close | A-Close | Titanic | |||
| (sec.) | (sec.) | (sec.) | (sec.) | |||||
| Pumsb | 95,00 | 3 | 74 | 172 | 12 | 24,67 | 57,33 | 4,00 |
| 90,00 | 7 | 679 | 1 914 | 36 | 97,00 | 273,43 | 5,14 | |
| 85,00 | 27 | 4 332 | 10 875 | 192 | 160,44 | 402,78 | 7,11 | |
| 80,00 | 416 | 19 848 | 47 167 | 1 233 | 47,71 | 113,38 | 2,96 | |
| 75,00 | 1 641 | 65 690 | 152 050 | 4 563 | 40,03 | 92,66 | 2,78 | |
| Connect | 90,00 | 8 | 853 | 1 652 | 23 | 106,62 | 206,50 | 2,87 |
| 80,00 | 25 | 3 428 | 5 771 | 135 | 137,12 | 230,84 | 5,40 | |
| 70,00 | 66 | 7 358 | 12 028 | 452 | 111,48 | 182,24 | 6,85 | |
| 60,00 | 332 | 13 024 | 20 747 | 1 205 | 39,23 | 62,49 | 3,63 | |
| 50,00 | 847 | 22 164 | 35 903 | / | 26,17 | 42,39 | / | |
| Chess | 90,00 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6,00 | 15,00 | 1,00 |
| 80,00 | 1 | 49 | 122 | 3 | 49,00 | 122,00 | 3,00 | |
| 70,00 | 3 | 217 | 481 | 25 | 72,33 | 160,33 | 8,33 | |
| 60,00 | 39 | 784 | 1 896 | 233 | 20,10 | 48,61 | 5,97 | |
| 50,00 | 197 | 2 560 | 5 451 | 1 520 | 12,99 | 27,67 | 7,71 | |
| 45,00 | 435 | 4 550 | 9 719 | 4 237 | 10,46 | 22,34 | 9,74 | |
| Mushroom | 20,00 | 1 | 14 | 28 | 2 | 14,00 | 28,00 | 2,00 |
| 10,00 | 1 | 32 | 69 | 5 | 32,00 | 69,00 | 5,00 | |
| 5,00 | 3 | 59 | 121 | 21 | 19,67 | 40,33 | 7,00 | |
| 3,00 | 4 | 83 | 163 | 46 | 20,75 | 40,75 | 11,50 | |
| 2,00 | 7 | 98 | 197 | 81 | 14,00 | 28,14 | 11,57 | |
| 1,00 | 13 | 123 | 250 | 180 | 9,46 | 19,23 | 13,85 | |
| 0,80 | 17 | 132 | 270 | 246 | 7,76 | 15,88 | 14,47 | |
| 0,30 | 33 | 154 | 322 | 3 127 | 4,67 | 9,76 | 94,76 | |
| 0,20 | 40 | 159 | 336 | 10 518 | 3,97 | 8,40 | 262,95 | |
| 0,10 | 50 | 168 | 352 | 26 877 | 3,36 | 7,04 | 537,54 |
L’algorithme Prince s’av re performant sur les contextes denses et pour toutes les valeurs de minsupp. La diff rence entre les performances de Prince et celles de Close et A-Close atteint son maximum pour le contexte Pumsb. En effet, Prince est environ 160 (resp. 403) fois plus rapide que Close (resp. A-Close) pour un support de 85 %. De m me, Prince est environ 538 fois plus rapide que Titanic pour le contexte Mushroom et pour un support gal 0,01 %. Pour ces contextes denses, Prince est en moyenne 42 (resp. 89 et 41) fois plus rapide que Close (resp. A-Close et Titanic).
6.1.2. Exp rimentations sur les contextes pars
Les temps d’ex cution de l’algorithme Prince compar s respectivement aux algorithmes Close, A-Close et Titanic sur les contextes pars sont pr sent s par la Figure 5 et le Tableau 4.
- T10I4D100K : pour cette base, Prince fait mieux que A-Close et Titanic pour toutes les valeurs de minsupp. En comparant les performances de Prince celles de Close, Prince fait mieux que cet algorithme pour des valeurs de minsupp sup rieures ou gales 0,03 %. Alors que c’est l’inverse pour des supports inf rieurs 0,03 %. Ceci peut tre expliqu par le fait que Prince est p nalis par le co t de la construction du treillis d’Iceberg pour de tr s basses valeurs de minsupp. Cependant, Close est avantag par une taille moyenne des objets relativement faible (10 items). A-Close se voit moins rapide en raison du balayage suppl mentaire de l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents de taille ( - ) effectu pour chaque candidat de taille afin de savoir si est minimal ou non. Au fur et mesure que la valeur de minsupp diminue, les performances de Titanic se d gradent consid rablement. En effet, pour minsupp = 0,02 %, 859 items sont fr quents parmi 1 000 possibles alors que la taille maximale d’un g n rateur minimal fr quent est gale 10 items seulement.
- T40I10D100K : les performances de Prince dans ce contexte sont largement meilleures que celles de Close, A-Close et Titanic quelle que soit la valeur de minsupp. Close et A-Close sont handicap s par une taille moyenne lev e des objets (40 items) sachant que Close prend le dessus sur A-Close. De m me, les performances de Titanic se d gradent d’une mani re consid rable pour les m mes raisons voqu es auparavant. Le co t des comparaisons, dans le cas de Prince, est nettement plus r duit que le co t du calcul des intersections (resp. des tentatives d’extension) pour calculer les fermetures dans le cas de Close et A-Close (resp. Titanic). Ceci explique l’ cart dans les performances entre Prince et les trois autres algorithmes. Il est aussi noter l’augmentation surprenante du nombre de classes d’ quivalence en passant de 1,50 % 0,50 % comme valeurs de minsupp. En effet, nous passons de 6 540 1 275 940 classes d’ quivalence, c’est- -dire plus de 195 fois. Les performances de Prince demeurent int ressantes m me pour un tel nombre de classes d’ quivalence.
- Retail : pour cette base, notre algorithme r alise des temps d’ex cution beaucoup moins importants que ceux r alis s respectivement par Close, A-Close et Titanic. Les performances r alis es peuvent tre expliqu es par l’influence norme du nombre lev d’items dans Retail. En effet, Close est handicap par un nombre norme de candidats pour lesquels il est oblig de calculer la fermeture alors qu’un grand nombre d’entre eux s’av rera non fr quent. Le nombre de candidats affecte aussi les performances de A-Close cause des balayages suppl mentaires ainsi que le co t du calcul des fermetures. De son c t , Titanic est consid rablement alourdi par un grand nombre d’items fr quents consid rer lors du calcul de la fermeture d’un g n rateur minimal fr quent (pour minsupp = 0,04 %, 4 463 items sont fr quents alors que la taille maximale d’un g n rateur minimal fr quent est gale 6 items seulement) seulement. L’ex cution de Titanic, pour des supports inf rieurs 0,04 %, s’arr te pour manque d’espace m moire.
- Accidents : dans cette base, les performances de Prince sont meilleures que celles de Close, A-Close et Titanic pour toutes les valeurs de minsupp. Notons que pour des valeurs de minsupp sup rieures ou gales 40 %, chaque g n rateur minimal fr quent est un ferm . Prince ne n cessite alors pas l’ex cution de sa proc dure Gen-Ordre tant donn que le treillis d’Iceberg est d j construit la fin de sa premi re tape. Les performances de Close et A-Close sont norm ment d savantag es par un nombre ainsi qu’une taille moyenne des objets relativement lev s, ce qui induit des co ts normes pour le calcul des fermetures. Le m canisme de comptage par inf rence adopt par Titanic s’av re plus efficace que le calcul des intersections. Ceci peut tre expliqu par le nombre r duit d’items fr quents prendre en consid ration lors du calcul des fermetures. En effet, seuls 32 items parmi 468 sont fr quents pour minsupp gal 30 % et la taille maximale d’un g n rateur minimal fr quent est gale 12 items.
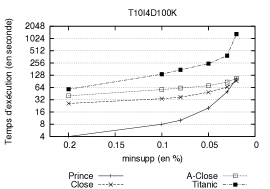
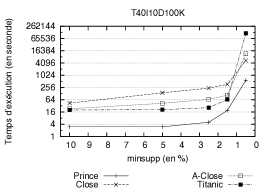
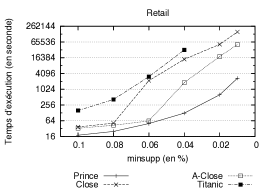
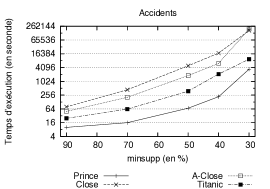
| Contexte | minsupp (%) | Prince | Close | A-Close | Titanic | |||
| (sec.) | (sec.) | (sec.) | (sec.) | |||||
| T10I4D100K | 0,50 | 3 | 17 | 9 | 7 | 5,67 | 3,00 | 2,33 |
| 0,20 | 4 | 26 | 40 | 58 | 6,50 | 10,00 | 14,50 | |
| 0,10 | 8 | 34 | 57 | 136 | 4,25 | 7,12 | 17,00 | |
| 0,08 | 10 | 37 | 62 | 174 | 3,70 | 6,20 | 17,40 | |
| 0,05 | 20 | 49 | 71 | 247 | 2,45 | 3,55 | 12,35 | |
| 0,03 | 50 | 66 | 87 | 387 | 1,32 | 1,74 | 7,74 | |
| 0,02 | 105 | 93 | 108 | 1 316 | 0,88 | 1,03 | 12,53 | |
| T40I10D100K | 10,00 | 3 | 44 | 23 | 20 | 14,67 | 7,67 | 6,67 |
| 5,00 | 3 | 140 | 43 | 21 | 46,67 | 14,33 | 7,00 | |
| 2,50 | 5 | 238 | 67 | 26 | 47,60 | 13,40 | 5,20 | |
| 1,50 | 19 | 366 | 108 | 66 | 19,26 | 5,68 | 3,47 | |
| 0,50 | 582 | 5 420 | 11 564 | 117 636 | 9,31 | 19,87 | 202,12 | |
| Retail | 0,10 | 18 | 37 | 33 | 158 | 2,05 | 1,83 | 8,78 |
| 0,08 | 25 | 52 | 43 | 415 | 2,08 | 1,72 | 16,60 | |
| 0,06 | 50 | 2 185 | 63 | 3 089 | 43,70 | 1,26 | 61,78 | |
| 0,04 | 125 | 14 358 | 1 833 | 32 663 | 114,86 | 14,66 | 261,30 | |
| 0,02 | 626 | 53 208 | 18 269 | / | 85,00 | 29,18 | / | |
| 0,01 | 2 699 | 159 217 | 52 162 | / | 58,99 | 19,33 | / | |
| Accidents | 90,00 | 10 | 79 | 50 | 25 | 7,90 | 5,00 | 2,50 |
| 70,00 | 16 | 440 | 206 | 63 | 27,50 | 12,87 | 3,94 | |
| 50,00 | 69 | 4 918 | 1 839 | 381 | 71,27 | 26,65 | 5,52 | |
| 40,00 | 219 | 17 528 | 6 253 | 2 120 | 80,04 | 28,55 | 9,68 | |
| 30,00 | 3 482 | 170 540 | 199 980 | 9 530 | 48,98 | 57,43 | 2,74 |
L’algorithme Prince s’av re aussi performant sur les contextes pars et pour toutes les valeurs de minsupp. La diff rence entre les performances de Prince et celles de Close et Titanic atteint son maximum pour le contexte Retail. En effet, Prince est environ 115 (resp. 261) fois plus rapide que Close (resp. Titanic) pour un support de 0,04 %. De m me, Prince est environ 57 fois plus rapide que A-Close pour le contexte Accidents et pour une valeur de minsupp gale 30 %. Pour ces contextes pars, Prince est en moyenne 31 (resp. 13 et 32) fois plus rapide que Close (resp. A-Close et Titanic).
6.1.3. Exp rimentations sur les contextes « pire des cas »
Pour toutes ces exp rimentations, la valeur de minsupp est fix e 1. Nous avons test 26 contextes « pire des cas » repr sentant la variation de la valeur de de 1 26. Étant donn que ces contextes repr sentent le pire des cas, tout motif candidat est un g n rateur minimal fr quent et est gal sa fermeture.
Les temps d’ex cution des quatre algorithmes ne commencent tre distinguables qu’ partir d’une valeur de gale 15. Pour les contextes « pire des cas », les performances de Prince restent meilleures que celles de Close, A-Close et Titanic. Chaque g n rateur minimal fr quent est aussi un ferm . Ainsi, Prince n’ex cute pas sa deuxi me tape, le treillis d’Iceberg tant construit d s la fin de sa premi re tape. De son c t , A-Close ne calcule pas les fermetures. D’o , ses performances sont meilleures que celles de Close et celles de Titanic. Il est important de noter que les calculs de fermetures effectu s par Close et Titanic s’av rent sans utilit car tout g n rateur minimal est gal sa fermeture. L’ex cution de ces deux algorithmes n’a pu se terminer pour une valeur de gale 24, en raison du manque d’espace m moire. Pour la m me raison, l’ex cution de A-Close n’a pu se terminer pour une valeur de gale 25. L’ex cution de notre algorithme prend aussi fin, pour = 26.
La Figure 6 et le Tableau 5 donnent le comportement des algorithmes suivant la variation de la valeur de . Dans le Tableau 5, les trois derni res colonnes indiquent le facteur multiplicatif des temps d’ex cution de Close, A-Close et Titanic par rapport l’algorithme Prince. L’algorithme Prince reste meilleur que les algorithmes Close, A-Close et Titanic sur les contextes « pire des cas ». La diff rence entre les performances de Prince et celles de Close (resp. A-Close et Titanic) est maximale pour = 21 (resp. 19 et 23). En effet, pour ces valeurs de , Prince est environ 29 (resp. 4 et 10) fois plus rapide que Close (resp. A-Close et Titanic). Pour ces contextes « pire des cas », Prince est en moyenne 16 (resp. 3 et 4) fois plus rapide que Close (resp. A-Close et Titanic.
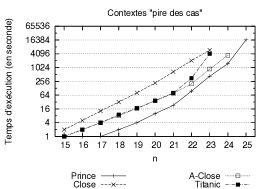
| Prince | Close | A-Close | Titanic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (sec.) | (sec.) | (sec.) | (sec.) | ||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| 17 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13,00 | 4,00 | 4,00 |
| 18 | 2 | 32 | 8 | 9 | 16,00 | 4,00 | 4,50 |
| 19 | 4 | 81 | 17 | 17 | 20,25 | 4,25 | 4,25 |
| 20 | 10 | 217 | 36 | 37 | 21,70 | 3,60 | 3,70 |
| 21 | 23 | 670 | 77 | 80 | 29,13 | 3,35 | 3,48 |
| 22 | 96 | 2 058 | 200 | 353 | 21,44 | 2,08 | 3,68 |
| 23 | 429 | 5 932 | 890 | 4 129 | 13,83 | 2,10 | 9,62 |
| 24 | 1 525 | / | 3 519 | / | / | 2,31 | / |
| 25 | 16 791 | / | / | / | / | / | / |
| 26 | / | / | / | / | / | / | / |
6.2. comparaisons des tapes de Prince
Le but de cette sous-section est de comparer le co t des trois tapes constituant Prince. À titre indicatif, le Tableau 6 montre le co t des diff rentes tapes sur deux contextes denses et deux contextes pars. Suite nos exp rimentations, nous pouvons noter les points suivants :
-
—
le co t de la deuxi me tape est g n ralement plus r duit que le co t de la premi re tape. Toutefois, ceci d pend troitement des caract ristiques du contexte. En effet, le co t du calcul du support des motifs (c’est- -dire l’op ration la plus co teuse de la premi re tape) d pend du nombre d’objets que contient le contexte et de leur taille moyenne.
-
—
la troisi me tape est la moins co teuse et ceci pour les diff rents contextes test s ainsi que pour les diff rentes valeurs de minsupp. En effet, du moment que la structure contenant les g n rateurs minimaux fr quents a t construite, la d rivation des motifs ferm s fr quents et des r gles d’association g n riques devient imm diate. Notons aussi que la variation de la valeur de minconf n’a pas d’influence significative sur le temps d’ex cution de Prince.
Les r sultats obtenus confirment ainsi l’utilit de l’approche propos e.
| Contexte | minsupp (%) | Temps d’ex cution | 1 tape | 2 tape | 3 tape |
|---|---|---|---|---|---|
| total (sec.) | |||||
| Connect | 90,00 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 80,00 | 25 | 24 | 1 | 0 | |
| 70,00 | 66 | 63 | 3 | 0 | |
| 60,00 | 332 | 322 | 9 | 1 | |
| 50,00 | 847 | 822 | 22 | 3 | |
| Mushroom | 20,00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,00 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 3,00 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2,00 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 1,00 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
| 0,80 | 17 | 6 | 10 | 1 | |
| 0,30 | 33 | 9 | 22 | 2 | |
| 0,20 | 40 | 10 | 26 | 4 | |
| 0,10 | 50 | 11 | 35 | 4 | |
| T10I4D100K | 0,50 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 0,20 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 0,10 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 0,08 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 0,05 | 20 | 16 | 4 | 0 | |
| 0,03 | 50 | 35 | 15 | 0 | |
| 0,02 | 105 | 58 | 47 | 0 | |
| T40I10D100K | 10,00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2,50 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 1,50 | 19 | 18 | 0 | 1 | |
| 0,50 | 582 | 480 | 86 | 16 |
7. CONCLUSION
Dans ce papier, nous avons propos un nouvel algorithme, Prince, permettant de r duire le nombre de r gles d’association en n’extrayant que des bases g n riques compos es seulement de r gles informatives. Prince est le seul algorithme offrir les composantes n cessaires une telle extraction sans avoir l’associer avec un autre algorithme. À cet effet, Prince extrait en premier lieu l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents et en d duit le treillis d’Iceberg. Les r gles d’association informatives sont alors d riv s par un simple parcours ascendant de la structure partiellement ordonn e. Gr ce une gestion efficace des classes d’ quivalence, Prince pr sente aussi comme avantages l’extraction non-redondante des motifs ferm s fr quents ainsi qu’une r duction du co t de la construction du treillis d’Iceberg. Les exp rimentations, que nous avons r alis es, ont montr qu’il est efficace sur les diff rents contextes test s couvrant les diff rents types de contextes. Ainsi, Prince offre un consensus entre la qualit de l’information extraite et l’efficacit d’extraction.
Les perspectives de travaux futurs concernent les pistes suivantes :
- Du point de vue de la qualit des connaissances extraites par Prince, l’adaptation de ce dernier pour l’exploration de l’espace disjonctif de recherche, o les items sont li s par l’op rateur de disjonction au lieu de l’op rateur de conjonction [Hamrouni & al., 2009], est une piste int ressante afin d’extraire diff rentes formes de r gles g n ralis es [Hamrouni & al., 2010]. Ces derni res sont connues pour tre plus riches en information tant donn qu’elles v hiculent diff rents liens entre les items et ne se limitent donc pas leur conjonction. Les m triques de support et de confiance des diff rentes formes sont facilement calculables puisque les supports conjonctifs et n gatifs peuvent tre d duits partir des supports disjonctifs gr ce aux identit s d’inclusion-exclusion [Galambos, Simonelli, 2000] et la loi de De Morgan, respectivement. Par ailleurs, l’utilisation de contraintes utilisateur [Bonchi, Lucchese, 2006] ainsi que d’autres mesures de qualit [Hébert, Crémilleux, 2007] dans le processus d’extraction des r gles d’association informatives est une t che importante. En effet, ceci permettra de r duire tant que faire se peut le nombre de r gles tout en gardant celles qui sont les plus int ressantes pour l’utilisateur.
- Du point de vue de algorithmique, il serait d’une part int ressant d’ tudier la possibilit d’int grer dans Prince le travail propos dans [Calders, Goethals, 2007]. Ce travail s’applique tout ensemble v rifiant la propri t d’id al d’ordre, ce qui est le cas de l’ensemble des g n rateurs minimaux utilis dans notre cas. Il permet de r duire le nombre de candidats auxquels un acc s au contexte d’extraction est n cessaire pour calculer le support. Étant donn que cette tape est la plus co teuse de la premi re tape, une telle int gration permettra de r duire un tel co t. D’autre part, la mise en place d’un choix adaptatif de la bordure ajouter l’ensemble des g n rateurs minimaux fr quents est envisag e. En effet, pour certains contextes, il est plus avantageux du point de vue cardinalit de maintenir une autre bordure que celle actuellement maintenue, savoir d- [Liu & al., 2008]. Ceci d pend troitement des caract ristiques des contextes [Hamrouni & al., à paraître] et qui seront donc tudier pour bien s lectionner la bordure maintenir.
Remerciements. Nous tenons remercier les relecteurs anonymes pour leurs remarques et leurs suggestions tr s utiles et qui ont permis d’am liorer consid rablement la qualit du travail. Nous tenons aussi remercier Yves Bastide pour avoir mis notre disposition les codes source des algorithmes Close, A-Close et Titanic. Ce travail est partiellement soutenu par le projet PHC-Utique 11G1417, EXQUI.
BIBLIOGRAPHIE
agrawal r., imielinski t., swami a. (1993), “Mining association rules between sets of items in large databases”, Proceedings of the ACM-SIGMOD International Conference on Management of Data, Washington (DC), p. 207–216.
agrawal r., srikant r. (1994), “Fast algorithms for mining association rules”, Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Databases (VLDB 1994), Santiago, Chile, p. 478-499.
ashrafi m.z., taniar d., smith k. (2007), “Redundant association rules reduction techniques”, International Journal Business Intelligence and Data Mining 2(1), p. 29-63.
barbut m., monjardet b. (1970), Ordre et classification. Algèbre et combinatoire, Paris, Hachette, tome II.
bastide y. (2000), Data mining : Algorithmes par niveau, techniques d’implantation et applications, Th se de doctorat, École Doctorale Sciences pour l’Ing nieur de Clermont-Ferrand, Universit Blaise Pascal.
bastide y., pasquier n., taouil r., stumme g., lakhal l. (2000(a)), “Mining minimal non-redundant association rules using frequent closed itemsets”, Proceedings of the 1st International Conference on Computational Logic (DOOD 2000), Springer-Verlag, LNAI, volume 1861, London (UK), p. 972-986.
bastide y., taouil r., pasquier n., stumme g., lakhal l. (2000(b)), “Mining frequent patterns with counting inference”, ACM-SIGKDD Explorations 2(2), p. 66-75.
bayardo r.j. (1998), “Efficiently mining long patterns from databases”, Proceedings of the International Conference on Management of Data (SIGMOD 1998), Seattle (WA), p. 85-93.
ben yahia s., mephu nguifo e. (2004), “Revisiting generic bases of association rules”, Proceedings of 6th International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (DaWaK 2004), Springer-Verlag, LNCS, volume 3181, Zaragoza, Spain, p. 58-67.
ben yahia s., hamrouni t., mephu nguifo e. (2006), “Frequent closed itemset based algorithms: A thorough structural and analytical survey”, ACM-SIGKDD Explorations, 8(1), p. 93-104.
bodon f., róyai l. (2003), “Trie: An alternative data structure for data mining algorithms”, Mathematical and Computer Modelling, 38(7-9), p. 739-751.
bonchi f., lucchese c. (2006), “On condensed representations of constrained frequent patterns”, Knowledge and Information Systems 9(2), p. 180-201.
boulicaut j.-f., bykowski a., rigotti c. (2003), “Free-sets: A condensed representation of Boolean data for the approximation of frequency queries”, Data Mining and Knowledge Discovery 7(1), p. 5-22.
calders t., rigotti c., boulicaut j.-f. (2005), “A survey on condensed representations for frequent sets”, Constraint Based Mining and Inductive Databases, Springer-Verlag, LNAI, volume 3848, p. 64-80
calders t., goethals b. (2007), “Non-derivable itemset mining”, Data Mining and Knowledge Discovery, Springer, 14(1), p. 171-206
ceglar a., roddick j.f. (2006), “Association mining”, ACM Computing Surveys 38(2).
le floc’h a., fisette c., missaoui r., valtchev p., godin r. (2003), « JEN : un algorithme efficace de construction de g n rateurs pour l’identification des r gles d’association », Num ro sp cial de la revue des Nouvelles Technologies de l’Information 1(1), p. 135-146.
galambos j., simonelli i. (2000), Bonferroni-type inequalities with applications, Springer.
ganter b., wille r. (1999), Formal Concept Analysis, Springer.
godin r., missaoui r., alaoui h. (1995), “ Incremental concept formation algorithms based on Galois (concept) lattices.”, Journal of Computational Intelligence 11(2), p. 246-267.
goethals b. (2004), “Frequent itemset mining implementations repository”,
http://fimi.cs.helsinki.fi/.
hamrouni t., ben yahia s., mephu nguifo e. (2009), “Sweeping the disjunctive search space towards mining new exact concise representations of frequent itemsets”, Data & Knowledge Engineering 68(10), p. 1091-1111.
hamrouni t., ben yahia s., mephu nguifo e. (2010), “Generalization of association rules through disjunction”, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 59(2), p. 201-222.
hamrouni t., ben yahia s., mephu nguifo e. (à paraître), “Looking for a structural characterization of the sparseness measure of (frequent closed) itemset contexts”, À para tre dans Information Sciences.
hébert c., crémilleux b. (2007), “A unified view of objective interestingness measures”, Proceedings of the 5th International Conference Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition (MLDM 2007), Springer-Verlag, LNCS, volume 4571, Leipzig (Germany), p. 533–547.
knuth d.e. (1968), The art of computer programming, volume 3, Addison-Wesley.
kryszkiewicz m. (2002), Concise representation of frequent patterns and association rules, Habilitation dissertation, Institute of Computer Science, University of Technology, Warsaw (Poland).
kuznetsov s.o., obiedkov s.a. (2002), “Comparing Performance of Algorithms for Generating Concept Lattices”, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 14(2-3), p. 189-216.
li h., li j., wong l., feng m., tan y. (2005), “Relative risk and odds ratio: a data mining perspective”, Proceedings of the 24th ACM-SIGMOD International Symposium on Principles Of Database Systems (PODS 2005), Baltimore (MD), p. 368-377.
liu g., li j., wong l. (2008), “A new concise representation of frequent itemsets using generators and a positive border”, Knowledge and Information Systems 17(1), p. 35-56.
lucchese c., orlando s., perego r. (2006), “Fast and memory efficient mining of frequent closed itemsets”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 18(1), p. 21-36.
mephu nguifo e. (1994), « Une nouvelle approche bas e sur le treillis de Galois pour l’apprentissage de concepts », Math matiques, Informatique et Sciences humaines 134, p. 19-38.
pasquier n. (2000), “Datamining : Algorithmes d’extraction et de r duction des r gles d’association dans les bases de donn es, Th se de doctorat, École Doctorale Sciences pour l’Ing nieur de Clermont Ferrand, Universit Clermont Ferrand II.
pasquier n., bastide y., taouil r., lakhal l. (1999(a)), “Discovering frequent closed itemsets for association rules”, Proceedings of 7th International Conference on Database Theory (ICDT 1999), LNCS, volume 1540, Springer-Verlag, Jerusalem, Israel, p. 398-416.
pasquier n., bastide y., taouil r., lakhal l. (1999(b)), “Efficient mining of association rules using closed itemset lattices”, Journal of Information Systems 24(1), p. 25-46.
pei j., han j., mao r. (2000), ‘Closet: An efficient algorithm for mining frequent closed itemsets”, Proceedings of the ACM-SIGMOD International Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2000), Dallas (TX), p. 21-30.
pfaltz j.l., taylor c.m. (2002), “Scientific knowledge discovery through iterative transformation of concept lattices”, Proceedings of Workshop on Discrete Applied Mathematics in conjunction with the 2nd SIAM International Conference on Data Mining, Arlington (VA), p. 65.74.
stumme g., taouil r., bastide y., pasquier n., lakhal l. (2002), “Computing Iceberg concept lattices with Titanic”, Data & Knowledge Engineering 2(42), p. 189-222.
szathmary l., napoli a., kuznetsov s. (2007), “ZART: A multifunctional itemset mining algorithm”, Proceedings of the 5th International Conference on Concept Lattices and their Applications (CLA 2007), Montpellier, p. 26-37.
uno t., asai t. uchida y., arimura h. (2004), “An efficient algorithm for enumerating closed patterns in transaction databases”, Proceedings of the 7th International Conference on Discovery Science, Padova, Italy, p. 16-31.
valtchev p., missaoui r., lebrun p. (2000), “A fast algorithm for building the Hasse diagram of a Galois lattice”, Proceedings of the Colloque LaCIM 2000, Montr al, Canada, p. 293-306.
zaki m.j. (2004), “Mining non-redundant association rules”, Data Mining and Knowledge Discovery 9(3), p. 223-248.
zaki m.j., hsiao c.j. (2002), “ChARM: An efficient algorithm for closed itemset mining”, Proceedings of the 2nd SIAM International Conference on Data Mining, Arlington (VI), p. 457-573.
zaki m.j., hsiao c.j. (2005), “Efficient algorithms for mining closed itemsets and their lattice structure”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17(4), p. 462-478.