![]()
![]()
UNIVERSITÉ PARIS-SUD XI
THÈSE
Spécialité: PHYSIQUE THÉORIQUE
Présentée
pour obtenir le grade de
Docteur de l’Université Paris XI
par
Mathieu Remazeilles
Sujet:
Évolution des perturbations cosmologiques dans les univers branaires
Soutenue le vendredi 28 novembre 2008 devant la commission d’examen:
Résumé
Dans la majeure partie de cette thèse nous explorons l’évolution des perturbations cosmologiques scalaires et tensorielles dans un Univers branaire de type Randall-Sundrum ayant une expansion cosmologique arbitraire. Nous adoptons un point de vue quadri-dimensionnel dans lequel les degrés de liberté localisés sur la brane sont considérés comme un système quantique ouvert couplé à l’environnement composé des gravitons du bulk Anti-de Sitter (). À cause de l’expansion non-uniforme de l’Univers, les degrés de liberté de la brane et ceux du bulk interagissent dans le temps, faisant apparaître une forme dissipation effective ainsi que des processus non-locaux en temps du point de vue quadri-dimensionnel d’un observateur sur la brane. À partir des propagateurs retardés “nus” sur la brane et dans le bulk nous calculons le propagateur effectif sur la brane pour les modes “habillés” localisés sur la brane en resommant les effets de rétroaction du bulk à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. La dissipation et la non-localité sont inscrites dans le propagateur effectif. Nous obtenons les taux de dissipation de diverses perturbations de matière sur la brane ainsi que du mode lié du graviton. Ensuite nous présentons un calcul explicite de la fonction de Green retardée covariante du graviton dans l’espace .
Dans la dernière partie nous étudions la reconstruction du champ de lentille gravitationnelle sur le CMB dans une cosmologie standard. Nous construisons un estimateur statistique des champs de dilatation et de cisaillement directement en espace réel. La méthode en espace réel développée ici est utile pour analyser des cartes du CMB réalistes, contenant une coupure galactique et les nombreuses autres petites coupures excluant les points-source.
Abstract
In this thesis we mainly explore the evolution of both scalar and tensor cosmological perturbations in a Randall-Sundrum braneworld having an arbitrary expansion history. We adopt a four-dimensional perspective in which the localized degrees of freedom on the brane are regarded as an open quantum system coupled to the large environment composed of the Anti-de Sitter () bulk gravitons. Due to the non-uniform expansion of the universe, the brane degrees of freedom and the bulk degrees of freedom interact as they propagate forward in time, leading to an effective dissipation as well as a nonlocality from the four-dimensional point of view of an observer on the brane. Using both the "bare" retarded propagator on the brane and the retarded propagator in the bulk, we compute the effective propagator on the brane for the "dressed" brane modes by resumming the bulk backreaction effects at all order in the brane-bulk coupling. Dissipation and nonlocality are encoded into the effective brane propagator. We find the dissipation rates of various matter perturbations on the brane as well as of the graviton bound state. Next we present an explicit calculation of the covariant retarded Green function for the graviton in space.
In the last part, we investigate the reconstruction of CMB lensing in standard cosmology. We construct a statistical estimator of the gravitational lensing dilatation and shear fields directly in real space. The real space method developed here is useful for analysing realistic CMB maps containing a galactic cut and possibly numerous small excisions to exclude point sources that cannot be reliably subtracted.
Mes premiers remerciements iront à Martin Bucher pour ces trois années particulièrement enrichissantes. J’ai appris beaucoup de physique aux côtés de cet esprit brillant. C’est en ami que je tiens à lui exprimer ici toute ma gratitude pour ses encouragements, son soutien, son humour, et ses autres qualités humaines qui en font un directeur de thèse exceptionnel.
Je tiens à remercier Brandon Carter, Jaume Garriga, Renaud Parentani et Fernando Quevedo pour m’avoir fait l’honneur de faire partie du jury de thèse, et tout particulièrement Jaume Garriga et Fernando Quevedo pour avoir accepté d’être les rapporteurs de mon manuscript de thèse.
Je remercie également mon collaborateur Kavi Moodley qui m’a généreusement invité à l’Université de Durban et à l’African Institute for Mathematical Sciences à Cape Town. Merci aussi à Carla Carvalho pour son aide et son soutien.
Un grand merci à tous les membres du LPT pour leur accueil et tout particulièrement au groupe de cosmologie: Christos Charmousis, Renaud Parentani, Bartjan van Tent, Jean Macher et Blaise Gouteraux. Merci aussi à Julien Serreau, Ana Teixeira et Robin Zegers avec qui j’ai eu le plaisir de partager mon bureau.
Je tiens naturellement à remercier mes parents, et mes frères, pour leur soutien inconditionnel.
Merci à Akba, Julien, Nico pour les écarts et les bons souvenirs.
Enfin j’aurai une pensée profonde pour Claire, avec qui j’ai eu le bonheur de partager ma vie pendant cette thèse.
À mes parents,
à mes frères.
Introduction
La possibilité que l’Univers possède plus que trois dimensions d’espace peut surprendre chacun à première vue puisque cela va à l’encontre de l’intuition et de l’expérience quotidienne. Mais cette idée ne doit pas être plus surprenante que celle d’Eratosthène qui, dès l’Antiquité, soutenait que la Terre est ronde devant ses contemporains qui la voyaient plate parce qu’ils ne possédaient pas encore la technologie suffisante pour en mesurer sa vraie géometrie. L’existence de dimensions supplémentaires dans l’Univers est un scénario scientifiquement plausible, réellement pris au sérieux par la communauté scientifique de la physique théorique moderne, mais qui n’a pas encore été confirmé expérimentalement. Les scénarios de dimensions supplémentaires sont motivés par les théories de la physique des hautes énergies qui visent à unifier à très haute énergie, à l’échelle dite de Planck ( GeV), l’interaction gravitationnelle avec les trois autres interactions fondamentales de la nature, à savoir l’interaction électromagnétique, l’interaction faible et l’interaction forte. Les deux grandes théories physiques du vingtième siècle, que sont la théorie de la relativité générale d’Einstein et la mécanique quantique - et la théorie quantique des champs-, prédisent avec une très grande précision la plupart des phénomènes physiques observés à ce jour, une grande partie des prédictions théoriques ayant été confirmées expérimentalement avec succès. La théorie de la relativité générale offre un cadre géométrique rigoureux pour décrire l’interaction gravitationnelle et les mécanismes de l’Univers aux échelles macroscopiques allant du dixième de millimètre jusqu’aux distances intergalactiques. Elle a également bouleversé notre vision de l’espace et du temps puisqu’elle unifie le temps aux dimensions spatiales révélant ainsi que notre Univers est un espace-temps à dimensions pouvant de surcroît être courbées. La théorie quantique des champs utilise un formalisme cohérent pour décrire le comportement microscopique des particules élémentaires du Modèle Standard de la physique des particules (quarks, leptons, bosons de jauge, …) et leurs interactions électromagnétique, faible et forte à travers les théories de jauge , et respectivement. Mais ces deux grandes théories reposent sur des formalismes mathématiques différents et peu compatibles, la première faisant appel à la géométrie différentielle et la seconde aux algèbres non-commutatives. Pourtant un cadre mathématique cohérent doit pouvoir unifier ces deux théories pour prétendre décrire complètement la physique de phénomènes très énergétiques, incluant des effet quantiques en plus des effets gravitationnels, tels que la formation de trous noirs dans l’Univers ou la cosmologie primordiale de l’Univers quelques fractions de secondes après le Big-Bang. La théorie des supercordes est le candidat le plus prometteur dans cette quête d’unification et de réalisation d’une théorie quantique de la gravité [1]. Cette nouvelle théorie, encore en développement, suppose que les constituants élémentaires de la matière ne sont plus les particules ponctuelles de la théorie quantique des champs mais des objets étendus unidimensionnels, à savoir des cordes minuscules de la taille de Planck ( cm). Chaque état quantique de vibration des cordes correspond à une particule du Modèle Standard de la physique mais le succès de la théorie des cordes repose en partie sur le fait que le spectre quantique des cordes contient également un état de spin sans masse qui correspond exactement au graviton, la particule quantique qui doit véhiculer l’interaction gravitationnelle. Ce succès vers l’unification s’accompagne cependant d’un nouveau bouleversement dans notre compréhension de la nature de l’espace-temps : un des résultats majeurs de la théorie est que cette dernière exige, pour des raisons de cohérence mathématique, que les cordes évoluent dans un espace-temps à dimensions. L’Univers pourrait donc posséder dimensions spatiales supplémentaires "cachées". La découverte complémentaire que les théories de cordes comprennent également des membranes de dimensions diverses, appelées "branes", en plus des cordes elles-même, a motivé l’étude de la possibilité que notre Univers observable réside en fait sur une membrane à dimensions entourée de dimensions supplémentaires, pas forcément petites ni compactifiées [5, 9].
L’étude de modèles d’Univers branaires plongés dans un espace-temps à cinq dimensions peut déjà nous révéler une phénoménologie très riche dans le cadre de la cosmologie. Des questions immédiates se posent dans cette nouvelle perspective : comment sont “dissimulées” les (ou la) dimensions supplémentaires ? Est-ce que la présence de dimensions supplémentaires dans l’Univers ne contredit pas les résultats expérimentalement valides de la physique standard quadridimensionnelle ? Quelles sont les modifications cosmologiques éventuelles par rapport à la cosmologie standard quadrimensionnelle et comment les détecter ? Dans la plupart des modèles branaires tous les champs de particules du Modèle Standard sont confinés sur une hypersurface de genre temps à quatre dimensions, la brane, et seuls les gravitons peuvent se propager dans les dimensions supplémentaires de l’espace-temps total appelé “bulk”. De cette façon la physique du Modèle Standard à quatre dimensions se trouve préservée sur la brane. Les signatures de la présence éventuelle de dimensions supplémentaires dans l’Univers ne peuvent donc être appréhendées que par l’étude du comportement de la gravitation et de la cosmologie. Une façon, alternative aux modèles branaires, de s’affranchir du problème des dimensions supplémentaires est de supposer qu’elles sont compactifiées, à la Kaluza-Klein, à très petite échelle de sorte qu’aucun instrument de mesure n’ait pu les détecter jusqu’à aujourd’hui. Cependant les scenarios branaires, qui autorisent pour certains d’entre eux la présence d’au moins une dimension supplémentaire non-compacte de grande taille voire infinie, offrent par conséquent la possibilité plus optimiste de pouvoir détecter cette dimension supplémentaire, au moins de façon indirecte. Si la dimension supplémentaire est infinie on peut objecter que la gravité risque de trop se diluer dans cette dimension supplémentaire et que la force de gravitation de Newton doit apparaitre beaucoup plus faible que prévue aux observateurs localisés sur l’Univers-brane à quatre dimensions ; et cela contredirait les mesures expérimentales de la loi de Newton qui confirment que le comportement de la force de gravitation est quadridimensionnel puisque son intensité diminue comme l’inverse de la distance au carré, au moins jusqu’aux petites distances de mm. Cependant dans leurs travaux de 1999 [9], Randall et Sundrum ont résolu ce paradoxe en proposant un modèle d’Univers branaire cohérent où la dimension supplémentaire est non-compacte et infinie mais préserve néanmoins un comportement quadridimensionnel pour la gravitation sur la brane à basse énergie (distances mm), du point de vue d’un observateur “confiné” sur la brane. Dans le modèle de Randall-Sundrum, l’Univers est une brane de géométrie Minkowski à quatre dimensions plongée dans un espace-temps à cinq dimensions de courbure négative, c’est-à-dire de géométrie Anti-de Sitter (). L’idée astucieuse de ce modèle est que la courbure négative de la dimension supplémentaire empêche la gravité de se diluer complètement dans cette dimension, de telle sorte que la gravité reste localisée de façon dynamique sur la brane à quatre dimensions. De cette façon le comportement de la gravité standard à quatre dimensions reste effectivement conservé sur la brane à basse énergie. Bien-sûr, la brane étant ici plate et vide de matière, ce premier modèle est pauvre du point de vue de la cosmologie. L’étape suivante est d’étudier la cosmologie dans le cas d’un Univers-brane ayant un contenu de matière et une histoire d’expansion cosmologique, c’est-à-dire une brane de géométrie Friedmann-Robertson-Walker plongée dans l’espace anti-de Sitter. Un outil efficace sinon indispensable pour évaluer les conséquences cosmologiques de ces modèles d’Univers reste la théorie des perturbations cosmologiques.
L’Univers constitue le plus grand laboratoire pour étudier les processus de la physique des hautes énergies et la cosmologie observationnelle est devenue à partir de la fin du vingtième siècle une science de précision extrême à travers les relevés de supernovae, les observations des structures à grande échelle de l’Univers, et surtout la cartographie des anisotropies de température et de polarisation du Fond Diffus Cosmologique (CMB, en anglais, pour Cosmic Microwave Background) grâce aux satellites COBE en 1992 puis WMAP en 2003. Le rayonnement de photons du Fond Diffus nous parvient depuis la surface de dernière diffusion, c’est-à-dire au moment du découplage entre la matière et les photons, 380 000 ans après le Big-Bang (redshift ) quand l’Univers ne faisait qu’un millième de sa taille actuelle et lorsque sa température était de 3000 K. C’est donc l’image la plus ancienne de notre Univers accessible aux observations. Ce rayonnement du ciel est un rayonnement micro-onde de type corps noir dont la température est aujourd’hui de 2.7 K à cause de l’expansion de l’Univers mais il présente néanmoins des anisotropies relatives, de l’ordre de , qui sont le reflet des inhomogénéités initiales de l’Univers, responsables de la formation ultérieure des grandes structures de l’Univers par attraction gravitationnelle. Ces inhomogénéités résultent elles-même de fluctuations quantiques intrinsèques aux échelles subhorizon lors de l’époque de l’Inflation de l’Univers. La théorie des perturbations cosmologiques permet de relier les perturbations inhomogènes initiales aux anisotropies du Fond Diffus Cosmologique. Les spectres d’anisotropies de température et de polarisation ont été calculés dans le cadre quadridimensionnel du Modèle Standard de la cosmologie et reproduisent dans un certain intervalle de précision les cartes du CMB observées. Dans le cadre d’une cosmologie branaire du type Randall-Sundrum, en présence d’une dimension supplémentaire ayant une structure Anti-de Sitter, on ne peut exclure que cette cinquième dimension ait un rayon de courbure aussi important qu’un dixième de millimètre. L’enjeu majeur pour la cosmologie branaire est de calculer l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion quelconque afin de comparer les résultats obtenus aux données du Fond Diffus Cosmologique. C’est dans ce cadre que s’inscrit la majeure partie de ce travail de thèse.
La théorie des perturbations cosmologiques standard quadridimensionnelle est bien connue depuis 1963 grâce aux travaux pionniers de Lifshitz et Khalatnikov [23] suivis en 1980 du formalisme invariant de jauge développé par Bardeen [24]. Selon le principe cosmologique, l’Univers apparait homogène et isotrope à grande échelle dans les trois directions spatiales. De ce fait les équations d’Einstein linéarisées pour les perturbations peuvent être diagonalisées par transformation de Fourier dans l’espace tridimensionnel et chaque mode de Fourier évolue selon une équation aux derivées ordinaires (EDO) en temps. Dans le cadre de la cosmologie branaire, la théorie des perturbations cosmologiques demeure bien plus compliquée parce que la présence de la brane, en tant que défaut topologique, brise l’isotropie de l’espace-temps à cinq dimensions, de sorte que les équations de perturbations ne sont plus des EDO en temps mais des équations aux dérivées partielles (EDP) en temps et en la cinquième dimension. Des résultats analytiques ont cependant été obtenus pour des Univers-branes vides à symétrie maximale, telle qu’une brane Minkowski ou une brane purement (Anti-)de Sitter. Mais dans le cas d’une brane “cosmologique” avec un contenu de matière et ayant une expansion arbitraire dans le temps, les équations linéarisées satisfaites par les perturbations cosmologiques ne sont plus séparables, de sorte que peu de prédictions quantitatives statisfaisantes ont été obtenues pour l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion. Cependant ce premier problème reste d’ordre technique et peut donc a priori être abordé de façon numérique. Un second problème, d’ordre plus fondamental ou physique, est celui des conditions initiales dans Anti-de Sitter : en plus d’être specifiées sur les degrés de liberté localisés sur la brane, les conditions initiales doivent être spécifiées sur une infinité de degrés de liberté dans le bulk . Mais il n’y a pas de conditions initiales naturelles dans l’espace . En cosmologie standard l’existence de conditions initiales naturelles est résolue par les scenarios d’Inflation et ce succès repose sur la structure causale de la géometrie de fond de Sitter () qui tend a effacer les irrégularités initiales. Mais dans le scénario branaire de Randall-Sundrum la géométrie de fond est , dont la structure causale fait que l’amplitude des irregularités initiales est conservée au cours du temps, empêchant ainsi de générer l’homogénéité et l’isotropie de l’Univers observées aujourd’hui. Si les difficultés techniques peuvent être écartées par des approches numériques, le problème des conditions initiales persiste puisque les schémas numériques ont besoin de spécifier des conditions initiales particulières dans le bulk pour faire évoluer les perturbations. Dans ce travail de thèse nous abordons le problème de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion de façon analytique: on utilise une approche effective quadri-dimensionnelle où on “trace” sur l’information manquante portée par les degrés de liberté du bulk, que l’on englobe dans le propagateur retardé de , ce qui évite de définir un vide initial dans le bulk. Nous calculons le propagateur retardé effectif sur la brane en resommant les effets de rétroaction du bulk, contenus dans le propagateur retardé du bulk , à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. L’objectif suivi dans ce travail de thèse est d’obtenir des résultats quantitatifs quant à l’ordre de magnitude des effets cosmologiques dûs à la présence de dimensions supplémentaires, cela dans un modèle d’Univers branaire en expansion arbitraire et du type Randall-Sundrum. Au lieu de chercher des solutions exactes aux équations de perturbations cosmologiques, nous nous sommes intéressés davantage au rôle des gravitons du bulk dans leur interaction avec les degrés de liberté localisés sur la brane. Dans le cas d’une expansion non-uniforme de l’Univers, les excitations quantiques de degrés de liberté localisés sur la brane peuvent engendrer l’émission de gravitons dans le bulk ; ceux-ci peuvent alors s’échapper vers l’infini futur, faisant apparaitre, du point de vue quadridimensionnel d’un observateur localisé sur la brane, une forme de dissipation. Les gravitons émis peuvent aussi être réfléchis ou diffractés dans le bulk inhomogène Anti-de Sitter à cause de la courbure, puis réabsorbés par la brane, engendrant une sorte de non-localité du point de vue d’un observateur sur la brane. Ces processus de dissipation et de non-localité sont “codés” dans le propagateur du graviton et par conséquent dans le propagateur effectif sur la brane, et constituent des signatures de la présence de dimensions supplémentaires. La majeure partie de cette thèse est consacrée au calcul des phénomènes dissipatifs en cosmologie branaire. Le dernier chapitre de cette thèse traite un sujet différent concernant un travail effectué en cosmologie standard : il s’agit d’un travail en progrès sur la reconstruction en espace réel des effets de lentilles gravitationnelles qui contaminent les spectres primordiaux du CMB. Ce mémoire de thèse est organisé comme suit :
-
—
Au chapitre 1 nous donnons les motivations physiques de la présence de dimensions supplémentaires dans l’Univers et introduisons les modèles d’Univers branaires.
-
—
Au chapitre 2 nous présentons le modèle de Randall-Sundrum ainsi que ses conséquences cosmologiques, ce travail de thèse s’inscrivant dans ce modèle.
-
—
Au chapitre 3 nous présentons la théorie des perturbations cosmologiques branaires dans le formalisme de Mukohyama et nous discutons quels sont les problèmes et les difficultés rencontrées dans le calcul de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion.
-
—
Au chapitre 4 nous exposons l’approche que nous avons adoptée pour étudier l’interaction brane-bulk et évaluer l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion. Nous montrons comment des processus de dissipation et de non-localité sont “codés” dans le propagateur du bulk Anti-de Sitter et nous calculons les taux de dissipation de divers degrés de liberté localisés sur la brane. Nos résultats que nous exposons dans ce chapitre ont donné lieu à la publication d’un article [51]: “Dissipation and nonlocality in a general expanding braneworld universe”, Mathieu Remazeilles, Phys. Rev. D79:043523 (arXiv:0807.4238 [hep-th]).
-
—
Au chapitre 5 nous calculons le propagateur retardé exact du graviton dans l’espace Anti-de Sitter de façon covariante. Ce travail n’a pas été soumis à publication.
-
—
Au chapitre 6 nous terminons sur un tout autre sujet concernant un travail effectué en cosmologie standard sur les effets de lentilles gravitationnelles qui contaminent les spectres du rayonnement du Fond Diffus Cosmologique. Il s’agit de construire un estimateur statistique optimal du potentiel de lentille en espace réel (par opposition à l’espace de Fourier tel qu’il a été fait dans la littérature) à partir des spectres observés des anisotropies de température et de polarisation, cela dans le but de pouvoir nettoyer les spectres primordiaux des effets de lentilles gravitationnelles tout en tenant compte des éventuelles coupures et excisions du ciel (points source, Voie Lactée, …). Les résultats de chapitre sont en progrès et doivent bientôt donner lieu à la publication d’un article : “CMB lensing reconstruction in real space”, Martin Bucher, Kavilan Moodley and Mathieu Remazeilles.
La convention de sommation d’Einstein sur les indices sera souvent utilisée : pour un espace-temps à dimensions de métrique .
La forme de ce mémoire de thèse traduit une volonté de présenter de façon claire et concise quels sont les enjeux et les difficultés du calcul des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion et quelle a éte mon approche pour les résoudre. Il ne s’agit en aucun cas de rappeler les bases de la théorie de la relativité générale ou les résultats de la cosmologie standard que le lecteur intéressé pourra trouver dans les nombreux ouvrages pédagogiques de qualité déjà existant sur le sujet et cités dans la bibliographie à la fin de ce manuscript.
Chapitre 1 Dimensions supplémentaires et Univers branaires
L’existence de dimensions spatiales supplémentaires dans l’Univers a d’abord été proposée dans la théorie de Kaluza-Klein en 1921. En introduisant une cinquième dimension dans l’espace-temps, Kaluza [2] puis Klein [3] ont remarqué qu’on pouvait de cette façon unifier l’interaction gravitationnelle et l’interaction électromagnétique. En effet les équations d’Einstein de la relativité générale à cinq dimensions peuvent se décomposer, lorsqu’on les projette sur l’espace-temps usuel à quatre dimensions, en les équations d’Einstein à quatre dimensions de la relativité générale, les équations de Maxwell décrivant l’interaction électromagnétique à quatre dimensions plus une équation de Klein-Gordon pour un nouveau champ scalaire appelé dilaton. L’absence de détection de la cinquième dimension a été expliquée par le fait que cette dimension supplémentaire devait être compactifiée autour du cylindre de rayon suffisamment petit de façon à échapper aux instruments de mesure. La théorie de Kaluza-Klein est ensuite tombée un peu dans l’oubli avec l’ engouement des physiciens provoqué par les découvertes de la mécanique quantique et des théories de jauges , et au cours du vingtième siècle, ces théories quantiques de champs décrivant avec succès les interactions électromagnétique, faible et forte entre les particules élémentaires ainsi que grand nombre d’expériences subatomiques. Cependant les phénomènes gravitationnels extrêmes existant dans l’Univers incluent à la fois des effets quantiques et des effets gravitationnels. C’est le cas pour la formation des trous noirs ou le comportement de la physique proche du Big-Bang. Dans l’objectif de comprendre la physique de ces phénomènes, la construction d’une théorie quantique de la gravitation s’est avérée indispensable. Dans cette quête d’une unification de la gravité avec les autres interactions fondamentales, la question de la dimensionnalité de l’espace-temps a resurgi à travers la théorie des cordes supersymétriques, ou supercordes, qui reste le meilleur candidat à l’unification. En remplaçant la représentation ponctuelle des particules de la théorie quantique des champs par une représentation unidimensionnelle sous forme de cordes élémentaires, cette théorie est à même de réconcilier la relativité générale avec les théories quantiques de champs, mais au prix d’une reconsidération de la dimensionnalité de l’espace-temps. En effet la quantification de la théorie des cordes n’est pertinente d’un point de vue mathématique que si les cordes évoluent dans un espace-temps à dimensions. Cette découverte, associée à la découverte que la théorie des cordes contient des solutions classiques correspondant à des membranes, appelées “D-branes”, de dimensions diverses, en plus des cordes elles-même, a inspiré l’idée que notre Univers observable réside sur une brane à dimensions plongée dans un espace-temps de plus haute dimension. Nous exposons dans ce chapitre les motivations physiques issues de la théorie des cordes qui ont inspiré les scénarios branaires et nous présentons quelques modèles branaires.
1.1 Deux résultats fondamentaux de la théorie des cordes
Nous déduisons dans cette section deux résultats majeurs de la théorie des cordes [1] qui ont motivé l’étude de modèles d’Univers branaire : la présence du graviton dans le spectre des états quantiques de la corde et la dimensionnalité de l’espace-temps. Nous nous restreignons à l’étude de la corde bosonique libre pour appréhender ces deux propriétés.
1.1.1 Le spectre quantique des cordes contient le graviton
En théorie quantique des champs la particule ponctuelle relativiste libre se propage dans l’espace-temps le long d’une ligne d’Univers de longueur minimale (géodésique), paramétrisée par le temps propre et à l’aide des coordonnées d’espace-temps notées . Suivant le principe de moindre action, les équations du mouvement de la particule sont obtenues en minimisant l’action proportionnelle à la longueur de la ligne d’Univers. La corde de la théorie des cordes n’étant que la généralisation bidimensionnelle de la particule, elle se propage dans l’espace-temps le long d’une feuille d’Univers d’aire minimale, paramétrisée par deux variables , ) et à l’aide des coordonnées d’espace-temps notées . Le choix naturel pour l’action de la corde bosonique est l’action de Nambu-Goto proportionnelle à l’aire de la feuille d’Univers, ou plutôt son homologue Lorentzien, . En utilisant la contrainte (1.2) calculée plus bas on montre aisément que cette action est équivalente à l’action de Polyakov
| (1.1) |
où la tension de la corde a la dimension d’une masse au carré et où il faut distinguer la métrique intrinsèque de la feuille d’Univers bidimensionnelle () de la métrique de l’espace-temps physique (ou espace cible) à dimensions (). Notons que si l’espace cible est Minkowskien on peut interpréter cette théorie d’un autre point de vue comme étant la gravité classique à deux dimensions, décrite par la métrique , en interaction avec champs scalaires ; le terme scalaire de Ricci de l’action d’Einstein-Hilbert n’ayant aucune raison d’être présent dans l’action parce que c’est un invariant topologique à deux dimensions et en ce sens un terme non dynamique111Notons de plus que l’on peut ajouter un terme de “constante cosmologique” dans l’action à deux dimensions qui contraint à respecter l’invariance relativiste de l’aire de la feuille d’Univers.. La minimisation de l’action (1.1) par rapport au champ métrique fournit une équation de contrainte sur l’annulation du tenseur énergie-impulsion de la feuille d’Univers
| (1.2) |
La feuille d’Univers de la trajectoire de la corde est conformément plate, c’est-à-dire conforme à l’espace Minkowski, comme toute variété bidimensionnelle. En effet l’action est invariante sous les difféomorphismes à deux dimensions, ainsi que sous transformation conforme de Weyl de la métrique de la feuille d’Univers, . L’invariance sous les difféomorphismes nous laisse la liberté de choisir la jauge telle que la métrique bidimensionnelle soit conforme à Minkowski , où est la métrique Minkowskienne, car disparaît de l’action. Nous considérons pour la suite que l’espace-temps physique de fond est Minkowskien afin de simplifier le raisonnement et nous notons , , alors l’action (1.1) se simplifie comme
| (1.3) |
où un “prime” dénote une dérivation par rapport à et un “point” une dérivation par rapport au temps . Dans le choix de jauge conforme la minimisation de l’action (1.3) par rapport à conduit à l’équation du mouvement de la corde qui n’est autre qu’une équation d’onde libre bidimensionnelle, et (1.2) conduit à deux équations de contraintes appelées conditions de Virasoro :
| (1.4) |
Il est nécessaire de choisir des conditions de bord pour la corde. Si la corde est une corde fermée il est naturel d’imposer une condition de périodicité sur le paramètre spatial tel que . Si la corde est une corde ouverte, chacune de ses extrémités peut satisfaire des conditions de bord de type Neumann, , ou peut aussi satisfaire des conditions de bord de type Dirichlet, . Les conditions de Dirichlet imposent à la corde ouverte d’avoir ses deux extrémités fixées dans une dimension spatiale, c’est-à-dire que la corde se trouve localisée dans l’espace-temps sur une hypersurface de genre temps et de codimension un où sont attachées ses extrémités. Cette hypersurface de l’espace-temps est appelée une D-brane où “D” vient de Dirichlet, ou encore une -brane car elle comporte dimensions spatiales. Son action est une généralisation à dimensions de celle de la corde qui n’est autre qu’une -brane. Comme nous allons le voir, le spectre quantique de la corde ouverte contient les états particulaires du Modèle Standard tel que le photon alors que le spectre de la corde fermée contient l’état du graviton. Les ingrédients sont donc réunis pour concevoir l’idée que les particules du Modèle Standard “seraient” des cordes ouvertes contraintes de se déplacer sur une D-brane de codimension un, représentant l’Univers observable, qui est entourée d’une dimension supplémentaire où seuls les gravitons, qui “seraient” des cordes fermées, peuvent se déplacer. La solution générale des équations du mouvement (1.4) pour la corde ouverte de type Neumann est donnée par
| (1.5) |
où est la longueur fondamentale de la
corde222La taille caractéristique des cordes peut être
calculée par analyse dimensionnelle en fonction de la constante de gravitation
, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck :
cm. Cette taille minuscule, dite
de Planck, justifie que les cordes
puissent être représentée à plus basse énergie par les particules ponctuelles
de la théorie quantique des champs. et
et correspondent respectivement à la position et à l’impulsion
du centre de masse de la corde. Pour la
corde fermée, la solution est une superposition de modes gauches G et droits
D,
, avec
| (1.6) | |||||
| (1.7) |
Nous pouvons quantifier la corde de façon canonique, comme en théorie
quantique des champs, en élevant au rang d’opérateurs les variables conjuguées
et et en imposant
des relations de commutation canoniques à temps égaux :
et
. Par conséquent les
coefficients des modes de la corde deviennent eux-même des opérateurs de création,
, et
d’annihilation, , qui satisfont les relations de commutation suivantes
| (1.8) |
pour la corde ouverte. L’état du vide est annihilé selon () et l’opérateur impulsion du centre de masse satisfait . Les états excités sont créés selon . Des relations similaires sont obtenues pour les opérateurs de la corde fermée. Les contraintes classiques de Virasoro sont représentées au niveau quantique par les opérateurs de Virasoro
| (1.9) |
où on a défini et où est une constante due à l’ambiguité dans l’ordonnement normal des opérateurs puisque et ne commutent plus dans . On peut vérifier que les contraintes classiques de Virasoro sont équivalentes à pour tout . La contrainte permet d’obtenir le spectre de masse des états physiques , c’est-à-dire sur la couche de masse, selon
| (1.10) |
où est la valeur propre de l’opérateur nombre d’excitations . Le spectre de la corde ouverte démarre donc avec
-
—
Le vide : et qui est un tachyon si .
-
—
Le premier état excité est un état bosonique vectoriel, : , . Cet état s’identifie au photon si sa masse est nulle, c’est à dire si .
Nous constatons donc que le choix dans la théorie des cordes bosoniques fait que le spectre de la corde ouverte contient le photon du Modèle Standard, c’est-à-dire la particule de jauge de spin 1 et à degrés de liberté véhiculant l’interaction électromagnétique. Cependant le vide est tachyonique ce qui traduit une instabilité du vide (masse imaginaire, impulsion de genre espace) et donc une incohérence à priori de la théorie quantique. En réalité cette instabilité tachyonique disparaît pour la théorie complète, dite des supercordes, qui inclue la présence de cordes fermioniques en plus des cordes bosoniques. L’action des supercordes est intrinsèquemnt supersymétrique (symétrie bosons-fermions), ce qui a pour effet d’éliminer le tachyon. Regardons maintenant le spectre de la corde fermée bosonique. Les relations de commutation supplémentaires pour les modes gauches de la corde fermée sont similaires à celles des modes droits , , où on note . Les états quantiques de la corde fermée sont crées à l’aide des opérateurs de création selon . Les conditions de Virasoro deviennent au niveau quantique . L’annulation de l’opérateur impose l’égalité entre les nombres de particules générées par les modes droits et gauches. L’annulation supplémentaire de l’opérateur fournit le spectre de masse suivant pour la corde fermée
| (1.11) |
Le vide de la corde fermée bosonique est encore tachyonique si . Le premier état excité () peut se décomposer selon
-
—
un état de spin 0 appelé dilaton, , de masse ,
-
—
un état tensoriel antisymétrique, , de masse ,
-
—
un état tensoriel symétrique et sans trace, , de masse .
En faisant le choix comme pour la corde ouverte, on constate le spectre de la corde fermée contient un état de spin 2 sans masse, symétrique et sans trace, état qui s’identifie naturellement au graviton, le champ de métrique de l’espace-temps. Le tachyon de la corde fermée disparait en théorie des supercordes lorsqu’on inclue les superpartenaires fermioniques dans la théorie. Le calcul des premiers états quantiques du spectre révèle que la théorie des supercordes engendre, parmi une infinité de particules, le photon, boson de jauge véhiculant l’interaction électromagnétique, ainsi que le graviton, boson de jauge devant véhiculer l’interaction gravitationnelle333On peut montrer que la théorie des cordes contient également les bosons de jauge de l’interaction faible et les gluons de l’interaction forte mais cela va au-delà de l’objectif de cette section.. En contenant le champ du graviton dans son spectre, la théorie des supercordes se présente donc comme une théorie quantique qui doit contenir la théorie de la relativité générale à basse énergie.
1.1.2 L’espace-temps possède (9+1) dimensions
Le choix de la jauge conforme, , adoptée précédemment ne fixe pas totalement la jauge pour l’action de Polyakov puisque peut-être choisi arbitrairement. Il reste une symétrie de jauge résiduelle liée aux transformations conformes de la feuille d’Univers. On peut utiliser cette liberté résiduelle pour fixer davantage la jauge. Introduisons pour cela les coordonnées du cône de lumière pour la feuille d’univers, , et pour l’espace-temps , les coordonnées transverses , , demeurant inchangées. L’action (1.3) puis l’équation du mouvement deviennent dans ces coordonnées
| (1.12) |
La symétrie résiduelle de l’action (1.12) correspond à la possibilité de reparamétrisations arbitraires de la feuille d’Univers , . Comme les solutions de l’équation du mouvement sont elles-même la somme d’une fonction de et d’une fonction de , l’invariance résiduelle nous autorise à fixer la jauge simple, dite du cône de lumière, pour un degré de liberté :
| (1.13) |
Les contraintes de Virasoro classiques, , où , permettent d’obtenir en fonction des :
| (1.14) |
où on a noté et où est une constante due à l’ambiguité d’ordonnement normal des opérateurs quantiques de création et d’annihilation et . L’encadrement entre deux points dénote le produit en ordre normal des opérateurs. On en déduit le spectre de masse des états quantiques où est la valeur propre de l’opérateur nombre d’excitations . Le premier état excité possède degrés de liberté et correspond au photon sans masse si de nouveau. Cette condition se trouve être en fait indispensable pour satisfaire l’invariance de Lorentz de la théorie puisque le premier état excité se transforme sous Lorentz comme un vecteur du groupe qui correspond au groupe de symétrie d’une particule vectorielle sans masse. Dans la jauge du cône de lumière on peut calculer cette fois directement la constante d’ordonnement normal , d’après la relation
| (1.15) |
On en déduit . Cette série divergente peut être régularisée au moyen de la fonction Zeta de Riemann selon de telle sorte que
| (1.16) |
Les conditions d’existence du photon et du graviton et la condition d’invariance de Lorentz dans la théorie des cordes se sont traduits par la condition . Combinée à l’expression explicite (1.16), cette condition impose à son tour la condition que l’espace-temps de la théorie des cordes bosoniques possède exactement dimensions. De façon alternative la quantification de la théorie par intégrale fonctionnelle à la Fadeev-Popov aurait montré qu’une anomalie quantique apparait dans l’algèbre des opérateurs de Virasoro (incluant les champs de ghost). La condition est alors nécessaire pour annuler l’anomalie quantique et ainsi rendre la théorie cohérente au niveau quantique. La théorie des cordes bosoniques n’est cependant pas satisfaisante d’un point de vue physique puisqu’elle ne contient pas de fermions. Une quantification analogue de la version supersymétrique de la théorie montre que les supercordes doivent en réalité évoluer dans un espace-temps à dimensions. Enfin précisons qu’il existe en fait cinq théories des supercordes différentes mais duales entre elles qui ne sont que des limites particulières d’une seule et unique théorie fondamentale, appelée “théorie M” [4], qui impose à l’espace-temps de posséder finalement dimensions.
Deux alternatives, qui ne s’excluent pas l’une et l’autre, ont été proposées pour expliquer l’absence de détection des six (ou sept) dimensions supplémentaires de l’espace-temps : ces dimensions peuvent soit être compactifiées à la Kaluza-Klein sur une échelle suffisament petite pour échapper à la résolution des instruments de mesure, soit être non-compactes mais orthogonales à une brane à quatre dimensions sur laquelle réside notre Univers observable.
1.2 Modèles d’Univers branaires
Nous avons vu que la théorie des cordes englobe toutes les théories de jauge y compris la gravitation à travers la présence du graviton dans son spectre. En contrepartie la quantification cohérente de cette théorie d’unification implique que l’espace-temps possède des dimensions supplémentaires. De plus les champs du Modèle Standard, décrits par des cordes ouvertes, peuvent être contraints de se déplacer sur des membranes (D-branes) de codimension 1. Seuls les gravitons, décrits par des cordes fermées, peuvent se propager dans la dimension supplémentaire. Ces conséquences majeures de la théorie des cordes ont été la première source d’inspiration dans la construction de modèles branaires, considérant que notre Univers observable réside en fait sur une brane à quatre dimensions plongée dans un espace-temps de dimension supérieure (Fig. 1.1). La physique du Modèle Standard conserve son comportement quadridimensionnel puisque tous les champs du Modèle Standard sont confinés sur la brane. La gravitation et la cosmologie doivent en revanche être affectées par la présence de dimensions supplémentaires puisque les gravitons peuvent se déplacer dans toutes les dimensions du bulk.
Dans cette section nous présentons dans les grandes lignes quelques premiers modèles branaires dont on pourra comparer les caractéristiques avec le modèle de Randall-Sundrum présenté de manière détaillée au chapitre 2.
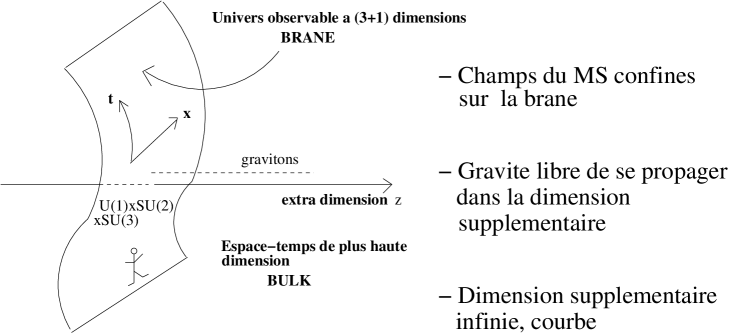
1.2.1 Modèle de Hoava-Witten
Ce modèle [4, 5] a été construit pour trouver des dualités qui relient les cinq versions perturbatives de la théorie des supercordes à la théorie M. On ne connait pas encore complètement la structure non-perturbative de la théorie M mais on sait que cette théorie fondamentale contient des -branes de dimension diverses et qu’elle admet la supergravité444Théorie avec supersymétrie locale qui induit la présence de la gravité. à 11 dimensions comme limite de basse énergie. En 1996, Hoava et Witten ont exprimé la théorie M, ou sa limite de basse énergie, la supergravité à 11 dimensions, sur la variété quotient , c’est-à-dire que la onzième dimension est compactifiée sur un cercle ayant une symétrie miroir et donc deux points fixes, le terme mathématique pour étant “orbifold”. En faisant cela ils ont constaté que, dans la limite d’un petit rayon de compactification, la théorie M est décrite par la théorie des cordes hétérotiques à 10 dimensions en couplage fort, qui est une des cinq versions de la théorie des cordes. Les deux points fixes de l’orbifold constituent des sous-espaces branaires à dimensions sur chacun desquels est confinée une théorie de jauge afin d’éliminer les anomalies de jauge et gravitationnelle dans la théorie. On peut encore compactifier à la Kaluza-Klein six dimensions spatiales sur une variété dite de Calabi-Yau, , parce que ce type de variété compacte conserve la supersymétrie de la théorie des cordes, réduisant ainsi le nombre de dimensions non-compactes à sur chaque brane fixe de l’orbifold : . En supposant que l’échelle de compactification des six dimensions sur la variété de Calabi-Yau est bien plus petite que le rayon de l’orbifold, on obtient le scénario d’un monde à cinq dimensions où se propage la gravité et contenant deux univers branaires à dimensions sur lesquels sont confinées les interactions de jauge (Fig.1.2). De part et d’autre de chaque brane l’espace est symétrique dans la cinquième dimension d’après la symétrie . Le modèle “cordiste” d’Horava-Witten a inspiré le modèle de Randall-Sundrum présenté plus loin, ainsi que le besoin de comprendre la phénoménologie et la cosmologie branaire à cinq dimensions non compactes.
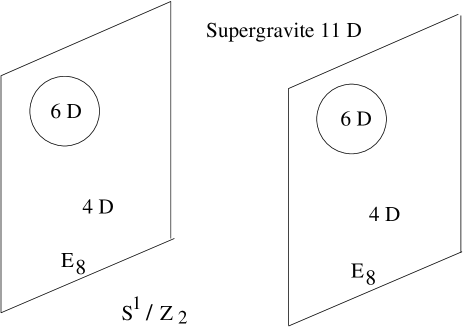
1.2.2 Modèle ADD
On peut se poser la question de savoir pourquoi l’interaction gravitationnelle entre deux particules est d’intensité beaucoup plus faible que les trois autres interactions de jauge du Modèle Standard. En effet l’échelle d’énergie à laquelle les interactions de jauge du Modèle Standard sont d’intensité équivalente est donnée par l’échelle électrofaible , alors que l’échelle d’énergie à laquelle l’intensité de la gravité serait aussi importante que celle des interactions de jauge est donnée par l’échelle de Planck , où est la masse de Planck et la constante de gravitation de Newton. Ceci constitue le problème de hiérarchie en physique des particules : pourquoi l’échelle de Planck de l’interaction gravitationnelle est-elle si éloignée de l’échelle électrofaible des trois autres interactions de jauge () ?
Le modèle d’Arkani-Hamed, Dimopoulos et Dvali (ADD) [7], publié en 1998, propose une solution au problème de hiérarchie. Dans ce modèle l’Univers réside sur une brane Minkowski à quatre dimensions entourée de dimensions supplémentaires compactes de taille ( est le rayon de compactification), donnant à l’espace-temps total à dimensions la topologie . Les champs de jauge du Modèle Standard sont confinés sur la brane, seule l’interaction gravitationnelle peut se diluer dans les dimensions compactes. L’échelle fondamentale de la gravitation est ainsi donnée par la masse de Planck à dimensions et la masse de Planck à quatre dimensions n’est qu’une échelle effective sur la brane. En supposant que l’échelle de Planck à dimensions est du même ordre de grandeur que l’échelle électrofaible, , on élimine ainsi tout problème de hiérarchie. L’importance de la masse de Planck à quatre dimensions , mesurée par un observateur localisé sur l’Univers-brane, s’explique donc par l’importance de la taille et du nombre des dimensions supplémentaires.
En appliquant le théorème de Gauss en dimensions, on trouve que le potentiel Newtonien d’interaction gravitationnelle entre deux masses test , séparées d’une distance vaut
| (1.17) |
illustrant que la gravité se dilue dans les dimensions supplémentaires. Par contre si les masses sont séparées d’une distance alors elles ne ressentent plus la présence des dimensions supplémentaires compactes et subissent un champ gravitationnel quasi quadridimensionnel : on obtient le comportement habituel du potentiel gravitationnel en
| (1.18) |
La constante de Planck effective à quatre dimensions est donc reliée à la à la constante de Planck fondamentale de plus haute dimension selon . En posant , la résolution du problème de hiérarchie exige donc que la taille des dimensions supplémentaires compactes soit
| (1.19) |
Le cas implique des modifications de la gravité de Newton usuelle jusqu’à des distances cm, c’est-à-dire de l’ordre des distances caractéristiques du système solaire. Ce cas est bien-sûr exclu par toutes les observations astronomiques. Par contre, le comportement quadridimensionnel en de la loi de Newton n’ayant jamais été testé à des distances inférieures au millimètre, cela laisse entrevoir la possibilité que l’Univers est une brane entourée d’au moins deux dimensions supplémentaires. Le cas est donc le plus intéressant car il implique l’existence de dimensions compactes de “grande”555L’échelle mm est “grande” par rapport aux autres échelles du problème telles que l’échelle électrofaible. taille mm et donc des modifications de la loi de Newton potentiellement détectables à cette “grande” distance. L’idée de ce modèle a été de profiter du fait que les trois interactions de jauge du Modèle Standard ont été testée aux échelles du TeV alors que la loi de la gravité n’a jamais été testée en dessous de mm. Cela autorise la gravité à se propager dans un espace de plus haute dimension tout en contraignant les interactions de jauge à se propager sur une brane à quatre dimensions.
La présence de dimensions supplémentaires entraine d’autres conséquences phénoménologiques, notamment l’existence de gravitons massifs comme nous allons le voir. De façon générale les gravitons sans masse (ou ondes gravitationnelles) se déplacent à la vitesse de la lumière dans un espace-temps à dimensions et correspondent aux fluctuations transverses et sans trace de la métrique. Les equations d’Eintein linéarisées pour ces perturbations de métrique se réduisent dans un espace-temps plat (Minkowskien) à une équation d’onde scalaire dans le vide (), c’est-à-dire dans l’espace des impulsions :
| (1.20) |
ce qui entraine l’apparence, du point de vue quadridimensionnel, d’une masse effective pour les gravitons . Dans le modèle ADD l’espace-temps total n’est pas Minkowskien puisque compactifié mais de la même façon en projetant les équations linéarisées du graviton à dimensions sur l’espace Minkowskien à quatre dimensions on obtient l’équation du mouvement d’un graviton massif à quatre dimensions. Les dimensions supplémentaires étant compactifiées sur un cercle de rayon , le spectre de masse des gravitons est discret et les masses sont séparées de . Cette tour discrète de gravitons massifs est appelée tour de Kaluza-Klein (KK) en référence au modèle du même nom qui partage cette propriété due aux dimensions supplémentaires. Plus est petit plus le premier graviton massif est lourd et peut avoir échappé aux détecteurs des accélérateurs de particules. Hormis les modifications de la loi de Newton à petite distance, la détection de gravitons KK dans les accélérateurs (e.g au Large Hadron Collider) constituerait une autre signature forte de la présence de dimensions supplémentaires.
1.2.3 Modèle RS 1
Le modèle ADD avec dimensions supplémentaires élimine certes la hierarchie entre l’échelle de Planck et l’échelle électrofaible mais introduit une nouvelle hiérarchie entre l’échelle électrofaible et l’échelle de compactification . De plus le fait que soit “grand” dans le modèle ADD autorise la présence de gravitons KK légers, ce qui semble incompatible avec l’absence de leur détection dans les accélérateurs actuellement en fonctionnement. Randall et Sundrum ont proposé un scénario alternatif pour résoudre le problème de hiérarchie en utilisant seulement une seule dimension supplémentaire, courbée mais non-compacte [8]. Dans ce premier modèle de Randall-Sundrum (modèle appelé RS 1), deux branes Minkowski de genre temps à quatre dimensions sont plongées dans une portion de l’espace Anti-de Sitter à cinq dimensions () où la cinquième dimension possède de plus la structure orbifold :
| (1.21) |
est la métrique Minkowski à dimensions et est le rayon de courbure l’espace . La première brane, située sur le point fixe de l’orbifold, est cachée tandis que l’autre brane, parallèlement positionnée à distance finie dans la dimension supplémentaire sur l’autre point fixe , constitue l’Univers visible. L’espace entre les deux branes a donc une constante cosmologique négative et est -symétrique de part et d’autre de chaque brane , (Fig. 1.3).
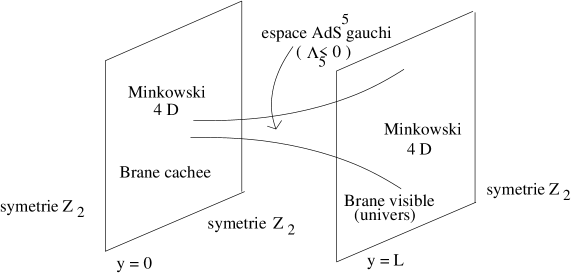
Cet édifice branaire correspond vraiment à une solution exacte des équations d’Einstein à cinq dimensions, qui conserve l’invariance de Poincaré à quatre dimensions sur chaque brane à la seule condition que les deux branes possède une tension de signe opposé qui soit ajustée selon , où est l’échelle fondamentale de Planck à cinq dimensions, afin d’annuler la constante cosmologique effective sur les branes Minkowski. Le modèle RS parait plus satisfaisant du point de vue géométrique que le modèle ADD puisque c’est une solution des équations d’Einstein et que les branes apparaissent cette fois comme des objets géométriques auto-gravitants, influençant la géométrie du bulk. Le point faible est que cet ajustement fin des paramètres n’a pas encore de justification fondamentale. Par contre le modèle RS s’insère très bien dans la théorie effective à cinq dimensions du scénario cordiste d’Horava-Witten (voir paragraphe 1.2.1). À partir de (1.21) on relie aisément le volume avec le volume ainsi que les scalaires de courbure de Ricci et , de telle façon que l’action d’Einstein-Hilbert inclue l’action effective à selon :
| (1.22) |
entrainant la relation suivante entre l’échelle fondamentale et l’échelle de Planck effective : . Si l’on veut discuter le problème de hiérarchie du point de vue de la brane visible supportant notre Univers il convient de renormaliser à le facteur conforme de la métrique induite sur la brane visible située à , en modifiant le facteur de gauchissement666“warp factor” en anglais. dans (1.21) selon . Dès lors la masse de Planck effective mesurée en sur la brane visible vaut
| (1.23) |
En supposant que l’échelle fondamentale soit le TeV et , le problème de hiérarchie se resoud donc en supposant que les branes sont distantes de . On constate que le modèle RS 1 n’introduit pas de nouvelle hiérarchie contrairement au modèle ADD. De plus la petite taille de la dimension supplémentaire répond de manière plus satisfaisante aux contraintes expérimentales que le modèle puisque les gravitons KK massifs sont cette fois beaucoup plus lourds avec des masses de départ de l’ordre du TeV. La distance entre les branes correspond à la valeur moyenne dans le vide d’un champ quantique scalaire (appelé le module), ce dernier doit être stabilisé si l’on veut que la hiérarchie soit respectée au niveau quantique. Notons qu’un mécanisme de stabilisation a été proposé par Goldberger et Wise [11] en introduisant un champ scalaire dans le bulk.
Je ne m’étendrai pas davantage sur le vaste problème de hiérarchie ni sur la phénoménologie des modèles branaires puisque je vais désormais me concentrer à partir du chapitre suivant sur la gravitation et la cosmologie dans le modèle de Randall-Sundrum à une brane (modèle appelé RS 2). Dans le modèle RS 2, l’Univers réside cette fois sur la brane en et l’autre brane a été repoussée à l’infini de sorte qu’il n’y a plus qu’une seule brane dans ce modèle.
Chapitre 2 Le modèle de Randall-Sundrum
Randall et Sundrum ont amené un point de vue nouveau sur la cosmologie et la gravitation en proposant en 1999 un modèle branaire simple et élégant [9] où la gravité standard est localisée de façon dynamique sur la brane quadridimensionnelle malgré la présence d’une dimension supplémentaire non-compacte et infinie. Dans ce modèle (dit RS 2), notre Univers observable réside sur une hypersurface à dimensions, une brane, de géométrie Minkowskienne plongée dans un espace-temps Anti-de Sitter à cinq dimensions (). De façon qualitative l’idée générale du modèle de Randall-Sundrum est que la courbure du bulk Anti-de Sitter entraine en fait une “compactification” effective de la cinquième dimension empêchant ainsi la gravité de se diluer dans cette dimension supplémentaire. En conséquence le comportement de la gravité d’Einstein reste préservé sur la brane, au moins aux grandes distances correspondant aux échelles où la force de gravité a été testée expérimentalement. Dans ce chapitre on présente quantitativement et qualitativement les conséquences gravitationnelles et cosmologiques du modèle branaire de Randall-Sundrum.
2.1 Localisation dynamique de la gravité
Dans le modèle de Randall-Sundrum l’Univers à dimensions est une brane Minkowki de tension plongée dans une portion de l’espace Anti-de Sitter à cinq dimensions de rayon de courbure :
| (2.1) |
où est la métrique de Minkowski à dimensions (Fig. 2.1). La métrique de l’espace dans les coordonnées (2.1) induit effectivement une métrique quadridimensionnelle de géométrie Minkowski sur la brane située en . Le facteur de gauchissement contient la valeur absolue parce que l’espace est supposé -symétrique de part et d’autre de la brane (symétrie miroir ), en référence à la symétrie orbifold du modèle de cordes de Hoava-Witten (paragraphe 1.2.1). Cette construction branaire (2.1) est la solution métrique des équations d’Einstein à cinq dimensions :
| (2.2) |
où et , , et où le tenseur énergie-impulsion (tension) quadridimensionnel de la brane est localisé en . Enfin la tension est ajustée à la constante cosmologique du bulk , afin qu’il n’y ait pas de constante cosmologique effective sur la brane Minkowski (), selon :
| (2.3) |
La géométrie de l’espace (2.1) est non-factorisable et gauchie.
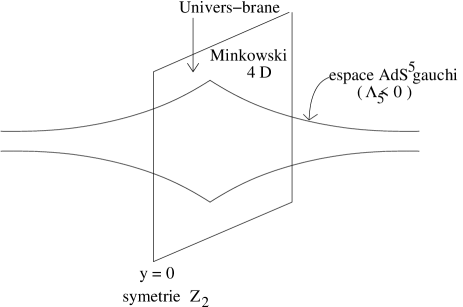
2.1.1 Equation du mouvement du graviton dans le bulk
La théorie des perturbations de la métrique permet de calculer le spectre des gravitons (ou ondes gravitationnelles d’un point de vue classique) apparaissant dans le modèle de Randall-Sundrum. Les ondes gravitationnelles correspondent aux fluctuations inhomogènes et anisotropes de la métrique de l’espace-temps, il s’agit donc d’étudier l’évolution des perturbations de la métrique à l’ordre linéaire à travers les équations d’Einstein linéarisées. Pour linéariser les équations d’Einstein il est pratique de se placer dans le système de coordonnées conformes de Poincaré, , pour décrire le bulk
| (2.4) |
Dans ces coordonnées, la métrique est conforme à la métrique Minkowski et est la dimension supplémentaire. Le calcul des perturbations, , de la métrique (2.4) du bulk
| (2.5) |
se ramène ainsi d’une certaine façon au calcul, plus simple, des perturbations de l’espace plat Minkowskien. Notons la métrique plate perturbée et la métrique perturbée (2.5) avec le facteur conforme . La perturbation linéaire du tenseur d’Einstein, , dans l’espace Minkowski perturbé est triviale (voir par exemple dans le livre de Robert Wald [10])
| (2.7) | |||||
où signifie la symétrisation sur les indices. De plus les tenseurs d’Einstein de deux espaces-temps conformes entre eux sont liés selon (voir par exemple dans le livre de Wald [10])
| (2.9) | |||||
où est la dérivée covariante selon la métrique de Minkowski perturbé. A partir de (2.7) et (2.9) on en déduit la perturbation linéaire du tenseur d’Einstein dans l’espace
| (2.15) | |||||
Il s’ensuit que les équations d’Einstein linéarisées dans le bulk , , sont
| (2.16) | |||
| (2.17) |
Comme la théorie de la relativité générale à cinq dimensions est invariante sous les cinq reparamétrisations locales des coordonnées d’espace-temps , , on peut fixer la jauge
| (2.18) |
qui élimine cinq composantes des quinze composantes de la perturbation . Cependant la jauge n’est pas complètement fixée [12] puisqu’on peut trouver cinq fonctions arbitraires dépendant des coordonnées 4D () telles que les reparamétrisations locales suivantes des coordonnées d’espace-temps, , ne modifient pas la jauge mais seulement les composantes transverses de la perturbation selon
| (2.19) |
Dans la jauge (2.18) on peut décomposer l’équation du mouvement (2.1.1) selon
| (2.20) | |||||
| (2.21) | |||||
| (2.22) |
où les indices sont élevés avec la métrique plate 4D , est la trace et . Les trois premières équations de (2.20) sont non-dynamiques et leur résolution donne et , où et sont cinq fonctions arbitraires des coordonnées 4D. On peut fixer complètement la jauge en choisissant les reparamétrisations résiduelles , telles qu’elles satisfont et . En faisant ce choix on annule ainsi et . Cette jauge complètement fixée est la jauge de Randall-Sundrum (RS), transverse et sans trace :
| (2.23) |
qui réduit les composantes de la perturbation métrique aux cinq degrés de libertés physiques du graviton . Dans la jauge RS (2.23), l’équation (2.20) du mouvement du graviton dans le bulk se réduit à une équation d’onde de type Klein-Gordon sur chaque degré de liberté du graviton. En ce sens les gravitons découplent et se propagent comme des champs scalaires libres dans le bulk selon :
| (2.24) |
L’équation de Klein-Gordon pour un champ scalaire libre dans n’importe quel système de coordonnées de métrique s’écrit
| (2.25) |
On peut donc réecrire cette équation de Klein-Gordon dans les coordonnées Gaussiennes normales (GN) initiales (2.1) du modèle de Randall-Sundrum et faire de plus le changement de variable afin d’observer l’évolution du champ réel de perturbation de métrique : . L’équation du mouvement des gravitons physiques devient dans les coordonnées GN -symétriques :
| (2.26) |
La fonction de Dirac provient de la symétrie et correspond aux conditions de bord suivantes pour le graviton sur la brane :
| (2.27) |
On peut retrouver l’équation du mouvement du graviton (2.26) en linéarisant de façon indépendante l’équation d’Einstein dans le bulk et les conditions de jonction d’Israel sur la brane. Les conditions de jonction d’Israel sont l’analogue en relativité générale des conditions de saut en électromagnétisme qui indiquent la variation du champ électromagnétique à la traversée d’une surface contenant des charges et des courants. Les conditions d’Israel découlent des équations d’Einstein, une fois prise en compte la matière présente sur la brane, et elles indiquent les variations du champ de métrique à la traversée de la brane contenant le tenseur énergie-impulsion selon :
| (2.28) |
où est la métrique induite sur la brane et est la courbure extrinsèque de la brane, c’est-à-dire à la courbure de la brane induite par immersion dans l’espace de dimension supérieure. Dans des coordonnées GN, la courbure extrinsèque est simplement donnée par la dérivée normale à la brane de la métrique induite [10] : . De plus, ici il n’y a pas de matière sur la brane, de sorte que le tenseur énergie-impulsion correspond simplement à la tension de la brane . En tenant compte enfin de la symétrie , , la linéarisation des conditions de jonction d’Israel selon entraine
| (2.29) |
Cela se traduit par les conditions de bord (2.30) du graviton sur la brane, complémentaires de l’équation du mouvement (2.31) dans le bulk :
| (2.30) | |||||
| (2.31) |
On constate qu’on peut encapsuler la condition de bord de (2.30) dans l’équation du bulk (2.31) de façon -symétrique et obtenir une écriture "compacte" de l’équation du mouvement du graviton correspondant exactement à la forme (2.26) précédemment obtenue.
Les indices tensoriels du champ de graviton n’apportant aucune information sur la propagation, nous utiliserons désormais une notation de type champ scalaire pour le graviton : . Notons enfin que les cinq degrés de liberté du gravitons 5D peuvent se décomposer par “projection” sur la brane 4D en deux degrés de liberté tensoriels transverses et sans trace (ondes gravitationnelles), deux degrés de liberté vectoriels sans divergence (appelés “gravi-photon”) et un degré de liberté scalaire (appelé “gravi-scalaire”).
2.1.2 Spectre des gravitons 5D
L’équation du mouvement (2.26) est séparable, de telle sorte qu’on peut chercher les modes du graviton , , selon
| (2.32) | |||||
| (2.33) |
Du point de vue d’un observateur confiné sur la brane, ces modes correspondent à des excitations de spin massives, c’est-à-dire des gravitons massifs de type Kaluza-Klein (KK).
Un moyen intuitif de cerner la physique du Modèle de Randall-Sundrum est d’analyser le problème de mécanique quantique analogue. En se plaçant dans les coordonnées conformes et en changeant d’échelle le champ de graviton selon , l’équation du mouvement des gravitons (2.32) dans le bulk prend la forme d’une équation de type Schrödinger
| (2.34) |
où la brane est située en et le potentiel de Schrödinger vaut
| (2.35) |
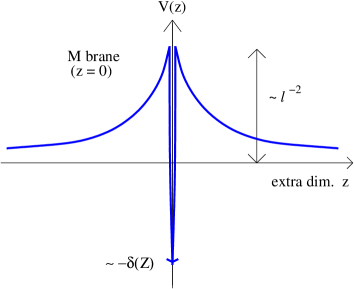
La forme du potentiel (Fig. 2.2) dans lequel évoluent les gravitons nous renseigne sur le spectre possible des gravitons : la présence de la brane créée un puit de potentiel infini alors que la courbure du bulk forme une barrière de potentiel décroissante comme l’inverse au carré de la distance à la brane. L’allure du potentiel qui en résulte est celle d’un "potentiel-volcan" qui autorise la présence d’un unique état lié, le mode zéro du graviton , accompagné d’un continuum d’états libres de se déplacer dans la cinquième dimension. L’état lié signifie que la fonction d’onde correspondante du mode zéro a son support localisé près de la brane, autour de 111Dans un langage plus mathématique, l’état lié est un état discret normalisable.. Du point de vue d’un observateur sur la brane, l’état lié du graviton s’identifie naturellement au graviton sans masse standard de la théorie effective à alors que les autres modes s’identifient à une infinité continue de gravitons KK massifs. Le potentiel tend asymptotiquement vers zéro quand , ce qui justifie l’absence de gap d’énergie entre le mode lié et le continuum KK dont les masses possibles sont et qui indique que les modes massifs se comportent asymptotiquement comme des ondes planes dans le bulk. La présence de ce continuum de gravitons KK massifs est le signe de la taille infinie de la dimension supplémentaire de structure . Nous tenons ici le résultat essentiel du modèle de Randall-Sundrum : malgré la présence d’une dimension supplémentaire non-compacte et infinie, la gravité standard (donnée par le mode de masse nulle) reste localisée sur la brane et ne fuit pas dans la cinquième dimension. Quant aux gravitons massifs libres et parasites, leur interaction avec la brane est supprimée à basse énergie grâce à la barrière de potentiel. Ainsi la théorie de la relativité générale quadridimensionnelle reste préservée en partie sur la brane, à basse énergie.
Concrètement la fonction d’onde (Fig. 2.3) du mode zéro lié du graviton est
| (2.36) |
et les fonctions d’onde des modes libres des gravitons KK massifs sont
| (2.37) |
Cette combinaison particulière des fonctions de Bessel satisfait les conditions de bord de inscrites dans la fonction du potentiel (2.35) : . La normalisation du mode zero, qui est un état discret normalisable, est imposée par . On peut trouver les coefficients de normalisation puisque les modes continus satisfont la condition d’orthonormalité . Le produit scalaire de Klein-Gordon correspondant est donné par . On remarquera que la fonction d’onde du mode lié correspond également à la limite de la fonction d’onde des modes massifs.
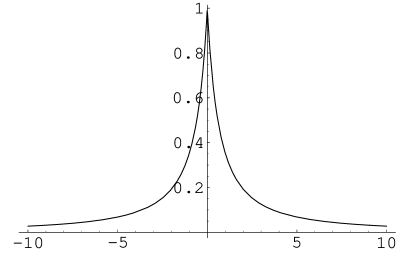
La courbure du bulk réalise en fait une sorte de "compactification effective" puisque, malgré une dimension supplémentaire infinie, le volume effectif supplémentaire est fini :
| (2.38) |
2.1.3 Modifications de la loi de gravitation de Newton
Même si la gravité se comporte de façon quadridimensionnelle du point de vue d’un observateur sur la brane à basse énergie, elle n’est pas purement locale (i.e confinée en ) mais localisée près de la brane avec une extension typique dans la cinquième dimension. La présence de modes massifs de gravitons KK doit provoquer des corrections pentadimensionnelles à la gravité standard à haute énergie (ou aux petites distances). Il est d’un intérêt cosmologique d’estimer ces corrections pour savoir si leur magnitude est suffisamment importante pour être accessible aux observations et aux expériences. Ces corrections de plus haute dimension constituent la signature des dimensions supplémentaires. Dans ce paragraphe on évalue les corrections pentadimensionnelles au potentiel Newtonien crée par une source gravitationnelle sphérique purement localisée sur la brane. Le calcul relativiste a été effectué par Garriga et Tanaka [13] en 2000.
On choisit temporairement la jauge dite Gaussienne normale (GN) au lieu de la jauge RS afin de faciliter le calcul des conditions de jonction d’Israel sur la brane en présence d’une source de matière. Dans la jauge GN, par définition, la brane reste fixée en dans les coordonnées GN (2.1) malgré les perturbations de la géométrie, c’est-à-dire
| (2.39) |
où le “tilde” est utilisé pour distinguer les variables dans la jauge GN des variables dans la jauge RS (qui seront dénotées par une “barre” pour les perturbations de métrique et sans rien pour les coordonnées de fond).
À l’ordre linéaire dans les perturbations et dans la jauge GN, les équations de jonction d’Israel (2.29) -symétriques deviennent, en présence de matière sur la brane,
| (2.40) |
où est le tenseur énergie-impulsion de la source de matière isolée sur la brane et est sa trace. Comme la tension de la brane est ajustée selon et , ces conditions de bord se réduisent dans la jauge GN à
| (2.41) |
Dans la jauge RS on a aussi la condition . La reparamétrisation la plus génerale qui conserve cette condition
| (2.42) | |||||
| (2.43) |
où les ne dépendent que des quatre coordonnées transverves, permet de passer de la jauge GN () à la jauge RS (). Dans la jauge RS la brane est légèrement déplacée en et les conditions de jonction sur la brane deviennent
| (2.44) | |||||
| (2.45) |
où la source inclue le léger déplacement de la brane. L’écriture compacte de l’équation du mouvement dans le bulk et des conditions de bord de façon symétrique devient donc dans la jauge RS
| (2.46) |
dont la solution formelle s’écrit
| (2.47) |
où est la fonction de Green retardée de l’équation du mouvement du graviton. La jauge RS impose et donc (2.47) impose , qui à son tour à travers (2.44) implique que le déplacement de la brane satisfasse
| (2.48) |
La présence d’une source de matière isolée sur la brane aura donc tendance à créer un déplacement local de la brane (“brane bending” en anglais) dans le bulk , , au niveau de la position de la source (Fig. 2.4). Signalons que la condition de la jauge RS est par conséquence aussi vérifiée d’après l’expression de (2.44).
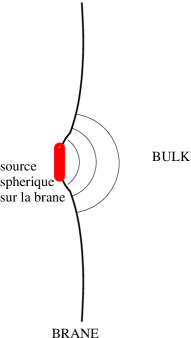
La fonction de Green est séparable avec
| (2.49) | |||||
| (2.50) | |||||
| (2.51) |
où est la transformée de Fourier de la fonction de Green massive dans Minkowski 4D et . Les solutions dans le bulk ont déjà été calculées en (2.37)
| (2.52) |
La fonction de Green retardée est donc donnée par
| (2.53) |
Le premier terme provient du mode zéro du graviton alors que le second terme provient de la contribution des modes KK massifs continus.
On considère une source stationnaire et on définit la fonction de Green stationnaire , où les coordonnées en gras couvrent les trois dimensions spatiales transverses sur la brane. Si les deux points sont sur la brane (, ) alors, en considérant les asymptotes des fonctions de Bessel, on trouve que la fonction de Green se comporte comme
| (2.54) |
Le premier terme issu du mode zéro correspond à la fonction de Green de l’équation de Poisson tridimensionnelle et le second terme est correctif et provient des modes massifs du bulk.
On peut décomposer les
perturbations de métrique selon , où on a
volontairement séparé la partie matière de la partie déplacement dans la
source :
et . Comme il est plus
pratique d’utiliser la jauge GN pour évaluer les perturbation de métrique sur
la brane fixée en , nous nous replaçons dans la jauge GN. De
(2.42), on voit qu’on peut choisir tel que la
perturbation métrique sur la brane en soit : .
Ainsi, pour une source de matière statique à symétrie sphérique sur la brane
| (2.55) |
où la quadrivitesse est et , on peut résoudre exactement les équations. En statique, l’équation de déplacement (2.48) s’écrit , elle s’intègre aisément de sorte qu’on trouve
| (2.56) | |||||
| (2.57) |
On déduit aussi facilement que et . À l’extérieur de la source on peut supposer que puis, en définissant la masse de la source , on trouve à partir de l’expression (2.54) de la fonction de Green que
| (2.58) |
et donc que le déplacement de la brane due à la matière vaut
| (2.59) |
Finalement le potentiel gravitationnel Newtonien créé par la source sur la brane est obtenu dans la limite de champ faible par la perturbation métrique sur la brane en jauge GN :
| (2.60) |
où est la constante de gravitation quadridimensionnelle. On constate qu’aux grandes distances le potentiel gravitationnel créé par la source de matière correspond au potentiel Newtonien standard quadridimensionnel. La signature d’une dimension supplémentaire se manisfeste donc à très courte distance , indiquant que l’effondrement gravitationnel est à cette échelle très différent de celui du trou noir de Schwarzchild à quatre dimension. Les corrections à la gravité quadridimensionnelle sont très faible à basse énergie comme c’était prévu à cause de la suppression des modes KK massifs par la barrière de potentiel (voir paragraphe 2.1.2). Les plus récents tests de la loi de Newton ont mesuré un comportement standard quadridimensionnel en de la force de gravitation jusqu’à des distances de millimètres [15]. Les expérimentateurs ne sont pas encore en mesure de pouvoir tester la force de gravitation à des distances plus courtes que le dixième de millimètre pour éventuellemnt détecter un comportement de plus haute dimension de la gravitation dans l’ultra-violet. Cette borne expérimentale indique qu’on ne peut exclure, pour une dimension supplémentaire ayant une structure anti-de Sitter, une taille aussi grande qu’un dixième de millimètre : mm.
Si les deux points de la fonction de Green (2.53) sont choisis sur la brane et comme le mode zéro est dominant à basse énergie on peut tronquer la fonction de Green au mode zéro et obtenir que . On en déduit que la perturbation métrique sur la brane est similaire à la solution standard de la théorie d’Einstein 4D linéarisée :
| (2.61) |
2.2 Cosmologie branaire dans le modèle RS
Le Modèle de Randall-Sundrum reproduit donc la théorie de la relativité générale à quatre dimensions sur la brane à basse énergie grâce à la courbure du bulk qui entraine l’exitence conjointe d’un état lié du graviton et d’une barrière de potentiel s’opposant à l’interaction des gravitons massifs du bulk avec la brane. Des modifications à la loi de gravitation de Newton, dues à la présence d’une cinquième dimension infinie et non-compacte, se manifestent à courte distance sur la brane , où est le rayon de courbure du bulk anti-de Sitter. Si le cas d’une brane Minkowskienne (plate et sans contenu de matière) permet d’appréhender les conséquences gravitationnelles dans le scénario branaire RS, ce cas n’est pas réaliste du point de vue de la cosmologie. L’Univers primordial a subi en réalité divers types d’expansion cosmologique au cours de son histoire thermique et contenu divers types de matière : une fraction de secondes après le Big-Bang l’Univers connait d’abord une phase d’Inflation, où son expansion est exponentielle, puis son expansion décélère durant l’ère dominée par la radiation et continue de décélérer durant l’ère ultérieure dominée par la matière. Il est donc nécessaire d’étudier le cas plus réaliste d’une brane homogène et isotrope de géométrie Friedmann-Robertson-Walker (FRW), ayant un tenseur énergie-impulsion non nul dépendant du temps et une histoire d’expansion cosmologique arbitraire, plongée dans le bulk du modèle de Randall-Sundrum. C’est l’objet de cette section, où l’on commence par généraliser le modèle RS au cas d’une brane de géométrie purement de Sitter pour ensuite énoncer les solutions cosmologiques homogènes et isotropes dans le modèle RS.
2.2.1 Brane de Sitter
Le cas particulier d’une brane de géométrie de Sitter () peut aider à modéliser un univers branaire dans sa phase inflationnaire en première approximation puisque lors de l’Inflation l’univers subit une expansion quasi-de Sitter. Les calculs perturbatifs effectués dans la section (2.1) dans le cas d’une brane Minkowskienne peuvent être généralisés au cas d’une brane (voir la référence [16] pour le détail des calculs ainsi que les références [17, 18, 19] pour des discussions similaires).
Un espace-temps de Sitter subit une expansion exponentielle uniforme caractérisée par le facteur d’échelle parce qu’il ne contient pas de matière mais seulement une constante cosmologique positive , où est le facteur de Hubble, constant dans ce cas. Un Univers à dimensions en expansion de Sitter peut être contenu dans une portion de l’espace , décrite dans les coordonnées statiques de Poincaré
| (2.62) |
au moyen du plongement explicite (, ) :
| (2.63) | |||||
| (2.64) |
De cette transformation de coordonnées on obtient la métrique écrite sous la forme
| (2.65) |
qui décrit une brane de géométrie fixée en dans l’espace . On a rajouté une valeur absolue sur la dimension supplémentaire pour mettre en évidence la symétrie propre au modèle de Randall-Sundrum. L’expansion uniforme quadridimensionnelle de l’Univers est équivalente du point de vue à cinq dimensions au mouvement de la brane dans le bulk statique selon la trajectoire rectiligne
| (2.66) | |||||
| (2.67) |
Les géodésiques ne sont pas des lignes droites dans l’espace courbe , de telle sorte que l’expansion uniforme () équivaut en fait à une trajectoire uniformément accélérée de la brane dans le bulk. Notons que l’infini futur de l’espace correspond à un temps fini (t = 0) dans le bulk (Fig. 2.5).
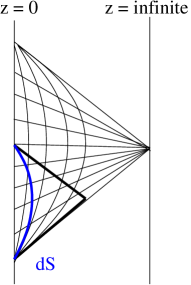
Au lieu d’étudier l’évolution des perturbations de manière covariante comme dans la section 2.1, on se focalise sur les perturbations purement tensorielles, c’est-à-dire les ondes gravitationnelles au sens quadridimensionnel (deux degrés de liberté). Elles correspondent aux fluctuations transverses et sans trace de la métrique ( où les indices sont élevés avec la métrique plate Euclidienne tridimensionnelle ) :
| (2.68) |
Par définition les perturbations tensorielles sont invariantes de jauge puisqu’elles ne sont pas affectées par une reparamétrisation des coordonnées. Elles ne couplent pas non plus à la matière ni aux perturbations de matière222Si on néglige les perturbations tensorielles anisotropes de matière., en ce sens elles évoluent librement dans le bulk et peuvent être décrite par un champ scalaire canonique minimalement couplé à la gravité après transformation de Fourier dans les trois directions spatiales transverses selon , où le tenseur est transverse et sans trace. On peut vérifier que la linéarisation des équations d’Einstein réalisée à la section 2.1 conduit pour les perturbations tensorielles à une équation de Klein-Gordon selon laquelle évolue le champ scalaire . Dans les coordonnées (2.65) pour le fond , l’équation de Klein-Gordon s’écrit
| (2.69) |
où est le facteur d’échelle traduisant l’expansion de Sitter de l’Univers. Cette équation du mouvement est séparable si . On peut donc rechercher les modes de spin massifs du graviton tels que et
| (2.70) |
L’équation (2.70) est celle d’un champ scalaire massif dans l’espace . En utilisant le temps conforme , on peut remarquer cette équation est de type Bessel pour le champ . Les modes de fréquence positive/ negative sont donc donnés par
| (2.71) |
où sont les fonctions de Hankel. Le mode est dit de fréquence positive/negative parce qu’il se comporte asymptotiquement dans le passé () comme une onde plane de fréquence positive/négative, comme dans l’espace plat : . Cette asymptote correspond de plus aux modes aux échelles subhorizon, , c’est-à-dire dont la longueur d’onde est plus petite que le rayon de Hubble (ou l’horizon des évènements) de l’espace . Ce n’est pas étonnant puisque qu’à petite échelle la courbure de l’espace de Sitter ne se fait plus sentir et ce dernier correspond quasiment à l’espace plat de Minkowski.
Le profil des modes du graviton dans la dimension supplémentaire est donné par la forme des fonctions d’onde . Il est pratique de reformuler le problème sous la forme d’un problème de mécanique quantique comme cela a été fait pour le cas de la brane Minkowskienne à la section 2.1.2. Le champ défini par satisfait l’équation de type Schrödinger suivante dans le bulk :
| (2.72) |
où la brane est située en et le potentiel de Schrödinger vaut
| (2.73) |

La fonction encode les conditions de bord suivantes sur la brane :
| (2.74) |
Ce potentiel-volcan pour la brane de Sitter (Fig. 2.6) peut être comparé au potentiel-volcan du modèle RS initial avec la brane Minkowskienne (section 2.1.2). On remarque cette fois la présence d’un gap d’énergie , le potentiel tendant asymptotiquement, loin de la brane (), vers cette valeur. Bien-sûr, dans la limite , on retrouve les résultats du modèle RS initial avec une brane Minkowskienne. La forme du potentiel (2.73) indique que le spectre des gravitons dans le modèle RS avec une brane de Sitter inclue un unique état lié, le mode zéro , discret et normalisable, dont la fonction d’onde a son support localisé près de la brane. Le spectre inclue également un continuum d’états libres qui démarre à à cause du gap. Le mode zéro s’identifie au graviton standard sans masse de la gravité linéarisée à et les modes s’identifient à des gravitons massifs de KK du point de vue quadridimensionnel. Ce modèle branaire, avec une brane de Sitter plongée dans le bulk , est aussi viable que le modèle RS initial du point de vue cosmologique puisque la localisation de l’état lié permet de reproduire la gravité standard à sur la brane tout en réalisant une expansion de Sitter de l’Univers. L’interaction des gravitons massifs avec la brane est d’autant plus supprimée à basse énergie à cause du gap .
2.2.2 Brane cosmologique
L’exploration de signatures cosmologiques de la présence de dimensions supplémentaires dans le modèle de Randall-Sundrum doit tenir compte d’un scénario cosmologique plus réaliste où l’Univers , homogène et isotrope, subit une expansion cosmologique arbitraire de type Friedmann-Robertson-Walker (FRW)
| (2.75) |
et dont l’évolution du facteur d’échelle , où est le facteur de Hubble dependant du temps sur la brane, est dictée par le type de matière (le tenseur d’énergie-impulsion) présent dans l’Univers. On supposera que l’Univers est plat dans les trois directions spatiales, comme semblent le confirmer les observations cosmologiques actuelles, telles que les cartes d’anisotropies du Fond Diffus Cosmologique (CMB en Anglais pour Cosmic Microwave Background). Donc la métrique tridimensionnelle est Euclidienne : (). Binetruy, Deffayet, Ellwanger et Langlois ont calculé en 2000 les solutions cosmologiques branaires homogènes et isotropes plongées dans l’espace et montré que le facteur d’échelle ne suit pas exactement l’évolution cosmologique conventionnelle333On entend par “conventionnelle” l’évolution du facteur d’échelle dans le modèle standard de la cosmologie pour un univers FRW. [20]. Un calcul similaire, mais de façon covariante, a été effectué la même année par Shiromizu, Maeda et Sasaki [21].
Un univers à dimensions du type Friedmann-Robertson-Walker, spatialement plat, homogène et isotrope, avec une expansion cosmologique arbitraire, caractérisée par le facteur d’échelle , où est le temps propre, peut être plongé dans une portion de l’espace de rayon de courbure , décrit en fonction des coordonnées de Poincaré statiques par
| (2.76) |
au moyen de la trajectoire suivante pour la brane
| (2.77) |
est le facteur de Hubble sur la brane. On peut construire explicitement des coordonnées Gaussiennes normales (GN) en calculant les courbes géodésiques dans le plan , normales à la trajectoire de la brane de temps propre et qui s’étendent à la distance propre de la brane. On obtient ainsi la transformation de coordonnées suivantes entre les coordonnées GN et les coordonnées de Poincaré :
| (2.78) | |||||
| (2.79) |
On déduit de cette transformation la métrique GN à cinq dimensions de :
| (2.82) | |||||
Dans ces coordonnées la brane FRW est stationnaire par rapport au bulk, située en , et mesure la distance propre à la brane. Il reste à connaître l’évolution du facteur d’échelle (ou du facteur de Hubble ) en fonction de l’évolution de la matière sur la brane.
Il s’agit donc de retrouver la solution métrique ( des équations d’Einstein à cinq dimensions suivantes :
| (2.83) |
où est la constante cosmologique de l’espace-temps total à cinq dimensions (le bulk), si est la masse de Planck à 5D. Dans le cadre du modèle de Randall-Sundrum on recherche une solution de fond anti-de Sitter , donc de constante cosmologique négative , où dénote le rayon de courbure du bulk. est le tenseur énergie-impulsion dépendant du temps, confiné sur la brane à dimensions en si dénote la cinquième coordonnée d’espace-temps (ou dimension supplémentaire) :
| (2.84) |
Tout au long de ce mémoire on notera et respectivement la densité d’énergie (ou de masse) et la pression de la matière effective sur la brane. Ces composantes sont reliées à la matière réelle sur la brane, constituée d’un fluide parfait sur la brane ayant pour équation d’état , où et sont repectivement la pression et la densité d’énergie du fluide, selon
| (2.85) |
si est la tension critique de la brane, ajustée dans le modèle de Randall-Sundrum de telle sorte que la constante cosmologique effective sur la brane plongée dans le bulk (de constante cosmologique négative ) soit zéro en l’absence de matière sur la brane. Son expression a été donnée en (2.3). Il est commode d’utiliser des coordonnées gaussiennes normales pour résoudre (2.83) et de considérer l’Ansatz homogène et isotrope suivant pour la métrique :
| (2.86) |
Dans ces coordonnées la brane reste fixée en et la coordonnée supplémentaire mesure la distance propre à la brane. On peut toujours reparamétriser le temps propre sur la brane pour que sur la brane. En notant de plus , on voit que la métrique induite sur la brane en est celle d’un Univers FRW à dimensions en expansion avec le facteur d’échelle (voir métrique (2.75)). En insérant l’Anstaz (2.86) dans les équations d’Einstein (2.83) et dans les conditions de raccordement d’Israel sur la brane ()
| (2.87) |
où est la métrique FRW induite sur la brane et est la courbure extrinsèque de la brane, on obtient que
| (2.88) |
Tout au long de ce mémoire, un point désigne une dérivée temporelle et un prime une dérivée selon la dimension supplémentaire. De l’égalité , on obtient de plus que , de telle sorte que la solution métrique contenant une brane est finalement
| (2.91) | |||||
L’équation de conservation du tenseur-énergie impulsion (de façon équivalente l’équation de Bianchi sur le tenseur d’Einstein ), où est la dérivée covariante associée à la métrique (), entraine de plus l’équation de conservation
| (2.92) |
Cette équation a la même forme que l’équation de conservation standard à quatre dimensions, où le facteur de Hubble sur la brane, caractérisant l’expansion cosmologique de la brane, est défini par . Cependant, on peut trouver une intégrale première des équations d’Einstein, conduisant à l’équation de Friedmann modifiée suivante sur la brane :
| (2.93) |
qui implique une évolution cosmologique non-standard du facteur d’échelle. est une constante d’intégration qui, si elle est non-nulle, décrit le paramètre de masse d’un espace Schwarzchild-anti-de Sitter . Comme on se place dans le cadre du modèle de Randall-Sundrum, avec un bulk pur, on fixera dans la suite. Réexprimons l’équation de Friedmann (2.93) et l’équation de conservation (2.92) en fonction de la densité d’énergie du fluide parfait sur la brane :
| (2.94) | |||||
| (2.95) |
On constate que l’équation de Friedmann standard à quatre dimensions () est effectivement retrouvée à basse énergie () sur la brane, si . Par contre des modifications à la cosmologie standard interviennent à haute énergie de façon quadratique en la densité d’énergie sur la brane. C’est donc dans l’Univers primordial (temps court ou haute énergie) que se manifeste la signature de dimensions supplémentaires éventuelles. On peut obtenir l’évolution cosmologique du facteur d’échelle sur la brane en résolvant les équations (2.94) selon :
| (2.96) |
et , où on rappelle que . À grand temps , ou basse énergie, on retrouve l’évolution cosmologique standard d’un univers FRW 4D contenant un tenseur-énergie impulsion de type fluide parfait : . Par contre dans l’Univers primordial, à temps court , ou haute énergie, l’évolution du facteur d’échelle n’est plus conventionnelle : . Notons que cette solution n’a pas de sens dans le cas mais en fait, dans ce cas, la solution de l’équation de conservation est de toute façon , et donc l’équation de Friedmann modifiée entraine que la brane est de géométrie de Sitter pur, sauf que le facteur de Hubble constant (ou constante cosmologique) diffère de la constante de Hubble d’un univers de Sitter dans le cas standard à quatre dimensions.
Terminons en réécrivant la métrique (2.91) de Binetruy, Deffayet, Ellwanger et Langlois en fonction du facteur de Hubble seulement car c’est cette forme que nous utiliserons par la suite, notamment au chapitre 4 où nous expose nos résultats. Au moyen de la relation (2.93), avec , on obtient que la métrique (2.91) se réécrit :
| (2.99) | |||||
telle que nous l’avons déjà calculée en (2.82).
Peut-on calculer l’évolution des perturbations cosmologiques autour de cette métrique de fond décrivant un univers FRW homogène et isotrope (dans les trois directions spatiales transverses), en expansion arbitraire, contenant un tenseur énergie-impulsion dépendant du temps et plongé dans l’espace , tel qu’on l’a fait pour des branes “vides”, Minkowski et de Sitter ? C’est le but principal de ce travail de recherche, exposé aux chapitres 3 et 4 : essayer de résoudre l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion quelconque.
Chapitre 3 La théorie des perturbations cosmologiques dans les Univers branaires
La métrique FRW à quatre dimensions (2.75) décrit l’Univers observable à dimensions à condition que celui-ci soit effectivement homogène et isotrope dans les trois dimensions spatiales. En réalité notre Univers n’apparait homogène et isotrope qu’à grande échelle, tel que le confirme les relevés astronomiques, mais comporte des inhomogénéités et des anisotropies à plus petite échelle, telles que les amas de galaxies ou les galaxies elles-même. Depuis les années 80 [22] on pense que la formation des grandes structures de l’Univers (amas de galaxies,…) resulte de l’attraction gravitationnelle de fluctuations de densité initiales à petite échelle, inhomogènes et anisotropes. En ce sens la compréhension de la formation des structures astrophysiques de l’Univers demande d’étudier un espace-temps légèrement différent de l’espace FRW, c’est-à-dire légèrement inhomogène et anisotrope, en perturbant tout simplement la métrique de fond FRW décrivant l’espace-temps ainsi que le tenseur énergie-impulsion décrivant la matière. La théorie des perturbations cosmologiques linéaire standard à quatre dimensions, dans le cadre relativiste, est bien connue depuis les travaux pionniers de Lifshitz et Khalatnikov en 1963 [23] et le formalisme invariant de jauge développé par Bardeen en 1980 [24]. Il s’agit de linéariser111C’est-à-dire tronquer les perturbations de métrique et de matière au premier ordre. les équations d’Einstein et de calculer l’évolution des perturbations de métrique et de matière. De la même manière que les équations d’Einstein relient inextricablement la géométrie de l’espace-temps (métrique) au contenu matériel de ce même espace-temps (tenseur énergie-impulsion), les équations linéarisées d’Einstein relient les perturbations de métrique (qui incluent les ondes gravitationnelles) aux fluctuations de densité de matière. Ces deux types de degrés de liberté se propagent dans l’espace-temps de fond non-perturbé. Puisque l’espace-temps de fond non-perturbé est homogène et isotrope, on peut effectuer une transformation de Fourier des variables de perturbations dans les trois directions spatiales, de telle sorte que les équations d’évolution des perturbations, issues des équations d’Einstein linéarisées, se réduisent simplement à des équations aux dérivées ordinaires (EDO), linéaires et d’ordre deux en temps. Ainsi il est facile de les résoudre complètement et trouver le comportement des perturbations à différentes échelles. Notons de plus qu’on est capable d’exprimer les anisotropies de température et de polarisation du Fond Diffus Cosmologique (CMB) en fonction des perturbations inhomogènes et anisotropes de métrique et de matière à travers la formule de Sachs-Wolfe par exemple [25]. Le rayonnement du Fond Diffus Cosmologique est de type corps noir à K mais présente un spectre d’anisotropies de température et de polarisation de l’ordre de K. Ce rayonnement provient de la surface de dernière diffusion, au moment du découplage des photons avec la matière (redshift ), et représente donc l’image la plus ancienne qu’on ait de l’Univers. L’extrème précision des cartes du CMB provenant de WMAP (et Planck dans un futur proche) nous pousse donc à étudier la théorie des perturbations cosmologiques dans des modèles non-standard, tels que les modèles branaires, afin de comparer les résultats théoriques aux observations du CMB, et de pouvoir valider, contraindre ou invalider ces modèles. La théorie des perturbations cosmologiques demeure un outil indispensable quand on veut comparer les résultats théoriques aux observations cosmologiques.
En cosmologie branaire, la théorie des perturbations cosmologiques est bien plus compliquée, et le calcul de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un univers branaire n’a pas encore complètement abouti. Cela est du à la presence de la brane dans l’espace-temps qui, en tant que défaut topologique brise l ’homogénéité et l’isotropie spatiale à cinq dimensions. En ce sens les équations d’évolution des variables de perturbation issues de la linéarisation des équations d’Einstein ne sont plus des EDO en temps mais des équations aux dérivées partielles (EDP) d’ordre deux en temps et en la dimension supplémentaire. En fait, dans le cas de branes vides de matière et à symétrie maximale, telles que des branes Minkowski ou de Sitter, on a vu aux sections 2.1.2 et 2.2.1 que les EDP pour les perturbations pouvaient être complètement intégrées parce qu’elles étaient séparables et qu’on pouvait calculer le spectre des gravitons (c’est-à-dire les perturbations de métrique) analytiquement. Mais hormis dans ces cas de haute symétrie, le mouvement de la brane FRW dans le bulk est arbitraire et compliqué. Par conséquent, la forme des composantes de la métrique de fond, donnée en (2.91) ou (2.99), est compliquée et non-séparable. Il s’ensuit que les EDP pour les perturbations ne sont plus séparables et donc difficile à résoudre au moins analytiquement. Notons que, outre cette difficulté d’ordre technique, la théorie des perturbations linéaires en cosmologie branaire fait également face à une difficulté d’ordre plus fondamental : le problème des conditions initiales. Pour résoudre complètement le problème des perturbations cosmologique branaires il faut spécifier des conditions initiales sur un nombre infini de degrés de liberté. Afin de tester les predictions des scenarios branaires et en amont les théories de cordes à l’aide des observations cosmologiques, il est indispensable de calculer au moins en partie l’évolution des perturbations cosmologiques dans les univers branaires. C’est un défi encore non résolu pour la cosmologie branaire, et un enjeu majeur pour la cosmologie théorique moderne.
3.1 Théorie des perturbations invariantes de jauge en cosmologie branaire
De nombreux formalismes existent concernant la théorie des perturbations cosmologiques en cosmologie branaire (on pourra par exemple lire les revues [26, 28]) : dans [27] les auteurs introduisent la jauge dite “longitudinale 5D”, qui est la jauge utilisée dans le formalisme de Mukohyama (voir section 3.2), pour exprimer les perturbations. Dans cette jauge les perturbations invariantes de jauge coincident avec les perturbations naturelles de la métrique. Les conditions de jonctions linéarisées pour les perturbations sont par contre plus maniables dans la jauge dite Gaussienne normale, où la brane perturbée reste à sa position fixe. Dans [30] les auteurs ont montré que les deux choix de jauge étaient équivalents pour les équations des perturbations. Pour faciliter le passage d’une jauge à l’autre il peut être utile d’utiliser un formalisme invariant de jauge. Ici nous présentons le formalisme invariant de jauge, couramment utilisée dans la littérature [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]). Cette partie concernant la théorie des perturbations est certes technique mais c’est le pilier de la cosmologie théorique moderne.
On peut toujours décomposer les perturbations d’un tenseur à deux indices en trois catégories : les perturbations purement "scalaires", les perturbations purement "vectorielles" et les perturbations purement "tensorielles".
3.1.1 Perturbations de métrique
En perturbant à l’ordre linéaire la métrique générale () donnée en (2.86) dans les coordonnées Gaussiennes normales, on obtient que la métrique perturbée s’écrit
où dénotent les trois directions spatiales sur la brane. , , , , , et sont les perturbations scalaires de métrique, , et sont les perturbations vectorielles (-vecteurs sans divergence), et représente les perturbations tensorielles (-tenseur transverse et sans trace)222On choisit de mettre une barre sur chaque perturbation lorsqu’on ne specifie pas de jauge particulière.. L’avantage de cette décomposition est que les perturbations scalaires, vectorielles et tensorielles évoluent indépendamment à l’ordre linéaire, selon des équations d’onde découplées l’une de l’autre.
La transformation de jauge (reparamétrisation des coordonnées d’espace-temps à l’ordre linéaire) se décompose en transformations scalaires et vectorielles seulement, selon
| (3.1) | |||||
| (3.2) | |||||
| (3.3) |
, et sont des scalaires et est un -vecteur sans divergence. Sous la transformation de jauge (3.1), les perturbations scalaires de métrique se transforment selon ()
| (3.4) | |||||
| (3.5) | |||||
| (3.6) | |||||
| (3.7) | |||||
| (3.8) | |||||
| (3.9) | |||||
| (3.10) |
On peut construire deux variables de perturbation invariantes sous les transformations de jauge 3D spatiales :
| (3.11) |
qui se transforment sous (3.1) selon , . Par suite on peut aussi construire deux variables de perturbation invariantes sous les transformations de jauge 4D : et . Puisqu’il y a trois fonctions scalaires inconnues pour les transformations de jauge 5D (3.1), on en déduit qu’on peut définir quatre perturbations de métrique scalaires invariantes de jauge au sens 5D parmi les sept variables scalaires de départ :
| (3.12) | |||||
| (3.13) | |||||
| (3.14) | |||||
| (3.15) |
Sous la transformation de jauge (3.1), les perturbations vectorielles de métrique se transforment selon
| (3.16) | |||||
| (3.17) | |||||
| (3.18) |
On peut écrire les perturbations vectorielles de métrique selon , et , où est un -vecteur sans divergence (). Puisqu’il y a une fonction vectorielle inconnue pour les transformations de jauge 5D (3.1), on en déduit qu’on peut définir deux perturbations de métrique vectorielles invariantes de jauge au sens 5D parmi les trois variables vectorielles de départ :
| (3.19) | |||||
| (3.20) |
Il n’y a pas de fonction tensorielle dans la transformation de jauge (3.1), de telle sorte que les perturbations tensorielles de métrique sont automatiquement invariantes de jauge, .
3.1.2 Perturbations de matière
Les perturbations du tenseur énergie-impulsion donné en (2.84), décrivant la matière présente sur la brane333Notons que la brane ne reste plus nécessairement fixée en après perturbation sauf dans le choix de jauge Gaussienne normale, par définition. On a déjà discuté le phénomène de ”brane bending” au chapitre 2., en ,
peuvent également se décomposer en perturbations scalaires, vectorielles et tensorielles grâce à la symétrie de l’espace-temps non-perturbé, comme pour les perturbations de métrique, selon
| (3.21) | |||||
| (3.22) |
, , et sont les perturbations scalaires de matière. et décrivent les perturbations vectorielles de matière, sans divergence, et représente la perturbation tensorielle de la matière, transverse et sans trace. Notons que est le tenseur anisotrope de perturbation du fluide .
Sous la transformation de jauge temporelle les perturbations de matière se transforment selon
| (3.23) | |||||
| (3.24) | |||||
| (3.25) |
alors que et sont invariants. À partir de (3.23) et en utilisant l’équation de conservation (2.92) on constate qu’on peut construire une perturbation de matière invariante de jauge , appelée contraste de densité :
| (3.26) |
Également on peut construire une autre perturbation scalaire de matière invariante de jauge , appelée perturbation d’entropie :
| (3.27) |
où est la vitesse du son du fluide.
Une fois identifiées les perturbations de métrique et de matière invariantes de jauge, on peut calculer leur évolution cosmologique au moyen des équations d’Einstein linéarisées, de forme générale :
| (3.28) |
Plus précisément on peut séparer l’évolution dans le bulk et l’évolution sur la brane : les gravitons (perturbations de métrique ) évoluent dans le bulk selon l’équation d’Einstein linéarisée dans :
| (3.29) |
et les perturbations de matière évoluent sur la brane et couplent aux perturbations métriques selon les conditions de raccordement d’Israel linéarisées et -symétriques, sur la brane :
| (3.30) |
où . Les équations linéarisées d’évolution des perturbations invariantes de jauge et les conditions de bord linéarisées reliant les perturbations métriques et les perturbations de matière, invariantes de jauge, peuvent donc être obtenues. Mais leurs expressions sont lourdes et nous préférons réécrire ces équations dans le formalisme de Mukohyama (section 3.2), qui permet de réduire ces équations de perturbations en des formes plus “compactes”.
L’intérêt de travailler avec des quantités indépendantes du choix de jauge est qu’on peut les faire évoluer dans la jauge qui nous arrange le plus suivant le problème considéré et on peut jongler d’une jauge à l’autre si nécessaire. Bien-sûr, une fois qu’on a identifié les perturbations indépendantes de jauge, on peut simplifier leur expression en choisissant la jauge la plus commode. Dans la prochaine section 3.2, nous choisissons la “jauge longitudinale 5D” pour les perturbations de type scalaires qui est la jauge utilisée dans le formalisme de Mukohyama.
3.2 Formalisme de Mukohyama
On choisit de se placer dans la “jauge longitudinale 5D” [27], définie par
| (3.31) |
où et ont été définis en (3.11). Cette jauge est appelée comme telle parce que c’est une sorte de généralisation, dans un modèle branaire, de la jauge longitudinale (ou de Newton), utilisée en théorie des perturbations standards sur l’espace FRW à dimensions. Dans cette jauge (3.31), les perturbations scalaires de métriques indépendantes de jauge (3.12) coincident avec les quatres perturbations scalaires de métrique naturellement introduites au début de la section 3.1.1 : , , et . Dans la suite nous omettons les barres sur ces quantités invariantes de jauge exprimées dans la “jauge longitudinale 5D”.
Mukohyama a montré le premier que, en l’absence de perturbations de matière dans le bulk, les perturbations scalaires de métrique dans la “jauge longitudinale 5D” (, , et ) peuvent toutes être exprimées en fonction d’une seule et unique variable scalaire maîtresse, , qui se propage suivant une simple équation d’onde à cinq dimensions [31] (un travail similaire a été effectué dans l’article [32]). De façon similaire, les perturbations vectorielles invariantes de jauge de la métrique ( et ) peuvent être exprimées en fonction d’une seule et unique variable scalaire maîtresse, , qui se propagent suivant une simple équation d’onde dans cinq dimensions. Les perturbations purement tensorielles de la métrique sont déjà invariantes de jauge et peuvent directement être considérées comme une variable maîtresse. Nous ne chercherons pas à refaire les calculs de Mukohyama mais seulement à énoncer les équations compactes qu’il a obtenues. Ces équations nous seront utiles pour le prochain chapitre 4. De manière générale, les équations de perturbations dans le formalisme de Mukohyama sont couramment utilisées dans la littérature concernant l’étude des perturbations cosmologiques en cosmologie branaire parce que ce formalisme simplifie élégamment l’attirail assez lourd des équations de perturbations exprimées dans d’autres formalismes.
3.2.1 Perturbations tensorielles
Les perturbations tensorielles, transverses et sans trace, sont les plus simples à étudier : elles décrivent des ondes gravitationnelles (au sens quadridimensionnel) et se propagent librement dans le bulk , indépendamment de la présence de matière sur la brane (au moins lorsqu’on fait l’hypothèse simplificatrice qu’il n’y a pas de perturbation tensorielle anisotrope de matière sur la brane, ). Les fluctuations tensorielles, transverses et sans trace, , de la métrique
| (3.32) |
sont, de plus, automatiquement invariantes de jauge. On peut ainsi les décrire à l’aide d’un champ scalaire canonique sans masse minimalement couplé à la gravité , , et transformé de Fourier dans les trois dimensions spatiales transverses, selon
| (3.33) |
qui se propage dans le bulk selon l’équation de Klein-Gordon
| (3.34) |
est le -moment (tri-impulsion) dans les trois dimensions spatiales transverses. Les conditions de jonction d’Israel linéarisées se réduisent à des conditions de bord de type Neumann sur la brane pour les perturbation tensorielles :
| (3.35) |
Ces conditions de bord sont homogènes sous l’hypothèse qu’il n’y a pas de perturbation anisotrope de matière ().
Le champ scalaire est le champ scalaire “maître” de Mukohyama pour les perturbations tensorielles quoique sa définition soit triviale dans ce cas.
3.2.2 Perturbations vectorielles
On a vu que les perturbations vectorielles de la métrique
| (3.37) | |||||
pouvaient être décrites par les deux perturbations indépendantes de jauge , définies en (3.19). En l’absence de perturbations de matière dans le bulk, Mukohyama a montré que les perturbations vectorielles de la métrique peuvent être générées à partir d’un unique champ scalaire “maître” , selon
| (3.38) | |||||
| (3.39) |
La nouvelle variable maîtresse , décrivant les perturbations vectorielles de métrique, satisfait l’équation d’onde à cinq dimensions suivante :
| (3.40) |
On constatera que celle-ci diffère de l’équation de Klein-Gordon, satisfaite par les perturbations tensorielles. Les conditions de jonction d’Israel linéarisées se réduisent à des conditions de bord de type Dirichlet sur la brane pour les perturbation vectorielles :
| (3.41) |
Ces conditions de bord sont homogènes sous l’hypothèse qu’il n’y a pas de perturbation anisotrope de matière.
3.2.3 Perturbations scalaires
Les quatre perturbations scalaires indépendantes de jauge, exprimées dans la “jauge longitudinale 5D”, transforment la métrique selon
| (3.43) | |||||
Les perturbations scalaires 5D de métrique couplent aux perturbations scalaires 4D de matière sur la brane, définies par le tenseur énergie-impulsion perturbé
Les indices grecs dénotent les coordonnées sur la brane et les indices latins en minuscules dénotent les trois dimensions spatiales sur la brane. On a négligé les perturbations anisotropes scalaires du tenseur énergie-impulsion parce qu’elles n’ont pas lieu d’être présentes lorsqu’on considère un fluide parfait ou un champ scalaire sur la brane [29]. Rappelons que les composantes de matière effective sur la brane, et , sont reliées aux composantes du fluide réel sur la brane, et , selon , , où est la tension de la brane dans le modèle de Randall-Sundrum. Nous avons discuté cela à la section 2.2.2. En l’absence de perturbations de matière dans le bulk, Mukohyama a trouvé que les perturbations scalaires de la métrique peuvent toutes être générées à partir d’un unique champ scalaire “maître” , selon
| (3.44) | |||||
| (3.45) | |||||
| (3.46) | |||||
| (3.47) |
On remarquera que le champ scalaire “maître” n’est pas sans dimension mais possède la dimension d’une longueur au carré. La variable maîtresse satisfait l’équation d’onde à cinq dimensions suivante :
| (3.48) |
On constatera que celle-ci diffère de l’équation de Klein-Gordon, satisfaite par les perturbations tensorielles. La linéarisation des conditions de jonction d’Israel se fait plus aisément dans la jauge Gaussienne normale parce que la brane reste fixée en dans cette jauge. On peut exprimer ces conditions de jonction liant les perturbations de métrique et de matière indépendantes de jauge dans la jauge Gaussienne normale, puisqu’ on sait passer de la jauge Gaussienne normale à la jauge longitudinale 5D. On peut dès lors re-exprimer les conditions de jonction calculées dans la jauge gaussienne normale en fonction de la variable maîtresse . Les conditions de jonction d’Israel se réduisent aux conditions de bord “non-locales”444Le terme ”non-local”, utilisé pour les conditions de bord des perturbations scalaires, n’a rien à voir avec la non-localité étudiée au chapitre 4 qui est due à l’information provenant du bulk. Comme Deffayet l’a expliqué dans son article [34], la terminologie ”non-locale” pour les conditions de bord n’est pas très adaptée, bien que fréquemment utilisée dans la littérature, parce que les conditions de bord contiennent ici seulement un nombre fini de dérivées. suivantes sur la brane [33]
| (3.49) | |||||
| (3.50) | |||||
| (3.52) | |||||
Les perturbations de type vectorielles ne survivent pas dans un modèle -symétrique tel que le modèle de Randall-Sundrum. C’est pourquoi nous nous concentrerons désormais sur les perturbations de type tensorielles (ondes gravitationnelles) et les perturbations de type scalaires (ondes gravitationnelles et matière).
On comprendra que l’équation du mouvement (3.48) et les conditions de bord (3.49), pour prendre l’exemple des perturbations scalaires, ne seront pas triviales à résoudre : l’équation du mouvement n’est plus séparable dans une géométrie de fond du type (2.99), décrivant une brane FRW en expansion quelconque dans le bulk . Dans l’article [34], Deffayet a montré cependant que le problème de l’évolution des perturbations scalaires était un problème bien posé au sens mathématique dans les cas particuliers d’un fluide parfait de perturbations adiabatiques ou d’un champ scalaire sur la brane : l’équation du mouvement (3.48) combinée aux conditions de bord (3.49) forment alors un système clos d’équations.
Chapitre 4 Dissipation et non-localité dans un Univers branaire en expansion (article)
Ce chapitre présente nos résultats sur les processus de dissipation et de non-localité dans un Univers branaire en expansion, qui ont donné lieu à la publication de l’article [51]: Dissipation and nonlocality in a general expanding braneworld universe, Mathieu Remazeilles, Phys. Rev. D79:043523 (arXiv:0807.4238 [hep-th]).
4.1 Introduction
Dans ce chapitre nous étudions l’évolution à la fois des perturbations tensorielles et des perturbations scalaires dans un Univers branaire du type Randall-Sundrum ayant une histoire d’expansion cosmologique arbitraire. Au lieu de rechercher des solutions exactes aux équations de perturbations présentées à la section 3.2, nous sommes intéressés en priorité par le rôle des gravitons du bulk (perturbations de métrique) dans leur interaction avec les degrés de liberté localisés sur la brane. Nous faisons le choix d’adopter un point de vue quadridimensionnel, en considérant les degrés de liberté localisés sur la brane comme un système quantique ouvert couplé à un grand environnement composé du continuum des gravitons du bulk. Lorsque l’expansion cosmologique de la brane est non-uniforme, les degrés de liberté sur la brane et les degrés de liberté du bulk interagissent quantiquement au cours du temps. Les excitations quantiques des degrés de liberté sur la brane peuvent se désintégrer en émettant des gravitons dans le bulk qui peuvent s’échapper vers l’infini futur dans la dimension supplémentaire, ce qui conduit à une forme de dissipation du point de vue quadridimensionnel d’un observateur confiné sur la brane. Les gravitons du bulk peuvent également être réfléchis (ou diffractés) dans le bulk (dimension supplémentaire) à cause de la courbure du bulk , puis ré-absorbés par la brane, et ainsi transformés de nouveau en quanta sur la brane, ce qui conduit à une forme de non-localité du point de vue quadridimensionnel. La dissipation et la non-localité sont inscrits dans le propagateur retardé du bulk , qui peut être systématiquement inséré dans le propagateur retardé effectif de la brane à quatre dimensions par resommation des effets de rétroaction du bulk (“backreaction” en Anglais) à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. Dans ce travail nous estimons, au moyen du propagateur retardé effectif sur la brane, les taux de dissipation du mode lié du graviton (tenseur) ainsi que des degrés de liberté de matière sur la brane (scalaires) dans différents régimes cosmologiques et pour différentes sources de matière sur la brane.
Nous avons vu dans les chapitres précédents comment des processus physiques peuvent être interprétés différemment entre un point de vue à cinq dimensions et le point de vue à quatre dimensions d’un observateur confiné sur une brane : par exemple l’impulsion d’un graviton 5D dans la cinquième dimension correspond de façon effective à une masse pour le graviton sur la brane d’un point de vue quadridimensionnel. De même, dans cette représentation de plus haute dimension, l’expansion de l’Univers quadridimensionnel peut être interprété comme le mouvement accéléré de la brane 4D dans le bulk 5D décrit dans des coordonnées statiques (coordonnées de Poincaré). Enfin dans ce chapitre nous allons voir comment la réduction dimensionnelle donne aux transitions 5D entre les modes quantiques sur la brane et dans le bulk l’apparence d’une forme de dissipation du point de vue quadridimensionnel d’un observateur confiné sur la brane. Nous utiliserons le formalisme de Mukohyama exposé à la section 3.2. La principale difficulté dans le calcul de l’évolution des perturbations est que, excepté dans le cas d’une brane ayant une accélération uniforme (brane plate ou brane ) où des solutions analytiques ont pu être obtenues (voir chapitre 2), les équations du mouvement ne sont généralement pas séparables à cause du mouvement compliqué dans le bulk de la brane FRW en expansion. Une courte revue sur le problème d’évolution des perturbations cosmologiques dans les Univers branaires en expansion est donnée dans la référence [35]. Ce problème a été examiné numériquement et un certain nombre de résultats intéressants ont été obtenus [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]. Le problème des perturbations cosmologiques dans les Univers branaires est en principe entièrement soluble numériquement une fois que le vide initial dans est connu. Cependant la spécification de conditions initiales dans le bulk pose un problème de nature plus fondamentale. Il n’y a pas de choix unique, physiquement motivé, de conditions initiales dans un espace de fond [49, 50] (contrairement à la situation dans un espace ). Par conséquent les résultats de ces études numériques sont sujets à certaines suppositions concernant les conditions initiales. Ici nous réalisons une approche analytique basée sur le calcul du propagateur retardé effectif sur la brane par resommation à partir des deux propagateurs retardés "nus" sur la brane et dans le bulk , l’objectif étant de fournir plus d’intuition concernant l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion. Dans cet article nous avons exploré l’évolution des perturbations cosmologiques dans un scénario du type Randall-Sundrum avec une brane FRW ayant un mouvement arbitraire dans le bulk -symétrique. Le but de ce travail est d’estimer la magnitude des effets physiques ressentis sur la brane et dûs à la présence d’une dimension supplémentaire infinie mais courbée. Nous nous inspirons des idées développées par Binétruy, Bucher et Carvalho [36].
Lorsque le paramètre de Hubble sur la brane, , varie dans le temps, l’accélération de la brane dans le bulk varie également et des gravitons sont émis dans le bulk. On peut illustrer cet effet par le problème classique équivalent suivant : considérons les particules localisées sur la brane (tel que l’état lié du graviton par exemple) comme des particules classiques, un changement d’accélération de la brane dans le bulk peut entrainer que cette particule se délocalise de la brane et s’échappe dans la dimension supplémentaire (Fig. 4.1)
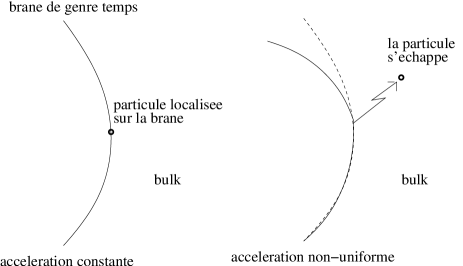
On peut se demander quel est le taux de dissipation effectif ou la probabilité qu’une particule s’échappe de la brane quand l’accélération de la brane change de façon adiabatique ?
Les gravitons émis dans le bulk peuvent soit s’échapper vers l’infini futur ou bien être ré-absorbés par la brane à cause de réflections de ces gravitons dans le bulk courbe. Du point de vue quadridimensionnel d’un observateur sur la brane, ces processus donne l’apparence de générer respectivement de la dissipation et de la non-localité [36]. Ces effets sont "codés" dans le propagateur retardé du graviton du bulk et peuvent être insérés systématiquement dans le propagateur effectif de la brane, en resommant la série perturbative prenant en compte les effets de rétroaction à tous les ordres. L’approche utilisée dans ce travail est une perspective quadridimensionnelle qui considère les degrés de liberté localisés sur la brane comme un système quantique ouvert couplé à un grand environnement composé des gravitons du bulk. Dans le langage la théorie quantique des champs hors-équilibre, le propagateur du bulk joue le même rôle qu’une "self-énergie" dans le sens où elle "habille" les champs "nus" (composés des degrés de libertés discrets localisés sur la brane et sans interaction avec le bulk).
Dans cet article nous estimons d’abord le taux de dissipation de l’état lié du graviton en étudiant l’évolution des perturbations tensorielles dans le cadre d’une brane FRW plongée dans le bulk . Gorbunov, Rubakov et Sibiryakov avaient obtenu en 2001 des résultats analytiques pour l’ordre de magnitude des modifications au spectre de puissance standard 4D pour les perturbations tensorielles, dans le cas où le facteur de Hubble sur la brane change instantanément [37] (voir aussi [38]). Ici nous considérons la situation plus réaliste où le facteur de Hubble sur la brane change continûment et adiabatiquement, dans le sens où . Nous explorons également la dissipation de degrés de liberté purement localisés sur la brane (c’est-à-dire confinés), tels qu’un fluide parfait (de perturbation adiabatique) ou un champ scalaire en roulement lent (inflaton) sur la brane, en étudiant l’évolution des perturbations scalaires et la nature du couplage entre les perturbations de métrique et les perturbations de matière. Nous utilisons les coordonnées Gaussiennes normales (GN) pour couvrir l’espace-temps et plonger la brane FRW dans une tranche du bulk ; ainsi la coordonnée de la dimension supplémentaire mesure la distance propre à la brane, et la position de la brane dans le bulk reste fixe par définition. Les coordonnées GN ont aussi l’avantage de simplifier la forme des conditions de jonction linéarisées sur la brane. Le principal désavantage des coordonnées GN est la présence de singularités de coordonnées dans le bulk à une distance finie de la brane bien que le bulk soit en fait régulier et extensible au-delà de la singularité en choisissant un autre système de coordonnées. À cause du mouvement arbitraire de la brane FRW dans le l’espace , les composantes de la métrique ont une forme compliquée, ce qui rend non-séparables les équations du mouvement pour les perturbations. C’est pourquoi, hormis dans le cas de l’inflaton sur la brane (section 4.3), nous utilisons une géométrie approchée comme étant la limite de la métrique exacte près de la brane afin de réaliser une séparation des équations. Cette limite peut être légitimée dans le modèle de Randall-Sundrum par le fait que le support de la fonction d’onde décrivant l’état lié est localisée près de la brane. Nous pensons que la physique proche de la brane est pertinente pour décrire des effets de dissipation dans les Univers branaires. Afin de se concentrer sur les effets dissipatifs, on peut approximer à haute énergie () l’inhomogénéité du bulk courbe , responsable des réflections des gravitons dans le bulk et par conséquent d’effets non-locaux sur la brane. Cette approximation est discutée ultérieurement dans ce chapitre.
4.2 Processus de dissipation et de non-localité dans un Univers branaire en expansion
Nous avons vu au chapitre 2 que l’évolution des perturbations cosmologiques dans le modèle de Randall-Sundrum a été résolu analytiquement pour des Univers branaires hautement symétriques, où le facteur de Hubble sur la brane était constant. C’était le cas d’une brane Minkowski (), statique, ou d’une brane de Sitter pur (), suivant une expansion uniforme, ou une trajectoire uniformément accélérée dans le bulk . Les équations linéarisées pour les perturbations étaient séparables par symétrie et on pouvait réduire le problème à la résolution d’une équation de type Schrödinger, où le potentiel obtenu avait l’aspect d’un potentiel-volcan : la présence de la brane créant un puit de potentiel du type fonction et la courbure du bulk créant une barrière de potentiel décroissante (Fig. 4.2).
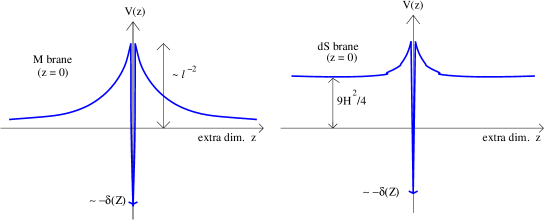
La forme du potentiel entraîne l’existence d’un unique état lié à la brane, le mode de masse zéro , dans le spectre de gravitons des équations d’Einstein linéarisées, ainsi qu’un continuum d’états de diffusion, c’est-à-dire de gravitons libres et massifs de Kaluza-Klein de masse dans le cas de la brane [16]. Le mode zéro s’identifie naturellement au graviton standard sans masse et reproduit la gravitation quadridimensionnelle sur la brane à basse énergie. Il représente un degré de liberté branaire dans le sens où il reste localisé près de la brane. L’amplitude d’interaction des gravitons massifs avec la brane est supprimée près de la brane à basse énergie à cause de la barrière de potentiel. Dans le cas d’un contenu de matière dépendant du temps dans l’Univers, l’expansion cosmologique n’est plus uniforme : le facteur de Hubble change avec le temps, ce qui entraine un changement dans la forme des potentiels-volcans. Par conséquent, les degrés de liberté sur la brane et les degrés de liberté du bulk interagissent et donc génère des transitions entre les modes.
Le système brane-bulk est un système quantique Hamiltonien, nécessairement conservatif puisque la densité de l’espace des phases doit être préservée par translation dans le temps. En ce sens, le système brane-bulk est intrinsèquement non-dissipatif, et l’apparence de dissipation ne peut se produire que par le résultat d’un “coarse graining” (i.e une moyenne sur l’information manquante). L’interaction entre les quanta, dûe à l’expansion de la brane, peut être caractérisisée par une transformation de Bogoliubov (matrice pour un système linéaire) reliant les modes de fréquence positive et de fréquence négative entre le vide “in” initial et le vide “out” résultant. Cependant, du point de vue d’un observateur confiné sur la brane, l’Univers quadridimensionnel, en tant que sous-variété, est un système quantique ouvert. Par conséquent le mélange entre les modes localisés sur la brane et les modes délocalisés dans le bulk créé l’apparence d’une dissipation pour l’observateur quadridimensionnel incapable d’accéder aux modes du bulk. L’observateur sur la brane n’est sensible qu’à une partie du vide complet de l’espace , partie composée seulement des modes discrets localisés sur la brane. L’espace de Hilbert du sytème branaire est “tronqué” à cause de la réduction dimensionnelle, et le vide du bulk, composé du continuum des modes du bulk, contient l’information manquante. Lorsqu’on observe les perturbations cosmologiques aujourd’hui, on mesure les valeurs moyennes dans le vide d’observables quadratiques en les opérateurs de création et d’annihilation localisés sur la brane aujourd’hui, à savoir et . La matrice exprime les opérateurs “out” comme des combinaisons linéaires de et d’un côté, et de et de l’autre. Une paramétrisation utile de cette transformation a été proposée dans [36]. Les auteurs définissent et comme étant entièrement sur la brane et dans le bulk respectivement, et normalisés tel que . Dès lors peut être exprimé en fonction de ceux-ci selon une des trois possibilités suivantes : soit
| (4.1) |
où ; ou bien
| (4.2) |
où ; ou bien
| (4.3) |
où . peut être construit entièrement comme une combinaison linéaire de et , et de même peut être construit entièrement comme une combinaison linéaire de and the , indexant les modes du continuum. Nous remarquons en (4.3) que l’état initial dans le bulk peut avoir un rôle considérable, voire dominant, dans la détermination de ce qui est observé sur la brane aujourd’hui.
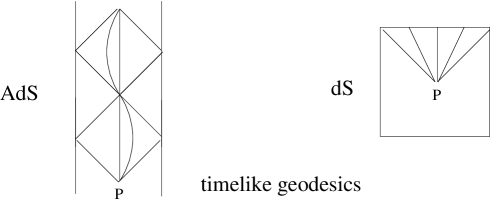
En cosmologie standard la théorie inflationnaire permet de résoudre le problème des conditions initiales et ce succès repose sur la structure causale de la géométrie de fond de Sitter () : l’espace "n’a pas de cheveux" ("no hair" en Anglais) dans le sens où les irrégularités initiales sont effacées au cours du temps puisque les géodésiques de genre temps divergent dans , perdant toute causalité (Fig. 4.3). Cela entraine l’homogénéité et l’isotropie observée dans l’Univers aujourd’hui et justifie l’existence de conditions initiales naturelles dans . En revanche dans les scenarios branaires à la Randall-Sundrum, la géométrie de fond est Anti-de Sitter (), dont la structure causale entraine que les amplitudes des perturbations initiales sont conservées au cours du temps parce que les géodésiques de genre temps d’abord divergent puis re-convergent et cela pertpétuellement (Fig. 4.3) : il n’y a donc pas de conditions initiales naturelles dans [49, 50]. Les méthodes numériques employées dans la littérature [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47] nécessitent un choix particulier de conditions initiales dans le bulk pour faire évoluer les perturbations et rendre compte de ce qui observé aujourd’hui sur la brane. Le vide initial souvent choisi dans les méthodes numériques est le vide invariant sous de Sitter (voir par exemple [44]), c’est-à-dire que les conditions initiales sont spécifiées à partir d’une combinaison des modes définis dans un découpage ("slicing" en Anglais) de . Les conditions initiales ne sont donc définies que sur l’horizon de Cauchy du bulk créé par le "slicing" . Ce choix n’est pas forcément légitime pour d’autant plus que, comme on le décrit à la section 4.4, des gravitons du bulk initiaux provenant de l’horizon de Poincaré de mais situés en dehors de l’Horizon de Cauchy du slicing peuvent affecter causalement les modes de la brane dans le futur, lorsque l’expansion de la brane décélère. Ajoutons qu’il a été observé numériquement [44, 46] que la contribution initiale dans le bulk était sous-dominante voire négligeable (quelques pourcent) par rapport à la contribution initiale sur la brane dans la détermination des spectres de puissance observés aujourd’hui sur la brane. Cependant ces conclusions dépendent très certainement du choix particulier du vide initial spécifié dans ces schémas numériques. Comme on l’a vu au paragraphe précédent, avec la paramétrisation explicite (4.3), les contributions relatives des conditions initiales dans le bulk et sur la brane peuvent varier considérablement suivant sur quelle base est défini le vide initial. Nous adoptons ici une approche effective à quatre dimensions analytique et basée sur les propagateurs retardés de la brane et du bulk , ce qui évite la spécification d’un vide initial dans le bulk. À partir des fonctions de Green retardées du bulk et de la brane "nue", nous construisons le propagateur retardé effectif sur la brane tenant compte de l’interaction avec le bulk.
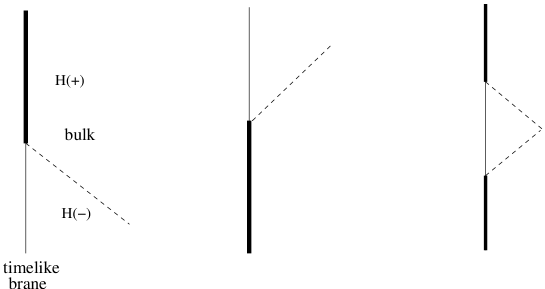
L’interaction brane-bulk peut être résumée par les processus suivants, fondamentaux du point de vue quadridimensionnel, et illustrés sur la figure Fig. 4.4. Un état du vide initial peut être complètement caractérisé en spécifiant l’état quantique des gravitons incidents sur l’horizon de Cauchy du passé dans le bulk et l’état quantique des degrés de liberté sur la brane à l’intersection de la brane avec . Ultérieurement les degrés de liberté de la brane et ceux du bulk interagissent au cours du temps. Les gravitons du bulk peuvent être absorbés et transformés en quanta sur la brane. De façon similaire, les excitations quantiques sur la brane peuvent se désintégrer en éméttant des gravitons dans le bulk. Ceux-ci peuvent soit s’échapper vers l’infini futur, conduisant à de la dissipation du point de vue quadridimensionnel, ou bien peuvent être ré-absorbés par la brane à cause de la courbure du bulk, conduisant à de la non-localité du point de vue quadridimensionnel.
On peut considérer l’interaction brane-bulk dans une perspective quadridimensionnelle en regardant les degrés de liberté de la brane comme un système quantique ouvert couplé à un grand environnement, le bulk, ayant un grand nombre de degrés de liberté. Schématiquement, on peut diagonaliser par bloc en faisant une transformation de Fourier dans les trois dimensions spatiales transverses. Pour un univers branaire en expansion, avec un fluide parfait ou un champ scalaire sur la brane, l’interaction entre un degré de liberté scalaire de la brane et un degré de liberté scalaire du bulk , où représente la dimension supplémentaire, est régie par un système d’équations couplées qui, sous des approximations justifiées plus loin dans ce chapitre, peuvent être écrites dans la forme générale suivante
| (4.4) | |||||
| (4.5) | |||||
| (4.6) |
où et sont des polynômes en de degré un et de degré deux respectivement, avec des coefficients dépendant du temps. La première équation est l’équation du mouvement dans le bulk, la seconde est la condition de bord sur la brane, de type Neumann, et la troisième l’équation du mouvement pour le degré de liberté sur la brane. Les degrés de liberté de la brane et du bulk sont reliés selon
| (4.7) | |||||
| (4.8) |
où est le propagateur retardé nu111Par “nu” on entend le propagateur des champs libres de la brane, c’est-à-dire excluant l’interaction avec le bulk. de la brane et le propagateur retardé du bulk dans sa forme Neumann. Après interaction, le propagateur retardé effectif de la brane peut être obtenu en resommant la série géométrique à tous les ordres de la perturbation (ou des effets de rétroaction) :
| (4.10) | |||||
| (4.11) |
où les deux points du propagateur du bulk résident sur la brane. Ainsi le degré de liberté sur la brane se propage selon l’équation intégro-différentielle
| (4.12) |
Ici le noyau du bulk est donné par
| (4.13) |
et joue le rôle d’une “self-énergie” qui habille le champ nu de la brane. Les effets de dissipation locale et les effets non-locaux sont tous contenus dans ce noyau d’interaction. Le propagateur retardé nu de la brane est le propagateur d’un oscillateur localisé sur la brane et contribue uniquement aux transitions entre modes 4D dues à l’expansion de l’Univers.
On peut considérer pour illustration les couplages suivants
| (4.14) |
Puisque la forme Neumann du propagateur retardé du bulk projeté sur la brane s’écrit de façon générale
| (4.15) |
le noyau d’interaction avec le bulk peut se décomposer en parties singulières et régulières
| (4.16) |
où
| (4.17) | |||||
| (4.18) |
La partie singulière est responsable de processus de dissipation locaux et la partie régulière décrit des processus non-locaux, tels que ceux résultant de réflections des gravitons dans le bulk courbe. La somme infinie sur la partie singulière
| (4.19) | |||||
| (4.20) |
équivaut en effet à introduire un terme de dissipation local dans l’équation effective du mouvement pour le degré de liberté sur la brane. En resommant ensuite sur la partie régulière
| (4.22) | |||||
on rajoute la non-localité dans l’équation effective du mouvement de telle sorte que le degré de liberté sur la brane se propage selon
| (4.23) |
Puisqu’une partie singulière locale ne dépend pas de la courbure du fond, il s’ensuit que le terme , qui apparaît dans le taux de dissipation locale, peut être remplacé par le propagateur de Minkowski dans sa forme Neumann. Nous rappelons que le propagateur retardé de Minkowski est
| (4.24) |
où est le moment dans les trois dimensions spatiales transverses. Donc et le taux de dissipation locale dépend seulement des couplages
| (4.25) |
Notons que nous n’avons fait aucune approximation pour calculer ce taux de dissipation locale. Pour des couplages autres que (4.14), des termes locaux supplémentaires peuvent apparaître contribuant dans l’équation effective du mouvement par example à un décalage de fréquence. Il se peut que la dissipation soit non-locale (c’est-à-dire qu’elle se manisfeste avec une sorte de mémoire dans le temps) lorsqu’il n’y a pas de dérivées dans les couplages. Ce formalisme à partir des fonctions de Green est pratique pour discriminer les transitions entre les modes 4D sur la brane dues à l’expansion de l’Univers des transitions entre les modes de la brane et les modes du bulk dûes à la présence d’une dimension supplémentaire. De plus ce formalisme permet de distinguer les processus de dissipation locaux des processus non-locaux. Le but de notre travail est d’estimer par ces méthodes les taux de dissipation de certains degrés de liberté confinés sur la brane (ou bien localisés près de la brane) dans le cas d’une expansion arbitraire de la brane et sans symétrie particulière.
4.3 Perturbations scalaires : Inflaton en roulement lent sur la brane
Les perturbations scalaires sont d’un intérêt particulier parce qu’elles couplent aux perturbations de matière sur la brane et donc peuvent affecter le contenu du tenseur énergie-impulsion de l’Univers. Elles sont toutes décrite par l’unique champ "maître" tel qu’on l’a déjà discuté à la section 3.2. Nous prenons la transformée de Fourier dans les trois directions spatiales transverses à cause de l’homogénéité et l’isotropie, et évoluons séparément chaque mode de Fourier. Dans cette section nous étudions le cas des perturbations scalaires, où le degré de liberté sur la brane est un champ scalaire avec un potentiel en roulement lent ("slow-roll" en anglais), , de telle sorte que la géométrie induite sur la brane est quasi-de Sitter. Durant l’Inflation en roulement lent, l’expansion de l’Univers est donc adiabatique dans le sens où . Le champ scalaire de l’inflaton, , peut être caractérisé par une densité d’énergie et une pression
| (4.26) | |||||
| (4.27) |
On peut combiner les équations de Mukohyama, exposées à la section 3.2.3 pour les perturbations scalaires, pour obtenir des équations couplées simples pour le système brane-bulk. Suivant les calculs effectués dans les références [41, 47], on introduit la variable de Mukhanov-Sasaki indépendante de jauge, définie dans [52], pour décrire le degré de liberté scalaire sur la brane :
| (4.28) |
où est la perturbation de l’inflaton et est une des perturbations scalaires de métrique, à savoir la perturbation de courbure (3.47), projetée sur la brane. Les équations du système brane-bulk dans le système de coordonnées Gaussiennes normales général (2.86) est alors donné par [41, 47] :
| (4.29) | |||||
| (4.30) | |||||
| (4.31) |
où est le moment transverse et la source est donnée par
| (4.34) | |||||
Ici les notations sont et . De l’équation de Friedmann (2.94), on a de plus que
| (4.35) |
Les équations (4.29), (4.34) peuvent être simplifiées dans le cas de l’Inflation à roulement lent, comme suit : on néglige toutes les corrections adiabatiques de l’expansion, comme des termes du type , excepté pour les termes impliqués dans les couplages entre et . D’après ces approximations et après changement d’échelle du champ "maître" selon , nous soutenons que le système des équations couplées se simplifie comme
| (4.36) | |||||
| (4.37) | |||||
| (4.38) |
où est la fonction de Green de l’équation du mouvement exacte dans
le bulk,
est la
fonction de Green “nue” de l’Inflaton sur la brane, et .
La première équation dans (4.36) est l’équation d’onde du bulk.
La présence de dérivées en temps des champs dans les couplages brane-bulk induit de la dissipation locale pour le champ scalaire sur la brane. Le propagateur effectif sur la brane, prenant en compte l’interaction
avec le bulk, est obtenu, comme expliqué à la section 4.2, en
resommant la série perturbative géométrique à tous les ordres de rétroaction
| (4.39) | |||||
| (4.40) | |||||
| (4.41) |
où décrit la propagation nue sur la brane. est le propagateur retardé du bulk dans sa forme Neumann et projeté sur la brane, et a la forme générale
| (4.42) |
Les dérivées par rapport au temps du propagateur du bulk (4.42) apparaissant dans le propagateur effectif de la brane (4.39) produisent des termes singuliers et réguliers. Cela suggère que la propagation de l’inflaton “habillé” contient des corrections adiabatiques locales et non-locales :
| (4.43) | |||
| (4.44) |
Ici le terme non-local dépend de la courbure de l’espace et de la courbure intrinsèque de la brane, et est donné par les dérivées par rapport au temps de la partie régulière de la fonction de Green de l’équation d’onde dans le bulk (4.36):
| (terme non-local) | (4.45) |
Les termes locaux ne dépendent pas de la courbure, ce qui signifie que la partie régulière de la fonction de Green du bulk est égale au propagateur de Minkowski à l’origine dans (4.43). Puisque la forme Neumann du propagateur de Minkowski est donné par
| (4.46) |
où
| (4.47) |
on a et , de telle sorte que l’équation du mouvement effective pour l’inflaton se réduit à
| (4.48) |
On peut renormaliser le terme cinétique à un en divisant cette équation par le coefficient du terme cinétique et obtenir
| (4.49) |
De l’équation (4.49) nous observons que l’interaction de l’inflaton avec les gravitons du bulk conduit à de la dissipation locale dans la dimension supplémentaire à travers le terme de friction locale apparaissant dans l’équation effective sous la forme d’une dérivée première par rapport au temps . Il y a de plus un décalage de phase donné par . Nous trouvons que le décalage de phase local de la fréquence nue de l’Inflaton induit par la dimension supplémentaire est :
| (4.50) |
Nous trouvons que le taux de dissipation local de l’inflaton dû à la dimension supplémentaire est :
| (4.51) | |||||
| (4.52) |
On observe que le terme de dissipation domine la correction de phase aux échelles superhorizon alors que c’est le contraire aux échelles subhorizon. De plus cette correction peut être du même ordre de grandeur que les corrections standard à l’Inflation (Stewart-Lydth corrections [33]).
Si l’Inflation a lieu dans le régime où le rayon de courbure du bulk est beaucoup plus grand que le rayon de Hubble (), le taux de dissipation local de l’inflaton se comporte comme
| (4.53) |
Dans le régime quasi-quadridimensionnel () le taux de dissipation local se comporte comme
| (4.54) |
Le taux de dissipation est supprimé dans le régime quasi-quadridimensionnel par un facteur . Le champ scalaire sur la brane se dissipe linéairement par rapport au paramètre de roulement lent à n’importe quelle échelle. La dissipation de l’inflaton dans la dimension supplémentaire est donc dominante aux échelles superhorizon et à haute énergie.
Dans le cas des perturbations tensorielles et dans le cas du fluide parfait pour les perturbations scalaires, les équations de Mukohyama n’auront pas de couplage dérivatif, ce qui fait que les corrections effectives sont non-locales. Il est donc nécessaire dans ces cas de connaître la forme du propagateur du bulk. On est donc amené à simplifier les équations des perturbations en approximant la géométrie de fond. C’est l’objet des sections qui suivent.
4.4 Métrique de fond
Un Univers homogène et isotrope Friedmann-Robertson-Walker (FRW) à dimensions avec une histoire d’expansion arbitraire, caractérisée par le facteur d’échelle fonction du temps propre , peut être plongé dans une portion de l’espace de rayon de courbure , décrit dans des coordonnées de bulk statique (coordonnées de Poincaré) par
| (4.55) |
au moyen du plongement explicite suivant
| (4.56) |
où est le facteur de Hubble sur la brane. Nous pouvons construire explicitement des coordonnées Gaussiennes normales en calculant la courbe géodésique dans le plan , normale à la trajectoire de la brane de temps propre et s’étendant à la distance propre à partir de la brane. Nous obtenons donc la projection suivante entre les coordonnées Gaussiennes normales et les coordonnées de Poincaré :
| (4.57) | |||||
| (4.58) |
d’où il s’ensuit l’élément de longueur suivant
| (4.61) | |||||
Dans ces coordonnées la brane est stationnaire par rapport au bulk, et measure la distance propre à la brane. Notons que nous avons déjà calculé cette métrique à la section 2.2.2 du chapitre 2 en présentant les solutions cosmologiques homogènes et isotropes dans le modèle de Randall-Sundrum. La seule différence est que nous étions partis des perturbations de matière pour exprimer la métrique alors qu’ici l’élaboration de la métrique est purement géométrique.
Bien que les coordonnées Gaussiennes normales soient commodes pour décrire une brane en expansion arbitraire, elles souffrent néanmoins d’un certain nombre de désavantages. En particulier une description du bulk avec ces coordonnées s’effondre quand les géodésiques spatiales normales à la brane développe des caustiques, focalisant soit dans le temps à , soit dans les dimensions spatiales transverses à . Même si ces singularités peuvent donner l’illusion d’un horizon, l’espace du bulk est régulier en ces points et peut être étendu au-delà en utilisant un autre ensemble de coordonnées. Considérons le problème des conditions initiales dans ces coordonnées en examinant le diagramme de Carter-Penrose pour des cosmologies du type Randall-Sundrum (Fig. 4.5). Il faut spécifier des données initiales sur une surface de temps Gaussien normal constant, dans le bulk aussi bien que sur la brane. Supposons qu’on limite notre ambition à prédire ce qui se passe sur la brane dans le futur. L’évolution d’un Univers branaire dans sa phase dominée par la matière (fluide sans pression ), qui initialement était dans sa phase inflationnaire, peut être causalement affecté dans le futur par de l’information inconnue provenant de l’extérieur de l’horizon de Cauchy initial du passé, parce que la taille de l’horizon du bulk a augmenté durant la décélération de l’expansion de la brane.
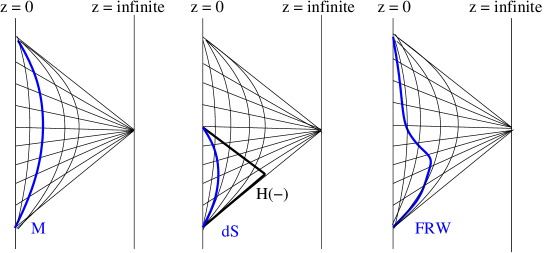
Le mouvement arbitraire et compliqué de la brane dans le bulk brise la symétrie de translation dans le temps du bulk, de telle sorte que les composantes de la métrique dans l’équation (4.61) exhibent une forme non-séparable. Il s’ensuit que les équations de Mukohyama régissant la propagation des perturbations et présentées au chapitre 3 sont également non-séparables. L’évolution des perturbations du bulk dans la métrique de fond (4.61) n’est donc pas maniable par des méthodes analytiques sans une certaine forme d’approximation. Par conséquent nous allons modifier la métrique en ne retenant que ses propriétés les plus importantes et supposer que la solution du bulk est quasi-séparable. Du point de vue d’un observateur sur la brane, la plupart de l’action a lieu dans un volume de quelques longueurs de courbure de (ou longueur de courbure apparente), où virtuellement tout le quadri-volume est concentré. Les modes du bulk liés à la brane ont presque tout leur support localisé là, donc une approximation médiocre de la métrique loin de la brane risque seulement de fournir une approximation pauvre de la queue de la fonction d’onde des états liés, mais la queue représente une probabilité quasiment nulle. Nous pouvons aussi espérer que chaque quanta qui s’échappe de la brane, à cause d’effets non-adiabatiques de l’expansion cosmologique, ne revient pas à cause de réflections ou diffractions dans le bulk courbe222En fait nous allons voir comment approximer l’inhomogénéité du bulk et omettre ainsi les effets non-locaux dûs aux réflections afin de se concentrer sur la dissipation à la section 4.5.1, où on introduira l’approximation par un “potentiel-plateau” valable à haute énergie .. Par conséquent un observateur sur la brane sera peu sensible à la façon dont ces quanta s’échappent, qui va dépendre de la forme de la métrique loin de la brane. De plus, dans l’approximation WKB, la plupart des quanta deviennent classiques à une distance courte de la brane. Pour toutes ces raisons nous pouvons approcher la géométrie de fond (4.61) par sa géométrie proche de la brane (), à l’aide de l’élément de longueur suivant
| (4.62) |
où on a -symétrisé en et où les facteurs de gauchissement (“warp factors”) dépendant du temps et le facteur d’échelle sont respectivement donnés par
| (4.63) | |||||
| (4.64) | |||||
| (4.65) |
Dans cette approximation (4.62) les singularités de coordonnées se trouvent rejetées à l’infini.
4.5 Perturbations tensorielles dans le bulk approximé
Nous étudions le cas le plus simple des perturbations tensorielles, décrivant les ondes gravitationnelles, qui évoluent indépendamment du contenu de matière sur la brane. Nous utilisons la géométrie de fond approchée (4.62), qui est fiable près de la brane. Chaque polarisation des perturbations tensorielles est décrite par un champ scalaire canonique sans masse, minimalement couplé à la gravité , comme on l’a déjà discuté à la section 3.2.1 du chapitre 3. Nous prenons la transformée de Fourier dans les trois directions spatiales transverses et évoluons séparément chaque mode de Fourier. Comme nous allons le voir dans la section qui suit, même dans la géométrie approchée (4.62), les équations du mouvement ne sont toujours pas séparables. On peut réaliser la séparation des équations en approximant l’inhomogénéité du bulk , mais on se concentre en même temps seulement sur les processus de dissipation en rejetant les processus non-locaux dus à la diffraction des gravitons dans le bulk.
4.5.1 Le potentiel-plateau
L’équation de Klein-Gordon du mouvement du champ scalaire sans masse , donnée en (3.34), est dans la métrique de fond approchée (4.62)
| (4.66) | |||
| (4.67) |
où est le moment dans les trois dimensions transverses. À partir de cette équation, valide dans l’intervalle , on peut extraire la condition de bord de Neumann homogène (3.35) en pour les modes pairs (i.e. -symétriques). En changeant d’échelle le champ physique selon
| (4.68) |
l’équation du mouvement devient
| (4.69) | |||
| (4.70) |
L’équation du mouvement n’est pas encore séparable. Cependant, comme l’état lié est localisé près de la brane, une approximation adéquate pour l’évolution de l’état lié du graviton peut être obtenue en retenant seulement le comportement dominant autour de des coefficients dépendant de , ce qui simplifie l’équation. Sans doute c’est une approximation grossière pour les bouts de la fonction d’onde de l’état lié mais nous soutenons que les bouts contribuent de façon négligeable. Par conséquent on pose
| (4.71) |
réduisant l’équation (4.69) à une équation de type Schrödinger
| (4.72) |
avec le “potentiel-plateau” effectif
| (4.73) |
où
| (4.74) |
La condition de bord pour le champ renormalisé est inscrite dans dans la fonction du potentiel et peut être obtenue en intégrant l’équation -symétrique (4.72). De manière équivalente on aurait pu imposer la condition de bord séparément
| (4.75) |
en et restreindre le domaine de (4.72) à , supprimant ainsi la fonction . Sous cette approximation, le cratère du potentiel-volcan habituel [9, 16] est fidèlement conservé mais le paysage autour du sommet reste à élevation constante, tel qu’indiqué à la figure Fig. 4.6 à droite.
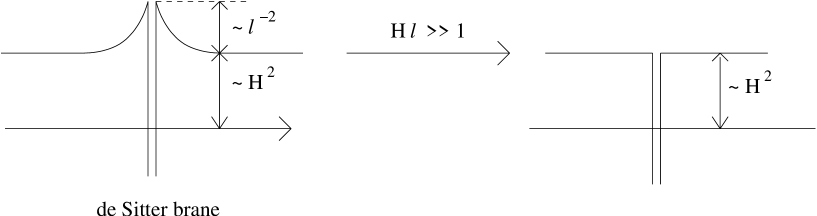
Lorsque la brane possède une géométrie de Sitter pur, les équations d’Einstein linéarisées dans pour les perturbations tensorielles peuvent être réduite à une équation de type “Schrödinger” pour un champ scalaire dans des coordonnées du bulk conformes et une fois que le champ a été changé d’échelle. L’expression exacte du potentiel effectif a été calculée en [16] et a été donnée à la section 2.2.1. Le potentiel a dans ce cas la forme habituelle d’un volcan avec une barrière de potentiel décroissante résultant de la courbure du bulk (Fig. 4.6 à gauche). La hauteur de la barrière de potentiel est et le gap (écart) d’énergie entre le mode zéro et le continuum est . Donc l’approximation du potentiel-plateau que nous avons utilisée précédemment consiste à négliger l’inhomogénéité du bulk et par conséquent la diffraction des gravitons par le bulk courbe. Cette approximation est légitime dans le régime cosmologique où le rayon de courbure du bulk est beaucoup plus grand que l’horizon de Hubble, , c’est-à-dire à haute énergie (ou tôt dans l’histoire de l’Univers). C’est parce que dans ce régime, l’intervalle d’énergie de la barrière de potentiel est de l’ordre , ce qui est beaucoup plus faible que l’échelle d’énergie de Hubble caractérisant le gap. Dans ce régime le potentiel-volcan ressemble au potentiel-plateau (Fig. 4.6), ce qui légitime l’approximation. Dans le régime opposé où le rayon de courbure de la dimension supplémentaire est beaucoup plus petit que l’horizon de Hubble, , notre approximation échoue parce que l’intervalle d’énergie de l’inhomogénéité du bulk est maintenant non-négligeable. Donc dans ce régime le potentiel-plateau donnerait seulement des bornes supérieures et inférieures grossières au vrai potentiel-volcan.
4.5.2 Dissipation de l’état lié du graviton pour une brane inflationnaire à haute énergie
Nous constatons que la forme du potentiel-plateau (4.73) implique, pour le spectre 5D de gravitons, la présence d’un unique état lié à la brane, le mode zéro du graviton, et d’un continuum de modes libres de diffusion dont les valeurs propres de masse démarrent au-dessus du plateau. Nous développons la fonction d’onde sur la base des modes normaux
| (4.76) |
où le indexe le mode lié et les indexent les modes du continuum. Les fonctions propres des modes () sont dépendantes du temps et satisfont
| (4.77) |
Le spectre -symétrique de l’équation (4.77) consiste effectivement en un unique état lié avec :
| (4.78) |
et en un continuum d’états libres du bulk avec :
| (4.79) |
Un gap d’énergie de sépare l’état lié du continuum.
Nous considérons l’Univers pendant l’époque de l’Inflation, lorsque la géométrie de la brane est quasi-de Sitter et l’expansion adiabatique, dans le sens où . Dans ce régime l’interaction brane-bulk peut être calculée de façon perturbative dans les couplages faibles. Dans le cas des perturbations tensorielles, le seul degré de liberté sur la brane est l’état lié discret du graviton (mode zéro). Nous pouvons calculer le taux de dissipation de l’état lié du graviton dû au mouvement inflationnaire de la brane dans le bulk. Dans l’approximation adiabatique on a que
| (4.80) |
On obtient l’équation d’évolution des coefficients () dépendant du temps du développement en modes dans le bulk approximé décrit en (4.62) :
| (4.82) | |||||
où les termes d’ordre supérieur incluent deux dérivées temporelles du potentiel (e.g. ). Les termes s’annulent puisque les modes propres sont réels. Les termes connectant deux états du continuum sont également nuls à cause de l’orthogonalité333L’orthogonalité est le résultat ici de la forme simplifiée du potentiel-plateau.. Les seuls éléments matriciels non nuls sont ceux qui connectent le mode lié à un mode du continuum,
| (4.83) |
L’équation (4.82) se réduit donc à
| (4.84) | |||||
| (4.85) |
couplant ainsi l’état lié aux états du continuum avec . Dans l’approximation adiabatique le facteur de couplage au premier ordre et les fréquences , sont
| (4.86) | |||||
| (4.87) | |||||
| (4.88) |
Le couplage dépendant du temps dans (4.84) génère des transitions entre le mode lié et le continuum, parce que les modes nus à l’ordre zéro agissent comme une source pour les modes au prochain ordre. Dès que l’accélération de la brane change dans le bulk, à travers la dérivée du facteur de Hubble (ou de manière équivalente ), le mode in agit comme une source à travers le facteur de couplage et génère différents modes au premier ordre. Par conséquent des transitions du mode lié vers le continuum se produisent au premier ordre dans les couplages, et les modes continus du premier ordre agissent ensuite eux-même comme une source pour le mode lié, comme un effet de rétroaction au deuxième ordre. Le mode lié à la brane et les modes continus du bulk sont reliés selon
| (4.89) | |||||
| (4.90) |
où et sont les fonction de Green retardées nues satisfaisant
| (4.91) | |||||
| (4.92) |
Nous pouvons exprimer la fonction de Green retardée du mode du bulk dans l’approximation WKB
| (4.93) |
Cette approximation WKB est raisonnable parce que les modes propres du bulk oscillent tout le temps. Il n’y a pas de point de rebroussement puisque est toujours vérifié. La condition est satisfaite à la fois pour des modes subhorizon, , et des modes superhorizon, . Le propagateur effectif sur la brane, avec l’interaction avec les modes du bulk prise en compte, est obtenue en resommant la série perturbative géométrique à tous les ordres :
| (4.94) | |||||
| (4.95) | |||||
| (4.96) |
L’interaction quadridimensionnelle entre les modes de la brane, dûe à l’expansion de l’Univers, est contenue dans , alors que l’interaction entre le mode lié et les modes du continuum est contenue dans le noyau du bulk :
| (4.97) | |||||
| (4.98) |
de telle sorte que l’évolution du mode lié à la brane est gouverné par l’équation intégro-différentielle :
| (4.99) | |||||
| (4.100) |
où le noyau d’interaction avec le bulk "habille" le champ nu de l’état lié. La dissipation éventuelle de l’état lié apparait donc ici comme non-locale (avec mémoire) à un observateur sur la brane. Ce caractère dissipatif se manifeste de façon non-locale parce que l’état lié n’est pas un degré de liberté purement local sur la brane mais localisé près de la brane, avec une extension typique dans le bulk donnée par . L’existence de l’état lié dépend intrinsèquement de la courbure du bulk . Cette condition est incompatible avec une interaction locale avec le bulk. Dans la limite de haute énergie (où le potentiel-plateau est une approximation fiable), on a , . Le noyau d’interaction avec le bulk (4.97) se simplifie dans la limite comme
| (4.101) |
aux échelles superhorizon, et comme
| (4.102) | |||||
| (4.103) |
aux échelles subhorizon, où dans ce dernier cas l’intégrale sur est supprimée pour . Nous avons utilisé le fait que , sont quasiment constant au cours du temps dans l’approximation adiabatique. Le noyau superhorizon (4.101) est tracé sur la figure Fig. 4.7.
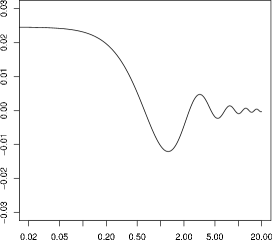
Nous observons que le noyau est non-local, variant typiquement sur un échelle de temps de Hubble . L’interaction avec le bulk contient donc une mémoire (ou un délai en temps). Par conséquent une approximation locale du noyau ne serait possible que si le mode lié variait avec une échelle de temps caractéristique plus grande que le temps de Hubble.
Au cours de l’Inflation, le rayon de Hubble de l’Univers reste quasiment constant dans le temps, alors que la longueur d’onde physique d’un mode augmente de façon exponentielle à cause de l’expansion. Au début de l’Inflation un mode de nombre d’onde donné est initialement subhorizon de sorte que . Au fur et à mesure de l’expansion de l’Univers, ce mode traverse l’horizon pour devenir superhorizon. Alors que les modes oscillent aux échelles subhorizon, ils deviennent "gelés" après le croisement de l’horizon de Hubble. Un observateur est sensible seulement aux modes superhorizon sur la brane qui sont les modes accessibles aux observations cosmologiques aujourd’hui et qui constituent les "conditions initiales" de l’Univers à la fin de l’Inflation. Pour ces raisons nous nous concentrerons sur les modes aux échelles superhorizon (ou, de façon équivalente, aux asymptotes à grand temps des modes)
| (4.104) |
L’évolution des modes de la brane aux échelles superhorizon, prenant en compte l’interaction avec le bulk à travers le noyau integral , est non-locale. Par conséquent l’évolution (et la dissipation éventuelle) des modes superhorizon sur la brane dépend en fait de leur évolution passée aux échelles subhorizon, à travers l’interaction du bulk avec les modes aux échelles subhorizon. Aux échelles superhorizon, la fréquence nue du mode lié est imaginaire
| (4.105) |
Le coefficient du mode lié, nu, , excluant l’interaction avec le bulk, est la superposition d’un mode croissant et d’un mode décroissant
| (4.106) | |||||
| (4.107) |
aux échelles superhorizon, dans l’approximation WKB. Puisque nous avions changé d’échelle le champ physique en (4.68) par le facteur , le vrai mode lié est en fait la superposition d’un mode constant et d’un mode décroissant. Les solutions nues (4.106) correspondent également aux asymptotes superhorizon de la solution quadridimensionnelle donnée par la fonction de Hankel dans la limite d’une géométrie purement de Sitter à quatre dimensions :
| (4.108) | |||||
| (4.109) |
où est le temps propre conforme et . Le mode décroissant n’est pas observable et a peu d’intérêt cosmologique pour la formation des structures à grande échelle dans l’Univers. Dans la suite nous considérons seulement la solution dominante composée du mode croissant.
Nous pouvons maintenant rechercher le mode croissant superhorizon de l’état lié "habillé", c’est-à-dire tenant compte de l’interaction avec le bulk, en utilisant l’Ansatz superhorizon :
| (4.110) |
où
| (4.111) |
Comme le noyau d’interaction avec le bulk est non-local, nous devrions prendre des précautions en insérant cet Ansatz superhorizon dans le noyau integral de l’équation (4.99). L’intégration complète et rigoureuse devrait bien-entendu prendre en compte la contribution du régime subhorizon, où le mode lié a une forme différente de l’Ansatz superhorizon (4.110). Cependant, nous conjecturons que, lorsqu’on observe la solution "habillée" aux échelles superhorizon aujourd’hui, les effets intégrés des modes subhorizon dans leur interaction avec le bulk sont sous-dominant en comparaison de la contribution des modes superhorizon. C’est parce que l’amplitude des modes subhorizon est supprimée par rapport à l’amplitude des modes superhorizon. On peut également remarquer en (4.102) que le noyau integral aux échelles subhorizon est diminué par le facteur par rapport à sa limite superhorizon. Utiliser l’Ansatz (4.110) à tout temps pour résoudre l’équation intégro-differentielle (4.99) pour l’état lié est en fait équivalent à lisser les oscillations subhorizon de faible amplitude dans la solution exacte du mode lié. Pour ces raisons nous considérons l’Ansatz superhorizon (4.110) suffisant pour résoudre l’équation intégro-differentielle (4.99) et calculer l’ordre de magnitude du taux de dissipation de l’état lié aux échelles superhorizon.
Nous procédons donc maintenant au calcul du facteur d’atténuation du mode lié croissant dans le régime de haute énergie . Dans ce régime le rayon de courbure de la dimension supplémentaire est beaucoup plus grand que le rayon de Hubble de sorte que taux de dissipation de l’état lié dans la dimension supplémentaire doit atteindre sa valeur maximale. Comme nous l’avons discuté au paragraphe 4.5.1, le potentiel-plateau est une approximation fiable dans ce régime pour appréhender le comportement et la magnitude de l’interaction brane-bulk. La hauteur du potentiel-plateau vaut alors et le coefficient du mode lié "habillé" évolue aux échelles superhorizon selon l’équation
| (4.112) |
où est le noyau d’interaction avec le bulk pris dans la limite superhorizon, éqn. (4.101).
L’insertion de l’Ansatz (4.110) dans (4.112) conduit à l’équation algébrique
| (4.113) |
qui, à l’ordre linéaire en , devient
| (4.114) |
de telle sorte que
| (4.115) |
Le signe moins trouvé dans signifie une atténuation du mode croissant dans la dimension supplémentaire. Le potentiel-plateau possède l’avantage d’éliminer les processus de diffraction (ou réflection) dans le bulk courbe en approximant l’inhomogénéité du bulk, ne préservant ainsi que les processus de dissipation due à la dimension supplémentaire. Même si l’état lié ne se dissipait pas dans le régime subhorizon et subissait seulement un décalage de fréquence, on observe que l’état lié subit de la dissipation classiquement dans le régime superhorizon selon
| (4.116) |
où est le mode croissant nu. Le taux de dissipation de l’état lié dans le régime superhorizon est donc donné par
| (4.117) |
Les gravitons émis dans la dimension supplémentaire sont oscillant à tout temps puisque leur fréquence reste au dessus du plateau du potentiel. Terminons cette section en ré-exprimant le facteur d’atténuation en fonction du paramètre de slow-roll de l’Inflation , caractérisant l’adiabaticité de l’expansion de l’Univers, et du nombre d’e-folds :
| (4.118) |
L’état lié du graviton (mode zéro des perturbations tensorielles) se dissipe de façon non-locale et quadratiquement dans le paramètre de slow-roll. La dissipation de l’état lié est donc sous-dominante par rapport à la dissipation de l’Inflaton (perturbation scalaire, section 4.3).
4.6 Perturbations scalaires dans le bulk approximé : fluide parfait adiabatique aux échelles subhorizon
Dans cette section nous explorons l’évolution des perturbations scalaires de métrique, dans la géométrie de fond approchée (4.62), couplant cette fois aux perturbations adiabatiques d’un fluide parfait sur la brane dans le régime subhorizon. Dans la géométrie de fond approchée (4.62), fiable près de la brane, l’équation du mouvement (3.48) du champ "maitre" de Mukohyama dans l’intervalle s’écrit :
| (4.119) | |||
| (4.120) |
où est le tri-moment transverse. De façon similaire au cas tensoriel de la section 4.5 précédente, nous réduisons l’équation du mouvement (4.119), en faisant le changement de variable
| (4.121) |
L’équation dans le nouveau champ s’écrit :
| (4.122) | |||
| (4.123) |
Elle contient des termes dépendant de représentant l’inhomogeneité du bulk . L’équation du mouvement n’est malgré tout pas encore séparable. Cependant, comme à la section 4.5.1 pour le cas tensoriel, lorsque nous avons introduit le potentiel-plateau, nous simplifions de nouveau la dépendance en en gardant seulement le comportement dominant des coefficients en autour de . On pose
| (4.124) |
réduisant l’équation (4.122) à
| (4.125) |
où
| (4.126) | |||||
| (4.127) |
La courbure du bulk est contenue dans et la courbure intrinsèque de la brane est contenue dans . Soulignons le "mauvais" signe du potentiel pour les perturbations scalaires puisque . En fait la brane va agir dans ce cas comme un potentiel répulsif pour les perturbations scalaires de métrique dans un cadre -symétrique, de telle sorte qu’il ne peut exister d’état lié gravitationnel scalaire près de la brane, au moins tant qu’il n’y a pas de couplage avec la matière sur la brane (voir équation de bord (4.132)).
Le cas d’un fluide parfait sur la brane (d’équation d’état ) entraîne quelques difficultés dans le calcul de l’évolution des perturbations parce que l’expansion de la brane n’est plus adiabatique. n’est pas petit excepté lorsque le fluide est sous-dominant par rapport à la tension de la brane (constante cosmologique). Dans cette section nous explorons la dissipation éventuelle des perturbations du fluide dans le régime subhorizon parce que, dans ce régime, l’approximation adiabatique de l’expansion est valide. En effet aux échelles subhorizon la geometrie de la brane apparait quasiment Minkowskienne.
Les conditions de bord (3.49), reliant le champ "maitre" des perturbations de métrique aux perturbations du fluide sur la brane, deviennent dans la géométrie de fond approximée (4.62) valide près de la brane :
| (4.128) | |||||
| (4.129) | |||||
| (4.131) | |||||
Il est possible de simplifier les conditions de bord (4.128) pour les perturbations scalaires de métrique en exprimant celles-ci en fonction de la perturbation de matière indépendante de jauge (contraste de densité). On obtient alors les conditions de bord suivantes :
| (4.132) |
qui, en fonction du champ "maitre" renormalisé (4.121), conduisent aux conditions de bord
| (4.133) |
où a été donné en (4.126).
L’équation du mouvement pour les perturbations de matière sur la brane peut également être obtenue à partir des conditions de bord (4.128) en imposant une équation d’état sur les perturbations de matière. Nous considérons des perturbations adiabatiques de matière (i.e sans entropie)
| (4.134) |
où est la vitesse du son du fluide. On obtient l’équation du mouvement pour le contraste de densité , similaire à l’équation obtenue dans [46],
| (4.135) | |||||
| (4.136) |
où, selon la dynamique des Univers branaires [20],[29], présentée à la section 2.2.2,
| (4.137) | |||||
| (4.138) | |||||
| (4.139) |
L’équation d’état du fluide parfait sur la brane est . Nous pouvons aussi changer d’échelle le degré de liberté sur la brane comme pour obtenir une équation d’oscillateur. Finalement les équations couplant les perturbations scalaires de la brane aux perturbations scalaires du bulk peuvent se résumer sous la forme générique
| (4.140) | |||||
| (4.141) | |||||
| (4.142) |
où et ont été donné en (4.127) et
| (4.144) | |||||
| (4.145) | |||||
| (4.146) |
L’observation immédiate, en référence à la section 4.2, est l’absence de couplages dérivatifs en temps pour le système brane-bulk dans (4.142). Par conséquent la dissipation éventuelle du fluide sur la brane vers le bulk ne peut être que non-locale malgré que le fluide parfait soit local (i.e. vraiment localisé sur la brane). Dit autrement, aucun terme de friction locale de la forme ne peut apparaitre dans l’équation effective sur la brane, cela signifie que la dissipation éventuelle du fluide sur la brane contient nécessairement une mémoire ou un délai en temps. La non-localité de l’interaction brane-bulk provient des effets de courbure.
La physique sous-jacente peut être illustrée en utilisant le modèle mécanique suivant. Considérons une corde couplée par son extrémité à un oscillateur harmonique avec deux ressorts, comme indiqué sur la figure Fig. 4.8.
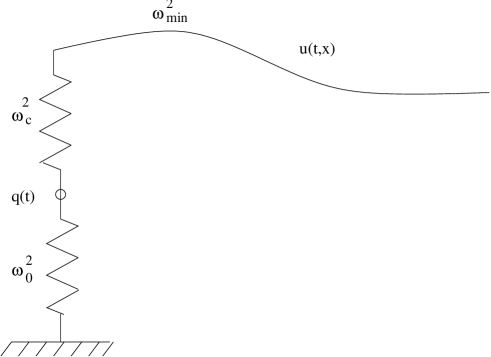
Les équations pour ce modèle sont similaires à celles obtenues pour les perturbations scalaires du système brane-bulk :
| (4.147) | |||||
| (4.148) | |||||
| (4.149) |
où est la tension de la corde exprimée comme une fréquence, et et sont les constantes de raideur des deux ressorts exprimées comme des fréquences au carré. Le ressort intermédiaire entre la masse et la corde joue le rôle d’un tampon. En l’absence de ce tampon, le couplage avec la corde introduirait un terme local de dérivée première en temps (terme de friction) dans l’équation effective pour l’oscillateur harmonique, indiquant alors une dissipation locale de l’oscillateur vers la corde. Ce n’est pas le cas ici.
En l’absence du terme de masse (force de rappel) sur la corde, les équations seraient
| (4.150) | |||||
| (4.151) | |||||
| (4.152) |
où est un terme de forçage. Pour des coefficients indépendant du temps, les Ansätze et entrainent
| (4.153) |
qui équivaut à
| (4.154) |
où
| (4.155) | |||||
| (4.156) | |||||
| (4.157) |
et Par conséquent, l’équation (4.154) devient
| (4.158) |
Dans le cas limite où on peut faire le développement
| (4.159) |
tel que l’équation(4.158) peut être approximée par
| (4.160) |
Nous considérons ensuite l’équation d’onde pour la corde incluant le terme de masse (force de rappel), de sorte qu’il y a maintenant une fréquence minimum pour exciter les modes de la corde (ou les modes se propageant dans le bulk). On a
| (4.161) |
Dans ce cas le noyau est modifié pour devenir
| (4.162) |
Lorsque n’est pas trop grand, , il y a un pôle isolé en , où
| (4.163) |
et une coupure sur l’axe réel s’étendant de à Pour obtenir un noyau causal, on doit prendre un contour passant au-dessus de la coupure sur l’axe réel. Pour où le noyau a son support, nous évaluons le contour en le déformant tel qu’il y ait deux contributions (voir Fig. 4.9(a)). Le premier terme a pour origine le contour encerclant le pôle dans le sens des aiguilles d’une montre :
| (4.164) |
Le second a pour origine le contour encerclant la coupure dans le sens des aiguilles d’une montre, comme indiqué à la figure Fig.4.9(a) :
| (4.165) |
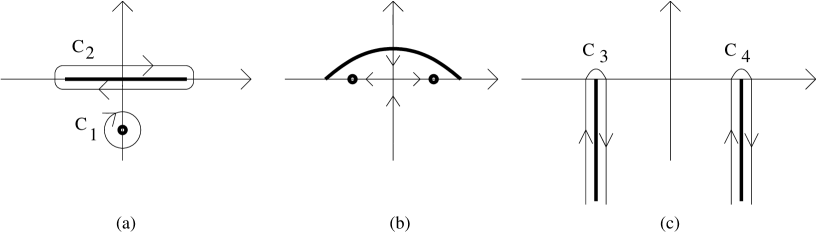
Quand approche , le pôle sur le demi-plan inférieur s’approche de . Il y a un second pôle, image miroir du premier, . Cependant ce pôle réside sur l’autre feuillet de Riemann, caché derrière la coupure. Lorsque excède , ces deux pôles entrent en collision et diffusent à angle droit en résidant sur la ligne réelle de la coupure (ou juste en dessous après la déformation faite à la figure Fig. 4.9(b)). On peut faire disparaître ces deux pôles en déformant la coupure vers le bas comme indiqué à la figure Fig. 4.9(c). La coupure a été repoussée vers l’infini négatif. Désormais le noyau intégral peut être exprimé comme
| (4.166) |
où les contours and sont indiqués à la figure Fig. 4.9(c). On peut réécrire cela comme
| (4.168) | |||||
En fait cette expression tient toujours pour . À des temps très grands, le noyau (4.168) se comporte asymptotiquement comme
| (4.169) |
Il semble peu aisé de manipuler les expressions du noyau en espace réel. C’est pourquoi nous calculons aussi le noyau dans l’espace de Fourier pour une étude complémentaire. Avec le terme de forçage , l’équation de l’oscillateur harmonique est
| (4.170) | |||||
| (4.171) |
La moyenne dans le temps de la puissance transmise à l’oscillateur (qui est une mesure de la dissipation) est
| (4.172) | |||||
| (4.173) | |||||
| (4.174) |
Si le noyau n’a pas de partie imaginaire, le système échange de l’énergie mais ne se dissipe pas puisque la puissance moyenne s’annule. Pour la partie imaginaire du noyau s’annule justement. De l’expression de , on déduit la puissance dissipée moyenne
| (4.175) |
La puissance dissipée est nulle lorsque . On peut comprendre qualitativement comment le comportement change quand varie. La corde peut être vue comme un filtre passe-haut avec le seuil . Seule la radiation de plus haute fréquence peut s’échapper dans la corde vers l’infini, conduisant ainsi à un flux d’énergie loin de l’oscillateur. À plus basse fréquence la corde est excitée autour de l’oscillateur mais de façon localisée avec une amplitude décroissant de manière exponentielle à distance de l’oscillateur puisque le moment de l’équation d’onde de la corde devient imaginaire. Dans ce cas il n’y a pas de dissipation à long terme parce que la corde vibre en phase avec l’oscillateur. Bien-sûr le couplage décale la fréquence de l’oscillateur parce que la corde ajoute de l’inertie et une force de rappel sur l’oscillateur.
Pour revenir au système brane-bulk, le seuil est donné par
| (4.176) |
où , ont été calculés en (4.127). Dans le cas d’un couplage faible avec le bulk (), la fréquence du degré de liberté sur la brane est seulement légèrement décalée de la valeur nue donnée à l’équation (4.144). Aux échelles subhorizon (),
| (4.177) |
puisque . Donc la puissance dissipée est exactement zéro. Dans l’approximation adiabatique, valide aux échelles subhorizon, le fluide ne peut pas se dissiper dans le bulk parce que la fréquence naturelle des modes du bulk, à nombre d’onde égal par ailleurs, est trop haute, empêchant les perturbations du fluide d’entrer en résonance avec les gravitons du bulk.
4.7 Discussion
Dans ce chapitre nous avons presenté nos résultats [51]. Nous avons proposé des approches analytiques pour estimer l’ordre de magnitude des effets dissipatifs en cosmologie branaire. Nous avons supposé que l’expansion de l’Univers était adiabatique, dans le sens où . Nous avons exploré l’évolution des perturbations scalaires et des perturbations tensorielles. Dans le cas des perturbations scalaires, avec un champ scalaire en roulement lent (Inflaton) sur la brane, sans aucune autre approximation nous avons obtenu le taux de dissipation local de l’Inflaton dû à l’interaction avec les gravitons du bulk: , qui est linéaire dans le facteur de slow-roll. C’est notre principal résultat et il s’accorde avec les résultats numériques obtenus par Koyama & al. dans [48]: dans le régime de haute énergie de l’Inflation branaire (), les corrections à l’Inflation standard dûes au couplage avec les perturbations de métrique du bulk sont également trouvées linéaires dans le facteur de slow-roll. De plus la dépendance en du taux de dissipation que nous avons trouvé correspond exactement au profil de la correction slow-roll tracée numériquement dans [48]. Dans le cas des perturbations scalaires avec un fluide parfait sur la brane ainsi que dans le cas des perturbations tensorielles, nous avons fait face à des processus de dissipation non-locaux, cela nous a amené à simplifier la géométrie de fond dans ces cas : nous avons considéré que la géométrie de fond proche de la brane est une approximation fiable pour décrire l’interaction brane-bulk, au moins les processus dissipatifs. Nous avons explicitement éliminé les effets non-locaux dûs à la diffraction des gravitons émis dans le bulk inhomogène en approximant cette inhomogénéité (potentiel-plateau). On s’est concentré de cette façon sur les processus de dissipation. Cette approximation est bien légitime dans le régime de haute énergie de l’Inflation branaire () parce que la courbure du bulk devient négligeable comparée à l’accélération de la brane. En utilisant une approche de “resommation quantique” nous avons été capable de séparer les transitions entre les quanta de la brane dûes à l’expansion non-uniforme de l’Univers des transitions entre les quanta de la brane et les quanta du bulk dûes à l’interaction avec la dimension supplémentaire.
À cause de l’expansion non-uniforme de la brane, les degrés de liberté localisés sur la brane interagissent avec les gravitons du bulk, ce qui conduit éventuellement à de la dissipation sur la brane d’un point de vue quadridimensionnel. Ces effets sont inscrits dans le propagateur du bulk . Nous avons calculé l’atténuation du mode croissant de l’état lié du graviton aux échelles superhorizon, due à l’interaction avec les modes KK du bulk. Nous avons trouvé que le taux de dissipation de l’état lié aux échelles superhorizon est de l’ordre de lorsque . Nous avons aussi montré que les perturbations adiabatiques d’un fluide parfait sur la brane ne peuvent pas se dissiper dans la dimension supplémentaire aux échelles subhorizon parce que la fréquence minimum d’excitation des modes KK du bulk, à nombre d’onde égal à celui du fluide, est trop haute pour pouvoir obtenir une résonance. Nous avons rencontré des difficultés pour appliquer des méthodes analytiques dans le cas du fluide parfait aux échelles superhorizon, parce qu’à de telles échelles l’expansion de l’Univers n’est plus adiabatique, au moins tant que le fluide domine la tension de la brane. Nous avons également montré qu’un champ scalaire en roulement lent sur la brane (“slow-roll inflaton”) se dissipe de façon locale à n’importe quelle échelle, alors que l’état lié du graviton se dissipe de façon non-locale. De plus l’inflaton dissipe avec un taux plus important , linéaire dans le paramètre adiabatique de roulement lent, que le taux de dissipation de l’état lié du graviton , quadratique dans le paramètre adiabatique de roulement lent. Cette différence est la conséquence du caractère local de l’interaction de l’inflaton avec les modes du bulk contrairement au caractère non-local de l’interaction de l’état lié du graviton avec les modes du bulk.
L’approche analytique développée ici repose sur le calcul du propagateur retardé effectif sur la brane. Comme nous avons pris en compte les effets de rétroaction à la fois pour les perturbations tensorielles et pour les perturbations scalaires sur la brane inflationnaire, nous sommes désormais en mesure de calculer les corrections branaires au rapport tenseur-scalaire standard de l’Inflation à un champ. Ce sera l’objet de nos futures recherches. Il serait également intéressant d’aller au-delà de l’approximation du potentiel-plateau pour prendre en compte l’inhomogénéité du bulk et la diffraction des gravitons par le bulk courbe qui entraine des effets non-locaux sur la brane. La non-localité est inscrite dans le propagateur du bulk et dépend fortement de la courbure du bulk. En ce sens l’expression exacte du propagateur du graviton dans est nécessaire pour calculer les processus non-locaux. La géométrie courbe du bulk entraine également l’existence de gravitons métastables (c’est-à-dire des états quasi-liés sur la brane), même si la brane est statique, comme l’a montré Seahra dans [53]. On pourrait comparer le flux des gravitons du bulk qui se propagent par tunnel quantique avec le flux des états quasi-liés. Ce sera l’objet d’une future publication. Notons enfin que les méthodes employées ici peuvent s’appliquer à tout autre modèle de théorie des champs en interaction avec un bord ou une sous-variété localisant une partie des champs.
Chapitre 5 Le propagateur retardé covariant du graviton dans l’espace Anti-de Sitter
Nous avons vu au chapitre 4 que, pour un Univers branaire en expansion non-uniforme, des gravitons pouvaient être émis dans le bulk . Nous avons montré que cela apparaissait comme de la dissipation du point de vue d’un observateur confiné sur la brane et nous avons estimé les taux de dissipation de différentes perturbations de matière sur la brane en utilisant une approche de "resommation quantique", où le propagateur du bulk est systématiquement inséré à tous les ordres de perturbation en les couplages pour obtenir le propagateur effectif sur la brane. À cause de la courbure du bulk , les gravitons qui ont été émis de la brane peuvent aussi être diffractés dans le bulk courbe puis ré-absorbés sur la brane et transformés de nouveau en quanta sur la brane, conduisant ainsi à de la non-localité du point de vue quadridimensionnel d’un observateur sur la brane. Cette non-localité est inscrite dans la forme du propagateur du bulk pour le graviton. Comme des effets non-locaux dépendent forcément de la courbure, il s’avère nécessaire de connaître la forme exacte du propagateur dans si l’on veut estimer correctement la magnitude des processus non-locaux sur la brane. Les calculs explicites du propagateur retardé du graviton dans , effectués dans ce chapitre, étaient motivés par le problème du calcul des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion.
Dans ce chapitre nous trouvons la forme explicite du propagateur retardé du graviton dans , où est arbitraire, de façon complètement covariante et classique. La méthode utilisée pour obtenir les fonctions de Green dans la première partie du chapitre est essentiellement celle employée par D’Hoker, Freedman, Mathur, Matusis et Rastelli [54], où les mêmes techniques ont été appliquées pour calculer la version Euclidienne de la fonction à deux points, sans fixer de jauge et en séparant explicitement parties physiques et parties de pure jauge. Dans la seconde partie du chapitre nous essayons de déterminer la forme retardée du propagateur du graviton par des considérations purement classiques. En fait nous souhaitons montrer, sans avoir recours à des arguments quantiques, que la prescription pour calculer la forme retardée du propagateur du graviton dans est exactement
| (5.1) |
si est la fonction à deux points du graviton dans et est la séparation invariante relativiste entre deux points sur la variété . En effet, la littérature ne nous semble pas très claire pour justifier la prescription (5.1) pour construire la forme retardée du propagateur dans un espace courbe. Plusieurs tentatives s’appuient sur les relations de commutations canoniques ou le choix d’un vide quantique [55], alors que le propagateur retardé est un objet classique. Les notations utilisées dans ce chapitre sont , et , où est la dérivée covariante associée à la métrique du fond non-perturbée . Le travail que nous exposons dans ce chapitre est informel, il n’a pas été soumis à publication.
5.1 Fonction de Green covariante du graviton dans
5.1.1 Équation d’Einstein linéarisée covariante dans
La métrique de l’espace-temps de rayon de courbure est la solution des équations d’Einstein à dimensions
| (5.2) |
où la constante cosmologique négative vaut . L’espace étant maximalement symétrique, on en déduit aisément respectivement le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci et le scalaire de courbure :
| (5.3) |
Sous l’influence d’une perturbation de matière apparaissant à l’ordre un, la nouvelle métrique perturbée de
| (5.4) |
diffère de la métrique de par la perturbation à l’ordre un, et est solution des équations d’Einstein111Le couplage avec la matière est posé egal à .
| (5.5) |
qui peuvent se ré-écrire sous la forme
| (5.6) |
où on a défini le tenseur énergie-impulsion “trace-modifié” () :
| (5.7) |
En gravité linéarisée dans , les gravitons correspondent aux perturbations de la métrique de fond et satisfont les équations d’Einstein (5.6) à l’ordre linéaire :
| (5.8) |
Les symboles de Christoffel se scindent en une partie d’ordre zéro et une partie d’ordre un
| (5.9) | |||||
| (5.10) |
où
| (5.11) | |||||
| (5.12) | |||||
| (5.13) | |||||
| (5.15) | |||||
| (5.16) |
Le tenseur de Riemann à l’ordre un vaut quant à lui
| (5.17) | |||||
| (5.18) |
On déduit de (5.17) et (5.11) que le tenseur de Ricci à l’ordre un apparaissant dans les équations d’Einstein linéarisées (5.8) vaut
| (5.19) |
En notant que et utilisant la relation , on peut ré-écrire
| (5.20) |
En insérant (5.20) dans (5.8), connaissant les expressions (5.3), on obtient l’équation de propagation complètement covariante du graviton dans avec source :
| (5.21) |
où est défini en (5.7). Bien-sûr on pourrait choisir la jauge covariante de Lorentz de façon à simplifier l’équation du mouvement selon
| (5.22) |
mais on préfèrera travailler avec l’équation (5.21) parce qu’elle est complètement covariante, sans choix de jauge particulier.
5.1.2 Fonction de Green
La solution de l’équation (5.21) est connectée à la source selon
| (5.23) |
où la fonction de Green satisfait
| (5.24) | |||||
| (5.25) |
Le dernier terme du membre de droite de (5.24) est un terme "trace-modifiant". Ce terme est nécessaire puisque nous avons défini connectant avec (au lieu du membre de droite de (5.21) : ).
L’espace-temps de rayon de courbure est une variété pseudo-Riemanienne (ou Lorentzienne) qui correspond à l’hypersurface à dimensions d’un hyperboloide plongé dans un espace plat à dimensions de signature , selon
| (5.26) |
La métrique de l’espace enveloppant à dimensions est
| (5.27) |
Le groupe d’isométrie de est donc . Il s’avère commode pour faire des calculs explicites d’utiliser les coordonnées
| (5.28) |
où le vecteur décrit l’hypersphère et . Ces coordonnées couvrent tout l’espace avec la métrique222Notons que cette métrique globale de correspond à celle qu’on a calculée en (4.61) au chapitre 4 dans le cas . de :
| (5.29) |
où est la métrique de la sphère . Il s’avère de plus commode d’utiliser la séparation invariante relativiste entre deux points : , où est la demi-distance entre dans l’espace plat de plongement de signature , dite distance cordale (Fig. 5.1).
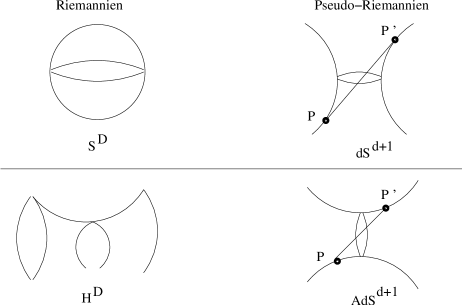
Dans les coordonnées globales, la séparation invariante s’écrit
| (5.30) |
Lorsque coincide avec ou réside dans le cône de lumière passé ou futur de , on a Si et peuvent être reliés par une géodésique de genre temps de longueur propre (en unité de la longueur de courbure de ), Lorsque coincide avec le point antipodal de (noté ) ou réside sur le cône de lumière passé ou futur de Si et sont connectés par une géodésique de genre espace de longueur propre (de nouveau en unité de la longueur de courbure de ), et si peut être connecté à par une géodésique de genre espace et de longueur propre (Fig. 5.2).
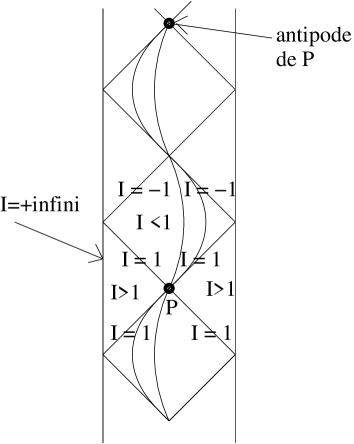
On peut exprimer en séparant explicitement les parties invariantes de jauge des parties artefacts de jauge [54]
| (5.31) | |||||
| (5.32) | |||||
| (5.33) | |||||
| (5.34) | |||||
| (5.35) |
ce qui est bien équivalent à la forme habituelle
| (5.36) | |||||
| (5.37) | |||||
| (5.38) | |||||
| (5.40) | |||||
| (5.41) |
décomposée sur la base des cinq bi-tenseurs de , symétriques sous le groupe d’isométrie . Nous noterons chacun des cinq bi-tenseurs de base accompagnant les cinq fonctions scalaires .
Les termes impliquant , and dans (5.31) sont des gradients par rapport à ou . Les gradients par rapport à ne contribuent pas à la propagation des composantes physiques de parce qu’on intègre sur des courants conservés : . Les gradients par rapport à donnent des modifications non-pertinentes de dans (5.23) puisqu’ils correspondent aux diffeomorphismes ou transformations de jauge . Donc , et sont des parties de pure jauge, alors que et sont les parties physiques du propagateur du graviton. On posera donc pour la suite. La forme de , avec ses parties physiques seulement, connecte donc les gravitons physiques à la source de matière selon
| (5.42) |
En insérant la partie physique de la fonction de Green dans l’équation d’Einstein linéarisée covariante (5.24), et en utilisant les formules algébriques données dans l’appendice 5.A de ce chapitre, on trouve, après un calcul trivial mais laborieux, l’équation du mouvement pour la fonction de Green physique du graviton dans :
| (5.43) | |||||
| (5.44) | |||||
| (5.45) | |||||
| (5.46) | |||||
| (5.47) | |||||
| (5.48) | |||||
| (5.49) |
si ne sont pas confondus (). Ensuite on peut manipuler les différents termes tensoriels de façon à isoler des dérivées totales du type , qui s’annulent par intégration par partie puisque . Il restera trois bi-tenseurs de base indépendants qui donneront trois équations pour et . Nous donnons les trois manipulations : on peut transformer le terme en en fonction de pour trouver que
| (5.50) | |||||
| (5.51) |
on peut aussi combiner le terme en avec un terme en pour trouver que
| (5.52) | |||||
| (5.53) | |||||
| (5.54) |
et enfin on peut combiner le terme en avec un terme en et un terme en pour trouver que
| (5.55) | |||||
| (5.56) | |||||
| (5.57) | |||||
| (5.58) |
De ces trois manipulations il résulte que l’équation pour le propagateur se simplifie selon :
| (5.59) | |||||
| (5.60) | |||||
| (5.61) | |||||
| (5.62) |
de telle sorte que les composantes scalaires physiques , du propagateur du graviton satisfont le système d’équations :
| (5.63) | |||
| (5.64) | |||
| (5.65) | |||
| (5.66) |
On pourra observer que ce sont des équations similaires à celles trouvées dans [54]. L’équation (5.63) est l’équation du propagateur d’un champ scalaire sans masse dans dont les deux solutions indépendantes sont connues. La solution de l’équation (5.64) peut s’écrire ensuite :
| (5.67) |
et on peut vérifier que cette solution est consistante avec la troisième équation (5.66). Notons que ces mêmes équations auraient pu être trouvées plus rapidement en utilisant l’opérateur du mouvement dans la jauge de Lorentz, et étant indépendants de jauge.
On arrive au point délicat. Un couple de solutions indépendantes à l’équation de Klein-Gordon (5.63) est donné au moyen de fonctions hypergéométriques selon
| (5.68) | |||||
| (5.69) |
Ces solutions pour la fonction à deux points ne sont bien définies que sur un espace Euclidien ou pour une séparation de genre espace entre les deux points sur un espace Lorentzien, c’est-à-dire que ces solutions sont analytiques pour . La première solution est régulière et naturellement prolongeable en dans les zones de genre temps, par contre la seconde solution est singulière sur le cône de lumière en et possède une coupure dans les zones de genre temps. La prescription habituelle pour la fonction à deux points dans qu’on peut trouver dans [54, 55] sélectionne le vide quantique dit "Euclidien" qui exige tout d’abord que la fonction à deux points corresponde, à l’origine (), à la fonction à deux points de l’espace plat, ce qui semble naturel puisque deux points infiniment proches ne doivent pas ressentir les effets de courbure. La prescription du vide “Euclidien” exige de plus que la fonction à deux points décroisse le plus vite possible à l’infini spatial sur les bords de , en . Cette seconde condition de la prescription sélectionne donc la solution singulière pour la fonction à deux points : , où la normalisation est obtenue par la première condition . Par exemple pour dimensions, la fonction à deux points Euclidienne est donc [54]
| (5.70) | |||||
| (5.71) |
La fonction de Green retardée est ensuite obtenue dans la littérature [55] selon la prescription suivante : elle est proportionnelle au commutateur et donc correspond au saut à travers la coupure , où on a omis les indices tensoriels pour ne pas alourdir les notations. La question est pourquoi ce choix particulier de vide quantique ? En fait ce choix de vide est relié aux conditions au bord de , nécessaires pour construire une théorie quantique de champs cohérente dans . L’espace n’est pas globalement hyperbolique (contrairement à l’espace Minkowski ou de Sitter), cela peut être admis en remarquant que l’infini spatial de (bord de ) peut être atteint en un temps fini, ainsi de l’information inconnue venant du bord peut affecter le cône de lumière futur. Dans [56] les auteurs ont montré qu’une théorie quantique des champs n’était bien définie sur l’espace qu’à condition de préciser des conditions au bord de , notamment celles qui conduisent à la prescription énoncée plus haut. Cependant la fonction de Green retardée est un objet classique qui ne dépend pas d’un choix de vide quantique (c’est le commutateur dans un cadre quantique). On doit donc pouvoir redémontrer quelle est la prescription à adopter pour la fonction de Green retardée sans faire appel à ces arguments quantiques. Notamment on va essayer de trouver des arguments classiques dans la section 5.2 montrant pourquoi le propagateur retardé du graviton dans ne sélectionne que la solution singulière dans (5.68).
5.2 Propagateur retardé (ébauche)
Cette section est une ébauche de démonstration classique (non quantique) de la prescription à adopter pour construire la forme retardée du propagateur covariant du graviton dans , qui un objet classique.
5.2.1 Méthode de construction
Chaque étape pour construire le propagateur retardé est donnée dans cette section pour le cas scalaire. En effet le propagateur tensoriel complet du graviton étant essentiellement déterminé à partir de la fonction qui n’est rien d’autre qu’un champ scalaire canonique sans masse dont l’équation du mouvement est l équation de Klein-Gordon (5.63), la généralisation au cas tensoriel est immédiate. Nous pouvons résumer la méthode en trois étapes :
-
—
L’équation de Klein-Gordon homogène pour le propagateur scalaire dans a deux solutions indépendantes. L’une, , est régulière sur le cône de lumière ( ou ), l’autre, , est singulière sur le cône de lumière
(5.72) De plus la solution singulière est bien définie seulement dans les zones de genre espace (c’est-à-dire à l’extérieur des cônes de lumière passé et futur) ou pour des distances Euclidiennes, i.e
(5.73) Afin d’obtenir le propagateur Lorentzien complet, on doit prolonger analytiquement la solution singulière dans la zone de genre temps (). Il y a deux possibilités. La continuation analytique peut être réalisée dans le demi-plan complexe supérieur ou dans le demi-plan complexe inférieur, de telle sorte que dans la zone de genre temps il y a trois solutions indépendantes de l’équation homogène : la solution régulière et les deux solutions singulières analytiquement prolongées de part et d’autre de la coupure . Ces deux différentes solutions singulières deviennent dégénérées dans la zone de genre espace :
(5.74) (5.75) -
—
En imposant ensuite que le propagateur retardé classique soit causal (i.e zéro dans les zones de genre espace), on trouve qu’une façon naturelle de répondre à la causalité est de conclure pour la solution singulière que
(5.76) et la causalité pour la solution régulière demande de la tronquer par une fonction . Finalement
(5.77) est le candidat le plus général qui soit maintenant causal et bien défini dans la zone de genre temps. Notons que cette prescription causale pour la partie singulière est une façon analytique de la tronquer en évitant l’utilisation d’une fonction . Une fois que nous seront convaincus que la partie régulière ne participe pas à la construction de la forme retardée, nous comprendrons que cette prescription pour la partie singulière peut être généralisée par abus à la fonction à deux points complète, c’est-à-dire qu’elle peut être appliquée également à la partie régulière, faisant disparaître cette dernière de la forme retardée du propagateur.
-
—
La dernière étape est de déterminer les coefficients et dans (5.77). On utilise pour cela les deux conditions suivantes :
-
1.
La source de la fonction de Green est localisée à l’origine (séparation nulle entre les deux points),
-
2.
on doit retrouver le propagateur de Minkowski à l’origine.
La seconde condition peut être utilisée pour la normalisation du propagateur. La première condition va déterminer la combinaison correcte de et . Cette première condition nous dit que, excepté à l’origine, l’opérateur appliqué au propagateur doit donner zéro sur le cône de lumière
(5.78) où est une fonction test et sont les coordonnées nulles du cône de lumière (voir appendice 5.B). L’intégration dans (5.78) est effectuée sur le cône de lumière, en dehors de l’origine, i.e dans la boite infinitésimale et (). En dimension paire d’espace-temps, la singularité en est isolée de sorte que le théorème des résidus sera utilisé dans le calcul de (5.78). En dimension impaire, il y a une coupure en donc une approche différente doit être adoptée dans ce cas. Le résultat de ce calcul sera que seul le coefficient , devant la partie singulière de , doit être non-nul pour que la condition (5.78) soit vérifiée. La conclusion immédiate sera que la prescription pour la forme retardée du propagateur est , ou plus généralement, puisque la partie régulière disparait de toute façon dans cette prescription :
avec la solution homogène Euclidienne bien définie dans la zone de genre espace. Cela prouvera que la prescription dans l’espace est la même que dans l’espace Minkowski.
-
1.
Dans la section 5.2.1 nous rendons explicite la construction du propagateur retardé en répétant les trois étapes décrites au-dessus et en calculant (5.78) par intégration de contour dans le plan complexe sur les coordonnées nulles du cône de lumière, achevant ainsi la démonstration de la prescription à adopter pour la forme retardée du propagateur du graviton dans .
5.2.2 Démonstration explicite
En toute dimension le propagateur scalaire sans masse dans satisfait l’équation
| (5.79) | |||||
| (5.80) |
en dehors de l’origine. C’est la même équation dans le cas tensoriel pour . On trouve plus commode de ré-écrire cette équation en fonction de la variable comme une équation hypergéométrique
| (5.81) |
dont la solution générale, définie dans la zone de genre espace ou Euclidienne , peut s’écrire dans une forme adaptée à la parité de la dimension d’espace-temps
| (5.82) | |||||
| (5.83) |
La constante est la solution régulière et la solution sous le coefficient est singulière sur le cône de lumière et non-définie à l’intérieur (zones de genre temps) : la coupure est en effet , ou de façon équivalente , puisque, pour pair, la solution singulière contient des fonctions logarithme et puissance entières négatives en et, pour impair, des fonctions puissances demi-entières négatives en .
D’après la seconde étape de la section 5.2.1, nous devons proplonger analytiquement la solution singulière des Euclidiens aux Lorentziens, ou dit autrement des zones de genre espace (extérieur du cône de lumière ) aux zones de genre temps (intérieur du cône de lumière ). Il y a deux continuations analytiques : dans le demi-plan complexe supérieur et dans le demi-plan complexe inférieur. Nous avons vu que la causalité implique d’écrire le propagateur complet Lorentzien et causal comme (par exemple pour impair) :
| (5.84) |
La dernière étape est de déterminer les coefficients et . Un moyen possible est d’appliquer la première condition de la section 5.2.1 : la source de la fonction de Green est localisée à l’origine seulement. On a donc, excepté à l’origine,
| (5.85) |
où est une fonction test et l’intégration est effectuée dans la boite infinitésimale et sur le cône de lumière, hors origine. sont les coordonnées du cône de lumière définies dans l’appendice 5.B et elles correspondent à . Dans ces coordonnées, l’opérateur d’Alembertien s’écrit
| (5.86) |
où vient de la géométrie . Montrons tout d’abord que la partie régulière de la fonction de Green retardée ne suffirait pas à elle-seule à satisfaire la condition exposée au-dessus puisque
| (5.87) | |||||
| (5.88) | |||||
| (5.89) |
d’après l’expression de . Donc sur le cône de lumière lorsque . Il y a une fonction avec son support sur le cône de lumière.
Nous allons voir que la partie singulière de , i.e la fonction causale sous , vérifie systématiquement la condition (5.85) en n’importe quelle dimension, de sorte la conclusion immédiate sera que nécessairement. On distingue pour la preuve le cas en dimension paire et le cas en dimension impaire :
Cas pair
Les singularités en correspondent aux singularités en sur le cône de lumière dans la boite (,), puisque . On vérifie la condition (5.85) pour la partie singulière de , i.e , en calculant le résidu. De façon concrète, si on pose , la vérification de (5.85) équivaut à calculer dans les coordonnées
| (5.92) |
où est le contour d’intégration qui évite la singularité en passant par le demi-plan complexe supérieur et est le contour d’intégration qui évite la singularité en passant par le demi-plan complexe inférieur. L’intégrand, dans le cas pair, possède une singularité isolée , tel qu’on le verra un peu plus bas, donc on peut refermer le contour et ré-écrire (5.92) comme
| (5.93) | |||||
| (5.94) |
où est le contour d’intégration encerclant la singularité . Ensuite, par le théorème de Cauchy, l’expression se réduit à
| (5.95) |
En notant que (formule 15.2.8 dans [57])
| (5.96) | |||||
| (5.97) |
l’expression devient
| (5.98) | |||||
| (5.99) | |||||
| (5.100) | |||||
| (5.101) |
parce que le résidu ne dépend pas de .
On conclut que et que le propagateur retardé scalaire dans est, pour pair,
| (5.103) | |||||
Par exemple, en dimensions,
| (5.104) | |||||
| (5.105) | |||||
| (5.106) |
Le coefficient de normalisation est ensuite déterminé par la seconde condition en comparant le propagateur retardé dans au propagateur retardé dans Minkowski proche de l’origine ( ou ). La généralisation au cas tensoriel, c’est-à-dire le propagateur retardé physique du graviton dans ( pair) est donc
| (5.107) | |||||
| (5.108) |
avec donné par (5.103). Et est déduit de à partir de (5.67).
Cas impair
De nouveau on veut vérifier (5.85) pour la partie singulière de , i.e . En posant , la vérification de (5.85) équivaut à calculer, dans les coordonnées ,
| (5.111) |
où est le contour d’intégration qui évite la singularité en passant par le demi-plan complexe supérieur et est le contour d’intégration qui évite la singularité en passant par le demi-plan complexe inférieur. L’intégrand, dans le cas impair, possède une coupure en , à cause des puissances demi-entières négatives, donc on ne peut refermer le contour que sur la gauche de la singularité où , et ré-écrire (5.111) comme
| (5.112) | |||||
| (5.113) |
où est le contour en "trou de serrure" ("keyhole contour" en anglais) autour de la coupure . De plus, par théorème de Cauchy, l’expression se réduit à
| (5.114) |
On a de plus que (formule 15.2.3 dans [57])
| (5.115) | |||||
| (5.116) |
Donc on a affaire au même intégrand que pour le cas pair (éqn. (5.96)), mais le contour d’intégration est différent :
| (5.117) |
La démonstration dans le cas impair est en progrès.
Annexe 5.A Formules algébriques utiles
Dans cet appendice, en utilisant la forme explicite de l’invariant de séparation
en fonction des coordonnées de avec la métrique globale nous calculons quelques formules algébriques utilisées dans le chapitre.
| (5.119) | |||||
| (5.120) | |||||
| (5.121) | |||||
| (5.122) | |||||
| (5.123) |
puis
| (5.125) | |||||
| (5.126) | |||||
| (5.127) | |||||
| (5.128) | |||||
| (5.129) |
Annexe 5.B Métrique dans les coordonnées du cône de lumière
On démarre avec la métrique globale
| (5.130) |
On calcule
| (5.131) | |||||
| (5.132) | |||||
| (5.133) |
Donc on a et
| (5.134) |
De (5.134) on déduit facilement
| (5.135) |
d’où
| (5.136) |
En posant and , on obtient
| (5.137) |
En posant ensuite and tel que
| (5.138) |
on obtient finalement
| (5.139) |
Chapitre 6 Reconstruction en espace réel des effets de lentille gravitationnelle sur le CMB
Dans ce dernier chapitre nous traitons un sujet en cosmologie standard plutôt différent de la majeure partie de cette thèse, consacrée principalement à la cosmologie branaire, mais auquel nous nous sommes intéressés en parallèle. Il s’agit d’un travail effectué en collaboration avec Martin Bucher de l’Université Paris-Sud en France et Kavilan Moodley de l’Université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ce travail est en progrès et devrait être publié bientôt sur les archives : CMB lensing reconstruction in real space, Martin Bucher, Kavilan Moodley and Mathieu Remazeilles.
Nous utiliserons l’abréviation anglaise CMB (Cosmic Microwave Background) pour désigner le rayonnement du Fond Diffus Cosmologique. Le CMB est un rayonnement de photons qui nous parvient de la surface de dernière diffusion, c’est-à-dire au moment du découplage entre les photons et les électrons lorsqu’ils ne diffusent plus ensemble (époque de la recombinaison, redshift , température ). Les photons se propagent alors librement jusqu’à nous (). Ce rayonnement du CMB est donc l’image la plus ancienne de l’Univers observable dont on dispose. Il nous apparait aujourd’hui à des fréquences micro-onde comme un rayonnement de type corps noir à la température , le refroidissement et la basse fréquence du rayonnement aujourd’hui étant dûs à l’expansion de l’Univers. Ce rayonnement du ciel a d’abord été détecté par inadvertance comme un bruit micro-onde par les ingénieurs Penzias et Wilson en 1965, puis détecté comme un corps noir par le satellite COBE en 1992. En fait ce rayonnemnt n’est pas totalement un corps noir mais présente des anisotropies de température , observables lorsqu’on mesure le spectre des corrélations angulaires de température entre deux points dans le ciel séparés d’un angle (bidimensionnel). Ces anisotropies de température sont directement reliées aux perturbations cosmologiques au moment du découplage [25], et donc aux conditions initiales de l’Univers produites à la fin de l’Inflation. En ce sens les spectres de puissance des anisotropies de température s’avèrent être un outil observationnel puissant pour sonder la physique de l’Univers primordial et notamment tester les théories d’Inflation. Les anisotropies de température ont été détectées par le satellite WMAP en 2003. Comme tout rayonnement électromagnétique, le rayonnement du CMB est polarisé et présente donc de la même façon des anisotropies de polarisation. Il est pratique et d’usage de décomposer les anisotropies de polarisation sur une base de modes et (notés comme tel en référence aux propriétés de parité scalaire ("électrique") pour le mode E et pseudo-scalaire ("magnétique") pour le mode B).
Les grandes structures dans l’Univers (amas de galaxies), présentes à un redshift , crééent un potentiel gravitationnel non-homogène (dit potentiel de lentille) et affectent donc le trajet des photons par un effet de lentille gravitationnelle faible (déviation de la lumière par un corps massif en relativité générale). Ce potentiel de lentille affecte donc les spectres primordiaux d’anisotropies de température T et de polarisation et et biaise donc l’image réelle de l’Univers primordial apparaissant aujourd’hui. Il est donc indispensable de "nettoyer" les spectres d’anisotropies observés et contaminés par les effets de lentille gravitationnelle faible ("weak gravitationel lensing" en Anglais) afin de restituer les spectres primordiaux. Un moyen de parvenir à cela est de reconstruire le champ de lentille gravitationnelle (où ) du CMB à l’aide d’estimateurs statistiques. On peut en effet construire des estimateurs quadratiques de à partir des anisotropies de température et/ou de polarisation observés, dans l’espace harmonique (équivalent à l’espace de Fourier si le ciel était plat au lieu d’être sphérique). L’objectif est bien-entendu de construire un estimateur statistique efficace et optimal malgré qu’on soit soumis à plusieurs limitations dûes aux capacités des outils d’observation (résolution, sensibilité, surface du ciel couverte,un seul point de vue d’observation, …) et aux avant-plans dans l’Univers (points sources, Voie Lactée, …).
Dans ce travail nous tentons de reconstruire le champ de lentille gravitationnelle du CMB directement en espace réel, en montrant qu’on ne perd que très peu d’information statistique lorsqu’on utilise nos estimateurs statistiques de courte portée angulaire sur la sphère céleste et en espace réel à la place des estimateurs habituels construits dans l’espace harmonique. Ces derniers sont non-locaux et nécessitent en principe une analyse couvrant tout le ciel en entier, sans coupures ni excisions. Étant donné que toute l’information pertinente des effets de lentille réside aux petites échelles angulaires, proches de l’échelle de résolution des cartes CMB du ciel, les champs de dilatation et de cisaillement (champs qui sont directement reliés aux observations de manière locale, contrairement au champ de déflection angulaire ou au potentiel de lentille lui-même), créés par le potentiel de lentille, peuvent être reconstruits au moyen de combinaisons quadratiques impliquant seulement des pixels faiblement séparés dans le ciel. Bien que la reconstruction théorique des effets de lentille est naturellement plus abordable en espace harmonique, les méthodes en espace réel développées ici (section 6.3) ont l’avantage d’être plus rapides à implémenter numériquement et certainement plus utiles lorsqu’on veut analyser des cartes réalistes du CMB contenant la coupure de la Voie Lactée ou d’éventuelles petites excisions pour soustraire les différents points sources. Nous commençons par rappeler brièvement le formalisme utilisé pour décrire les anisotropies du CMB en section 6.1, puis nous expliquons les effets de lentille gravitationnelle sur les spectres d’anisotropies du CMB en espace harmonique à la section 6.2, enfin nous présentons une ébauche de notre travail sur la reconstruction des effets de lentille (dilatation et cisaillement) en espace réel à la section 6.3.
On notera abusivement les fluctuations anisotropes de température du CMB dans le ciel bidimensionnel dans la direction . Les anisotropies du champ de polarisation du CMB sont décrites par les modes et . Pour décrire les effets de lentille sur le CMB, on utilisera souvent l’approximation de ciel plat qui reste une approximation assez précise pour toutes les échelles angulaires couvertes par les instruments de mesure sauf pour les plus grandes échelles angulaires, où la courbure de la sphère céleste ne joue plus un rôle négligeable.
6.1 Un peu de formalisme du CMB
Les anisotropies du CMB sont liées aux perturbations cosmologiques provenant elles-mêmes des fluctuations quantiques de l’inflaton. En ce sens les anisotropies sont des variables stochastiques et ce sont donc leurs propriétés statistiques que l’on cherche à étudier. La plupart des modèles d’Inflation prédisent des fluctuations gaussiennes, dans ce cas toute l’information statistique est contenue dans la fonction de corrélation à deux points
| (6.1) |
par exemple pour les anisotropies de température du CMB. Ici est l’angle bidimensionnel entre les deux points du ciel observés dans les deux directions et et défini par . L’hypothèse d’isotropie de l’Univers entraine l’isotropie statistique des variables fluctuantes donc que la fonction de corrélation ne dépend que de l’écart angulaire entre les deux points. On peut, de façon conjuguée, décrire les anisotropies de température sur la sphère céleste dans l’espace des harmoniques sphériques selon
| (6.2) |
Le spectre de puissance des anisotropies de température est donc
| (6.3) |
Il est pratique de décomposer la fonction de corrélation angulaire sur la base des polynômes de Legendre selon afin de réduire
| (6.4) |
à l’aide de la formule à
| (6.5) |
Les coefficients constituent le spectre de puissance angulaire et ne dépendent que du paramètre appelé multipôle et relié à l’ecart angulaire entre deux points du ciel selon , si est en degrés. Le monopôle correspond à la température moyenne du CMB : . Le dipôle est du à l’effet Doppler créé par notre mouvement, ou plutôt par le mouvement de la Voie Lactée. Sur les cartes d’anisotropies du CMB est représenté le spectre de puissance RMS ("root mean square" en Anglais), défini par .
Beaucoup de contraintes sur la physique de l’Univers primordial peuvent être obtenues à partir de l’analyse de ces spectres d’anisotropies du CMB. Nous ne les détaillerons pas ici, mais par exemple on peut montrer que la position des pics acoustiques dans le spectre d’anisotropies de température, notamment à , exige que les conditions initiales de l’Univers issues de l’Inflation soient adiabatiques. Les courbes des spectres d’anisotropies ont également permis de contraindre la valeur des paramètres cosmologiques tels que, par exemple, la densité baryonique, la densité d’énergie noire, de neutrinos, le paramètre de Hubble, … [60].
Dans la suite nous utiliserons l’approximation de ciel plat, qui est une approximation robuste pour la plupart des échelles angulaires couvertes par les instruments de mesure mais critique aux plus grandes échelles angulaires, où la courbure de la sphère céleste n’est plus négligeable. Dans l’approximation de ciel plat, on peut développer les anisotropies de température sur la base de Fourier selon
| (6.6) |
où l’angle bidimensionnel a cette fois la dimension d’une longueur, et le moment bidimensionnel a la dimension de l’inverse d’une longueur. Notons que, la fluctuation de température étant un champ réel, on a . Par isotropie statistique la fonction de corrélation à deux points ne dépend que de la séparation entre les deux points
| (6.7) |
Il s’ensuit
| (6.8) | |||||
| (6.9) | |||||
| (6.10) |
où on a effectué le changement de variable et . En utilisant la décomposition en fonctions de Bessel, , on définit le spectre de puissance des anisotropies dans l’approximation ciel plat selon
| (6.11) |
Le spectre de puissance des anisotropies du CMB est statistiquement isotrope et donc diagonal en :
| (6.12) |
Remarquons que . La quantité RMS sans dimension pour le spectre est dans l’approximation ciel plat : , à comparer avec l’expression en ciel sphérique.
En pratique, on n’observe qu’une seule réalisation statistique de notre
Univers observable, et donc dans une hypothèse d’ergodicité spatiale, les
spectres observés sont obtenus à partir d’une moyenne spatiale
sur tout le ciel alors que les théoriques correspondent une moyenne
statistique (en fait c’est la variance cosmique) de variables gaussiennes
distribuées selon une loi de probabilité gaussienne
. On utilise donc généralement l’estimateur statistique
sans biais () suivant :
| (6.13) |
pour estimer la variance cosmique .
Bien-entendu tout le formalisme présenté dans cette section pour décrire les anisotropies de température est identique pour les anisotropies de polarisation et . Si l’on note le spectre d’anisotropies de température, on peut également obtenir les spectres d’anisotropies et ainsi que les corrélations croisées , et . Notons que pour des raisons de parité, les perturbations scalaires ne peuvent engendrer que des modes (qui possède la symétrie scalaire), ce qui indique que la détection de modes (qui possèdent la symétrie pseudo-scalaire), à travers l’observation du spectre (non-encore détecté), sera le signe de l’existence d’ondes gravitationnelles (perturbations tensorielles) produites lors de l’Inflation, et donc un test décisif pour les modèles d’Inflation. On pourrait alors mesurer le rapport tenseur-scalaire et magnitude du potentiel de slow-roll dans l’Inflation à un champ (échelle d’énergie de l’Inflation).
6.2 Effets de lentille gravitationnelle sur le CMB dans l’approximation de ciel plat
6.2.1 Effets de lentille
La présence de grandes structures, telles que les amas de galaxies dans l’Univers, constitue un avant-plan à sur la ligne de visée entre la surface de dernière diffusion et nous. Ces structures crééent un potentiel gravitationnel qui dévie les géodésiques nulles (ou la trajectoire des photons du CMB). Par conséquent les spectres d’anisotropies du CMB qu’on observe aujourd’hui ont subit des distorsions dûes au potentiel gravitationnel. C’est l’effet de lentille gravitationnelle faible sur le CMB ("CMB weak gravitational lensing" en Anglais). Une revue complète des effets de lentille gravitationnelle sur le CMB a été faite par Challinor et Lewis [61].
Dans le formalisme de la relativité générale, on peut calculer la déflection (vecteur de déplacement sur la sphère céleste) des géodésiques nulles perturbées (trajectoires des photons) à l’ordre linéaire, engendrée par le potentiel gravitationnel [61] :
| (6.14) |
où est la coordonnée radiale et est la distance à la surface de dernière diffusion, est dérivée covariante sur la sphère céleste et ou ou décrit la géométrie spatiale, selon que l’Univers est respectivement fermé () ou ouvert () ou plat () spatialement. On définit le potentiel de lentille comme , de telle sorte que l’angle de déflection sur la sphère céleste s’écrit simplement
| (6.15) |
Dans l’approximation de ciel plat, les fluctuations de température "lentillées" sont donc dont le développement à l’ordre linéaire entraine que le décalage d’anisotropie de température sans et avec lentille est
| (6.16) |
De façon conjuguée, la correction (dûe aux lentilles) à l’anisotropie de température observée est donnée dans l’espace de Fourier (approximation ciel plat) par
| (6.17) |
Les anisotropies de polarisation peuvent être décomposées sur la base des modes et , dans l’approximation de ciel plat :
| (6.18) |
où et donne l’anisotropie de température de la composante polarisée linéairement le long du vecteur Il s’ensuit
| (6.19) |
où est l’angle entre le vecteur et le vecteur Il s’ensuit que le spectre de puissance "lentillé" des anisotropies de température vaut
| (6.20) |
Ici on a supposé implicitement que le potentiel de lentille et l’anisotropie de température intrinsèque (non "lentillée") ne sont pas corrélés. De façon similaire pour la polarisation "lentillée", on a le spectre de puissance suivant :
| (6.22) | |||||
Ici on a supposé que Au niveau des fonctions de corrélation à deux points, les effets de lentille gravitationnelle distordent donc le spectre de puissance des corrélations (température-température) et mélangent les spectres de puissance des polarisations et , en plus de les distordre. Pour des bas (i.e. dans la limite ), on peut approximer l’intégrale (6.20) par
| (6.23) |
Le fait que cette intégrale ne diverge pas dans l’infrarouge ( possède un pic bien à droite du quadrupôle ) implique que pour le spectre est quasiment un spectre de bruit blanc. Un léger changement de change radicalement l’intégrand; donc dans ce régime est presque constant. Dit autrement, toute la magnitude à bas est dûe à de très faibles lentilles agissant sur les anisotropies du CMB aux grandes échelles angulaires. Le même argument s’applique à cependant la position du pic est décalée par rapport à du fait de l’allure différente du spectre
6.2.2 Reconstruction du potentiel de lentille en espace de Fourier
Nous nous occupons maintenant de la reconstruction du potentiel de lentille en construisant des estimateurs quadratiques optimaux en espace de Fourier. Soit
| (6.24) |
Comme la théorie est gaussienne, les fonctions de corrélations à trois points du type s’annulent lorsqu’on considère le potentiel de lentille comme un champ stochastique gaussien, de façon identique à . Cependant, si nous considèrons le potentiel de lentille du CMB comme fixé, nous trouvons que les fonctions de corrélations "lentillées" (qui impliquent à l’ordre linéaire en des fonctions à trois points ) ne s’annulent plus, et cette propriété peut être exploitée pour reconstruire le champ de lentille en utilisant des estimateurs statistiques quadratiques en (ou et ). On peut développer
| (6.25) | |||||
| (6.26) | |||||
| (6.27) |
Par conséquent,
| (6.28) |
génère une famille continue bidimensionnelle d’estimateurs statistiques pour indexée par Notons que et indexent le même estimateur. Pour éliminer cette redondance, on introduit les coordonnées où et sont les composantes parallèles et perpendiculaires par rapport au vecteur Si on exige on évite le double comptage.111Dans la limite continue on n’a pas besoin de s’inquiéter du bord de ce domaine qui est de mesure zéro. Ci-dessous, dénotera la somme avec Nous recherchons maintenant la combinaison linéaire optimale
| (6.29) |
où les poids satisfont
| (6.30) |
La variance de l’estimateur ci-dessus est
| (6.31) |
où
| (6.32) | |||
| (6.33) | |||
| (6.34) | |||
| (6.35) |
Pour donner du sens à l’expression ci-dessus, on passe à la limite discrète telle que (6.35) devient
| (6.36) |
où est le coté du carré d’observation du ciel dans l’approximation de ciel plat. Soit
| (6.37) |
On trouve que, pour l’estimateur optimal formé des combinaisons linéaires
avec
| (6.38) | |||||
| (6.39) | |||||
| (6.40) |
où, à la dernière ligne, on a utilisé une approximation continue. Les poids optimaux sont donnés par
| (6.41) |
On peut ré-exprimer le résultat (6.40) ci-dessus en fonction d’un spectre de puissance continu pour le bruit de la reconstruction (variance de l’estimateur) :
| (6.42) | |||||
| (6.43) |
Lorsque et (i.e. un bruit blanc), l’expression ci-dessus se simplifie selon
| (6.44) |
Les différents facteurs sont compris comme suit. Le facteur est présent parce que c’est la déformation de cisaillement (et également la dilatation) qui se mesure localement. Pour , on a essentiellement un bruit blanc, parce que c’est surtout l’effet de lentille sur les plus petites échelles de fluctuations, juste en dessous du "cut-off" , qui fournit l’essentiel de l’information. Qualitativement, on peut dire que est détecté en mesurant le spectre de puissance local sur les échelles juste en dessous du "cut-off" et en comparant ce dernier avec le spectre de puissance moyen. Il faut remarquer que et ne sont pas directement mesurables. On ne peut pas mesurer le déplacement absolu parce que, la statistique étant invariante par translation, nous ne savons pas à quoi devraient ressembler les anisotropies "non-lentillées" sous-jacentes. Par conséquent, le rapport signal sur bruit carré de la carte reconstruite est donné par
| (6.45) |
À l’aide d’un “broad binning” (i.e. avec ), on peut améliorer le rapport signal sur bruit au carré pour la détection des effets de lentille selon
| (6.46) |
Estimons maintenant dans quelles proportions le bruit d’un spectre générique (de type loi de puissance) pour le fond “non-lentillé” diffère de l’estimation précedente qui supposait un spectre de type bruit blanc. Bien-sûr, lorsque le spectre contient des zéros, on peut s’attendre à ce que le dénominateur s’annule et la fonction diverge. Mais supposons pour le moment un spectre en loi de puissance. Si nous comparons la magnitude de (le seul terme qui apparait dans le cas du bruit blanc) avec le terme donnant la correction dominante au spectre de bruit blanc on trouve que c’est de l’ordre de pour le cas d’une loi de puissance de la forme Par conséquent, quand l’indice spectral local est d’ordre un, on s’attend à ce que le calcul de bruit blanc effectué ci-dessus soit corrigé d’un facteur d’ordre 1.
Finalement on modifie l’équation (6.43) pour inclure le bruit du détecteur et la largeur finie du faisceau selon
| (6.47) |
Ici, les incluent un facteur d’atténuation du profil du faisceau de la forme Avec ces modifications, le cut-off est donné par le profil du faisceau et le bruit du détecteur correspond à un cut-off régulier. Le facteur sert à compenser le double comptage.
De le même façon on peut construire un estimateur quadratique en espace de Fourier basé sur l’effet de lentille transformant le mode mode en mode .
| (6.48) |
Avec une sensibilité suffisante des détecteurs (i.e. ), cet estimateur devient particulièrement puissant grâce au facteur par comparaison à un estimateur construit à partir des corrélations , avec approximativement la même résolution angulaire. Pratiquement tout le signal peut être attribué sans ambiguité aux effets de lentille, sans risque de confusion avec le signal intrinsèque “non-lentillé” bien plus faible. Deux autres estimateurs peuvent être construits de la même façon en utilisant les combinaisons Pour former l’estimateur quadratique optimal, pour chaque on peut construire les estimateurs où les indices décrivent les combinaisons et Il n’est pas nécessaire d’inclure la combinaison parce que cette combinaison n’intervient qu’au deuxième ordre en
6.3 Reconstruction en espace réel de la dilatation et du cisaillement des cartes du CMB (ébauche)
Nous avons vu à la section 6.2 qu’au niveau des fonctions à deux points, l’effet de lentille gravitationnelle déforme les spectres des corrélation TT (température-température) et mélange les spectres de corrélation EE et BB (polarisation) en plus de les déformer. Les effets de lentille génère en fait des non-Gaussianités se manifestant dans les fonctions de corrélations à plus de points. Au niveau des fonctions à trois points par exemple, contient la fonction à trois points ( désigne la température non-lentillée) qui ne s’annule plus si l’on considère le potentiel de lentille comme un champ fixe, et non plus aléatoire. Cette propriété a été exploitée à la section 6.2 pour reconstruire le champ de lentille au moyen d’estimateurs quadratiques en (ou et ) dans l’espace harmonique (ou de Fourier dans l’approximation du ciel plat).
Beaucoup d’efforts ont été dépensés dans la littérature pour obtenir une reconstruction optimale du potentiel de lentille en espace harmonique. Mais cette méthode présupposait implicitement une couverture totale du ciel sans la coupure galactique, sans les mauvais pixels dûs aux points sources qui devraient normalement être excisés, et sans pondération non-uniforme tenant compte d’une couverture irrégulière mais réaliste du ciel. Pour une reconstruction basée sur la température, il a été montré comment construire un optimateur quadratique optimal dans ce contexte idéalisé, et que l’amélioration gagnée lorsqu’on utilise plutôt un estimateur du maximum de vraisemblance (plus optimal) est marginale [67], parce que la déformation dûe à l’effet de lentille est faible par rapport à la variance cosmique et au bruit de l’expérience (excepté cependant aux très grands ). Pour l’exploitation des anisotropies de polarisation, la situation est différente : à haute sensibilité de l’expérience, le mode de polarisation , dû quasi-exclusivement aux effets de lentille sur le mode , domine le bruit de l’expérience et les corrections d’ordre supérieur de l’estimateur quadratique présentes dans l’estimateur du maximum de vraisemblance ne sont plus négligeables.
Ici nous adoptons une approche en espace réel pour la reconstruction des effets de lentille. Dans les conditions idéales souvent supposées et décrites ci-dessus, cette approche donnerait naturellement le même résultat que l’approche conventionnelle en espace harmonique. Cependant notre intérêt est de construire des estimateurs légèrement non-optimaux, qui sont modifiés de façon à être de courte portée (courtes échelles angulaires), de telle sorte que les coupures, excisions de pixels et couverture non-uniforme du ciel puissent être prises en compte d’une façon simple et flexible. Nous pensons que de tels estimateurs locaux définis dans l’espace réel, non-idéaux mais plus robustes, vont se montrer supérieurs dans la confrontation avec les complications inhérentes aux données réelles.
Nous présentons maintenant les relations entre les différentes descriptions de l’effet de lentille et nous calculons la déformation des anisotropies dans l’espace réel. La déformation par effet de lentille des anisotropies du CMB sur la surface de dernière diffusion peut être décrite de trois manières : par le potentiel de lentille , par le champ de déflection ou par les trois composantes du tenseur de cisaillement
| (6.49) |
Même si on avait accès au ciel entier, les descriptions et souffrent d’une certaine ambiguité. ne peut pas être distingué de et le champ vectoriel ne peut être mesuré qu’à une constante de translation près (ou une rotation près si on prend en compte la courbure du ciel). Si on observe seulement le spectre de puissance du CMB, un morceau du ciel et son translaté ont nécessairement la même probabilité à cause de la propriété d’isotropie. Par contre, la dilatation et le cisaillement (qui sont les gradients du champ vectoriel de translation) sont localement bien définis. Cela se voit facilement en considérant l’effet d’une déformation constante décrit par la matrice de déformation reliant les coordonnées angulaires actuellement observées sur la sphère céleste pour un point de la surface de dernière diffusion, aux coordonnées qu’aurait ce même point en l’absence d’effet de lentille222Dans la suite, sauf indication contraire, on emploiera l’approximation du ciel plat où le vecteur représente un point sur la sphère céleste “aplatie” et represente un nombre d’onde. Par moments des sommations sur seront aussi utilisées.. On a avec Nous employons l’approximation du ciel plat et supposons que les déformations sont petites et donc qu’une approximation à l’ordre linéaire est acceptable. On notera de façon générique le spectre de puissance primordial (c’est-à-dire sans les effets de lentille) dans l’espace de Fourier pour n’importe quelle fonction de correlation à deux points.
Calculons la déformation des spectres de puissance par dilatation et cisaillement. On ne cherchera pas la rigueur dans la démonstration qui suit mais plutôt les arguments principaux qui amènent au résultat attendu.
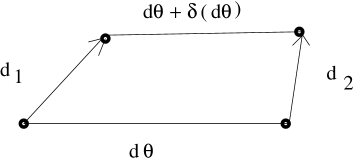
Si deux points et de la sphère céleste sont déplacés par effet de lentille selon les vecteurs de déflection et respectivement, alors, d’après le trapèze (Fig. 6.1), on a que la déformation de l’écart entre les deux points vaut . Dans la limite de petites déflections et de points proches, et puisque la déflection est le gradient du potentiel de lentille (, ), on peut re-écrire
| (6.50) | |||||
| (6.51) |
où est le tenseur de cisaillement et où on somme sur les indices répetés (). La déformation du spectre de puissance dans l’espace réel vaut donc
| (6.52) | |||||
| (6.53) | |||||
| (6.54) |
En supposant que la dilatation et le cisaillement varient lentement et en remarquant que la transformée de Fourier de vaut , on a dans l’espace de Fourier la déformation suivante pour le spectre de puissance
| (6.55) | |||||
| (6.56) | |||||
| (6.57) |
À l’ordre linéaire le spectre de puissance est donc modifié de la façon suivante, préservant l’homogénéité mais pas l’isotropie du processus stochastique sous-jacent:
| (6.58) |
Pour le cas d’un spectre invariant d’échelle (i.e. une loi de puissance de la forme ) il n’y a pas de modifications dans les corrélations qui soit dûe à la composante de dilatation du tenseur de cisaillement. De façon similaire pour un spectre de bruit blanc parfait (i.e. une loi de puissance de la forme ), il n’y a aucune modification venant des composantes de cisaillement pur , dans les corrélations anisotropes à deux points.
Si les composantes de dilatation-cisaillement sont supposées lentement variables, on peut donc construire les estimateurs de , et , en repassant dans l’espace réel, comme suit :
| (6.60) | |||||
| (6.61) |
et de façon similaire, en posant et ,
| (6.63) | |||||
| (6.64) |
où les facteurs de normalisation sont donnés par
| (6.65) | |||||
| (6.66) |
et est l’aire du domaine du ciel considéré.
Les expressions ci-dessus supposent un domaine du ciel spatialement plat, bidimensionnel, d’aire étendue mais finie, et sujet à une déformation linéaire spatialement uniforme. On pourrait considérer un domaine toroidal dans la limite où la période du tore devient extrèmement grande. Il est indispensable de considérer tout d’abord la relation entre ce problème simplifié et le problème réel de reconstruction du champ de lentille pour des cartes du CMB de résolution finie. À cause de la petitesse des déformations des anisotropies du CMB par les lentilles, la situation simplifiée considérée ci-dessus est moins différente qu’on pourrait le penser de la situation réelle où l’on a affaire à un ciel courbe et des champs de dilatation/cisaillement non-uniformes.
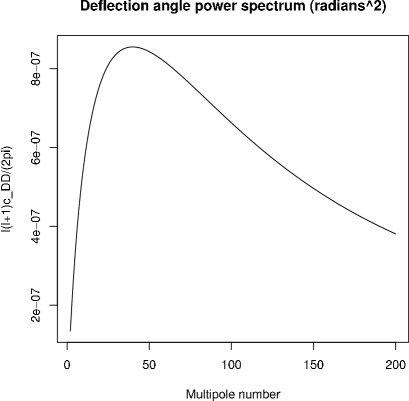
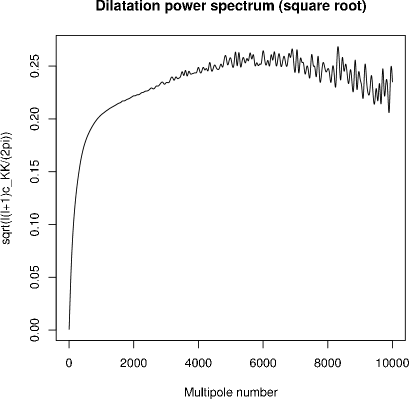
Le tracé le plus à droite de la figure Fig. 6.2 montre le spectre de puissance RMS de la dilatation/cisaillement ("Root Mean Square" en anglais, i.e. ) en fonction du nombre de multipôle, et on observe que pour , la déformation est toujours plus faible qu’environ Cela illustre que les effets de la dilatation/cisaillement se manisfestent en particulier aux très petites échelles angulaires sur les cartes d’anisotropies du CMB.
Pour l’estimateur linéaire idéal (couverture totale du ciel), l’inverse de la variance est
| (6.67) | |||||
| (6.68) |
et pour un estimateur non-idéal avec le vecteur de poids on définit
| (6.69) |
où et avec
| (6.70) |
Le produit scalaire a été défini ici comme suit
| (6.71) |
Ainsi, l’estimateur non-idéal n’est pas biaisé mais sa variance est donnée par
| (6.72) |
La variance de l’estimateur non-idéal (de support fini) est donc toujours plus grande que la variance de l’estimateur idéal excepté dans le cas particulier où
les vecteurs
et sont liés (linéairement dépendants).
Des formules analogues peuvent être obtenues facilement pour et .
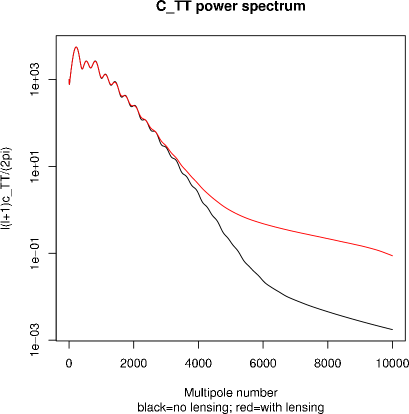

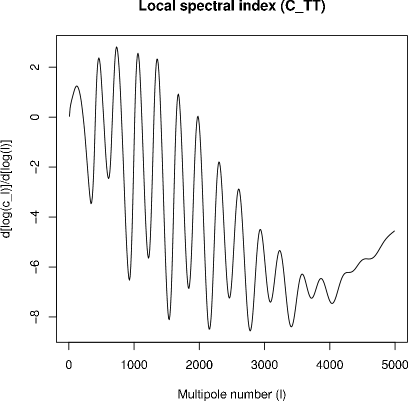
Considérons comment l’information contenue dans l’estimateur idéal est répartie sur les différents multipôles. Sur la figure Fig. 6.3 on a tracé les quantités
| (6.73) |
et , où le bruit de l’expérience est
| (6.74) |
et
Les noyaux idéaux de variance minimum pour les estimateurs et ont leur support nettement piqué sur les petites séparations angulaires, mais leur support s’étend néanmoins jusqu’aux grandes séparations. Nous recherchons maintenant combien d’information est perdue si le support aux grandes séparations est complètement coupé, comme c’est le cas pour notre estimateur non-idéal. La façon quantitative de caractériser cette perte d’information est de se demander de quel facteur la variance de l’estimateur est amplifiée par rapport à la variance de l’estimateur optimal, une fois qu’on a renormalisé notre estimateur "rogné" pour le rendre non-biaisé.
Nous définissons notre estimateur au support tronqué en utilisant la fonction "fenêtre" :
| (6.78) |
qui a la bonne propriété d’être une fonction . Le noyau de l’estimateur de variance minimum couvrant tout le ciel, défini par
| (6.79) |
est donc tronqué selon
| (6.80) |
tel que
| (6.81) |
La variance est alors amplifiée par le facteur où
| (6.82) |
et où on a défini le produit scalaire cette fois selon
| (6.83) |
Nous devons maintenant trouver la façon optimale d’effectuer la troncation de manière à minimiser l’amplification de variance: ce travail est en progrès.
Conclusions
Dans la majeure partie de ce travail de thèse nous avons exploré le problème de l’évolution des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire du type Randall-Sundrum ayant une expansion cosmologique arbitraire. L’objectif était d’obtenir des signatures cosmologiques de la présence éventuelle d’une dimension supplémentaire infinie au moyen de la théorie des perturbations cosmologiques et d’estimer la magnitude des interactions entre la brane et le bulk. Nous avons insisté sur les deux difficultés majeures intervenant dans le problème des perturbations cosmologiques dans un Univers branaire en expansion : d’une part c’est un problème d’ordre technique puisque le mouvement arbitraire de la brane en expansion non-uniforme dans le bulk brise les symétries du problème et rend les équations d’Einstein linéarisées non-séparables pour les perturbations cosmologiques. D’autre part on est confronté à un problème d’ordre plus fondamental qui est celui des conditions initiales inconnues dans le bulk Anti-de Sitter (). Il n’y a pas de conditions initiales naturelles dans pour générer homogénéité et isotropie. Si le premier problème technique peut être en partie résolu de façon numérique, le problème des conditions initiales pour les gravitons du bulk persiste puisque les schémas numériques spécifient nécessairement des conditions initiales particulières dans le bulk pour faire évoluer les perturbations dans le temps. Nous avons proposé une méthode analytique basée sur les fonctions de Green retardées de la brane et du bulk et avons suivi une approche effective quadridimensionelle en considérant les degrés de liberté localisés sur la brane comme un système quantique ouvert couplé à l’environnement composé des gravitons du bulk. Nous avons vu que dans cette perspective quadri-dimensionnelle, les transitions quantiques entre les modes du bulk et ceux de la brane apparaissaient sous la forme de processus de dissipation et de non-localité du point de vue quadri-dimensionnel d’un observateur sur la brane. En partant des propagateurs retardés "nus" (c’est-à-dire sans couplage brane-bulk) de la brane et du bulk , nous avons construit le propagateur retardé effectif sur la brane en resommant les effets de rétroaction du bulk à tous les ordres dans le couplage brane-bulk. Nous avons montré comment les processus de dissipation et de non-localité étaient codés dans ce propagateur effectif, et nous avons reussir à extraire les taux de dissipation effectifs de diverses perturbations de matière sur la brane en appliquant ce calcul aux équations linéarisées d’Einstein exactes dans le formalisme de Mukohyama et pour diverses configurations de champs. Dans l’hypothèse d’une expansion adiabatique de l’Univers (), nous avons trouvé que la perturbation de l’inflaton (champ scalaire en roulement lent sur la brane) se dissipait de façon locale et linéaire dans le facteur de slow-roll, alors que le mode zéro lié du graviton (perturbations tensorielles) se dissipe de façon non-locale et quadratique dans le facteur de slow-roll aux échelles superhorizon et à haute énergie, et donc que la dissipation de la perturbation scalaire domine par rapport à celle de la perturbation tensorielle. Nous avons trouvé aussi que les perturbations adiabatiques d’un fluide parfait sur la brane ne se dissipent pas aux échelles subhorizon.
Au chapitre 5 nous avons présenté le calcul explicite du propagateur retardé covariant du graviton dans . Ce dernier étant un objet classique, nous avons voulu le calculer en utilisant uniquement des considérations classiques basées sur la structure causale de l’espace . Nous avons réussi à faire la démonstration dans le cas d’un espace de dimension paire. Le cas en dimension impaire est en progrès. En dehors de l’intérêt mathématique et technique, le calcul du propagateur retardé du graviton dans est nécessaire pour parfaire la description des processus non-locaux intervenant en cosmologie branaire et que nous avons présentés dans cette thèse.
Dans le dernier chapitre nous avons exposé notre travail sur la reconstruction des effets de lentille gravitationnelle sur le CMB dans une cosmologie standard. Ce travail est encore en progrès mais est bien avancé et devrait déboucher bientôt sur la publication de nos résultats. À partir des spectres d’anisotropies observés et contaminés par les lentilles, nous reconstruisons le champ de dilatation/cisaillement directement en espace réel à l’aide d’estimateurs quadratiques de courte portée angulaire, puisque l’information sur l’effet de lentille se situe principalement aux courtes échelles angulaires sur la sphère céleste. Les méthodes locales en espace réel que nous développons dans ce travail présentent l’avantage d’être plus efficaces pour traiter des cartes réalistes du CMB contenant la coupure galactique et de nombreuses petites excisions dûes aux point-sources qu’il faut exclure. La méthode employée ici est générale et peut s’appliquer à d’autres non-gaussianities, comme celles provenant des avant-plans ("foregrounds") ou celles issues de scenarios d’Inflation. Dans un futur proche, nous aimerions étendre ce travail de recherche à d’autres non-gaussianités pouvant affecter le rayonnement du CMB.
L’approche analytique, que nous avons développée au chapitre 4, pour traiter l’évolution des perturbations cosmologiques dans des univers branaires en expansion du type Randall-Sundrum est plus générale et peut être appliquée à tout autre théorie de champs en interaction avec des champs localisés sur un bord ou une sous-variété. Nous pensons notamment au modèle branaire Dvali-Gabadadze-Porrati (DGP) [58] qui propose une explication à l’accélération tardive de l’Univers (problème de l’énergie noire) et au modèle branaire ekpyrotique [59] de cosmologies à rebonds qui propose une alternative à l’Inflation pour le problème des conditions initiales de l’Univers. Nous aimerions mettre en évidence les signatures cosmologiques de tels modèles cordistes au moyen de la théorie des perturbations cosmologiques en se plaçant dans des géométries de fond dépendantes du temps pour la brane. Nous espérons pouvoir mener à bien ces recherches dans un avenir proche.
Références
- [1] M. B. Green, J. H. Schwarz, E. Witten, Superstring theories, Vol.1 et 2, Cambridge University Press, 1987.
- [2] T. Kaluza, “On the problem of unity in physics,” Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin (math. Phys.) 1921, 996-972, 1921.
- [3] O. Klein, “Quantum theory and five-dimensional relativity,” Z. Phys. 37, 895-906, 1926.
- [4] P. Hoava and E. Witten, “Heterotic and type I string dynamics from eleven dimensions,” Nucl. Phys. B460 506-524, 1996. [hep-th/9510209].
- [5] P. Hoava and E. Witten, “Eleven dimensional supergravity on a manifold with boundary,” Nucl. Phys. B475 94-114, 1996. [hep-th/9603142].
- [6] A. Linde, “Chaotic Inflation,” Phys. Lett. B129, 177, 1983.
- [7] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos and G. Dvali, “The hierarchy problem and new dimensions at a millimeter,” Phys. Lett. B429, 263, 1998. [hep-ph/9803315].
- [8] L. Randall and R. Sundrum, “A Large Mass Hierarchy From a Small Extra Dimension,” Phys. Rev. Lett. 83, 3370 (1999). [hep-ph/9905221].
- [9] L. Randall and R. Sundrum, “An Alternative to Compactification," Phys. Rev. Lett. 83, 4690 (1999). [hep-th/9906064].
- [10] R. M. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, 1984.
- [11] W. D. Goldberger and M. B. Wise, “Modulus stabilization with bulk fields”, Phys. Rev. Lett 83, 4922-4925 (1999). [hep-th/9907447].
- [12] N. Deruelle, “Linearized gravity on branes: From Newton’s law to cosmological perturbations”, (2003). [gr-qc/0301036].
- [13] J. Garriga and T. Tanaka, “Gravity in the Randall-Sundrum Brane World,” Phys. Rev. Lett. 84, 2778 (2000). [hep-th/9911055].
- [14] N. Deruelle, “Cosmological Perturbations of an Expanding Brane in an Anti-de Sitter Bulk: A Short Review,” Astrophys. Space Sci. 283:619-626 (2003). [gr-qc/0301035].
- [15] D. J. Kapner, T. S. Cook, E. G. Adelberger, J. H. Gundlach, B. R. Heckel, C. D. Hoyle and H. E. Swanson, “Tests of the graviational inverse-square law below the dark-energy length scale”, Phys. Rev. Lett. 98:021101 (2007).
- [16] D. Langlois, R. Maartens and D. Wands , “Gravitational Waves from Inflation on the Brane,” Phys. Lett. B489, 259 (2000). [hep-th/0006007].
- [17] J. Garriga and M. Sasaki, "Brane-World Creation and Black Holes," Phys. Rev. D62:043523 (2000). [hep-th/9912118]
- [18] A. Karch and L. Randall, “Locally Localized Gravity,” JHEP 0105:008 (2001). [hep-th/0011156].
- [19] A. V. Frolov and L. Kofman, “Gravitational Waves from Brane World Inflation,” (2002). [hep-th/0209133].
- [20] P. Binétruy, C. Deffayet, U. Ellwanger and D. Langlois, “Brane Cosmological Evolution in a Bulk With Cosmological Constant,” Phys. Lett. B477, 285 (2000); P. Binétruy, C. Deffayet and D. Langlois, “Nonconventional Cosmology From a Brane Universe,” Nucl. Phys. B565, 269 (2000); P. Bowcock, C. Charmousis and R. Gregory, “General Brane Cosmologies and their Global Space-Time Structure,” Class. Quant. Grav. 17, 4745 (2000).
- [21] T. Shiromizu, K. Maeda and M. Sasaki, “The Einstein Equations on the 3-Brane World,” Phys. Rev. D 62, 024012 (2000).
- [22] P. J. E. Peebles, Principle of physical cosmology, Princeton University Press, 1993.
- [23] E. M. Lifshitz and I. M. Khalatnikov, “Investigations in relativistic cosmology,” Advances in Physics, Volume 12, pages 185-249 (1963).
- [24] J. M. Bardeen, “Gauge-Invariant Cosmological Perturbations,” Phys. Rev. D 22, 1882-1905 (1980).
- [25] R. K. Sachs and A. M. Wolfe, “Perturbations of a Cosmological Model and Angular Variations of the Microwave Background,”Astrophys. J. 147, 73 (1967).
- [26] D. Langlois, “Brane cosmological perturbations,” Phys.Rev.D62:126012 (2000). [hep-th/0005025].
- [27] C. van de Bruck, M. Dorca, R. H. Brandenberger and A. Lukas, “Cosmological perturbations in brane world theories: Formalism,” Phys.Rev.D62:123515 (2000). [hep-th/0005032].
- [28] A. Riazuelo, F. Vernizzi, D. Steer and R. Durrer, “ Gauge invariant cosmological perturbation theory for brane worlds,” [hep-th/0205220] (2002)
- [29] C. Deffayet, “On Brane World Cosmological Perturbations,” Phys. Rev. D66, 103504 (2002). [hep-th/0205084].
- [30] H. A. Bridgman, K. A. Malik and D. Wands, “Cosmological perturbations in the bulk and on the brane,” Phys.Rev.D65:043502 (2002). [astro-ph/0107245].
- [31] S. Mukohyama, “Gauge Invariant Gravitational Perturbations of Maximally Symmetric Spacetimes,” Phys. Rev. D62, 084015 (2000); S. Mukohyama, “Perturbation of Junction Condition and Doubly Gauge Invariant Variables,” Class. Quant. Grav. 17, 4777 (2000); S. Mukohyama, “Integro-differential Equation for Brane World Cosmological Perturbations,” Phys. Rev. D64:064006 (2001) (Erratum-ibid. D66, 049902 (2002)); S. Mukohyama, “Doubly Covariant Action Principle of Singular Hypersurfaces in General Relativity and Scalar-Tensor Theories,” Phys. Rev. D65, 024028 (2002); S. Mukohyama, “Doubly Covariant Gauge Invariant Formalism of Braneworld Cosmological Perturbations,” hep-th/0202100; S. Mukohyama, “Nonlocality as an Essential Feature of Brane Worlds,” Prog. Theor. Phys. Suppl. 148, 121 (2003).
- [32] H. Kodama, A. Ishibashi and O. Seto, “Brane World Cosmology: Gauge-Invariant Formalism for Perturbation,” Phys. Rev. D62, 064022 (2000).
- [33] K. Koyama, “Late Time Behaviour of Cosmological Perturbations in a Single-Brane Model,” JCAP0409,010 (2004); K. Koyama, D. Langlois, R. Maartens and D. Wands, “Scalar Perturbations from Brane-World Inflation,” JCAP0411,002 (2004).
- [34] C. Deffayet, “Note on the Well-Posedness of Scalar Brane World Cosmological Perturbations,” Phys. Rev. D71, 023520 (2005).
- [35] N. Deruelle, “Cosmological Perturbations of an Expanding Brane in an Anti-de Sitter Bulk: A Short Review,” Astrophys. Space Sci. 283:619-626 (2003).
- [36] P. Binetruy, M. Bucher and C. Carvalho, “Models for the Brane Bulk Interaction: Toward Understanding Brane World Cosmological Perturbations,” Phys. Rev. D70:043509 (2004); M. Bucher and C. Carvalho, “ Linearized Israel Matching Conditions for Cosmological Perturbations in a Moving Brane Background,” Phys. Rev. D71:083511 (2005).
- [37] D. S. Gorbunov, V. A. Rubakov and S. M. Sibiryakov, “Gravity Waves From Inflating Brane or Mirrors Moving in AdS5,” JHEP 0110, 015 (2001).
- [38] T. Kobayashi, H. Kudoh and T. Tanaka, “ Primordial Gravitational Waves in Inflationary Brane World,” Phys. Rev. D68:044025 (2003).
- [39] T. Hiramatsu, K. Koyama and A. Taruya, “Evolution of gravitational waves from inflationary brane world : numerical study of high-energy effects,” Phys.Lett.B578:269-275 (2004).
- [40] T. Hiramatsu, K. Koyama and A. Taruya, “Evolution of gravitational waves in the high-energy regime of brane-world cosmology,” Phys.Lett.B609:133-142 (2005).
- [41] T. Hiramatsu and K. Koyama , “ Numerical Study of Curvature Perturbations in a Brane-World Inflation at High-Energies,” JCAP 0612:009 (2006).
- [42] T. Hiramatsu, “High-energy effects on the spectrum of inflationary gravitational wave background in braneworld cosmology,” Phys.Rev.D73:084008 (2006).
- [43] T. Kobayashi and T. Tanaka, “Quantum-mechanical generation of gravitational waves in braneworld,” Phys.Rev.D71:124028 (2005).
- [44] T. Kobayashi, “Initial Kaluza-Klein Fluctuations and Inflationary Gravitational Waves in Braneworld Cosmology,” Phys. Rev. D73:124031 (2006). [hep-th/0602168].
- [45] S. S. Seahra, “Gravitational Waves and Cosmological Braneworlds: A Characteristic Evolution Scheme,” Phys. Rev. D74:044010 (2006). [hep-th/0602194].
- [46] A. Cardoso, T. Hiramatsu, K. Koyama and S. S. Seahra, “Scalar Perturbations in Braneworld Cosmology,” arXiv:0705.1685[astro-ph].
- [47] K. Koyama, A. Mennim, V. A. Rubakov, D. Wands and T. Hiramatsu, “Primordial Perturbations from Slow-roll Inflation on a Brane,” JCAP 0704:001 (2007).
- [48] K. Koyama, A. Mennim and D. Wands, “Brane-world inflation: Slow-roll corrections to the spectral index,” Phys.Rev.D77:021501 (2008).
- [49] G. D. Starkman, D. Stojkovic and M. Trodden, “Homogeneity, Flatness and ’Large’ Extra Dimensions,” Phys.Rev.Lett.87:231303 (2001) [hep-th/0106143]; G. D. Starkman, D. Stojkovic and M. Trodden, “Large Extra Dimensions and Cosmological Problems,” Phys.Rev.D63:103511 (2001). [hep-th/0012226].
- [50] M. Bucher, “A Brane World Universe from Colliding Bubbles,” Phys.Lett.B530:1-9 (2002). [hep-th/0107148].
- [51] M. Remazeilles, “Dissipation and Nonlocality in a General Expanding Braneworld Universe,” Phys.Rev.D79:043523 (2009). arXiv:0807.4238[hep-th].
- [52] Sasaki M, “Large Scale Quantum Fluctuations In The Inflationary Universe,” Prog. Theor. Phys. 76 1036 (1986); Mukhanov V F, “Quantum Theory Of Gauge Invariant Cosmological Perturbations,’ Sov. Phys. JETP 67 1297 (1988); Mukhanov V F, Feldman H A and Brandenberger R H, “Theory of cosmological perturbations. Part 1. Classical perturbations. Part 2. Quantum theory of perturbations. Part 3. Extensions.,” Phys. Rep. 215 203 (1992).
- [53] S. S. Seahra, “Ringing the Randall-Sundrum Braneworld: Metastable Gravity Wave Bound States,” Phys.Rev.D72:066002 (2005). [hep-th/05011075] ; S. S. Seahra, “Metastable Massive Gravitons from an Infinite Extra Dimension,” Int. J. Mod. Phys. D14:2279-2284 (2005).
- [54] E. D’Hoker, D. Z. Freedman, S. D. Mathur, A. Matusis and L. Rastelli, "Graviton and Gauge Boson Propagators in ," Nucl.Phys.B562:330-352 (1999). [hep-th/9902042].
- [55] B. Allen and T. Jacobson, "Vector Two-Point Functions in Maximally Symmetric Spaces," Commun. Math. Phys. 103 (1986) 669.
- [56] S. J. Avis, C. J. Isham and D. Storey, "Quantum Field Theory in Anti-de Sitter Space-Time,", Phys. Rev. D18 (1978).
- [57] M. Abramowitz and I. A. Stegun, eds., Handbook of Mathematical Functions With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, NBS Applied Mathematics Series 55, National Bureau of Standards, Washington, DC (1964).
- [58] G. R. Dvali, G. Gabadadze and M. Porrati, “ 4-D gravity on a brane in 5-D Minkowski space,” Phys.Lett.B485:208-214 (2000). [hep-th/0005016].
- [59] J. Khoury, B. A. Ovrut, P. J. Steinhardt and N. Turok, “The Ekpyrotic universe: Colliding branes and the origin of the hot big bang,” Phys.Rev.D64:123522 (2001). [hep-th/0103239].
- [60] D. N. Spergel et al. (WMAP Collaboration), “First year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: Determination of cosmological parameters,” Astrophys.J.Suppl.148:175 (2003). [astro-ph/0302209].
- [61] A. Challinor and A. Lewis, “Weak gravitational lensing of the CMB,” Phys. Rept. 429, 1 (2006). [astro-ph/0601594].
- [62] U. Seljak, “Gravitational lensing effect on cosmic microwave background anisotropies: A Power spectrum approach,” Astrophys. J. 463, 1 (1996) (astro-ph/9505109)
- [63] K. Tomita and K. Watanabe, “Gravitational Lens Effect On The Cosmic Background Radiation Due To Nonlinear Inhomogeneities,” Prog. Theor. Phys. 82, 563 (1989)
- [64] F. Bernardeau, “Lens distortion effects on CMB maps,” Astron. Astrophys. 338, 767 (1998) (astro-ph/9802243)
- [65] U. Seljak and C. Hirata, “Gravitational lensing as a contaminant of the gravity wave signal in CMB,” Phys. Rev. D69, 043005 (2004) (astro-ph/0310163)
- [66] C. Hirata and U. Seljak, “Analyzing weak lensing of the cosmic microwave background using the likelihood function,” Phys. Rev. D67, 043001 (2003) (astro-ph/0209489)
- [67] C. Hirata and U. Seljak, “Reconstruction of lensing from the cosmic microwave background polarization,” Phys.Rev.D68:083002 (2003) (astro-ph/0306354)
- [68] K. Benabed, F. Bernardeau and L. Van Waerbeke, “CMB B polarization to map the large scale structures of the universe,” Phys. Rev. D63, 043501 (2001) (astro-ph/0003038)
- [69] A. Cooray and M. Kesden, “Weak lensing of the CMB: Extraction of lensing information from the trispectrum,” New Astron. 8, 231 (2003) (astro-ph/0204068)
- [70] W. Hu and T. Okamoto, “Mass reconstruction with cmb polarization,” Astrophys. J. 574, 566 (2002) (astro-ph/0111606)
- [71] M. Kesden, A. Cooray and M. Kamionkowski, “Weak lensing of the CMB: Cumulants of the probability distribution function,” Phys. Rev. D66,083007 (2002) (astro-ph/0208325)
- [72] A. Cooray, “Lensing reconstruction of primordial cosmic microwave background polarization,” Phys. Rev. D66, 103509 (2002) (astro-ph/0205306)
- [73] A. Cooray, “Weak lensing of the cosmic microwave background: Power spectrum covariance,” Phys. Rev. D65, 063512 (2002) (astro-ph/0110415)
- [74] F. Bernardeau, “Lens distortion effects on CMB maps,” Astron. Astrophys. 338, 767 (1998) (astro-ph/9802243)
- [75] K. Benabed, F. Bernardeau and L. van Waerbeke, “CMB B polarization to map the large scale structures of the universe,” Phys. Rev. D63, 043501 (2001) (astro-ph/0003038)
- [76] Ludovic Van Waerbeke, F. Bernardeau and K. Benabed, “Lensing effect on the relative orientation between the cosmic microwave background ellipticities and the distant galaxies,” Astrophys. J. 540, 14 (2000) astro-ph/9910366
- [77] J. Lesgourgues, L. Perotto, S. Pastor and M. Piat, “Probing neutrino masses with cmb lensing extraction,” Phys.Rev.D73:045021,2006. (astro-ph/0511735)
- [78] N.J. Miller, M. Shimon and B.G. Keating, “CMB Beam Systematics: Impact on Lensing Parameter Estimation,” (astro-ph/08063096)
- [79] S. Das and P. Bode, “A Large Sky Simulation of the Gravitational Lensing of the Cosmic Microwave Background,” (astro-ph/07113793)
- [80] N. Aghanim, S. Majumdar and J. Silk, “Secondary anisotropies of the CMB,” Rept. Prog. Phys. 71, 066902 (2008) (astro-ph/07110518)
- [81] L. Popa and A. Vasile, “Constraints on non-thermal Dark Matter from Planck lensing extraction,” JCAP 0710, 017 (2007) (astro-ph/07082030)
- [82] S. Gratton, A. Lewis and G. Efstathiou, “Prospects for Constraining Neutrino Mass Using Planck and Lyman-Alpha Forest Data,” Phys. Rev. D77, 083507 (2008) (astro-ph/07053100)
- [83] J.Rocher, K. Benabed and F. Bouchet, “Probing inflation with CMB polarization: Weak lensing effect on the covariance of CMB spectra. ” JCAP 0705, 013 (2007) (astro-ph/0612662)