Centre de Physique Théorique – École Polytechnique
THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ PARIS VI
Spécialité : PHYSIQUE THÉORIQUE
![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/9806123/assets/x1.png)
présentée par
Boris PIOLINE
pour obtenir le grade de
Docteur de l’Université Paris VI
Sujet :
Aspects non perturbatifs
de la théorie des supercordes
Soutenue le 21 avril 1998 devant le jury composé de :
| MM. | Luis Álvarez-Gaumé, | rapporteur, |
|---|---|---|
| Ignatios Antoniadis, | directeur de thèse, | |
| Jean-Loup Gervais, | ||
| Costas Kounnas, | rapporteur, | |
| Eliezer Rabinovici, | ||
| Paul Windey, | président du jury, | |
| & | Jean-Bernard Zuber. |
À mon frère et mes parents.
Remerciements
Mon travail de thèse s’est déroulé au Centre de Physique Théorique de l’École Polytechnique du mois de septembre 1995 au mois d’avril 1998 ; je remercie sincèrement les directeurs successifs Guy Laval et Marie-Noëlle Bussac de m’avoir admis au sein de ce laboratoire, et ainsi permis de travailler dans un cadre scientifique exceptionnel. Ignatios Antoniadis et Constantin Bachas ont bien voulu m’intégrer dans leur équipe de <<cordistes>> et je leur suis profondément reconnaissant de m’avoir initié à un domaine de recherche d’un abord difficile mais réellement passionnant. Ignatios a dirigé mes recherches doctorales vers des directions fructueuses avec une grande patience, gentillesse et disponibilité ; non content de répondre à mes interrogations purement scientifiques, il a su me communiquer sa passion et sa pugnacité tout en me laissant maître de déterminer l’orientation de mes recherches ; je tiens à lui exprimer ma plus grande gratitude. Edouard Brézin et Jean Iliopoulos m’ont fait goûter aux délices de la théorie quantique des champs, et ma vie en a été changée. Bientôt relayé par Paul Windey, Costas Kounnas m’a le premier parlé avec la faconde qui le caractérise d’<<une théorie of everything>> qui m’a semblé bien attirante ; je lui dois, ainsi qu’à Jean Iliopoulos et Gabriele Veneziano, d’avoir pu effectuer mon service national de la coopération à la division théorie du CERN, où pendant seize mois, moyennant une modeste assistance informatique aux membres de la division, j’ai pu interagir avec d’illustres physiciens et faire progresser considérablement mes recherches. Je leur en suis très reconnaissant.
Luis Álvarez-Gaumé et Costas Kounnas ont accepté la lourde tâche d’être les rapporteurs de cette thèse de poids conséquent, je les en remercie chaleureusement. Jean-Loup Gervais, Eliezer Rabinovici, Paul Windey et Jean-Bernard Zuber ont accepté de participer au jury, et c’est un honneur dont je leur suis très reconnaissant. Je remercie particulièrement Paul Windey pour avoir accepté de prendre la présidence du jury, et Jean-Bernard Zuber pour ses numéreuses et précieuses remarques stylistiques.
Costas Kounnas et Elias Kiritsis, aux enthousiasmes batailleurs, m’ont permis d’entrer dans le jeu de la recherche en théorie des cordes, par les séances initiatiques qu’ils ont organisées au CERN, et au cours de collaborations enflammées (car il n’y a pas de fumée sans feu) avec Andrea Gregori, Niels Obers et Marios Petropoulos ; Tom Taylor m’a aidé à contrer les velléités somnambulatoires d’Ignatios au cours de longues veillées de travail ; Niels Obers a conjugué ses efforts aux miens contre vents et marées algébriques, et avec Kristin Förger m’a aidé à corriger les nombreuses coquilles se cachant dans ce manuscrit ; Eliezer Rabinovici a accepté de sacrifier sa vie conjugale aux exigences de la M-théorie : qu’ils reçoivent tous l’expression de ma gratitude et mon amitié.
La vie du laboratoire se partage souvent entre personnel scientifique et personnel technique. Au cours de ma thèse j’ai pu faire l’expérience inverse grâce au soutien et à l’amitié des membres du secrétariat de la division théorie du CERN, Nanie, Suzy, Marie-Noëlle et Jeanne, et d’Elena, ma collègue informaticienne. Je remercie également Françoise Andalo et Brigitte Oisline pour leur grande gentillesse et efficacité, et Jean-Luc Bellon pour ses multiples conseils informatiques.
L’expérience de la thèse comporte des périodes fastes et des périodes creuses : les premières ne compenseraient les secondes sans le soutien de mes corréligionnaires et concurrents Hervé Partouche et Pierre Vanhove, des autres thésards et post-docs du laboratoire, de mes collègues et amis du CERN, Éric, Philippe, Niels, Emilian, Christophe et Christoph, et de quelques co-coopérants avec qui nous arpentions d’autres sommets. Je remercie aussi chaleureusement mes amis pour m’avoir conservé leur amitié pendant ces trois années d’éloignement ; tenant à les garder, je préserverai leur anonymat. Finalement, c’est à mes parents et mon frère que je dédie ce mémoire, pour leur soutien et leur compréhension.
Avertissement
Ce mémoire a été écrit avec le souci de rendre les travaux effectués dans le cadre de cette thèse accessibles à un public non expert. Au cours de ses trente années d’existence, la théorie des cordes a cependant suscité un nombre considérable de contributions à la base des développements les plus récents. J’ai donc fait le choix d’introduire, autant que possible, toutes les notions implicites dans les travaux présentés ici, en mettant l’accent plus sur les concepts que sur les détails techniques. Le lecteur trouvera dans la bibliographie les références nécessaires pour donner une signification plus précise à ces concepts. L’invitation au voyage s’adresse à un public large et évite résolument toute équation. Elle fournit une présentation synthétique des arguments menant à la formulation de la M-théorie, et résume mes contributions à ce domaine. Celles-ci se regroupent en trois thèmes principaux : la dualité électrique-magnétique des théories de jauge (chapitre 2), les dualités des théories de supercordes et leurs effets non perturbatifs (chapitres 3 et 4), la théorie des matrices (chapitre 5). Chaque chapitre contient une présentation pédagogique des concepts mis en jeu, et un résumé de mes contributions ; les publications elles-mêmes sont reproduites en version originale dans les annexes A à G. Les contributions aux actes de conférence n’ont pas été reproduites dans ce mémoire.
Chapter 1 Invitation au voyage
En l’espace de quelques années, de l’article fondateur de Seiberg et Witten obtenant la première solution exacte d’une théorie de jauge supersymétrique fortement couplée en quatre dimensions grâce aux symétries de dualité, à la proposition de Banks, Fischler, Shenker et Susskind de définition explicite non perturbative de la théorie des supercordes, le paysage de la théorie des champs et des cordes a subi un profond bouleversement, auquel j’ai eu la chance d’assister, participer modestement quelquefois. Les questions fondamentales de la théorie des champs, structure du vide, spectre à basse énergie, confinement, jusqu’alors hors de portée de la théorie de perturbations, devenaient ainsi accessibles au traitement analytique, tout au moins dans le cadre des théories supersymétriques. En même temps, on découvrait dans le spectre des différentes théories de supercordes une richesse d’états non perturbatifs étendus, dits -branes, identifiés aux états fondamentaux d’une théorie des supercordes duale ; ses phénomènes non perturbatifs dans le cadre d’une théorie de cordes devenaient accessibles au calcul perturbatif dans la théorie duale. Les cinq théories des supercordes étaient ainsi identifiées comme développements de perturbation en différents régimes d’une théorie maîtresse encore mystérieuse, la M-théorie, dans laquelle les cordes ne semblent pas occuper de position privilégiées. Par un retour remarquable, ces développements offrent de nouvelles perspectives sur les théories de jauge, décrivant les degrés de liberté des solitons de -branes de la théorie des cordes. Il me semblait nécessaire d’ouvrir ce mémoire par un panorama historique et synthétique de ce paysage en mouvement qui constitue l’arrière-plan de mon travail de thèse, et qui a déterminé au jour le jour la direction de mes recherches.
1.1 De la théorie des champs quantiques…
La théorie quantique des champs et son alter ego, la théorie statistique des champs, représentent à l’heure actuelle les fers de lance de l’arsenal de la physique théorique moderne pour traiter un large spectre de problèmes s’étendant de la physique des particules élémentaires à la physique de la matière condensée et des milieux désordonnés. Ces théories prennent le relais de la mécanique quantique de Bohr, Heisenberg et Planck et de la mécanique statistique de Boltzmann lorsqu’il n’est plus possible d’isoler un petit nombre de degrés de liberté, comme c’est le cas en physique des particules lorsque les effets de production de paires deviennent importants, ou en physique des supraconducteurs lorsque les excitations cohérentes collectives du nuage électronique déterminent les propriétés de conduction. Elles rendent compte de nombreux résultats expérimentaux avec une précision inégalée, dont l’illustration la plus frappante est sans doute donnée par l’accord à près de des calculs d’électrodynamique quantique avec les mesures de la structure hyperfine des raies de résonance atomique. La théorie des champs de jauge non abélienne de groupe de jauge décrivant le modèle standard [YM54, Wei67, Sal68] ne peut encore être confrontée à des mesures d’une telle précision, mais reproduit jusqu’à présent l’ensemble des résultats obtenus dans les divers accélérateurs de particules [B+96]. Les désaccords tantôt observés se sont jusqu’à présent révélés imputables à des erreurs de protocole expérimental, et dans l’hypothèse où un tel désaccord viendrait à être confirmé, certaines particularités de ces théories seraient susceptibles d’être revues sans pour autant remettre en cause le schéma général de la théorie quantique des champs.
1.1.1 Divergences et renormalisations
Cet état de grâce de la théorie des champs contraste singulièrement avec le scepticisme général qui en a entouré la naissance dans les années 1940, entâchée il est vrai d’incohérences mathématiques de mauvais augure. Si les infinis apparaissant dans le calcul de quantités aussi élémentaires que la masse de l’électron induite par les fluctuations du vide ont été assez rapidement domptés par une procédure de renormalisation, la puissance prédictive de telles théories était néanmoins diminuée, puisqu’il était nécessaire de normaliser ces infinis à la valeur finie donnée par l’expérience. Sans compter l’aspect inesthétique et ad hoc de la procédure, la série de perturbation obtenue s’avérait elle-même divergente, et pouvait au mieux s’interpréter comme une série asymptotique à faible couplage. La transposition des méthodes du groupe de renormalisation de K. Wilson en théorie statistique des champs à la théorie quantique des champs a permis une compréhension bien plus satisfaisante de ces infinis. L’origine de ces divergences était alors identifiée comme le résultat de l’évolution des constantes de couplage en fonction de l’échelle d’observation, après intégration des degrés de libertés aux échelles intermédiaires. Les constantes de couplage <<nues>> de la théorie aux échelles infiniment petites apparaissaient ainsi infinies à l’échelle d’observation. Les théories des champs dites renormalisables ne pouvaient donc être définies sans référence à une échelle de régularisation ultraviolette, et seuls les couplages préservant la renormalisabilité étaient pertinents pour la détermination des interactions à l’échelle d’observation, les autres ne survivant pas au flot de renormalisation. En particulier, le couplage des théories de jauge, sans dimension et donc juste pertinent, présentait un comportement très différent sous le groupe de renormalisation, tendant à zéro aux grandes distances dans les théories de jauge abéliennes ou non abéliennes avec un nombre suffisant de champs de matière, tandis qu’il augmentait dans l’infrarouge pour les théories de jauge non abéliennes avec suffisamment peu (ou pas) de champs de matière, finalement quittant le régime perturbatif. Inversement, aux petites distances, le couplage des premières divergeait au pôle dit de Landau , tandis qu’il décroissait vers zéro pour les secondes, dites pour cette raison asymptotiquement libres. Cette dernière catégorie, dans laquelle entre le modèle standard, devenait ainsi le seul candidat à une théorie fondamentale susceptible de décrire les interactions de jauge. La liberté asymptotique permettait en outre de calculer de nombreuses prédictions à haute énergie par un développement perturbatif, aboutissant à l’accord que l’on sait avec les résultats des expériences de diffusion profondément inélastique.
1.1.2 Au-delà de la théorie de perturbation
Si seules les théories de jauge asymptotiquement libres peuvent prétendre à une description fondamentale de la matière, on conçoit l’importance de définir ces théories au niveau non perturbatif, sinon de développer des méthodes de calcul dans ce régime. L’échelle d’énergie du spectre des particules stables, leptons, mésons et baryons (), est en effet bien inférieure à l’échelle des quarks et gluons sondée par les expériences de diffusion profondément inélastique (), et correspond donc à un régime de fort couplage effectif ; la démonstration du confinement du nombre quantique de couleur et de la brisure de symétrie chirale est donc hors de portée des méthodes perturbatives ordinaires.
La définition d’une théorie des champs hors du régime perturbatif est en soit un problème majeur, et les approches constructivistes ne sont pas encore en mesure de définir rigoureusement les théories de jauge en dimension 4. Inspirée par les modèles de physique statistique, la régularisation sur réseau des théories de jauge offre une définition commode à tout couplage, relèguant ces complications au traitement de la limite de grand volume. Elle se prête particulièrement bien au calcul sur superordinateur, et des résultats très encourageants ont déjà été obtenus [Wei96]. Son efficacité sur le plan analytique n’est cependant pas aussi évidente, et une meilleure compréhension, au moins qualitative, des phénomènes non perturbatifs peut être obtenue grâce aux méthodes semi-classiques, basées sur la recherche des solutions classiques et leur quantification perturbative.
Le développement de ces méthodes remonte à la découverte des solitons de Polyakov et ’t Hooft [Pol74, tH76] et des instantons de ’t Hooft et Belavin et al. [tH76, BPST75] 111On se reportera avec profit à [Col77, Col74] pour une introduction élémentaire à ces techniques.. Les solitons correspondent à des solutions non triviales des équations classiques du mouvement, indépendantes du temps et localisées dans l’espace ; leur stabilité est garantie classiquement par la topologie non triviale de ces configurations de champs. Leur masse croît comme , et ils échappent donc au spectre perturbatif. Ce sont des candidats à la représentation de particules du spectre non perturbatif, et leurs propriétés peuvent en principe être déterminées par quantification autour de ces solutions.
Les instantons sont au contraire localisés dans le temps autant que dans l’espace, et correspondent à des transitions par effet tunnel entre les vides classiques de la théorie. Ils entrent en principe sur un pied d’égalité avec le vide trivial dans la définition non perturbative de la théorie, bien que le calcul se limite dans la pratique à la prise en compte d’un gaz dilué d’instantons. Leur contribution n’est pertinente que dans le cas de processus interdits perturbativement, sans quoi la contribution en des instantons ne saurait émerger des contributions perturbatives en .
1.1.3 Supersymétrie, dualité et calculabilité
Ces méthodes non perturbatives ont très récemment subi un essor remarquable dans le cadre des théories de jauge à supersymétrie étendue, pour lesquelles les propriétés de supersymétrie garantissent l’absence de corrections perturbatives pour certaines quantités physiques au-delà d’un certain ordre, ainsi que la stabilité, pour des valeurs génériques du couplage, d’états vérifiant la propriété de Bogomolny, Prasad et Sommerfield (BPS), c’est-à-dire annihilés par certaines charges de la super-algèbre de Poincaré222Les désintégrations d’états BPS ont été mises en envidence dans les théories de supersymétrie [SW94b, Fer97] mais n’interviendront pas dans les cas de supersymétrie plus élevée considérés dans ce mémoire.. Dès 1978, une conjecture de Montonen et Olive [MO77] raffinée par Osborn [Osb79] proposait que les théories de jauge à supersymétrie , finies à tout ordre en perturbation, possédaient au niveau quantique la symétrie de dualité électrique-magnétique, dite S-dualité. Cette symétrie est bien connue dans l’électrodynamique classique de Maxwell, où elle échange champs électriques et champs magnétiques, charges électriques et charges magnétiques, tout en inversant le couplage de jauge. Bien que l’absence expérimentale de monopôles magnétiques laisse supposer que cette symétrie n’est pas préservée dans la réalité, on conjecturait au contraire que cette transformation de dualité restait une symétrie quantique des théories de jauge supersymétriques . L’aspect le plus frappant de cette conjecture est qu’elle reliait un régime de faible couplage, dans lequel la théorie de perturbation donne des informations fiables, à un régime de fort couplage hors d’atteinte jusqu’alors. La découverte par Witten et Olive [WO78] que la masse des états BPS était protégée de corrections quantiques pour toute valeur du couplage, donnait les premières indications de la validité de cette conjecture, en permettant l’identification des monopôles magnétiques de ’t Hooft et Polyakov aux bosons de jauge fondamentaux dans la formulation duale. Un pas décisif dans la démonstration de cette conjecture était effectué par Sen en 1994, qui montrait que l’extension de cette dualité binaire à un groupe discret infini , dit de S-dualité, agissant par transformations modulaires sur le paramètre complexe , où l’on a inclus l’angle couplant à la densité topologique , impliquait l’existence d’états solitoniques de charge électrique et magnétique pour tous et entiers premiers entre eux ; il reliait l’existence de ces états aux vides d’une mécanique quantique sur l’espace des modules des monopôles de charge magnétique , et construisait explicitement la fonction d’onde du monopôle de charge magnétique 2 [Sen94]. Ces résultats sont pour une grande part à l’origine de la ruée vers l’El Dorado des dualités.
La découverte du gisement revient cependant à Seiberg et Witten, qui la même année 1994, montraient comment, en utilisant les contraintes de la supersymétrie et de la dualité électrique-magnétique sur la structure globale de l’espace des vides, on pouvait déterminer l’action effective de basse énergie, exacte à toute valeur du couplage, pour une large classe de théories de jauge à supersymétrie étendue [SW94a, SW94b]. Ce tour de force donnait pour la première fois la dynamique à grande distance, ou fort couplage, d’une théorie des champs non triviale en quatre dimensions d’espace-temps, et fournissait ainsi un terrain d’étude privilégié pour les phénomènes non perturbatifs de confinement, brisure de symétrie chirale et condensation de monopôles. L’argument de Seiberg et Witten utilisait de manière cruciale la dualité électrique-magnétique, celle-ci reliant différentes descriptions équivalentes d’un même point de l’espace des modules.
Malheureusement, ces théories à supersymétrie étendue, bien que traitables analytiquement, n’ont que peu de pertinence phénoménologique, la raison première en étant l’impossibilité d’introduire de la matière chirale. Elles peuvent certes donner lieu à des théories supersymétriques N=1 ou sans supersymétrie par brisure douce, encore contrôlables mathématiquement, mais toujours non chirales. Peu de temps avant son article fondateur avec E. Witten, N. Seiberg proposait une version différente de la dualité électrique-magnétique dans le cadre des théories de jauge de supersymétrie , dite dualité infrarouge [Sei94]. Sur la base d’arguments de comptage de degrés de liberté, de limites de découplage et de correspondance d’anomalies chiralesde ’t Hooft, Seiberg proposait que la théorie de groupe de jauge et en présence de saveurs de quarks soit identique à grande distance à une théorie de groupe de jauge différent , saveurs de quarks et singlets de jauge ; les bosons de jauge non abéliens d’une théorie apparaissaient ainsi comme des solitons dans la description duale. Si cette conjecture a été étendue à un grand nombre de situations et a considérablement fait progresser notre compréhension de la dynamique des théories de jauge, sa puissance calculatoire est malheureusement restée limitée jusqu’à présent.
1.2 …aux théories des supercordes…
Couronnée de succès pour la description des trois interactions électromagnétique, forte et faible dans le cadre du modèle standard, la théorie des champs doit cependant reconnaître son échec à décrire la force de gravitation au niveau quantique. Renormalisables en dimension deux, les interactions gravitationnelles génèrent de sévères divergences ultraviolettes en dimension supérieure, et de nouveaux contre-termes et donc constantes de couplage doivent être introduits à chaque ordre en perturbation. Ces difficultés ne sont finalement pas surprenantes, si l’on réalise que la notion de gravité quantique remet en cause les fondements de la structure de l’espace-temps aux distances inférieures à l’échelle de Planck ( m, ou GeV), et donc la notion même de champ défini en tout point de l’espace. Des efforts importants ont été consacrés à transposer les méthodes des théories de jauge à la gravitation dans le cadre de la théorie de gravitation de boucles [Rov97], mais leur succès est encore incertain. Face à ces difficultés, la théorie des supercordes apparaît à l’heure actuelle comme le seul candidat viable à l’unification quantique de toutes les interactions fondamentales.
1.2.1 Théories perturbatives de cordes
Initialement développée sous le nom de modèles duaux à la fin des années soixante afin de rendre compte des trajectoires de Regge observées sur le spectre des résonances hadroniques de spin élevé, la théorie des cordes a découvert sa véritable vocation lorsqu’il a été réalisé que la présence d’une particule de spin 2 dans son spectre de masse nulle en faisait un candidat naturel à la description de la gravitation quantique[SS74] ; ce candidat était d’autant plus attirant que contrairement aux théories des champs, toutes les amplitudes y étaient finies. La raison de ce miracle tient à la structure étendue que la théorie confère aux objets élémentaires, de petites cordes relativistes oscillantes décrivant une surface d’univers au cours de leur propagation dans l’espace-temps, et interagissant de manière géométrique par coupure et recollement (splitting and joining), correspondant aux bifurcations de cette surface (figure 1.1). La tension de la corde définit l’échelle de masse de la théorie, dite échelle des cordes, tandis que les interactions sont pondérées par le couplage des cordes sans dimension . Vues de loin, ces cordes se comportent comme des particules ponctuelles dont la nature, la masse et les interactions sont déterminées par l’état d’oscillation interne. Tout comme la ligne d’univers d’une particule ordinaire supporte une théorie des champs unidimensionelle, la surface d’univers de la corde supporte une théorie des champs bidimensionnelle conforme333Cette dernière condition, nécessaire au découplage du champ de Liouville sur la surface d’univers, peut être relaxée dans le cadre des théories des cordes non critiques. Ces dernières seront ignorées dans le cadre de cette thèse, bien que de récents progrès permettent d’espérer en leur quantification.. Les contraintes d’invariance conforme restreignent la dimensionalité de l’espace-temps à la dimension critique , et lui imposent en outre de vérifier une extension des équations de la relativité générale, corrigées à tous les ordres en . La gravitation émerge donc naturellement, et cette correspondance fixe la taille caractéristique des cordes à l’échelle de Planck.
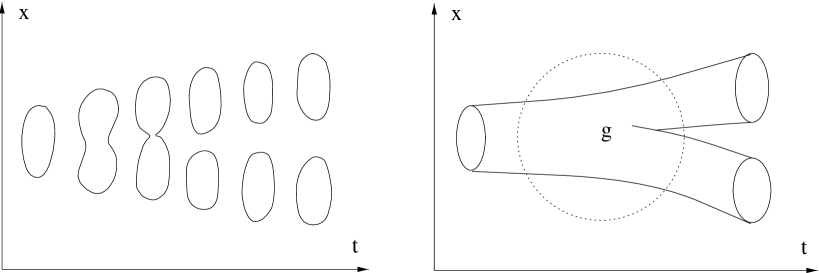
Cette version simpliste, dite corde bosonique n’est cependant pas viable en raison de la présence d’une particule de masse carrée négative, le tachyon, révélatrice de l’instabilité de cette théorie, ainsi qu’en raison de l’absence de degrés de liberté fermioniques dans le spectre. On peut cependant remplacer la théorie conforme bidimensionnelle en une théorie conforme localement supersymétrique, ou superconforme, pour obtenir, après une projection judicieuse [GSO76], une théorie sans tachyon de dimension critique 444Les théories superconformes étendues conduisent à une dimension critique () ou () dont la pertinence n’est pas évidente. Certaines constructions hétérotiques permettent d’obtenir pour une supersymétrie de surface d’univers [OV91], mais ne seront pas considérées dans ce mémoire.. L’invariance superconforme sur la surface d’univers conduit alors à une théorie supersymétrique dans l’espace ambiant. Ces théories sont en général chirales, et les contraintes de compensation d’anomalies gravitationnelles sélectionnent une dizaine de modèles [KLT86a], dont seuls six modèles ne présentent pas de tachyon : on construit ainsi les cordes ouvertes de type I avec supersymétrie d’espace-temps à dix dimensions et groupe de jauge SO(32) ; les cordes fermées de type IIA et IIB avec supersymétrie non chirale (IIA) ou chirale (IIB) à dix dimensions ; les cordes fermées hétérotiques avec supersymétrie à dix dimensions et groupes de jauge ou ; et finalement la corde hétérotique non supersymétrique de groupe de jauge [AGGMV86], que nous omettrons dans la suite en nous restreignant aux théories des supercordes critiques supersymétriques.
Le spectre de ces théories de supercordes se compose donc d’un étage de masse nulle comprenant une particule scalaire dite dilaton, dont la valeur moyenne définit le couplage de la théorie, d’une particule de spin 2 identifiée au graviton , et d’un certain nombre de tenseurs antisymétriques de jauge dépendant de la théorie considérée ; ces tenseurs généralisent la notion de potentiel vecteur à un tenseur antisymétrique à indices , ou -forme, invariant sous la transformation de jauge où est une -forme quelconque. Le spectre inclut également une tour d’états massifs de spin arbitrairement élevé et de masses carrées en progression arithmétique , tout comme la gamme pythagoricienne des modes propres de la corde vibrante. Les modes n’apparaissent qu’aux énergies de l’ordre de l’échelle de Planck, et leurs effets peuvent donc être intégrés pour donner une théorie des champs de basse énergie régissant la dynamique des états de masse nulle ; les symétries de difféomorphismes et de jauge ajoutées aux propriétés de supersymétrie d’espace-temps identifient cette théorie des champs aux théories de supergravité introduites par Freedman, van Nieuwenhuizen, Ferrara, Deser et Zumino [FvNF76, DZ76b]. Bien que ces théories soient non renormalisables au sens du comptage de puissances, les théories de supercordes en fournissent une régularisation cohérente et compatible avec toutes les invariances de jauge.
1.2.2 Interactions et théorie de perturbations
La théorie des supercordes telle qu’elle émerge au milieu des années 1980 rassemble donc en réalité six théories des cordes critiques distinctes, sélectionnées par un cahier des charges drastique: absence d’instabilité tachyonique, et absence d’anomalies gravitationnelles et de jauge. Ces théories sont définies par leur développement perturbatif en somme sur les surfaces de Riemann de genre arbitraire , remplaçant les diagrammes de Feynman ordinaires à boucles, pondérées par une puissance du couplage (figure 1.2). Grâce à l’invariance conforme, les pattes externes des diagrammes peuvent être incorporées comme des insertions d’opérateurs de vertex locaux dans la théorie des champs bidimensionnelle. Il faut encore sommer sur les différentes métriques sur la surface d’univers, ou plus précisément sur leurs classes d’équivalence conforme, lesquelles sont déterminées par la structure complexe de la surface de Riemann : cette opération est analogue à la sommation sur les moments des particules se propageant dans les boucles, et prend également en compte les facteurs de symétrie des diagrammes. La définition des théories des supercordes est donc intrinsèquement perturbative en le paramètre . Par contraste, la théorie conforme sur chaque surface est définie non perturbativement en , bien qu’il puisse s’avérer nécessaire d’effectuer un développement perturbatif en lorsque cette théorie n’est pas intégrable.
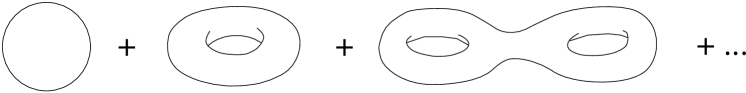
1.2.3 Compactification et dégénérescence du vide
La restriction sur la dimensionnalité de l’espace peut être levée en supposant certaines d’entre elles compactes de rayon très faible. La variété correspondant à ces directions compactes est astreinte à vérifier les équations d’Einstein généralisées ; la préservation de la supersymétrie d’espace-temps restreint la variété de compactification aux espaces de Calabi-Yau, mais laisse encore un nombre important de possibilités : ainsi, dans le cas de la compactification à 4 dimensions, quelques 11000 espaces de Calabi-Yau topologiquement distincts sont connus, avec pour chacun plusieurs paramètres de déformations continues ! Notons de plus que l’on peut construire des théories de supercordes directement à quatre dimensions en remplaçant les dimensions internes par une théorie superconforme de charge centrale équivalente [KLT86b, ABK87]. On obtient dans certains cas des descriptions conformes exactes de compactification géométrique sur des espaces de Calabi-Yau [Gep87] ou sur des solutions cosmologiques [KL92], ou bien des descriptions sans équivalent géométrique connu.
Cette abondance de modèles pour une théorie d’unification ne justifie cependant pas que l’on se désintéresse de ces théories : ces modèles doivent en effet être considérés comme des états du vide différents des quelques théories des supercordes fondamentales à dix dimensions, déterminés par les valeurs moyennes de champs scalaires de masse nulle, dits champs de module, paramétrant la variété de compactification. Ces scalaires prennent en général leurs valeurs dans une variété abstraite courbe, dite espace des modules. La sélection du vide physique, ou en d’autres termes la génération de masse pour les champs de modules, reste incomprise à l’heure actuelle.
1.2.4 Symétries perturbatives et symétries cachées
La découverte des dualités d’espace cible (target space dualities, ou T-dualités) apporte une confirmation de ce point de vue. Ces dualités apparaissent dans l’exemple le plus simple de la compactification sur un cercle de rayon : le spectre comporte alors des états de moment de masse correspondant aux excitations de la théorie des champs portant un moment interne selon la direction compacte, mais aussi des états d’enroulement spécifiques à la théorie des cordes, de masse correspondant à une corde enroulée fois autour du cercle (figure 1.3). Ces deux états sont échangés sous l’inversion du rayon , et on peut montrer que cette transformation est une symétrie exacte de la théorie conforme, donc valable à tous les ordres dans la théorie de perturbation. Cette symétrie se généralise en une symétrie de T-dualité pour les compactifications sur tore , et dans le cas des compactifications sur espaces de Calabi-Yau donnent lieu à la symétrie miroir, qui identifie deux espaces de topologies différentes. La T-dualité agit comme automorphisme des cordes hétérotiques, mais comme isomorphisme des cordes de type IIA et IIB, échangées sous la T-dualité. Elle aura également des conséquences inattendues dans le cadre des théories de cordes ouvertes, ainsi que nous le verrons incessamment.
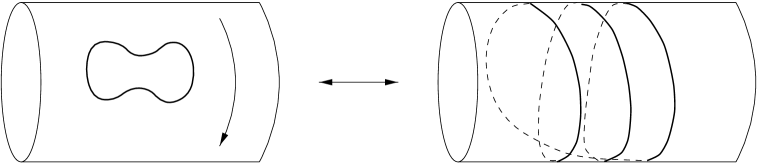
Les T-dualités agissent ordre par ordre en théorie des perturbations et apparaissent comme symétries continues555Les états d’enroulement et de moment chargés par rapport à cette symétrie continue sont en effet absents de la théorie effective à basse énergie. de la théorie de supergravité décrivant la dynamique à basse énergie. Les théories de supergravité présentent cependant, outre ces symétries perturbatives, des symétries cachées reliant des régimes de couplages différents, analogues à la S-dualité électrique-magnétique des théories de jauge [CJ79]. L’exemple le plus simple est sans doute la S-dualité de la théorie de type IIB, agissant par transformations modulaires sur le paramètre complexe , où correspond à la valeur moyenne d’un champ scalaire de la théorie de type IIB ; les deux tenseurs antisymétriques se transforment en outre comme un doublet sous cette symétrie. La théorie de supergravité est invariante sous le groupe continu [Sch83] ; celui-ci est brisé en un sous-groupe discret par l’existence de la corde fondamentale, chargée sous cette symétrie. Par analogie avec la dualité de Montonen- Olive, on est donc amené à conjecturer la validité quantique de cette symétrie, et donc l’existence d’un multiplet de cordes solitoniques de charges par rapport aux champs . Cette conjecture suppose naturellement l’existence d’une extension non perturbative de la théorie des supercordes de type IIB.
De telles symétries cachées sont visibles dans de nombreux cas, et se conjuguent avec les dualités d’espace cible pour former un groupe de dualité plus large, dit de U-dualité, agissant dans l’extension non perturbative hypothétique des théories de supercordes, ou reliant différentes théories de supercordes moyennant une redéfinition des champs [HT95]. L’existence de symétrie de l’action effective ne suffirait pas à conclure à l’existence de ces dualités, mais l’étude du spectre non perturbatif des théories de supergravité en apporte une confirmation éclatante.
1.2.5 Spectre de solitons, membranes et D-branes
Bien que la formulation non perturbative des théorie des supercordes reste encore un problème ouvert à ce stade, l’étude du spectre semi-classique des solitons de la théorie de supergravité donne une indication du spectre non perturbatif de cette théorie hypothétique. En particulier, pour autant que ces états soient suffisamment étendus pour que la description de basse énergie soit valide, les solitons vérifiant la propriété BPS peuvent être identifiés avec des états BPS non perturbatifs de la théorie des cordes.
La détermination de ces états est probablement à l’origine du bouleversement de notre compréhension des théories des supercordes. Elle révèle en effet l’existence d’une variété d’états BPS étendus dits -branes, généralisant la notion de particule ponctuelle ( ) et de corde ( ) à des objets comportant dimensions internes. Ces états, infiniment lourds et localisés à faible couplage, correspondent à des champs de fond des théories de supergravité concentrés au voisinage d’hypersurfaces de dimension . Ces objets possèdent néanmoins des modes propres de vibration leur conférant une dynamique, qui peut en principe être calculée dans l’approximation de l’espace des modules, comme dans le cas des monopôles magnétiques de la théorie des champs.
Ces états étendus ne sont pas sans rappeler les D-branes étudiées dès le début des années 1990 dans le cadre de la T-dualité des théories de cordes ouvertes [Hor89, DLP89]. Contrairement aux théories de cordes fermées où la transformation agit de manière triviale, la propagation libre des cordes ouvertes sur un cercle de rayon est identifiée dans l’image duale à la propagation sur un cercle de rayon en présence d’un défaut ponctuel sur lequel les extrémités des cordes ouvertes sont contraintes de s’attacher (figure 1.4). Ce défaut, localisé dans la dimension compacte dualisée, définit une hypersurface de dimension 9 dans l’espace minkovskien à 10 dimensions, et donc une 8-brane (ou, dans le cas d’une compactification sur un tore de dimension , une -brane). Ces objets, baptisés D-branes (ou D-branes) par référence à la condition de bord de Dirichlet satisfaite par les coordonnées de plongement de la corde ouverte, ont été identifiés avec les -branes de la supergravité dans un article majeur de Polchinski, identifiant leur couplage aux champs de jauge des supergravités de type II [Pol95]. Leur rôle s’est considérablement développé lorsqu’il a été réalisé que la description de leurs interactions se ramenait à une théorie de jauge usuelle sur leur volume d’univers, permettant ainsi l’application fructueuse de résultats obtenus dans le cadre de la théorie des cordes au domaine des théories de jauge. Notons également l’existence dans les théories de type II et hétérotiques de la 5-brane de Neveu-Schwarz, ou NS5-brane, chargée magnétiquement par rapport au tenseur du secteur gravitationnel universel. Contrairement aux D-branes, cet objet solitonique ne possède à l’heure actuelle pas de description en termes de théorie conforme bidimensionnelle.
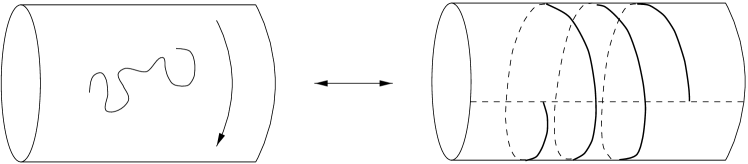
1.3 …à la M-théorie
La découverte de ces solitons étendus remettait en cause la vision perturbative des théories de supercordes : de la corde fondamentale et des solitons de membranes, quels sont les objets fondamentaux définissant la théorie au niveau non perturbatif ? Quand il existe une corde solitonique en plus de la corde fondamentale, existe-t-il une description duale dans laquelle leurs rôles soient échangés ? On savait déja que les cordes de type IIA et de type IIB étaient reliées par la symétrie miroir perturbative, les autres cordes pourraient-elles être reliées par des dualités non perturbatives analogues à celles mises en évidence en théorie des champs ?
1.3.1 Dualité des théories de cordes
Ces développements conduisirent ainsi en 1995 à la formulation de l’hypothèse, largement confirmée par la suite, que les cinq théories de supercordes supersymétriques ne formaient que différentes facettes de la même théorie, dans différentes approximations de son espace des modules. Cette idée dépasse largement en puissance le concept de dualité électrique-magnétique apparu en théorie des champs, et s’inspire d’un faisceau de coïncidences remarquables ; le lecteur pourra s’orienter à l’aide de la M-appemonde figure (1.5).
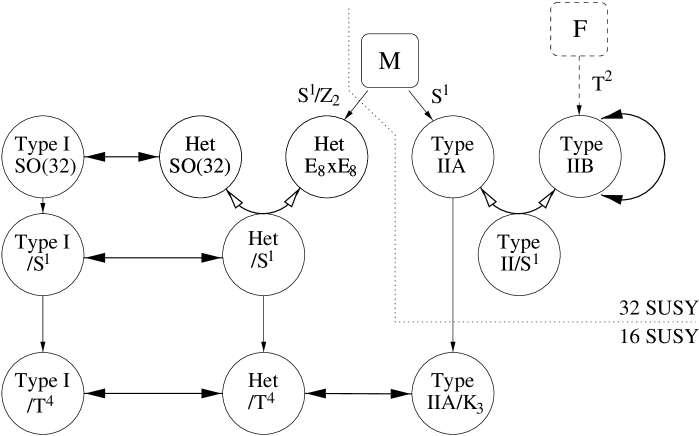
Ainsi, les cordes de type I et hétérotiques de groupe de jauge SO(32) possèdent la même action moyennant la redéfinition . La corde de type I à dix dimensions possède un outre un soliton de corde, correspondant à la 1-brane de Polchinski, dont la structure n’est autre que celle de la corde fondamentale de la théorie hétérotique. Ces observations conduisent à postuler que la théorie des supercordes de type I et la théorie des supercordes hétérotiques SO(32) ne sont que deux développements perturbatifs, l’un à faible, l’autre à grand, d’une même théorie définie à toute valeur de . Les théories hétérotiques de groupe de jauge et étant perturbativement équivalentes par T-dualité après compactification sur un cercle, on voit que l’on ramène ainsi les trois théories de supercordes avec supersymétrie à dix dimensions à une seule.
En réalité, le cas le plus clair de dualité fut d’abord observé dans les compactifications à six dimensions de la corde hétérotique sur un tore , et de la corde de type IIA sur une variété . Ces deux modèles, de supersymétrie en six dimensions, possèdent le même espace des modules correspondant au dilaton et aux modules du réseau pair autodual définissant la compactification de la théorie hétérotique d’une part ; au dilaton et aux modules de la compactification de la corde de type IIA sur d’autre part. Les actions effectives de basse énergie sont en correspondance sous l’identification , et les états du spectre perturbatif correspondant au réseau sont identifiés avec les D-branes enroulées sur les 4 cycles auto-duaux et 20 cycles anti-auto-duaux de l’homologie de . Cette dualité sera largement discutée dans ce mémoire, où nous l’utiliserons pour déduire des couplages exacts dans une théorie grâce à un calcul perturbatif dans la théorie duale.
1.3.2 Le chaînon manquant
La conjecture de dualité entre les théories de type IIA et hétérotiques souffrait cependant de n’être valable qu’après compactification à six dimensions, et laissait mystérieux le lien entre les théories de type I (supersymétrie ) et les théories de type II () à dix dimensions. Le chaînon manquant fut postulé par E. Witten en 1995, et le mystère qui l’entoure encore maintenant lui a valu l’appellation de M-théorie. La justification de son existence repose principalement sur le lien entre la théorie de supergravité à dix dimensions décrivant la dynamique de basse énergie des supercordes de type IIA avec la théorie de supergravité à onze dimensions construite par Cremmer, Julia et Scherk [CJS78]. La supergravité à 11 dimensions restitue en effet la supergravité de type IIA après compactification à la Kaluza-Klein sur un cercle, c’est-à-dire en omettant toute dépendance sur la direction interne[Kal21, Kle26]. Le rayon de la onzième dimension et l’échelle de Planck à onze dimensions se trouvent ainsi identifiés avec la constante de couplage de la théorie des cordes de type IIA et l’échelle de corde selon666Les coefficients numériques ont été omis dans cette formule. Des relations équivalentes mais utiles sont , .
| (1.1) |
Cette identification entre théories de supergravité peut être étendue à plus haute énergie en identifiant les D0-branes de la théorie de type IIA avec les modes de Kaluza-Klein du graviton de onze dimensions [Tow95, Wit95b] ; les D2-branes et la corde fondamentale de la théorie de type IIA suggèrent alors l’existence d’une membrane de la M-théorie, enroulée ou non selon le cercle de rayon , tandis les D4- et NS5-branes descendraient d’une hypothétique 5-brane. Membranes et 5-branes apparaissent du reste comme solitons de la supergravité à onze dimensions. Ces objets ne peuvent cependant être quantifiés à ce jour, et la définition même de la M-théorie est encore inconnue ; nous reviendrons sur ce problème dans la suite.
L’existence de cette théorie étant postulée, il est naturel d’appliquer les méthodes de construction de descendants habituelles en théorie des cordes. En particulier, tandis que la compactification sur un cercle restitue la théorie de type IIA, la compactification sur un orbifold (autrement dit, un segment), doit donner une théorie de supersymétrie moitié, soit . Les constructions d’orbifold entraînent génériquement l’existence d’états dits twistés, localisés sur les points fixes, soit ici les deux 9-branes à chaque extrémité du segment. Tandis que la théorie des cordes offre une méthode générale pour déterminer ces états, on doit ici se contenter d’arguments indirects. Horava et Witten ont ainsi pu montrer que l’annulation locale des anomalies gravitationnelles nécessitait l’existence de bosons de jauge se propageant sur chaque bord [HW96]. Dans la limite où la longueur du segment tend vers zéro, on restitue ainsi le contenu de la théorie hétérotique , dont la corde fondamentale est donnée par la membrane (ou 2-brane) de la M-théorie suspendue entre les deux neuf-branes !
1.3.3 La théorie non perturbative des supercordes
On voit donc que les cinq théories des cordes de supersymétrie correspondent à cinq limites d’une théorie maîtresse qui admet un développement différent en série de cordes perturbative dans chaque limite, tandis que la supergravité à onze dimensions représente la limite de basse énergie de cette théorie. Plus précisément, nous avons discuté un certain nombre de conditions satisfaites par ces cinq formulations limites qui autorisent l’existence d’un prolongement dans l’intérieur du domaine des paramètres. Cette approche est assez similaire à celle adoptée en géométrie différentielle, où l’on définit une variété par les cartes locales sur un ensemble d’ouverts et par les fonctions de transitions. L’analogie a ses limites, car dans le cas présent, sur chaque carte l’information n’est que de nature asymptotique, en raison de la non convergence de la série asymptotique. On ne donne donc la théorie que sur un ensemble de mesure nulle , et il faudrait un argument d’analyticité pour prolonger cette information à des valeurs finies des constantes de couplage.
Quoi qu’il en soit, cette théorie non perturbative des supercordes, que nous dénommerons M-théorie dans la suite de cet exposé, ne semble pas donner de place privilégiée aux cordes elles-mêmes, mais plutôt aux membranes et cinq-branes. Elle doit également présenter la propriété d’engendrer une algèbre de courants dès lors qu’elle est définie en présence de bord, ce qui l’apparente aux théories de Chern-Simons [Hor97]. La théorie des supermembranes semble en l’état actuel incohérente et ne peut servir de définition à la M-théorie. Dans la suite, nous discuterons une proposition récente pour définir la M-théorie sur le front de lumière. Pour l’instant, nous adopterons une approche moins ambitieuse mais de rapport plus immédiat, et envisagerons dans quelle mesure les techniques de calcul semi-classique en théorie des champs peuvent être transposées à la théorie des cordes.
1.3.4 Approche semi-classique à la théorie des supercordes
Comme nous l’avons discuté plus haut, les méthodes semi-classiques pour la détermination non perturbative d’amplitudes physiques sont particulièrement efficaces en théorie des champs lorsque l’on s’intéresse à des processus interdits perturbativement. La théorie des supercordes, considérée dans un de ses vides supersymétriques, remplit précisément cette condition, du moins lorsque l’on s’intéresse aux interactions dominantes à basse énergie. On peut donc chercher à calculer les corrections non perturbatives en incluant les configurations d’instantons de la théorie des cordes. L’étude des points-selles euclidiens de la théorie de supergravité décrivant la dynamique de basse énergie permet de déterminer ces configurations, tout comme l’étude des solutions classiques minkovskiennes fournissait le spectre BPS non perturbatif des -branes. Tout naturellement, les solutions euclidiennes s’obtiennent en enroulant la ligne d’univers de genre temps des solutions minkovskiennes statiques autour d’un cercle de genre espace du continuum d’espace-temps. On obtient ainsi un “spectre” d’objets instantoniques, localisés à un instant donné, mais étendus dans directions spatiales, à la différence des instantons ponctuels des théories de jauge en dimension 4. Malheureusement, l’absence de formulation non perturbative de la théorie des supercordes ne nous permet pas d’obtenir les règles de sommation sur ces configurations de manière déductive. Cette approche serait donc vouée à l’échec, s’il n’existait un certain nombre d’amplitudes physiques déterminables exactement grâce par des arguments de dualité. L’examen de ces quantités, exactes à toute valeur du couplage, dans la limite de faible couplage, permet d’identifier les contributions non perturbatives de ces instantons, et donne des indications précieuses sur les règles à appliquer dans des cas plus généraux. Cette stratégie a été mise en œuvre dans le cadre de ce travail de thèse, et fera l’objet d’une discussion approfondie dans ce mémoire.
1.3.5 M comme Matrice ?
Définie par le prolongement hypothétique de théories perturbatives, la théorie non perturbative des supercordes gagnerait en crédibilité et prédictivité à recevoir une formulation intrinsèque qui ne fasse appel à aucun développement perturbatif. Bien que la réponse à cette question reste encore hors d’atteinte, Banks, Fischler, Shenker et Susskind ont proposé une formulation [BFSS97, Sus97] qui reproduit bon nombre des caractéristiques supposées de la M-théorie, dont l’amplitude de diffusion graviton-graviton prédite par la théorie de supergravité à 11 dimensions [BB97]. Cette approche, connue sous le nom de théorie des matrices (M(atrix) Theory) postule que la dynamique de la M-théorie peut être décrite sur le front de lumière par la mécanique quantique supersymétrique de 9 matrices hermitiennes de dans la limite de grand , obtenue par réduction dimensionnelle de la théorie de Yang-Mills supersymétrique à dix dimensions ; les 9 champs scalaires issus de la réduction du potentiel vecteur sont identifiés aux 9 coordonnées non commutatives transverses au front de lumière. Ce modèle n’est autre que celui décrivant la dynamique de D0-branes, ainsi identifiées aux composants élémentaires, ou partons, de la M-théorie. Cette formulation rappelle les développements encore récents des modèles de matrices, qui avaient en effet permis de faire le lien entre la mécanique statistique d’une matrice aléatoire gaussienne dans la limite de double scaling et le développement en genre d’une théorie de cordes. La connection avec les théories de supercordes critiques était cependant restée hors de portée, et le calcul limité au calcul de certains exposants critiques. L’analogie a pourtant ses limites, car c’est ici les fluctuations d’un nombre continu de matrices paramétrées par le temps propre qu’il faut considérer. La propriété de supersymétrie étendue de la théorie des matrices permet cependant d’espérer que ce problème reste traitable. Sa recevabilité reste cependant subordonnée à la démonstration de l’invariance de Lorentz à onze dimensions, non manifeste sur le front de lumière.
Encore cette formulation ne traite-t-elle que la M-théorie dans l’espace plat à onze dimensions, soit une limite particulière de la théorie non perturbative des supercordes. Pour prétendre au nom de M-théorie, elle doit pouvoir décrire les configurations de champs de fond les plus générales, et en particulier pouvoir être compactifiée 777Plus précisement, l’espace de Hilbert de la théorie des matrices devrait comporter des secteurs de supersélection décrivant les différentes compactifications possibles.. Le mécanisme de compactification sur des variétés quelconques est bien loin d’être compris, mais déjà, la compactification sur des variétés toroïdales plates de dimension se révèle beaucoup plus complexe qu’en théories des champs ou des cordes habituelles, puisque la mécanique quantique de matrices devient une théorie de jauge supersymétrique en dimension , dans la limite de grand ! Ce saut qualitatif compromet la prédictivité de cette théorie, en particulier lorsque puisqu’alors la théorie de jauge devient non renormalisable et donc mal définie à courte distance, où elle doit être complétée par des degrés de liberté supplémentaires. Les U-dualités de la M-théorie sont alors identifiées aux dualités électrique-magnétique et géométriques de ces théories de jauge étendues. Au cours de ce travail de thèse, nous avons également montré comment les modules de la compactification pouvaient s’interpréter dans le cadre de la théorie des matrices, et étudié le spectre des états BPS dans les deux formulations. L’identification de la théorie des matrices à la M-théorie, et en particulier aux théories de supercordes limites, n’a cependant été vérifiée que dans le secteur BPS, et on peut légitimement se demander si cette équivalence, comme les conjectures de dualité des cordes, s’étend au spectre entier des théories de supercordes.
1.3.6 Au delà du cadre de ce mémoire…
Le panorama historique que nous avons dessiné jusqu’à présent ne donne qu’un aperçu impressionniste et imprécis du bouleversement survenu en quelques années dans les théories des champs et des cordes. Nous aurons l’occasion de remédier à une partie des insuffisances de cette introduction dans la suite de ce mémoire pour les sujets touchant de plus près à mes recherches doctorales, renvoyant le lecteur aux articles originaux et articles de revue cités en référence pour plus de détails. Nous devrons également ignorer certains développements prometteurs que nous n’avons pu aborder dans le cadre de cette thèse mais que nous espérons explorer dans un proche avenir :
-
•
La théorie des supercordes de type IIB admet des schémas de compactification non perturbative dans lesquels le dilaton n’est pas uniforme, et défini à une transformation de S-dualité près. Ces configurations peuvent naturellement être interprétées dans le cadre d’une théorie en dimension 12, introduite par C. Vafa sous le nom de F-théorie [Vaf96]. Bien que cette dernière soit encore mal définie (voir [BK97] pour une tentative intéressante), on peut ainsi construire une nouvelle classe de modèles, dont, par compactification sur un espace de Calabi-Yau de dimension complexe 4, certains modèles de supersymétrie à quatre dimensions d’intérêt phénoménologique. Cette procédure permet également de construire des théories de jauge de contenu arbitraire dans la limite où la gravité se découple, et de résoudre celles-ci explicitement [KKV97, Kle97].
-
•
La modélisation des trous noirs en termes d’états liés de D-branes permet une description des degrés de liberté microscopiques de ces objets. On a ainsi pu dériver la formule de Bekenstein-Hawking pour l’entropie des trous noirs extrémaux et quasi extrémaux, correspondant aux intersections BPS et quasi-BPS de D-branes (pour une courte revue, voir par exemple [Mal98]). Ce calcul a été récemment étendu aux trous noirs non extrémaux, dont le trou noir de Schwarzschild, grâce à certaines transformations de U-dualité non considérées dans ce mémoire [SS97c].
-
•
L’étude de la dynamique de volume d’univers des solitons de la M-théorie permet de comprendre les dualités des théories de jauge comme action géométrique sur la configuration solitonique (voir [GK98] pour une revue de ces développements) ; elle suggère également l’existence d’une classe de théories de jauge non triviales en dimension supérieure à quatre, dont l’absence de formulation lagrangienne ne diminue pas l’intérêt. Elle permet enfin de relier les excitations des théories de jauge conformes, et en particulier de la théorie de Yang-Mills N=4 à quatre dimensions, aux excitations de supergravité sur l’horizon de ces solitons, tout au moins dans la limite de grand [Mal97].
1.4 Présentation de mes recherches doctorales
Au cours de cette thèse, je me suis tout d’abord intéressé aux propriétés de dualité des théories de champs supersymétriques . Dans leur article fondateur de 1994, Seiberg et Witten ont montré comment les corrections non perturbatives à la métrique des scalaires de la branche de Coulomb, où la symétrie de jauge est brisée en un sous-groupe abélien, pouvaient être calculées grâce aux propriétés de dualité électrique-magnétique. En revanche, la branche de Higgs, où la valeur moyenne des scalaires des hypermultiplets brise entièrement la symétrie de jauge, est protégée de telles corrections par la supersymétrie globale. Les corrections provenant de la théorie des cordes ne sont cependant pas exclues, ce qui a motivé l’étude de cette branche sous la direction d’Ignatios Antoniadis (annexe A) [AP97]. J’ai en particulier pu montrer l’existence d’une nouvelle dualité identifiant la branche de Higgs d’une théorie de jauge avec couleurs et saveurs avec celle d’une théorie de couleurs et saveurs. Cette dualité des branches de Higgs rappelle la dualité infrarouge suggérée par Seiberg dans les théories des champs supersymétriques correspondantes ; elle a par la suite été interprétée en termes d’action géométrique sur les configurations de D-branes. Je me suis ensuite penché avec Hervé Partouche sur le problème de la brisure partielle de supersymétrie globale par les termes de Fayet-Iliopoulos magnétiques qu’il avait mise en évidence avec Ignatios Antoniadis et Tomasz Taylor [APT96] ; cette étude a conclu à l’impossibilité d’étendre ce processus en présence d’hypermultiplets chargés minimalement couplés, et ne sera pas reprise dans ce mémoire [PP97].
Mon intérêt s’est ensuite porté vers les dualités des théories de cordes, au contact d’Elias Kiritsis et Costas Kounnas à la division Théorie du CERN. Après l’étude d’une proposition récente de dénombrement des états BPS des théories de cordes hétérotiques compactifiées sur ou de type IIA compactifiée sur [DVV97a] qui s’est révélée incomplète, nous nous sommes intéressés, en collaboration avec Andrea Gregori, Niels Obers et Marios Petropoulos, aux corrections de seuil aux interactions gravitationnelles à quatre dérivées dans les théories de rang non maximal (annexe B)[GKK+98]. Sous la dualité hétérotique-type II, la contribution à une boucle de type II donne lieu à des corrections non perturbatives en correspondant à des cinq-branes hétérotiques enroulées sur le tore . Cette généralisation des résultats de Harvey et Moore [HM96] a mis en évidence la restriction de la S-dualité à un sous-groupe de dans ces modèles d’orbifolds sans point fixes, ainsi que certains comportements inattendus de théories hétérotiques à fort couplage.
Cette première confrontation avec les effets non perturbatifs de la théorie des cordes m’a conduit à étudier, en collaboration avec Ignatios Antoniadis et Tomasz Taylor, d’autres couplages à quatre dérivées dans ces théories , qui ont cette fois la propriété d’être donnés exactement à une boucle du coté hétérotique (annexe F)[APT98]. Leur interprétation du point de vue des cordes de type II correspond alors à des effets non perturbatifs en de D-branes s’enroulant sur les cycles d’homologie de . Nous avons ainsi obtenu les premiers exemples explicites d’effets d’instantons en espace courbe, et retrouvé le dénombrement des cycles algébriques de de genre donné, conjecturé indépendamment par Berschadsky, Sadov et Vafa [BVS96].
Je me suis simultanément tourné avec Elias Kiritsis vers l’étude de situations plus pures où les contributions de ces instantons pouvaient être comprises plus précisément. Nous nous sommes ainsi intéressés aux couplages en de la théorie de type IIB, pour lesquels Green et Gutperle avaient conjecturé une expression non perturbative en termes d’une fonction non holomorphe modulaire de [GG97b]. Nous avons étendu leur conjecture aux compactifications de la corde de type IIB sur et , pour lesquelles nous avons montré que les séries d’Eisenstein invariantes sous les groupes de U-dualité et reproduisaient les contributions perturbatives à l’ordre des arbres et à une boucle, ainsi que des sommes d’instantons interprétables en termes de cordes de type , images de la corde fondamentale sous la symétrie , enroulées sur les deux-cycles du tore de compactification (annexe C)[KP97c]. Nous avons ensuite étendu ces résultats aux compactifications toroïdales quelconques de type IIA ou IIB, obtenant les contributions de D-branes de dimensionalité arbitraire à ces couplages (annexe D)[PK98]. En même temps, nous remarquions que ces contributions ne suffisaient pas à reproduire un résultat invariant sous la dualité en dimension , et qu’elles devaient être complétées par des contributions en dont l’interprétation reste obscure à ce jour. Tout récemment, j’ai pu démontré l’absence de contributions des formes cuspoïdales aux couplages en , fournissant ainsi la démonstration définitive de la conjecture de Green et Gutperle (annexe E)[Pio98]. Ce résultat apparaît également comme conséquence de l’étude des couplages à quatre dérivées cité plus haut.
La théorie des matrices, prétendante à une définition non perturbative de la M-théorie et donc de la théorie des supercordes, ayant remporté des succès remarquables, je me suis penché sur ces développements en collaboration avec Eliezer Rabinovici et Niels Obers, dans l’espoir de clarifier ces contributions instantoniques (annexe G) [OPR97]. Nous avons ainsi pu faire le lien avec des résultats obtenus peu avant par Eliezer en collaboration avec Amit Giveon, Shlyamon Elitzur et David Kutasov sur l’implémentation de la symétrie de U-dualité en théorie des matrices [EGKR98]. Nous avons également pu étendre ces résultats, en démontrant comment la théorie des matrices devait être modifiée pour décrire des compactifications en présence de champs de fond de jauge, nécessaires à la réalisation de la U-dualité.
Chapter 2 Dualités non perturbatives des théories des champs supersymétriques
Comme nous l’avons décrit dans notre introduction, la notion de dualité électrique-magnétique mise en évidence dans les théories de jauges non abéliennes à supersymétrie étendue a joué un rôle essentiel dans l’émergence de la conjecture de dualité des théories de supercordes. Nous en donnerons ici une présentation sommaire, qui nous permettra d’introduire de nombreux concepts de base implicites dans les chapitres ultérieurs. Nous suivrons ainsi le cheminement de mon apprentissage, et introduirons le lecteur à la publication en appendice A. Ces idées ne prendront leur pleine dimension qu’une fois transposées aux théories de supergravité qui décrivent la dynamique à basse énergie des théories de supercordes, et présentent des symétries <<cachées>> non perturbatives analogues à la S-dualité des théories de jauge. La brève description que nous en donnerons nous introduira aux dualités des théories de supercordes, qui feront l’objet du chapitre suivant.
2.1 Des monopôles magnétiques à la S-dualité
2.1.1 Dualité et monopôles magnétiques
L’idée de dualité électrique-magnétique remonte sans doute aux premiers jours de l’électrodynamique classique maxwellienne, dont les équations dans le vide présentent une symétrie globale mélangeant champs électrique et champs magnétique selon . La validité en présence de matière de cette symétrie impliquerait l’existence de particules ponctuelles chargées magnétiquement, dites monopôles magnétiques, qui aurait l’avantage d’expliquer la quantification de la charge : en effet, l’inobservabilité de la singularité de Dirac dans le potentiel vecteur en présence de deux dyons de charges électriques et magnétiques et impose la condition de Dirac-Schwinger-Zwanziger [Dir31, Sch66, Zwa68]
| (2.1) |
la charge électrique et la charge magnétique sont donc restreintes à prendre leurs valeurs dans le réseau
| (2.2) |
où la première relation définit notre convention pour le couplage de jauge . On voit ainsi que la dualité électrique-magnétique échangeant charges électrique et magnétique s’accompagne d’une inversion du couplage de jauge111Nous choisissons dès à présent les unités de mesure .
| (2.3) |
échangeant faible couplage et fort couplage. Les monopôles de la théorie de Maxwell correspondent cependant à des configurations singulières du champ de jauge, et leur existence est malheureusement fortement exclue par les données expérimentales.
2.1.2 Monopôle de ’t Hooft-Polyakov et conjecture de Montonen-Olive
L’intérêt pour ces particules a été relancé avec la découverte de solutions classiques de théories de jauges non abéliennes à symétrie spontanément brisée, chargées magnétiquement sous le groupe de jauge abélien résiduel [tH74a, Pol74]. La charge magnétique est donnée par un invariant topologique, et ces états sont donc stables classiquement. Leur masse est donnée classiquement dans le cas du modèle de Georgi-Glashow par
| (2.4) |
où désigne la valeur moyenne du scalaire de Higgs dans la représentation adjointe du groupe de jauge . Ceci est à comparer à la masse des bosons du spectre perturbatif,
| (2.5) |
Ces deux objets saturent donc la borne de Bogomolny [Bog76] apparaissant dans la limite de Prasad et Sommerfield [PS75] du modèle de Georgi-Glashow, où la longueur du champ de Higgs est gelée :
| (2.6) |
Cette relation, invariante sous la dualité électrique-magnétique, recevra plus loin une interprétation dans le cadre des théories supersymétriques. Un calcul semi-classique de diffusion montre également que la force statique entre deux monopôles s’annule, tout comme l’interaction entre deux particules de même charge, en raison de la compensation entre l’échange répulsif de bosons vecteurs et l’échange attractif de particules de Higgs . Ces constatations conduisirent en 1977 Montonen et Olive à formuler l’hypothèse de dualité électrique-magnétique des théories de jauge de groupe , généralisée peu après à tous les groupes compacts par Goddard, Nuyts et Olive, postulant l’équivalence des théories de jauge de couplage et , les monopôles magnétiques de ’t Hooft- Polyakov jouant le rôle des champs fondamentaux dans la formulation duale [MO77, GNO77].
2.1.3 Supersymétrie et propriété BPS
L’idée de dualité dans les théories quantiques des champs en tant que telle n’est pas neuve : la dualité de Kramers-Wannier entre les phases de haute température et de basse température du modèle d’Ising-Onsager en est sans doute le premier exemple ; le modèle de sine-Gordon à 1+1 dimensions s’est également révélé dual à fort couplage au modèle de Thirring, les solitons d’une théorie s’identifiant aux champs fondamentaux de la théorie duale [Col75] . L’importance particulière de la dualité de Montonen-Olive tient au fait qu’elle correspond à une théorie des champs à 3+1 dimensions non intégrable, et candidate à une description phénomènologique des interactions fortes et électrofaibles. Dans sa formulation première de Montonen et Olive, cette conjecture n’est cependant pas tenable, pour deux raisons apparemment distinctes. Premièrement, le couplage de jauge, par suite des corrections quantiques, dépend de l’échelle d’observation, et l’identification n’a pas de sens ; en outre la masse des solitons en fonction de ce couplage est sujette à des corrections quantiques et la validité de la formule (2.6) n’est pas assurée ; enfin, les monopôles du modèle de Georgi-Glashow sont des particules scalaires qui ne sauraient être identifiées aux particules fondamentales de spin 1.
Ces trois problèmes peuvent être résolus simultanément au prix d’une perte de généralité et de pertinence phénomènologique, en considérant des théories de jauge à supersymétrique étendue. La supersymétrie donne lieu à des théorèmes de non renormalisation permettant de contrôler les corrections quantiques. En particulier, les théories sont finies à tout ordre en perturbation, et l’action effective à deux dérivées ne reçoit aucune correction quantique 222Les théories sont en effet des exemples de théories conformes à quatre dimensions. La symétrie conforme est spontanément brisée par la valeur moyenne du champ de Higgs.. Le couplage de jauge est donc égale à sa valeur <<nue>>, et parler de son inversion ne pose pas de difficulté. La supersymétrie organise aussi le spectre en représentations dépendant des charges centrales de l’algèbre de supersymétrie étendue 333L’ouvrage [WB92] rassemble les informations essentielles sur la supersymétrie et la supergravité.
| (2.7a) | ||||
| (2.7b) | ||||
où les indices grecs correspondent aux indices spinoriels et les indices aux charges supersymétriques. La représentation irréductible générique, de dimensions vérifie l’inégalité
| (2.8) |
où désigne toute valeur propre de la matrice antisymétrique . Lorsque l’inégalité (2.8) est saturée pour une valeur propre , la représentation générique se réduit alors en deux représentations irréductibles de dimension moitié annihilées par la moitié des charges supersymétriques. Ce processus dichotomique se poursuit lorsque l’égalité dans l’équation (2.8) se produit pour plusieurs valeurs propres444La dimension est encore divisée par deux lorsque toutes les charges centrales s’annulent.. L’égalité dans la formule de masse (2.8) est alors exacte à tout couplage, sans quoi la dimension de la représentation changerait de manière discontinue. Dans le cas de la théorie de Yang-Mills de supersymétrie , la charge centrale s’écrit
| (2.9) |
où est la forme symplectique standard, et la borne de Bogomolny (2.6) apparaît comme une conséquence de l’algèbre de supersymétrie ; les monopôles magnétiques, comme les bosons appartiennent ainsi à des représentations courtes de l’algèbre de supersymétrie et comprennent donc un état de spin 1 555Le spin des monopôles provient de la quantification des modes zéro fermioniques en leur présence.. Plus généralement, on appelle borne de Bogomolny-Prasad- Sommerfield (ou borne BPS) l’inégalité (2.8), et états BPS les états la saturant. Ces états sont centraux dans l’étude des dualités en théories des champs et théories de cordes.
2.1.4 S-dualité de la théorie de Yang-Mills
Ignorée pendant une quinzaine d’années, la conjecture de dualité électrique-magnétique a de nouveau concentré l’intérêt en 1994 grâce au travail de Sen qui en a donné une vérification essentielle. En présence d’un couplage topologique , la charge électrique effective subie l’<<effet Witten>> [Wit79], de sorte que la masse d’un état BPS de charges électrique et magnétique (2.6) devient
| (2.10) |
Cette relation présente la propriété d’invariance sous le groupe modulaire des matrices de déterminant 1 et coefficients entiers agissant par
| (2.11) |
On est ainsi amené à conjecturer l’invariance de la théorie quantique elle-même sous cette symétrie, baptisée S-dualité. Ce groupe est engendré par la transformation de dualité électrique-magnétique , qui généralise la dualité de Montonen-Olive à une valeur non nulle de l’angle , ainsi que par le flot spectral , qui ne change pas les amplitudes mais agit non trivialement sur le spectre. L’existence de bosons de jauge dans le spectre implique alors l’existence de l’orbite sous de ces états, soit tous les états de charge , où et sont deux entiers premiers entre eux. Ces états BPS doivent correspondre à l’existence d’un état fondamental supersymétrique pour la mécanique quantique définie sur l’espace des modules classiques des monopôles de charge 666Cet espace a fait l’objet d’une étude mathématique approfondie, résumée dans l’ouvrage [AH88]., et Sen a pu construire explicitement la fonction d’onde dans le cas du monopôle magnétique de charge [Sen94].
La conjecture de S-dualité des théories de jauge supersymétriques a depuis fait l’objet de nombreux tests. En particulier, il a été prouvé que la fonction de partition de la version topologiquement <<twistée>> de ces théories de jauge sur une variété arbitraire était invariante sous la S-dualité [VW94], tout comme l’était la divergence infrarouge de l’énergie libre en présence de flux électriques et magnétiques, [GGPZ95]. La démonstration rigoureuse de l’invariance de la théorie de jauge originale est cependant restée hors d’atteinte 777La fonction de partition de la théorie de jauge abélienne non supersymétrique de Maxwell sur une variété de dimension 4 quelconque a été calculée indépendamment par E. Verlinde et E. Witten [Ver95, Wit95a] et présente un poids modulaire non trivial sous les transformations de S-dualité, où est la caractéristique d’Euler et la signature de la variété.. Elle apparaît maintenant comme une conséquence élémentaire de la conjecture de dualité des théories de supercordes. Cette conjecture n’a cependant pas encore mené au calcul de quantités non-triviales, comme par exemple des couplages à plus de deux dérivées, principalement en raison de la méconnaissance des contraintes de la supersymétrie sur ces quantités. Ce problème sera abordé dans le chapitre 3 dans le cadre des théories de supercordes. En revanche, l’extension par Seiberg et Witten de la conjecture de S-dualité aux théories supersymétriques a déclenché un grand retentissement tant en physique des particules qu’en mathématiques.
2.2 Dualité dans les théories de jauge de supersymétrie N=2
En regard des théories de jauge à supersymétrie bien dociles, les théories de jauge présentent une richesse étourdissante. En particulier, l’action effective de basse énergie n’est plus astreinte au théorème de non renormalisation et la fonction beta ne s’annule en général plus, de sorte que la dynamique peut réserver des surprises inattendues. Les contraintes de la supersymétrie restent cependant encore assez fortes pour permettre la détermination exacte de l’action effective à deux dérivées, comme l’ont montré Seiberg et Witten.
2.2.1 Action microscopique, action effective et supersymétrie N=1
Comme nous l’avons discuté dans l’introduction, les degrés de liberté des théories de jauge asymptotiquement libres à grande distance, correspondant aux particules observables à basse énergie, n’ont que peu à voir avec les degrés de liberté microscopiques en termes desquels la théorie est formulée, ceci en raison de la croissance rapide du couplage de jauge aux grandes échelles. On cherche donc à retenir les degrés de liberté de masse minimale, et caractériser leurs interactions à basse énergie en termes d’une action effective, obtenue après intégration de degrés de liberté de masse supérieure. Cette action effective peut être développée en puissance des moments ou dérivées, et l’on ne retient d’ordinaire que les termes cinétiques à deux dérivées au plus. Dans les théories supersymétriques, ceux-ci peuvent être caractérisés par le superpotentiel , fonction holomorphe des composantes scalaires des multiplets chiraux, le potentiel de Kähler , fonction réelle des mêmes champs, et la matrice des couplages de jauge et L’action à deux dérivées des champs bosoniques s’écrit alors
| (2.12) |
où nous n’avons retenu que les termes purement bosoniques, suffisants pour déterminer l’action complète par supersymétrie. Une formulation plus géométrique définirait les champs comme application de l’espace-temps dans une variété kählerienne , et le superpotentiel, dont la phase est sans signification, comme section holomorphe d’un fibré en ligne sur cette variété.
2.2.2 Supersymétrie , géométries spéciales et hyperkähleriennes
En présence de supersymétrie étendue , la structure de l’action effective devient plus contrainte. Les multiplets de l’algèbre de supersymétrie se combinent pour former des multiplets de l’algèbre :
-
•
un multiplet chiral et un multiplet vectoriel forment un multiplet vectoriel N=2, correspondant à un scalaire complexe , deux fermions de Weyl888Les propriétés de chiralité (Weyl) et réalité (Majorana) des représentations spinorielles sont discutées en détail dans la référence [KT83]. et un boson vecteur ;
-
•
deux multiplets chiraux N=1 forment un hypermultiplet N=2, correspondant à deux scalaires complexes et et deux fermions de Weyl.
La variété kählerienne se sépare alors, au moins localement, en un produit d’une variété de géométrie spéciale , de dimension paramétrée par les scalaires des multiplets vectoriels, et d’une variété hyperkählerienne , de dimension correspondant aux hypermultiplets. Le potentiel de Kähler s’écrit donc comme une somme de deux termes dépendant de chaque facteur séparément, et les couplages et angles de jauge ne dépendent que des scalaires des multiplets vectoriels. Les transformations de jauge correspondant aux interactions électro-magnétiques sont définies par les isométries communes aux deux variétés, et leur jaugement introduit le seul couplage entre les deux facteurs sous la forme d’un superpotentiel non-trivial (et bien entendu, de dérivées covariantes)999La référence [A+96] offre une description générale des couplages de la supergravité et supersymétrie .. En particulier, les hypermultiplets neutres et les multiplets vectoriels sont découplés en l’absence de la gravitation. Ce point sera à la base d’arguments de non renormalisation dans la suite de l’exposé.
Du côté des multiplets vectoriels, potentiel de Kähler, couplages et angles de jauge se trouvent unifiés en terme d’une section holomorphe d’un fibré vectoriel de groupe symplectique sur la variété selon
| (2.13) |
Cette description incorpore précisément les transformations de dualité électrique-magnétique correspondant aux rotations symplectiques sur le vecteur à composantes , généralisant les transformations de dualité au cas . Sous cette rotation, la section holomorphe se transforme comme un vecteur, laissant le potentiel de Kähler invariant. La matrice des couplages de jauge se transforme également en accord avec la dualité électrique-magnétique. Lorsqu’elles sont indépendantes, on peut choisir les quantités elles-mêmes comme coordonnées sur la variété de géométrie spéciale101010 On se prive ainsi de cas fort intéressants où la supersymétrie globale se trouve spontanément brisée en [APT96].. Les fonctions peuvent alors être obtenues en termes d’une fonction holomorphe dite prépotentiel , selon . Ce choix obscurcit cependant le rôle des transformations de dualité.
La variété hyperkählerienne définissant les interactions des hypermultiplets est elle aussi très contrainte. Elle ne possède malheureusement pas une caractérisation aussi explicite que la variété de géométrie spéciale, la raison profonde en étant l’absence de description en termes de superchamps hors de la couche de masse des hypermultiplets 111111Il existe bien une description en termes de super-espace harmonique , mais elle introduit une infinité de champs auxiliaires qui ne peuvent en général être éliminés [GIK+84]. Il existe également une classe de variétés hyperkähleriennes dites spéciales [CFG89], correspondant aux fibrés cotangents des variétés de géométrie spéciale, qui joue un rôle particulier en théorie des cordes, mais leur étude n’a pas été développée à sa pleine mesure.. Par définition, ces variétés admettent trois structures complexes covariantement constantes réalisant l’algèbre des unités des quaternions 121212On trouvera en appendice A une description plus complète des variétés hyperkähleriennes.. Le choix d’une structure complexe particulière équivaut au choix d’une sous-algèbre dans l’algèbre de supersymétrie . La forme de Kähler covariantement constante associée en fait une variété symplectique holomorphe dont le groupe d’holonomie est au plus compris dans . En particulier, la courbure de Ricci est nulle, et ces variétés (en dimension 4) définissent ainsi des instantons gravitationnels. Elles interviennent également comme espace des modules des monopôles et instantons, et les constructions de ADHM [ADHM78] et de Kronheimer-Nakajima [Kro89, Nak94] en donnent des réalisations explicites, loin cependant d’en épuiser la variété. L’étude de leur réalisation comme espace des modules de théories de jauge renormalisables fait l’objet de la publication en appendice A.
Cette caractérisation des actions à l’ordre de deux dérivées vaut aussi bien pour l’action microscopique définissant la théorie que pour l’action effective en donnant la limite à grande distance. Dans le premier cas, on se restreint à une action microscopique renormalisable, ce qui implique que les variétés des multiplets vectoriels et des hypermultiplets sont triviales. Les transformations de jauge agissent alors par des représentations linéaires sur les divers multiplets. En particulier, les multiplets vectoriels se transforment dans la représentation adjointe, tandis que les deux scalaires complexes des hypermultiplets se transforment dans deux représentations conjuguées, soit au total une représentation réelle. Cette absence de chiralité est en fait la principale limitation des théories de jauge de supersymétrie . Le second cas est bien plus intéressant, puisqu’il décrit la dynamique à basse énergie, une fois que l’effet des modes massifs a été intégré.
2.2.3 Phase de Coulomb, phase de Higgs, et associées
Le comportement à grande distance des théories de champs montre en général une variété de phases distinguées par des paramètres d’ordre correspondant aux valeurs moyennes de certains opérateurs. Dans le cas des théories de jauge asymptotiquement libre, ces paramètres d’ordre correspondent aux valeurs moyennes des champs scalaires des multiplets vectoriels et des hypermultiplets, autorisées par les directions plates du potentiel scalaire 131313Des valeurs moyennes correspondant à des minima locaux du potentiel effectif correspondraient à des vides non supersymétriques., et ces phases correspondent à des branches distinctes de l’espace des modules. Les valeurs moyennes des scalaires des multiplets vectoriels brisent génériquement la symétrie de jauge en un sous-groupe abélien de même rang (le tore de Cartan) et correspondent à la phase de Coulomb. Les valeurs moyennes des hypermultiplets dans la représentation fondamentale peuvent en revanche briser le groupe de jauge complètement, résultant en la phase dite de Higgs. Dans le cas d’une théorie de jauge avec doublets d’hypermultiplets, ces deux phases sont exclusives l’une de l’autre, et se connectent classiquement en un point où tous les scalaires s’annulent et la symétrie de jauge est restaurée. Dans des cas plus généraux, on peut avoir des branches mixtes où hypers et vecteurs condensent, et des restaurations de symétries partielles sur des sous-variétés de l’espace des modules .
Cette structure de l’espace des modules est basée sur l’analyse des directions plates du potentiel scalaire microscopique, et peut fort bien être modifiée par les corrections quantiques. L’absence de superpotentiel sur la variété de géométrie spéciale garantit que les directions plates de la phase de Coulomb ne seront pas levées, mais leur géométrie a toutes les raisons d’être modifiée, comme le montre le calcul explicite de Seiberg et Witten [SW94a, SW94b]. Nous en donnons ici une présentation sommaire, renvoyant aux cours et articles de revue [Ler97, AGH97] pour plus de détails.
2.2.4 Géométrie de la phase de Coulomb
La phase de Coulomb apparaît dans le cas le plus simple d’une théorie de jauge sans hypermultiplets. Le potentiel montre des directions plates correspondant à la valeur moyenne complexe du triplet de Higgs , brisant la symétrie de jauge en un sous-groupe abélien . L’espace des modules classique correspond donc au plan complexe quotienté par la symétrie correspondant à une transformation de jauge résiduelle, et paramétré de manière univoque par . La singularité conique à l’origine correspond à la restauration classique de la symétrie de jauge lorsque . D’une manière générale, on attend que chaque singularité corresponde à la divergence infrarouge associée à l’apparition d’un état de masse nulle. Cette image de l’espace des modules est certainement correcte pour grand, car a la dimension d’une énergie carrée, mesurée par rapport à l’échelle d’énergie dynamiquement générée
| (2.14) |
où est le coefficient de la fonction beta à une boucle ; ce régime correspond aux petites distances pour lesquelles la théorie est asymptotiquement libre. La section symplectique y est donnée par un calcul perturbatif, à une boucle en raison d’un théorème de non renormalisation perturbative :
| (2.15) |
et présente une monodromie non triviale sous les rotations :
| (2.16) |
Par compacité de l’espace des modules, cette monodromie doit être égale au produit des monodromies autour des singularités apparaissant à fini, soit en région de fort couplage. La monodromie associée à l’apparition de particules de charges et de masse nulle peut être calculée dans une description duale où sa charge est purement électrique, et s’écrit
| (2.17) |
Le problème de la factorisation de la monodromie à l’infini (2.16) en un produit de monodromies (2.17) pour des valeurs des charges électriques est bien défini, et admet une unique solution sous la forme de deux singularités de charges et correspondant respectivement à un monopôle magnétique et un dyon devenant de masse nulle en ces deux points. La singularité classique de l’espace des modules est ainsi résolue en deux points distincts, , où la théorie admet une description duale faiblement couplée. L’espace des modules quantique correspond donc à la sphère de Riemann privée de ces deux points et du point à l’infini, et il ne reste plus qu’à trouver une section holomorphe sur possédant les monodromies requises au voisinage des trois singularités.
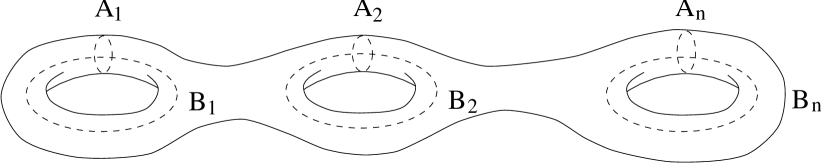
Ce problème peut être rattaché à l’étude des surfaces de Riemann en remarquant que le couplage de jauge peut être vu comme le paramètre modulaire d’un tore auxiliaire associé à chaque point de l’espace des modules. Plus généralement, pour un groupe de rang spontanément brisé en , les composantes peuvent être interprétées comme les périodes d’une certaine forme méromorphe sur les cycles d’une surface de Riemann de genre et de matrice de périodes (figure 2.1) 141414La matrice des périodes détermine la structure complexe de la surface de Riemann, et correspond aux périodes de la 1-forme holomorphe duale au cycle , voir par example [DP88]. . Les monodromies symplectiques sur les périodes correspondent alors simplement aux monodromies affectant la base symplectique des cycles d’homologie lorsque les modules de la surface de Riemann sont variés. Les périodes peuvent alors être déterminées en résolvant les équations de Picard-Fuchs avec les conditions asymptotiques appropriées. On peut ainsi obtenir une solution en termes de fonctions hypergéométriques pour la section , et remonter ainsi au prépotentiel exact . Le développement à faible couplage
| (2.18) |
montre alors une série d’effets non perturbatifs d’ordre
| (2.19) |
que l’on peut identifier aux contributions à instantons. Un calcul explicite permet du reste de vérifier les premiers termes de cette série. La même méthode permet d’obtenir l’action effective de basse énergie pour des théories de jauge asymptotiquement libres de groupe de jauge quelconque, en présence d’hypermultiplets chargés. Nous reviendrons sur l’étude de séries d’instantons analogues à l’équation (2.18), mais cette fois dans le contexte de la théorie des supercordes au chapitre 4.
La solution de Seiberg et Witten constitue un tour de force unanimement salué, et donne le premier exemple non-trivial de calcul exact à toute valeur du couplage. De nombreux enseignements ont pu en être tirés pour la compréhension des phénomènes de confinement, brisure de symétrie chirale et condensation de monopôles. Dans sa version <<twistée>>, elle a également permis une avancée majeure dans la classification des variétés différentielles de dimension 4, grâce au calcul des invariants topologiques de Seiberg et Witten.
2.2.5 Géométrie de la phase de Higgs
Contrairement à la branche de Coulomb, la géométrie de la branche de Higgs est protégée de toute correction quantique. Le couplage de jauge , ou de manière équivalente l’échelle , peut en effet être assimilé à la valeur moyenne dans le vide du champ scalaire d’un multiplet vectoriel gelé 151515tout comme la masse des hypermultiplets peut s’interpréter comme la valeur moyenne d’un multiplet vectoriel gelé correspondant au jaugement de la symétrie de saveur.. Le découplage des multiplets vectoriels et des hypermultiplets garantit alors l’indépendance de la métrique sur l’espace des modules des hypermultiplets en la constante de couplage. Ceci n’est cependant plus le cas en théorie des supercordes de type II supersymétriques , où la constante de couplage des cordes est un hypermultiplet dont peut donc dépendre la métrique de l’espace des hypermultiplets 161616L’espace des modules des hypermultiplets en théorie des cordes est une variété quaternionique et non plus hyperkählerienne. Il est cependant possible de définir une limite ¡¡plate¿¿ dans laquelle les effets gravitationnels disparaissent, et les corrections de théories des cordes subsistent.. Cette remarque est à l’origine de notre intérêt pour ce sujet, bien qu’elle n’est pas été approfondie dans le cadre de ce travail de thèse. L’absence de corrections quantiques, pour décevante qu’elle soit, ne diminue pour autant pas l’intérêt de l’étude de la phase de Higgs dans les théories de jauge . Elle permet en effet de donner des vérifications non triviales des conjectures de dualité électrique-magnétique, comme nous l’avons montré en collaboration avec Ignatios Antoniadis dans la publication en appendice A. Nous en donnons maintenant une présentation sommaire.
Comme dans le cas de la branche de Coulomb classique, la structure de la branche de Higgs s’obtient en déterminant les directions plates du potentiel scalaire, mais pour une valeur moyenne nulle des scalaires des multiplets vectoriels, et en identifiant les solutions reliées par la symétrie de jauge résiduelle. Le potentiel scalaire est généré par le jaugement des isométries de la variété hyperkählerienne ; dans le langage de la supersymétrie , il est la somme des F-termes des multiplets chiraux, égaux aux dérivées du superpotentiel, et des D-termes des multiplets vectoriels :
| (2.20) |
où la première somme est effectuée sur tous les champs chiraux et la seconde sur les générateurs du groupe de jauge. Dans le cas d’une théorie minimalement couplée, le superpotentiel et les D-termes s’écrivent en fonction des scalaires complexes et des multiplets vectoriels et hypermultiplets respectivement selon
| (2.21a) | ||||
| (2.21b) | ||||
où est la matrice hermitienne associée au générateur . Les vides supersymétriques sont donc obtenus pour des valeurs des champs scalaires extrémisant le superpotentiel et annulant le D-terme. En particulier, pour , on est ramené à équations algébriques complexes et équations réelles :
| (2.22a) | |||||
| (2.22b) | |||||
Ces trois équations réelles se transforment comme un triplet sous la symétrie agissant sur les structures complexes de la variété hyperkählerienne, et correspondent à l’annulation des trois applications moment correspondant à l’action du groupe d’isométrie sur la variété. Après avoir quotienté l’espace des solutions de ces équations par l’action du groupe de jauge, on obtient une variété de dimension dont on peut montrer qu’elle est encore hyperkählerienne. Cette construction est connue sous le nom de quotient hyperkählérien et généralise les notions de quotients symplectique et kählérien bien connues en mathématiques. La variété quotient décrit alors les interactions des hypermultiplets subsistant à basse énergie après le mécanisme de Higgs. Elle devient singulière lorsque l’action du groupe de jauge sur l’espace des solutions aux équations (2.22a) n’est plus libre, c’est-à-dire lorsque la symétrie non abélienne n’est pas totalement brisée, en accord avec l’idée que les singularités de l’action effective de basse énergie coïncident avec les points où des particules de masse nulle apparaissent. Notons finalement que cette construction peut être déformée en introduisant des termes de Fayet-Iliopoulos dans l’action microscopique, dont l’effet est de remplacer le second membre des équations (2.22a) par une constante non nulle pour les générateurs abéliens du groupe de jauge. La déformation résultante de l’espace des solutions en général restaure une action libre du groupe de jauge, et résout ainsi les singularités de l’espace quotient.
Dans le travail annexé en appendice A, nous avons étudié ces espaces quotients dans une variété de situations, que nous avons comparés à la lumière des dualités électrique-magnétique. Les branches de Higgs correspondant à la théorie microscopique avec saveurs à faible couplage se sont ainsi révélées coïncider avec les branches de Higgs émanant des différentes singularités à fort couplage décrites par des théories abéliennes en présence d’hypermultiplets chargés de masse nulle. Nous avons également découvert l’égalité de la branche de Higgs d’une théorie avec saveurs d’hypermultiplets dans la représentation fondamentale, avec la branche de Higgs d’une théorie de groupe de jauge et autant de saveurs. Cette identification rappelle la dualité conjecturée par Seiberg dans le contexte des théories de jauge de supersymétrie entre ces mêmes théories, mais s’en distingue par la présence du multiplet chiral adjoint caractéristique de la supersymétrie . Elle a par la suite trouvé une justification dans le cadre de la théorie des D-branes.
2.3 Symétries cachées des théories de supergravité
La résolution par Seiberg et Witten des théories de jauge de supersymétrie a considérablement modifié notre compréhension des théories des champs supersymétriques, en montrant comment l’information dans différentes limites perturbatives de l’espace des modules pouvait être combinée avec les impératifs de la supersymétrie grâce aux transformations de dualité pour restituer la structure exacte globale de la théorie de basse énergie. L’impact qu’elle a eu en théorie des supercordes ne s’expliquerait cependant pas sans le faisceau d’indications issu des théories de supergravité, qui représentent les théories de supercordes dans la limite de basse énergie. Ces théories révèlent, tout au moins au niveau de leur action classique, l’existence de symétries cachées de dualité reliant des régions de l’espace des modules faiblement couplées à des régions de fort couplage, bien que le terme de dualité électrique-magnétique ne soit plus adéquat dans ce cas. Ces théories n’existent au niveau quantique que par la théorie des supercordes qui les régularise et les prolonge à toute énergie. Leurs symétries cachées ne seront donc que le premier indice de la dualité des théories des supercordes que nous aborderons au chapitre suivant.
2.3.1 Supersymétrie locale, gravitation et unification
L’inclination naturelle du physicien contemporain le porte à jauger toute nouvelle symétrie interne qui lui échoit. La supersymétrie globale ne fait pas exception, mais son jaugement est loin d’être anodin : le commutateur de deux transformations de supersymétrie générant une translation, toute théorie invariante sous les transformations locales de supersymétrie sera en particulier invariante sous le groupe des difféomorphismes, et incluera donc le graviton de spin 2, avec son partenaire supersymétrique, le gravitino de spin 3/2. Cette complication cache en réalité une aubaine, puisqu’elle laisse espérer un meilleur comportement ultraviolet dans une théorie de la gravitation réputée non renormalisable. Qui plus est, en présence de supersymétrie étendue , on unifie gravitation et interactions de jauge en un multiplet supersymétrique gravitationnel contenant simultanément le graviton, les gravitini, et particules de spin 1 dits graviphotons. L’absence de particules non massives de spin supérieur à 2 impose une borne supérieure sur le nombre de supersymétries autorisées. L’unification maximale est réalisée dans la théorie de supergravité maximalement supersymétrique, qui n’autorise que le seul multiplet gravitationnel contenant tous les spins de 0 à 2. Elle n’échappe malheureusement pas à l’absence de chiralité caractéristique des théories à supersymétrie étendue.
D’abord développées comme théories de champs à quatre dimensions, les théories de supergravité ont connu un regain d’intérêt en relation avec le développement des théories des supercordes, qu’elles décrivent à basse énergie. Les théories de supergravité en dimension dix ont ainsi pu être classifiées, en parallèle avec la classification des supercordes critiques en dimension dix. La supergravité à onze dimensions est restée à l’écart de ce schéma avant d’être incorporée dans les développements les plus récents.
2.3.2 Supergravité de type I à dix dimensions
Les charges de la supersymétrie à 9+1 dimensions se répartissent en un spineur de Majorana-Weyl de 16 composantes, correspondant à charges supersymétriques dans le décompte en 3+1 dimensions. Ceci correspond à la supersymétrie maximale, et donc la dimension maximale également, d’une théorie de jauge à supersymétrie globale. Les multiplets vectoriels, contenant chacun un champ de jauge et un fermion de Majorana-Weyl de chiralité droite, peuvent être couplés au multiplet gravitationnel , contenant le graviton, le gravitino de chiralité gauche, un tenseur antisymétrique de jauge 171717On entend par tenseur antisymétrique de jauge, une forme différentielle de rang dont la dynamique présente l’invariance de jauge , où est toute forme différentielle de rang . En d’autres termes, est un élément du groupe de cohomologie de l’espace-temps. , un spineur droit et un scalaire dit dilaton, pour donner la théorie de supergravité dite de type I. Cet ensemble de champs correspond précisément aux modes de masse nulle des théories de supercordes de type I et hétérotiques, dont la valeur moyenne du dilaton représente la constante de couplage. La chiralité de ce contenu en champs entraîne l’existence d’anomalies gravitationnelles et de jauge, par exemple visibles dans les diagrammes en hexagone, qui ne peuvent être compensées que pour les groupes de jauge et . La théorie des cordes de type I fournit une réalisation de la première possibilité, où la symétrie de jauge est réalisée grâce aux charges de Chan-Paton portées par les extrémités de la corde ouverte 181818La restriction au groupe de jauge peut également être comprise comme la condition de compensation des diagrammes de tadpole.. La découverte du mécanisme de compensation d’anomalies en supergravité de type I par Green et Schwarz [GS84] a relancé la recherche d’une théorie des cordes de symétrie et a conduit à la découverte des cordes hétérotiques et [GHMR85]. L’unicité de la théorie de supergravité à dix dimensions sera un élément important en faveur de la dualité hétérotique-type I dont nous dirons un mot au chapitre suivant.
2.3.3 Supergravité de type IIB
La définition d’une théorie de supergravité à dix dimensions requiert le choix de la chiralité relative des deux charges spinorielles de Majorana-Weyl définissant l’algèbre de supersymétrie. Le choix de deux spineurs de chiralité opposée conduit à une théorie non chirale, dite de type IIA, que nous détaillerons au paragraphe suivant. Dans le cas de deux spineurs de même chiralité, on obtient la supergravité chirale de type IIB, dont le multiplet gravitationnel contient, en plus du graviton et des deux gravitini, deux tenseurs antisymétriques de jauge et , deux spineurs de même chiralité, un scalaire complexe , ainsi qu’un tenseur antisymétrique de jauge à quatre indices à courbure courbure auto-duale ; les anomalies gravitationnelles sont précisément compensées pour ce multiplet [AGW84], qui est le seul multiplet de spin inférieur ou égal à deux autorisé par la supersymétrie maximale à 32 supercharges. Ce contenu en champs correspond au spectre de masse nulle de la théorie des supercordes de type IIB. En particulier, la partie réelle du scalaire complexe , la deux-forme et la quatre-forme proviennent du secteur de Ramond de la corde de type IIB 191919Les notions de secteur de Ramond et de secteur de Neveu-Schwarz seront introduites dans le chapitre 3, section 3.2.1. Nous noterons les champs de Ramond avec des lettres rondes, pour les distinguer des champs de Neveu-Schwarz en lettres droites., tandis que la partie imaginaire de est identifiée avec , l’inverse de la constante de couplage de la théorie des cordes. La supergravité de type IIB se révèle être invariante sous le groupe de symétrie continue , agissant sur les champs bosoniques selon
| (2.23) |
et laissant invariants la métrique et le tenseur antisymétrique à quatre indices[Sch83]. Cette symétrie continue classique ne saurait cependant survivre quantiquement en raison de la quantification de Dirac de la charge associée aux champs de jauges et . Il peut cependant en subsister un sous-groupe discret , contenant en particulier l’inversion reliant le régime de faible couplage au régime de fort couplage [HT95]. Cette symétrie jouera un rôle important dans la conjecture de dualité des supercordes, et central dans les développements dans lesquels j’ai été impliqué.
2.3.4 Supergravité de type IIA et supergravité à onze dimensions
L’autre option consiste à choisir deux spineurs de chiralité opposée pour définir une algèbre de supersymétrie dite de type IIA. Le multiplet gravitationnel consiste alors, en sus du graviton et de deux gravitini de chiralité opposée, de tenseurs de jauge , , , de deux spineurs de Weyl-Majorana et d’un scalaire réel correspondant au dilaton. Les champs de jauge et correspondent au secteur de Ramond de la supercorde de type IIA. Contrairement à la supergravité de type IIB, la supergravité de type IIA ne présente pas de symétrie reliant fort et faible couplage. En revanche, son contenu en champs est identique à celui de la réduction dimensionnelle à la Kaluza-Klein d’une théorie de supergravité à onze dimensions contenant, en plus du graviton et d’un gravitino de Majorana , une trois-forme de jauge . L’action de cette théorie a été construite par Cremmer, Julia et Scherk [CJS78], et s’écrit, en ne retenant que les termes bosoniques,
| (2.24) |
La normalisation relative des termes cinétiques et du terme de Wess-Zumino est fixée par l’algèbre de supersymétrie. La réduction dimensionelle de Kaluza-Klein consiste à compactifier la théorie sur un cercle de rayon et à omettre la dépendance des champs sur la dimension interne (voir par exemple [SS82]). Cette procédure est valable aux énergies inférieures à , pour laquelle les états de moment interne peuvent être ignorés. La métrique à onze dimensions se réduit ainsi en une métrique à dix dimensions , un rayon fluctuant dans l’espace non compact et un champ de jauge , selon l’ansatz
| (2.25) |
Le tenseur de jauge en onze dimensions donne quant à lui après réduction dimensionelle une trois-forme et une deux-forme . Dans le référentiel d’Einstein, c’est-à-dire après dilatation de Weyl afin de découpler le rayon de l’action d’Einstein-Hilbert, l’action de la supergravité à onze dimensions réduite à dix dimensions s’écrit alors
| (2.26) |
où on a identifié le dilaton au rayon selon . Cette action reproduit précisément l’action de la supergravité de type IIA ; les implications de cette coïncidence ne seront pleinement réalisées que dans le cadre de la théorie des supercordes de type IIA, qui donne une définition microscopique d’une théorie des champs autrement non renormalisable.
2.3.5 Compactification toroïdale et U-dualité
Nous avons jusqu’à présent décrit les théories de supergravité en dimension 10, dimension critique des théories de supercordes. Ces théories incorporent cependant la gravité, et la géométrie 202020Le terme géométrie inclut ici non seulement la valeur moyenne de la métrique , mais aussi de tous les autres champs, scalaires, de jauge et fermioniques inclus. de l’espace-temps qu’elles choisissent est en principe une question déterminée par la dynamique quantique. En raison de leur supersymétrie cependant, le potentiel effectif dans l’espace des géométries présente des directions plates, et on est libre de considérer la théorie au voisinage d’un point quelconque de ces géométries, en particulier en un point où l’espace-temps se décompose en une variété plate non compacte correspondant à l’espace-temps ambiant, et une variété compacte de dimension et de rayon très petit devant l’échelle d’observation. Les fluctuations de la géométrie le long des directions plates au voisinage du vide choisi correspondent à des champs scalaires de masse nulle dits champs de modules. La supersymétrie est en général brisée par la compactification. La raison en est que les générateurs de la supersymétrie correspondent aux configurations covariantement constantes du spineur relié au gravitino par supersymétrie, lesquelles disparaissent pour des variétés de courbure quelconque, c’est-à-dire de groupe d’holonomie . Pour des variétés à holonomie restreinte cependant, il existe des configurations de spineur invariantes par transport parallèle, et donc une algèbre de supersymétrie éventuellement étendue. Les isométries de la variété de compactification apparaissent comme des symétries de jauge dans la théorie réduite, ainsi que nous l’avons vu dans l’exemple de compactification sur un cercle du paragraphe précédent, et le groupe des difféomorphismes de la variété interne peut également donner lieu à des symétries globales dans la théorie réduite. Le cas le plus simple est celui d’une variété compacte plate, c’est-à-dire d’un tore , pour lequel toutes les supersymétries sont conservées 212121 En dimension paire, le groupe d’holonomie peut être réduit de à , correspondant aux variétés kähleriennes à courbure de Ricci nulle, dites variétés de Calabi-Yau, et il existe alors un spineur neutre sous et donc covariantement constant. En dimension multiple de 4, on peut encore réduire le groupe d’holonomie à , correspondant aux variétés hyperkähleriennes que nous avons déjà discutées. On peut également compactifier sur une sphère sans briser aucune supersymétrie, à condition de choisir un espace anti-de Sitter pour les dimensions non compactes [FR80, Sch83, MJDP98]. Les isométries de translation donnent lieu à une invariance de jauge , éventuellement étendue à une symétrie non abélienne pour certaines valeurs des modules du tore, tandis que le groupe des difféomorphismes du tore donne lieu à une symétrie globale , dont un sous-groupe agit trivialement.
Si l’intérêt phénoménologique de la compactification est évident, son intérêt théorique demande peut-être plus de justification. On pourrait en effet argumenter que la compactification d’une théorie des champs ne fait que quantifier l’impulsion des particules, entraînant l’existence de tours d’états de Kaluza-Klein, et ne fait qu’ajouter au problème une complication inutile. Cette vue oublie cependant de prendre en compte l’existence possible d’états étendus dans la théorie non compactifiée, qui peuvent être stabilisés grâce à l’existence de cycles d’homologie non triviaux de l’espace compact. Il se peut également qu’une symétrie <<cachée>> dans la théorie non compactifiée se combine avec les symétries inhérentes à la compactification en un groupe plus grand de symétries tout à fait visibles. C’est précisément le cas des compactifications toroïdales des théories de supergravité à supersymétrie maximale, ainsi que l’ont reconnu Cremmer et Julia [CJ79].
Ainsi, la compactification de la théorie de type IIA sur un tore montre une extension de la symétrie évidente, en un groupe de symétrie caché mélangeant les modules de avec le dilaton et les lignes de Wilson du champ de jauge de Ramond . Cette symétrie n’est autre que la manifestation de la filiation entre la théorie de supergravité de type IIA et la supergravité à onze dimensions discutée au paragraphe précédent. Par ailleurs, la compactification de la théorie de type IIA sur un cercle de rayon (et a fortiori sur un tore , ) et de couplage , se révèle strictement équivalente à la compactification de la supergravité de type IIB de couplage sur un cercle de rayon , moyennant l’identification du scalaire de Ramond de type IIB avec la ligne de Wilson sur le cercle du champ de jauge de la théorie de type IIA. Cette propriété n’est quant à elle que le reflet à basse énergie de la T-dualité des théories des cordes perturbatives, que nous discuterons au chapitre suivant. En utilisant cette équivalence, la dualité de la théorie des supercordes de type IIB, après compactification sur un cercle et T-dualité, n’est autre que la symétrie géométrique de la supergravité à onze dimensions compactifiée sur un tore .
Cette structure ne fait que s’étendre pour des compactifications sur des tores de dimension . L’espace des modules contient en effet un sous-espace homogène , correspondant aux modules de la métrique sur le tore définissant la compactification de la supergravité à onze dimensions, mais aussi un sous-espace , d’intersection non vide avec le précédent, définissant les modules de la métrique et du tenseur antisymétrique du secteur de Neveu-Schwarz sur le tore . Du point de vue de la théorie des cordes, ces modules coïncident avec les paramètres de la théorie conforme de bosons compactifiés, et sont identifiés sous l’action du groupe de T-dualité 222222En effectuant deux T-dualités successives, on obtient en effet une symétrie de la supergravité de type IIA compactifiée sur (et non plus une dualité avec la supergravité de type IIB). L’ensemble de ces transformations forme le groupe discret .. L’espace des modules total contenant ces deux sous-espaces s’écrit encore comme un quotient , où est le groupe non compact généré par et , et son sous-groupe compact maximal 232323Cette dernière propriété est une conséquence de la positivité de la métrique sur l’espace , c’est-à-dire de l’absence de fantômes dans la dynamique des scalaires.. Pour , les groupes correspondent à des versions non compactes des groupes de Lie exceptionnels et , tandis que pour ils se réduisent aux groupes classiques
| (2.27) |
Le groupe apparaît comme une symétrie globale de l’action de la théorie de supergravité compactifiée sur (et non seulement de l’espace des modules), tandis que le groupe est un groupe de symétrie locale. Il n’est cependant pas associé à des champs de jauge fondamentaux mais à une connection composite construite à partir des champs scalaires, et l’invariance de jauge peut être fixée en choisissant un réprésentant de ces scalaires dans l’orbite de .
L’appellation historique de <<symétrie cachée>> peut sembler à ce stade déconcertante : nous en avons attribué une partie à l’existence de la T-dualité, et l’autre à l’existence d’une théorie de supergravité à onze dimensions dont la théorie de type IIA est la réduction dimensionnelle. Elle reste cependant justifiée pour plusieurs raisons :
-
•
la T-dualité est visible dans la théorie de type IIA à dix dimensions, mais n’a à ce jour pas été exhibée comme symétrie de la théorie à onze dimensions. En d’autres termes, l’action de la T-dualité sur les modes de Fourier d’impulsion non nulle autour du cercle de rayon n’est pas connue.
-
•
la T-dualité est une symétrie perturbative de la théorie de cordes de type IIB, mais ce n’est pas le cas de l’invariance de Lorentz à 11 dimensions. En particulier, l’opération qui échange un rayon de compactification avec le rayon de la onzième dimension ne préserve pas la série de perturbation en .
-
•
seul un sous groupe discret de la symétrie continue de l’action effective de basse énergie subsiste au niveau de la théorie des cordes, en raison de la quantification des impulsions dans l’espace compact. Existe-t-il donc un sous-groupe résiduel du groupe de symétrie continue , dit groupe de U-dualité, incluant des dualités non perturbatives ?
Ces questions ne peuvent avoir un sens que si une extension non perturbative des théories de supergravité existe. La définition perturbative de ces théories non renormalisables est déjà un problème en soi, auxquelles les théories des cordes, que nous introduirons dans le chapitre suivant, fourniront la solution, en offrant une régularisation finie dans l’ultraviolet. La définition non perturbative quant à elle est partiellement résolue par la conjecture de dualité des supercordes, mais n’a pas encore été totalement explicitée. Considérées comme théories effectives de basse énergie des théories de supercordes, les théories de supergravité fournissent néanmoins des indications précieuses sur le contenu de cette hypothétique théorie des cordes non perturbative, en particulier grâce à l’étude de leurs solutions classiques vers lesquelles nous nous tournons maintenant.
2.4 Solitons de -brane des théories de supergravité
L’étude du spectre BPS des solutions classiques des théories de supergravité révèle une diversité d’objets solitoniques étendus, en correspondance avec la diversité des champs de jauge présents. Avec les symétries cachées décrites dans la section précédente, l’existence de ces états sera un argument essentiel de la conjecture de dualités des théories de supercordes. Nous en donnerons une brève description, renvoyant le lecteur aux nombreux articles de revue pour plus de détails (par exemple, [DKL95, Duf96, Ste96, Tow96, Tow97]).
2.4.1 Tenseurs antisymétriques de jauge et -branes
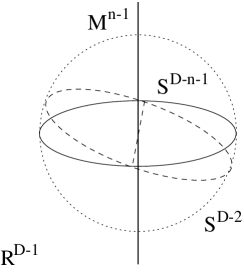
Avant de donner une description explicite de ces solutions classiques, il est souhaitable d’identifier le type de configurations solitoniques attendues. Le secteur bosonique des théories de supergravité à dix dimensions comprend la métrique , le dilaton et plusieurs tenseurs antisymétriques de jauge , où l’indice désigne le rang de la forme différentielle. On s’intéresse en particulier aux solitons chargés sous ces tenseurs de jauge 242424On peut également considérer des solutions purement gravitationnelles où le potentiel de jauge est nul et le dilaton constant. Excepté pour le cas de l’onde gravitationnelle, la géométrie asymptotique de ces solutions n’est cependant pas minkovskienne, et on n’obtient pas ainsi de solitons de la théorie plate. On peut cependant obtenir des solutions de géométrie asymptotique (en utilisant l’espace d’Einstein self-dual de Taub-NUT, de géométrie asymptotique ) décrivant des monopôles magnétiques de Kaluza-Klein de la théorie compactifiée sur [Sor83], localisés dans 4 dimensions et donc assimilables à des -branes.. En dimension 3+1, la charge électrique associée à un champ de jauge est mesurée par le flux du champ électrique à travers une 2-sphère entourant la configuration. La charge électrique est donc essentiellement ponctuelle, en accord avec le fait que la dynamique d’une particule ponctuelle peut être naturellement couplée à la 1-forme par un couplage dans l’action. La charge magnétique est définie de manière identique après dualité de Poincaré , soit par le flux . Elle est conservée en vertu de l’identité de Bianchi , tandis que la conservation de la charge électrique requiert l’équation du mouvement dans le vide . De manière analogue, on définit la charge électrique associée à un tenseur de jauge de rang dans un espace temps de dimension comme l’intégrale sur une sphère de dimension à l’infini, sous-variété de la sphère à l’infini spatial (figure 2.2). La charge correspondante est donc portée par un objet transverse à dans , soit de dimension . Le tenseur de jauge de rang se couple d’ailleurs naturellement au volume d’univers d’un objet étendu de dimensionnalité par le couplage . Ainsi, en dimension 3+1, la charge associée à une deux-forme est portée par une corde, et mesurée par le flux sur un cercle à l’infini transverse à la corde. Notons que la charge ne dépend en général pas des variations infinitésimales de la section de la sphère à l’infini , mais qu’elle subit une discontinuité lorsque cette section intersecte la corde, ou tout autre objet chargé. En particulier, la charge s’annule si la corde ne s’étend pas à l’infini. La charge magnétique sous est bien entendu définie comme la charge électrique par rapport au dual de Poincaré . Cette charge est donc portée par des objets étendus dans directions. Les objets chargés par rapport au potentiel correspondent donc à des objets étendus sur dimensions internes, communément baptisés -branes. La dualité électrique-magnétique en dimension échange donc -branes et -branes .
Les solutions des théories de supergravité correspondant à ces objets étendus peuvent être obtenues en décomposant les coordonnées de l’espace temps en coordonnées de volume d’univers et coordonnées transverses . On considère alors un ansatz
| (2.28a) | |||
| (2.28b) | |||
| (2.28c) |
où la métrique et le dilaton, invariants sous les translations le long du volume d’univers, ne dépendent que du rayon transverse , et où désigne l’élément de volume du volume d’univers de la -brane. De telles solutions décrivent en réalité des -branes <<épaisses>> dont la taille dépend de la vitesse de décroissance de . L’interprétation solitonique requiert également que cette décroissance soit assez rapide pour que l’espace soit asymptotiquement plat, de sorte que de telles solutions puissent être mises en présence à grande distance.
Avant de pouvoir déterminer les fonctions de l’ansatz précédent, il est nécessaire de préciser le lagrangien que l’on considère. Ne s’intéressant qu’aux solutions chargées par rapport à un seul champ de jauge , on peut omettre tous les autres potentiels de jauge, et se restreindre à
| (2.29) |
La valeur du couplage au dilaton dépend du modèle considéré. Cette troncation préserve l’existence d’une charge supersymétrique . L’invariance sous cette charge implique l’invariance sous la moitié des supersymétries originelles.
2.4.2 Membranes et 5-branes à onze dimensions
Les fonctions peuvent maintenant être déterminées par la condition BPS d’invariance sous la supersymétrie . Nous renvoyons le lecteur à l’article de revue [Ste96] pour une présentation complète, et nous nous contentons ici de décrire les caractéristiques générales des solutions obtenues, tout d’abord dans le cas de la supergravité à onze dimensions. On obtient dans ce cas des solutions solitoniques de -brane, aussi appelées membranes, chargées électriquement sous la trois-forme , et des solutions de 5-brane chargées magnétiquement sous . Ces objets infiniment étendus dans 2 (resp. 5) dimensions spatiales possèdent une tension, soit une masse par unité de volume d’univers, de (resp. ), où est l’unique échelle de longueur de la supergravité à 11 dimensions. La géométrie de la membrane interpole entre l’espace asymptotiquement plat à grande distance et un espace 252525La notation désigne un espace maximalement symétrique anti-de Sitter de dimension . à l’horizon . Elle peut être continuée analytiquement au-delà de l’horizon jusqu’à une singularité de genre temps correspondant à une deux-brane infiniment fine. La 5-brane en revanche est régulière partout, et interpole entre l’espace asymptotiquement plat et à l’horizon. La continuation au-delà de l’horizon montre que l’espace intérieur peut être identifié avec l’espace extérieur à l’horizon . Ces solutions correspondent à des configurations extrêmes de solutions de <<p-branes noires>> où l’horizon interne coïncide avec l’horizon externe. Ce cas est en effet le seul préservant la moitié des supersymétries. En conséquence, elles saturent les inégalités de Bogomolny entre la masse par unité de volume d’univers et les charges électriques et magnétiques sous le champ de jauge : ce sont donc des états BPS annihilés par la moitié des supersymétries.
L’existence de ces solutions semble peser en faveur d’une description microscopique de la théorie de supergravité à onze dimensions en termes d’une théorie de supermembranes. Cette espérance est malheureusement déçue par les difficultés de quantifier les non-linéarités de la dynamique des supermembranes. Nous reviendrons sur cette question dans le dernier chapitre de ce mémoire.
2.4.3 Solitons des supergravités à dix dimensions
La même approche fournit des solutions de -branes pour toutes les théories de supergravité en dimension 10, associées à chaque tenseur de jauge. Dans le cas de la supergravité de type IIA, on peut de manière équivalente étudier comment celle-ci hérite des solutions de la supergravité à onze dimensions par compactification sur le cercle de rayon . Deux types de réduction sont en général envisageables262626On peut également réduire le long d’une isométrie angulaire, mais le statut de cette procédure est encore peu clair [MJDP98]. :
-
•
Dans le cas où le volume d’univers de la -brane contient la direction compactifiée, c’est-à-dire lorsque la -brane est enroulée sur cette direction, on peut quotienter par l’isométrie correspondante pour obtenir une -brane en dimension . Cette opération est dite réduction diagonale. La tension de la membrane réduite est alors .
-
•
Si au contraire le volume d’univers de la -brane est transverse à la dimension compacte, la symétrie de translation est brisée et on ne peut alors plus prendre le quotient. On peut en revanche considérer un empilement continu de -branes dans la direction compacte, de manière à restaurer la symétrie de translation. La possibilité de superposer des configurations identiques de -branes est intimement liée à l’absence d’interactions statiques entre configuration BPS. On obtient ainsi une -brane de même tension en dimension inférieure, ce qui vaut à ce processus le nom de réduction verticale.
La membrane de la supergravité à onze dimensions donne ainsi par réduction diagonale une 1-brane de tension et chargée par rapport au tenseur de jauge de Neveu-Schwarz , qui n’est autre que la corde fondamentale de la théorie de type IIA ; et par réduction verticale une D2-brane de tension chargée par rapport au tenseur de jauge de Ramond : nous appellons NS-branes les -branes chargées sous les tenseurs de jauge de Neveu-Schwarz, et D-branes celles chargées sous les champs de Ramond, pour des raisons qui apparaîtront dans la section 3.3.3.
De même, la 5-brane de la supergravité à onze dimensions chargée magnétiquement sous donne par réduction la D4-brane de tension , chargée sous le tenseur de jauge de Ramond , ainsi que la NS5-brane de tension , chargée magnétiquement sous le tenseur de Neveu-Schwarz . Le monopôle de Kaluza-Klein de la supergravité à onze dimensions apparaît comme la D6-brane de tension 272727Il donne également par réduction diagonale le monopôle de Kaluza-Klein de la supergravité de type IIA compactifiée sur un cercle de rayon , correspondant à une 5-brane de tension ; et par réduction verticale une 6-brane de tension , sur laquelle nous reviendrons dans le dernier chapitre.. Il faut encore ajouter à ces objets étendus les états issus de l’onde gravitationnelle en dimension 11, correspondant au supergraviton à dix dimensions ainsi qu’à ses excitations de Kaluza-Klein, de masse , identifiées aux D0-branes de la théorie de type IIA et à ses états liés.
Dans le cas de la supergravité de type IIB, cette procédure de réduction n’est bien entendu pas applicable et on doit reprendre l’approche précédente. On obtient ainsi une D1-brane chargée sous ; une D3-brane chargée sous le tenseur de jauge à courbure autoduale ; une D5-brane magnétiquement chargé sous , ainsi qu’une autre NS5-brane chargée sous le tenseur de jauge de Neveu-Schwarz . La 1-brane solitonique est un candidat de corde duale à la corde fondamentale sous la dualité de la théorie de type IIB si cette dualité doit exister, et les deux 5-branes en formeraient alors un doublet. On obtient également un cas dégénéré de solution avec un volume d’univers réduit à un point, soit une D-brane . L’espace correspondant étant de signature euclidienne, cette solution doit être identifiée à une configuration instantonique de la supergravité de type IIB. Cet objet sera essentiel aux développements traités au chapitre 4.
La théorie de type I quant à elle comprend un tenseur de jauge du secteur de Ramond en même temps que les bosons de jauge de la symétrie non abélienne . De fait, la supergravité de type I montre l’existence d’un soliton de D1-brane chargé électriquement sous , qu’il est tentant d’identifier à la corde hétérotique de groupe de jauge ; ainsi que de trois types de solitons de 5-brane [CHS91a] : la 5-brane neutre est chargée sous le tenseur de la corde hétérotique ou le tenseur de la corde de type I mais neutre sous le groupe de jauge, tandis que les 5-branes de jauge et symétriques, construites à partir d’un instanton de Yang-Mills dans les directions transverses, sont chargées à la fois sous et sous le groupe de jauge. La 5-brane symétrique présente la particularité d’être une solution exacte en des équations du mouvement issues de la théorie des cordes, correspondant à une théorie superconforme.
Par opposition aux particules ponctuelles, ces objets étendus possèdent des degrés de liberté externes correspondant aux modes zéro des champs de la supergravité en leur présence. Ces modes sont associés aux symétries brisées par la présence du soliton, en particulier la symétrie de translation dans les directions transverses, et correspondent à des coordonnées collectives généralisées de la -brane [GJS76, CHS91b]. Les excitations de ces modes modifient la position de la -brane ainsi que sa forme, et la -brane doit bien plus être comprise comme un objet compact étendu que comme un plan rigide infini. La théorie des champs (ou la mécanique quantique, pour ) définissant la dynamique de ces modes sur le volume d’univers peut en principe être obtenue en évaluant l’action microscopique sur la configuration des champs du soliton. Les supersymétries préservées par le soliton BPS correspondent à autant de supersymétries de la théorie de volume d’univers, tandis que les supersymétries brisées sont réalisées non-linéairement, c’est-à-dire spontanément brisées. Les premières peuvent être rendues manifestes grâce à l’introduction d’une supersymétrie locale dite kappa-symétrie, dont la fixation impose l’égalité des nombres de degrés de liberté bosoniques et fermioniques. La détermination de la dynamique des modes zéros d’un soliton est un problème difficile ; Polchinski en a donné la solution dans le cadre de la théorie des supercordes ouvertes, tout au moins pour les -branes chargées sous les tenseurs de Ramond de la corde de type II. Dans le cas de la 5-brane hétérotique, certains modes zéros apparaissent non perturbativement et la théorie de volume d’univers est décrite par une théorie des cordes, et non plus une théorie des champs [CHS91a, Wit96b, SS97a].
2.4.4 Compactification et cycles supersymétriques
Etant donné le spectre des configurations solitoniques en dimension maximale, on peut en principe en déduire le spectre en dimension inférieure en enroulant les directions internes des solitons autour des directions compactes. Les réductions diagonale et verticale que nous avons discutées au paragraphe précédent fournissent l’exemple le plus simple de ce processus pour le cas des compactifications toroïdales, et n’affectent pas le nombre de supersymétries préservées par les états correspondants. Dans le cas de la compactification sur des espaces courbes de Calabi-Yau, l’enroulement de l’état sur un cycle quelconque brise toutes les supersymétries, et la stabilité de l’état correspondant n’est pas garantie. Pour certains cycles cependant, dits supersymétriques, la supersymétrie brisée par la présence du soliton peut être compensée par une kappa-symétrie sur le volume d’univers du soliton. Les conditions sur les trois-cycles des espaces de Calabi-Yau de dimension 6 ont été analysées par K. et M. Becker et A. Strominger [BBS95] ; cette analyse a été étendue par Ooguri et al. par un argument basé sur la description microscopique des solitons en termes de D-branes, et conduit à deux catégories de cycles supersymétriques sur les espaces de Calabi-Yau de dimension complexe : [OOY96] :
-
•
les cycles de type A, de dimension réelle , sont tels que le pull-back de la -forme holomorphe est proportionnel à la forme volume induite par la métrique de sur le cycle .
-
•
les cycles de type B sont les sous-variétés holomorphes de la variété .
Les cycles supersymétriques sont donc en particulier de volume minimal 282828En présence de champs de jauge, cette définition doit être étendue, et c’est l’action de Born-Infeld du soliton qui doit être extrémale.. Ainsi, dans le cas du tore , les cycles de type B sont simplement les points, et ses recouvrements, tandis que les cycles de type A sont tels que où la phase est constante : il s’agit donc d’une ligne droite tracée sur le tore. Dans le cas des variétés de Calabi-Yau de dimension , ou variétés , les cycles de type A et B se confondent, grâce à la symétrie de la variété hyperkählerienne qui échange la deux-forme holomorphe et la forme de Kähler .
Chapter 3 Pluralité, dualité et unicité des théories de supercordes
Le lecteur aura sans doute été gêné par la discussion des dualités non perturbatives des théories de supergravité au chapitre précédent, alors que ces théories foncièrement non renormalisables ne sont déjà pas définies comme théories de perturbation. La renormalisabilité d’une théorie des champs n’est cependant un critère important que lorsque cette théorie prétend à une description fondamentale à toute énergie ; et encore la non-renormalisabilité au sens du comptage de puissance n’implique-t-elle pas l’absence de schéma de renormalisation cohérent. Les théories de supergravité ne prétendent cependant qu’à une description effective de la dynamique à basse énergie induite après intégration sur les modes massifs de fréquence supérieure à une échelle . Il n’est donc pas question d’intégrer les diagrammes de boucles sur des moments infiniment grands, mais seulement sur les moments inférieurs à . La description microscopique est fournie par les théories de supercordes, qui contrairement à ces théories des champs ne souffrent pas de divergences ultraviolettes. Les contraintes de cohérence restreignent ces théories à cinq modèles définis en dix dimensions, donnant naissance à une variété presque infinie de modèles en dimensions inférieures. Il existe de nombreux ouvrages d’introduction à la théorie des cordes [GSWa, GSWb, LT89, Pol94a, OY96, Kir97, Vaf97], dont le très complet livre vert de Green, Schwarz et Witten ; fidèles à notre approche, nous nous contenterons d’en donner une introduction très condensée dans les sections 1 et 2 de ce chapitre, en insistant sur les points nécessaires à la compréhension des travaux présentés dans cette thèse.
Une fois résolu le problème de la définition perturbative des théories de supergravité, restera la question beaucoup plus épineuse de la définition non perturbative des théories de supercordes. Cette définition n’existe pas encore explicitement. Les relations de dualité entre théories de supercordes en donnent une définition partielle, en identifiant le régime de fort couplage d’une théorie de supercordes au régime de faible couplage de la théorie duale. Nous décrirons avec plus de détails dans la section 3 de ce chapitre, après en avoir donné un avant-goût au chapitre précédent dans le cadre des théories de supergravité. Ces dualités indiquent l’existence d’une théorie non perturbative des supercordes, dont les cinq théories de supercordes perturbatives représentent les développement limités dans cinq limites de son espace des modules ; cette théorie fondamentale fera l’objet des deux derniers chapitres de ce mémoire.
Dans ce travail de thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés à la dualité des théories hétérotique et de type II à seize charges supersymétriques, qui contient la richesse des effets non perturbatifs des théories des supercordes sans requérir l’arsenal de la géométrie algébrique des espaces de Calabi-Yau. Nous avons en particulier donné des tests de cette dualité dans les couplages gravitationnels des compactifications twistées de ces théories, en collaboration avec A. Gregori, N. Obers, E. Kiritsis, C. Kounnas et M. Petropoulos ; nous avons également vérifié cette dualité dans les couplages scalaires du dilaton de la théorie de type II, au cours d’une collaboration avec I. Antoniadis et T. Taylor. Ce chapitre constitue une introduction à ces contributions, rassemblées dans les appendices B et F de ce mémoire Nous reviendrons sur ces travaux dans le chapitre 4, sous l’aspect des effets instantoniques de membrane.
3.1 La corde bosonique
L’idée de résoudre le problème des divergences ultraviolettes des théories des champs en supposant une extension finie aux particules élémentaires est aussi vieille que les théories des champs elle-mêmes. Elle a cependant resurgi avec vigueur au début des années 1970, après la gestation des modèles duaux, sous la forme de la théorie des cordes. Cette théorie considère la dynamique relativiste d’un objet unidimensionnel filiforme. Tout comme une particule ponctuelle de masse décrit une ligne d’univers de genre temps dont l’action est mesurée par la longueur propre
| (3.1) |
la corde décrit une surface d’univers dont l’action est mesurée par la surface propre
| (3.2) |
où on a rassemblé le temps propre et l’abscisse curviligne sous la notation . Le paramètre , homogène à l’inverse d’une aire et souvent noté , correspond à la tension de la corde. Tout comme la dynamique de la particule peut être quantifiée à la Feynman en sommant sur les lignes d’univers à extrémités fixées, la corde relativiste quantique est obtenue en sommant sur les surfaces d’univers tubulaires à bords fixés [GS71]. L’action (3.2), dite de Nambu-Goto, est classiquement équivalente à l’action de Polyakov [BVH76, DZ76a]
| (3.3) |
où on introduit une métrique auxiliaire fluctuante sur la surface d’univers ; les équations du mouvement identifient cette métrique à la métrique induite par le plongement dans l’espace-temps ambiant, à un facteur conforme non fixé près, en raison de la symétrie de Weyl
| (3.4) |
de l’action de Polyakov (3.3), propre au caractère bidimensionnel de la surface d’univers. L’invariance sous les difféomorphismes de la surface d’univers permet (localement) de ramener la métrique à la forme diagonale , Le facteur conforme dit champ de Liouville, se découple grâce à la symétrie de Weyl, et on se ramène ainsi à l’action gaussienne
| (3.5) |
La symétrie de Weyl présente cependant une anomalie quantique, et Polyakov a pu prouver que cette anomalie s’annulait uniquement en dimension 26, dimension critique de la théorie des cordes bosoniques [Pol81].
3.1.1 Tachyon, spectre de masse nulle et états massifs
Dans la jauge (3.5), les 26 coordonnées de plongement se découplent, et vérifient l’équation des ondes bidimensionnelle ; chaque coordonnée s’écrit donc comme somme de composantes droite et gauche,
| (3.6) |
elles-mêmes découplées dans le cas de la corde fermée, auquel nous nous restreignons ici 111Dans le cas de la corde ouverte, ces deux composantes sont identifiées par la condition de Neumann aux bords .. Il est commode d’effectuer une rotation de Wick sur la surface d’univers, de sorte que les composantes gauches et droites s’identifient aux fonctions holomorphes et anti-holomorphes de la coordonnée . Les excitations quantiques de la corde fermée sont donc décrites par deux séries d’oscillateurs , correspondant aux modes de Fourier de et , vérifiant les relations
| (3.7) | ||||
| (3.8) |
et agissant sur le vide de l’espace de Fock d’impulsion . Le mode zéro correspond à l’impulsion totale transverse de la corde.
L’invariance de jauge sous les difféomorphismes de surface d’univers impose l’annulation du tenseur d’énergie-impulsion sur la surface d’univers, de modes de Fourier
| (3.9) | |||||
| (3.10) |
où les constantes et , dites intercepts, sont fixées à la valeur par l’absence de fantômes. En particulier, l’annulation de et implique la formule de masse et la condition de level matching :
| (3.11) | ||||
| (3.12) |
où et désignent les nombres d’oscillateurs gauche et droit.
En particulier, l’état fondamental de l’espace de Fock correspond à une particule de masse imaginaire dite tachyon, révélatrice de l’instabilité de la théorie. Le premier état excité , soit , correspond à des particules de masse nulle, dont le spin dépend du choix du tenseur de polarisation :
-
•
correspond au champ scalaire du dilaton ;
-
•
antisymétrique correspond au tenseur antisymétrique de jauge
-
•
symétrique de trace nulle correspond au graviton .
Les états plus excités forment une tour d’états supermassifs de masse de l’ordre de la masse de Planck, et de spin arbitrairement élevé. La propagation de la corde dans les champs de fonds et peut être décrite en généralisant l’action (3.3) à
| (3.13) |
Cette action n’est plus gaussienne que dans l’approximation où la taille de la corde est très inférieure au rayon de courbure caractéristique de l’espace-temps. L’invariance conforme de la théorie des champs sur la surface d’univers222On pourra se reporter à l’excellent cours [Gin88] pour une introduction aux théories des champs conformes bidimensionnelles., nécessaire au découplage du champ de Liouville impose alors une dynamique sur les champs de fond de masse nulle, donnée par l’annulation des fonctions beta relatives aux couplages , et ; celle-ci peut se résumer au premier ordre en en termes de l’action effective
| (3.14) |
où la trois-forme dénote la courbure du tenseur de jauge . La gravitation d’Einstein-Hilbert se trouve ainsi incluse et généralisée dans la théorie des cordes.
3.1.2 Interactions, dilaton et série de perturbation
Les théories des champs associent une constante de couplage à chaque type d’interaction selon la nature des particules incidentes. La théorie des cordes au contraire unifie tous les types de particules comme différentes excitations d’un même objet. Il n’existe alors plus qu’un seul type d’interaction correspondant à l’ouverture de deux cordes fermées et leur recollement en une seule (interaction de splitting and joining), soit l’ouverture d’un manche dans la surface d’univers. Par transformation conforme, une surface correspondant à une interaction à l’ordre des arbres de plusieurs états asymptotiques peut être déformée en une sphère ponctuée d’autant de pattes extérieures (figure 3.1)333On pourra se reporter aux références [FMS86, DP88] pour un exposé détaillé des méthodes de calcul d’amplitudes de diffusion en théorie des cordes ; on trouvera également à la fin de l’article en annexe B un exemple détaillé de calcul de diffusion à une boucle..L’effet de chaque particule est incorporé par l’insertion d’un opérateur de vertex local dans la théorie conforme bidimensionnelle, dépendant de l’état d’oscillation interne, de la polarisation et de l’impulsion de la particule. Le tachyon et le graviton sont ainsi décrits par les insertions
| (3.15) |
La fonction de corrélation de la théorie conforme sur la sphère en présence de ces insertions fournit ainsi l’élément de matrice S de diffusion entre ces particules.
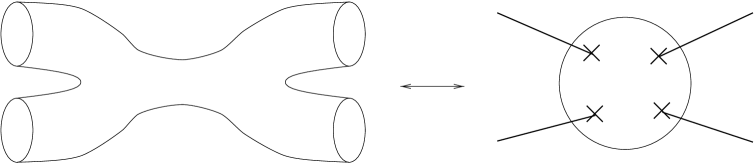
Les diagrammes à boucles conduisent à des corrélations d’opérateurs de vertex sur des surfaces de Riemann de genre . Il ne suffit cependant pas d’intégrer sur les champs de la théorie conforme, mais il faut aussi sommer sur les différentes métriques sur la surface d’univers, ou plus exactement sur les classes d’équivalence de métriques modulo les difféomorphismes et les transformations de Weyl. Ces classes d’équivalence sont paramétrisées par un espace des modules444 Il ne faut pas confondre cet espace des modules avec l’espace des modules décrivant les vides des théories de champs ou de cordes. Cet espace correspond au quotient de l’espace de Teichmüller, décrivant les métriques modulo les transformations de Weyl et les difféomorphismes connectés à l’identité, par le groupe modulaire décrivant les classes de difféomorphismes non connectés à l’identité. de dimension finie (ou 0 pour ,et 2 pour ), sur lequel on doit encore intégrer. Ainsi, dans le cas d’un diagramme à une boucle, la métrique est définie aux difféomorphismes et transformations de Weyl près par le paramètre de structure complexe , tel que . prend ses valeurs dans le demi-plan de Poincaré modulo le groupe modulaire . Ce quotient peut être représenté par le domaine fondamental
| (3.16) |
La partie imaginaire de peut être vue comme le paramètre de Schwinger de la théorie des champs ordinaire, tandis que l’intégrale sur impose la condition de level matching (3.11). En particulier, la région de faible paramètre de Schwinger , correspondant à la région ultraviolette, est exclue de ce domaine (ou plus exactement équivalente à la région par transformation modulaire), ce qui explique l’absence de divergences ultraviolettes en théorie des cordes. L’amplitude de transition vide-vide (ou, en d’autres termes, la constante cosmologique) à une boucle s’écrit alors, pour la théorie bosonique en espace plat,
| (3.17) |
où les fonctions modulaires 555L’article en appendice B rassemble les identités utiles sur les fonctions modulaires, et fournit une introduction détaillée au calcul d’amplitudes à une boucle en théorie des cordes. On se reportera également avec profit aux références [Gin88, Kir97]. et de Dedekind correspondent aux contributions des 24 oscillateurs gauches et droits, tandis que le préfacteur correspond à l’intégration sur l’impulsion transverse des états dans la boucle. L’intégrand correspond à la fonction de partition des modes de la corde. Son invariance sous les transformations modulaires de est un prérequis fondamental pour la cohérence de la théorie 666La fonction n’est en effet invariante modulaire qu’à une racine 24-ième de l’unité près. On retrouve ainsi la dimension critique de la théorie des cordes bosoniques, bien que cet argument n’élimine pas les autres possibilités ..
Le calcul d’une amplitude physique doit donc prendre en compte les surfaces d’univers de genre arbitraire pour décrire les diagrammes de Feynman de nombre de boucles quelconque, ce qui lui vaut le nom de développement en genre. Le genre d’une surface de Riemann, relié à la caractéristique d’Euler , peut s’écrire comme l’intégrale sur la surface d’univers d’un terme local topologique
| (3.18) |
qui n’est autre que l’opérateur décrivant le couplage du dilaton à la surface d’univers dans l’équation (3.13). Les surfaces de genre sont donc pondérées par un facteur , où désigne ici la valeur moyenne du champ de dilaton, que nous pouvons donc identifier avec le couplage de la théorie des cordes :
| (3.19) |
Cette formulation de la théorie des cordes apparaît donc essentiellement perturbative. Parler d’effets non perturbatifs ne saurait avoir de sens que dans le cadre d’une théorie plus large dont le développement en genre, ou développement de cordes, ne représente qu’un schéma d’approximation.
3.2 Les théories de supercordes
La théorie des cordes bosoniques décrite à grands traits dans la section précédente présente de nombreuses insuffisances. L’existence du tachyon montre qu’elle n’est pas définie au voisinage de son vide stable, et la théorie de perturbation n’a donc pas de sens. L’absence de particules fermioniques est regrettable pour une théorie visant à l’unification des forces, bien qu’il ne soit pas exclu que ces particules apparaissent autour du point stable de cette théorie. Les théories des supercordes pallient à ces insuffisances en introduisant des champs fermioniques sur la surface d’univers, de manière à étendre la symétrie conforme en une symétrie superconforme. Cette symétrie locale contient en particulier la supersymétrie locale de la supergravité bidimensionnelle. La contribution à la charge centrale de l’algèbre conforme des fantômes de Faddeev-Popov correspondants abaisse la dimension critique des théories de supercordes à . Tandis que les champs bosoniques, représentant les coordonnées physiques de la corde, doivent être définis globalement sur la surface d’univers, les champs fermioniques peuvent être soit périodiques soit antipériodiques le long de la corde, définissant ainsi les secteurs de Ramond (R) et de Neveu-Schwarz (NS). L’invariance modulaire impose alors l’introduction de périodicités définies le long de l’axe du temps propre de la surface d’univers, projetant effectivement la moitié de chaque secteur. Plus généralement, sur une surface de Riemann de genre , on est amené à sommer sur tous les choix de structure de spin , soit signes correspondant aux périodicités autour de chacun des cycles d’homologie (figure 2.1 page 2.1), avec une phase déterminée par les impératifs d’invariance modulaire et de factorisation [AGMV86, SW86]. Cette projection, dite GSO du nom de ses inventeurs Gliozzi, Scherk et Olive [GSO76], élimine en particulier du spectre le tachyon, et garantit l’existence d’un nombre égal de particules bosoniques et fermioniques à chaque niveau d’excitation. La supersymétrie d’espace-temps n’est pas manifeste dans cette construction ; Green et Schwarz en ont donné une formulation équivalente dans le cône de lumière où cette supersymétrie est explicite [GS82]. Ce gain est cependant obtenu au détriment de l’invariance de Lorentz à dix dimensions.
3.2.1 Cordes fermées de type II
En associant à chaque boson son partenaire supersymétrique et en appliquant la projection GSO séparément dans chacun des secteurs gauche et droit, on obtient ainsi les supercordes de type IIA et IIB, selon le choix du signe relatif de la projection GSO entre les deux secteurs. Leur définition est résumée succintement dans la fonction de partition777C’est plutôt d’un indice de partition qu’il faudrait parler, car les fermions sont comptés avec un signe opposé à celui des bosons.
| (3.20) |
avec en type IIB et en type IIA. L’interprétation de cette expression est transparente si l’on choisit la jauge du cône de lumière, où est effectivement restreint aux huit coordonnées transverses. On reconnaît alors respectivement l’intégrale sur les impulsions transverses, la contribution des huit oscillateurs bosoniques transverses, et celle des huits fermions gauches et droits de structure de spin et . La fonction de partition comprend quatre secteurs selon la valeur de , et la sommation sur impose les projections GSO dans chaque secteur. Le caractère bosonique ou fermionique dépend de la phase évaluée en . Après projection, l’état fondamental d’un complexe de huit fermions de Neveu-Schwarz () correspond à un vecteur sous le groupe de Lorentz transverse , tandis que l’état fondamental d’un complexe de huit fermions de Ramond () correspond à un spineur ou selon le choix du signe de la projection. Le spectre dans chaque secteur peut ainsi être obtenu par produit tensoriel des représentations gauche et droite:
-
•
le secteur , dit de Neveu-Schwarz (ou NS-NS), comprend 64 degrés de libertés dans les représentations correspondant au dilaton , graviton et tenseur antisymétrique respectivement ;
-
•
le contenu du secteur , dit de Ramond (ou R-R) dépend du choix de la chiralité relative des spineurs gauche et droit. Dans le cas de la théorie de type IIA, le produit des deux spineurs de chiralité opposée donne un contenu non-chiral correspondant aux tenseurs antisymétriques de jauge et 888On pourrait aussi bien considérer des potentiels de jauge duaux de Poincaré à et , qui possèderaient les mêmes degrés de liberté sur la couche de masse.. Dans le cas de type IIB, on obtient au contraire un contenu chiral représentable en termes d’un champ scalaire , d’un tenseur antisymétrique et d’un tenseur à courbure autoduale . Le statut des champs de Ramond est très différent de celui des champs de Neveu-Schwarz. La corde fondamentale n’est pas chargée par rapport à ces champs. En particulier, il n’existe pas de modèle sigma non-linéaire généralisant le lagrangien (3.13) en présence de champs de fond de Ramond.
-
•
les deux secteurs fermioniques et (ou R-NS et NS-R) sont identiques (à un changement de chiralité près en type IIA), et contiennent chacun un gravitino et un fermion, selon . Ils constituent les partenaires supersymétriques des bosons des secteurs de Neveu-Schwarz et Ramond.
On obtient ainsi des théories de supersymétrie à dix dimensions (soit 32 supercharges), chirale (type IIB) ou non chirale (type IIA), dont les descriptions de basse énergie sont données par les théories de supergravité décrites au chapitre précédent. Les propriétés de supersymétrie se manifestent dans le calcul des amplitudes physiques par différentes annulations. En particulier, la fonction de partition (3.20) est identiquement nulle par l’identité sur les fonctions théta
| (3.21) |
qui traduit la compensation entre les degrés de liberté bosonique et fermionique à chaque niveau. La constante cosmologique à une boucle, égale à l’intégrale modulaire de la fonction de partition, est donc aussi nulle999Cette annulation ne semble pas être une conséquence de la supersymétrie d’espace-temps, puisqu’il existe des théories de supergravité générant une constante cosmologique non nulle à une boucle..
3.2.2 Cordes de type I
Ayant obtenu une version supersymétrique de la théorie des cordes fermées, il est naturel de chercher une construction correspondante pour les cordes ouvertes. Les théories de supercordes ouvertes, dites de type I, ont connu un regain d’intérêt récent en liaison avec la (re)découverte des D-branes. Elles n’occupent cependant pas une position centrale pour ce travail de thèse, aussi serons-nous plus brefs encore qu’à l’accoutumée (le lecteur pourra se reporter à [Fab97] pour plus de détails.). La corde bosonique fermée présentait deux séries d’oscillateurs gauche et droits et . Les conditions aux limites de Neumann des cordes ouvertes identifient ces opérateurs de manière à ne plus laisser que les modes stationnaires. Cette opération revient à prendre le quotient par l’involution inversant l’orientation de la surface d’univers. Dans le cas de la théorie des supercordes de type II, cette opération doit être combinée avec une involution sur l’espace de Fock fermionique et un échange des fermions gauches et droits, ce qui n’est possible qu’en type IIB lorsque ceux-ci sont de même chiralité. Cette identification élimine la moitié des supersymétries de la théorie de type IIB. Elle introduit dans le développement en genre, en plus des surfaces de Riemann orientables de la théorie IIB, des surfaces fermées non-orientables, ainsi que des surfaces avec bords. La caractéristique d’Euler d’une surface de genre avec bords et points de non-orientabilité (dits crosscaps) s’écrivant , on voit qu’à l’ordre d’une boucle il est nécessaire d’introduire la bouteille de Klein (), l’anneau () et le ruban de Möbius (). L’existence d’un bord permet le couplage à un champ de jauge par l’intermédiaire de charges ponctuelles dites de Chan-Paton, de groupe ou dans le cas de cordes ouvertes non orientées, en accord avec l’existence d’un champ de jauge dans le spectre de masse nulle. Le critère d’invariance modulaire est beaucoup moins puissant dans le cas des théories de cordes ouvertes, et doit être complété par le critère de compensation des tadpoles nécessaire à l’absence de divergences ultraviolettes. Ce prérequis fixe les coefficients respectifs des différents diagrammes, et restreint le groupe de jauge à , en accord avec les restrictions de compensation d’anomalies dans la théorie de supergravité de type I discutées au chapitre précédent. On obtient ainsi la théorie des supercordes de type I, dont le spectre de masse nulle comprend le dilaton et graviton du secteur de Neveu-Schwarz des cordes fermées (mais pas le tenseur antisymétrique exclu par la projection), le tenseur antisymétrique de Ramond , ainsi que le champ de jauge du secteur des cordes ouvertes et leurs partenaires fermioniques sous la supersymétrie à dix dimensions.
3.2.3 Cordes hétérotiques
L’introduction de supersymétrie sur la surface d’univers et le choix d’une projection convenable a ainsi permis de résoudre le problème du tachyon et de l’absence de fermions de la théorie des cordes bosonique. L’absence de symétrie de jauge non abélienne augure mal cependant de l’avenir phénoménologique de la théorie des supercordes de type II. La théorie des cordes de type I présente bien une invariance de jauge non abélienne, mais la construction de modèles chiraux en dimension 4 est restée longtemps difficile en raison de l’absence d’un critère d’invariance modulaire commode. Grâce à la découverte de la théorie des supercordes hétérotiques, il est devenu possible de construire des modèles phénoménologiques viables reproduisant les trois générations de matière chirale, ouvrant ainsi l’ère de la <<phénoménologie des supercordes>>. La construction des cordes hétérotiques repose sur le constat que les secteurs gauche et droit des théories de cordes fermées ne sont couplés que par les modes zéro bosoniques et fermioniques. En revanche, la définition d’une projection GSO ne requiert la supersymétrie que d’un seul côté et suffit à garantir l’absence de tachyon et la présence de fermions dans le spectre. Gross, Harvey, Martinec et Rohm ont ainsi proposé en 1985 une théorie des cordes combinant la théorie superconforme définissant la corde de type II dans le secteur gauche, et la théorie conforme non supersymétrique de la corde bosonique dans le secteur droit [GHMR85]. Les dix champs gauches sont ainsi associés avec les dix champs droits pour définir les coordonnées de plongement de la corde hétérotique, tandis que les seize champs supplémentaires , soit après fermionisation les trente-deux fermions droits , sont utilisés pour réaliser une algèbre de courant de rang 16. Les contraintes d’invariance modulaire restreignent alors cette algèbre à et comme attendu d’après l’analyse de la compensation d’anomalies par Green et Schwarz. La fonction de partition de ces modèles s’écrit ainsi
| (3.22) |
où l’on reconnaît à nouveau l’intégrale des modes zéros, les huit oscillateurs bosoniques transverses, leurs partenaires supersymétriques gauches, et les 32 fermions droits répartis en deux groupes de 16. Le terme entre crochets reproduit le caractère de l’algèbre affine , ou aussi bien celui de l’algèbre affine ; bien que les fonctions de partition de ces deux modèles soient identiques, les spectres soient en effet distincts. A nouveau, la même identité (3.21) implique l’annulation de cette fonction de partition.
3.3 Compactification et T-dualité
A ce stade, nous avons obtenu les cinq théories des supercordes supersymétriques en dimension critique : cordes fermées de type IIA et IIB, cordes ouvertes de type I, cordes hétérotiques et . La simplicité relative de cette classification s’évanouit dès que l’on considère ces théories en dimension inférieure, tout d’abord en raison de la multiplicité des compactifications possibles, et ensuite de l’existence de constructions non géométriques directement en dimension inférieure. Nous nous contenterons ici de discuter les deux cas les plus simples préservant respectivement tout ou moitié de la supersymétrie : compactifications toroïdales et sur variété . Ces deux cas suffiront aux besoins de cette thèse, et à révéler l’originalité de la perception de l’espace-temps par la théorie des cordes. Ils nous fourniront l’exemple de dualités perturbatives, précurseurs des S-dualités que nous considèrerons dans la section suivante.
3.3.1 Compactification toroïdale de la corde bosonique fermée
Nous avons déja discuté la compactification des théories de champs sur un cercle dans la section 2.3.5: chaque état de la théorie originale se scinde en une tour d’états de Kaluza-Klein de masse . Dans le cas de la théorie des cordes, la situation est qualitativement différente puisque l’existence d’un cycle non-trivial autorise de nouvelles configurations, dites instantons de surface d’univers, où la corde s’enroule fois autour de ce cercle. Les entiers et correspondent aux charges électriques sous la symétrie de jauge correspondant aux vecteurs et , où l’indice désigne la direction compacte. La théorie conforme décrivant ces états est une théorie de boson compact libre soluble explicitement. Chaque couple décrit un état <<fondamental>> de la théorie conforme d’énergie et spin conforme avec
| (3.23) | |||||
| (3.24) |
sur lequel est construite une tour d’états d’oscillations identique à celle d’un boson non compact, soumise à la condition de level matching
| (3.25) |
La fonction de partition s’écrit donc
| (3.26) |
où . On constate en particulier que cette fonction de partition est invariante sous l’inversion du rayon . Cette symétrie, dite T-dualité101010 La symétrie de T-dualité est décrite en détail dans l’article de revue [GPR94]., correspond à une dualité de Poincaré sur la surface d’univers, soit . Elle agit sur le spectre des états en échangeant le nombre classique d’enroulement avec le nombre quantique de moment . En particulier, lorsque , les états enroulés autour du cercle deviennent toujours plus légers, tandis que les états de Kaluza-Klein deviennent plus massifs. De manière duale, lorsque le cercle est décompactifié, ce sont les états d’enroulement qui deviennent supermassifs, tandis que les états de moment approchent la masse nulle. Cette symétrie, que nous avons ici vérifiée à l’ordre d’une boucle, est valide à tous les ordres en perturbation, moyennant la transformation du dilaton 111111Cette transformation préserve le dilaton effectif ., et elle commute donc avec le développement perturbatif. Au point autodual , les états de charges deviennent de masse nulle et correspondent aux bosons de jauge associés à l’extension de la symétrie de jauge en une symétrie non abélienne . Cette symétrie de jauge est spontanément brisée pour , et la T-dualité peut s’interpréter comme la symétrie de Weyl résiduelle sous cette brisure. A ce titre, elle doit donc être exacte dans une généralisation non perturbative de la théorie des cordes.
Cette symétrie admet une extension remarquable dans le cas des compactifications toroïdales sur un tore de dimension supérieure. Il est alors nécessaire de préciser à la fois la métrique sur le tore et la valeur moyenne du tenseur antisymétrique . Ces champs scalaires correspondent à autant de modules de la théorie compactifiée. Moments et enroulements sont alors quantifiés par des entiers et tels que
| (3.27) |
L’énergie et le spin conforme sont donnés par
| (3.28) | |||||
| (3.29) |
Le vecteur à composantes décrit alors un réseau muni de la norme paire de signature , et de la métrique de volume unité. La fonction de partition associée à ce réseau auto-dual pair
| (3.30) |
est donc bien une fonction invariante modulaire, et représente la fonction de partition des modes zéro des bosons compacts, ainsi que des oscillateurs gauches et droits associés. L’espace des modules du réseau est un espace homogène
| (3.31) |
de dimension , paramétré par la matrice de la forme quadratique :
| (3.32) |
L’action contragradiente du groupe sur l’espace homogène peut être compensée par une rotation du vecteur entier lorsque est une matrice à coefficients entiers, soit . La fonction de partition du tore est donc invariante sous le groupe de T-dualité . Un sous-groupe générateur (mais non minimal) de ce groupe de T-dualité consiste en les rotations euclidiennes du tore , les flots spectraux et les T-dualités élémentaires sur chaque cercle du tore.
Une simplification importante intervient dans le cas des compactifications sur un tore . L’espace homogène se scinde en effet en deux facteurs correspondant à deux paramètres complexes et :
| (3.33) |
sur lequel le groupe de T-dualité agit par transformations modulaires indépendantes et par échange de et [DVV88]. Plus généralement, la symétrie de T-dualité existe dès lors que la variété de compactification admet une isométrie ; elle la transforme alors en une variété de topologie classique tout à fait distincte, mais équivalente du point de vue de la propagation de la corde. Elle s’étend également aux compactifications sur espaces de Calabi-Yau où elle transforme une variété en sa variété miroir (voir par exemple les cours [HKT94, Gre96]). Cette symétrie de dualité est donc de portée très générale et correspond à une symétrie de jauge de la théorie des cordes encore mal comprise.
3.3.2 T-dualité et supercordes fermées
La discussion précédente s’appliquait à la corde bosonique et au secteur bosonique des supercordes fermées. Dans le cas de la supercorde de type II, l’action de la T-dualité sur les champs bosoniques de la surface d’univers s’accompagne d’une action sur les champs fermioniques renversant la chiralité des spineurs du secteur droit. Les cordes de type IIA et de type IIB sont ainsi échangées à chaque inversion de rayon, de sorte que le groupe de T-dualité se trouve réduit à , le générateur de déterminant -1 reliant les deux théories IIA et IIB. Les valeurs moyennes des tenseurs antisymétriques de jauge du secteur de Ramond fournissent en outre des modules supplémentaires de la théorie compactifiée, sur lesquels la T-dualité doit encore agir. Une analyse explicite de la géométrie de l’espace des modules de Ramond montre que la T-dualité sur la direction est représentée sur les potentiels de Ramond par 121212Cette équation admet des corrections en présence d’un champ non nul (cf appendice D).
| (3.34) |
où désigne la somme des formes différentielles de Ramond d’ordre pair (en type IIB) ou impair (en type IIA), et où les symboles et désignent les produits intérieurs et extérieurs de formes différentielles. L’ensemble de ces transformations pour engendrent une algèbre de Clifford qui n’est autre que l’algèbre associée à . Les champs scalaires de Ramond se transforment donc comme une représentation spinorielle de , et le passage de la théorie de type IIA à la théorie de type IIB s’accompagne d’une inversion de chiralité.
Le cas de la théorie hétérotique offre une particularité d’un autre ordre. Les bosons de jauge de la corde hétérotique en dimensions 10 fournissent par compactification toroïdale champs de modules correspondant aux lignes de Wilson brisant la symétrie de jauge de rang 16. Qui plus est, la distinction entre coordonnée de plongement et coordonnée d’algèbre de courant disparaît du côté droit de la corde, si bien qu’en réalité on a bosons à gauche et à droite, compactifiés sur un réseau de Narain , paramétré par l’espace homogène modulo le groupe de T-dualité étendu [Nar86, NSW87, LSW89]. La formule de masse et la condition de level matching s’écrivent131313 contient ici les oscillateurs fermioniques demi-entiers.
| (3.35) | |||
| (3.36) |
Les états tels que et correspondent donc à des bosons de jauge de masse nulle s’ajoutant aux 16 bosons (). Ils signalent donc l’extension de la symétrie de jauge hétérotique en certains points de l’espace des modules. Les racines ayant toutes la même longueur , on obtient ainsi les groupes de jauge simplement lacés A,D,E de la classification de Cartan. En particulier, lorsque le réseau est factorisé en , soit pour des lignes de Wilson nulles, on retrouve la symétrie de jauge (ou ) de la théorie à 10 dimensions. On peut cependant trouver une valeur des lignes de Wilson restituant l’autre symétrie de jauge (ou ) : les deux théories hétérotiques à dix dimensions sont ainsi continûment reliées par compactification sur un cercle.
3.3.3 Cordes ouvertes et D-branes
La T-dualité que nous avons décrite dans le cas des cordes fermées permet ainsi de relier deux à deux les théories des supercordes à dix dimensions que l’on croyait distinctes. Son existence dans la théorie des cordes ouvertes de type I semble a priori problématique, puisque les états d’enroulement images des états de Kaluza-Klein sous la T-dualité n’existent pas en théorie des cordes ouvertes. La résolution de ce paradoxe a mené Horava, Polchinski, Dai, et Leigh à la découverte des D-branes [DLP89, Hor89] qui ont récemment pris une importance considérable dans la compréhension des dualités des théories des cordes et des théories de jauge. Nous en rappellerons brièvement les points saillants indispensables à la compréhension des travaux de ce mémoire, renvoyant le lecteur aux articles de revue pour plus de détails [Bac96, PCJ96, Pol96, Tay97].
Revenant à l’interprétation de la T-dualité en termes de dualité de Poincaré sur la surface d’univers, on voit que dans le cas des cordes ouvertes, cette opération remplace la condition de Neumann sur la coordonnée compacte par la condition de Dirichlet , traduisant le fait que les extrémités de la corde ouverte sont attachées à un point fixe dans la direction , soit sur une 8-brane de l’espace-temps. Le moment n’est alors plus conservé, mais l’enroulement autour de la direction compacte devient un bon nombre quantique. La T-dualité peut être appliquée dans plusieurs directions distinctes successivement de manière à générer des -branes de toute dimension dites D-branes. La 9-brane correspond à la propagation libre des cordes ouvertes, mais la présence de d’entre elles revient à attacher un facteur de Chan-Paton aux extrémités des cordes ouvertes orientées 141414 ou dans le cas des cordes non orientées. En particulier, dans la théorie de type I, la symétrie de jauge peut être interprétée comme la présence de 16 D9-branes.. Ces D-branes apparaissent comme des objets infiniment massifs, étendus longitudinalement et localisés transversalement dans la théorie de perturbation.
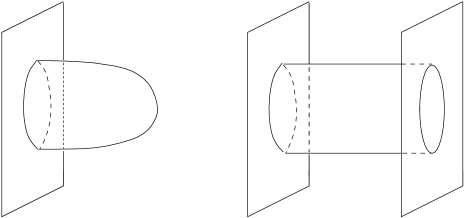
L’échange de moment avec les fluctuations du champ de cordes ouvertes en sa présence confère à la D-brane une dynamique justifiant cette appellation de membrane. Les modes de masse nulle des cordes ouvertes attachées à la D-brane correspondent en particulier aux degrés de liberté de la D-brane. Contrairement à la théorie des cordes ouvertes <<libres>> où ces modes se propagent dans l’espace-temps à dix dimensions, la brisure de la symétrie de translation par la D-brane réduit leur dépendance aux coordonnées longitudinales, et ils ne propagent donc plus que sur le volume d’univers de la D-brane. Ils se couplent néanmoins aux modes des cordes fermées de l’espace-temps à dix dimensions, et en particulier au graviton. Le potentiel vecteur de la théorie des cordes ouvertes libres donne ainsi naissance à champs , scalaires du point de vue du volume d’univers de la D-brane et correspondant aux fluctuations de position transverses à la D-brane, et un champ de jauge se propageant sur ce volume d’univers ; à ces fluctuations marginales s’ajoutent les modes massifs des cordes ouvertes, dont l’intégration conduit à une action effective pour les degrés de liberté et de la D-brane. Cette action peut être aisément déterminée par T-dualité à partir de l’action effective du champ de jauge de la théorie des cordes ouvertes libres [Lei89]. Ce champ de jauge couple au bord de la surface d’univers de la corde ouverte par une ligne de Wilson ; l’amplitude à l’ordre du disque de la théorie des cordes ouvertes en présence du champ de fond (figure 3.2) peut être évaluée explicitement151515aux termes contenant des dérivées de près. [ACNY87] et conduit à l’action de l’ électrodynamique de Born-Infeld [BI35]
| (3.37) |
où est la courbure du champ de jauge . Cette action restitue aux énergies basses devant l’action de Maxwell ordinaire, mais la corrige par des interactions à nombre de dérivées arbitraires161616Cette série est générée par le développement de la racine carrée, et non pas du déterminant qui contient les termes , . La racine carrée peut du reste être éliminée en introduisant un champ auxiliaire : . . La T-dualité dans la direction remplace le couplage de jauge par un couplage transverse au flux d’impulsion traversant l’extrémité de la corde vers la D-brane. Le champ apparaît donc bien comme la variable conjuguée au moment de la D-brane, soit comme la position dans la direction . L’électrodynamique de Born-Infeld (3.37) donne alors sous cette réinterprétation l’action de Dirac-Born-Infeld [Dir62] décrivant la dynamique de la D-brane
| (3.38) |
où représente la métrique induite sur le volume d’univers par le plongement . En particulier, la tension de la D-brane est donnée par
| (3.39) |
très supérieure à celle de la corde fondamentale à faible couplage, mais aussi très inférieure à celle en des solitons des théories des champs habituelles.
L’action de Born-Infeld peut être aisément généralisée en présence d’un champ de fond de tenseur antisymétrique de Neveu-Schwarz . Celui-ci couple à la surface d’univers par un terme topologique , invariant sous la transformation de jauge à un terme de bord près qui peut être absorbé dans une transformation du champ de jauge de volume d’univers de la D-brane . La courbure généralisée est alors invariante de jauge, et remplace dans l’équation (3.38).
Nous avons jusqu’à présent décrit les D-branes dans le cadre de la théorie des cordes ouvertes. Elles existent tout autant dans les théories des supercordes de type I et II, où elles décrivent des états 1/2-BPS saturés 171717La structure drastiquement différente des modes gauches et droits dans la corde hétérotique empêche l’introduction de bord sur la surface d’univers de la corde, et donc l’existence de D-branes hétérotiques.. Cette propriété apparaît par exemple dans l’annulation de l’interaction à une boucle de deux D-branes parallèles statiques (figure 3.2), donnée par la fonction de partition de la théorie de supercordes sur l’anneau. L’action de Born-Infeld est alors complétée par des termes fermioniques de manière à former une théorie de volume d’univers invariante sous la moitié des supersymétries de la théorie libre. L’autre moitié, brisée spontanément par la présence de la D-brane, est réalisée non-linéairement sur le volume d’univers.
Comme remarqué par Polchinski, l’annulation du potentiel d’interaction statique entre deux D-branes parallèles résulte de la compensation entre les interactions gravitationnelles du secteur de Neveu-Schwarz et les interactions de jauge du secteur de Ramond. Elle implique en particulier que la D-brane est chargée sous le potentiel de Ramond , et porte la charge minimale permise par la condition de quantification de Dirac. L’action de la D-brane comprend donc, en sus de l’action de Born-Infeld (3.37), le couplage topologique de Wess-Zumino
| (3.40) |
où l’intégrale sélectionne la -forme après développement en série de l’exponentielle [GHT96, GHM97]. Les D-branes peuvent ainsi être identifiées aux -branes des théories de supergravité de type I et II chargées sous ces mêmes champs, et en fournissent une description en termes de théorie conforme. Certaines configurations de D-branes non parallèles préservent quant à elles une fraction inférieure de la supersymétrie, et peuvent encore être identifiées à des états BPS des théories de supergravité.
Si l’action de Born-Infeld (3.38) décrit la dynamique d’une D-brane, elle ne dit cependant rien de l’interaction entre plusieurs D-branes. Celle-ci peut à nouveau être déterminée en considérant les fluctuations du champ de cordes entre elles. Le champ de cordes fermées conduit aux interactions gravitationnelles ordinaires, corrigées par l’effet des modes massifs. Le champ de corde ouvertes engendre cependant de nouvelles interactions, puisque les cordes sont maintenant susceptibles d’avoir leurs deux extrémités attachées sur deux D-branes différentes. La masse des états fondamentaux de ces cordes est proportionnelle à leur élongation , et ces modes deviennent de masse nulle lorsque les deux D-branes se touchent. Le cas de D-branes paralléles, positionnées à des abscisses le long d’une direction compacte (figure 3.3) est particulièrement simple : sous la T-dualité il correspond à 9-branes, soit à la présence de facteurs de Chan-Paton aux extrémités de la corde ; la symétrie de jauge est cependant brisée en par l’holonomie du champ de jauge autour du cercle
| (3.41) |
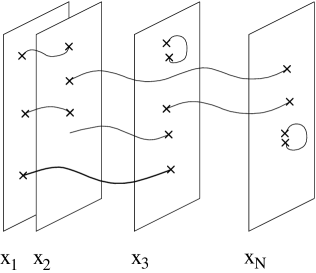
La coïncidence de D-branes s’accompagne donc d’une restauration de symétrie non abélienne dont les bosons vecteurs non abéliens correspondent aux cordes de masse nulle joignant les D-branes deux à deux. La dynamique effective décrivant ces modes peut en principe encore être obtenue à partir de l’action effective d’un champ de jauge non-abélien en théorie de type I ; la non commutativité des champs de jauges matriciels empêche une évaluation explicite de l’amplitude à une boucle généralisant l’équation (3.37)181818Dans le cas non abélien, en raison de la relation , la distinction entre termes dérivatifs et commutateurs n’existe plus, et on est donc réduit à garder ou omettre tous les deux. Dans le second cas, on obtient une relation analogue à (3.37) où la trace symétrisée dans la représentation adjointe de apparaît devant la racine carrée [Tse97]. Les effets conjugués de non linéarité et de non commutativité sont cependant gâchés par cette approximation. Le couplage topologique est quant à lui donné exactement par la trace de l’équation (3.40), où la courbure généralisée doit être lue . ; la limite de basse énergie est cependant non ambiguë, et correspond à une théorie de Yang-Mills supersymétrique 191919à 16 charges supersymétriques en type II, ou 8 charges en type I. non abélienne de groupe de jauge . Les champs de jauge deviennent par T-dualité les positions non abéliennes transverses des D-branes [Wit96a], sujettes au potentiel scalaire
| (3.42) |
Dans la phase de Higgs, les matrices de positions commutent et peuvent être simultanément diagonalisées : on recouvre ainsi la notion de position individuelle de chaque D-brane. Au voisinage des points de symétrie étendue, où deux valeurs propres des matrices de position coïncident, les fluctuations des degrés de liberté non diagonaux induisent des effets de cohérence et seule la position du centre de masse, correspondant au facteur diagonal , est bien définie. Cette non-commutativité de l’espace-temps n’est pas sans rappeler la géométrie non commutative formulée par A. Connes [Con94], mais la connection n’a jusqu’a présent pas été formulée en toute généralité. Bien qu’incomplète, cette formulation est particulièrement adaptée à l’étude des états liés de D-branes : l’approximation de basse énergie à l’action de D-branes est alors suffisante, et les états liés peuvent être identifiés aux états du vide supersymétriques de la théorie de Yang-Mills . L’absence de mass gap dans ces théories en rend cependant l’étude délicate, et seule l’existence d’états liés pour a jusqu’à présent pu être prouvée ; l’unicité de l’etat lié de D0-branes, à la base de nombreuses conjectures de dualité, est encore incertaine.
3.3.4 Orbifolds et compactification sur
La compactification toroïdale que nous avons décrite jusqu’à présent, n’agissant que sur les modes zéros bosoniques, préservait la totalité des supersymétries de la théorie non compactifiée. La supersymétrie peut être réduite de manière commode en jaugeant une symétrie discrète de l’espace-temps [DHVW85, DFMS87]. L’espace résultant, dit orbifold, présente des singularités aux points fixes de la symétrie, mais la théorie conforme correspondante est parfaitement régulière, comme l’atteste l’équivalence de la compactification sur l’orbifold de rayon avec la compactification sur un cercle de rayon . L’invariance modulaire impose l’inclusion d’états dits twistés en sus des états de la théorie originale invariants sous la symétrie. Les états twistés correspondent aux cordes fermées à une action de la symétrie près, soit aux états encerclant les singularités de l’orbifold. En particulier, le secteur de masse nulle contient les modes non twistés correspondant aux modules de la théorie initiale préservant l’existence de la symétrie, ainsi que les modes de résolution (blow-up modes) paramètrant la résolution de chaque singularité de l’orbifold. L’exemple le plus simple consiste à jauger la symétrie renversant toutes les coordonnées du tore . La fonction de partition bosonique peut s’écrire en terme des blocs conformes twistés :
| (3.43a) | |||
| (3.43b) |
où (resp. 1) dans le secteur non twisté (resp. twisté), et où correspond à l’insertion de l’opérateur de symétrie. Les blocs twistés ne dépendent pas des modules non twistés , la symétrie ne laissant que le secteur de charges nulles . Ils dépendraient en revanche des modules de résolution si on écartait marginalement la théorie conforme du point d’orbifold . Dans le cas des théories de supercordes, l’invariance du courant de supersymétrie de surface d’univers impose que la symétrie agisse également sur les fermions selon . Pour , cette action brise la supersymétrie d’espace-temps 202020En effet, le spineur de Majorana-Weyl à 10 dimensions se réduit en un spineur de Majorana en dimension 9, un spineur de Weyl en dimension 8, et un spineur de Dirac en dimension 7. Ce n’est qu’en dimension 6 qu’il se scinde en deux spineurs dont l’un peut être projeté sous la symétrie .. Pour , une moitié de la supersymétrie est préservée par la projection. L’orbifold représente en effet le prototype 212121Il existe trois autres modèles d’orbifolds abéliens de : . Le groupe discret agit dans tous ces cas sur les coordonnées complexes du 4-tore par . Cette action préserve en particulier la deux-forme holomorphe . d’une surface , c’est-à-dire une variété (éventuellement singulière) kählérienne compacte de dimension 4, simplement connexe, et de courbure de Ricci triviale. Ces conditions assurent l’existence d’un spineur covariantement constant, et donc d’une supersymétrie résiduelle. Compte tenu du rôle central joué par les compactifications sur dans les conjectures de dualité et dans les travaux présentés en appendice B et F de ce mémoire, nous consacrerons le reste de cette section à décrire les aspects les plus importants de ces surfaces, renvoyant à la référence [Asp96] pour une présentation plus approfondie.
En réalité, c’est de la surface qu’il faudrait parler : toutes les surfaces sont en effet difféomorphiquement équivalentes. Elles diffèrent cependant dans le choix de la 2-forme holomorphe définissant la structure complexe, et de la classe de Kähler . Le théorème de Calabi et Yau assure l’existence et l’unicité d’une métrique de courbure de Ricci nulle (ou métrique d’Einstein) ces deux structures étant fixées [Yau77]. Toutes deux peuvent être spécifiées en termes de vecteurs dans le réseau de cohomologie de , qu’il est aisé de déterminer au point d’orbifold : de la cohomologie du tore , seuls subsistent les formes non twistées . La résolution de chacune des 16 singularités de type (soit dans la classification des singularités des surfaces complexes) introduit autant de deux-cycles non triviaux ; la cohomologie totale est résumée dans le diamant de Hodge
| (3.44) |
pour une caractéristique d’Euler . Le second groupe de cohomologie est particulièrement important, puiqu’il peut être munie d’une forme d’intersection de signature , et à valeurs entières paires. La dualité de de Rham identifie en outre avec son dual . constitue donc un réseau pair autodual, analogue au réseau de Narain définissant les compactifications toroïdales hétérotiques. Le choix de la 2-forme holomorphe et de la 2-forme de Kähler définissent trois vecteurs de . La surface étant hyperkählérienne, elle n’est cependant pas affectée par une rotation de ces trois objets. Le choix de la métrique d’Einstein sur la variété est donc paramétré par l’espace des modules homogène
| (3.45) |
correspondant au choix d’un 3-plan dans l’espace vectoriel , aux difféomorphismes du réseau près. Le facteur correspond lui au volume de la métrique d’Einstein.
La donnée de la métrique d’Einstein ne suffit cependant pas à définir la théorie des cordes sur cet espace : il faut encore spécifier la valeur moyenne du tenseur antisymétrique , ainsi que des tenseurs de jauge de Ramond dans les supercordes de type II, ou des champs de jauge dans le cas des supercordes hétérotiques et de type I. Nous laissons ce dernier cas de côté dans cette thèse, puisque nous nous restreignons aux situations avec au moins 16 supercharges de symétrie. Les valeurs moyennes du tenseur antisymétrique peuvent être mesurées par les 22 intégrales sur les deux-cycles de , et étendent l’espace des modules à [Sei88]
| (3.46) |
auquel il faut encore ajouter un facteur correspondant au dilaton. La symétrie contient la symétrie géométrique précédente, mais l’étend par des transformations supplémentaires mélangeant la métrique et le tenseur antisymétrique. Ces transformations correspondent aux symétries miroir des modèles sigma non-linéaires sur les espaces de Calabi-Yau, et correspondent à des dualités perturbatives des théories des cordes analogues aux T-dualités des compactifications toroïdales. Dans le cas des supercordes de type IIA compactifiées sur , on obtient ainsi l’espace des modules complet, car les champs de Ramond, correspondant à des formes différentielles de degré impair, ne génèrent pas de degrés de liberté scalaires sur . En revanche, dans le cas IIB, il faut encore inclure la valeur moyenne du scalaire de Ramond , les 22 flux du tenseur antisymétrique de Ramond à travers les deux-cycles de ainsi que le flux total de la 4-forme . Avec le facteur du dilaton, ces champs se combinent en l’espace des modules de type IIB
| (3.47) |
pour lequel il est naturel de conjecturer une identification sous le groupe . Cette dualité est cependant non perturbative, car mélangeant le dilaton avec les paramètres géométriques de la compactification. Notons qu’on ne sait définir la théorie des cordes perturbativement que pour une valeur moyenne nulle des champs de Ramond.
Les compactifications sur permettent ainsi de réduire la dimension de l’espace-temps à tout en conservant la moitié des supersymétries. La dimension peut être atteinte par compactification supplémentaire 222222On peut aussi envisager la compactification de dix dimensions à quatre sur un espace de Calabi-Yau à six dimensions [CHSW85]. Ce cas ne préserve cependant qu’un quart des supersymétries, aussi l’omettrons nous dans ce mémoire. sur un tore . On obtient ainsi, partant de la théorie des cordes de type IIA ou IIB, une théorie supersymétrique en dimension 4. L’espace des modules contient l’espace des modules de la théorie sur ainsi que les modules de la compactification sur . Il contient également les valeurs moyennes des champs de Ramond sur les cycles de , ainsi que l’axion équivalent au tenseur antisymétrique de Neveu-Schwarz sur la couche de masse. Avec le dilaton , ce champ forme le scalaire complexe . Dans le cas IIA, l’ensemble de ces champs s’organise dans l’espace homogène
| (3.48) |
où le premier facteur correspond au paramètre et le second rassemble et les modules de et de Ramond. Le cas IIB s’obtient par T-dualité . La encore, il est naturel de conjecturer l’invariance de la théorie sur les transformations modulaires de cet espace homogène. Cet espace des modules est identique à celui de la corde hétérotique compactifiée toroïdalement sur un tore : le facteur est alors interprété comme le champ complexe de la corde hétérotique, tandis que le second facteur n’est autre que l’espace des modules du réseau de Narain . Cette coïncidence est une des premières indications des dualités des supercordes, vers lesquelles nous nous tournons dans la section suivante. La S-dualité de la théorie hétérotique est alors conséquence de la T-dualité de la théorie de type II [FILQ90].
La compactification sur que nous venons de décrire n’est cependant pas la seule à fournir une théorie de supersymétrie en dimension 4. En particulier, la variété admet, sur une sous-variété de son espace des modules, une involution sans point fixe dite involution d’Enriques232323 admet ainsi les translations par une demi-période comme involutions d’Enriques. Ces involutions identifient les 16 points fixes de l’orbifold deux à deux. Elles génèrent le groupe de symétrie de la théorie conforme associée à [DVV88].. En combinant cette involution avec une translation d’une demi-période sur le tore, on obtient une théorie conforme sur qui préserve la supersymétrie . La projection élimine cependant une partie des cycles de la variété , soit une partie des bosons de jauge dans le spectre de basse énergie. On obtient ainsi des théories de type II à rang réduit, d’espace des modules . L’étude des corrections de seuil gravitationnelles dans ces théories et dans les théories hétérotiques duales fait l’objet du travail en appendice B.
3.4 La théorie non perturbative des supercordes
Après le long chemin qui nous a conduit des dualités électriques-magnétiques des théories de jauge supersymétriques aux dualités d’espace-cible des théories des supercordes en passant par les symétries cachées et le spectre des états solitoniques de membrane des théories de supergravité, nous avons maintenant en main les concepts essentiels aboutissant à la conjecture de dualité des théories de supercordes. Nous nous sommes d’ailleurs à plusieurs reprises approchés de cette idée, et nous n’aurons ainsi qu’à rassembler les notions principales apparues au cours de notre route.
3.4.1 Dualité des cordes hétérotique et de type II
Comme nous l’avons décrit dans la section précédente, les dualités d’espace-cible réduisent à trois le nombre de théories des supercordes perturbatives : les théories de type IIA et de type IIB sont identifiées par T-dualité après compactification sur un cercle, de même que les cordes hétérotiques de groupe de jauge et . Cette dualité commute avec le développement perturbatif en puissances du couplage , et peut être démontrée à tout ordre. Elle peut en outre s’interpréter comme symétrie de jauge spontanément brisée, et à ce titre doit valoir également au niveau non perturbatif.
Nous avons également rencontré de nombreux indices de dualité non perturbative entre ces trois théories. Ainsi, la théorie des cordes de type IIA compactifiée sur une variété présente le même espace des modules que la théorie hétérotique compactifiée sur un tore . Cette indication peut être renforcée par l’examen des actions effectives de basse énergie [Sen95]. L’action à l’ordre des arbres de la théorie hétérotique compactifiée sur s’obtient par réduction de Kaluza-Klein de l’action à dix dimensions :
| (3.49) |
où l’on a omis les champs fermioniques et les puissances de . Le couplage est relié au dilaton de la théorie à dix dimensions par où est le volume de ; est la courbure du champ de jauge provenant de la symétrie de jauge à dix dimensions (brisée par les lignes de Wilson) ou de la symétrie de jauge de Kaluza-Klein ; contient les corrections de Chern-Simons usuelles dans ces réductions ; la matrice symétrique paramétrise l’espace des modules homogène et désigne la métrique paire de signature (4,20). Le facteur correspond à une contribution à l’ordre de la sphère. D’un autre côté, l’action de la théorie de type II réduite sur s’écrit
| (3.50) | |||||
Les 24 champs de jauge proviennent cette fois du champ de jauge de Ramond , de la réduction du tenseur de jauge sur les 2-cycles de et du tenseur lui-même, équivalent à un champ de jauge U(1) à six dimensions. Tous ces champs proviennent du secteur de Ramond de la théorie de type IIA, et présentent un couplage anormal au dilaton sur une surface de caractéristique d’Euler . On notera l’absence de corrections de Chern-Simons dans la courbure , et la présence d’un terme topologique provenant d’un couplage à dix dimensions. L’identité entre ces deux actions apparaît après une transformation de Weyl éliminant le facteur du dilaton devant l’action d’Einstein-Hilbert, et menant à l’action effective dans la métrique d’Einstein :
| (3.51) | |||||
| (3.52) | |||||
Ces deux actions sont précisément équivalentes sous les identifications
| (3.53) |
L’identification des métriques d’Einstein peut alternativement être prise en compte en transformant l’échelle des cordes , de sorte que la dualité hétérotique-type II peut être commodément résumée par les transformations
| (3.54) |
Cette dualité en particulier inverse le couplage , et échappe donc à la théorie de perturbations. Dans ces conditions, l’invariance de l’action effective à l’ordre des arbres peut sembler une bénédiction exagérée : elle reflète l’existence d’un théorème de non-renormalisation de l’action effective à deux dérivées dans les théories à 16 supersymétries. On ne saurait donc se contenter de l’examen de cette action pour conclure à la dualité exacte des théories hétérotique et de type IIA à six dimensions. Notons finalement qu’après compactification des deux théories sur un tore , l’identification (3.53) implique l’équivalence des deux théories de supersymétrie à quatre dimensions résultantes sous l’échange discuté à la fin de la section précédente.
Cette conjecture de dualité reçoit une confirmation supplémentaire par l’étude du spectre des états BPS dans chaque théorie. Il existe en effet dans la théorie de supergravité à six dimensions deux solitons de 1-brane : l’un, régulier dans la métrique hétérotique et singulier dans la métrique de type IIA, chargé sous le tenseur antisymétrique de Neveu-Schwarz , peut être interprété comme la corde fondamentale de type IIA, apparaissant comme un soliton de la corde hétérotique ; son partenaire magétique est au contraire régulier dans la métrique de type IIA et singulier dans la métrique hétérotique, et admet 24 déformations correspondant aux courants électriques sous les 24 champs de jauge . Il peut donc être interprété comme la corde hétérotique fondamentale, apparaissant comme soliton dans la corde de type IIA [Sen95]
Le spectre des états ponctuels peut aussi être mis en correspondance précise 242424Le matériel présenté dans cette section apparaît dans la seconde partie de l’article en appendice B, où il permet l’identification des contributions non perturbatives aux couplages scalaires à quatre dérivées dans la théorie de type II compactifiée sur .. Ces états BPS correspondent aux excitations des oscillateurs droits (non supersymétriques) de la corde hétérotique252525Les excitations BPS de la corde de type IIA se restreignent aux états de masse nulle et n’apportent donc pas de nouvelle confirmation de la dualité., les oscillateurs gauches étant dans leur état fondamental. La condition de level matching pour impose donc
| (3.55) |
où est le vecteur des 24 charges entières sous les champs de jauge , et la métrique de signature (4,20). Cette équation ne détermine que le nombre total d’excitations des oscillateurs bosoniques droits . Pour chaque valeur de , le nombre de possibilités , et donc la dégénérescence de l’état de charges , est donné par la fonction de partition
| (3.56) |
La masse carrée est quant à elle donnée, dans la métrique hétérotique, par
| (3.57) |
En particulier, ces états deviennent de masse nulle aux points où soit et , correspondant aux points de symétrie étendue de la corde hétérotique.
Dans la métrique de type IIA, la masse carrée présente le comportement non perturbatif en caractéristique des D-branes :
| (3.58) |
tandis que les charges correspondent maintenant aux charges sous les 24 champs de jauge du secteur de Ramond de la théorie de type IIA. Ces états peuvent donc être identifiés avec les D0,D2,D4-branes de la théorie de type IIA enroulés autour d’un cycle supersymétrique de la variété . Les charges correspondent alors aux nombres d’enroulement de la D-brane autour de chacun des 24 cycles de , soit aux coefficients du développement du cycle sur le réseau d’homologie de . La norme entière correspond alors au nombre d’auto-intersection du cycle (égale à sa caractéristique d’Euler dans le cas d’un 2-cycle),et à son aire carrée. Pour être correcte, la dualité hétérotique-type IIA prévoit donc le nombre de cycles supersymétriques homologiquement équivalents à :
| (3.59) |
Bershadsky et al. ont testé cette prédiction en étudiant la théorie topologiquement twistée sur le volume d’univers des D-branes [BVS96] ; Zaslow et Yau en ont donné une reformulation dans le cadre de la géométrie algébrique et ont pu en vérifier l’exactitude pour [YZ96, Bea97]. Cette prédiction est réalisée naturellement dans les corrections non perturbatives étudiées dans l’appendice F de ce mémoire.
Les points de symétrie étendue de la corde hétérotique correspondent aux points de l’espace des modules de où la variété devient singulière, soit lorsqu’un ou plusieurs cycles deviennent d’aire nulle. Les D-branes enroulées autour de ces cycles évanescents génèrent les particules de masse nulle d’une symétrie de jauge non abélienne déterminée par la matrice d’intersection des cycles. Les singularités des surfaces ont été classées dans la littérature mathématique et se restreignent précisément aux singularités de type ADE, en accord avec les symétries de jauge observables du côté hétérotique.
Cette précise correspondance des spectres BPS des deux théories constitue l’argument le plus fort en faveur de la dualité des théories hétérotique et de type IIA compactifiées sur et sur respectivement. Le lecteur sceptique pourrait cependant avec raison argumenter que toutes ces indications ne concernent que le secteur BPS <<visible>> de la théorie, et ne présument rien du secteur <<caché>> de l’iceberg, sur lequel se brisent toutes les approches. Les contraintes de cohérence de la théorie des cordes suggèrent néanmoins que l’identité des secteurs BPS puisse suffire à entraîner l’identité complète. On notera également que la théorie hétérotique perturbative apparaît beaucoup plus complète que la théorie de type IIA, qui nécessite l’introduction des D-branes non perturbatives pour décrire le spectre BPS.
3.4.2 Dualités et unicité
Première à être découverte, la dualité N=4 hétérotique-type II s’inscrit maintenant dans un écheveau complet de dualités qui a reçu de nombreuses confirmations. Ce mémoire n’a pas vocation à en donner une revue exhaustive, aussi nous bornerons nous à en décrire la structure générale sans entrer dans tous les détails.
Des cinq théories des cordes perturbatives, la T-dualité après compactification sur un cercle ne laisse que trois théories apparamment distinctes: la théorie de type I, la théorie hétérotique (de groupe de jauge ou ) et la théorie de type II (A ou B). Ces théories sont identifiées par les dualités non perturbatives suivantes :
-
•
La dualité hétérotique - type I identifie les deux théories des cordes de supersymétrie et groupe de jauge à dix dimensions. Les deux actions effectives de basse énergie sont identiques sous l’inversion du couplage et changement d’échelle
(3.60) et l’identification du tenseur de la corde hétérotique avec le tenseur du secteur de Ramond des cordes fermées de la corde de type I. La corde hétérotique, chargée sous , peut être identifiée avec la D1-brane de la théorie de type I, chargée sous [HS95]. Les champs de la surface d’univers de la D1-brane, correspondant aux modes de masse nulle des cordes ouvertes dont la ou les extrémités sont attachées à la D-brane, correspondent précisément aux coordonnées de plongement et aux champs construisant l’algèbre de courant sur la surface d’univers de la corde hétérotique. La 5-brane hétérotique peut également être identifiée à la D5-brane de la théorie de type I. Après compactification sur un tore, les points de symétrie étendue de la théorie hétérotique sont associés à des points de fort couplage local 262626Le champ de fond du dilaton de type I n’est en effet pas uniforme sur le cercle. de la théorie de type I [PW96].
-
•
L’ auto-dualité de la théorie de type IIB identifie cette dernière sous les transformations modulaires du scalaire complexe . Cette symétrie associe à la corde fondamentale de charges électriques (1,0) sous les deux tenseurs de jauge un multiplet de cordes de charges , identiques en tout point à la corde fondamentale, et de tension [Sch95]. La D3-brane est invariante sous cette dualité, mais celle-ci agit par dualité électrique-magnétique dans la théorie de jauge décrivant le volume d’univers de la D3-brane [Tse96]. Les solitons de charge de cette théorie de jauge sont interprétés comme les extrémités des cordes de type s’attachant à la D3-brane. La NS5-brane et la D5-brane forment quant à eux deux membres d’un multiplet de 5-branes de charges magnétiques . Après compactification toroïdale sur , la symétrie non perturbative se combine avec la symétrie de T-dualité pour former la symétrie de U-dualité [HT95]. Cette symétrie existe aussi bien dans la théorie de type IIA compactifiée sur , que l’on obtient par une T-dualité de déterminant -1 arbitraire. Elle laisse invariante l’échelle de Planck
(3.61) -
•
La dualité hétérotique-type II relie les cordes hétérotiques et type IIA compactifiées sur et respectivement. La symétrie du réseau de Narain hétérotique apparaît comme la symétrie miroir associée à la variété . Les points de symétrie étendue de la théorie hétérotique correspondent dans la théorie de type IIA aux points où la variété devient singulière. Les états ponctuels non perturbatifs correspondant aux D0,2,4-branes enroulées autour du ou des cycles évanescents de deviennent alors de masse nulle et engendrent la symétrie de jauge.La dualité hétérotique-type II induit une dualité de ces mêmes théories compactifiées sur et à quatre dimensions. L’espace du côté de type II peut être fibré non trivialement en un espace de Calabi-Yau de dimension 6 de manière à obtenir une compactification à quatre dimensions. La dualité hétérotique-type II continue à valoir à condition de fibrer l’espace hétérotique en une variété .
-
•
La compactification de la théorie de type IIB sur une variété conduit en revanche à une théorie chirale à seize charges supersymétriques, où la dualité se combine avec la symétrie miroir en un groupe de U-dualité . La corde fondamentale est alors membre d’un multiplet contenant les D1,3,5-branes enroulées sur les 0,2,4-cycles de , ainsi que leurs partenaires sous la symétrie . Les points singuliers de correspondent à l’apparition de cordes de tension nulle et donc de tours d’états solitoniques non massifs.
Ces relations de dualité déterminent la dynamique à fort couplage des théories de type IIB, type I et hétérotique . La dynamique à fort couplage des théories de type IIA et hétérotique peut a priori être obtenue après compactification sur un cercle de rayon fixe, T-dualité , puis S-dualité vers la théorie de type IIB ou I respectivement. Si cette dernière théorie est faiblement couplée (), elle ne se réduit pour autant pas à la théorie perturbative correspondante, en raison du rétrécissement simultané du cercle de rayon . En particulier, les D1-branes des théories de type I ou IIB enroulées autour du cercle de rayon donnent lieu à des états de masse comparable à la masse des excitations de Kaluza-Klein de masse .
Le régime de fort couplage des théories de type IIA et hétérotique peut en revanche être déterminé dans la limite de basse énergie. En effet, la théorie des cordes de type IIA est décrite aux énergies inférieures à l’échelle des cordes par la réduction de la supergravité à onze dimensions sur un cercle de rayon . Cette relation, observée sur l’action effective à l’ordre des arbres de la théorie de type IIA, persiste pour toute valeur du couplage, en raison de la non-renormalisation de l’action à deux dérivées des théories à 32 supersymétries. Elle s’étend également aux énergies de l’ordre de , grâce à l’identification des états liés de D0-branes de la théorie de type IIA avec les états de Kaluza-Klein de moment correspondant à la réduction du supergraviton à onze dimensions 272727 La validité de cette identification repose sur l’existence d’un unique état lié marginal de D0-branes, soit un unique vide supersymétrique dans une théorie de jauge à seize supercharges. [Tow95, Wit95b]. A fort couplage, les D0-branes deviennent de masse nulle et la théorie de type IIA développe une onzième dimension non compacte. La dimension critique de la théorie des supercordes de type IIA apparaît donc comme un artefact de la théorie de perturbations. Ce point de vue supprime également la distinction entre états fondamentaux et états solitoniques : la corde fondamentale et la D2-brane ne sont que les réductions diagonale et verticale d’une membrane de la théorie à onze dimensions, tandis que les D4-branes et 5-brane de Neveu-Schwarz correspondent aux descendants d’une unique 5-brane à onze dimensions. La D6-brane, chargée magnétiquement sous le champ de jauge de Kaluza-Klein , peut encore être identifiée au monopôle magnétique de Kaluza-Klein sous la réduction dimensionnelle [Tow95]. Enfin, la compactification de la théorie à onze dimensions sur un segment peut être identifiée avec la théorie des cordes hétérotiques . L’invariance de jauge apparaît sous la forme de multiplets vectoriels à dix dimensions se propageant sur les 9-branes à chaque extrémité du segment. Ces états sont analogues aux états twistés des constructions d’orbifold, bien qu’ils ne soient plus imposés par une condition d’invariance modulaire, mais par la compensation locale de l’anomalie de cette théorie chirale. Tout comme la onzième dimension disparaît dans la théorie de perturbation de type IIA, l’écart entre les deux 9-branes s’annule en théorie des perturbations hétérotique, menant à une théorie des supercordes en dimension critique. La corde fondamentale hétérotique peut alors être interprétée comme la membrane de la théorie à onze dimensions suspendue entre les deux 9-branes.
Les cinq théories de supercordes et la supergravité à onze dimensions apparaissent ainsi comme cinq différentes facettes d’une théorie non perturbative des supercordes, plus communément nommée M-théorie, dont la formulation ab initio reste encore Mystérieuse. Les théories de cordes et leurs dualités définissent la M-théorie comme les cartes et fonctions de transitions définissent une variété différentielle, aux restrictions près que la théorie n’est définie qu’asymptotiquement sur chaque carte, tandis que la compatibilité des fonctions de transitions n’est acquise que dans le secteur BPS. Membranes et 5-branes semblent en tenir les rôles principaux, mais les tentatives de quantification se heurtent aux non-linéarités de leur propagation libre. L’inclusion non perturbative de leurs interactions semble du reste encore plus inaccessible. Plusieurs tentatives de définition totalement orthogonales à cette approche ont été proposées, les unes basées sur des modèles de matrice supersymétriques, d’autres sur une théorie de Chern-Simons à onze dimensions [Hor97]. La formulation de Banks, Fischler, Shenker et Susskind semble pour le moment la plus prometteuse, et fera l’objet du dernier chapitre de ce mémoire. En l’attente d’une formulation non perturbative ab initio de la M-théorie, une approche moins ambitieuse et plus pragmatique consiste à étudier dans quelle mesure les méthodes semi-classiques de la théorie des champs peuvent s’étendre à la théorie des cordes. Cette étude constitue le coeur de ce travail de thèse, et fait l’objet du chapitre que nous abordons maintenant.
Chapter 4 Approche semi-classique à la M-théorie
Les méthodes semi-classiques figurent parmi les rares outils d’investigation des théories de champs non intégrables au niveau non perturbatif. Elles sont particulièrement adaptées aux situations où les corrections perturbatives sont nulles ou en nombre fini : les contributions des points-selle de l’action microscopique, ou instantons, fournissent les premières corrections non perturbatives à ces amplitudes. Par chance, de nombreuses quantités physiques des théories de supercordes sont protégées des corrections perturbatives par des théorèmes de non renormalisation. Par malchance, l’action microscopique de la théorie non perturbative des supercordes n’est pas connue, et les règles de somme sur les points-selle, sinon les points-selle eux-mêmes, sont indéterminés. Les théories de supergravité, décrivant les théories de cordes à basse énergie, fournissent une première détermination du spectre des instantons. Les dualités des théories de cordes sont quant à elles assez strictes pour autoriser la détermination exacte de certaines amplitudes physiques. Le développement de ces amplitudes à faible couplage met en évidence une somme d’effets non perturbatifs que l’on peut chercher à interpréter comme la contribution des points-selle de la M-théorie. On peut ainsi par recoupement déterminer les règles du calcul semi-classique dans une théorie dont on ne connaît pas la formulation microscopique, et espérer les appliquer dans les situations où les contraintes de dualité et de supersymétrie sont insuffisantes. Cette ligne directrice m’a ainsi conduit à étudier les effets non-perturbatifs dans les couplages gravitationnels en des théories de type II à supersymétrie maximale (annexes C,D et E) ; les couplages scalaires à quatre dérivées dans les théories de type II à 16 charges supersymétriques (annexe F) ; et les couplages gravitationnels en dans ces mêmes théories (annexe B). Ces amplitudes physiques présentent le dénominateur commun de ne recevoir de contributions que de configurations solitoniques préservant la moitié des supersymétries. Cette propriété de saturation BPS va de pair avec la propriété de non renormalisation et simplifie considérablement l’identification des instantons contribuant à l’amplitude. Dans ce chapitre, nous introduirons et discuterons les résultats obtenus dans ces travaux, renvoyant aux articles eux-mêmes pour la dérivation.
4.1 Calcul semi-classique en M-théorie
4.1.1 Instantons de surface d’univers et instantons d’espace–temps
La notion d’approximation semi-classique renvoie en général à la limite et aux affres liés au rétablissement d’un symbole si étroitement identifié à 1 et ses multiples. Dans le cas des théories de jauge, la normalisation standard de l’action identifie la constante de couplage à , et la limite semi-classique est aussi une limite de faible couplage. Dans le cas des théories de cordes, il faut distinguer l’action de la corde, dite de première quantification, de l’action du champ de corde, correspondant à la seconde quantification. joue le même rôle que dans le premier cas, et le développement semi-classique correspond à un développement de basse énergie. Il prend en compte les configurations d’instantons du modèle sigma bidimensionnel, dits instantons de feuille d’univers (worldsheet instantons), dans lesquels la surface d’univers s’enroule autour d’un cycle non trivial de l’espace-cible. Ces instantons génèrent des effets d’ordre , où est l’aire du cycle, et peuvent apparaître à tout ordre de la théorie de perturbation en . Le second cas est malheureusement moins explicite, l’action du champ de corde n’étant pas connue. La constante de Planck doit cependant y apparaître comme diviseur commun, et le développement semi-classique est alors un développement autour des solutions classiques de l’équation du mouvement des champs de cordes. Ces équations du mouvement se décomposent en autant d’équations que de modes propres de la corde, et les configurations d’instanton décrivent la configuration de tous ces modes. L’effet des modes massifs peut cependant être intégré de manière à ne laisser que la dynamique effective des champs de masse nulle, décrite par une action où (à l’ordre des arbres) le dilaton apparaît comme facteur global. L’approximation semi-classique correspond donc à toutes fins utiles à une approximation de faible couplage. Les instantons correspondants, dits instantons d’espace-temps, contribuent aux amplitudes par un facteur où représente l’action de l’instanton.
4.1.2 Série de perturbation et effets non-perturbatifs
Les instantons correspondent aux transitions entre plusieurs vides perturbatifs d’une théorie quantique. Ils sont particulièrement familiers dans les théories de Yang-Mills, où ils correspondent aux connexions de jauge à courbure auto-duales de la théorie euclidienne. Ces configurations minimisent l’action euclidienne dans le secteur de seconde classe de Chern , et induisent des effets non perturbatifs d’ordre . Des instantons analogues apparaissent également en présence de gravitation sous la forme d’espaces asymptotiquement localement euclidiens (ALE spaces), de courbure de Riemann auto-duale (cf. [EGH80] pour une revue détaillée). Ils génèrent des effets du même ordre , où le couplage correspond cette fois au couplage gravitationnel et multiplie l’action de Einstein-Hilbert. Ces effets sont comparables à l’incertitude de la série perturbative asymptotique aux grands ordres de perturbation. Les diagrammes de Feynman à boucles donnent en effet une contribution d’ordre à l’amplitude totale, générant des pôles dans le plan de Borel. Le choix de la prescription de contournement des pôles introduit alors après transformation de Borel inverse des incertitudes d’ordre 111Je remercie V. Rivasseau pour ses explications eclairantes sur le sujet..
Les théories de cordes unifient en particulier les interactions de jauge et la gravitation avec le même couplage , et doivent donc inclure de tels effets non perturbatifs. Comme l’a remarqué Shenker, le volume de l’espace des modules des surfaces de Riemann de genre , analogue aux facteurs combinatoires des diagrammes de Feynman de la théorie des champs, induit un comportement beaucoup plus explosif de la série de perturbation aux grands ordres, conduisant à une incertitude d’ordre [She90]. Bien qu’observés explicitement dans les modèles de matrice des théories de cordes, ces effets instantoniques beaucoup plus importants à faible couplage sont restés mystérieux jusqu’à la découverte des D-branes 222L’explication de ces effets ne nécessite en réalité que le couplage anormal des champs de jauge de Ramond au dilaton, conduisant aux solitons de supergravité de masse , et non la formulation de ces D-branes en termes de théories conformes bidimensionnelles à bord., dont la masse se comporte précisément comme . Après rotation de Wick, ces solitons donnent ainsi lieu à des instantons dont l’action euclidienne croît comme . La contribution en peut également s’expliquer heuristiquement comme l’exponentiation de diagrammes de disque d’ordre correspondant aux surfaces d’univers des cordes ouvertes attachées à la membrane333Ces diagrammes restes connexes en raison du flux de moment d’un disque à l’autre à travers la D-brane. [Pol94b].
4.1.3 M-théorie et approximation semi-classique
La M-théorie est en l’état actuel définie par les théories de supercordes qui en donnent différentes approximations perturbatives. Elle présente donc autant d’approximations semi-classiques que de limites perturbatives, et le choix de telle ou telle description dépend du régime des paramètres considéré. En particulier, les configurations d’instantons diffèrent d’une limite à l’autre. Elles peuvent être obtenues par l’étude des solutions classiques des théories de supergravité euclidiennes décrivant les modes de masse nulle de la M-théorie dans la limite considérée, bien qu’on ne puisse exclure l’existence de solutions mettant en jeu les modes massifs. Nous avons déjà discuté les solutions des théories de supergravité minkovskiennes du spectre 1/2-BPS des théories de cordes. Après rotation de Wick, ces solitons fournissent des configurations instantoniques de -brane préservant la moitié des supersymétries. Ces configurations infiniment étendues possèdent cependant une action euclidienne infinie, et ne décrivent donc pas des instantons à dix dimensions 444On pourrait imaginer de replier le volume d’univers de ces solutions en un volume fini, mais l’action ne serait alors plus extrémale sous les contractions de ce volume.. Seule la supergravité de type IIB présente des configurations instantoniques localisées d’action euclidienne finie, correspondant à une excitation de la métrique et du scalaire de Ramond . Cette configuration est décrite par la D(-1)-brane, ou D-instanton, de la théorie de type IIB [Gre91]. Son action euclidienne
| (4.1) |
peut être vue comme un cas dégénéré de l’action de Born-Infeld (3.38).
Après compactification en revanche, il devient possible de stabiliser les configurations euclidiennes de -branes en les enroulant sur certains cycles non triviaux de la variété de compactification. On obtient ainsi des instantons d’action euclidienne finie en dimension inférieure. La préservation d’une partie des supersymétries impose les mêmes conditions géométriques sur le cycle que dans le cas des solitons BPS (section 2.4.4). Les D-branes donnent ainsi lieu à des configurations d’action euclidienne donnée par l’action de Born-Infeld
| (4.2) |
faisant intervenir la courbure du champ de jauge du volume d’univers de la D-brane, tandis que l’action associée à la 5-brane de Neveu-Schwarz enroulée sur un 6-cycle s’écrit
| (4.3) |
où est le tenseur de jauge dual au tenseur de Neveu-Schwarz à dix dimensions sous la dualité de Poincaré. La théorie de type I recevra ainsi des contributions en des D1- et D5-branes, tandis que les théories de type IIA et IIB recevront des contributions des D-branes de dimension paire et impaire respectivement ; toutes les théories de supercordes pourront en outre recevoir des contributions de NS5-brane d’ordre . En particulier, les cordes hétérotiques et ne présentant pas de D-brane dans leur spectre solitonique, seules des corrections en seraient attendues 555L’argument de Shenker de la section 4.1.2 s’applique cependant tout autant à la corde hétérotique, et de fait la dualité hétérotique-type I transforme les instantons de surface d’univers de type I en des effets en de la corde hétérotique, dont l’interprétation reste mystérieuse. Il serait très intéressant de disposer d’un exemple explicite de tels effets.. La corde hétérotique apparaît ici encore comme la description perturbative <<la moins incomplète>> de la M-théorie, si toutefois cette conjecture s’avère correcte. Encore ces instantons n’épuisent-ils que le spectre des configurations préservant la moitié des supersymétries, auxquelles il faut encore ajouter les configurations de -branes intersectantes, et nombre d’objets non décrits par l’ansatz (2.28a).
4.1.4 Instantons et saturation BPS
Les contraintes de supersymétrie permettent heureusement de contrôler cette prolifération. Chaque classe de configuration instantonique admet en effet des déformations continues paramétrées par des coordonnées collectives, sur lesquelles les fonctions de corrélation doivent être intégrées [GJS76]:
| (4.4) |
dénote l’action de l’instanton, la forme quadratique décrivant les fluctuations gaussiennes autour de l’instanton orthogonales aux modes zéros ; les représentent les opérateurs de vertex intervenant dans la fonction de corrélation, et dépendent de l’amplitude physique considéree. Une coordonnée collective est en particulier associée à chaque symétrie brisée par la configuration solitonique666Dans le cas des théories de Yang-Mills, les instantons brisent l’invariance par translation et par dilatation ; ils présentent par conséquent des coordonnées collectives de position globale et de taille., bien que d’autres degrés de liberté puissent être présents. En particulier, chaque charge supersymétrique brisée par l’instanton engendre une coordonnée collective grassmannienne, ou mode zéro fermionique. L’intégration conduit donc à un résultat nul, à moins que les vertex évaluées autour de la configuration solitonique ne saturent tous les modes zéros fermioniques. Grâce à la supersymétrie, on peut toujours se ramener au cas où tous les opérateurs de vertex sont fermioniques 777La supersymétrie convertit une dérivée bosonique en un bilinéaire fermionique.. Ces opérateurs sont nuls dans la configuration bosonique de référence, mais dépendent linéairement au premier ordre en les coordonnées fermioniques grassmanniennes. Le nombre d’insertions doit donc au moins égaler le nombre de charges supersymétriques brisées par l’instanton.
Cette règle de sélection est à la base de théorèmes de non renormalisation très importants 888Il s’agit ici de théorèmes de non renormalisation semi-classique. Ils ne présagent pas de l’existence de corrections non perturbatives d’autre nature, bien que de telles corrections n’aient pas été observées.. En effet, les instantons brisent au minimum la moitié des charges supersymétriques. Les interactions correspondant à vertex fermioniques ne reçoivent donc pas de contributions instantoniques, tandis que celles correspondant à ne reçoivent de contributions que des instantons BPS préservant la moitié des supersymétries, ou 1/2-BPS saturés. Plus généralement, les interactions correspondant à peuvent être corrigés par des effets d’instantons BPS préservant supercharges. Cette supersymétrie résiduelle suffit à garantir la compensation entre les modes bosoniques et fermioniques autour de l’instanton, soit . Les amplitudes vérifiant , ainsi que les termes de l’action effective auxquels elles correspondent, sont dits BPS saturées. Cette propriété permet également de déterminer le nombre d’instantons contribuant. La stabilité neutre des configurations BPS permet en effet de mettre en présence un nombre arbitraire d’instantons BPS, dont les positions relatives sont décrites par des coordonnées collectives supplémentaires, ainsi que leurs partenaires supersymétriques grassmanniennes. Les modes zéros d’une telle configuration ne sont alors plus saturés, et la contribution à l’amplitude s’annule. Cet argument peut être mis en défaut aux points singuliers de l’espace des modules des instantons où la dimension de l’espace tangent change, et on ne peut donc exclure les contributions d’instantons BPS coïncidant [Bac97]; ceux-ci sont cependant en général indistinguables des instantons de charge multiple.
Ainsi, dans le cas des théories de supersymétrie maximale soit à supercharges, les premiers effets instantoniques peuvent se manifester dans les couplages -BPS saturés à 16 fermions, reliés par supersymétrie aux couplages à 8 dérivées. Le seul multiplet étant le multiplet gravitationnel, ces couplages correspondent aux interactions en , où la contraction des indices de Lorentz n’est pas spécifiée. Ces couplages font l’objet des publications en appendices C, D et E. Les couplages en sont quant à eux -BPS saturés, et les couplages en reçoivent a priori des contributions des instantons non supersymétriques. Dans le cas des théories à 16 supercharges, le rôle des couplages -BPS saturés est joué par les interactions en et , cette dernière faisant l’objet de la publication en appendice F. Finalement, dans les théories à 8 supercharges, l’action à deux dérivées elle-même est corrigée, et le potentiel scalaire dans les théories à 4 supercharges. Dans ces deux derniers cas, la structure holomorphe de la géométrie des multiplets vectoriels et du superpotentiel respectivement interdit les corrections en . Cette restriction ne s’applique cependant pas à la géométrie des hypermultiplets et au potentiel de Kähler respectivement. Elle ne limite pas non plus les corrections de NS5-brane en dans aucun de ces termes.
4.2 Instantons hétérotiques de 5-brane
Les premiers exemples explicites de corrections non-perturbatives en théorie des cordes ont été obtenus dans l’étude de la métrique des multiplets vectoriels dans les compactifications de la corde hétérotique sur ; ils sont basés sur la conjecture de dualité hétérotique-type IIA formulée par Kachru et Vafa dans le cadre des théories de type II [KV95], et en fournissent une vérification cruciale (voir par exemple [Par97]). Un ingrédient essentiel à la démonstration est la propriété de découplage des multiplets vectoriels et des hypermultiplets. Le dilaton appartient à un hypermultiplet dans la théorie de type II, de sorte que la métrique des multiplets vectoriels ne peut recevoir aucune correction perturbative ou non perturbative du coté de type IIA. Elle est donc donnée exactement par la contribution à l’ordre des arbres 999En pratique, les instantons de surface d’univers apparaissant dans la métrique à l’ordre des arbres sont calculés classiquement par symétrie miroir à partir de la théorie de type IIB.. Ce théorème de non renormalisation ne s’applique pas du côté hétérotique, où le dilaton appartient à un multiplet vectoriel. On peut appliquer la transformation de dualité et traduire la métrique exacte des multiplets vectoriels de type II dans les variables hétérotiques. Les effets d’instantons de surface d’univers en s’interprètent alors comme des instantons d’espace-temps en de la théorie hétérotique. Les complications géométriques des compactifications de type II sur espace de Calabi-Yau et hétérotiques sur une variété ont cependant empêché jusqu’à présent une interprétation de ces corrections en termes de NS5-branes enroulées sur .
Les contributions des NS5-branes peuvent être plus facilement analysées dans le cas de la compactification toroïdale de la corde hétérotique. On obtient ainsi une théorie à quatre dimensions, dont l’action effective à deux dérivées ne reçoit pas de corrections quantiques perturbatives ou non perturbatives. En revanche, les corrections gravitationnelles en correspondent à des couplages 1/2-BPS saturés et peuvent recevoir des corrections de NS5-brane. Ces corrections ont été déterminées par Harvey et Moore en utilisant la dualité entre la corde hétérotique compactifiée sur et la corde de type II compactifiée sur [HM96]. Le couplage en est en effet le premier d’une suite d’amplitudes topologiques de la théorie de type II, où represente ici la courbure d’un champ de jauge du multiplet gravitationnel [AGNT94]. Ces amplitudes peuvent être évaluées dans le cadre de la théorie topologique reliée à la théorie conforme bidimensionnelle sur par un twist, et un comptage des modes zéros sur la surface d’univers montre qu’elles ne reçoivent de contributions que de surfaces de Riemann de genre . Ce théorème de non renormalisation ne vaut bien entendu qu’au niveau perturbatif. Il peut être étendu au niveau non perturbatif en notant que dans le cas des théories , les amplitudes ne dépendent que des multiplets vectoriels, et ne reçoivent donc pas de corrections même non perturbatives. De fait, le calcul de l’amplitude à une boucle en type IIA donne
| (4.5) |
où dénote le module de Kähler du tore . Cette expression est en elle-même invariante sous le groupe de U-dualité , et ne requiert donc pas de contributions perturbatives ou non perturbatives supplémentaires. L’indépendance de sur les modules de traduit le caractère topologique de cette amplitude. Exprimée en terme des variables hétérotiques, elle devient
| (4.6) |
où est le scalaire complexe décrivant le couplage de la théorie hétérotique compactifiée sur un tore de volume . Le développement à faible couplage de cette amplitude
| (4.7) |
reproduit la contribution à l’ordre des arbres , mais montre l’existence d’une série de contributions non perturbatives d’ordre 101010L’équation (4.7) montre également un terme traduisant l’existence d’une divergence logarithmique à fort couplage. Ce phénomène, que l’on retrouvera dans la suite, n’a pas encore reçu d’interprétation satisfaisante.. La comparaison du poids de ces termes avec l’équation (4.3) permet d’identifier ces contributions avec celle de NS5-branes euclidiennes dont les six directions sont enroulées autour du tore111111ou alternativement, d’une seule NS5-brane enroulée fois autour du tore. Le cas correspond à une anti-brane, ou une brane d’orientation opposée à l’orientation de .. L’indépendance de sur les modules du réseau traduit la neutralité de la 5-brane vis-à-vis du groupe de jauge hétérotique. L’extension de ce raisonnement aux théories de rang réduit fait l’objet de la publication en appendice F. Il montre en particulier l’existence d’une symétrie restaurée dans la limite de fort couplage et grand volume de certaines théories hétérotiques (figure LABEL:tt:f1 page LABEL:tt:f1). Nous reviendrons également plus loin sur une autre amplitude, cette fois exacte du côté hétérotique, mais correspondant à des effets de D-brane du côté de type II.
4.3 Instantons de type II et D-branes
Dans la section précédente, nous avons décrit des effets non perturbatifs de la corde hétérotique interprétés en termes de NS5-branes neutres enroulées autour du tore . La connaissance très imparfaite de la description des NS5-branes ne nous a permis d’en donner une interprétation précise que dans le cas simple d’une compactification toroïdale sur . La dynamique des D-branes de type I et II est en revanche bien comprise dans le cadre de l’action de Born-Infeld, et la signature en de ces effets en permet une identification beaucoup plus sûre. La variété de leurs dimensionnalités permet également d’étudier comment elles rentrent en jeu successivement au cours de la compactification sur des tores de dimension croissante. Avant de montrer ce point, nous commencerons cependant par discuter brièvement le premier exemple explicite de corrections de D-branes construit par Ooguri et Vafa dans le cadre des compactifications de type II sur espace de Calabi-Yau.
4.4 D-instantons et géométrie des hypermultiplets
La résolution par Strominger de la singularité de conifold a constitué l’un des premiers succès de l’application des idées de Seiberg et Witten en théorie des cordes [Str95]. Cette singularité apparaît dans la métrique des multiplets vectoriels décrivant la structure complexe de l’espace de Calabi-Yau dans le cas de la compactification de la théorie de type IIB à quatre dimensions, lorsqu’un 3-cycle de dégénère. Elle se traduit par une divergence logarithmique dans le prépotentiel à l’ordre des arbres lorsque la période s’annule. La métrique des multiplets vectoriels de type II étant exacte à l’ordre des arbres, cette singularité ne peut être éliminée par les corrections quantiques, et doit donc avoir une origine physique : Strominger a montré qu’elle correspondait à l’intégration d’un état non perturbatif devenant de masse nulle lorsque ; cet état n’est autre que la D3-brane enroulée autour du cycle évanescent [Str95].
Par symétrie miroir, il existe donc également une singularité logarithmique dans la métrique perturbative des hypermultiplets de la théorie de type IIA sur la variété miroir . Il n’existe cependant pas de D3-brane dans la théorie de type IIA pour expliquer cette singularité, et du reste la métrique des hypermultiplets n’est plus protégée des corrections quantiques. Ooguri et Vafa ont montré que les corrections instantoniques de D2-brane enroulées autour du cycle évanescent pouvaient résoudre la singularité, et ont donné une expression explicite pour ces corrections dans le cas idéalisé où la variété des hypermultiplets se restreignait à une variété hyperkählérienne de dimension 4 [OV96]. Ce cas correspond à la limite de double scaling . Les quatre scalaires de l’hypermultiplet correspondent alors à la période et deux variables périodiques réelles décrivant la valeur moyenne du tenseur de Ramond sur et sur son dual. La métrique est classiquement invariante par translation selon et , mais les instantons enroulés sur brisent l’invariance de translation selon à un sous groupe discret . Une métrique hyperkählerienne de dimension 4 avec une isométrie admet la forme générale121212Cet ansatz apparaît également dans l’étude des instantons gravitationnels, et définit les espaces d’Eguchi-Hanson, et de Taub-NUT, (voir [EGH80]). La solution de Ooguri et Vafa resurgira dans le chapitre 5.
| (4.8) |
où le potentiel et le vecteur vérifient les conditions
| (4.9) |
et peuvent donc être interprétés comme des potentiels électrostatique et magnétostatique respectivement, crées par la même distribution de charges, axisymétrique puisque la phase de ne doit pas intervenir. Les effets instantoniques étant éliminés pour , vérifie la condition aux limites
| (4.10) |
Ces conditions déterminent alors à toute distance par
| (4.11) |
correspondant à une distribution de charges ponctuelles régulièrement espacées le long de l’axe . Les pôles simples en ne correspondent à aucune singularité de la métrique 131313Ce ne serait plus le cas si les charges ponctuelles avaient une valeur double, tout comme la métrique en coordonnées polaires présente une singularité conique lorsque . , et la singularité de conifold disparaît donc sous les corrections d’instantons. Le comportement à faible couplage peut être exhibé par resommation de Poisson sur l’entier :
| (4.12) |
où est une constante arbitraire, et redonne la contribution logarithmique perturbative, ainsi qu’une somme d’effets non perturbatifs exprimés en terme de la fonction de Bessel ; les fonctions de Bessel se comportent à grand argument comme 141414On trouvera dans l’appendice de la publication en annexe C un rappel des propriétés des fonctions , ainsi qu’une méthode commode pour effectuer ce type de resommation de Poisson ; la série dans l’équation (4.13) se termine à lorsque est demi-entier.
| (4.13) |
L’action euclidienne associée à ces effets s’écrit donc , soit précisément l’action euclidienne associée à une D3-brane enroulée fois autour du 3-cycle de volume et de flux de Ramond . Les corrections à l’approximation (4.13) traduisent l’existence de corrections perturbatives autour de la configuration d’instanton. L’absence de corrections perturbatives au terme logarithmique dans le vide trivial suppose en revanche un théorème de non renormalisation perturbative au-delà d’une boucle de la métrique des hypermultiplets.
Ce résultat constitue à ma connaissance le premier exemple de calcul explicite de corrections de D-branes à une amplitude physique. Il présente bon nombre de phénomènes que nous retrouverons à l’oeuvre dans la suite de ce mémoire. Il ne s’applique cependant qu’à une situation <<idéalisée>>, et fait une utilisation cruciale des contraintes géométriques des variétés hyperkählériennes de dimension 4, lesquelles n’ont pas d’équivalent en dimension supérieure. Dans les sections suivantes, nous considèrerons des amplitudes physiques pour lesquelles les contraintes de dualité permettent de donner des résultats exacts, et étudierons leur interprétation en termes de somme d’instantons.
4.5 D-instantons et compactification toroïdale
L’étude des compactifications toroïdales de la M-théorie permet de s’affranchir des complications algébriques liées à la détermination des cycles supersymétriques des espaces de Calabi-Yau pour se concentrer sur les contributions propres des D-branes. Le groupe de U-dualité apparaissant dans ces théories à supersymétrie maximale est en outre assez contraignant pour permettre une détermination exacte de certains couplages, dont on peut alors analyser les contributions non perturbatives. Nous nous intéresserons en particulier aux couplages en , qui sont 1/2-BPS saturés dans ces théories à 32 charges supersymétriques151515Des couplages en ont également été étudiés dans les théories hétérotiques et de type I, où ils sont reliés par supersymétrie à des termes d’anomalie et donc non renormalisés au-delà d’une boucle [BFK+98, KO97] ; des couplages reliés par supersymétrie aux couplages en ont été considérés par [KP97b, GGK97]., et qui sont en outre invariants sous la U-dualité, cette dernière préservant la métrique dans le référentiel d’Einstein. La M-théorie compactifiée sur un cercle est décrite à faible rayon par la théorie des cordes de type IIA à dix dimensions. Cette dernière n’admet pas de configurations d’instantons 1/2-BPS, et on s’attend donc à ce que le couplage en soit donné par sa valeur perturbative. Le groupe de U-dualité de la théorie de type IIA non compactifiée est cependant trivial, et il n’est pas clair à ce stade quels ordres de la théorie de perturbation contribueront à ce couplage. La théorie de type IIB à dix dimensions présente en revanche une symétrie non perturbative qui nous permettra, à la suite de Green et Gutperle, de déterminer les contributions perturbatives ainsi que la contribution des D(-1)-instantons ; nous pourrons alors en déduire le couplage de type IIA après compactification à 9 dimensions sur un cercle suivie d’une T-dualité. La poursuite de ce raisonnement pour des compactifications nous permettra de déterminer les contributions des D-branes de toutes dimensions à ces couplages.
4.5.1 Couplages dans la théorie de type IIB non compactifiée
Le couplage à l’ordre des arbres et à une boucle dans l’action effective peut être aisément déterminé en calculant l’amplitude de diffusion à quatre gravitons 161616Il est techniquement plus commode de calculer l’amplitude à quatre gravitons et un module dans la théorie compactifiée sur . et en isolant la contribution dominante à basse énergie, soit huit puissances des moments externes. On obtient ainsi, dans la métrique des cordes,
| (4.14) |
où (resp. ) en type IIB (resp. IIA). Les tenseurs et désigne les contractions particulières des indices du tenseur de Riemann provenant des contractions des fermions de surface d’univers dans les structures de spin impaires et paires :
| (4.15) | ||||
| (4.16) |
En particulier, les diagrammes à l’ordre des arbres et à une boucle contribuent en type IIB au même couplage dans la métrique d’Einstein
| (4.17) |
où
| (4.18) |
Le couplage complet , invariant sous les transformations modulaires du paramètre , ne saurait donc se restreindre aux seules contributions perturbatives de la sphère et du tore. D’un autre côté, on ne peut utiliser les résultats usuels sur les fonctions modulaires, puisque n’est manifestement ni holomorphe, ni harmonique. Il existe cependant une classe de fonctions réelles invariantes sous le groupe modulaire , correspondant aux séries d’Eisenstein d’ordre
| (4.19) |
dont le comportement à faible couplage, soit , peut s’obtenir par resommation de Poisson sur l’entier :
| (4.20) |
Green et Gutperle ont en particulier remarqué que la série d’Eisenstein reproduisait précisément les deux termes perturbatifs de ; elle les complète en une fonction invariante sous la U-dualité par une somme infinie de termes non perturbatifs [GG97b]. En utilisant le comportement asymptotique de la fonction de Bessel (4.13), on obtient
La comparaison avec l’action euclidienne (4.1) montre que chaque terme non perturbatif peut s’interpréter comme la contribution de D-instantons de la théorie de type IIB à l’amplitude , ou alternativement d’un instanton de charge . Les corrections correspondent à des corrections perturbatives dans le champ de fond de l’instanton. Il est donc naturel de conjecturer, à la suite de Green et Gutperle, que le couplage exact dans la théorie de type IIB est donné par la série d’Eisenstein . Cette conjecture suppose en particulier que toutes les corrections perturbatives à plus d’une boucle s’annulent. Ce théorème de non-renormalisation perturbative pourrait en principe être démontré par un comptage soigneux des modes zéros fermioniques correspondant à l’amplitude à quatre gravitons sur une surface de genre arbitraire ; Berkovits a pu en donner une preuve basée sur les contraintes de supersymétrie après compactification sur un tore [Ber97]. Il est particulièrement intéressant de noter la mesure de sommation sur ces instantons :
| (4.21) |
Cette mesure a pu être déterminée par Sethi et Stern dans le cas dans le cadre du modèle de matrice décrivant les D-instantons [SS97b], mais la démonstration de cette formule pour tout reste un problème ouvert [GG97a]. Avant d’étudier les conséquences de cette conjecture pour les D-branes de dimension plus élevée, nous discutons dans la section suivante quelques propriétés des séries de Eisenstein et leur pertinence pour les couplages de la théorie de type IIB.
4.5.2 Fonctions modulaires réelles et séries de Eisenstein
En comparaison avec les formes modulaires holomorphes, les fonctions modulaires réelles, c’est-à-dire les fonctions définies sur le demi-plan de Poincaré et invariantes sous les transformations modulaires de , sont encore largement méconnues. Leur importance pour certains problèmes de théorie des nombres a cependant aiguisé l’intérêt des mathématiciens, et on trouvera une présentation abordable des principaux résultats à leur sujet dans l’ouvrage de A. Terras [Ter85]. Les séries de Eisenstein constituent en réalité les seules fonctions modulaires réelles connues explicitement. La série (4.5.1) en fournit une définition pour , qui peut être prolongée analytiquement dans tout le plan complexe privé de 171717Les pôles de la fonction en sont en effets compensés par les zéros de la fonction , et le pôle en de la fonction est compensé par le pôle de la fonction dans le second terme., et la fonction peut être régularisée en soustrayant le pôle simple
| (4.22) |
où l’on reconnaît la contribution de l’orbite dégénérée à la fonction de partition de . L’existence du pôle en peut également être observée à partir de la relation de symétrie
| (4.23) |
Les fonctions de Eisenstein sont des fonctions propres du Laplacien sur le demi-plan de Poincaré :
| (4.24) |
à l’exception de la série régularisée :
| (4.25) |
qui souffre de l’anomalie holomorphique usuelle, correspondant à la divergence logarithmique en . La relation (4.23) traduit la non dégénérescence des valeurs propres du Laplacien. En sus des séries d’Eisenstein, le Laplacien admet une infinité discrète de formes cuspoïdales (cusp forms) , de valeurs propres localisées sur l’axe ; ces formes sont définies par l’annulation des coefficients et dans le développement de Fourier générale des modes propres
| (4.26) |
et décroissent donc exponentiellement en . Aucune d’entre elles n’est malheureusement connue explicitement. Etant donné le spectre du Laplacien, on peut maintenant énoncer le théorème de décomposition spectrale de Roelcke-Selberg : toute fonction modulaire de carré intégrable181818pour la mesure invariante . Noter que les séries d’Eisenstein ne sont jamais de carré intégrable, et sont intégrables pour . se décompose sur les modes propres du Laplacien selon
| (4.27) |
Après avoir rappelé cet arrière-plan mathématique, nous pouvons maintenant discuter la relevance des séries de Eisenstein pour la détermination des couplages exacts de la théorie de type IIB. Les deux termes d’ordre et dans le développement (4.5.1) peuvent s’interpréter comme deux corrections perturbatives de cordes fermées s’ils sont séparés d’une puissance paire de : doit alors être demi-entier 191919Les fonctions de Bessel contiennent alors une série infinie de corrections perturbatives, par opposition aux fonctions .. L’entier correspond au nombre d’ordres de perturbations séparant ces deux contributions. En particulier, dans le cas des couplages en que nous avons considéré, l’ordre de la série était imposé par l’existence de corrections à l’ordre des arbres et à une boucle. Les puissances exactes du dilaton provenant de l’ordre de perturbation et de la transformation de Weyl doivent également être reproduites : si on considère une interaction de dimension 202020Dans la convention présente, désigne la dimension de longueur de l’opérateur, soit pour le terme d’Einstein-Hilbert à dix dimensions , ou pour le couplage . recevant des contributions de genre et , les deux conditions s’écrivent
| (4.28) |
dont la compatibilité impose
| (4.29) |
Cette condition est en particulier vérifiée pour le cas des couplages en , mais aussi pour les couplages , dont on peut donc imaginer qu’ils soient donnés par , correspondant à deux termes perturbatifs à et boucles respectivement. Cette conjecture vient d’être renforcée par Vafa et Berkovits, qui ont relié ce couplage à une amplitude topologique similaire aux amplitudes des théories [BV98].
Cette discussion ne fixe cependant que les contributions des séries d’Eisenstein au couplage. Les formes cuspoïdales ne sont pas visibles en série de perturbation, et ne contributent qu’aux effets instantoniques. Il serait particulièrement intéressant de mettre en évidence par un raisonnement de dualité de telles contributions, compte tenu de l’intérêt mathématique de ces formes. Dans le cas des couplages en de la théorie de type IIB, Green et Vanhove ont conjecturé que la condition pourrait être une conséquence de la supersymétrie[GV97]. Grâce aux techniques de superespace développées par Berkovits, j’ai pu prouver dans la note en annexe E [Pio98] que cela était bien le cas : ce théorème suffit donc à disqualifier les contributions de formes cuspoïdales à . Nous obtiendrons ce même résultat par un argument très différent dans la section 4.6.3.
4.5.3 Couplages et compactification de la M-théorie
Connaissant l’expression exacte des couplages en dans la théorie de type IIB à dix dimensions, on en déduit immédiatement le résultat après compactification à neuf dimensions sur un cercle : la théorie de type IIB à neuf dimensions ne possède toujours que les D(-1)-branes comme configurations instantoniques 1/2-BPS, et leur contribution est simplement multipliée par la circonférence du cercle, correspondant à l’intégration sur la coordonnée collective de translation le long de ce cercle. L’amplitude de 4 gravitons à une boucle présente la contribution supplémentaire des instantons de surface d’univers correspondant aux modes d’enroulement de la corde de type IIB (ou les états de moment de la corde de type IIA), mais on peut vérifier que cette contribution correspond à une structure tensorielle distincte . On obtient ainsi un résultat invariant sous la U-dualité à dix dimensions , qui n’est autre que la dualité de la théorie de type IIB. Après traduction dans les variables de la théorie de type IIA grâce à la T-dualité, on obtient le couplage
| (4.30) |
où dénote la valeur moyenne du champ de Ramond le long du cercle. Cette expression reproduit précisément les contributions à l’ordre des arbres et à une boucle, et exclue toute contribution perturbative d’ordre plus élevé. Elle inclut en outre une somme d’effets non perturbatifs
pouvant s’interpréter comme la contribution des instantons de D0-branes dont la ligne d’univers s’enroule autour du cercle : l’action euclidienne d’une telle configuration s’écrit en effet
| (4.31) |
La signification des entiers et à ce stade n’est pas claire, mais nous découvrirons bientôt que correspond à la charge de la D0-brane (c’est-à-dire au nombre de D0-branes élémentaires liées ensemble), tandis que correspond au nombre d’enroulement de la ligne d’univers autour de la direction compacte.
La limite de décompactification à dilaton constant supprime les contributions des états d’enroulement et des instantons de D0-branes. Le couplage de la théorie de type IIA à dix dimensions se réduit donc exactement à la contribution à l’ordre des arbres ; s’y ajoute le couplage correspondant à la décompactification de la contribution des états de Kaluza-Klein à neuf dimensions. On obtient ainsi l’action effective en de la théorie de type IIA:
| (4.32) |
Contrairement à la théorie de type IIB, l’action en de la théorie de type IIA ne reçoit donc pas de corrections radiatives au-delà d’une boucle.
Si la théorie de type IIA décrit en effet la M-théorie compactifiée sur un cercle, la limite de décompactification doit reproduire un couplage invariant sous le groupe de Poincaré à onze dimensions. Le couplage (4.32) vérifie bien cette condition, puisque sous cette limite, le terme à l’ordre des arbres est supprimé, et seul subsiste le couplage
| (4.33) |
La supergravité à onze dimensions décrivant la M-théorie ne peut restituer cette prédiction : le calcul de l’amplitude de diffusion de quatre gravitons à une boucle dans cette théorie non-renormalisable souffre d’une divergence cubique. La reproduction de ce résultat constituerait cependant un test crucial des propositions de définition microscopique de la M-théorie.
La restauration de l’invariance de Poincaré à onze dimensions dans la limite de fort couplage ne contraint pas seulement la limite , mais implique également l’invariance des couplages de la théorie de type IIA compactifiée sur sous les symétries du tore étendu ; ce groupe de symétrie avec le groupe de T-dualité génère en effet le groupe de U-dualité. L’invariance du couplage de la théorie de type IIA à neuf dimensions sous ces symétries peut être rendue manifeste en l’exprimant en termes des modules de la M-théorie compactifiée sur :
| (4.34) |
en parfaite analogie avec le couplage de type IIB (4.19). Comme l’ont remarqué Green, Gutperle et Vanhove, cette expression et sa généralisation en dimension peut être reproduite, à la divergence cubique mentionnée ci-dessus près, par un calcul de diffusion à une boucle de quatre gravitons de la supergravité à onze dimensions [GGV97]. Les nombres quantiques apparaissent alors comme les charges duales par resommation de Poisson aux moments de Kaluza-Klein du graviton <<tournant>> dans la boucle. Une telle connection n’est pas étonnante, les D0-branes étant identifiées aux modes de Kaluza-Klein du supergraviton à onze dimensions. Elle suppose néanmoins des propriétés de non-renormalisation des couplages de la M-théorie. On en déduit les contributions du supergraviton à 10 dimensions () et des D0-branes () au couplage en toutes dimensions :
| (4.35) | ||||
où la deuxième ligne s’obtient par resommation de Poisson sur l’entier . Cette description unifie ainsi en un résultat -invariant l’amplitude à l’ordre des arbres, la contribution à l’ordre d’une boucle de l’orbite dégénérée 212121L’orbite dégénérée désigne la contribution des cordes non excitées de nombres d’enroulement nuls à l’amplitude à une boucle, et correspond donc, tout comme l’amplitude à l’ordre des arbres, à la contribution du supergraviton à dix dimensions. et la contribution de D0-branes, d’action classique
| (4.36) |
Elle justifie en outre l’interprétation que nous avons donnée dans le cas des entiers et .
4.5.4 Cordes de charges et somme solitonique
Nous avons vu que ce résultat reproduisait la totalité du couplage en dimensions 9 et 10, en accord avec l’égalité de groupe de U-dualité et de son sous-groupe dans ces dimensions. En dimension 8, les D0-branes restent les seules configurations instantoniques de la théorie de type IIA compactifiée sur un tore , et on s’attend donc à ce que ce résultat reste valide. De fait, le groupe de U-dualité en dimension 8 se sépare en deux facteurs :
-
•
correspond au groupe modulaire du tore du point de vue de la M-théorie. Il contient en particulier le groupe de dualité non perturbative de la théorie de type IIB, et le sous-groupe de la T-dualité correspondant aux transformations modulaires de la structure complexe du tore de la théorie de type IIA (ou aux transformations de la structure de Kähler du tore de type IIB). Il agit sur l’espace des modules homogène comprenant en particulier le dilaton.
-
•
correspond inversement aux transformations modulaires de la structure complexe du tore de la théorie de type IIB et aux transformations de la structure de Kähler du tore de type IIA. Du point de vue de la M-théorie, il correspond aux transformations modulaires du module complexe paramétrant . Dans tous les cas il correspond à des transformations perturbatives.
Le calcul de l’amplitude à quatre gravitons à genre 0 et 1 montre que le couplage , ici écrit dans les variables de type IIB,
| (4.37) |
ne dépend que des modules de , tandis que le couplage
| (4.38) |
est donné à une boucle et ne dépend que des modules du second facteur (cf. annexe C). Cette analyse a été étendue à tous les ordres en perturbations par Berkovits [Ber97]. En collaboration avec E. Kiritsis, nous avons conjecturé que le premier couplage était donc donné exactement par la série d’Eisenstein d’ordre 3/2 (4.5.3) pour le groupe , tandis que le second couplage était exact à une boucle, et donc donné par la série d’Eisenstein d’ordre 1 . Cette conjecture contient les résultats précédents par décompactification du tore , et restitue les contributions attendues des D0-branes de la théorie de type IIA. La situation est cependant beaucoup plus intéressante du côté de type IIB, où l’on attend, en plus des D-instantons, les contributions des D1-branes ainsi que des cordes de charges qui leur sont reliées par S-dualité. De fait, l’expansion (4.5.3), en termes des variables de type IIB, donne
| (4.39) |
Cette expression contient pour la contribution des D-instantons (4.5.1) déjà observée en dimension supérieure. Lorsque cependant, l’action euclidienne des effets non perturbatifs
| (4.40) |
correspond précisément à l’action de Born-Infeld d’une D1-brane enroulée fois autour du tore et portant un flux électrique . Une telle configuration correspond en effet à une configuration des champs de plongement et un champ électrique
| (4.41) |
sur la surface d’univers D1-brane 222222Si la quantification des nombres d’enroulement est clairement imposée par la définition univoque du plongement , la quantification du flux résulte quant à elle de la compacité du groupe de jauge supporté sur la D-brane., et l’évaluation de la métrique et des tenseurs de jauge induits par ce plongement conduit à
| (4.42) | |||||
| (4.43) |
où la deux-forme d’enroulement
| (4.44) |
invariante sous les reparamétrisations de la surface d’univers, spécifie le 2-cycle sur lequel la D1-brane s’enroule. Dans le cas présent d’une compactification sur un tore , seule la composante intervient et s’identifie à la charge de l’équation (4.40). L’identification du flux électrique avec la charge de D-instanton réalise explicitement une proposition de Douglas et Witten sur la description d’états liés de solitons de D-branes, ici transposée dans le contexte des D-instantons [Dou95, Wit96a].
Si les D1-branes et les D-instantons sont apparus naturellement dans l’interprétation de la série d’instantons, le rôle du multiplet des cordes de charges de la théorie de type IIB est jusqu’à présent resté obscur. Ce n’est qu’en choisissant une représentation où la S-dualité commute avec le développement en série que leurs effets deviennent manifestes. Il suffit pour cela d’effectuer une resommation de Poisson sur la charge de D-instanton232323une resommation de Poisson sur l’entier ramènerait au contraire à la série d’Eisenstein (4.34), après avoir toutefois séparé la contribution des D-instantons . La fonction de Bessel donne alors après resommation de Poisson une fonction exponentielle , et la série peut alors être réécrite sous la forme
| (4.45) |
où la somme est effectuée sur les couples d’entiers sans diviseurs communs, et où le paramètre
| (4.46) |
n’est autre que le module de Kähler du tore mesuré par une corde de charges sous les tenseurs et de tension . Le couplage en de la théorie de type IIB s’interprète alors comme la somme des amplitudes à l’ordre des arbres et à une boucle des cordes de type c’est-à-dire comme une somme sur les solitons de la théorie de type IIB (Ce point de vue a également été discuté par Kehagias et Partouche [KP97a]). Le développement (4.45) commute cependant avec la S-dualité, et ne correspond donc plus à un développement semi-classique.
4.5.5 Instantons de D-branes et T-dualité
Après compactification sur un cercle supplémentaire, soit dans le cas de la M-théorie compactifiée sur , le groupe de U-dualité ne se réduit plus au sous-groupe géométrique . Cette extension coïncide avec l’apparition des D2-branes de la théorie de type IIA, qui peuvent maintenant s’enrouler autour du tore . Elle coïncide également avec la fusion des deux amplitudes , en raison de l’insuffisance des modes zéros fermioniques 242424alternativement, la densité d’Euler à huit dimensions s’annule en dimensions inférieures.. La série d’Eisenstein d’ordre pour le groupe constitue un candidat naturel pour le couplage en exact : nous avons pu prouver, en collaboration avec Elias Kiritsis, qu’elle restituait en effet 252525grâce à une propriété arithmétique assez miraculeuse. les amplitudes à l’ordre des arbres et à une boucle (toutes orbites confondues). Du point de vue de type IIB, elle reproduit également la série instantonique des D-instantons et D-cordes, ou la série solitonique des cordes de charge . Du point de vue de type IIA, elle montre au contraire les contributions des D2-branes d’action de Born-Infeld euclidienne
| (4.47) | |||||
où les formes et s’obtiennent en termes des configurations des champs sur la surface d’univers par
| (4.48) |
Les D0-branes apparaissent donc comme des flux électriques et magnétiques sur le volume d’univers des D2-branes, en parfaite analogie avec le cas des D-instantons et des D1-branes.
La détermination de la paramétrisation de l’espace homogènes des modules nécessaire à l’application de cette méthode devient assez rapidement prohibitive pour des compactifications en dimensions inférieures. Dans la publication annexée en appendice C, Elias Kiritsis et moi-même avons alors adopté une autre approche, et utilisé une séquence de T-dualités et transformations de Lorentz pour fixer les configurations des D-branes de dimension arbitraire. Appliquée sur l’action (4.36) d’une configuration de D0-branes enroulées autour d’un cycle du tore , la T-dualité selon la direction 1 génère une configuration d’action262626Le tilde dénote des corrections aux champs de Ramond proportionnelles à , soit ici , détaillées dans l’appendice D.
| (4.49) |
Pour satisfaire l’invariance sous les transformations de Lorentz internes , il est nécessaire de réinterpréter la première composante de la charge de la D0-brane comme un singlet , et les composantes suivantes comme les composantes d’un tenseur de charges . On découvre ainsi les charges et l’action euclidienne (4.40) de la D1-brane et des D-instantons de type IIB. Cette procédure peut être réitérée pour obtenir les charges et l’action des D-branes paires ou impaires de dimension arbitraire. On obtient ainsi pour la D3-brane
| (4.50) | |||||
que l’on peut encore relier à l’action de Born-Infeld de la D3-brane sous les identifications
| (4.51) |
En particulier, les D1-branes de charges d’enroulement apparaissent comme les flux electriques et magnétiques sur la D3-brane de charge d’enroulement , tandis que les D-instantons de charge apparaissent comme des instantons de la théorie de jauge sur le volume d’univers de la 3-brane272727Ces instantons, absents des théories de jauge dans l’espace non-compact, sont stabilisés par la compacité du volume d’univers de la 3-brane..
Comme nous l’avons remarqué dans la section (3.3.2), les champs de Ramond se transforment dans une représentation spinorielle du groupe de T-dualité . La représentation de ces champs comme formes de degré pair en type IIB ou impair en type IIA ne fait que refléter la décomposition d’un spineur de de chiralité fixée en représentations irréductibles de . Cette propriété est tout aussi est tout aussi valable des charges ou des D-branes de type IIB ou IIA sous ces champs. La partie imaginaire de l’action de Born-Infeld correspond alors à la contraction des spineurs conjugués et . La partie réelle dépend en revanche des modules définissant l’élement de l’espace homogène , soit la métrique dans le réseau de compactification
| (4.52) |
où se transforme dans la représentation fondamentale de . Cette métrique induit une métrique sur toutes les représentations de , et en particulier sur la représentation spinorielle . L’action de Born-Infeld peut alors s’écrire
| (4.53) |
où la T-dualité est maintenant manifeste. Connaissant l’action générale des D-branes, on peut alors l’insérer dans la série d’instantons
| (4.54) |
et essayer de reproduire les amplitudes en à l’ordre des arbres et à une boucle, tout au moins en dimension où les contributions de NS5-brane ne sont pas attendues. La règle de sommation sur les états de D(-1), D0-,D1- et D2-branes est déterminée par l’exactitude des couplages en en dimensions 7,8,9,10 282828On peut néanmoins concevoir de modifier cette règle de sommation tout en préservant l’invariance sous la T-dualité, par exemple en introduisant une contrainte ..
4.5.6 Instantons de D-branes et U-dualité
Si l’invariance sous la T-dualité est ainsi garantie, ce n’est pas le cas de l’invariance sous la U-dualité. Tout comme l’invariance sous la S-dualité de la théorie de type IIB, celle-ci peut être étudiée par resommation de Poisson sur l’entier . On obtient ainsi une série d’Eisenstein dont l’invariance sous la symétrie du tore étendu doit être manifeste. De manière inattendue, cette invariance n’est pas satisfaite292929Corrélativement, la série d’instantons de D-branes ne reproduit pas les contributions perturbatives au couplage en . par les contributions de D-branes en dimension . La resommation de Poisson conduit en effet à une série d’Eisenstein de terme général , où
| (4.55) | |||||
L’invariance sous les transformations de Lorentz de requiert alors l’introduction d’une quatre-forme aux côtés de la charge de D2-brane . Les charges et forment alors une représentation fondamentale du groupe de U-dualité , de norme carrée
| (4.56) |
Cette extension est loin d’être anodine : la norme de la charge croît en effet en par contraste avec la norme des charges de D-branes en , ce qui implique l’existence d’effets en là où seuls des effets en seraient attendus. L’existence de ces effets n’est cependant pas avérée dans la mesure où toutes les tentatives pour reproduire les amplitudes perturbatives à partir de cette série d’Eisenstein ont échoué.
4.6 D-instantons et la géométrie de
L’étude des couplages en dans les compactifications toroïdales de la M-théorie nous a permis d’identifier en détail les effets non perturbatifs intervenant dans ces couplages en termes d’instantons de D-branes enroulées sur les cycles non triviaux de la variété de compactification. Le succés de cette identification repose largement sur la paramétrisation explicite de l’espace des modules, et sur la connaissance du spectre des cycles supersymétriques du tore de dimension arbitraire. Il est cependant souhaitable de déterminer si cette image persiste dans des situations plus réalistes et donc moins supersymétriques. L’étude de la compactification à 16 charges de supersymétrie sur représente un premier pas dans cette direction. La dualité hétérotique-type II permet encore de contrôler les effets non perturbatifs dans les couplages 1/2-BPS saturés, et la simplicité géométrique de la variété permet encore d’en donner une interprétation en termes de D-branes.
Nous avons déjà discuté les cas de la théorie de type II compactifiée sur et de la théorie hétérotique sur dans le cadre des corrections gravitationnelles en : ces dernières sont calculables exactement à une boucle dans la théorie de type II, en raison du découplage des multiplets vectoriels et des hypermultiplets dans la théorie sous-jacente ; elles s’interprètent alors du côté hétérotique comme les contributions des instantons de NS5-brane enroulées sur le tore . Il existe cependant d’autres couplages 1/2-BPS saturés pour lesquels cette restriction ne s’applique pas. C’est le cas du couplage à quatre dérivées
| (4.57) |
où désigne le scalaire complexe du dilaton dans la théorie de type II (soit le module de Kähler de la théorie hétérotique duale). La comparaison des opérateurs de vertex du dilaton et du graviton montre que est relié perturbativement au couplage gravitationnel par la symétrie miroir . Il se réduit donc perturbativement à la contribution à une boucle donnée par la fonction modulaire
| (4.58) |
obtenue à partir du couplage (4.5) par échange des modules et . Du point de vue de la supersymétrie , est cependant comme le dilaton membre d’un hypermultiplet, et les corrections non perturbatives ne sont donc pas exclues. Elles sont du reste nécessaires à l’invariance de l’amplitude (4.57) sous le groupe de U-dualité mélangeant le module aux modules de et au dilaton. On peut cependant les calculer perturbativement du point de vue hétérotique, où le découplage des hypermultiplets au multiplet vectoriel du dilaton implique que l’amplitude image soit exacte à une boucle. Le développement à faible couplage de type IIA, soit à grand volume du côté hétérotique, permet alors d’analyser les contributions du côté de type II. Cette approche a été développée conjointement avec I. Antoniadis et T. Taylor, et a fait l’objet de la publication annexée en appendice F. Nous y réfèrons le lecteur pour les détails de la dérivation, et nous contentons d’en décrire le résultat.
4.6.1 Couplage exact à quatre dimensions
Le calcul de l’amplitude de diffusion à une boucle hétérotique de deux modules avec deux autres modules quelconques et conduit à l’intégrale de la fonction de partition du réseau de Narain sur le domaine fondamental du tore, en présence d’insertions de moments :
| (4.59) |
Le tenseur décrit la polarisation associée au module , et la fonction représente la contribution des 24 oscillateurs du côté droit. L’absence d’oscillateurs du côté supersymétrique gauche traduit la saturation BPS de ce couplage.
Dans la limite de grand volume du deux-tore , le réseau de Narain se factorise en deux réseaux ; les états de nombre d’enroulement non nul autour de donnent lieu à des corrections d’ordre en principe identifiables à des configurations instantoniques de NS5-branes de type II, négligeables devant les corrections qui nous intéressent ici. Les moments droits s’identifient alors aux moments gauches , et l’amplitude à quatre modules devient alors intégrable par rapport aux modules et :
| (4.60) |
Le couplage s’écrit alors, après resommation de Poisson sur les charges de moments autour de et intégration sur ,
| (4.61) |
Les deux charges sont duales aux charges de moments autour du tore de métrique , tandis que les 24 charges indexent les vecteurs du réseau , de norme carrée et produit pair . Les modules désignent les lignes de Wilson des champs de jauge du réseau autour des deux cycles de . Finalement, les coefficients correspondent aux coefficients de Fourier de la fonction modulaire comme dans l’équation (3.56). Les états de charge engendrent la contribution dominante à cette expression :
| (4.62) |
laquelle reproduit précisément l’amplitude à une boucle dans la théorie de type IIA duale (4.58), donnant un test supplémentaire de la dualité hétérotique-type II. Les états de charge non nulle induisent quant à eux des contributions d’ordre :
| (4.63) |
4.6.2 Instantons et l’homologie de
Dans les variables de type IIA, ces contributions correspondent alors à des effets d’ordre :
| (4.64) |
correspondant à une action euclidienne
| (4.65) |
où désigne le dilaton de la théorie de type IIA à six dimensions. Ces effets s’interprètent naturellement en termes de D-branes de la théorie de type IIA s’enroulant sur les cycles impairs de la variété de compactification : on reconnaît en effet dans l’action (4.65) le produit de la masse d’un état solitonique à six dimensions (3.58) par la longueur d’un cycle de nombres d’enroulement autour des deux cercles du tore . L’état solitonique à six dimensions correspondant lui même à une D-brane enroulée sur un cycle pair de , on obtient bien ainsi l’action euclidienne de la D-brane enroulée sur le produit . L’identification des lignes de Wilson hétérotiques avec les valeurs de fond des potentiels de Ramond permet également d’interpréter la partie imaginaire de l’action effective comme le couplage de la D-brane aux champs de Ramond :
| (4.66) |
Du point de vue de la théorie de type IIB 303030Ce paragraphe constitue une addition par rapport à la publication en annexe F., l’action euclidienne des effets non perturbatifs devient
| (4.67) |
où on a renommé les charges en et séparé la matrice des champs de Ramond en deux vecteurs , correspondant aux valeurs de fond des champs de Ramond sur les 24 cycles de , et , correspondant aux valeurs de fond sur des 24 tenseurs antisymétriques à six dimensions obtenus en réduisant les champs de Ramond sur . Les entiers et différencient les deux types de configurations instantoniques susceptibles d’apparaître dans la compactification de la théorie de type IIB sur :
-
•
Les D(-1)-,D1- et D3-branes entièrement enroulées sur un cycle de donnent lieu à des D-instantons dans la théorie à six dimensions, et a fortiori à quatre dimensions. Leur action euclidienne est proportionnelle à l’aire du cycle et reproduit l’équation (4.67) pour . La phase est également en accord avec cette interprétation.
-
•
Les mêmes D-branes peuvent également être enroulées partiellement sur le cycle , et donner lieu à des D-cordes à six dimensions, de tension
(4.68) celles-ci peuvent encore être enroulées sur le tore , pour former des D-instantons de la théorie à quatre dimensions. L’action euclidienne associée à ces effets est alors le produit de l’action de Born-Infeld par la tension, reproduisant l’équation (4.67) dans le cas .
Les configurations solitoniques pour quelconques correspondent à des superpositions de D-instantons et de D-cordes, soit, en analogie avec le cas de la compactification toroïdale, à des D-cordes de flux électrique non nul.
Si l’interprétation du poids semi-classique en termes de configurations de D-branes ne pose pas de difficulté, les coefficients apparaissant devant ce poids dans l’équation (4.63) sont moins clairs mais devraient en principe résulter de l’expression des opérateurs de vertex du dilaton dans le champ de fond de ces instantons, ainsi que de l’intégration sur les modes zéro. Le coefficient entier peut en revanche être interprété comme le nombre de cycles supersymétriques de dans la classe d’homologie 313131 est alors égale à l’auto-intersection du cycle, c’est-à-dire dans le cas des surfaces de Riemann sa caractéristique d’Euler.. Nous avons déja mentionné cette conjecture dans le cadre du comptage des états BPS de la théorie de type IIA, et nous la retrouvons ici de manière naturelle et indépendante.
4.6.3 Décompactification et couplages en
Le couplage exact à quatre dimensions étant ainsi obtenu, il est tentant d’en étudier les conséquences en dimensions supérieures par simple décompactification. Du point de vue de type IIA, la décompactification à dilaton fixé élimine toutes les contributions de D-branes, puisque celles ci s’enroulent autour d’un des cercles du tore. La contribution à une boucle, indépendante du volume du tore, disparaît également, et le couplage est donc nul en type IIA à six dimensions. La situation est plus intéressante du côté de type IIB, où les D-instantons subsistent en dimension 6, ainsi que la contribution à une boucle :
| (4.69) |
Dans la limite décadimensionnelle où le volume de tend lui même vers l’infini, seuls les D(-1)-instantons subsistent dans la somme, qui se réduit alors à
| (4.70) |
De manière inattendue, la limite à dix dimensions des couplages de la théorie de type IIB compactifiée sur reproduit ainsi le couplage en exact de Green et Gutperle323232au terme à l’ordre des arbres près. On montre dans l’appendice de l’article en annexe F que ce terme est en réalité présent, mais qu’il n’affecte pas les amplitudes physiques à quatre modules. de la théorie de type IIB à dix dimensions ! Cette coïncidence peut cependant s’expliquer de la manière suivante : les couplages en de la théorie de type IIB sont reliés par supersymétrie à des couplages à huit dérivées , dont la réduction sur , de nombre de Pontryagin , génère l’interaction . Inversement, on démontre ainsi la validité de la conjecture de Green et Gutperle, et en particulier l’absence de contributions des formes cuspoïdales de aux couplages en .
Chapter 5 M comme Matrice ?
L’écheveau des dualités des théories de cordes que nous avons décrit au chapitre 3 de ce mémoire nous a conduit à l’idée que les cinq théories des supercordes à dix dimensions n’étaient que cinq regards perturbatifs sur une théorie fondamentale encore mystérieuse, dite M-théorie. Si le spectre perturbatif de ces théories des cordes correspond à celui d’une théorie à nombre infini de champs en dix dimensions le spectre BPS non perturbatif signale l’existence d’une onzième dimension compacte : les D0-branes représentent les modes de Kaluza-Klein du supergraviton, et les cordes perturbatives apparaissent alors comme les membranes enroulées selon cette direction. Il est donc naturel de rechercher une formulation de la théorie fondamentale dans l’espace-temps non compact à onze dimensions, reproduisant la dynamique perturbative des théories de supercordes aprés compactification. La théorie des matrices, proposée par Banks, Fischler, Shenker et Susskind en 1996 et revisitée par Susskind en 1997, constitue une tentative de définition ab initio de cette théorie [BFSS97, Sus97]. Nous donnerons une brève introduction à la théorie des matrices 111Le lecteur pourra également se reporter aux articles de revue [Ban97, BS97c, Bil97] pour plus de détails. et discuterons plus particulièrement ses compactifications toroïdales, dans le but de comprendre les U-dualités des théories des cordes maximalement supersymétriques. Ce chapitre visera en même temps à introduire au travail effectué en collaboration avec Niels Obers et Eliezer Rabinovici, annexé en appendice G.
5.1 Quantification sur le front de lumière
5.1.1 Cinématique sur le front de lumière
Si l’invariance de Poincaré est un prérequis de toute théorie physique, sa manifestation explicite dans les théories de jauge oblige cependant à l’introduction de degrés de liberté <<fantômatiques>> qui obscurcissent la physique. La définition de l’espace de Hilbert d’une théorie des champs nécessite du reste une foliation (slicing) de l’espace-temps qui brise l’invariance de Poincaré (figure 5.1). La foliation par surfaces de temps égal est généralement choisie, et est invariante sous les translations et rotations spatiales, correspondant aux générateurs cinématiques du groupe de Poincaré. Les générateurs de translation selon le temps et de boost font quant à eux explicitement intervenir les complications de la dynamique.
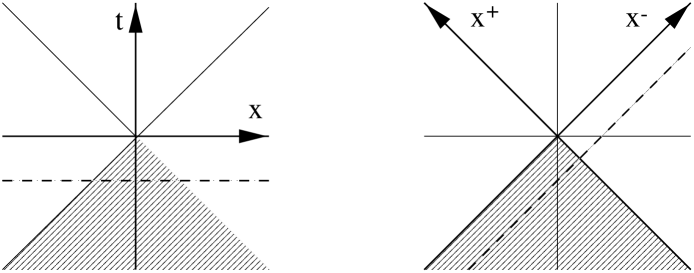
La foliation par surfaces de <<temps de lumière>> , correspondant à la quantification sur le front de lumière222Le terme ¡¡cône de lumière¿¿ est inapproprié, car seule la moitié du cône supporte la fonction d’onde. On utilise également la dénomination de ¡¡référentiel de moment infini¿¿, qui n’est guère plus adaptée., est avantageuse de ce point de vue, puisque les translations et rotations transverses et ainsi que le moment longitudinal et les boosts et sont des générateurs cinématiques333La quantification à constant présente ainsi un générateur cinématique supplémentaire sur la quantification à constant, quelque soit la dimension de l’espace.. engendre les translations selon et joue le rôle du Hamiltonien. Par contraste avec la relation de dispersion non polynomiale de la quantification à temps égal (figure 5.2)
| (5.1) |
la relation de dispersion prend sur le front de lumière la forme
| (5.2) |
La similitude de cette relation avec la relation de dispersion non relativiste résulte de l’invariance sous le groupe de Galilée de l’espace transverse.
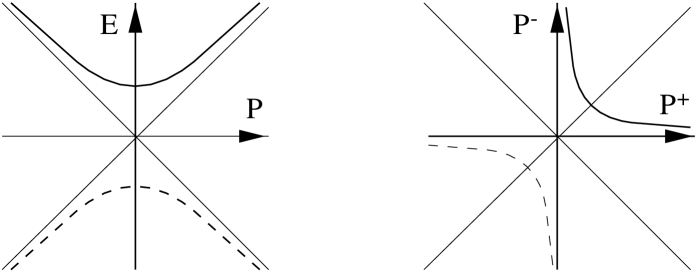
L’équation (5.2) implique en particulier que les particules, correspondant à , ont un moment longitudinal positif, tandis que les antiparticules ont un moment négatif (figure 5.2). L’état du vide de se réduit donc à l’état fondamental de l’espace de Fock 444à la contribution des modes de moment nul près. Ces derniers sont exclus par la relation de dispersion (5.2), sauf lorsque la masse s’annule.. Les états fantômatiques de norme négative sont également exclus dans cette formulation. En contrepartie de ces simplifications, le hamiltonien sur le front de lumière présente des interactions non locales instantanées correspondant à la présence du pôle en dans la relation (5.2), et donnant naissance aux diagrammes de <<mouettes>> caractéristiques de la quantification sur le front de lumière. Le traitement des modes de moment constitue le point le plus délicat de ce schéma de quantification, sous lequel se réfugient les complications de la structure du vide dans l’approche ordinaire (voir par exemple [Pin93]).
5.1.2 Front de lumière discret et résolution spectrale
La théorie des champs peut être régularisée à la fois dans l’infrarouge et dans l’ultraviolet en supposant la direction compacte de <<longueur>> [MY76, PB85]. Le moment longitudinal de la particule est alors quantifié selon
| (5.3) |
ce qui vaut à cette procédure le nom de quantification sur le front de lumière discret (discrete light cone quantization, ou DLCQ). Le moment total étant conservé, l’espace de Hilbert se décompose alors en secteurs de supersélection de moment , de dimension finie555dans le cas d’une théorie en dimension . En dimension supérieure, le continuum des impulsions transverses subsiste, et peut être levé par une compactification appropriée. engendré par les états de l’espace de Fock tels que ; la diagonalisation du hamiltonien peut alors être effectuée numériquement dans chaque secteur. Contrairement au cas de la quantification à temps égal ordinaire, cette finitude ne requiert pas de cut-off ultraviolet sur les impulsions longitudinales : la dimension finie est assurée par la condition . Il faut cependant prendre garde au fait que la direction est de genre lumière, et que n’est pas une longueur invariante. Elle peut être modifiée à volonté par un boost de Lorentz :
| (5.4) |
La dépendance en du moment et du hamiltonien est donc particulièrement simple :
| (5.5) |
et la masse est en particulier indépendante de . La compacité de la direction n’est cependant qu’un artifice de calcul, et les résultats physiques sont obtenus dans la limite double , à moment longitudinal fixé. Le spectre de masse, correspondant aux valeurs propres de la matrice , dépend de et se précise au fur et à mesure que augmente. L’entier correspond donc en réalité à la résolution spectrale bien plus qu’au moment longitudinal. On peut évaluer la valeur de minimale pour représenter un état au repos de masse et de taille caractéristique en demandant que cette dernière soit très inférieure au rayon du cercle de genre lumière [BS97b]. En tenant compte de l’égalité au repos , on obtient ainsi la condition
| (5.6) |
5.1.3 La théorie des cordes sur le front de lumière discret
La quantification sur le front de lumière a joué un rôle historique très important dans la compréhension des modèles duaux et des théories de cordes [GGRT73]. Elle permet en effet de fixer complètement les reparamétrisations de la surface d’univers, et ne laisse que les degrés de liberté physiques des fluctuations transverses de la corde. Nous avons pu apprécier l’efficacité de cette procédure au chapitre 3 pour la détermination des fonctions de partition des théories des cordes. Elle peut être aisément adaptée au cas de la compactification sur un cercle de genre lumière , comme nous le rappelons maintenant.
La jauge du front de lumière consiste à identifier le temps de la surface d’univers avec le temps propre de l’espace cible :
| (5.7) |
La condition de Virasoro associée à l’invariance sur les reparamétrisations
| (5.8) |
permet d’éliminer la coordonnée au profit des coordonnées transverses. Les coefficients de Fourier de s’expriment alors en fonction des oscillateurs transverses :
| (5.9) | |||||
| (5.10) |
La compactification peut être construite comme une construction d’orbifold habituelle : elle projette donc sur les états invariants de moment , et introduit des états twistés s’enroulant fois autour de la direction compacte :
| (5.11) |
En insérant les modes zéros gauches et droits de
| (5.12) |
la somme et la différence des équations (5.9) conduisent à la formule de masse et la condition de level matching :
| (5.13) | |||||
| (5.14) |
Ces relations peuvent être étendues au cas des supercordes en utilisant les valeurs appropriées des intercepts et , et incluant les contributions fermioniques dans les nombres d’excitations et . La limite de grand est triviale dans le cas de la théorie des cordes libres, mais devient intéressante en présence d’interactions ; celles-ci nécessitent cependant l’introduction d’une théorie de champs de cordes, qui n’a pas encore été pleinement développée. La quantification du moment peut être commodément incorporée en redéfinissant la périodicité de la coordonnée à . Chaque corde consiste alors en un nombre entier de <<partons>> élémentaires de longueur , et la conservation du moment au cours des interactions entre cordes correspond à la conservation du nombre de partons.
5.2 M-théorie sur le front de lumière
Selon la conjecture BFSS, dans sa formulation renforcée par Susskind, la M-théorie est décrite sur le front de lumière discret dans le secteur de moment longitudinal par la mécanique quantique de D0-branes. Cette conjecture peut être heuristiquement justifiée en identifiant le cercle de genre lumière de <<rayon de lumière>> définissant le front de lumière discret à un cercle spatial ordinaire de rayon infiniment boosté :
| (5.15) |
A rayon de lumière fixé, le rayon tend donc vers 0 dans la limite de boost infini . Le secteur du front de lumière discret correspond donc au secteur , soit de la M-théorie compactifiée sur un cercle spatial de rayon . Cette théorie correspond précisément à la théorie des cordes de type IIA en présence de D0-branes. Pour définir sans ambiguïté la limite à considérer, il est nécessaire de déterminer le régime d’énergie pertinent pour la description de la M-théorie sur le front de lumière discret. Le hamiltonien sur le front de lumière discret étant proportionnel au <<rayon de lumière>> , il s’écrit donc, pour raison de dimension,
| (5.16) |
où le spectre de est d’ordre unité. Après le boost, on obtient ainsi une énergie
| (5.17) |
et il est donc commode d’effectuer un changement d’échelle de manière à maintenir cette énergie finie. Les degrés de liberté pertinents seront sélectionnés dans la limite de scaling
| (5.18) |
Exprimés en termes de et , les paramètres de la théorie de type IIA s’écrivent alors
| (5.19) |
La théorie des cordes de type IIA est donc faiblement couplée et à basse énergie dans la limite. Les corrections de boucles et de dérivées supérieures à la dynamique des D0-branes sont donc supprimées, et celle-ci est exactement décrite par l’approximation de Yang-Mills à l’action de Born-Infeld supersymétrique :
| (5.20) |
où les neuf coordonnées , maintenant interprétées comme les coordonnées transverses de la M-théorie sur le front de lumière discret, prennent leurs valeurs dans l’adjoint de . Après redéfinition du champ , on obtient en unités de
| (5.21) |
avec . Le hamiltonien associé à cette théorie des champs en dimensions 0+1 s’écrit alors en termes du moment conjugué à :
| (5.22) |
auquel on a ajouté l’énergie au repos des D0-branes à grande séparation. L’invariance de jauge permet de fixer , mais il faut encore restreindre l’espace de Hilbert aux états invariants de jauge en imposant la contrainte de Gauss
| (5.23) |
Cet argument nous conduit donc à la conjecture BFSS : la M-théorie est décrite sur le front de lumière discret dans le secteur de moment longitudinal par la mécanique quantique supersymétrique de 9 matrices hermitiennes , de hamiltonien
| (5.24) |
où on a découplé le facteur abélien de moment et le facteur de moment ; le premier décrit le mouvement transverse du centre de masse du système, tandis que le second décrit les interactions des D0-branes, identifiées aux partons de la M-théorie sur le front de lumière discret. La M-théorie sur le front de lumière non compact est obtenue dans la limite de résolution spectrale infinie :
| (5.25) |
Cette conjecture appelle plusieurs commentaires :
-
•
le hamiltonien (5.24) remplit tout d’abord les conditions de symétrie sous le groupe de Galilée supersymétrique de l’espace transverse
(5.26) engendré par les 16+16 charges supersymétriques
(5.27) (5.28) Les 16 charges sont réalisées non linéairement et n’agissent que sur le facteur abélien du groupe de jauge . Elles correspondent aux charges spontanément brisées par la présence des D0-branes dans le langage de la théorie de type IIA. Seules les charges , correspondant aux 16 charges de la théorie de Yang-Mills à dix dimensions, contraignent la dynamique relative des D0-branes.
-
•
la dépendance du hamiltonien en le rayon de lumière est compatible avec l’invariance de Lorentz selon . L’invariance sous les générateurs dynamiques est en revanche loin d’être évidente, et constitue l’essence de la conjecture. Elle est du reste brisée par la compacité de la direction , et n’a lieu d’être que dans la limite . La construction d’opérateurs dans le secteur de supersélection générant le groupe de Poincaré à grand reste un problème ouvert de première importance.
-
•
pour prétendre à décrire la M-théorie, la moindre des exigences est que la théorie des matrices inclue le supergraviton de masse nulle et de moment longitudinal . Un tel état doit correspondre à un état fondamental supersymétrique du hamiltonien décrivant le mouvement relatif des partons. La démonstration de l’existence et l’unicité d’un tel état constitue un second problème non résolu à ce jour. Les états à plusieurs gravitons de moments peuvent être décrits asymptotiquement en décomposant la matrice en blocs diagonaux ; un calcul de diffusion dans l’approximation de Born-Oppenheimer peut alors être effectué et comparé à la prédiction de la théorie de supergravité. K. et M. Becker ont ainsi observé l’accord au second ordre dans le développement en boucles de la mécanique quantique des D0-branes [BB97].
-
•
les membranes et cinq-branes de la M-théorie ne jouent aucun rôle dans cette formulation. Elles doivent donc apparaître comme états liés de D0-branes. De fait, le hamiltonien (5.24) est identique au hamiltonien de la supermembrane après remplacement du crochet de Lie de l’algèbre par le crochet de Poisson sur l’algèbre des fonctions sur la surface de la membrane [BSS97]. Dans le cas d’une membrane toroïdale, la correspondance peut être précisée en associant à chaque fonction la matrice de ses coefficients sur la base de Fourier . Le statut des 5-branes est moins clair à ce jour [BD97].
-
•
ayant ramené l’étude de la gravité quantique à onze dimensions à un problème de mécanique quantique, on pourrait pousser le raisonnement plus loin et considérer le modèle de matrice correspondant à la mécanique statistique de D-instantons de la théorie de type IIB, décrite par la réduction dimensionnelle totale de la théorie de Yang-Mills à 10 dimensions :
(5.29) où l’indice va maintenant de 0 à 9. Cette approche a été initiée par Ishibashi, Kawai, Kitazawa et Tsuchiya [IKKT97], et n’a pas reçu la même attention que la proposition concurrente. La construction des membranes mentionnée au paragraphe précédent peut cependant être transposée dans ce formalisme pour obtenir la corde de type IIB [FKKT98]. Comme nous le verrons dans la section suivante, la théorie des matrices peut être considérée comme une compactification de cette théorie des D-instantons.
5.3 Compactification de la théorie des matrices
La théorie des matrices prétend décrire la M-théorie non compactifiée sur le front de lumière. Dans une théorie contenant des objets étendus, la compactification est une opération non triviale qui peut changer drastiquement les degrés de liberté pertinents. La prescription pour la compactification de la théorie des matrices est à l’heure actuelle incomplète : elle fournit une formulation acceptable pour les compactifications sur un tore de dimension , mais indéfinie en dimension inférieure ou sur des variétés courbes. Elle montre toutefois une extension dramatique des degrés de liberté à prendre en compte, puisque la mécanique quantique doit céder la place à une authentique théorie des champs en dimension .
5.3.1 Compactification toroïdale et théories de jauge
La compactification toroïdale d’une théorie des champs procède en général en imposant l’invariance sous la symétrie discrète . Dans le cas de la théorie des matrices, cette identification doit être prise à une transformation de jauge près, et on est donc conduit à restreindre notre attention aux matrices telles que
| (5.30) |
où la matrice est unitaire et la translation agit sur la coordonnée du centre de masse uniquement. Cette condition n’admet de solution qu’à infini, soit en présence d’un nombre infini de D0-branes. En choisissant pour la permutation , elle traduit le fait que le groupe de D0-branes, décrit par les matrices hermitiennes , est dupliqué autour de chaque point . Les matrices infinies prennent donc la forme
| (5.31) |
Les blocs élémentaires peuvent être commodément regroupés en un seul en introduisant une nouvelle coordonnée compacte de période , et en définissant
| (5.32) |
Les commutateurs des matrices infinies s’expriment alors simplement en termes des fonctions à valeurs dans par
| (5.33) | |||||
| (5.34) |
et la trace dans est simplement remplacée par . Le modèle de matrices à 0+1 dimensions, dans le secteur des matrices infinies satisfaisant aux conditions (5.30), est donc remplacé par une théorie de jauge supersymétrique à 1+1 dimensions 666Par la même construction, le modèle de matrices de BFSS apparaît donc comme la compactification du modèle des instantons de Ishibashi et al.
| (5.35) |
où la coordonnée compacte est interprétée comme la connexion de jauge . Les transformations de jauge de la théorie initiale, commutant avec la matrice unitaire , engendrent ainsi les transformations de jauge de la théorie compactifiée :
| (5.36) | |||||
| (5.37) |
Cette théorie de jauge à 1+1 dimensions peut être interprétée comme la définition non perturbative de la théorie de type IIA sur le front de lumière discret [BS97a, DVV97b, Mot97]. A grande distance, les 8 coordonnées matricielles deviennent en effet simultanément diagonalisables, et décrivent les positions transverses de cordes élémentaires. La diagonalisation n’est cependant pas globalement définie autour de la direction , mais seulement à une permutation des N valeurs propres près. Les cordes élémentaires s’arrangent alors selon les cycles intervenant dans la permutation en cordes de longueur , et de moment longitudinal . On retrouve ainsi la formulation de la théorie des cordes perturbatives sur le front de lumière discret, dans un formalisme de seconde quantification. Les interactions sont induites par l’extension de la symétrie de jauge lorsque deux valeurs propres coïncident. La corde hétérotique non perturbative est quant à elle obtenue par projection , et décrite par une théorie de jauge à 1+1 dimensions et 8 charges supersymétriques [BM97]
Cette construction peut aisément être répétée pour des compactifications sur un tore , et conduit, dans le cas où les matrices unitaires de compactification commutent, à une théorie de jauge à 16 charges supersymétriques en dimensions, définie sur l’espace réciproque du tore de compactification. Cette théorie n’est autre que la réduction dimensionnelle de la théorie de Yang-Mills supersymétrique à dix dimensions. La simplicité de la théorie des matrices disparaît donc rapidement par compactification, et sa signification devient même problématique pour , puisque la théorie de jauge perd sa liberté asymptotique et devient indéfinie à courte distance. Si en revanche les matrices ne commutent pas, la théorie de jauge ordinaire doit être remplacée par une théorie de jauge sur le tore non commutatif [CDS97, Con94]. Le statut de ces théories et leurs propriétés sont encore largement méconnues.
5.3.2 Compactification et limite de scaling
Le schéma de compactification discuté ci-dessus peut être compris plus généralement en revenant à la limite de scaling qui nous a conduit au modèle de BFSS [Sei97, Sen97]. En identifiant le cercle de genre lumière à un cercle spatial infiniment boosté, on peut obtenir la quantification sur le front de lumière discret de la M-théorie compactifiée sur le tore comme la théorie de type IIA compactifiée sur en présence de D0-branes. dans la limite de scaling
| (5.38) |
où les rayons du tore sont gardés constants en unités de Planck . Le tore devient donc de taille nulle, et il est alors commode d’effectuer une T-dualité sur toutes les directions de : on obtient ainsi la théorie des cordes de type IIA ( pair) ou IIB ( impair) en présence de D-branes, de paramètres
| (5.39) |
Le tore est maintenant de taille fixée, et l’échelle des cordes tend vers , de sorte que les modes massifs se découplent toujours. Pour , la théorie de type II reste faiblement couplée, et la M-théorie peut donc être décrite par la théorie de Yang-Mills à 16 charges supersymétriques sur le volume d’univers de la D-brane. Le couplage et les paramètres géométriques de cette théorie de jauge sont donnés par
| (5.40) |
et sont donc gardés fixes dans la limite de scaling. La M-théorie sur le front de lumière non compact est alors obtenue dans la limite de résolution spectrale infinie , soit
| (5.41) |
Le couplage de Yang-Mills étant de dimension , il est plus intéressant de le ramener à la taille du tore :
| (5.42) |
et le couplage sans dimension est donc gardé fixe dans les limites de scaling et de résolution spectrale infinie.
Cette description reste correcte dans le cas bien que le couplage de la théorie des cordes soit maintenant fini, car les corrections de boucles sont toujours supprimées par la limite . On note en particulier que la limite est différente de la limite de grand de ’t Hooft couramment considérée dans les théories de jauge à 4 dimensions [tH74b]. Pour cependant, la théorie de type IIA devient fortement couplée et génère une nouvelle <<onzième dimension>> 777à ne pas confondre avec la dimension définissant le front de lumière discret., de rayon et d’échelle de Planck
| (5.43) |
Les D4-branes de la théorie de type IIA correspondent maintenant à 5-branes enroulées sur la direction de rayon . La masse de Planck divergeant dans la limite de scaling, la gravitation se découple des degrés de liberté sur le volume d’univers de la 5-brane, et la M-théorie compactifiée sur peut donc être décrite sur le front de lumière discret par la théorie de volume d’univers de 5-branes [BRS97]. Cette théorie est malheureusement trop mal connue à l’heure actuelle pour fournir une définition utilisable de la M-théorie compactifiée sur .
Dans le cas , le fort couplage de la théorie de type IIB invite à effectuer une transformation de S-dualité ; les D5-branes deviennent alors NS5-branes de la théorie de type IIB de paramètres
| (5.44) |
Dans la limite de scaling, les modes se propageant dans l’espace-temps ambiant peuvent encore être découplés des modes localisés sur les NS5-branes, laissant une théorie des cordes de tension finie se propageant sur la NS5-brane. L’existence de cette théorie des cordes non critiques est hautement conjecturale, et ne permet pas de donner une définition effective de la M-théorie compactifiée sur . La situation est encore plus sérieuse dans le cas de la compactification sur , où le rayon de la onzième dimension générée à fort couplage diverge et où l’échelle de Planck reste finie dans la limite de scaling.
A défaut de fournir une définition non perturbative de la M-théorie, ces descriptions justifient au moins heuristiquement les groupes de U-dualité observés dans les compactifications de la M-théorie sur et : le groupe peut être interprété comme le groupe modulaire du volume d’univers de la 5-brane dans le cas , tandis que le groupe apparaît comme le groupe de T-dualité de la théorie des cordes hypothétique se propageant dans le volume d’univers des NS5-branes de la théorie de type IIB pour . Dans le paragraphe suivant, nous obtiendrons une meilleure compréhension de ces symétries de U-dualité en les traduisant dans le langage des théories de jauge.
5.3.3 Dualité électrique-magnétique et U-dualité
La prescription de BFSS pour la définition de la M-théorie demeure donc pour l’heure sérieusement incomplète, et pour les compactifications sur des variétés de dimension , se heurte à la difficulté d’étendre dans l’ultraviolet les théories de jauge en dimension . Certaines propriétés de cette extension peuvent cependant être fixées en traduisant les contraintes de la U-dualité de la M-théorie compactifiée toroïdalement en termes de cette théorie de jauge. Cette approche a été suivie par Elitzur, Giveon, Kutasov et Rabinovici et prolongée en collaboration avec Obers et Rabinovici, dans le travail présenté en appendice G [EGKR98, OPR97].
Le groupe de U-dualité de la M-théorie compactifiée sur est engendré par deux sous-groupes discrets : le groupe modulaire du tore de compactification, et le groupe de T-dualité . L’action du premier est manifeste dans la théorie de jauge décrivant la M-théorie sur le front de lumière discret, et s’identifie au groupe modulaire du tore réciproque sur lequel se propage la théorie de jauge. Si on se restreint pour simplicité aux tores rectangulaires en l’absence de champ de fond pour le tenseur de jauge 888L’extension de ce formalisme aux compactifications toroïdales générales fait l’objet de l’article en appendice G., ce groupe modulaire se restreint au groupe de permutations
| (5.45) |
des rayons, qui n’est autre que le groupe de Weyl de .
L’action du second peut être déterminée en choisissant une dimension parmi les dimensions du tore (notée 11 dans les chapitres précédents), et en identifiant la M-théorie compactifiée sur à la théorie de type IIA compactifiée sur , de couplage et d’échelle des cordes
| (5.46) |
L’inversion simultanée de deux rayons s’écrit alors, en termes des variables de la M-théorie 999 peut être rendue invariante par un changement d’échelle, mais les transformations des rayons seraient alors moins élégantes.
| (5.47) |
La transformation de T-dualité est donc invariante sous les permutations des trois rayons , qui apparaissent ainsi sur un pied d’égalité du point de vue de la M-théorie. Elle laisse en particulier invariante l’échelle de Planck à dimensions . En termes des paramètres de la théorie de jauge, la transformation s’écrit
| (5.48) |
Dans le cas de la compactification sur , cette transformation se réduit à la symétrie de dualité électrique- magnétique de la théorie de jauge à 3+1 dimensions [Sus96, FHRS97]. Pour , la transformation (5.48) peut encore s’interpréter comme S-dualité en interprétant le tore comme fibration de tores : la théorie de jauge sur peut alors être réduite en une théorie de Yang-Mills sur le 3-tore généré par les directions , de couplage
| (5.49) |
La transformation (5.48) correspond alors simplement à la S-dualité dans la théorie de Yang-Mills sur . Comme l’ont montré Elitzur et al, le groupe généré par les transformations et n’est autre que le groupe de Weyl du groupe de U-dualité . Les générateurs manquants de , que nous appellerons générateurs de Borel, correspondent aux transformations modulaires du tore , ainsi qu’aux transformations de T-dualité ; ces dernières étendent en particulier la transformation au groupe de S-dualité de la théorie de Yang-Mills sur la fibre . Pour observer l’invariance sous le groupe de U-dualité total, il est donc nécessaire d’autoriser les compactifications sur des tores de métrique non rectangulaire en présence de champ de fond pour le tenseur .
5.3.4 Etats BPS et multiplets de U-dualité
Ayant décrit comment le groupe de U-dualité émergeait du point de vue de la théorie de jauge décrivant la M-théorie compactifiée sur le front de lumière discret, il nous reste encore à comprendre comment le spectre BPS s’organise en représentations de ce groupe. Etant donné les incertitudes de la définition de la M-théorie, on ne peut en l’état actuel dériver ce spectre ; l’existence de certains états est cependant requise, et donc également celle de leurs images sous la U-dualité.
Ainsi, la M-théorie devant inclure le supergraviton de masse nulle dans son spectre, elle doit après compactification contenir les états de Kaluza-Klein de masse et de moment . Ceux-ci correspondent à des états d’énergie
| (5.50) |
et s’identifient donc dans la théorie de jauge à l’état portant un flux électrique dans la direction . Par dualité , cet état donne naissance à un multiplet de flux, d’énergies et de masses101010Les indices sont distincts, exceptés lorsqu’ils sont séparés par un point-virgule.
| (5.51) | ||||
| (5.52) | ||||
| (5.53) |
où l’on s’est restreint aux états apparaissant pour . désigne le volume du tore dual. L’état (5.51) n’est autre que le flux magnétique selon les directions et , et décrit la membrane de la M-théorie enroulée sur un deux-cycle du tore . L’état (5.52) apparaît pour , et, comme le montre sa masse, correspond à la 5-brane de la M-théorie enroulée sur un 5-cycle du tore ; son énergie en ne permet cependant de l’identifier à aucun état connu de la théorie de Yang-Mills ordinaire. Le troisième état, apparaissant pour , correspond quant à lui au monopôle magnétique de Kaluza-Klein : lorsque , il présente une masse en caractéristique d’un monopôle chargé magnétiquement sous le champ de Kaluza-Klein . Si on choisit la onzième direction orthogonalement aux indices à , on obtient un état de masse mystérieux du point de la théorie des cordes. Comme l’ont remarqué Blau et O’Loughlin [BO97], ceci revient à considérer un réseau de monopôles Taub-NUT dans la direction , dont la métrique est donnée précisément par l’espace de Ooguri et Vafa (équation 4.12 page 4.12) apparu dans l’étude de la singularité de conifold dans l’espace des hypermultiplets. La divergence logarithmique pour implique que cet espace n’est pas asymptotiquement plat, et ne décrit donc pas un soliton au sens propre. De manière générale, une dépendance en de la <<masse>> implique un champ gravitationnel en , et le traitement à faible couplage n’est justifié que pour [EGKR98]. L’existence de ces états ne présente cependant pas d’obstruction de principe au niveau de la M-théorie111111Un état singulier du point de vue de la théorie des cordes apparaît donc régulier dans la M-théorie, de manière trés analogue au cas du monopôle de Kaluza-Klein construit par Sorkin dans le cas de la réduction de 5 à 4 dimensions, qui apparaît singulier en dimension 4 mais régulier lorsqu’interprété dans les variables appropriées à la dimension 5[Sor83]., et semble requise par la U-dualité ; on note en particulier qu’elle ne préserve pas la structure asymptotique de l’espace-temps [SS97c]. Notons finalement que pour , de nouveaux états apparaissent, de masse en qui n’admettent pas même l’interprétation heuristique que nous avons donnée ici.
Comme nous l’avons vu dans la section (5.1.3), la quantification sur le front de lumière discret de la théorie des cordes introduit des états enroulés sur le cercle compact de genre lumière. Dans la M-théorie, ils correspondent donc à des membranes enroulées selon le cercle de genre lumière et un cercle du tore de compactification, de masse . Ces états correspondent donc dans la théorie de jauge à des excitations d’énergie
| (5.54) |
qui peuvent donc être identifiés aux excitations de Kaluza-Klein de la théorie de jauge sur le tore . Sous la U-dualité , ces états donnent naissance au multiplet dit de moment :
| (5.55) | ||||
| (5.56) |
où l’on s’est cette fois restreint aux états apparaissant en dimension . L’état (5.55) s’interprète comme la 5-brane de la M-théorie enroulée sur le cercle de genre lumière et sur un 4-cycle du tore ; en termes de la théorie de jauge, il peut être identifié à un instanton de la théorie de Yang-Mills en dimension 3+1, <<relevé>> en dimension d+1. L’état (5.56) correspond quant à lui aux monopôles de Kaluza-Klein.
Nous avons décrit jusqu’à présent l’orbite des états de flux et de moment sous le groupe de Weyl , et donné leur masse pour des compactifications de la M-théorie sur un tore rectangulaire en l’absence de champ de fond . Comme nous l’avons montré dans le travail en appendice G, les générateurs de Borel et génèrent cependant un flot spectral imposant de prendre en compte les superpositions arbitraires des états élémentaires précédents. Les états du multiplet de flux peuvent ainsi être décrit par un ensemble de charges entières , totalement antisymétriques correspondant aux états (5.50,5.51, 5.52,5.53) respectivement. La formule de masse d’une telle combinaison d’états, invariante sous le groupe de U-dualité total , a été obtenue dans la référence [OPR97] (annexe G) par analyse des transformations de ces charges sous la T-dualité. Les états (5.54,5.55,5.56) peuvent pareillement être décrits en termes de charges entières .
5.3.5 Invariance de Lorentz et dualité de Nahm
Les multiplets de flux et de moment épuisent donc l’ensemble des états 1/2-BPS attendus de la M-théorie compactifiée sur , tout en fournissant une variété d’états plus exotiques que l’extension microscopique de la théorie de jauge sur se doit de reproduire. Ensemble, ces états forment deux représentations du groupe de U-dualité, résumées dans la table suivante, dont les deux dernières lignes deviendront claires incessamment :
On a ainsi vérifié l’invariance du spectre (convenablement étendu) sous le groupe de U-dualité. L’invariance de Lorentz à onze dimensions de la théorie des matrices impose cependant l’existence d’une symétrie supplémentaire dans le spectre : la quantification sur le front de lumière discret de la M-théorie compactifiée sur peut en effet être considérée comme une compactification à part entière de la M-théorie sur , et il doit donc exister une action du groupe de U-dualité étendu sur le spectre[HV97]. Le générateur de Weyl manquant correspond naturellement à l’échange d’une direction spatiale avec le cercle de genre lumière ; il échange donc les états du multiplet de flux (5.51,5.52) avec ceux du multiplet de moment (5.54,5.55). Comme on le montre dans l’appendice G et le représente dans les deux dernières lignes de la table ci-dessus, les multiplets de flux et de moment décrivant les états 1/2-BPS de la M-théorie compactifiée sur peuvent être assemblés en un multiplet de flux du groupe étendu , moyennant l’introduction d’une charge supplémentaire 121212trois charges dans le cas , et une infinité dans le cas . qui n’est autre que le moment selon la direction compacte du front de lumière 131313des conclusions identiques ont été atteintes par [BO97, Hul97].. représentant également le rang de la théorie de jauge décrivant la théorie des matrices compactifiée, cette extension suppose donc l’existence de symétrie mélangeant le rang et les charges électriques et magnétiques. Cette symétrie rappelle fortement la symétrie classique de Nahm [Nah82] échangeant le rang et le flux électrique dans les théories de jauge à deux dimensions sur . La mise en évidence des générateurs de Borel supplémentaires requiert l’étude de la compactification sur le front de lumière discret en présence de lignes de Wilson pour le champ de jauge de Kaluza-Klein et de champs de fond pour le tenseur de jauge , qui semble nécessiter une description dans le cadre de la géométrie non commutative [CDS97, DH97].
Appendix A Higgs branch, HyperKähler quotient and duality in SUSY N=2 Yang-Mills theories
Int. J. Mod. Phys. A12 (1997) 4907
Appendix B Corrections and Non-perturbative Dualities of N=4 String ground states
Nucl. Phys. B 510 (1998) 423
Appendix C On threshold corrections in IIB string theory and (p,q) string instantons
Nucl. Phys. B 508 (1997) 509
Appendix D U-duality and D-brane Combinatorics
Phys. Lett. B 418 (1998) 61
Appendix E A note on non-perturbative
couplings
accepté pour publication dans Phys. Lett.
Appendix F Calculable Effects
Nucl. Phys. B 512 (1998) 61
Appendix G M-Theory and U-duality on with Gauge Backgrounds
accepté pour publication dans Nucl. Phys. B.
Références bibliographiques
References
- [A+96] L. Andrianopoli et al., General matter coupled supergravity, Nucl. Phys. B476, 397–417 (1996), hep-th/9603004.
- [ABK87] I. Antoniadis, C. P. Bachas et C. Kounnas, Four-dimensional superstrings, Nucl. Phys. B289, 87 (1987).
- [ACNY87] A. Abouelsaood, C. G. Callan, C. R. Nappi et S. A. Yost, Open strings in background gauge fields, Nucl. Phys. B280, 599 (1987).
- [ADHM78] M. F. Atiyah, V. G. Drinfeld, N. J. Hitchin et Y. I. Manin, Construction of instantons, Phys.Lett. 65A, 185 (1978).
- [AGGMV86] L. Alvarez-Gaume, P. Ginsparg, G. Moore et C. Vafa, An heterotic string, Phys. Lett. B171, 155 (1986).
- [AGH97] L. Alvarez-Gaume et S. F. Hassan, Introduction to S duality in N=2 supersymmetric gauge theories: A pedagogical review of the work of Seiberg and Witten, Fortsch. Phys. 45, 159–236 (1997), hep-th/9701069.
- [AGMV86] L. Alvarez-Gaume, G. Moore et C. Vafa, Theta functions, modular invariance and strings, Commun. Math. Phys. 106, 1–40 (1986).
- [AGNT94] I. Antoniadis, E. Gava, K. S. Narain et T. R. Taylor, Topological amplitudes in string theory, Nucl. Phys. B413, 162–184 (1994), hep-th/9307158.
- [AGW84] L. Alvarez-Gaume et E. Witten, Gravitational anomalies, Nucl. Phys. B234, 269 (1984).
- [AH88] M. F. Atiyah et N. J. Hitchin, The geometry and dynamics of magnetic monopoles, Princeton University Press, 1988.
- [AP97] I. Antoniadis et B. Pioline, Higgs branch, hyperkahler quotient and duality in SUSY Yang-Mills theories, Int. J. Mod. Phys. A12, 4907 (1997), hep-th/9607058.
- [APT96] I. Antoniadis, H. Partouche et T. R. Taylor, Spontaneous breaking of global supersymmetry, Phys.Lett. B372, 83–87 (1996).
- [APT98] I. Antoniadis, B. Pioline et T. R. Taylor, Calculable effects, Nucl. Phys. B512, 61 (1998), hep-th/9707222.
- [Asp96] P. S. Aspinwall, K3 surfaces and string duality, (1996), hep-th/9611137.
- [B+96] R. M. Barnett et al., Review of particle physics. particle data group, Phys. Rev. D54, 1–720 (1996).
- [Bac96] C. Bachas, (half) a lecture on D-branes, (1996), hep-th/9701019.
- [Bac97] C. Bachas, Heterotic versus type-I, (1997), hep-th/9710102.
- [Ban97] T. Banks, Matrix theory, (1997), hep-th/9710231.
- [BB97] K. Becker et M. Becker, A two loop test of M(atrix) theory, Nucl. Phys. B506, 48 (1997), hep-th/9705091.
- [BBS95] K. Becker, M. Becker et A. Strominger, Five-branes, membranes and nonperturbative string theory, Nucl. Phys. B456, 130–152 (1995), hep-th/9507158.
- [BD97] M. Berkooz et M. R. Douglas, Five-branes in M(atrix) theory, Phys. Lett. B395, 196–202 (1997), hep-th/9610236.
- [Bea97] A. Beauville, Counting rational curves on K3 surfaces, (1997), alg-geom/9701019.
- [Ber97] N. Berkovits, Construction of terms in superspace, (1997), hep-th/9709116.
- [BFK+98] C. Bachas, C. Fabre, E. Kiritsis, N. A. Obers et P. Vanhove, Heterotic / type I duality and D-brane instantons, Nucl. Phys. B509, 33 (1998), hep-th/9707126.
- [BFSS97] T. Banks, W. Fischler, S. H. Shenker et L. Susskind, M theory as a matrix model: A conjecture, Phys. Rev. D55, 5112–5128 (1997), hep-th/9610043.
- [BI35] M. Born et L. Infeld, Foundations of the new field theory, Proc. Roy. Soc A144, 425 (1935).
- [Bil97] A. Bilal, M(atrix) theory : A pedagogical introduction, (1997), hep-th/9710136.
- [BK97] I. Bars et C. Kounnas, Theories with two times, Phys. Lett. B402, 25 (1997), hep-th/9703060.
- [BM97] T. Banks et L. Motl, Heterotic strings from matrices, (1997), hep-th/9703218.
- [BO97] M. Blau et M. O’Loughlin, Aspects of U duality in matrix theory, (1997), hep-th/9712047.
- [Bog76] E. B. Bogomolny, Stability of classical solutions, Sov. J. Nucl. Phys. 24, 449 (1976).
- [BPST75] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwarz et Y. S. Tyupkin, Pseudoparticle solutions of the yang-mills equations, Phys. Lett. 59B, 85 (1975).
- [BRS97] M. Berkooz, M. Rozali et N. Seiberg, Matrix description of M theory on and , Phys. Lett. B408, 105–110 (1997), hep-th/9704089.
- [BS97a] T. Banks et N. Seiberg, Strings from matrices, Nucl. Phys. B497, 41–55 (1997), hep-th/9702187.
- [BS97b] D. Bigatti et L. Susskind, A note on discrete light cone quantization, (1997), hep-th/9711063.
- [BS97c] D. Bigatti et L. Susskind, Review of matrix theory, (1997), hep-th/9712072.
- [BSS97] T. Banks, N. Seiberg et S. Shenker, Branes from matrices, Nucl. Phys. B490, 91–106 (1997), hep-th/9612157.
- [BV98] N. Berkovits et C. Vafa, Type IIB conjectures, (1998), hep-th/9803145.
- [BVH76] L. Brink, P. D. Vecchia et P. Howe, A locally supersymmetric and reparametrization invariant action for the spinning string, Phys. Lett. 65B, 471–474 (1976).
- [BVS96] M. Bershadsky, C. Vafa et V. Sadov, D-branes and topological field theories, Nucl. Phys. B463, 420–434 (1996), hep-th/9511222.
- [CDS97] A. Connes, M. R. Douglas et A. Schwarz, Noncommutative geometry and matrix theory: Compactification on tori, (1997), hep-th/9711162.
- [CFG89] S. Cecotti, S. Ferrara et L. Girardello, Geometry of type-II superstrings and the moduli of superconformal field theories, Int. J. Mod. Phys. A4, 2475 (1989).
- [CHS91a] C. G. Callan Jr., J. A. Harvey et A. Strominger, World sheet approach to heterotic instantons and solitons, Nucl. Phys. B359, 611 (1991).
- [CHS91b] C. G. Callan Jr., J. A. Harvey et A. Strominger, Worldbrane actions for string solitons, Nucl. Phys. B367, 60–82 (1991).
- [CHSW85] P. Candelas, G. T. Horowitz, A. Strominger et E. Witten, Vacuum configurations for superstrings, Nucl. Phys. B258, 46 (1985).
- [CJ79] E. Cremmer et B. Julia, The supergravity, Nucl. Phys. B159, 141 (1979).
- [CJS78] E. Cremmer, B. Julia et J. Scherk, Supergravity theory in eleven-dimensions, Phys. Lett. 76B, 409 (1978).
- [Col74] S. Coleman, Classical lumps and their quantum descendants, (1974), in Aspects of Symmetry, Cambridge University Press, 1985.
- [Col75] S. Coleman, The quantum sine-gordon equation as the massive thirring model, Phys. Rev. D11, 2088 (1975).
- [Col77] S. Coleman, The use of instantons, (1977), in Aspects of Symmetry, Cambridge University Press, 1985.
- [Con94] A. Connes, Non commutative geometry, Academic Press, 1994.
- [DFMS87] L. Dixon, D. Friedan, E. Martinec et S. Shenker, The conformal field theory of orbifolds, Nucl. Phys. B282, 13–73 (1987).
- [DH97] M. R. Douglas et C. Hull, D-branes and the noncommutative torus, (1997), hep-th/9711165.
- [DHVW85] L. Dixon, J. A. Harvey, C. Vafa et E. Witten, Strings on orbifolds, Nucl. Phys. B261, 678–686 (1985).
- [Dir31] P. A. M. Dirac, Quantized singularities in the electromagnetic field, Proc. Roy. Soc. A133, 60 (1931).
- [Dir62] P. A. M. Dirac, An extensible model of the electron, Proc. Roy. Soc. A268, 57 (1962).
- [DKL95] M. J. Duff, R. R. Khuri et J. X. Lu, String solitons, Phys. Rept. 259, 213–326 (1995), hep-th/9412184.
- [DLP89] J. Dai, R. G. Leigh et J. Polchinski, New connections between string theories, Mod. Phys. Lett. A4, 2073–2083 (1989).
- [Dou95] M. R. Douglas, Branes within branes, (1995), hep-th/9512077.
- [DP88] E. D’Hoker et D. H. Phong, The geometry of string perturbation theory, Rev. Mod. Phys. 60, 917 (1988).
- [Duf96] M. J. Duff, Supermembranes, (1996), hep-th/9611203.
- [DVV88] R. Dijkgraaf, E. Verlinde et H. Verlinde, conformal field theories on riemann surfaces, Commun. Math. Phys. 115, 649–690 (1988).
- [DVV97a] R. Dijkgraaf, E. Verlinde et H. Verlinde, Counting dyons in string theory, Nucl. Phys. B484, 543–561 (1997), hep-th/9607026.
- [DVV97b] R. Dijkgraaf, E. Verlinde et H. Verlinde, Matrix string theory, Nucl. Phys. B500, 43 (1997), hep-th/9703030.
- [DZ76a] S. Deser et B. Zumino, A complete action for the spinning string, Phys. Lett. 65B, 369–373 (1976).
- [DZ76b] S. Deser et B. Zumino, Consistent supergravity, Phys. Lett. 62B, 335 (1976).
- [EGH80] T. Eguchi, P. B. Gilkey et A. J. Hanson, Gravitation, gauge theories and differential geometry, Phys. Rept. 66, 213 (1980).
- [EGKR98] S. Elitzur, A. Giveon, D. Kutasov et E. Rabinovici, Algebraic aspects of matrix theory on , Nucl. Phys. B509, 122 (1998), hep-th/9707217.
- [Fab97] C. Fabre, Unification et dualité en théories de cordes ouvertes, Thèse de doctorat, Université Paris 7, 1997.
- [Fer97] F. Ferrari, Dualité couplage fort / couplage faible dans les théories de jauge non-abéliennes, Thèse de doctorat, Université Paris 6, 1997.
- [FHRS97] W. Fischler, E. Halyo, A. Rajaraman et L. Susskind, The incredible shrinking torus, Nucl. Phys. B501, 409 (1997), hep-th/9703102.
- [FILQ90] A. Font, L. E. Ibanez, D. Lust et F. Quevedo, Strong - weak coupling duality and nonperturbative effects in string theory, Phys. Lett. B249, 35–43 (1990).
- [FKKT98] M. Fukuma, H. Kawai, Y. Kitazawa et A. Tsuchiya, String field theory from IIB matrix model, Nucl. Phys. B510, 158 (1998), hep-th/9705128.
- [FMS86] D. Friedan, E. Martinec et S. Shenker, Conformal invariance, supersymmetry and string theory, Nucl. Phys. B271, 93 (1986).
- [FR80] P. G. O. Freund et M. A. Rubin, Dynamics of dimensional reduction, Phys. Lett. 97B, 233 (1980).
- [FvNF76] D. Z. Freedman, P. van Nieuwenhuizen et S. Ferrara, Progress toward a theory of supergravity, Phys. Rev. D13, 3214–3218 (1976).
- [Gep87] D. Gepner, Exactly solvable string compactifications on manifolds of su(n) holonomy, Phys. Lett. 199B, 380 (1987).
- [GG97a] M. B. Green et M. Gutperle, D particle bound states and the D instanton measure, (1997), hep-th/9711107.
- [GG97b] M. B. Green et M. Gutperle, Effects of D instantons, Nucl. Phys. B498, 195 (1997), hep-th/9701093.
- [GGK97] M. B. Green, M. Gutperle et H. Kwon, Sixteen fermion and related terms in M theory on , (1997), hep-th/9710151.
- [GGPZ95] L. Girardello, A. Giveon, M. Porrati et A. Zaffaroni, S duality in Yang-Mills theories with general gauge groups, Nucl. Phys. B448, 127–165 (1995), hep-th/9502057.
- [GGRT73] P. Goddard, J. Goldstone, C. Rebbi et C. B. Thorn, Quantum dynamics of a massless relativistic string, Nucl. Phys. B56, 109–135 (1973).
- [GGV97] M. B. Green, M. Gutperle et P. Vanhove, One loop in eleven-dimensions, Phys. Lett. B409, 177–184 (1997), hep-th/9706175.
- [GHM97] M. Green, J. A. Harvey et G. Moore, I-brane inflow and anomalous couplings on D-branes, Class. Quant. Grav. 14, 47–52 (1997), hep-th/9605033.
- [GHMR85] D. J. Gross, J. A. Harvey, E. Martinec et R. Rohm, The heterotic string, Phys. Rev. Lett. 54, 502–505 (1985).
- [GHT96] M. B. Green, C. M. Hull et P. K. Townsend, D-brane Wess-Zumino actions, T duality and the cosmological constant, Phys. Lett. B382, 65–72 (1996), hep-th/9604119.
- [GIK+84] A. Galperin, E. Ivanov, S. Kalitsyn, V. Ogievetskii et E. Sokatchev, Unconstrained matter, Yang-Mills and supergravity theories in harmonic superspace, Class. Quant. Grav. 1, 469 (1984).
- [Gin88] P. Ginsparg, Applied conformal field theory, (1988), cours de l’école d’été des Houches, France, 28 juin - 5 août, 1988.
- [GJS76] J. L. Gervais, A. Jevicki et B. Sakita, Collective coordinate method for quantization of extended systems, Phys. Rept. 23, 281 (1976).
- [GK98] A. Giveon et D. Kutasov, Brane dynamics and gauge theory, (1998), hep-th/9802067.
- [GKK+98] A. Gregori, E. Kiritsis, C. Kounnas, N. A. Obers, P. M. Petropoulos et B. Pioline, corrections and nonperturbative dualities of string ground states, Nucl. Phys. B510, 423 (1998), hep-th/9708062.
- [GNO77] P. Goddard, J. Nuyts et D. Olive, Gauge theories and magnetic charge, Nucl. Phys. B125, 1 (1977).
- [GPR94] A. Giveon, M. Porrati et E. Rabinovici, Target space duality in string theory, Phys. Rept. 244, 77–202 (1994), hep-th/9401139.
- [Gre91] M. B. Green, Space-time duality and Dirichlet string theory, Phys. Lett. B266, 325–336 (1991).
- [Gre96] B. R. Greene, String theory on Calabi-Yau manifolds, (1996), hep-th/9702155.
- [GS71] J. L. Gervais et B. Sakita, Functional integral approach to dual-resonance models, Phys. Rev. D4, 2291 (1971).
- [GS82] M. B. Green et J. H. Schwarz, Supersymmetrical string theories, Phys. Lett. 109B, 444 (1982).
- [GS84] M. B. Green et J. H. Schwarz, Anomaly cancellations in supersymmetric gauge theory require , Phys. Lett. 149B, 117 (1984).
- [GSO76] F. Gliozzi, J. Scherk et D. Olive, Supergravity and the spinor dual model, Phys. Lett. 65B, 282 (1976).
- [GSWa] M. B. Green, J. H. Schwarz et E. Witten, Superstring theory. vol. 1: Introduction, Cambridge, Uk: Univ. Pr. ( 1987) 469 P. ( Cambridge Monographs On Mathematical Physics).
- [GSWb] M. B. Green, J. H. Schwarz et E. Witten, Superstring theory. vol. 2: Loop amplitudes, anomalies and phenomenology, Cambridge, Uk: Univ. Pr. ( 1987) 596 P. ( Cambridge Monographs On Mathematical Physics).
- [GV97] M. B. Green et P. Vanhove, D - instantons, strings and M theory, Phys. Lett. B408, 122–134 (1997), hep-th/9704145.
- [HKT94] S. Hosono, A. Klemm et S. Theisen, Lectures on mirror symmetry, (1994), hep-th/9403096.
- [HM96] J. A. Harvey et G. Moore, Five-brane instantons and couplings in string theory, (1996), hep-th/9610237.
- [Hor89] P. Horava, Background duality of open string models, Phys. Lett. B231, 251 (1989).
- [Hor97] P. Horava, M theory as a holographic field theory, (1997), hep-th/9712130.
- [HS95] J. A. Harvey et A. Strominger, The heterotic string is a soliton, Nucl. Phys. B449, 535–552 (1995), hep-th/9504047.
- [HT95] C. M. Hull et P. K. Townsend, Unity of superstring dualities, Nucl. Phys. B438, 109–137 (1995), hep-th/9410167.
- [Hul97] C. M. Hull, U duality and BPS spectrum of super Yang-Mills theory and M theory, (1997), hep-th/9712075.
- [HV97] F. Hacquebord et H. Verlinde, Duality symmetry of Yang-Mills theory on , Nucl. Phys. B508, 609 (1997), hep-th/9707179.
- [HW96] P. Horava et E. Witten, Eleven-dimensional supergravity on a manifold with boundary, Nucl. Phys. B475, 94–114 (1996), hep-th/9603142.
- [IKKT97] N. Ishibashi, H. Kawai, Y. Kitazawa et A. Tsuchiya, A large reduced model as superstring, Nucl. Phys. B498, 467 (1997), hep-th/9612115.
- [Kal21] T. Kaluza, On the problem of unity in physics, Preuss. Akad. Wiss. K1, 966 (1921).
- [Kir97] E. Kiritsis, Introduction to superstring theory, (1997), hep-th/9709062.
- [KKV97] S. Katz, A. Klemm et C. Vafa, Geometric engineering of quantum field theories, Nucl. Phys. B497, 173–195 (1997), hep-th/9609239.
- [KL92] C. Kounnas et D. Lust, Cosmological string backgrounds from gauged wzw models, Phys. Lett. B289, 56–60 (1992), hep-th/9205046.
- [Kle26] O. Klein, Quantentheorie und fünfdimensionale relativitätstheorie, Z. Phys. 37, 895 (1926).
- [Kle97] A. Klemm, On the geometry behind N=2 supersymmetric effective actions in four-dimensions, (1997), hep-th/9705131.
- [KLT86a] H. Kawai, D. C. Lewellen et S. H. H. Tye, Classification of closed fermionic string models, Phys. Rev. D34, 3794 (1986).
- [KLT86b] H. Kawai, D. C. Lewellen et S. H. H. Tye, Construction of four-dimensional fermionic string models, Phys. Rev. Lett. 57, 1832 (1986).
- [KO97] E. Kiritsis et N. A. Obers, Heterotic type I duality in -dimensions, threshold corrections and D instantons, (1997), hep-th/9709058.
- [KP97a] A. Kehagias et H. Partouche, D instanton corrections as string effects and nonrenormalization theorems, (1997), hep-th/9712164.
- [KP97b] A. Kehagias et H. Partouche, The exact quartic effective action for the type IIB superstring, (1997), hep-th/9710023.
- [KP97c] E. Kiritsis et B. Pioline, On threshold corrections in IIB string theory and string instantons, Nucl. Phys. B508, 509 (1997), hep-th/9707018.
- [Kro89] P. B. Kronheimer, The construction of ALE spaces as hyperkähler quotients, J. Diff. Geom. 29, 665–683 (1989).
- [KT83] T. Kugo et P. Townsend, Supersymmetry and the division algebras, Nucl. Phys. B221, 357 (1983).
- [KV95] S. Kachru et C. Vafa, Exact results for compactifications of heterotic strings, Nucl. Phys. B450, 69–89 (1995), hep-th/9505105.
- [Lei89] R. G. Leigh, Dirac-Born-Infeld action from Dirichlet sigma model, Mod. Phys. Lett. A4, 2767 (1989).
- [Ler97] W. Lerche, Introduction to Seiberg-Witten theory and its stringy origin, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 55B, 83 (1997), hep-th/9611190.
- [LSW89] W. Lerche, A. N. Schellekens et N. P. Warner, Lattices and strings, Phys. Rept. 177, 1 (1989).
- [LT89] D. Lust et S. Theisen, Lectures on string theory, (1989), Berlin, Germany: Springer (1989) 346 p. (Lecture notes in physics, 346).
- [Mal97] J. Maldacena, The large N limit of superconformal field theories and supergravity, (1997), hep-th/9711200.
- [Mal98] J. M. Maldacena, Black holes and D-branes, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 61A, 111 (1998), hep-th/9705078.
- [MJDP98] H. L. M. J. Duff et C. N. Pope, untwisted, (1998), hep-th/9803061, et références incluses.
- [MO77] C. Montonen et D. Olive, Magnetic monopoles as gauge particles?, Phys. Lett. 72B, 117 (1977).
- [Mot97] L. Motl, Proposals on nonperturbative superstring interactions, (1997), hep-th/9701025.
- [MY76] T. Maskawa et K. Yamawaki, The problem of mode in the null-plane field theory and Dirac’s method of quantization, Prog. Theor. Phys. 56, 270 (1976).
- [Nah82] W. Nahm, Monopoles in quantum field theory, (1982), In Trieste 1982, Proceedings of the monopole meeting, ed. N. Craigie.
- [Nak94] H. Nakajima, Instantons on ALE spaces, quiver varieties, and Kac Moody algebras, Duke Math.J. 76, 365–416 (1994).
- [Nar86] K. S. Narain, New heterotic string theories in uncompactified dimensions < 10, Phys. Lett. 169B, 41 (1986).
- [NSW87] K. S. Narain, M. H. Sarmadi et E. Witten, A note on toroidal compactification of heterotic string theory, Nucl. Phys. B279, 369 (1987).
- [OOY96] H. Ooguri, Y. Oz et Z. Yin, D-branes on Calabi-Yau spaces and their mirrors, Nucl. Phys. B477, 407–430 (1996), hep-th/9606112.
- [OPR97] N. A. Obers, B. Pioline et E. Rabinovici, M theory and U duality on with gauge backgrounds, (1997), hep-th/9712084.
- [Osb79] H. Osborn, Topological charges for supersymmetric gauge theories and monopoles of spin 1, Phys. Lett. 83B, 321 (1979).
- [OV91] H. Ooguri et C. Vafa, Geometry of N=2 strings, Nucl. Phys. B361, 469–518 (1991).
- [OV96] H. Ooguri et C. Vafa, Summing up D instantons, Phys. Rev. Lett. 77, 3296–3298 (1996), hep-th/9608079.
- [OY96] H. Ooguri et Z. Yin, TASI lectures on perturbative string theories, (1996), hep-th/9612254.
- [Par97] H. Partouche, Dualité en théorie des cordes, Thèse de doctorat, Ecole Polytechnique, 1997.
- [PB85] H. C. Pauli et S. J. Brodsky, Solving field theory in one space one time dimension, Phys. Rev. D32, 1993 (1985).
- [PCJ96] J. Polchinski, S. Chaudhuri et C. V. Johnson, Notes on D-branes, (1996), hep-th/9602052.
- [Pin93] S. Pinsky, The light cone field theory paradigm for spontaneous symmetry breaking, (1993), hep-th/9405091.
- [Pio97] B. Pioline, D-effects in toroidally compactified type II string theory, (1997), hep-th/9712155.
- [Pio98] B. Pioline, A note on non-perturbative couplings, (1998), hep-th/9804023.
- [PK98] B. Pioline et E. Kiritsis, U duality and D-brane combinatorics, Phys. Lett. B418, 61 (1998), hep-th/9710078.
- [Pol74] A. M. Polyakov, Particle spectrum in the quantum field theory, JETP Lett. 20, 194–195 (1974).
- [Pol81] A. M. Polyakov, Quantum geometry of bosonic strings, Phys. Lett. 103B, 207 (1981).
- [Pol94a] J. Polchinski, What is string theory ?, (1994), Ecole des Houches, Fluctuating Geometries in Statistical Mechanics and Field Theory, 1994.
- [Pol94b] J. Polchinski, Combinatorics of boundaries in string theory, Phys. Rev. D50, 6041–6045 (1994), hep-th/9407031.
- [Pol95] J. Polchinski, Dirichlet branes and Ramond-Ramond charges, Phys. Rev. Lett. 75, 4724–4727 (1995), hep-th/9510017.
- [Pol96] J. Polchinski, TASI lectures on D-branes, (1996), hep-th/9611050.
- [PP97] H. Partouche et B. Pioline, Partial spontaneous breaking of global supersymmetry, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 56B, 322 (1997), hep-th/9702115.
- [PS75] M. K. Prasad et C. M. Sommerfield, An exact classical solution for the ’t hooft monopole and the julia-zee dyon, Phys. Rev. Lett. 35, 760–762 (1975).
- [PW96] J. Polchinski et E. Witten, Evidence for heterotic - type I string duality, Nucl. Phys. B460, 525–540 (1996), hep-th/9510169.
- [Rov97] C. Rovelli, Loop quantum gravity, (1997), gr-qc/9710008.
- [Rus97] J. G. Russo, An ansatz for a nonperturbative four graviton amplitude in type IIB superstring theory, (1997), hep-th/9707241.
- [Sal68] A. Salam, Weak and electromagnetic interactions, (1968), Originally printed in *Svartholm: Elementary Particle Theory, Proceedings Of The Nobel Symposium Held 1968 At Lerum, Sweden*, Stockholm 1968, 367-377.
- [Sch66] J. Schwinger, Magnetic charge and quantum field theory, Phys. Rev. 144, 1087–1093 (1966).
- [Sch83] J. H. Schwarz, Covariant field equations of chiral N=2 D = 10 supergravity, Nucl. Phys. B226, 269 (1983).
- [Sch95] J. H. Schwarz, An multiplet of type IIB superstrings, Phys. Lett. B360, 13–18 (1995), hep-th/9508143.
- [Sei88] N. Seiberg, Observations on the moduli space of superconformal field theories, Nucl. Phys. B303, 286 (1988).
- [Sei94] N. Seiberg, Exact results on the space of vacua of four-dimensional SUSY gauge theories, Phys. Rev. D49, 6857–6863 (1994), hep-th/9402044.
- [Sei97] N. Seiberg, Why is the matrix model correct?, Phys. Rev. Lett. 79, 3577–3580 (1997), hep-th/9710009.
- [Sen94] A. Sen, Dyon - monopole bound states, selfdual harmonic forms on the multi - monopole moduli space, and invariance in string theory, Phys. Lett. B329, 217–221 (1994), hep-th/9402032.
- [Sen95] A. Sen, String string duality conjecture in six-dimensions and charged solitonic strings, Nucl. Phys. B450, 103–114 (1995), hep-th/9504027.
- [Sen97] A. Sen, D0-branes on and matrix theory, (1997), hep-th/9709220.
- [She90] S. H. Shenker, The strength of non-perturbative effects in string theory, (1990), In Cargèse 1990, Proceedings, Workshop on Random Surfaces, Quantum Gravity and Strings, France.
- [Sor83] R. D. Sorkin, Kaluza-Klein monopole, Phys. Rev. Lett. 51, 87 (1983).
- [SS74] J. Scherk et J. H. Schwarz, Dual models for nonhadrons, Nucl. Phys. B81, 118–144 (1974).
- [SS82] A. Salam et J. Strathdee, On Kaluza-Klein theory, Annals Phys. 141, 316 (1982).
- [SS97a] N. Seiberg et S. Sethi, Comments on Neveu-Schwarz five-branes, (1997), hep-th/9708085.
- [SS97b] S. Sethi et M. Stern, D-brane bound states redux, (1997), hep-th/9705046.
- [SS97c] K. Sfetsos et K. Skenderis, Microscopic derivation of the Bekenstein-Hawking entropy formula for nonextremal black holes, (1997), hep-th/9711138.
- [Ste96] K. S. Stelle, Lectures on supergravity -branes, (1996), hep-th/9701088.
- [Str95] A. Strominger, Black hole condensation and duality in string theory, (1995), hep-th/9510207.
- [Sus96] L. Susskind, T duality in M(atrix) theory and S duality in field theory, (1996), hep-th/9611164.
- [Sus97] L. Susskind, Another conjecture about M(atrix) theory, (1997), hep-th/9704080.
- [SW86] N. Seiberg et E. Witten, Spin structures in string theory, Nucl. Phys. B276, 272 (1986).
- [SW94a] N. Seiberg et E. Witten, Electric - magnetic duality, monopole condensation, and confinement in supersymmetric Yang-Mills theory, Nucl.Phys. B426, 19–52 (1994).
- [SW94b] N. Seiberg et E. Witten, Monopoles, duality and chiral symmetry breaking in supersymmetric QCD, Nucl.Phys. B431, 484–550 (1994).
- [Tay97] W. Taylor IV, Lectures on D-branes, gauge theory and M(atrices), (1997), hep-th/9801182.
- [Ter85] A. Terras, Harmonic analysis on symmetric spaces and applications, volume I, Springer Verlag, 1985.
- [tH74a] G. ’t Hooft, Magnetic monopoles in unified gauge theories, Nucl. Phys. B79, 276–284 (1974).
- [tH74b] G. ’t Hooft, A planar diagram theory for strong interactions, Nucl. Phys. B72, 461 (1974).
- [tH76] G. ’t Hooft, Computation of the quantum effects due to a four- dimensional pseudoparticle, Phys. Rev. D14, 3432–3450 (1976).
- [Tow95] P. K. Townsend, The eleven-dimensional supermembrane revisited, Phys. Lett. B350, 184–187 (1995), hep-th/9501068.
- [Tow96] P. K. Townsend, Four lectures on M theory, (1996), hep-th/9612121.
- [Tow97] P. K. Townsend, M theory from its superalgebra, (1997), hep-th/9712004.
- [Tse96] A. A. Tseytlin, Selfduality of Born-Infeld action and Dirichlet 3-brane of type IIB superstring theory, Nucl. Phys. B469, 51–67 (1996), hep-th/9602064.
- [Tse97] A. A. Tseytlin, On nonabelian generalization of Born-Infeld action in string theory, Nucl. Phys. B501, 41 (1997), hep-th/9701125.
- [Vaf96] C. Vafa, Evidence for F theory, Nucl. Phys. B469, 403–418 (1996), hep-th/9602022.
- [Vaf97] C. Vafa, Lectures on strings and dualities, (1997), hep-th/9702201.
- [Ver95] E. Verlinde, Global aspects of electric - magnetic duality, Nucl. Phys. B455, 211–228 (1995), hep-th/9506011.
- [VW94] C. Vafa et E. Witten, A strong coupling test of S duality, Nucl. Phys. B431, 3–77 (1994), hep-th/9408074.
- [WB92] J. Wess et J. Bagger, Supersymmetry and supergravity, Princeton Series in Physics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992, second edition.
- [Wei67] S. Weinberg, A model of leptons, Phys. Rev. Lett. 19, 1264 (1967).
- [Wei96] D. H. Weingarten, Quarks by computer, Sci. Am. 274, 104–108 (1996).
- [Wit79] E. Witten, Dyons of charge , Phys. Lett. 86B, 283–287 (1979).
- [Wit95a] E. Witten, On S duality in abelian gauge theory, (1995), hep-th/9505186.
- [Wit95b] E. Witten, String theory dynamics in various dimensions, Nucl. Phys. B443, 85–126 (1995), hep-th/9503124.
- [Wit96a] E. Witten, Bound states of strings and -branes, Nucl. Phys. B460, 335–350 (1996), hep-th/9510135.
- [Wit96b] E. Witten, Small instantons in string theory, Nucl.Phys. B460, 541–559 (1996).
- [WO78] E. Witten et D. Olive, Supersymmetry algebras that include topological charges, Phys. Lett. 78B, 97 (1978).
- [Yau77] S.-T. Yau, Calabi’s conjecture and some new results in algebraic geometry, Proc. Nat. Acad. Sci. 74, 1798–1799 (1977).
- [YM54] C. N. Yang et R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, Phys. Rev. 96, 191 (1954).
- [YZ96] S.-T. Yau et E. Zaslow, BPS states, string duality, and nodal curves on K3, Nucl. Phys. B471, 503–512 (1996), hep-th/9512121.
- [Zwa68] D. Zwanziger, Magnetic charge and quantum field theory, Phys. Rev. 176, 1480 (1968).
Aspects non perturbatifs de la théorie des supercordes
Les théories de supercordes sont à l’heure actuelle le seul candidat à l’unification quantique des interactions de jauge et de la gravité. Ces théories n’etaient jusqu’à récemment définies que dans le régime de faible couplage par leur série de perturbation. La découverte récente des symétries de dualité, prolongeant la dualité électrique-magnétique des équations de Maxwell, permet maintenant d’identifier ces théories perturbatives comme différentes approximations d’une théorie fondamentale, la M-théorie. Les symétries de dualités donnent accès aux effets non perturbatifs d’une théorie des cordes donnée à partir de calculs perturbatifs dans une théorie duale.
Le premier chapitre de ce mémoire fournit une introduction non technique à ces développements. Le second introduit les dualités non perturbatives observées en théories de jauge et de supergravité, le spectre BPS non-perturbatif dans ces théories, et présente une nouvelle dualité reliant les branches de Higgs de certaines théories de jauge supersymétriques . Dans le troisième chapitre, nous introduisons brièvement les théories des cordes perturbatives et vérifions explicitement les conjectures de dualités dans les théories des cordes de supersymétrie à quatre dimensions. Grâce aux dualités, nous obtenons des résultats exacts non perturbativement pour certains couplages dans l’action effective de basse énergie, et interprétons dans le chapitre 4 les effets non perturbatifs ainsi obtenus en termes de configurations instantoniques de -branes enroulées sur les cycles supersymétriques de la variété de compactification. Enfin, nous discutons une proposition récente de définition a priori de la M-théorie en termes de théories de jauge supersymétriques à grand , l’étendons à des compactifications toroïdales en présence de champs de fond constants, et interprétons le spectre d’états BPS en termes d’excitations de la théorie de jauge. Les publications originales décrivant ces travaux sont reproduites en appendice.
mots-clés : action effective, instantons, M-théorie, p-branes, solitons, symétries de dualité, supergravité, théorie de jauge supersymétrique
Non-perturbative Aspects of Superstring Theory
Superstring theories are to date the only viable candidate for quantum unification of gauge interactions with gravity. Until recently, these theories were only defined in the weak coupling regime by their perturbative series. Thanks to the recent discovery of duality symmetries, extending the electric-magnetic duality of Maxwell equations, these theories can now be identified as distinct approximations to a fundamental theory known as M-theory. Duality symmetries give access to non-perturbative effects in one string theory from perturbative computations in a dual theory.
The first chapter of this thesis gives a non-technical introduction to these developments. The second chapter introduces the non-perturbative dualities that have been observed in gauge and supergravity theories as well as the non-perturbative BPS spectrum, and presents a novel duality relating the Higgs branches of certain supersymmetric N=2 gauge theories. In the third chapter, we briefly introduce the perturbative string theories and give some checks on the duality between four-dimensional N=4 string theories. From duality arguments, we obtain exact non-perturbative results for various couplings in the low energy effective action, and interpret the corresponding non-perturbative effects in terms of instantonic configurations of -branes wrapped on supersymmetric cycles of the compactification manifold. Finally, we discuss a recent proposal of definition of M-theory in terms of large supersymmetric gauge theories ; we extend it to toroidal compactifications in constant background fields, and interpret the resulting spectrum of BPS states in terms of excitations in the gauge theory. Original publications for these results are included in the Appendices.
keywords: duality symmetries, effective action, instantons, M-theory, p-branes, solitons, supergravity, supersymmetric gauge theory
Index
- homologie de, see cycle d’homologie
- accélerateur §1.1
- action effective §2.2.1, §4.1.1
- action euclidienne §4.1.2
- ALE, espace, see instanton gravitationnel
- amplitude de diffusion §1.2.2
- angle §2.1.4, §2.2.1
- anomalie
- ansatz
- anti-brane footnote 11
- anti-de Sitter, espace footnote 21, §2.4.2
- arbres, interaction à l’ordre des §3.1.2
- asymptotique, série §1.1.1, §1.3.3, §4.1.2
- auto-dual pair, réseau §3.3.1
- axion §3.3.4
- Banks, Fischler, Shenker et Susskind, conjecture de §1.3.5, §3.4.2, Chapter 5, §5.2
- Bessel, fonction de footnote 19, §4.4, §4.5.1, §4.5.4
- beta, fonction
- Bogomolny, borne de §2.1.2, §2.1.3, §2.4.2
- Borel, générateur de §5.3.3
- Borel, plan de §4.1.2
- Born-Infeld, action de §3.3.3, §4.1.3, §4.5.4, §4.5.5, §4.5.5, 2nd item, §5.2
- bosonique, théorie des cordes §1.2.1, §3.1
- boucle, développement en boucle, see genre, développement en
- BPS, états, see états BPS
- BPS, saturation, see saturation BPS
- brane §1.2.5, §2.4.3
- Calabi-Yau, variété de §1.2.3, footnote 21, §2.4.4, footnote 22, §3.3.1, 3rd item, §4.2, §4.4
- calcul semi-classique, see semi-classique
- Cartan, classification de §3.3.2
- champ de cordes, théorie de §4.1.1, §5.1.3
- Chan-Paton, facteur de §2.3.2, §3.2.2, §3.3.3, §3.3.3
- charge centrale §2.1.3
- Chern-Simons, théorie de §1.3.3, §3.4.2
- Chern, classe de §4.1.2
- chiralité §1.2.1, §2.2.2, §3.2.3, §3.3.2
- cinq-brane §3.4.2
- Clifford, algèbre de §3.3.2
- compactification §1.2.3, §2.3.5
- confinement §1.1.2, §1.1.3
-
conforme, théorie des champs §1.2.3
- superconforme §1.2.1, §3.2
- sur la surface d’univers §1.2.1, §3.1.1
- SYM footnote 2
- conifold, see singularité de conifold
- coordonnée collective §2.4.3, §4.1.4, §4.5.3
- corde relativiste §3.1
- cosmologique, constante §3.1.2, §3.2.1
- couplage des cordes, see dilaton
- couplage effectif §1.1.1
- critique, dimension §1.2.1, footnote 6, §3.1, §3.2
- crosscap §3.2.2
- cuspoïdale, forme §4.5.2, §4.5.2, §4.6.3
- cycle d’homologie
- D-brane §1.2.5, §3.2.2, §3.3.3, §3.4.2, §4.1.2
- D-instanton §4.1.2
- D-terme §2.2.5
- décompactification, limite de §3.3.1, §4.5.3, §4.6.1, §4.6.3
- découplage
- désintégration d’états BPS footnote 2
- diffusion profondément inélastique §1.1.1
- dilaton §1.2.1, §1.2.1, 1st item, §3.1.2, 1st item, §3.3.1, §3.3.4, §4.2, §4.5.2, §4.6
- Dirac, condition de quantification de §2.1.1, §2.3.3, §3.3.3
- directions plates
- Dirichlet, condition de §1.2.5, §3.3.3
- Dirichlet, membrane de, see D-brane
- divergence infrarouge §2.1.4, §2.2.4
- divergence logarithmique en couplage footnote 10, §4.5.2
- divergence ultraviolette §1.1.1, §1.2
- domaine fondamental modulaire §3.1.2, §4.6.1
-
dualité
- d’espace-cible, see T-dualité
- de Het et Het §3.3.2, §3.4.1
- de Kramers-Wannier §2.1.3
- de la théorie IIB 10D, see S-dualité
- de Nahm §5.3.5
- de Poincaré §2.4.1, §3.3.1, §4.1.3
- de Seiberg dans SYM §2.2.5
- de sine Gordon-Thirring §2.1.3
- des théories de supergravité, see symétries cachées
- des théories IIA et IIB §1.2.4, §2.3.5, §3.3.2, §3.4.1, §4.5.3
- des théories IIA et SUGRA 11D §2.3.5, §3.4.2
- électrique-magnétique §1.1.3, §2.1.1, §2.4.1, 2nd item, §5.3.3
- hétérotique - type I §1.3.1, §2.3.2, 1st item
- hétérotique - type II §3.3.4, 3rd item, §4.2, §4.6.1
- hétérotique-type II §4.6
- S-dualité, see S-dualité
- T-dualité, see T-dualité
- U-dualité, see U-dualité
- duaux, modèles §1.2.1, §3.1, §5.1.3
- Eguchi-Hanson, espace d’ footnote 12
- Einstein-Hilbert, action d’ §2.3.4, §3.1.1, footnote 20, §4.1.2
- Einstein, référentiel d’ §2.3.4
- Eisenstein, série d’ §4.5.1, §4.5.2, §4.5.4, §4.5.6
- El Dorado §1.1.3
- électrodynamique
- Enriques, involution d’ §3.3.4
- enroulement
- espace des modules §1.2.3
- états BPS §1.1.3, §1.2.5, §3.3.3, §4.1.3
- euclidienne, action §4.1.2
- Euler, caractéristique d’ §3.1.2, §3.2.2, §3.3.4, §3.4.1, footnote 31
- Euler, densité d’ footnote 24
- F-théorie 1st item
- fantôme footnote 23, §3.1.1, §3.2
- Fayet-Iliopoulos, terme de §2.2.5
- fermionique, construction §1.2.3
- Feynman, diagramme de §1.2.2, §4.1.2
- flot spectral
- flux électrique §2.4.1, §4.5.4, §4.5.5, §5.3.4
- flux, multiplet de §5.3.4
- foliation §5.1.1
- front de lumière §3.2
- Galilée, invariance de §5.1.1, 1st item
- Gauss, contrainte de §5.2
- genre, développement en §3.1.2, §3.2.2
- géométrie non commutative §3.3.3, §5.3.1, §5.3.5
- géométrie spéciale, variété de §2.2.2
- Georgi-Glashow, modèle de §2.1.2
- graviton §1.2.1, 3rd item, §3.4.2, 3rd item
- Green et Gutperle, conjecture de §4.5.1, §4.6.3
- Green et Schwarz, corde de §3.2
- Green et Schwarz, mécanisme de §2.3.2, §3.2.3
- groupe
- GSO, projection §1.2.1, §3.2, §3.2.3
- harmonique, super-espace footnote 11
- Higgs
- holonomie
- horizon, géométrie de l’ 3rd item, §2.4.2
- hyperfine, structure §1.1
- hyperkählerien, quotient §2.2.5
- hyperkählerienne spéciale, variété footnote 11
- hyperkählerienne, variété footnote 21, §2.2.2, §2.4.4
- hypermultiplet 2nd item, §2.2.2, §4.1.4, §4.2, §4.4, §4.6
-
instanton Chapter 4
- de feuille d’univers §4.1.1, §4.2
- de surface d’univers §3.3.1
- des théories de jauge §1.1.2, footnote 27, §4.1.2, §5.3.4
- des théories des cordes §1.3.4
- gravitationnel footnote 24, §2.2.2, footnote 12, §4.1.2
- mesure d’intégration §1.3.4, Chapter 4, §4.5.1
- série de, see série d’instantons
- symétrie brisée par §4.1.4
- intercept §3.1.1, §5.1.3
- intersection §3.4.1, footnote 31
- , surface §1.3.1, §3.3.4, §4.2, §4.6
- Kähler, module de §4.2
- Kähler, potentiel de §2.2.1, §4.1.4
- Kaluza-Klein §2.3.4
- kappa-symétrie §2.4.3
- §1.1.2
- Landau, pôle de §1.1.1
- Laplacien §4.5.2, §4.5.2
- level matching, condition de §3.1.1, §3.1.2, §3.3.1, §3.3.2, §3.4.1, §5.1.3
- liberté asymptotique §1.1.1, §2.2.4
- lié, état lié de D-branes footnote 27, §3.3.3, 3rd item
- ligne d’univers §1.2.1, §1.3.4, §3.1, §4.5.3
- Liouville, champ de footnote 3, §3.1, §3.1.1
- Lorentz, invariance à 11D §1.3.5, 2nd item, §4.5.3, 2nd item, §5.3.5
- Lorentz, transformation de §4.5.5
- lumière, front de §1.3.3, §5.1.1
- M-théorie §1.3, §1.3.2, §1.3.5, §3.4.2
- masse, formule de
- matrices, théorie des §1.3.5, Chapter 5, §5.2
- membrane, soliton de SUGRA 11D §1.3.2, §2.4.2
- miroir, symétrie §1.2.4, §3.3.1, §3.3.4, 3rd item, 4th item, footnote 9, §4.4, §4.6
- mode zéro
- modèle standard §1.2, see standard
-
modes zéros
- des D-branes §2.4.3
- modulaire, forme §3.1.2, §4.5.1, §4.5.2, §4.6, §4.6.1
- modulaire, invariance §3.2.2, §3.2.3, §3.3.1, §3.3.4, §3.4.2
- module, champ de §1.2.3
- modules, champs de §2.3.5
- moment, état de, see Kaluza-Klein
- moment, multiplet de §5.3.4
- monodromie §2.2.4
- monopôle magnétique §1.1.3
- Montonen-Olive, conjecture de §1.1.3, §2.1.2
- mouette, diagramme de §5.1.1
- Nambu-Goto, action de §3.1
- Narain, réseau de §3.3.2, §3.3.4, §3.3.4, 3rd item, §4.6.1
- Neumann, condition de footnote 1, §3.3.3
- Neveu-Schwarz, secteur de §2.3.3, §2.3.4, §3.2, §3.3.3
- non critiques, théorie des cordes footnote 3
- non renormalisation §4.1.4
- NS5-brane, see cinq-brane de Neveu-Schwarz
- opérateur de vertex §3.1.2, §4.1.4, §4.6.2
- orbifold, see variété orbifold
- oscillateur §3.1.1, §3.4.1, §4.6.1, §5.1.3
- particule relativiste §3.1
- partition, fonction de
- parton §1.3.5, §5.1.3, §5.2
- phase
- phénoménologie §1.1.3, 1st item, §3.2.3
- Planck, échelle de §1.2, §1.2.1, §1.2.1, 2nd item, §5.3.3
-
Poincaré
- dualité de §2.4.1
- Poincaré, demi-plan de §3.1.2, §4.5.2
- Poisson, resommation de §4.4, §4.5.1, §4.5.3, §4.5.4, §4.5.6, §4.6.1
- Polyakov, action de §3.1
- , cordes de charge §1.2.4, 2nd item, §4.5.4
- , dyons de charge §1.1.3, §2.1.4, 2nd item
- Prasad-Sommerfield, limite de §2.1.2
- prépotentiel §2.2.2, §4.4
- Pythagore §1.2.1
- quaternions §2.2.2
- Ramond, secteur de §2.3.3, §2.3.4, §3.2, §3.3.2, §3.3.3, §3.4.1, §4.5.5
- rang réduit, théorie des cordes à §3.3.4
-
réduction dimensionnelle
- de Kaluza-Klein, see Kaluza-Klein, réduction de
- de SYM §5.3.1
-
réduction dimensionnelle
- des solitons §2.4.3
- Regge, trajectoire de §1.2.1
- renormalisation §1.1.1
- réseau, théorie de jauge sur §1.1.2
- Riemann, identité de §3.2.1
- Riemann, surface de, see Riemann
- Roelcke-Selberg, théorème de §4.5.2
- S-dualité §3.3.4
- saturation BPS §4.1.4, §4.5, §4.6, §4.6, §4.6.1
- scaling, limite de §5.2, §5.3.2
- Schwinger, paramètre de §3.1.2
- secteur de Neveu-Schwarz §3.2.2
- secteur de Ramond §3.2.2
- Seiberg-Witten
- Seiberg, dualité dans SYM §1.1.3, §2.2.5
- semi-classique
- série d’instantons
- série de perturbation
-
incertitude de la §4.1.2
- en théorie des cordes §3.4.2
- singularité
- soliton
- spectrale, résolution §5.1.2, §5.2
- spin, structure de §3.2
- spinorielle, représentation footnote 8, §4.5.5
- splitting and joining §1.2.1, §3.1.2
- standard, modèle §1.1, §1.1.1
- supercordes, théorie des §1.2.1
- supergravité §1.2.1, §2.3.1
- supermassifs, états §1.2.1, §3.1.1, §3.3.3, §4.1.1
- superpotentiel §2.2.1, §2.2.3, §2.2.5
-
supersymétrie §1.1.3
- algébre de §2.1.3
- brisure par compactification §2.3.5
- brisure partielle de la footnote 10
- charge centrale §2.1.3
- du spectre des supercordes §3.2
- en théorie des matrices 1st item
- globale §2.2.2
- jaugement de la §2.3.1
- maximale §2.3.1
- représentations de la §2.1.3, §2.3.1
- sur le volume d’univers des branes §2.4.3, §3.3.3
- surface de Riemann §1.2.2
- symétrie chirale, brisure de §1.1.2, §1.1.3
- symétrie de jauge
- symétries cachées §1.2.4, §2.3, §2.3.3, §2.3.5, §2.3.5
- T-dualité §1.2.4, §2.3.5, §3.3.1, 2nd item, §4.5.3, §4.5.5
- tachyon §1.2.1, §3.1.1, §3.2
- tadpoles, compensation de §3.2.2
- Taub-NUT, instanton de footnote 24, §5.3.4
- tenseur antisymétrique §1.2.1, §2.3.2, §2.3.4, 2nd item, 1st item, §3.2.2, §3.3.3, §3.3.4
- tension
- ’t Hooft, limite de §5.3.2
- trou noir, entropie des 2nd item
- twisté, état §1.3.2, §3.3.4, §3.4.2, §5.1.3
- U-dualité §1.2.4
-
variété
- à holonomie restreinte §2.3.5
- de Calabi-Yau, see Calabi-Yau
- de compactification, see compactification
- de géométrie spéciale §2.2.2
- différentielle §1.3.3, §3.4.2
- différentielles de dimension 4 §2.2.4
- homogène §2.3.5, §3.3.1
- hyperkählerienne footnote 21, §2.2.2, §2.2.5, §2.4.4, §4.4
- hyperkählerienne spéciale footnote 11
- , see
- orbifold §3.3.4
- quaternionique footnote 16
- symplectique §2.2.2
- vectoriel, multiplet 1st item, §4.2, §4.4, §4.6
-
vide
- dégénérescence en théorie des cordes §1.2.3
- des théories supersymétriques footnote 27
- sélection du §2.3.5
- sur le front de lumière §5.1.1
- transition entre §4.1.2
- volume d’univers §3.3.3
- Wess-Zumino, terme de
- Weyl
- Weyl, groupe de Weyl de la U-dualité §5.3.3, §5.3.3
- Wick, rotation de §4.1.2
- Wilson, ligne de §2.3.5, §3.3.2, §3.3.3, §4.6.1
- Witten, effet §2.1.4