![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/0502103/assets/x1.png)
![[Uncaptioned image]](/html/hep-th/0502103/assets/x2.png)
UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE PARIS VI
THÈSE
Spécialité: PHYSIQUE THÉORIQUE
Présentée
pour obtenir le grade de
Docteur de l’Université Paris VI
par
Maria-Cristina Timirgaziu
Sujet:
Aspects des théories des cordes non-supersymétriques ou avec brisure de supersymétrie
Soutenue le 17 décembre 2004 devant la commission d’examen:
Introduction
Un des principaux défis pour les physiciens théoriciens d’aujourd’hui est la description quantique de la gravitation. Toutes les autres interactions, électromagnétique, faible et forte sont décrites par le Modèle Standard, basé sur la théorie quantique des champs et qui est verifié expérimentalement avec une très bonne précision. La tentative de description de la gravitation par une théorie quantique des champs se solde par un échec, la théorie résultante étant perturbativement nonrenormalizable.
La théorie des cordes est un des candidats actuels à la description quantique de la gravitation. Elle postule que les objets fondamentaux ne sont pas des particules ponctuelles comme dans la théorie des champs, mais des cordes, c’est à dire des objets à une dimension. La longueur des cordes doit être suffisamment petite pour expliquer le fait qu’on ne les observe pas aux énergies actuelles. L’extension spatiale des cordes permet la régularisation des interactions gravitationnelles, d’une manière similaire à la régularisation de la théorie de Fermi par l’introduction de l’échange des bosons W et Z.
En théorie des cordes les particules élémentaires du Modèle Standard sont obtenues comme des différents états d’excitation des cordes. Les seuls processus d’interaction des cordes sont celui de fusion de deux cordes dans une corde et celui de séparation d’une corde en deux cordes. Ils contiennent toutes les interactions du Modèle Standard plus la gravitation. La théorie des cordes ne se contente pas d’offrir une description quantique de la gravitation, mais elle a comme ambition l’unification de toutes les interactions dans une seule théorie. Le seul paramètre de la théorie des cordes est l’échelle de masse, ( ou l’échelle de longueur, ). La théorie des cordes pourraient expliquer les valeurs des masses des particules élémentaires, qui apparaissent dans le Modèle Standard comme des paramètres sans une justification théorique. D’autre part, il n’est pas facile d’obtenir des prédictions à basse énergie de la théorie des cordes. La cohérence quantique de la théorie des cordes impose que la dimension de l’espace-temps soit dix. Mais nous percevons un espace-temps quadri-dimensionel, ce qui implique que les six dimensions supplémentaires doivent être compactifiées à une échelle assez petite pour qu’elles soient invisibles aux énergies atteintes actuellement. Le nombre très grand des compactifications possibles rend difficile la question du contact avec la réalité.
Historiquement la théorie des cordes est apparue vers la fin des années 1960 comme une possible description des intéractions fortes[1]. Mais très vite elle a été abandonnée au profit de la chromodynamique quantique. Un des défauts de la théories des cordes en tant que théorie des interactions fortes était l’existence d’un état de masse nulle et de spin 2 dans le spectre, décrivant une particule sans équivalent dans le spectre des hadrons.
En 1974 Scherk et Schwarz proposent d’interpréter cette particule comme le graviton et la théorie des cordes devient un candidat à l’unification des interactions. Mais les modèles à intérêt phénoménologique, comme la théorie de type I, présentaient des anomalies gravitationnelles et de jauge.
Dix ans plus tard Green et Schwarz proposent un mécanisme[14] d’annulation des anomalies qui impose que le groupe de jauge de la théorie de type I soit SO(32). Une deuxième possibilité pour le groupe de jauge qui permet l’annulation des anomalies est , mais elle est incompatible avec la théorie des cordes ouvertes. Gross, Harvey, Martinec and Rohm montrent une année plus tard que ce groupe de jauge, ainsi que peuvent être réalisés dans une théorie de cordes fermées, la corde hététrotique[3].
Une dizaine d’années plus tard l’introductions des D-branes[54] par Polchinski a rendu possible la conjecture des dualités entre différentes théories des cordes qui apparaissent comme des différentes régions dans l’espace des modules d’une théorie unique, la M-théorie, ouvrant la voie à une formulation nonperturbative de la théorie des cordes.
Un des défis actuels de la théorie des cordes est d’obtenir des prédictions à basse énergie qui pourraient valider la théorie des cordes comme une description de la nature. En particulier il est nécessaire d’obtenir le Modèle Standard comme limite de basse énergie de la théorie des cordes et expliquer pourquoi la nature a choisi cette compactification parmi toutes les possibilités. Les modèles actuels présentent des caractéristiques prometteuses, comme la brisure de la supersymétrie, la présence des fermions chiraux, le bon nombre de générations. Mais ces modèles restent à améliorer.
Récemment une autre voie a été explorée, les prédictions en cosmologie de la théorie des cordes. La théorie des cordes est un cadre naturel pour formuler des questions liées à la cosmologie, comme le problème de la constante cosmologique ou la singularité du Big Bang. Les dix dernières années des modèles explicites ont été proposés qui pourraient résoudre certains des problèmes de la cosmologie standard, comme le modèle du pre-Big Bang, l’univers ekpyrotic et l’inflation des branes.
La supersymétrie apparaît de manière naturelle en théorie des cordes et elle permet d’éliminer le tachyon présent dans le spectre des cordes bosoniques. Les théories des cordes supersymétriques sont bien connues, mais pour que la théorie des cordes soit une extension du Modèle Standard il faut que la supersymétrie soit brisée. Généralement la brisure de supersymétrie reintroduit des tachyons dans le spectre, toutefois il existe des modèles de cordes nonsupersymétriques sans tachyons et qui présentent toutes les propriétés intéressantes des cordes supersymétriques, comme l’absence d’anomalies, la présence des fermions chiraux et la possibilité d’avoir un groupe de jauge intéressant.
Les cordes nonsupersymétriques sont particulièrement intéressantes pour la cosmologie, car la brisure de supersymétrie entraîne une redéfinition du vide de la théorie, l’espace de Minkowski n’étant plus une solution. Les solutions des cordes nonsupersymétriques peuvent dépendre du temps et décrire, donc, une évolution cosmologique. De plus, la stabilisation des modules des cordes, nécessaire pour avoir une cosmologie statisfaisante, est, au moins partiellement, liée à la brisure de la supersymétrie. Le problème principal des solutions dépendantes du temps est leur stabilité.
Plan de la thèse. Le manuscrit de cette thèse est organisé en cinq parties:
-
Le premier chapitre est une introduction générale à la théorie des cordes bosoniques et fermioniques, aux interactions des cordes, ainsi qu’à la notion de -brane. Les dualités entre les différentes théories des cordes sont présentées et une discussion des annulation des anomalies clôt le chapitre.
-
Le deuxième chapitre traite de la construction des orientifolds et orbifolds.
-
Le troisième chapitre presente le mécanisme de Scherk-Schwarz de brisure de supersymétrie.
-
Le quatrième chapitre présente d’abord une introduction au modèle standard de la cosmologie et aux problèmes non-résolus de ce modèle. Ensuite l’inflation est introduite comme une possible solution aux problèmes de la cosmologie standard.
-
Le dernier chapitre est dédié aux alternatives de l’inflation qui s’inspirent de la théorie des cordes et aux solutions dépendantes du temps des théories nonsupersymétriques des cordes.
Chapitre 1 Notions introductives
1.1 La corde bosonique
1.1.1 La corde bosonique classique
Une corde est un objet unidimensionel. En mouvement elle décrit une surface d’univers 111L’équivalent de la ligne d’univers pour une particule ponctuelle. parametrisée par deux coordonnées: une coordonnée de type temps, , et la coordonnée qui décrit la corde, . La surface d’univers d’une codre bosonique , plongée dans un espace-temps D dimensionel, est décrite par D fonctions scalaires . L’action la plus simple, independante de la parametrisation, qui décrit un tel objet est proportionelle à l’aire de la surface d’univers et s’appelle l’action de Nambu-Goto[5][6]222L’analogue de l’action proportionelle au temps propre le long de la ligne d’univers pour une particule ponctuelle. :
| (1.1) |
où est le determinant de la métrique induite sur la surface d’univers, , est la surface de l’univers, , et 333Par la suite on va considerer la propagation des cordes dans l’espace-temps de Minkowski, donc . est la métrique de l’espace-temps. La constante , appellée paramètre de Regge, est reliée à la tension, , de la corde :
| (1.2) |
En plus de l’invariance sous les reparametrisations, , l’action de Nambu-Goto est invariante sous le groupe de Poincaré à D dimensions :
| (1.3) |
où est une transformation de Lorentz et une translation.
La présence de la racine carré rend la quantification difficile, mais l’action de Nambu-Goto peut être simplifiée en introduisant une métrique independante, , sur la surface d’univers. La nouvelle action qu’on obtient de cette manière s’appelle l’action de Polyakov444Bien quelle ait été trouvée pour la première fois par Brink, Di Vecchia, Howe, Deser et Zumino , c’est Polyakov qui a mis en évidence son utilité pour la quantification. :
| (1.4) |
Bien évidemment l’action de Polyakov est classiquement équivalente à celle de Nambu-Goto et pour s’en convaincre il suffit d’éliminer la métrique de l’action de Polyakov à l’aide de son equation de mouvement :
| (1.5) |
L’equation (1.5) se réécrit :
| (1.6) |
ce qui implique que et l’équivalence des deux actions s’en suit. L’équation (1.6) determine à une transformation de Weyl près ce qui fait que l’action de Polyakov possède une invariance de plus par rapport à l’action de Nambu-Goto. En résumé les symétries classiques de l’action de Polyakov sont555Il y a un autre terme qui est compatible avec les symétries de l’action de Polyakov, , avec le scalaire de Ricci de la métrique . Ce terme joue un rôle important dans les interactions des cordes, mais ne contribue pas aux équations de mouvement, car en 2 dimensions est une dérivé totale. :
-
i.)
l’invariance sous le groupe de Poincaré D dimensionel :
-
ii.)
l’invariance sous les difféomorphismes(ou reparamétrisations) :
-
iii.)
l’invariance de Weyl:
La variation de l’action par rapport à définit le tenseur énergie-impulsion :
| (1.7) |
et, par conséquent, l’équation de mouvement de s’écrit :
| (1.8) |
L’invariance sous les transformations de Weyl implique l’annulation de la trace du tenseur énergie-impulsion, , et l’invariance sous les reparamétrisations a comme conséquence sa conservation: .
Intéressons-nous maintenant aux équations du mouvement des champs . En variant l’action de Polyakov par rapport à on obtient :
| (1.9) | |||||
où est la longueur de la corde. Le terme de bord s’annule dans les situations suivantes:
-
1.
.
Ces conditons de périodicité définissent la corde fermée. -
2.
.
Ce sont ce qu’on appelle les conditions de Neumann et elles définissent une corde ouverte avec les extrémités libres. -
3.
.
Ces conditions, appelées conditions de Dirichlet, brisent l’invariance de Poincaré. Elles définissent une corde ouverte avec les extrémités fixées. -
4.
On peut également choisir une condition de Dirichlet pour une extrémié de la corde ouverte et une condition de Neumann pour l’autre extrémité. Par exemple: et .
L’équation de mouvement prend alors la forme :
| (1.10) |
Pour simplifier les équations du mouvement on peut faire un choix de jauge convenable. L’invariance sous les reparamétrisations permet de fixer 2 des 3 composantes de la métrique bi-dimensionelle . La métrique peut alors être mise sous la forme :
| (1.11) |
Dans cette jauge, appellée jauge conforme, l’action devient :
| (1.12) |
et l’équation de mouvement des champs devient l’équation d’onde à 2 dimensions :
| (1.13) |
Les contraintes prennent aussi une forme très simple 666Nous avons utilisé les notations et . :
| (1.14) | |||
| (1.15) |
ou exprimés autrement .
La solution générale de l’équation (1.13) peut être écrite comme la somme de deux fonctions arbitraires :
| (1.16) |
avec , les coordonnées du cône de lumière sur la surface d’univers. décrit les modes qui se propagent à gauche ( pour "left") et les modes qui se propagent à droite ( pour "right").
Dans les coordonnées du cône de lumière les contraintes se réécrivent :
| (1.17) |
La solution générale de l’équation de mouvement (1.13) en tenant compte des conditions de périodicité pour les cordes fermées, est :
| (1.18) |
où sont les modes de Fourier, est la quantité de mouvement du centre de masse de la corde et la position du centre de masse. étant des fonctions réelles il en resulte que et sont réelles et également :
| (1.19) |
Pour une corde ouverte de longueur la solution de l’équation du mouvement avec les conditions aux bords est :
| (1.20) |
Par la suite les contraintes (1.17) doivent être imposées aux solutions des équations de mouvement. Leurs modes de Fourier, appellés operateurs de Virasoro, sont pour la corde fermée :
| (1.21) |
avec . Le système doit respecter les contraintes : . En particulier les contraintes
| (1.22) |
permettent de trouver l’expression de la masse d’un mode de la corde :
| (1.23) |
Pour les cordes ouvertes il y a un seul type d’opérateurs de Virasoro définis par :
| (1.24) |
où . Les contraintes de Virasoro sont dans ce cas et la masse d’un mode de la corde ouverte s’exprime :
| (1.25) |
A noter que l’Hamiltonian de la corde fermée s’écrit :
| (1.26) |
et donc .
Pour la corde ouverte il devient : .
1.1.2 Quantification de la corde bosonique
La quantification de la corde bosonique peut être effectuée de plusieures manières distinctes, mais équivalentes. Deux exemples seront exposés ici :
-
1.
La quantification covariante dans laquelle l’invariance de Lorentz est manifeste, mais qui présente le désavantage de la présence des états de norme négative, qui ne sont pas physiques.
-
2.
La quantification dans la jauge du cône de lumière qui est une approche où, comme son nom l’indique, des nouvelles restrictions de jauge sont imposées ce qui a l’avantage d’éliminer les états de norme négative, mais l’invariance de Lorentz n’est plus manifeste. Comme on le verra par la suite la condition que la théorie soit invariante de Lorentz fixe la dimension de l’espace-temps.
Dans la première approche on considère les fonctions comme des opérateurs quantiques. Par conséquent ils obeissent aux rélations de commutation habituelles :
| (1.27) |
où est le moment conjugué.
La relation (1.27) détermine les commutateurs pour les modes de Fourier de 777Pour la corde ouverte les sont absentes. :
| (1.28) |
Les opérateurs sont reliés aux opérateurs canoniques de l’oscillateur harmonique par :
| (1.29) |
Les modes de fréquence négative, sont des opérateurs d’annihilation et les modes de fréquence positive sont des opérateurs de création. L’opérateur nombre pour le mode est alors 888Le symbole :: dénote l’ordre normale qui consite à placer les modes de fréquence négative à droite des modes de fréquence positive..
L’état fondamental est défini par :
| (1.30) |
Il est alors facile de voir que des états de norme négative apparaissent. Comme il en résulte que tous les états de la forme sont de norme négative: . Néanmoins on peut espérer que les contraintes de Virasoro élimineront ces états de l’espace de Hilbert. Les opérateurs de Virasoro quantiques sont définis par leurs expressions classiques, mais avec l’ordre normal :
| (1.31) |
et de même pour les . Ceci ne pose pas de problème pour car, dans ce cas, et commutent. Ceci n’est plus le cas pour et pour résoudre l’ambiguité on va inclure une constante à déterminer dans toutes les formules contenant . Par conséquent un état physique, , de la corde ouverte, par exemple, devrait satisfaire a priori les conditions suivantes :
| (1.32) |
Les opérateurs satsifont l’algébre de Virasoro :
| (1.33) |
La constante s’appelle charge centrale et elle est égale à la dimension de l’espace-temps pour la corde bosonique. Le terme apparaît comme un effet quantique et est responsable du fait qu’on ne peut pas implementer dans la théorie quantique toutes les contraintes classiques. En effet :
| (1.34) |
donc on ne peut pas imposer . Le maximum des conditions qu’on peut imposer sur les états physiques est :
| (1.35) |
pour la codre ouverte. En fait les conditions (1.35) englobent toutes les contraintes, car en vertu de la relation on a :
| (1.36) |
Pour la corde femée il faut imposer également les contraintes . Les opérateurs satisfont aussi une algèbre de Virasoro et commutent avec les .
Avec la nouvelle forme de la contrainte générée par l’opérateur de masse pour la corde ouverte devient :
| (1.37) |
avec .
Pour la corde fermée les conditions et impliquent ou plus simplement 999On rappelle que .. C’est ce qu’on appelle la condition de raccordement des niveaux(level matching). L’opérateur de masse est donné par :
| (1.38) |
Il peut être montré que dans le cas où la dimension de l’espace-temps est et les états de norme négative découplent[53]. Nous allons prouver le fait que et dans le cadre de la quantification dans la jauge de lumière. L’approche consiste à choisir une jauge dans laquelle les contraintes de Virasoro peuvent être explicitement résolues pour que la théorie soit décrite en terme des états physiques uniquement. Pour la quantification covariante nous avons choisi une jauge dans laquelle la métrique sur la surface de l’univers est conformement plate :
| (1.39) |
mais ceci ne fixe pas complètement la jauge car toutes les transformations du type peuvent être compensées par une transformation de Weyl et ne changent pas la jauge. La transformation de :
| (1.40) |
implique que satisfait l’équation d’onde à 2 dimensions :
| (1.41) |
Rappelons que les champs satisfont également cette équation, on peut donc faire une reparametrisation de manière à ce que soit égal à un des . La jauge du cône de lumière correspond au choix ou autrement :
| (1.42) |
Les coordonnées du cône de lumière de l’espace-temps sont définies par: .
Ayant fixé on peut exprimer en fonction des coordonnées transverses à partir des contraintes de Virasoro, :
| (1.43) |
ce qui détermine les :
| (1.44) |
Dans la jauge du cône de lumière toutes les excitations de la corde sont générées par les oscillateurs transverses (et les pour les cordes fermées). Les différents états des cordes sont obtenus en agissant avec les opérateurs de création sur l’état fondamental . Par exemple le premier état excité de la corde ouverte est qui est un vecteur avec composantes. Il appartient à la représentation vectorielle du petit groupe . Sous une transformation de Lorentz un vecteur avec une polarisation transverse peut aquérir également une polarisation longitudinale, sauf s’il est non massif. Pour que la théorie soit invariante de Lorentz il faut donc que cet l’état soit de masse nulle. En utilisant la formule de l’opérateur de masse pour les cordes ouvertes (1.37) on trouve :
| (1.45) |
On peut voir mainenant que l’état fondamental de la corde ouverte, de masse est un tachyon. Ceci est également le cas pour les cordes fermées dont l’état fondamental a la masse . Le premier état excité des cordes fermées est donné par . Ceci est un tenseur de masse nulle, , qui se décompose en représentations irreductibles de : un tenseur antisymétrique, , un tenseur symétrique de trace nulle, , correspondant à une particule de spin deux et sans masse, le graviton, et un champ scalaire, , appelé dilaton.
Nous avons vu que pour respecter l’invariance de Lorentz la constante doit être égale à 1. Mais cette constante est reliée à la dimension de l’espace-temps. Pour voir cela on peut calculer à partir de la formule :
| (1.46) |
La somme divergente peut être calculée par la méthode de régularisation de la fonction zeta 101010La formule générale est . et vaut . Par conséquent , donc la dimension de l’espace temps est 26.
1.2 Cordes supersymétriques
Les cordes bosoniques ne permettent pas la description des fermions de l’espace-temps et, par conséquent, ne sont pas de bons candidats pour une description de la réalité. En plus, l’état fondamental pour les cordes bosoniques, ouvertes ou fermées, est tachyonique, ce qui indique une instabilité. Introduire des dégrées de liberté fermioniques pourrait résoudre ce probléme, car la masse négative de l’état fondamental provient de l’énergie du point zéro des oscillateurs bosoniques et les dégrées de liberté fermioniques apportent, en principe, une contribution de signe opposé.
Le procédé de construction de la corde fermionique consiste à introduire des spineurs sur la surface d’univers, qui seront les superpartenaires des champs . La supersymétrie sur la surface d’univers est manifeste, mais, en revanche, la supersymétrie de l’espace-temps n’est pas garantie. Dans le formalisme de Ramond[9], Neveu et Schwarz[10] la supersymétrie de l’espace-temps est obtenue après troncation du spectre par la projection dite GSO (Gliozzi, Scherk et Olive)[11]. Il existe un deuxième formalisme, de Green et Schwarz[14], dans lequel la supersymétrie de l’espace temps est manifeste, mais pas celle de la surface d’univers. Le premier formalisme sera adopté dans la suite.
1.2.1 La corde fermionique classique
L’action de Polyakov (1.4) pour la corde bosonique représente champs scalaires couplés à la métrique, à deux dimensions. La généralisation supersymétrique de cette action necessite l’introduction des partenaires supersymétriques de et .
En dimensions les champs représentent degrés de liberté bosoniques. En introduisant spineurs de Majorana sur la surface d’univers, , on obtient degrés de liberté fermioniques "on-shell"111111Un spineur de Dirac sur la surface d’univers représente 4 degrés de liberté fermioniques. La condition de Majorana et l’équation de mouvement divisent chaqune le nombre de degrés de liberté par 2.. "Off-shell" il faut introduire champs scalaires auxiliares pour former un multiplet scalaire avec supersymétrie en dimension deux. Le gravitino, partenaire supersymétrique du , est un spineur-vecteur de Majorana, représentant 2 degrés de liberté fermioniques "off-shell"121212Deux des quatre degrés de liberté sont éliminés par les transformations de supersymétrie.. représentant un seul degré de liberté bosonique 131313Deux des trois degrés de liberté de la métrique pouvant être éliminés par les reparametrisations à 2 dimensions comme on l’a vu précédement. il faut introduire un champ scalaire auxiliare. "On-shell" le graviton et le gravitino suffisent.
La généralisation supersymétrique de l’action (1.4) est :
| (1.47) |
où est le gravitino et sont les matrices de Dirac à 2 dimensions :
| (1.52) |
L’action (1.47) est invariante sous les transformations de supersymétrie :
| (1.53) |
où est un spineur de Majorana qui paramétrise la supersymétrie.
La jauge superconforme, l’équivalent supersymétrique de la jauge conforme (1.11) du cas bosonique, est définie par les conditions :
| (1.54) |
avec . Dans cette jauge (1.47) devient l’action de champs scalaires et champs fermioniques libres :
| (1.55) |
Les champs satisfont l’équation d’onde à deux dimensions, comme dans le cas bosonique, et l’équation de mouvement pour les champs est l’équation de Dirac de masse nulle :
| (1.56) |
Les équations de mouvement doivent être supplementées par les conditions aux bords et les contraintes, qui sont les équations de la métrique et du gravitino. Les conditions aux bords pour les coordonnées bosoniques sont les mêmes que dans le cas de la corde bosonique. Pour les champs fermioniques ces conditions résultent de l’annulation du terme de surface :
| (1.57) |
Le tenseur énergie impulsion prend la forme :
| (1.58) |
La variation du gravitino dans l’action produit le supercourant :
| (1.59) |
Les contraintes à imposer aux états physiques sont alors :
| (1.60) |
Comme dans le cas bosonique on va utiliser les coordonnées du cône de lumière sur la surface d’univers, et . L’action et les équations de mouvement se réécrivent :
| (1.61) |
| (1.62) |
La solution pour est à nouveau la somme de deux fonctions arbitraires et et le développement en oscillateurs est le même que dans le cas bosonique, alors que pour les coordonnées fermioniques on obtient: et . Pour les cordes fermées la condition de périodicité s’écrit dans les coordonnées du cône de lumière , ce qui revient aux conditions :
| (1.63) |
et de même pour . On appelle conditions de Ramond (R) celles de périodicité et conditions de Neveu-Schwarz(NS) celles de antipériodicité. Plus brièvement les fermions sur la surface d’univers respectent la condition :
| (1.64) |
avec pour le secteur de Ramond et pour le secteur de Neveu-Schwarz. Avec cette condition la solution générale de l’équation de Dirac s’écrit :
| (1.65) |
avec et pour assurer la réalité des spineurs de Majorana .
Dans les coordonnées du cône de lumière les contraintes prennent la forme :
| (1.66) |
et leurs modes de Fourier sont donnés par :
| (1.67) |
1.2.2 Quantification de la corde fermionique
Les rélations de commutation (1.27) doivent être complétées par les anticommutateurs :
| (1.68) |
ce qui implique pour les oscillateurs fermioniques :
| (1.69) |
Remarquons que les modes zero satisfont l’algèbre de Clifford :
| (1.70) |
L’opérateur nombre d’oscillateurs est donné par :
| (1.71) |
Les opérateurs de Virasoro doivent être redéfinis en utilisant l’ordre normal et une constante, , doit être rajoutée dans les formules contenant . Ils satisfont l’algèbre de super-Virasoro :
| (1.72) |
L’état fondamental est défini par :
| (1.73) |
Dans le secteur de Neveu-Schwarz l’état fondamental est un scalaire comme pour la corde bosonique. Ceci n’est plus le cas dans le secteur de Ramond à cause de l’existence du mode dans ce secteur. Il faut remarquer que commute avec l’opérateur de masse, , ce qui implique que les états et ont la même masse. En se rappellant que sont les générateurs de l’algèbre de Clifford on peut conclure que l’état fondamental dans le secteur de Ramond est un spineur de l’espace-temps. Comme les oscillateurs et sont des vecteurs de l’espace-temps il en résulte que tous les états construits à partir de l’état fondamental de Neveu-Schwarz sont des bosons de l’espace-temps et que tous les états construits à partir de l’état fondamental de Ramond sont des fermions de l’espace-temps.
Des états de norme négative sont à nouveau présents dans le spectre et il est instructif d’étudier la quantification dans la jauge du cône de lumière qui est donnée par les conditions:
| (1.74) |
Les contraintes permettent d’exprimer les oscillateurs et en fonctions des modes transverses et et les états de la corde sont construits en utilisant seulement les oscillateurs transverses.
Le spectre de la corde ouverte (qui équivaut à celui des modes de gauche ou de droite de la corde fermée à un facteur près dans la formule de la masse) est donné par:
1.) Le secteur de Neveu-Schwarz: l’état fondamental, , est un scalaire de masse . Le premier état excité, , est donné par avec la masse . Ceci est un vecteur de et l’invariance de Lorentz impose qu’il soit de masse nulle, c.a.d. . L’état fondamental est encore une fois tachyonique. D’autre part la constante de l’ordre normale vaut , qui, en utilisant la régularisation de la fonction , donne le résultat . On en déduit que la dimension de l’espace-temps vaut .
Les états avec sont , qui est un vecteur de , et , tenseur antisymétrique de , avec la masse . Ces dégrés de liberté bosoniques forment un tenseur antisymétrique de , qui est le petit groupe des états massifs en dix dimensions.
Au niveau on obtient des états de masse :
, et , soit un total de 128 états.
2.) Le secteur de Ramond: l’état fondamental est, comme on l’a vu, un spineur. En 10 dimensions on peut imposer simultanément les conditions de Weyl et Majorana, ce qui conduit à 8 dégrés de liberté fermioniques indépendants "on-shell", qui représentent les composantes d’un spineur de Majorana-Weyl, de masse nulle, du groupe . La masse de l’état fondamental étant donnée par il résulte que . Il y a deux possibilités pour la chiralité de ce spineur conduisant à deux états possibles et . Le niveau est formé des états , , et de masse , soit états.
À ce niveau le spectre obtenu n’est pas supersymétrique, mais la projection permet d’obtenir la supersymétrie. D’abord il faut éliminer le tachyon du secteur NS, ainsi que tous les états de masse qui n’ont pas d’équivalent dans le secteur de Ramond. Il s’agit, donc, d’éliminer tous les états avec un nombre pair d’oscillateurs de type , c.a.d. tous les bosons ( par rapport à la surface d’univers) du secteur NS. Le projecteur dans le secteur NS est défini par :
| (1.75) |
avec le nombre fermionique sur la surface d’univers.
Ensuite on remarque que pour obtenir l’équilibre entre le nombre des dégrés de liberté fermioniques (R) et bosonique (NS) pour les états de masse nulle, par exemple, il est nécessaire d‘éliminer un des états ou . L’opérateur qui permet d’effectuer cette opération est
| (1.76) |
où est l’opérateur de chiralité dans les dimensions transverses et le nombre fermionique sur la surface d’univers dans le secteur de Ramond. En demandant pour tous les états (ou pour tous les états) on élimine la moitié des dégrés de liberté en rétablissant l’équilibre avec les bosons du secteur NS.
Pour obtenir le spectre des cordes fermées il faut combiner les modes de droite avec celles de gauche en tenant compte de la contrainte , ou autrement . Quatre secteurs apparaissent : (NS,NS) et (R,R), qui conduisent à des bosons de l’espace-temps, et (NS,R), (R,NS) qui contiennent les fermions de l’espace-temps. La projection peut être effectuée séparément pour les modes de droite et de gauche ce qui donne la possibilité de choisir indépendemment la projection dans le secteur R: ou .
Avec le premier choix on obtient la théorie appellée IIB dont le spectre non massif est donné par :
secteur (NS,NS): un scalaire (le dilaton), le graviton, , et un tenseur antisymétrique, .
secteur (R,R): une zero forme, , une 2-forme, , et une 4-forme auto-duale, .
secteurs (R,NS) et (NS,R): deux gravitinos de spin avec la même chiralité et deux fermions de spin .
Le comptage des degrés de liberté fermioniques et bosoniques
(128) indique qu’il s’agit d’une théorie supersymétrique. La présence de deux
gravitions avec la même chiralité indique que la théorie IIB est une théorie chirale avec supersymétrie .
Le choix conduit à la théorie IIA qui possède au niveau non massif les états :
secteur (NS,NS): un scalaire (le dilaton), le graviton, , et un tenseur antisymétrique, .
secteur (R,R): une 1-forme, et une 3-forme, .
secteurs (R,NS) et (NS,R): deux gravitinos de spin avec des chiralités opposées et deux dilatinos de spin , un pour chaque chiralité.
La théorie IIA est une théorie non chirale avec supersymétrie .
1.3 Développement de Polyakov
L’integrale de chemin de Feynman est une méthode naturelle pour décrire les interactions en théorie des cordes. En mécanique quantique les amplitudes sont obtenues en sommant sur toutes les trajectoires possibles qui relient les états initials et finals, chaque trajectoire étant pondérée par un facteur , où est l’action classique.
Polyakov a généralisé ce procedé à la théorie des cordes[8]: une amplitude des cordes est obtenue en sommant sur toutes les surfaces d’univers qui relient les courbes initiales et finales.
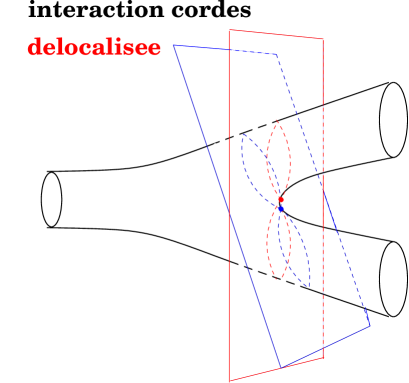
Les interactions des cordes sont implicites dans la somme sur les surfaces d’univers. Par exemple la figure (1.1) montre la désintegration d’une corde fermée en deux cordes. Les particules sont obtenues comme des différentes états d’excitation des cordes et toutes les interactions du Modèle Standard apparaissent à partir de ce type d’intéraction.
Comme on peut le voir sur cette figure (1.1) la désintegration semble avoit lieu à des différents points de l’espace selon le repère de Lorentz choisi. L’interaction est "étendue" dans l’espace, ce qui pourrait résoudre les divergences de la gravité quantique.
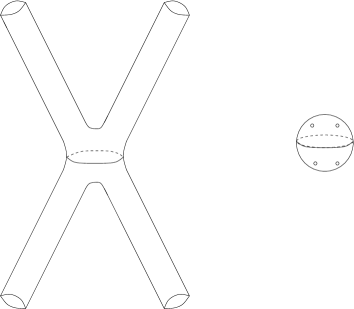
La somme sur les surfaces d’univers qui relient des courbes initiales et finales conduit à des amplitudes difficiles à calculer. Le calcul se simplifie lorsque les sources sont envoyées à l’infini. Dans ce cas l’invariance conforme de la théorie sur la surface d’univers rend équivalentes une surface d’univers avec des cordes externes et une surface compacte avec des insertions ponctuelles, comme la figure (1.2) le montre.
Pour calculer une amplitude il faut intégrer sur toutes les métriques possibles de la surface d’univers, , et toutes les possibilités de plonger la surface d’univers dans l’espace-temps, 141414Nous avons remplacé la métrique minkowskienne sur la surface d’univers avec une métrique euclidienne. :
| (1.77) |
avec
| (1.78) |
où :
| (1.79) |
est le nombre d’Euler de la surface d’univers qui pour une surface avec poignées, frontières et crosscaps151515Un crosscap est une frontière avec les points diamétralement oppposés identifiés. vaut .
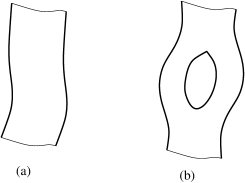
On peut remarquer que si on ajoute une frontière sur une surface d’univers (fig 1.3), ce qui équivaut à l’émission suivie de l’absorption d’une corde ouverte, le nombre d’Euler diminue d’une unité et dans l’intégrale de chemin il y aura un facteur de plus. Il en résulte que l’amplitude pour émettre une corde ouverte est proportionnelle à . De la même façon on peut voir que le fait d’ajouter une poignée sur la surface d’univers équivaut à l’émission suivi de l’absorption d’une corde fermée et, en même temps, diminue le nombre d’Euler de 2 unités. L’amplitude d’émission pour une corde fermée est, donc, proportionnelle à .
La constante de couplage en théorie des cordes est reliée à , qui semble être un paramètre libre de la théorie. Mais si on veut généraliser l’action des cordes dans l’espace de Minkowski à une action décrivant la propagation des cordes dans un espace-temps courbe on se rend compte qu’en plus du remplacement de la métrique de Minkowski avec une métrique générale , il faut inclure des couplages aux autres états de masse nulle des cordes, car le graviton n’est qu’un états de cordes parmi d’autres. Autrement dit il faut inclure des couplages au tenseur antisymétrique et au dilaton :
| (1.80) |
On peut voir à partir de l’action (1.78) que les différentes valeurs du paramètre correspondent , en fait, à des différents fonds d’une seule théorie et non pas à des théories différentes. La constante de couplage des cordes est donnée par la valeur moyenne dans le vide du dilaton :
| (1.81) |
L’intégrale de chemin (1.77) comporte un comptage erroné car les configurations reliés par les difféomorphismes et par la transformation de Weyl décrivent la même physique et devraient être comptées une seule fois. Pour cela il faut diviser la mesure d’intégration par le volume des groupes de symétrie:
| (1.82) |
La mesure d’intégration correcte s’obtient par la méthode de Faddeev-Popov.
Les reparamétrisations et l’invariance de Weyl permettent de fixer complètement la métrique à une valeur . La mesure de Faddeev-Popov, , est définie par:
| (1.83) |
où dénote une transformation sous les reparamétrisations combinée avec une transformation de Weyl et est une mesure invariante de jauge. En insérant (1.83) dans l’intégrale de chemin on obtient:
| (1.84) |
Après intégration sur et une transformation de jauge l’intégrale de chemin devient:
| (1.85) |
On peut effectuer l’intégrale sur qui se simplifie avec le volume du groupe de jauge, le résultat étant:
| (1.86) |
Le déterminant de Faddeev-Popov vaut[53]:
| (1.87) |
où , avec et des fantômes de Grassmann.
1.4 Compactification toroidale, T-dualité, D-branes
Nous avons vu que la corde bosonique et la supercorde prédisent une dimension de l’espace-temps plus grande que , qui est la dimension de notre espace-temps, telle qu’elle est perçue à l’heure actuelle. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les dimensions supplémentaires sont compactifiées à une échelle très réduite qui rend impossible leur détection aux énergies actuelles.
Ici on va considérer le cas le plus simple, à savoir la compactification d’une coordonnée sur un cercle pour la corde bosonique :
| (1.88) |
La périodicité implique que l’impulsion du centre de masse de la corde est quantifiée, comme pour la compactification de Kaluza-Klein en théorie des champs :
| (1.89) |
En théorie des cordes la compactification a un deuxième effet. Une corde fermée peut s’enrouler autour de la dimension compacte:
| (1.90) |
s’appelle nombre d’enroulement (winding number) et représente le nombre de tours effectués par la corde autour de la dimension .
Le développpement en oscillateurs pour la coordonnée compacte est donné par :
| (1.91) |
qui, en utilisant la formule (1.18) permet de determiner :
| (1.92) |
Les opérateurs de Virasoro et sont donnés par161616A noter que n’implique plus , mais . :
| (1.93) |
et l’opérateur de masse devient :
| (1.94) | |||||
On peut voir à partir de cette formule que lorsque les modes d’enroulement deviennent infiniment massifs et les valeurs de l’impulsion compacte tendent vers un spectre continu, comme pour une dimension non-compacte. Dans la limite ce sont les valeurs de l’impulsion qui deviennent infinies et les modes d’enroulement qui tendent vers un continuum, ce qui ressemble à nouveau au spectre d’une dimension non-compacte. En fait les deux limites sont équivalentes, ce qui n’est pas le cas en théorie des champs où il n’y a pas l’équivalent du nombre d’enroulement. L’invariance du spectre sous la transformation :
| (1.95) |
s’appelle T-dualité. L’équivalence des limites et en théorie des cordes montre que la géométrie de l’espace-temps à courte distance est vue différemment par les cordes et par les particules ponctuelles. Les théories inéquivalentes sont celles pour lesquelles .
Échanger et revient à une parité sur l’impulsion et, implicitement, sur la coordonnée . Après la T-dualité la théorie est décrite en termes de la coordonnée .
La T-dualité agit de manière non-trivialle sur le dilaton. Le couplage de la théorie compactifiée doit être invariant sous la T-dulaité. Ce couplage est obtenu en integrant l’action de la théorie à 26 dimensions sur la coordonnée compacte, il sera, donc, proportionnel au périmètre du cercle et, donc, au rayon . Il en résulte que doit être invariant sous la T-dualité, ce qui implique la transformation suivante pour :
| (1.96) |
Pour les cordes ouvertes il n’y a pas de nombre d’enroulement car les conditions aux bords de Neumann indiquent que les bouts des cordes ouvertes se dépalcent librement dans l’espace ce qui permet toujours de dérouler la corde de la dimension compacte. Dans la limite on n’obtient pas un continuum d’états comme pour la corde fermée. Après la T-dualité les cordes ouvertes se déplacent en 25 dimensions. L’interpretation de ce fait est que les cordes ouvertes vibrent toujours à 26 dimensions, mais que leurs bouts sont contraints à appartenir à une hypersurface 25-dimensionnelle. En effet, la théorie T-duale étant décrite en utilisant la coordonnée , la condition de Neumann dans cette direction devient, après la T-dualité, une condition de Dirichlet :
| (1.97) |
Les hypersurfaces auxquelles les bouts des cordes ouvertes sont restreintes sont des nouveaux objets dynamiques appelés -branes. En effectuant des T-dualités sur coordonnées on obteint une -brane, un objet avec dimensions spatiales. Comme la T-dualité échange les conditions aux bords Neumann et Dirichlet il en résulte qu’en effectuant une T-dualité le long d’une coordonnée parallèle à une -brane on la transforme en une -brane, alors qu’une T-dualité dans une direction perpendiculaire à la brane la transforme dans une -brane.
Par analogie avec le cas de la corde l’action effective pour une -brane pourrait s’écrire :
| (1.98) |
où sont les coordonnées qui paramétrisent la brane et est la métrique induite sur la brane :
| (1.99) |
est la tension de la -brane, donnée par :
| (1.100) |
avec la masse de Planck et la valeur moyenne du dilaton dans le vide.
La dependance dans le dilaton, , intervient puisqu’il s’agit d’une action des cordes ouvertes au niveau des arbres, la première contribution venant du disque().
La métrique (1.98) fait intervenir les champs qui décrivent le plongement de la brane dans l’espace-temps et leur couplage à la métrique induite. Il n’y a aucune raison pour ne pas inclure des couplages aux autres états de masse nulle des cordes fermées et ouvertes: le tenseur antisymétrique, , qui doit apparaître dans l’action comme le tenseur induit, :
| (1.101) |
et le champ de jauge . Ces champs apparaissent dans l’action des cordes sur la surface d’univers comme :
| (1.102) |
Cette action est invariante sous la transformation de jauge de l’espace-temps . Par contre la transformation de jauge conduit à un terme de surface non nul qui peut être annulé si se transforme sous la symétrie de jauge de comme: . La combinaison , avec , est invariante sous les deux transformations de jauge. C’est cette combinaison qui doit apparaître dans l’action. Par conséquent l’action de la brane s’écrit :
| (1.103) |
(1.103) s’appelle l’action de Born-Infeld.
Une -brane couple naturellement à une forme :
| (1.104) |
où est la charge de la brane, appelée charge de Ramond-Ramond (RR), car les formes apparaissent dans le secteur (R,R) du spectre des cordes fermioniques. L’action (1.104) représente le couplage "électrique". La duale d’une forme étant une forme il existe également un couplage "magnétique" à une brane.
Une antibrane, , a la même trension qu’une brane et la charge opposée.
Les branes et les antibranes sont des objets BPS, c’est à dire qu’elles préservent une partie de la supersymétrie. Plus précisement les branes brisent la moitié des supersymétries et les antibranes brisent l’autre moitié. La combinaison brane-antibrane brise complètement la supersymétrie et forme un système non-BPS.
La théorie de type IIB contient des branes BPS avec dimension impaire et la théorie de type IIA conteint les branes BPS de dimension paire. En plus la théorie de type IIB contient des branes non-BPS de dimension paire et la théorie IIA contient des branes non-BPS de dimension impaire[12]. Une -brane non-BPS en théorie IIB est définie comme une combinaison d’une brane BPS et une brane BPS de la théorie IIA soumise à l’opération , avec le nombre fermionique gauche de l’espace-temps. Par cette transformation la théorie IIA est transformée dans la théorie IIB. Comme cette opération change le signe des champs du secteur (R,R) et que les branes sont chargées sous un champ RR, il en résulte qu’une - brane se transforme en une antibrane et inversement. Par conséquent le système brane-antibrane est invariant sous cette transformation. De la même manière on peut définir des branes impaires non-BPS en théorie IIA. Etant construites à partir des paires brane-antibrane les branes non-BPS ne sont pas chargées sous les formes de RR. Leur tension est reliée à celle des branes BPS par
| (1.105) |
Les combinaisons brane-antibrane sont décrites en théorie IIB par l’amplitude de l’anneau 171717Pour les notations voir le chapitre 2.[13]:
| (1.106) |
avec le nombre de branes et le nombre d’antibranes. Les caractères se décomposent selon:
| (1.107) |
où le deuxième caractère de chaque produit décrit des degrés de liberté internes. Par exemple se décompose en un vecteur avec composantes et scalaires.
Après l’opération les branes et antibranes sont interchangées, ce qui implique en particulier une identification des facteurs de Chan-Paton :
| (1.108) |
Le facteur 2 dans l’amplitude confirme la relation (1.105). Le spectre contient un vecteur, un tachyon, scalaires et un fermion non-chiral dans l’adjointe du groupe de jauge .
Les théories de type I 181818Voir le chapitre 2 pour leur définitions., et , contiennent des , et branes BPS et des branes non-BPS pour les autres valeurs de . Pour pair les branes non-BPS sont obtenues à partir des branes non-BPS de la théorie IIB en agissant avec la projection d’orientifold. Les branes non-BPS , et sont obtenues à partir des paires brane-antibrane BPS de la théorie IIB. La brane non-BPS dans la théorie et la brane non-BPS dans la théorie sont stables, car leurs spectres ne contiennent pas des tachyons.
1.5 Dualités des cordes
Il existe 5 théories des cordes supersymétriques à 10 dimensions. Deux d’entre elles ont été discutées dans les sections précédentes: les théories de type IIA et type IIB. Ce sont des théories des cordes fermées orientées. Une troisième théorie est obtenue en jaugeant la parité sur la surface d’univers, , en théorie IIB. Cette nouvelle théorie, dite de type I, contient des cordes fermées et ouvertes non-orientées. Il existe aussi deux théories des cordes fermées, avec supersymétrie , dites les cordes hétérotiques[3]. Nous avons vu que pour les cordes fermées les secteurs gauche et droit sont pratiquement indépendants, n’étant reliés que par la condition de raccordement des niveaux. Ceci est le point de départ pour la construction de la corde hétérotique, qui est obtenue en mettant ensemble le secteur gauche de la corde bosonique en 26 dimensions avec le secteur droit de la corde fermionique à 10 dimensions. 16 des champs bosoniques de gauche, sont, en fait, des degrés de liberté internes et la théorie résultante est une théorie à 10 dimensions. Les champs vivent sur un tore 16-dimensionnel. Leurs impulsions prennent des valeurs discrètes et sont des vecteurs d’un réseau de dimension seize, :
| (1.109) |
où forment une base de vecteurs de . L’invariance modulaire à une boucle, qui sera discutée dans le chapitre suivant, impose des restrictions sur les réseaux possibles. doit être un réseau pair et auto-dual. À 16 dimensions il n’y a que deux choix possibles pour conduisant à deux théories différentes: la corde hétérotique et la corde hétérotique . Le spectre de masse nulle de ces théories contient les mêmes états que les secteurs (NS,NS) (graviton, tenseur antisymétrique et dilaton) et (NS,R) (gravitino et dilatino) des cordes de type I, plus les bosons de jauge de ou , obtenus par le produit tensoriel des modes bosoniques internes de gauche avec le secteur NS droit, et leurs partenaires supersymétriques, les jauginos(produit tensoriel des modes bosoniques internes de gauche avec le secteur R droit).
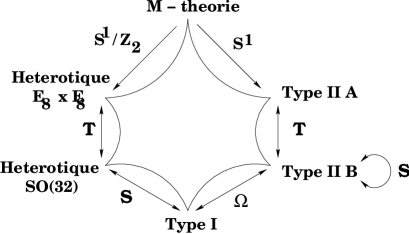
L’existence de cinq théories différentes mettait en danger l’unicité de la théorie des cordes. Mais en 1995 il a été conjecturé [16] qu’en fait ces cinq théories sont reliées par des dualités et pourraient être des différentes facettes d’une seule théorie, pas encore élucidée, la M-théorie. Cette idée a été suggérée par le fait que la limite de basse énergie de la théorie de type IIA peut être obtenue par réduction dimensionnelle de la théorie de supergravité à 11 dimensions. La M-théorie correspondrait à une théorie fondamentale qui est rélié à la limite de couplage fort de la théorie IIA et dont la limite de basse énergie serait la supergravité onze-dimensionnelle. La compactification de la M-théorie sur un cercle serait équivalente au couplage fort de la théorie IIA, alors que la compactification sur un intervalle avec deux bords sur lequels vivent des champs de jauge correspondrait à la corde hétérotique .
Les dualités qui relient les différentes théories de cordes supersymétriques en 10 dimensions sont :
-
a)
La T-dualité, discutée précédemment, qui rend équivalentes une théorie compactifiée sur un cercle de rayon et une théorie compactifiée sur un cercle de rayon . Sont reliées par cette dualité les théories de type IIA et IIB et également les deux théories de la corde hétérotique. La T-dualité est une symétrie perturbative, satisfaite à tous les ordres du développement en puissance de la constante de couplage . La T-dualité entre deux théories peut être verifiée ordre par ordre dans le développement perturbatif.
-
b)
La S-dualité, qui change le signe de la valeur moyenne du dilaton , rendant équivalents le régime de couplage faible d’une théorie avec le régime de couplage fort d’une autre théorie. La théorie de type IIB est auto-duale sous la S-dualité, et la théorie de type I est reliée par S-dualité à la théorie de la corde hétérotique . La S-dualité est de nature non-perturbative. La conjecture de S-dualité entre deux théories est établie en comparant l’action effective des modes de masse nulle qui est fixée par la supersymétrie et ne peut pas être modifiée par les corrections des boucles. Un autre outil est offert par le spectre des états BPS, comme les branes, par exemple, qui reste inchangé lorsque la constante de couplage varie.
1.6 Anomalies
Les symétries des théories classiques peuvent être brisées par des effets quantiques qu’on appelle des anomalies. Les anomalies proviennent des diagrammes de Feynman qui n’admettent pas des régulateurs compatibles avec la conservation simultanée de tous les courants attachés. L’interprétation des anomalies diffère selon s’il s’agit d’une symétrie globale ou locale qui est brisée. La brisure des symétries globales peut être utile dans certaines théories pour des raisons phénoménologiques. En revanche la brisure des symétries locales, comme l’invariance de jauge ou la covariance de la théorie , conduit à des inconsistances. Les anomalies apparaissent dans les théories chirales. En conséquece les anomalies existent seulement en dimension paire191919En dimension impaire on ne peut pas avoir des spineurs de Weyl.202020Des anomalies de parité peuvent exister en dimension impaire.. En dimension , le plus simple diagramme de Feynman, qui est potentiellement source d’anomalies, est une boucle avec bras externes. Pour les supercordes, , cela correspond à un diagramme hexagonal(fig 1.5). Les lignes externes peuvent être des bosons de jauge ou des gravitons et les lignes internes sont des fermions ou des bosons auto-duaux(ou anti-auto-duaux).
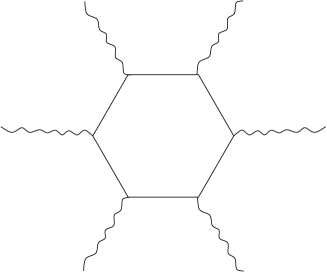
En dimension les anomalies sont représentées par des -formes, , qui sont des polynômes de et , où est le tenseur du champ de jauge et , avec la connexion de spin, est d’une certaine manière l’équivalent de pour la gravitation212121Pour une revue complète du formalisme des anomalies voir le volume 2 de ”Superstring Theory”, M.B. Green, J.M. Schwarz et E. Witten, Cambridge University Press, 1987.. est, par construction, invariante de jauge et exacte. Elle détermine localement une -forme, :
| (1.110) |
dont la variation sous les transformation de jauge est exacte, en conséquence de l’invariance de jauge de :
| (1.111) |
L’anomalie est déterminée comme l’intégrale de . La condition d’annulation des anomalies est donnée par .
Rappelons nous que la théorie de type IIB est une théorie chirale. Elle peut donc présenter des anomalies. La théorie IIB ne contient pas de bosons de jauge, les anomalies possibles sont, donc, de nature purement gravitationnelle.
En définissant :
| (1.112) |
les polynômes pour les anomalies gravitationelles sont données par222222Un facteur global a été enlevé dans les formules suivantes. :
-
i) pour un fermion chiral de spin 1/2:
(1.113) -
ii) pour un fermion chiral de spin 3/2:
-
iii) pour une tenseur auto-dual:
(1.114)
Ces expressions contiennent les contributions des anomalies pour les dimensions de la forme pour tout . Pour obtenir l’anomalie pour la dimensions il faut extraire de ces expressions les termes d’ordre . En revenant à la théorie IIB le spectre de la théorie de basse énergie contient un gravitino de Weyl, un spineur de Weyl de chiralité oposée et une 4-forme auto-duale. Leurs contributions :
| (1.115) |
au polynôme total d’anomalie: s’annulent complètement: . La théorie IIB est consistante.
Pour les théories qui contiennent des bosons de jauge il faut prendre en compte les anomalies de jauge ou mixtes. La formule utile dans ce cas est :
| (1.116) |
avec donné par (1.113). Par exemple la théorie de type I, qui sera présentée dans le chapitre suivant, contient des bosons de jauge et les anomalies de jauge et mixtes reçoivent une contribution venant des jauginos. Cette contribution est annulée par le mécanisme de Green-Schwarz [14]. Ce mécanisme consiste à introduire un nouveau couplage, qui n’est pas présent dans la supergravité minimale, du tenseur antisymétrique, , 232323En réalité, comme on le verra dans la chapitre suivant, le tenseur antisymétrique, , du secteur (NS,NS) est éliminé dans la théorie de type I, mais une 2-forme est toujours présente, la du secteur (R,R). aux bosons de jauge et/ou au graviton :
| (1.117) |
où est un expression générique pour les termes d’ordre 4, , , etc. Dans la supergravité minimale de type I il y a déjà un terme de couplage du tenseur aux bosons de jauge :
| (1.118) |
qui provient du terme . En effet dans la supergravité minimale N=1 en 10 dimensions, couplée à un système Yang-Mills, la supersymétrie impose que le tenseur de la 2-forme, , soit généralisé de à :
| (1.119) |
avec la 3-forme Chern-Simons, donnée par:
| (1.120) |
Le tenseur de , , est invariant sous une transformation de jauge:
| (1.121) |
ce qui implique la transformation de jauge suivante pour : , avec , . est invariante de jauge si est invariant de jauge, c’est à dire si n’est pas invariant de jauge. En revanche, est invariante de jauge si est invariant de jauge. et ne peuvent, donc, pas être invariants de jauge en même temps. Le diagramme de Feynman de la figure 1.6 contient les deux couplages et génére une contribution aux anomalies qui compense les anomalies de jauge et gravitationnelles venant du diagramme hexagonal.
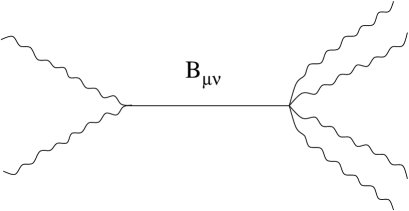
Les anomalies peuvent être compensées par le mécanisme de Green-Schwarz si le polynôme d’anomalies peut être factorisé sous la forme:
| (1.122) |
avec une constante et un polynôme d’ordre quatre en et . Comme est exacte il en résulte que est exact aussi. Il y a deux choix possibles pour . On a et, également, , où est donnée par une expression analogue à (1.120) en remplaçant par la connexion de spin, . Si on définit comme la forme la plus générale pour est donnée par:
| (1.123) |
où le dernier terme représente l’ambiguité dans la définition de avec un paramètre arbitraire. est alors obtenue, modulo une forme exacte, par , donc
| (1.124) |
avec et . L’anomalie, , est donnée par:
| (1.125) |
Cette anomalie peut être annulée par l’ajout dans le Lagrangian des termes:
| (1.126) |
et si la transformation de jauge pour le champ est généralisé à :
| (1.127) |
c’est à dire si le tenseur du est généralisé à :
| (1.128) |
Pour la théorie de Type I (et la corde hétérotique ) l’anomalie totale donnée par les diagrammes hexagonales est:
| (1.129) |
et explicitement pour jauginos:
| (1.130) | |||||
où designe la trace dans la représentation adjointe(les traces dans la représentation fondamentale sont notées ). Pour que l’anomalie (1.130) puisse être factorisée il faut que le coefficient de s’annule, c’est à dire que le groupe de jauge doit avoir 496 générateurs, . Ensuite en exprimant les traces dans la représentation adjointe en fonction de celles dans la réprésentation fondamentale, pour un groupe ,
| (1.131) |
on voit que pour le groupe il n’y a pas de contribution dans les anomalies. En plus ce groupe a générateurs. L’anomalie se factorise dans la forme (1.122) avec et
| (1.132) |
L’anomalie peut, donc, être annulée par le mécanisme de Green-Schwarz.
Un autre groupe avec 496 générateurs est ( possède 248 générateurs), qui correspond à la corde hététorique. Pour ce groupe est proportionnelle à et à . Le factorisation dans la forme (1.122) peut avoir lieu.
D’autres possibilités pour le groupe de jauge sont et , mais on ne connaît pas des théories des cordes qui possèdent ces groupes de jauge.
Chapitre 2 Orbifolds et Orientifolds
2.1 Fonction de partition - le tore
À la difference de la théorie des champs, en théorie des cordes les amplitudes du vide jouent un role important, car elles determinent le spectre perturbtif. Intéressons-nous à l’amplitude du vide à une boucle pour les cordes fermées bosoniques.
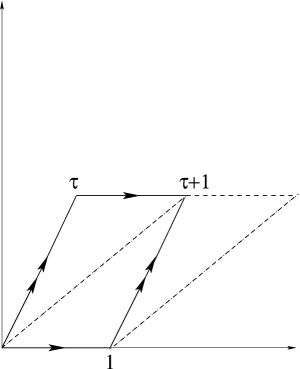
Une corde fermée qui effectue une boucle dessine un tore. Le tore peut être représenté comme un parallélogramme dans le plan complexe, avec les côtés opposées identifiées (fig 2.1). La structure complexe du tore est décrite par un paramètre complexe, , appelé paramètre de Teichmüller. Mais toutes les valeurs de ne correspondent pas à des tores inéquivalents. Plus précisement toutes les valeurs reliées par la transformation :
| (2.1) |
décrivent le même tore. La transformation (2.1) décrit le groupe modulaire , qui est engendré par les deux transformations :
| (2.2) |
On peut noter que la transformation échange les côtés horizontal et oblique, alors que la transformation redéfinit le côté oblique.
Les valeurs indépendantes de sont contenues à l’intérieur de la région fondamentale :
| (2.3) |
L’expression de l’amplitude du vide à une boucle pour un champ de masse est donnée par (voir [17]) :
| (2.4) |
où la trace Str prend en compte la multiplicité et les signe "-" pour les états fermioniques, est le volume de l’espace-temps et est un cut-off ultraviolet.
Appliquons cette formule aux cordes fermées bosoniques. On rappelle que la dimension critique dans ce cas vaut et que l’opérateur de masse est donné par :
| (2.5) |
avec la contrainte . Cette contrainte peut être imposée en introduisant une fonction :
| (2.6) |
On obtient alors :
| (2.7) |
L’expression (5.4) peut être mise sous une forme plus concise en définissant le paramètre de Schwinger :
| (2.8) |
et en définissant :
| (2.9) |
pour obtenir :
| (2.10) |
Le paramètre de Schwinger, , est identifié au paramètre Teichmüller du tore. Par conséquent il faut restreindre l’intégration à la région fondamentale . Cette restriction introduit un cutoff UV. Aprés un changement de normalisation l’amplitude sur le tore prend la forme :
| (2.11) |
Cette expression définit la fonction de partition pour la corde fermée bosonique et peut être généralisée pour tout modèle de cordes fermées orientées si on connaît les opérateurs de Virasoro.
Dans la suite on va calculer explicitement l’amplitude (2.11) pour la corde bosonique. On rapelle l’expression des opérateurs de Virasoro dans ce cas :
| (2.12) |
où nous avons utilisé les opérateurs d’annihilation et de création avec la normalisation habituelle pour l’oscillateur harmonique. On obtient alors :
| (2.13) |
et la fonction de partition vaut :
| (2.14) |
où est la fonction de Dedekind :
| (2.15) |
Les transformations modulaires de la fonction :
| (2.16) |
impliquent l’invariance de la combinaison . La mesure étant également invariante sous et il résulte que la fonction de partition est invariante sous le groupe modulaire.
2.2 Orientifold
Les modèles d’orientifold[18] sont des théories de cordes fermées non-orientées ou des théories des cordes fermées et ouvertes non-orientées.
2.2.1 Cordes fermées non-orientées
Jusqu’à présent nous avons discuté des théories des cordes orientées. Mais la surface d’univers possède une symétrie que nous n’avons pas prise en compte. La transformation de coordonnées :
| (2.17) |
avec pour la corde ouverte et pour la corde fermée, change l’orientation de la surface d’univers. Cette symétrie est générée par la parité sur la surface d’univers, . A partir des développements en oscillateurs (1.18) et (1.20) on peut en déduire l’action de sur les oscillateurs :
| (2.18) |
pour la corde fermée, et
| (2.19) |
pour la corde ouverte. A partir de (2.17) on voit que . Le spectre est, donc, partagé en états pairs et impairs sous . Étant donné que deux états impairs qui interagissent donnent naissance à un état pair il résulte que que la seule manière consistente de tronquer le spectre est de garder les états pairs. Par exemple pour les cordes fermées bosoniques au niveau non-massif on gardera le dilaton et le graviton qui sont pairs sous , alors que le tenseur antisymétrique sera éliminé. Au niveau non-massif le modèle des cordes fermées orientées bosoniques contenait degrés de liberté, dans le modèle des cordes non-orientées il restent degrés de liberté. A noter que le tachyon reste présent dans les théories non-orientées.
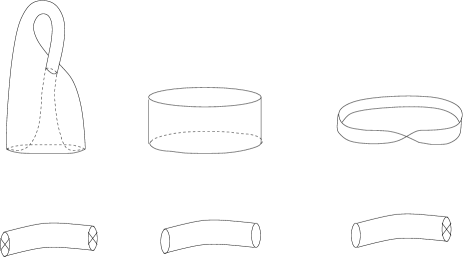
Dans la section précedente nous avons calculé l’amplitude du vide à une boucle pour les cordes fermées orientées qui est donnée par l’amplitude sur le tore, qui est la seule surface fermée orientée avec nombre d’Euler zéro. En revanche les cordes non-orientées peuvent parcourir aussi des surfaces non-orientées, ce qui laisse encore une possibilité, la bouteille de Klein.
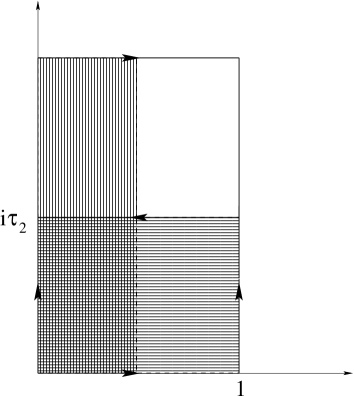
Comme pour le tore on peut représenter la bouteille de Klein dans le plan complexe (fig 2.3) et on a le choix entre deux polygones. Pour le premier, de côtés 1 et , les côtés verticaux sont identifiés comme dans le cas du tore, mais les côtés horizontaux ont des orientations opposées. Cette représentation décrit la propagation dans une boucle d’une corde fermée qui subit une inversion de son orientation, étant le temps propre sur la surface d’univers. Le deuxième polygone est obtenu en divisant par deux le côté horizontal et en doublant le côté vertical. On obtient alors un tube terminé par deux crosscaps et le temps s’écoule "horizontalement", cette représentation décrivant la propagation d’une corde fermée à l’ordre des arbres entre deux crosscaps(fig 2.2). Ces deux choix de temps propre sont reliées par une transformation .
La bouteille de Klein est obtenue à partir du tore de double recouvrement, avec paramètre de Teichmüller , par l’involution .
Pour décrire le spectre des cordes fermées non-orientées il faut insérer dans la fonction de partition le projecteur . Ceci revient à diviser par deux la contribution du tore et à rajouter l’amplitude provenant de la bouteille de Klein :
| (2.20) |
où:
| (2.21) |
En utilisant le fait que on obtient:
| (2.22) |
Le calcul de la trace est ensuite analogue à celui effectué dans le cas du tore et la résultat est :
| (2.23) |
Ceci représente l’amplitude de la bouteille de Klein dans la canal direct (ou à une boucle) et elle dépend du temps propre "vertical" . L’amplitude dans le canal transverse ( ou à l’ordre des arbres) est obtenue par une transformation et elle dépend du temps propre "horizontal" :
| (2.24) |
Il est intéressant de regarder le développement en puissances de des intégrands de et , en faisant attention à ne garder pour le tore que les termes avec puissances égales de et qui respectent la condition de raccordement des niveaux :
| (2.25) |
On voit donc que la combinaison reproduit bien le spectre projeté, en particulier au niveau non-massif on retouve degrés de liberté et le tachyon est toujours présent.
L’amplitude de la bouteille de Klein n’est pas protegée par l’invariance modulaire, comme le tore, et elle présente dans le canal direct une divergence ultraviolete, , qui, dans le canal transverse, devient une divergence infrarouge, . Il est plus simple d’examiner cette divergence dans le canal transverse. Un état de masse ayant une contribution proportionnelle à:
| (2.26) |
on peut voir que la divergence provient des états de masse nule avec impulsion nulle. Dans le cas des cordes fermées bosoniques il s’agit du dilaton. Comme on va le voir dans la suite, l’introduction d’un secteur des cordes ouvertes dans la théorie permet d’éliminer la divergence.
2.2.2 Cordes ouvertes - facteur de Chan-Paton - annulation des tadpoles
Les cordes ouvertes admettent une généralisation grâce au fait qu’elles possèdent deux points spéciaux, leurs bouts. On peut attacher à chaque bout une charge, nommée charge de Chan-Paton[23]. Ces nouveaux degrés de liberté ne sont pas dynamiques, mais permettent l’introduction des groupes de jauge non-abeliens en théorie des cordes[20].
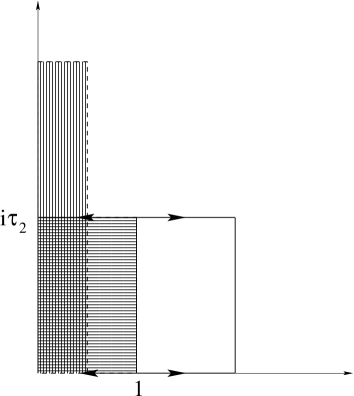
Une corde ouverte qui effectue une boucle décrit un anneau. Comme pour le tore et la bouteille de Klein l’anneau peut être représenté dans le plan complex par un polygone(fig 2.4) et il y a deux choix pour ce polygone. Pour la première, de côtés 1 et , les côtés horizontaux sont identifiés et les côtés verticaux correspondent aux deux frontières. est le temps propre pour une corde ouverte qui se propage dans une boucle. Dans la deuxième représentation le temps s’écoule horizontalement et c’est une corde fermée qui se propage entre deux frontières(fig 2.2). Ces deux représentations sont reliées par une transformation . L’anneau peut être obtenu à partir de son tore de double recouvrement de paramètre de Teichmüller par les involutions: et .
Calculons l’amplitude de l’anneau pour la corde bosonique. On associe une multiplicité à chaque bout de la corde ouverte. En utilisant l’expression de l’opérateur de masse : dans la formule (2.4) on obtient :
| (2.27) |
L’amplitude dans le canal transverse est obtenue par la transformation à partir de (2.27) et dépend du paramètre :
| (2.28) |
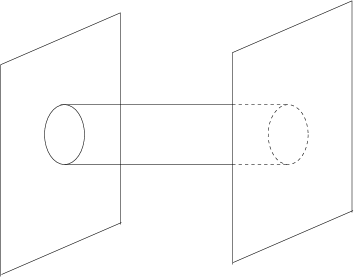
Dans le chapitre précedant nous avons introduit la notion de -brane. Deux -branes interagissent en échangeant des cordes fermées comme dans la figure 2.5. L’amplitude est un anneau et peut être vue également comme la propagation à une boucle d’une corde ouverte tendue entre les -branes. Elle est donné par une expression de la forme (2.27). Si on réécrit l’amplitude (2.27) en reintroduisant tous les facteurs initiaux,
| (2.29) |
alors l’interaction de deux -branes s’obtient en remplaçant le nombre de dimensions 26 avec et en rajoutant un terme de masse additionnel lié à la tension de la corde ouverte tendue entre les deux -branes[54] :
| (2.30) |
où est la séparation des branes et le facteur de Chan-Paton est devenu 2, car il y a deux orientations possibles de la corde ouverte.
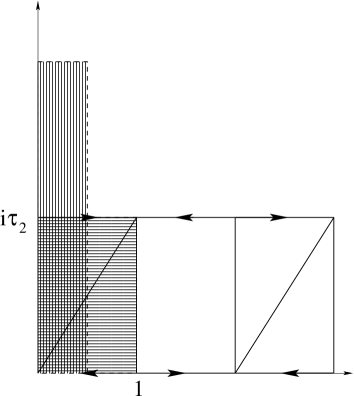
Une corde ouverte qui effectue une boucle et qui subit une inversion d’orientation décrit une bande de Möbius. Dans le polygone de la figure 2.6 de côtés 1 et les côtés horizontaux sont identifiés, mais avec des orientations opposées et les côtés verticaux décrivent deux portions de la même frontière. est le temps propre qui s’écoule lorsqu’une corde ouverte parcourt la bande de Möbius. On peut également chosir un temps "horizontal", dans ce cas la bande de Möbius est représentée comme un tube terminé par un crosscap et une frontière et c’est une corde fermée qui se propage. Le paramètre de Teichmüller pour le tore de double recouvrement est et on obtient la bande de Möbius par l’involution: . Le canal direct et la canal transverse sont reliés dans le cas de la bande de Möbius par la transformation :
| (2.31) |
L’amplitude sur la bouteille de Möbius est donnée par :
| (2.32) |
avec . Le dans l’argument de la fonction est une conséquence de la rélation: et est un signe qui provient de l’action de sur les facteurs de Chan-Paton. Si on désigne par un état de la corde ouverte, avec l’état des champs de la surface d’univers et et les facteurs de Chan-Paton associés aux extrémités gauche et droite, l’action de sur s’écrit[21]:
| (2.33) |
En agissant deux fois avec :
| (2.34) |
et en imposant il résulte que : . Si est symétrique on peut choisir une base telle que . Dans le cas où est antisymétrique on peut choisir une base telle que:
| (2.35) |
Le signe de l’amplitude de la bande de Möbius est donné par le facteur qui provient de l’action (2.33) de sur les facteurs de Chan-Paton.
La transformation permet d’obtenir l’amplitude de la bande de Möbius dans le canal transverse :
| (2.36) |
avec . Le facteur reflète la possibilité d’interpreter comme la propagation d’une corde fermée d’une frontière à un crosscap ou d’un crosscap à une frontière. Ceci montre que peut être aussi calculé directement à partir de et comme leur moyenne géométrique.
Le développment en puissance de de :
| (2.37) |
montre que pour au niveau de masse nulle il y a vecteurs ce qui correspond à un groupe de jauge orthogonal. Le cas conduit à un groupe de jauge symplectique.
L’anneau et la bande de Möbius présent aussi une divergence qui provient dans la canal transverse de la propagation des états de masse nulle avec un impulsion zéro. Les termes divergents de , et ont une contribution proportionnelle à111La contribution de la bande de Möbius comporte un signe ”-” car l’état de masse nulle apparaît avec un signe ”-” dans le développement (2.37). :
| (2.38) |
qui s’annule pour et . Le groupe de jauge de Chan-Paton est donc [19]. La condition que la somme des divergences (2.38) s’annule s’appelle une condition de tadpole, car les divergences apparaissent à partir des fonctions à un point pour le dilaton devant une frontière ou un crosscap. A noter que la divergence infrarouge due à la propagation du dilaton dans le canal transverse pour ne reflète pas une inconsistance de la théorie, mais simplement le fait que le vide a été mal défini. Ceci ne sera pas le cas pour d’autres états qui apparaissent, par exemple, dans les modèles supersymétriques et dans ces cas la condition d’annulation des tadpoles sera obligatoire pour la consistence de la théorie, ce qui justifiera l’introduction d’un secteur des cordes ouvertes.
2.2.3 Amplitudes du vide pour les cordes supersymétriques
Pour calculer les amplitudes du vide pour la corde fermionique nous avons besoin de nous rappeler que dans ce cas la dimension critique vaut et que le spectre contient deux secteurs, le secteur de Neveu-Schwarz (NS) et le secteur de Ramond(R) et l’opérateur de masse est donné par :
| (2.39) |
où englobe les contributions des fermions et des bosons et vaut dans le secteur NS et 0 dans le secteur R. Dans les sections précédentes nous avons déjà calculé la contribution des bosons. Pour les oscillateurs fermioniques on obtient :
| (2.40) |
où est un entier allant de 1 à pour le secteur R et un demi-entier dans le secteur NS et où nous avons tenu compte du principe de Pauli.
En mettant ensemble les contributions des bosons et des fermions on obtient pour le secteur NS:
| (2.41) |
et pour le secteur R :
| (2.42) |
où le coefficient 16 reflète la dégénérescence de l’état fondamental dans le secteur R.
Dans la suite on va s’intéresser aux amplitudes du vide pour la théorie IIB. Il faut donc inclure dans la trace la pojection GSO :
| (2.43) |
| (2.44) |
où sont les opérateurs nombre fermionique sur la surface d’univers et l’insertion de change le signe des contributions avec un nombre impair d’oscillateurs fermioniques et est l’opérateur de chiralité dans les dimensions transverses.
L’amplitude résultante s’écrit de manière compacte en utilisant les fonctions de Jacobi, définies par:
| (2.47) | |||
Sous les transformations modulaires les fonctions se transforment de la manière suivante :
| (2.52) | |||
| (2.57) |
En notant que222A noter également le fait que . :
| (2.60) | |||
| (2.63) | |||
| (2.66) |
on peut voir que l’amplitude du tore pour la théorie IIB s’écrit :
| (2.68) |
On peut facilement vérifier à l’aide des transformations (2.57) que (2.68) est invariante modulaire. Également la fameuse aequatio identica satis abstrusa de Jacobi :
| (2.69) |
montre que l’amplitude (2.68) est nulle, ce qu’il fallait attendre puisque la théorie IIB est supersymétrique et contient, donc, un nombre égal de degrés de liberté fermioniques et bosoniques.
L’amplitude (2.68) peut s’écrire de manière encore plus compacte en utilisant les caractères du groupe :
| (2.70) |
repésente la trace sur les états du secteur NS qui subsitent après la projection GSO (2.43) et représente la trace sur toutes les autres états:
| (2.71) |
Si on développe et en puissances de :
| (2.72) |
et si l’on tient compte de l’énergie du point zéro pour les bosons de la surface d’univers, , on voit que le développement de commence par , ce qui correspond à un scalaire de masse , le tachyon de la corde ouverte, et que commence avec un état non-massif avec 8 degrés de liberté, qui est le vecteur de la corde ouverte fermionique dans le secteur NS après la projection GSO.
Les caractères et décrivent chacun une des deux parties du spectre du secteur R: et , avec .
En général pour une algèbre les caracthéres sont définis par :
| (2.73) |
Les trasformations modulaires pour le vecteur sont données par les matrices:
| (2.74) |
| (2.75) |
| (2.76) |
où , , et la transformation agit sur les caractéres , où sont les poids conformes .
Les amplitudes du vide pour les supercordes s’expriment en fonction des caractéres divisés par et les matrices des transformations modulaires et prennent une forme très simple pour les combinaisons :
| (2.77) |
| (2.78) |
Avec les caractéres l’amplitude du tore pour la théorie IIB s’écrit :
| (2.79) |
et on peut facilement vérifier qu’elle est bien invariante sous les transformations modulaires. Dans la suite on va laisser implicites dans les expression l’intégration et la contributions des bosons de la surface d’univers, donc :
| (2.80) |
Pour la théorie IIA l’amplitude du tore s’écrit :
| (2.81) |
A partir des caractéres on peut construire encore deux amplitudes, invariantes sous les transformations modulaires, qui correspondent aux deux théories nonsupersymétriques 0A et 0B[22] :
| (2.82) |
A noter que les théories 0A et 0B ne contiennent pas des fermions d’espace-temps et que le tachyon est présent dans le spectre. La projection GSO pour la théorie 0B est donnée par dans les secteurs NS et R, alors que pour la théorie 0A la projection est dans le secteur NS et dans le secteur R.
Rapellons qu’il existe en 10 dimensions deux autres théories supersymétriques, la corde hétérotique et la corde hétérotique . Leurs fonctions de partitions sont données par:
| (2.83) | |||||
| (2.84) |
Les caractères et décrivent les degrés de liberté internes.
2.2.4 La théorie de type I
Dans cette séction on va discuter l’orientifold de la théorie IIB. Les amplitudes de la bouteille de Klein, de l’anneau et de la bande de Möbius dans le canal direct sont obtenues de façon similaire que pour la corde bosonique :
| (2.85) |
La bouteille de Klein symétrise le secteur NS-NS en éliminant au niveau de masse nulle le tenseur antisymétrique, et en gardant le graviton et le dilaton. Le secteur R-R est antisymétrisé, ce qui élimine la 0-forme et la 4-forme et garde la 2-forme. Comme l’amplitude du tore doit être multipliée avec 1/2, la moitié des états des secteurs NS-R et R-NS subsistent: un gravitino et un dilatino(au niveau de masse nulle). Le spectre résultant est supersymétrique avec . Les amplitudes dans les canaux transverses sont obtenues par les transformations et :
| (2.86) |
et la condition d’annulation des tadpoles,
| (2.87) |
implique et ce qui correspond au groupe . A noter que la condition (2.87) s’applique autant au dilaton qu’au secteur R-R. L’amplitude du cylindre décrit l’interaction entre deux -branes, selon la formule (2.30). De la même manière l’amplitude de la bouteille de Klein décrit l’interaction entre deux objets non-dynamiques, des orientifolds . Les orientifolds ou - planes sont des hyperplanes avec dimensions spatiales qui sont invariantes sous la transformation . Comme les - branes, les - planes couplent à une forme et ils possèdent une tension et une charge, à la différence que leur tension peut être négative. Les orientifolds ne contiennent pas de la matière.
Il y a plusieurs types d’orientifolds :
| tension | charge | |
|---|---|---|
| - | - | |
| - | + | |
| + | + | |
| + | - |
La théorie de type I contient des orientifolds et la condition d’annulation des tadpoles traduit la compensation de la charge et de la tension entre les - planes et le - branes. Les conditions d’annulation des tadpoles NS-NS et R-R sont très différentes. Comme nous l’avons expliqué dans le cas de la corde bosonique, un tadpole NS-NS non nul indique que le vide de la théorie doit être redéfini. En revanche la loi de Gauss interdit l’existence d’une charge non nulle dans un espace compact. Ceci laisse une deuxième possibilité [24] pour construire une théorie consistante, mais avec un tadpole résiduel pour le dilaton. Dans ce deuxième modèle l’amplitude de la bande de Möbius vaut :
| (2.88) |
La condition d’annulation des tadpoles de R est toujours satisfaite pour , en revanche le tadpole du dilaton est non nul. Les orientifolds dans ce modèle sont des -planes. La présence simultanée des -branes et antiorientifolds brise la supersymétrie. La formule de l’amplitude de l’anneau dans le canal direct (2.85) et l’équation (2.88) montrent qu’au niveau de masse nulle il y a vecteurs ce qui correspond au groupe . Les fermions de masse nulle sont en nombre de , la supersymétrie est, donc, brisée.
2.3 Compactification toroidale
Dans la section (1.4) nous avons discuté la compactification d’une coordonnée sur un cercle. A présent nous allons exposer la manière dont cette compactification se traduit dans les amplitudes du vide à une boucle. Nous rappelons que les impulsions gauche et droite pour la coordonnée compacte sont données par :
| (2.89) |
et que les opérateurs de Virasoro s’écrivent :
| (2.90) |
Dans le calcul des amplitudes l’integrale sur l’impulsion est remplacée par une somme discrete :
| (2.91) |
Par exemple la fonction de partition pour la théorie IIB devient:
| (2.92) |
Pour la bouteille de Klein la projection ne permet que la propagation des états avec ou autrement . Par conséquent l’amplitude de la bouteille de Klein devient :
| (2.93) |
avec . Pour obtenir l’amplitude dans le canal transverse on utilise la formule de resommation de Poisson:
| (2.94) |
Dans la canal transverse ne se propagent que les états avec et nombre d’enroulement pair :
| (2.95) |
avec .
Le tadpole de R-R pour impose l’introduction d’un secteur des cordes ouvertes. Les cordes ouvertes avec conditions aux bords de Neumann ne possèdent pas de nombre d’enroulement. Les amplitudes de l’anneau et de la bande de Möbius s’écrivent :
| (2.96) |
avec . Dans le canal transverse de l’anneau se propagent que les états avec , alors dans le canal transverse de la bande de Möbius se propagent les états avec et nombre d’enroulement pair :
| (2.97) |
2.4 Orbifolds
Les orbifolds [26] [29]sont des modèles qui présentent des spectres intéressantes pour la phénomènologie. Des alternatives phénomènologiques des orbifolds sont les compactifications sur les variétés de Calabi Yau[27] et les constructions des cordes fermioniques en quatre dimensions[28].
Du point de vue gómétrique l’orbifold [25] généralise la notion de variété en permettant qu’un ensemble discret des points, qui sont les points fixes, de la variété soient singuliers. Les points fixes de l’action d’un groupe discret sur une variété sont les points pour lesquels ( identité). L’orbifold est défini comme l’espace quotient construit par l’identification des points de la variété par la relation d’équivalence .
Exemple. Le cercle paramétrisé par avec l’action du groupe qui agit comme créent l’orbifold qui est le segment avec les points fixes et .
En théorie des cordes la notion d’orbifold correspond à une théorie invariante modulaire obtenue en jaugeant une symétrie dans une théorie invariante modulaire , où est une symétrie discrète de la théorie initiale. Pour construire l’orbifold il faut d’abord projeter l’espace de Hilbert de la théorie dans le sous-espace invariant sous . Ensuite puisque les points et sont échivalents il faut considérer les états où la corde ferme modulo une transformation de : . Ces nouveaux états s’appellent des états twistés et sont confinés aux points fixes. Le secteur des états twistés doit être à son tour projeté dans le sous-espace invariant sous l’action de . L’existence du secteur twisté, ainsi que la nécessité de le projeter dans le sous-espace invariant sous l’action de sont imposées par l’invariance modulaire.
Du point de vue de l’amplitude sur le tore la projection du spectre untwisté revient à considérer des états avec une périodicité modulo une transformation de dans la direction du type "temps" : . Mais comme la transformation échange les deux cycles du tore, il faut également ajouter des états avec une périodicité : . Ceci sont les états twistés. Sous une transformation le secteur twisté se transforme dans un secteur avec , qui représente la projection dans les états invariants sous .
Dans la suite on va déduire la fonction de partition de l’orbifold pour la corde bosonique:
| (2.98) |
où est le générateur du groupe , et la trace porte sur les secteurs untwisté et twisté. Le premier terme correspond à l’amplitude du tore de la théorie initiale divisée par 2. Ce terme est invariant modulaire. Le deuxième terme est la trace sur le secteur untwisté avec l’action de . La contribution à ce terme d’un boson complexe pour un élement d’un groupe générique est donné par:
| (2.101) | |||||
Pour le groupe on a . En prenant en compte aussi les modes de droite on obteint la contribution totale pour un boson complexe . Dans notre cas une seule coordonnée bosonique est affectée par l’opération et la contribution du secteur untwisté à la fonction de partition s’écrit :
| (2.102) |
La transformée du dernier terme génére la contribution du secteur twisté . Ensuite par la transformation de ce terme on obtient la contribution . Au final la fonction de partition est donnée par:
| (2.103) |
Le facteur 2 devant les contributions du secteur twisté représente le nombre de points fixes. Les états twistés sont localisés aux points fixes et il y a autant de secteurs twistés que de points fixes.
Chapitre 3 Brisure de supersymétrie
3.1 Brisure de supersymétrie en théorie des cordes
La brisure de la supersymétrie est un point central de la phénoménologie des cordes. Dans les modèles d’orientifolds quatre mécanismes de brisure de supersymétrie sont connues :
-
La supsersymétrie peut être brisée dés le départ. Il s’agit des orientifolds de la théorie de type 0A et 0B. Ces modèles contiennent en général des tachyons, mais la projection en 0B, avec le nombre fermionique de la surface d’univers, conduit à une théorie sans tachyons, appelée 0’B[30].
-
Le mécanisme de Scherk-Schwarz, qui consite à déformer les modes de Kaluza-Klein ou les modes d’enroulement, brise la supersymétrie à l’échelle de la compactification[32]. Ce mécanisme sera présenté dans la suite.
-
Une autre possibilité consiste à briser la supersymétrie dans le secteur des cordes ouvertes par l’introduction des champs magnétiques internes[34]. La supersymétrie est brisée à l’échelle de compactification et la T-dualité relie ces modèles à des configurations avec des branes inclinées (branes at angles)[35].
3.2 Brisure de supersymétrie par compactification à la Scherk-Schwarz
Le mécanisme de brisure de supersymétrie de Scherk-Schwarz est une généralisation de la compactification de Kaluza-Klein. Considérons un champ scalaire en D dimensions. Si une des coordonnées est compacte , la périodicité du champ , implique que l’impulsion dans la direction est quantifiée, , et que la champ peut être développé en modes de Fourier :
| (3.1) |
L’équation de Klein Gordon en D dimensions,
| (3.2) |
devient:
| (3.3) |
Le champ se décompose dans un nombre infini des champs D-1 dimensionels avec des masses données par . Ceci est le mécanisme de Kaluza-Klein.
Une généralisation possible est de permettre une périodicité des champs modulo une transformation :
| (3.4) |
Si la transformation est, par exemple, le nombre fermionique, , on obtient une brisure de supersymétrie. En effet, les bosons restent périodiques, mais les champs fermioniques satisfont une condition d’antipériodicité:
| (3.5) |
qui a comme effet une modification des modes de Kaluza-Klein:
| (3.6) |
La masse des fermions est décalée par rapport à celle des bosons et on obtient une brisure de supersymétrie.
En théorie des cordes on a également la possibilité de décaler les modes d’enroulement. Ce deuxième mécanisme s’appelle "M-theory breaking" car il peut être relié par des dualités à un mécanisme Scherk-Schwarz conventionnel le long de la onzième coordonnée[31]. Ces modèles présentent le phénomène de "brane supersymmetry": les excitations des branes plongées dans un bulk nonsupersymétrique peuvent être supersymétriques, au premier ordre, car les branes sont orthogonales à la direction de la déformation et la brisure n’affecte pas le secteur de masse zéro des cordes ouvertes.
3.2.1 Scherk-Schwarz parallèle
Le point de départ est l’orbifold de la théorie IIB, compactifiée sur un cercle , avec le générateur , avec le nombre fermionique de l’espace-temps et le shift: . La fonction de partition résultante est donnée par :
| (3.7) | |||||
avec
| (3.8) |
La fonction de partition peut être mise sous la forme :
| (3.9) | |||||
avec
Il est utile d’effectuer la transformation qui permet de mieux visualiser la connection avec le mécanisme de Scherk-Schwarz en théorie des champs. La fonction de partition se réécrit :
| (3.11) | |||||
Dans cette nouvelle base on voit que les fermions ont des modes de Kaluza-Klein décalés avec 1/2 par rapport aux bosons. Pour le spectre des cordes fermées contient un tachyon. Dans la limite on retrouve la théorie IIB, tandis que la limite conduit à la théorie 0B.
Dans la bouteille de Klein se propagent les états avec :
| (3.12) |
avec . La transformation fournit l’amplitude dans la canal transverse :
| (3.13) |
où .
Le tadpole de R-R impose l’introduction des - branes. L’amplitude de l’anneau s’écrit :
| (3.14) |
L’amplitude de la bande de Möbius dans la canal transverse est obtenue comme la moyenne géométrique de et :
| (3.15) |
L’annulation des tadpoles de R-R impose .
Les amplitudes des cordes ouvertes sont données par :
| (3.16) |
Le mécanisme de brisure de supersymétrie à la Scherk-Schwarz correspond au signe "+" dans . Le groupe de jauge dans ce cas est . Le signe "-" correspond au groupe .
3.2.2 M-theory breaking
On va considérer le même modèle que dans la section précedante, mais avec un shift antisymétrique . La fonction de partition est alors donnée par :
| (3.17) | |||||
et devient après le rescaling :
| (3.18) | |||||
Pour le spectre des cordes fermées contient un tachyon. Dans la limite on retrouve la théorie IIB, tandis que la limite conduit à la théorie 0B.
La projection impose , donc seulement les états avec nombre d’enroulement zéro se propagent dans la bouteille de Klein :
| (3.19) |
La transformation permet d’obtenir l’amplitude dans le canal transverse :
| (3.20) | |||||
Les états de R-R qui se propagent dans le canal transverse sont tous massifs, il n’y a, donc, pas de tadpole de R-R. Le modèle contient des et planes et leurs charges de R-R se compensent. Pour que le secteur des cordes ouvertes n’introduise pas de tadpoles de R-R, il faut qu’il comporte des et branes. On va appeler le nombre des branes et le nombre de antibranes. L’amplitude de l’anneau dans le canal transverse s’écrit :
| (3.21) | |||||
Les amplitudes de la bouteille de Klein et de l’anneau dans le canal transverse permettent d’obtenir l’amplitude transverse de Möbius :
| (3.22) | |||||
qui devient dans le canal direct :
| (3.23) |
L’annulation des tadpoles de R-R implique que pour pair , c’est à dire . L’amplitude de l’anneau dans le canal direct :
| (3.24) |
montre qu’au niveau de masse nulle, pour le signe "-" dans l’amplitude (3.23) on a effectivement un spectre supersymétrique avec le groupe de jauge . Si on impose également l’annulation des tadpoles de NS on a :
| (3.25) |
donc le groupe de jauge est .
Une T-dualité sur la coordonnée transforme les modes d’enroulement en modes de Kaluza-Klein et on retrouve le mécanisme de Scherk-Schwarz habituel. La T-dualité transforme également les - branes et - planes en et et elle génére une parité . Les - branes et - planes sont placés en , tandis que les - branes et - planes se trouvent en . Déformer les modes d’enroulement est, donc, équivalent, à la déformation des modes de Kaluza-Klein dans une coordonnée orthogonale aux branes.
En [37] un modèle ressemblant à été proposé. Ce modèle utilise une parité particulière sur la surface d’univers: , avec le nombre fermionique sur la surface d’univers. Cette projection a le mérite d’éliminer le tachyon présent dans le spectre des cordes fermées. Le modèle résultant interpole entre la théorie de type I supersymétrique et la théorie de type I avec groupe de jauge .
La bouteille de Klein dans ce modèle vaut:
Le tachyon est antisymétrisé et éliminé du spectre. Dans le canal transverse l’amplitude de la bouteille de Klein devient:
| (3.26) |
Comme on peut le voir sur cette amplitude il n’y a pas de tadpole de NS-NS, mais il y a un tadpole de R-R. Pour annuler ce tadpole il est nécessaire d’introduire des -branes. La modèle T-dual conteint des - planes à l’origine et des - planes en . Les - branes sont distribuées entre ces deux points. Lorsque des - branes sont placées sur les - planes la supersymétrie est brisée.
Si les branes sont placées au même point l’amplitude de l’anneau dans le canal transverse s’écrit:
| (3.27) |
L’amplitude de la bouteille de Möbius est alors donnée par:
| (3.28) |
Le signe "-" correspond au cas où dans le modèle T-dual les - branes sont placées sur les - planes, alors que le signe "+" décrit la configuration avec les - branes sont situées en avec les . L’annulation des tadpoles implique .
Les amplitudes des cordes ouvertes :
| (3.29) |
determinent le groupe de jauge qui est pour le signe "-" et pour le signe "+". Si branes sont placées à l’origine et en le groupe de jauge est .
Chapitre 4 Introduction à la cosmologie
4.1 Le modèle du Big Bang
La cosmologie est basée sur l’hypothèse que, dans une première approximation, l’univers est isotrope et homogène dans les coordonnées spatiales 111Les observations montrent que l’univers n’est pas statique, donc on ne peut pas considèrer l’homogénéité et l’isotropie dans le temps.. Cela veut dire que l’univers peut être "coupé" en tranches qui sont des hypersurfaces du genre temps isotropes et homogènes. La métrique de l’espace-temps peut donc s’écrire:
| (4.1) |
où est une métrique avec symétrie maximale pour fixé. Les métriques avec symétrie maximale sont les métriques avec symétrie sphérique et de courbure constante. Ceci conduit aux solutions:
| (4.2) |
dites métriques de Robertson-Walker, avec selon la courbure des hypersurfaces spatiales. Le cas avec courbure négative, , correspond à l’espace hyperbolique, dit également ouvert, car son volume est infini. Le cas correspond à l’espace euclidien, appellé espace plat. L’espace avec courbure positive est la sphère, qui est un espace fermé.
La matière dans l’univers peut être décrite par un fluide parfait dont le tenseur énergie-impulsion peut être mis sous la forme:
| (4.3) |
où est la densité d’énergie et la pression. Les équations d’Einstein s’écrivent alors:
| (4.4) | |||||
| (4.5) |
La dernière équation peut être simplifiée à l’aide de la première:
| (4.6) |
Mises sous cette forme ces équations s’appellent les équations de Friedmann-Lemaître. Une conséquence directe est l’equation de continuité:
| (4.7) |
où est le paramètre de Hubble qui décrit le taux d’expansion de l’univers. Sa valeur à l’époque présente est la constante de Hubble , qui vaut environ 76 km/s/Mpc 2221Mpc(Megaparsec.)=cm.
Pour determiner l’évolution cosmologique il faut compléter les équations obtenues jusqu’à maintenant avec une équation d’état, qui pour les fluides parfaits les plus populaires en cosmologie prend une forme très simple:
| (4.8) |
avec une constante indépendante de temps qui vaut, par exemple, pour un gas des particules relativistes ou pour la radiation électromagnétique et pour la matière non-relativiste333Par exemple les étoiles et les galaxies, pour lesquelles la pression est négligeable par rapport à la densité d’énergie..
| (4.9) |
où l’indice indique les quantités évaluées à présent. Pour un univers dominé par la matière la densité d’énergie varie comme , ce qui reflète la décroissance de la densité volumique des particules dans un univers en expansion. Dans un univers dominé par la radiation la densité d’énergie varie plus rapidement, , à cause de la perte d’énergie par effet Doppler.
Pour , l’équation (4.4) permet alors d’obtenir rapidement la dépendance dans le temps du facteur d’échelle: , pour un univers dominé par la matière et , pour un univers dominé par la radiation.
On peut considérer aussi le cas d’une constante cosmologique444Ou énergie du vide, . Les équations d’Einstein avec une constante cosmologique s’écrivent :
| (4.10) |
et peuvent être vues comme les équations d’Einstein habituelles, mais avec un tenseur énergie-impulsion pour le vide de la forme:
| (4.11) |
Ceci a la forme d’un tenseur énergie-impulsion pour un fluide parfait avec:
| (4.12) |
La constante cosmologique satisfait, donc, une équation d’état de la forme (4.8) avec . Ceci implique que la densité d’énergie, , est indépendante de et qu’un univers en expansion qui présente une énergie du vide non nulle sera, aprés un certain temps, dominé par l’énergie du vide, car les densités d’énergie pour la matière et la radiation décroissent avec l’expansion. Pour un univers dominé par l’énergie du vide le facteur d’échelle a une évolution exponentielle:
| (4.13) |
Il est utile d’introduire le paramètre "densité":
| (4.14) |
avec
| (4.15) |
appelée densité critique. La première équation de Friedmann-Lemaître (4.4) se réécrit alors:
| (4.16) |
La valeur de la courbure est, donc, déterminée par la densité d’énergie:
| (4.17) |
Les observations cosmologiques donnent les valeurs suivantes pour les paramètres de densité:
Baryons: ,
Matière noire ,
Constante cosmologique ,
Photons: .
Notre univers est dominé à présent par l’énergie du vide, ce qui implique qu’il accèlére, . Mais en extrapolant dans le passé on trouve que la radiation a été dominante à une certaine époque, car décroît plus vite que . À cette époque l’univers décellerait, ce qui implique que, plus on remonte dans le temps, plus l’univers était en expansion de plus en plus rapide et au moment on trouve une singularité. Cette singularité s’appelle le Big Bang. A l’approche de cette singularité la relativite générale ne permet plus une description valide de la nature, car les effets de la gravité quantique deviennent importantes. La théorie des cordes pourrait offrir les outils necessaires pour comprendre les phénomènes qui se sont déroulés dans cette région de l’espace-temps.
4.2 Les problèmes du modèle du Big Bang
Le modèle du Big Bang a remporté beaucoup des succes̀, en particulier ses prédictions sont en excellent accord avec les observations sur la température du CMB(cosmic microwave background)555fond diffus cosmologique et le scénario de la nucléosynthèse est en accord avec les abondances des élements D, , , [59]. Mais en plus du problème théorique mentionné plus haut, concernant la non validité du traitement classique de la gravité dans les régions proches de la singularité, le modèle cosmologique standard échoue dans l’explication de plusieurs problèmes observationnels comme les anisotropies du CMB, la formation des structures et l’origine de la matière. Egalement le modèle cosmologique standard est basé sur des hypothèses qu’il ne justifie pas, comme l’homogénéité et l’isotropie de l’univers. Voici un apperçu des principaux problèmes laissés sans réponse par le modèle cosmologique standard:
-
1.
Le problème de l’homogénéité et de l’isotropie.
Les observations confirment que l’univers est homogène et isotrope avec une très bonne précision. Comme les inhomogénéités ont tendance à s’accentuer dans le temps, à cause de la gravitation, cela veut dire que dans le passé elles étaient encore plus petites et rien n’explique pourquoi l’univers était si homogène dans le passé.
-
2.
Le problème de la platitude.
Selon les observations, est très proche de 1(). Dans ce cas la première équation de Friedmann implique et , donc . Pour la matière non relativiste() et la radiation() cela implique que croît dans le temps. En même temps l’équation (4.16):
implique que la valeur de s’éloigne rapidement de 1(sauf si elle est exactement 1). Le fait que soit si proche de 1 de nos jours demande un enorme ajustement fin de près de 1 au début de l’univers.
-
3.
Le problème de l’horizon.
Les observations du CMB montrent qu’ à l’époque de la dernière diffusion (last scattering) l’univers était quasi-homogène. Ce qui pose problème est le fait que, selon le modèle cosmologique standard, toutes les régions de l’univers n’avait pas eu le temps d’entrer en contact causal jusqu’à cette époque, il n’y a, donc, aucune raison qu’elles aient, par exemple, la même température.
-
4.
L’absence des défauts topologiques.
La densité d’énergie dans l’univers primordial était assez élevée pour produire en abondance des défauts topologiques, prédites par les théories de grande unification, comme les monopoles, les murs des domaines (domain walls) ou les cordes cosmiques. Mais ces défauts n’ont pas été observés jusqu’à présent. En fait, la densité prédite est si grande qu’elle entraînerait le collapse de l’univers.
-
5.
L’origine des anisotropies du CMB ne trouve pas d’explication dans la théorie du Big Bang.
4.3 Inflation
Certains des problèmes du modèle du Big Bang trouvent une réponse dans le scénario de l’inflation. L’inflation correspond à une période pendant laquelle décroît, c’est à dire que le facteur d’échelle croît plus vite que le rayon de l’horizon . Ceci permet de résoudre le problème de la platitude.
Pendant l’inflation l’univers subit une phase d’expansion accélérée et, d’une certaine manière, on peut dire que l’expansion est plus rapide que la vitesse de la lumière. Les objets qui ont été en contact causal peuvent être separés, à cause de l’inflation, par des distances plus grandes que le rayon de Hubble(plus grandes, donc, que leurs horizons respectifs). Ceci veut dire que des objets, qui, après l’inflation, semblent ne pas avoir été en contact causal, ont pu être en contact avant l’inflation, ce qui explique pourquoi elles ont les mêmes propriétés et résout le problème de l’horizon.
Egalement l’expansion très rapide de l’univers pendant l’inflation implique une forte dilution des défauts topologiques expliquant le fait qu’ils n’ont pas été observés. Ceci est également le cas pour les inhomogénéités, ce qui explique la quasi homogénéité de l’univers.
De la même manière la matière existant dans l’univers primordial serait diluée par l’inflation. La création de la matière observée aujourd’hui et la thermalisation trouvent une explication dans les méchanismes de réchauffement (reheating) et préchauffement (preheating) [38]. Ces méchanismes doivent être contrôlés pour ne pas produire à leur tour des défauts topologiques.
L’inflation prédit des anisotropies dans le CMB avec les bonnes propriétés(adiabatiques et invariantes d’échelle[39]), mais pour obtenir la bonne amplitude des anisotropies des ajustements fins sont nécessaires.
La condition pour avoir un régime d’inflation est donnée par:
| (4.18) |
c’est à dire pour un univers en expansion(), donc une expansion accélérée. L’équation de Friedmann (4.6):
| (4.19) |
montre qu’on peut obtenir un tel régime dans un univers qui contient un fluide parfait avec pression négative. La constante cosmologique peut être alors un bon candidat, mais un univers dominé par une constante cosmologique sera dominé dans le futur par une constante cosmologique et ne pourra pas donner lieu à une époque dominée par la matière ou la radiation. L’univers sera en expansion exponentielle éternelle.
Le bon candidat s’avère être un champ scalaire, appelé inflaton, qui possède une énergie potentielle:
| (4.20) |
Le tenseur énergie impulsion:
| (4.21) |
dans le cas d’un univers et matière homogènes, décrit un fluide parfait avec la densité d’énergie:
| (4.22) |
et la pression:
| (4.23) |
L’équation du mouvement de l’inflaton dans un univers FLRW666Friedmann-Lamaître-Robertson-Walker est donnée par:
| (4.24) |
et les équations de Friedmann prennent la forme :
| (4.25) |
la dernière équation étant redondante. Ce système conduit à une expansion accélérée dans l’approximation de slow-roll(descente lente), qui consiste à négliger l’énergie cinétique de l’inflaton devant son énergie potentielle:
| (4.26) |
ce qui implique . Une deuxième condition est : . Les équations (4.24) et (4.25) deviennent alors:
| (4.27) |
Les conditions de slow-roll sont généralement décrites par les paramètres:
| (4.28) |
avec , la masse de Planck quadri-dimensionnelle.
L’expansion pendant l’inflation peut se mésurer en nombre de e-foldings:
| (4.29) |
qui est relié au potentiel de l’inflaton par le fait que :
| (4.30) |
Pour résoudre, par exemple, le problème de l’ajustement fin de , 70 e-foldings seraient nécessaires.
Le premier modèle de type inflation a été proposé par Alexei Starobinsky [40], mais la motivation du modèle n’était pas la résolution des problèmes de la théorie du Big Bang. Alan Guth a proposé en 1981, un modèle plus simple, qu’on appelle "old inflation"[41]. Dans ce modèle l’univers subit une inflation exponentielle dans un état de "faux" vide avec une large densité d’énergie. Le vrai vide aparraît sous forme de bulles qui entrent en collision. Le problème de ce scénario est que pour résoudre les difficultés du modèle standard cosmologique le taux de création des bulles doit être plutôt faible, mais dans ce cas, comme l’espace est en expansion, les bulles ne s’unissent pas. Un scénario avec plus de chances de reussite a été proposé par A. Linde[42]. Ce modèle, appelé "new inflation", demande un potentiel très plat près de , ce qui est assez artificiel, et n’arrive pas à expliquer tous les problèmes du Big Bang. Le modèle de l’inflation chaotique[43] a montré que l’inflation peut être obtenue avec des potentiels de forme très simple. Par exemple avec un potentiel de la forme:
| (4.31) |
si initialement la valeur l’inflaton est très grande, l’équation (4.25) implique que est grand également, donc le terme de friction est aussi très grand, ce qui permet que l’inflaton entre dans un régime de slow-roll et l’inflation peut avoir lieu. Le nombre des e-foldings est donné par :
| (4.32) |
donc initialement l’inflaton a une valeur et l’inflation s’arrête lorsque , c’est à dire . A la fin de l’inflation le champ commence à osciller autour du minimum du potentiel et perd son énergie en créant des paires de particules élémentaires. C’est le mécanisme de réchauffement. Une fois que les particules produites se sont thermalisées l’univers peut être décrit par le modèle cosmologique standard.
Après l’inflation la taille de l’univers peut atteindre des valeurs beaucoup plus grandes que la taille de l’univers visible, cm. Si l’univers était initialement formé de plusieures régions avec des différentes valeurs pour , les régions où la valeur de l’inflaton n’est pas assez large ne vont pas subir d’inflation et à la fin de l’inflation l’univers sera formé d’immenses "îles" hommogènes, de taille beaucoup plus grande que l’univers observable, qui apparaissent du chaos initial, d’où le nom d’inflation chaotique.
Il existe également des modèles d’inflation "hybride"[44], qui utilisent deux champs scalaires, dont un joue le rôle de l’inflaton et l’autre permet d’arrêter l’inflation. La motivation de ce modèle est d’éviter que l’inflation commence avec une valeur . L’exemple le plus simple est le potentiel effectif :
| (4.33) |
Le champ a une masse effective . Pour le potentiel pour a un minimum à . Le champ est pris au piège au minimum et le potentiel effectif pour l’inflaton, est:
| (4.34) |
où . Ce potentiel permet que l’inflation a lieu si . Pendant l’inflation le champ décroît lentement jusqu’à la valeur . Le potentiel pour est alors modifié et deux nouveaux minimas apparaissent en . Ceci modfie le potentiel de l’inflaton et l’inflation prend fin.
Les anisotropies du CMB peuvent être une source d’information sur le potentiel de l’inflation. En effet le fond diffus cosmologique n’est pas complètement isotrope. Les déviations de l’isotropie sont de l’ordre de et représentent un des outils observationnels les plus précis en cosmologie. A l’origine de ces déviations se trouvent les inhomogénéités dans l’univers au moment de la dernière diffusion. Les variations dans la densité de matière ont généré des potentiels gravitationnels qui ont eu comme conséquence l’émission des photons avec de légères variations de longueur d’onde, qui se traduisent dans les anisotropies de température du CMB. Les inhomogénéités initiales se sont accentuées par instabilité gravitationnelle et sont à l’origine des grandes structures observées aujourd’hui, étoiles, galaxies et clusters. Dans ce sens les anisotropies du CMB portent l’empreinte des conditions initiales qui ont généré la structure de l’univers.
L’origine des perturbations dans la densité de matière est un point clé de la cosmologie et l’inflation offre une solution: l’expansion accélérée peut convertir des fluctuations quantiques du vide en perturbations cosmologiques classiques. L’inflation dilue la matière initiale et l’univers se retrouve dans un état du vide. Un état du vide dans un univers en expansion a une température non nulle, la température de Gibbons-Hawking
| (4.35) |
et les fluctuations de l’inflaton sont données par pour toutes les longueurs d’onde. Ces fluctuations sont reliées à celles de la densité par:
| (4.36) |
Le spectre des fluctuations scalaires est donné par:
| (4.37) |
où est évalué au moment où les perturbations sont gelées, c’est à dire au moment où la longueur d’onde physique devient égale au rayon de l’horizon, . D’autre fluctuations possibles sont les fluctuations tensorielles de la métrique:
| (4.38) |
L’amplitude des perturbations du CMB offre des informations sur l’échelle d’énergie de l’inflation. Si les anisotropies du CMB sont dues en grandes parties aux fluctuations tensorielles on peut déduire rapidement . Si les anisotropies du CMB sont de nature scalaire on en déduit et si n’est pas extrêmement petit on peut conclure que .
Chapitre 5 Cosmologie des cordes
5.1 Inflation et alternatives à l’inflation en théorie des cordes
La principale critique qui puisse être formulée à l’égard des modèles d’inflation est le fait que l’inflaton est ajouté "ad hoc" avec l’espoir que ce scénario pourrait trouver une justification dans un cadre plus fondamental. Les modules des cordes qui décrivent la géométrie des compactifications pourraient être des possibles candidats pour l’inflaton. Le potentiel de l’inflaton doit être assez plat, mais pas complètement. Dans les théories des cordes supersymétriques il y a des directions plates, qui pourrait être utiles pour l’inflation, aprés brisure de supersymétrie.
Inflation des branes. Il existe en théorie des cordes des modèles qui essayent de générer l’inflation en utilisant des -branes. Dans ces modèles la distance entre les -branes est identifiée à l’inflaton. Si la configuration des branes est supersymétrique, il n’y a aucune force entre les branes, l’attraction gravitationnelle étant compensée par la répulsion due aux charges de R-R, et l’inflaton n’a pas de potentiel. En revanche, la brisure de la supersymétrie peut générer un potentiel attractif de la forme utile pour l’inflation[49]. Une possibilité est d’utiliser des configurations des et branes. Dans ce cas, les branes ayant des charges opposées, la force due aux charges R-R est attractive et s’ajoute à la force gravitationnelle. Le potentiel généré dans ce cas, après compactification à 4 dimensions, a la forme d’un potentiel gravitationnel:
| (5.1) |
où est la distance entre les branes, associée à l’inflaton, est le nombre des dimensions transverses aux branes et et sont des coefficients reliés à la tensions des branes et au volume des dimensions compactes parallèles aux branes. Les conditions de slow-roll se traduisent par , où est le rayon des dimensions transverses compactes. Mais les branes ne peuvent pas être séparées par une distance plus grande que la taille des dimensions compactes. Ce problème peut être contourné dans certains modèles[50].
Quand la distance entre les branes devient de l’ordre de l’échelle de longueur des cordes un mode tachyonique apparît dans le spectre des cordes ouvertes [51]. Le potentiel du tachyon reproduit les potentiels utilisés dans l’inflation hybride. La brisure de symétrie correspond dans ce cas à l’annihilation des branes. Le mécanisme doit être controlé pour que, après annihilation, il reste des - branes. L’annihilation est encore mal comprise et on ne sait pas comment le réchauffement se produit.
Les cordes permettent aussi la formulation des modèles qui pourraient être des alternatives à l’inflation. En théorie des cordes l’action effective prend la forme:
| (5.2) |
où est le dilaton et le scalaire de Ricci. Cette action représente l’interaction graviton-dilaton, qui sont des états de la corde fermée. Cette contribution vient de la sphère (), ce qui explique la dépendance dans la constante de couplage des cordes. Pour retrouver l’action de Einstein-Hilbert habituelle,
| (5.3) |
il faut effectuer la transformation suivante de la métrique:
| (5.4) |
en dimension . Les courbures scalaires sont reliées alors par:
| (5.5) |
L’action de Einstein-Hilbert devient:
| (5.6) |
L’action de la relativité générale, , est invariante sous la transformation , qui se traduit pour le facteur d’échelle et la constante de Hubble par:
| (5.7) |
La présence du dilaton permet d’avoir une nouvelle symétrie:
| (5.8) |
La transformation implique . Cette dualité d’échelle, combinée avec l’inversion du temps, rend l’espace des solutions plus riche que dans la cosmologie standard. Une solution en cosmologie des cordes contient quatre branches: . Deux branches décrivent des univers en expansion() et les deux autres des univers en contraction(). Entre autre une solution, , décrivant un univers en expansion avec une courbure décroissante, , admet une solution duale, , valable pour , qui décrit un univers en expansion avec courbure croissante, (et qui dans le repère d’Einstein apparaît comme un univers en contraction).
Ceci est le point de départ du modèle du pre-Big Bang[45], qui suppose que le Big Bang n’est pas le début de l’Univers, mais le passage entre une époque pre-Big Bang et l’univers actuel, post-Big Bang. Dans ce scénario l’univers commence dans un état avec densité d’énergie et courbure faibles. A cause d’une instabilité l’univers commence à se contracter et la courbure croît. Avant d’atteindre la singularité du "Big Crunch", l’univers "s’échappe"111Le passage entre la contraction et l’expansion reste un phénomène spéculatif, connu dans la littérature sous le nom de ”gracefully exit”., de la phase de contraction et entre dans la phase d’expansion, le post-Big Bang.
Ce scénario n’est pas complètement indépendant de l’inflation, mais permet d’obtenir les avantages de l’inflation avec un épisode inflationnaire situé dans le pre-Big Bang et non pas après le Big Bang, l’avantage étant que la question de ce qui a précédé l’inflation dans le modèle standard cosmologique est éliminée. Un autre avantage du modèle du pre-Big Bang est le fait que son point de départ est la théorie des cordes, qui pourrait être la théorie fondamentale des interactions, par rapport à l’inflation qui n’a pas encore trouvé de justification dans une théorie plus fondamentale.
Le problème principal du modèle du pre-Big Bang est la phase de transition entre les solutions pre- et post-Big Bang. Ce passage se passe à couplage fort et la théorie des cordes n’est pas encore assez développée pour maîtriser ce problème non-perturbatif.
Un autre scénario qui s’inspire de la théorie des cordes est le modèle de l’univers ekpyrotic[46]. Son point de départ est la théorie de Horava-Witten[47] (M-théorie hétérotique compactifiée à 5 dimensions). L’univers quadri - dimensionnel a comme frontières deux - branes, une avec tension positive et une avec tension négative. Dans ce scénario nous vivons sur la brane avec tension négative, appelée brane "visible" (l’autre brane s’appelle la brane "cachée"). Une troisième brane se déplace dans le bulk. L’état initial est statique et proche du vide. La dynamique est générée par une faible brisure de la supersymétrie qui crée un potentiel atractif entre la brane visible et la brane dans le bulk. La collision de ces deux branes, appelée "ekpyrosis", correspond au Big Bang. La brane du bulk est absorbée dans la brane visible et une partie de son énergie cinétique génére la matière sur la brane visible. Au moment de la collision les branes sont presque parallèles ce qui assure l’homogénéité et l’isotropie de l’univers. Les fluctuations quantiques des branes peuvent être la source des anisotropies du CMB. Un observateur sur la brane visible verrait l’époque avant la collision comme un univers en contraction et l’époque d’après comme notre univers en expansion. Contrairement au pre-Big Bang ce scénario n’utilise pas l’inflation, mais il reste incomplet.
Un scénario amelioré est l’univers cyclique[48] dans lequel le Big Bang correspond à la collision des branes visible et cachée. Les branes sont supposées pouvoir passer l’une à travers l’autre et ensuite revenir pour une nouvelle collision et ainsi de suite. A la fin de chaque cycle, avant la collision, il y a une expansion générée par une constante cosmologique qui prepare les conditions pour un nouveau cycle. D’une certaine manière ce scénario fait appel lui aussi à l’inflation.
La collision des branes dans les modèles de l’univers ekpyrotic et cyclique a lieu à couplage faible, néanmoins le mécanisme n’est pas encore compris et reste spéculatif.
5.2 Orbifolds Lorentziens
Les orbifolds dépendants du temps permettent de modéliser en théorie des cordes la singularité du Big Bang. Par exemple les modèles ekpyrotic et cyclic utilisent des orbifolds dépendants du temps de la théorie M.
La théorie des cordes est caractérisée par deux développements perturbatives:
-
le développement en puissances du couplage , comme en théorie des champs
-
le développement en qui est typique aux cordes et dispparaît dans la limite , où est la longueur des cordes
Les termes d’ordre supérieur en deviennent importants lorsque la courbure de l’espace-temps devient importante, comme dans la région de la singularité du Big Bang. Les orbifolds représentent des solutions exactes en . Les singularités des orbifolds euclidiens (les points fixes) sont "résolues" en théorie des cordes, dans le sens que la propagation des cordes est bien définié et les cordes voient une géométrie régulière. On pourrait espérer qu’il soit de même pour les singularités des orbifolds lorentziens, mais ces modèles sont plus compliqués et encore mal compris.
L’exemple de plus simple d’orbifold lorentzien est le quotient de l’espace de Minkowski , par le groupe , engendré par le boost:
| (5.9) |
où sont les coordonnées du cône de lumière.
Les régions avec décrivent un espace de Milne. Avec le changement des coordonnées la métrique se réécrit: , avec . L’espace de Milne présente une singularité de type espace à et la métrique dépend du temps.
Les régions décrivent des espaces de Rindler avec la métrique , avec . Ces régions contiennent des courbes fermées du genre temps.
La fonction de partition pour l’orbifold lorentzien est donnée par:
| (5.10) |
où est le projecteur dans les états invariants sous les boosts. Le spectre perturbatif de cet orbifold a été trouvé en [58].
En [55] un argument de rélativité générale a été exposé pour montrer que les orbifolds dépendants du temps sont instables: l’addition d’une particule causerait l’effondrement de tout l’espace-temps dans une singularité. Une particule localisée dans l’orbifold correspond à une infinité des particules dans l’espace de Minkowski reliées par des boosts. L’intéraction entre les images des particules peut créer un trou noir si le paramètre d’impact, , est plus petit que le rayon de Schwarzchild associé à l’énergie du centre de masse, , de la particule et son -ième image :
| (5.11) |
avec la constante de Newton. Pour l’orbifold de l’espace de Minkowski bi-dimensionnel par un boost, l’énergie du centre de masse de la particule et son -ième image croît comme , et le paramètre d’impact est indépendant de . La condition pour la formation d’un trou noir est satisfaite et pour grand le rayon de Schwarzchild est arbitrairement grande et occupe tout l’espace.
In [57] des amplitudes de diffusion des cordes au niveau des arbres ont été calculées dans un espace-temps de Milne et il a été montré que ces amplitudes présentent des divergences associées à l’échange du graviton prés de la singularité cosmologique. Ces divergences peuvent être évitées par un ajustement fin des conditions initiales.
Le spectre des cordes dans l’espace-temps de Milne a été obtenu en [58].
5.3 Solutions cosmologiques des cordes nonsupersymétriques
Les cordes nonsupersymétriques présentent un intérêt particulier pour la cosmologie, car l’espace de Minkowski n’est plus une solution du vide et on peut obtenir des solutions dépendantes du temps, donc, une évolution cosmologique. En [60] nous avons trouvé des solutions dépendantes du temps pour un modèle générique d’orientifold de la théorie IIB, qui contient des - branes et - planes. Les branes sont placées, comme sur la figure 5.1, à l’origine, , et en , où est une coordonnée compacte, , orthogonale aux branes, et avec la symétrie .
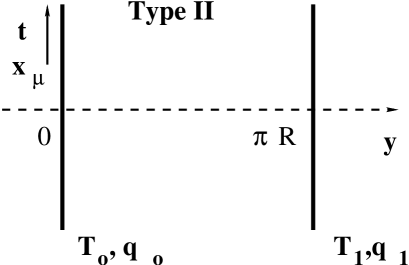
La somme des tensions(charges R-R) des objets localisés en est notée ( ) et ( ) pour les objets en . La condition d’annulation des tadpoles impose , en revanche la somme des tensions peut être non nulle. Comme la supersymétrie est brisée nous incluons une constante cosmologique dans le bulk, . Ce type de configuration peut être obtenue, par exemple, dans le modèle exposé à la fin de la section 3.2.2, après une T-dualité.
L’action effective est donnée par:
où est la 9-forme de R-R qui couple aux - branes et - planes, la métrique induite et , avec l’échelle des cordes. Les équations classiques n’admettent pas de solution avec la symétrie [37]. Nous avons cherché des solutions avec la plus grande symétrie possible, c’est à dire . Les solutions dépendent de la coordonnée compacte et d’une autre coordonnée qui peut être le temps ou une autre coordonnée d’espace. Nous nous intéressons ici à une des solutions dépendantes du temps qui présente une relation intéressante avec une solution supersymétrique. La forme générale d’une solution dépendante du temps est :
| (5.13) |
où est la forme de volume en 10 dimensions et correspond à un 8-hyperboloid, l’espace plat à 8 dimensions et la 8-sphère pour la métrique 8-dimensionelle à et fixés. La 9-forme n’est pas dynamique et peut être absorbée dans la constante cosmologique:
| (5.14) |
avec une fonction impaire périodique de et pour .
On définit dans la suite la constante cosmologique effective:
| (5.15) |
Deux conditions nécessaires pour avoir des solutions sont:
| (5.16) |
Pour les solutions des équations d’Einstein et du dilaton sont données, dans le repère d’Einstein, par :
| (5.17) |
| (5.18) |
où les paramètres et sont reliés aux tensions, à la charge et à la constante cosmologique:
| (5.19) |
et est une constante d’intégration, choisie positive, pour éviter les singularités.
Par le changement des coordonnées :
| (5.20) |
on obtient une métrique indépendante du temps:
| (5.21) |
valable pour . Cette solution a la même forme que la solution supersymétrique de Polchinski-Witten [62]. Comme on le verra dans la suite la dépendance dans le temps de notre solution initiale est reportée dans le nouveau repère sur les frontières.
Dans ce nouveau système de coordonnées la symétrie devient une parité, , dans la coordonnée , multipliée avec un boost de paramètre , . La parité initiale sur la surface d’univers , , devient . On peut vérifier facilement que car . Par conséquent .
L’identification sur la cercle se traduit dans les coordonnées par un boost, avec la vitesse determinée par les tensions, la charge et la constante cosmologique:
| (5.28) |
Les points fixes dans l’espace sont donnés par:
| (5.29) |
Les branes et orientifolds situes à l’origine se déplacent avec la vitesse
| (5.30) |
dans le fond statique (5.21), alors que les objets en ont une vitesse
| (5.31) |
Les conditions aux bords (5.19) se réécrivent sous la forme:
| (5.32) |
qui répresente une condition d’annulation des tadpoles de NS "boostée".
L’espace-temps obtenu est présenté dans la figure 5.2.
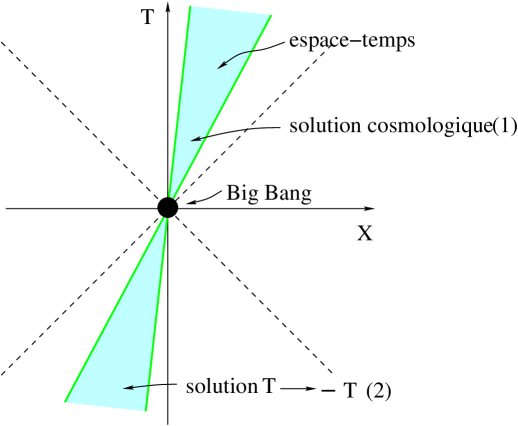
L’espace-temps est contenu entre les deux frontières en mouvement. A il y a une singularité de type Big Bang et l’approche de théorie effective n’est plus valable. Nous avons représenté également la solution . En supposant que les corrections des cordes permettraient une transition continue entre les deux solutions on obtient un univers du type pre-Big Bang.
Il est intéressant d’étudier la métrique perçue par un observateur sur les branes. La métrique induite à l’origine est complètement plate et un observateur situé sur les branes en ne verrait pas la singularité à . Sur l’autre frontière l’obervateur perçoit un univers en expansion avec une singularité dans la passé:
| (5.33) |
avec . La singularité à est une illusion, car la métrique perd sont validité à .
En [63] cette solution a été compactifiée à 4 dimensions. Nous avons choisi le cas , c’est à dire , ce qui est effectivement le cas dans le modèle discuté à la fin de la section 3.2.2 dans la limite où la distance entre les orientifolds est très grande. Dans ce cas les points fixes sont donnés par:
| (5.34) |
Les branes et orientifolds situés à l’origine sont en repos, alors que les objets localisés en se déplacent avec la vitesse . Les conditions aux bords (5.19) se réécrivent:
| (5.35) |
et la condition (5.32) est alors équivalente à la condition d’annulation des charges de R-R.
Nous considèrons que les branes placées en contiennent des champs de jauges, :
| (5.36) |
avec relié au couplage de Yang-Mills 9d.
La métrique initiale dans la repère d’Einstein et le dilaton sont donnés par:
| (5.37) |
et la métrique se réécrit dans le repère des cordes:
| (5.38) |
Nous considèrons que cinq dimensions parallèles aux branes et orientifolds sont compactifiées sur un tore. On obtient des - branes et - planes qui se propagent dans un espace-temps cinq-dimensionnel. Les coordonnées sont indexées par , où sont les coordonnées noncompactes plus la coordonnée et sont les cinq coordonnées parallèles aux - branes et - planes.
La compactification de 10 à 5 dimensions implique:
| (5.39) |
où est le volume du tore interne cinq-dimensionnel avec le paramètre constant de volume et est donnée par:
| (5.40) |
La métrique 5d prend la forme suivante, dans le repère des cordes:
| (5.41) |
Dans le repère d’Einstein la métrique et le volume 5d sont donnés par:
| (5.42) |
| (5.43) |
Cette métrique est une solution classique du lagrangien :
| (5.44) | |||||
où , et dénotent maintenant les tensions et charges des - branes.
Si au cours de l’évolution temporelle l’espace interne 5d devient plus petit que l’échelle des cordes il faut effectuer des T-dualités le long des coordonnées du tore 5d. Après les T-dualités le volume 5d devient et le couplage des cordes est . Le lagrangien 5d qui décrit la solution après les T-dualités est donné par:
| (5.45) | |||||
En définissant le temps propre, dans le repère des cordes, sur la brane avec vitesse constante par:
| (5.46) |
on obtient un univers en contraction :
| (5.47) |
avec un couplage de Yang-Mills independant du temps:
| (5.48) |
où dénote le volume 5d en unités de l’échelle des cordes. Si il faut effectuer des T-dualités le long du tore 5d. La solution T-duale décrit un univers en expansion. Le couplage des cordes et d’ordre un, , et il détermine également le couplage de Yang-Mills .
Dans le repère d’Einstein l’univers apparaît en expansion :
| (5.49) |
Ceci décrit un univers FRW avec une équation d’état et le paramètre de Hubble222Ce résultat ne contredit pas la cosmologie 4d, car, en fait, il est obtenu à partir de la métrique 5d (5.43) induite sur les branes.:
| (5.50) |
L’évolution cosmologique conduit à un univers avec trois dimensions spatiales larges, une dimension de l’ordre du mm et cinq dimensions compactes très petites et avec un évolution cosmologique très lente. Le couplage des cordes est de l’ordre de et l’échelle des cordes vaut .
En [64] nous avons étudié la stabilisation de la coordonnée noncompacte , appelée dans la suite, pour le lagrangien (5.45). Dans ce but nous avons rajouté des potentiels sur les frontières:
Ces potentiels peuvent être généres par des effets nonperturbatifs. Par exemple, en prenant en compte l’anomalie de Weyl à une boucle, qui intervient lors de la transformation de Weyl qui effectue le passage entre le repère des cordes et celui d’Einstein, on obtient, après la condensation des jauginos, des potentiels de la forme:
| (5.51) |
Nous déffinisons les potentiels complets qui incluent ceux déjà existants en (5.45):
| (5.52) |
et nous cherchons des solution de la forme:
La solution obtenue:
| (5.53) |
est, en fait, équivalente, après un changement des coordonnées à (5.43). On trouve également les conditions locales suivantes pour les potentiels:
où et est le potentiel supersymétrique(BPS: ). Ces conditions imposent que les sources, pour les champs du bulk, données par les branes non BPS, soient les mêmes que pour les branes BPS.
Nous avons étudié deux examples pour lesquels .
(i) . Dans ce cas les conditons aux bords impliquent
On retrouve donc le potentiel supersymétrique et la coordonnée n’est pas stabilisée.
(ii) . Les conditions aux bords déterminent les paramètres du potentiel:
En tenant compte du fait que , la première condition implique , c’est à dire que le volume de l’espace compact est très grand, ce qui permet de réaliser effectivement les hierachies décrites en [63]. On obtient également une condition pour :
Le potentiel total s’écrit:
et en intégrant sur la coordonnée on obtient un potentiel quadri-dimensionnel positivement défini, comme dans les théories de supergravité sans échelle [65]:
Le dilaton peut être stabilisé par la suite en ajoutant des flux de R-R et NS-NS[66][67]. En [64] nous avons montré qu’il existe également des solutions de Sitter dans le voisinage des solutions Minkowski.
Une fois que le potentiel nonperturbatif apparaît l’evolution temporelle s’arrête réalisant les hierarchies en [63] et tout en permettant que soit stabilisé à une valeur assez petite pour ne pas créer des problèmes phénomènologiques comme la déviation de la loi de Newton. Nous avons également construit en [64] des modèles chiraux en 6 et 4 dimensions, en utilisant des orbifolds et , pour lesquels tout les considérations de cette section s’appliquent.
5.4 Conclusion
Les théories des cordes avec brisure de supersymétrie sont un cadre naturel pour l’étude de la cosmologie. Nous avons construit des orbifolds non-tachyoniques de la théorie des cordes avec brisure de supersymétrie à la Scherk-Schwarz en dimension 8, 6 et 4. Les modèles en dimension 6 et 4 contiennent des fermions chiraux. Les théories effectives de ces modèles générent des solutions dépendantes du temps qui s’interprètent comme des frontières en mouvement dans un espace-temps statique soumis à une identification par un boost. Ces solutions peuvent être compactifiées à 4 dimensions et générent des couplages de jauge indépendants du temps, au niveau des arbres, sur les - branes, qui sont les frontières. L’anomalie de Weyl à une boucle induit une dépendance logarithmique dans le temps de ces couplages et après un temps exponentiellement long le système entre dans un régime non-perturbatif qui invalide notre solution. Ce temps très long qui s’écoule avnat le régime non-perturbatif permet une évolution cosmologique qui génére des hierarchies entre l’échelle des cordes et la masse de Planck.
Nous avons étudié le problème de stabilisation des modules. Dans ce but nous avons ajouté des potentiels sur les branes et nous avons trouvé que pour stabiliser les modules internes ces potentiels doivent reproduire sur les frontières les mêmes sources que dans le cas supersymétrique. Après stabilisation la solution classique devient la même que dans le cas non-supersymétrique. Cette procédure ne stabilise pas le dilaton, qui peut être stabilisé, par la suite, en ajoutant des flux de R-R et NS-NS. Dans le cas des potentiels non-perturbatifs, induits par condensation de jauginos, on obtient un potentiel défini positif, comme dans les théories de supergravité sans échelle.
Un des résultats principaux du travail effectué pendant cette thèse a été de trouver les solutions du vide pour des modèles de cordes avec brisure de supersymétrie et tadpoles de NS, car dans ces cas l’espace-temps de Minkowski n’est plus une solution. Comme certaines de ces solutions présentent une dépendance dans le temps, elles s’avèrent utiles pour étudier des problèmes liés à la cosmologie. Néanmoins ces solutions sont encore loin des modèles cosmologiques réalistes et des questions comme leur stabilité quantique et la quantification des cordes dans ces fonds restent à étudier. D’autre part nous avons montré qu’on peut construire des modèles de cordes avec des caractéristiques réalistes, brisure de supersymétrie, absence des tachyons et présence des fermions chiraux en 4d, mais on est encore loin de la réalisation du Modèle Standard comme limite de basse énergie de la théorie des cordes.
Références
- [1] G. Veneziano, "Construction of a crossing-symmetric, Regge behaved amplitude for linearly rising trajectories", Nouvo. Cim. A57 (1968) 190.
- [2] M.B. Green and J. Schwarz, "Anomaly cancellation in supersymmetric D=10 gauge theory and superstring theory", Phys. Lett. B149 (1984) 117.
- [3] D.J. Gross, J.H. Harvey, E. Martinec and A. Rohm, "Heterotic String Theory 1. The free heterotic string", Nucl. Phys. B 256 (1985) 253; "Heterotic String Theory 2. The interacting heterotic string", Nucl. Phys. B 267 (1986) 75.
- [4] J. Polchinski, Phys. Rev. Lett. 75 (1995), 4727, [hep-th/9510017].
- [5] Y. Nambu, "Lectures at the Copenhagen symposium", 1970.
- [6] T. Goto, "Relativistic quantum mechanics of one-dimensional mechanical continuum and subsidiary condition of dual resonance model", Prog. Theor. Phys. 46 (1971) 1560.
- [7] S. Desser and B. Zumino, "A complete action for the spining string", Phys. Lett. B65 (1976) 369; L. Brink, P.Di. Vecchia and P. Howe, "A locally supersymmetric and reparametrisation invariant action for the spining string", Phys. Lett. B65 (1976) 471.
- [8] A.M. Polyakov, "Quantum geometry of bosonic strings", Phys. Lett. 103B (1981) 207.
- [9] P. Ramond, "Dual theory of free fermions", Phys. Rev. D3 (1971) 2415.
- [10] A. Neveu and J. Schwarz, "Factorizable dual model of pions", Nucl. Phys. B31 (1971) 86.
- [11] F. Gliozzi, J. Scherk and D. Olive, "Supergravity and the spinor dual model", Phys. Lett. 65B (1976) 282; "Supersymmetry, supergravity theories and the dual spinor model", Nucl. Phys. B122 (1977) 253.
- [12] A. Sen, hep-th/9904207.
- [13] E. Dudas, J. Mourad et A. Sagnotti, hep-th/0107081.
- [14] M.B. Green and J. Schwarz, "Supersymmetric dual string theory", Nucl. Phys. B181 (1981) 502; "Supersymmetrical string theories", Phys. Lett. 109B (1982) 444.
- [15] D. Friedan, "Introduction to Polyakov’s String Theory", Proc. of Summer School of Theoretical Physics: Recent Advances in Field Theory and Statistical Mechanics, Les Houches, France, Aug 2 - Sep 10, 1982.
- [16] E. Witten, "String theory dynamics in various dimensions", Nucl. Phys. B 443 (1995) 85, [hep-th/9503124]; P.K. Townsend, "The eleven-dimensional supermembrane revisited", Phys. Lett. B 350 (1995) 184, [hep-th/9501068]; C.M. Hull and P.K. Townsend, "Enhanced gauge symmetries in superstring theories", Nucl. Phys. B 145 (1995) 525, [hep-th/9505073]; "Unity of superstring dualities", Nucl. Phys. B 438 (1995) 109, [hep-th/9410167].
- [17] C. Angelantonj, A. Sagnotti, “Open Strings”, Phys. Rept. 371 (2002), [hep-th/0204089]
- [18] A. Sagnotti, in Cargese ’87, "Non-perturbative Quantum Field theory", eds G.Mack et all (Pergamon Press, 1988), p.521, [hep-th/0208020]; G. Pradisi and A. Sagnotti, Phys. Lett. B 216(1989), 59; P. Horava, Nucl. Phys B 327 (1989) 461, Phys. Lett. B 231 (1989) 251 ; M. Bianchi and A. Sagnotti, Phys. Lett. B 247 (1990) 517, Nucl. Phys. B 361 (1991) 519; M. Bianchi, G. Pradisi and A. Sagnotti, Nucl. Phys. B 376 (1992) 365. Reviews: E. Dudas, Class. Quant. Grav. 17 (2000) R41, [hep-ph/0006190]; C. Angelantonj and A. Sagnotti, Phys. Rept. 371 (2002) 1, [hep-th/0204089].
- [19] M. R. Douglas, B. Grinstein, Phys. Lett. B 183 (1987) 52; N. Marcus , A. Sagnotti ,Phys. Lett. B 188 (1987) 58; S. Weinberg, Phys. Lett. B 187 (1987) 278; M. Bianchi, A. Sagnotti, Phys. Lett. B 211 (1988) 407.
- [20] J. H. Schwarz, Presented at 6th Johns Hopkins Workshop on Current Problems in High-Energy Particle Theory, Florence, Italy, Jun 2-4, 1982. Published in Johns Hopkins Workshop 1982:233; N. Marcus, A. Sagnotti, Phys. Lett. B 119 (1982) 97.
- [21] E. G. Gimon et J. Polchinski, hep-th/9601038
- [22] N. Seiberg , E. Witten, Nucl. Phys. B 276 (1986) 272; L. J. Dixon, J. A. Harvey, Nucl. Phys. B 274 (1986) 93.
- [23] H. M. Chan and J. E. Paton, "Generalized Veneziano model with isospin", Nucl. Phys. B10 (1969) 516.
- [24] S. Sugimoto, Prog. Theor. Phys. 102 (1999) 685, [hep-th/9905159].
- [25] P. H. Ginsparg, “Applied confroaml field theory”, Lectures given at Les Houches Summer School in Theoretical Physics, Les Houches, France, 1988, hep-th/9108028.
- [26] L. J. Dixon, J. A. Harvey, C. Vafa, E. Witten, Nucl. Phys. B 261 (1985) 678; L. J. Dixon, J. A. Harvey , C. Vafa , E. Witten , Nucl. Phys. B 274 (1986) 285.
- [27] P. Candelas , G. T. Horowitz , A. Strominger , E. Witten, Nucl. Phys. B 258 (1985) 46.
- [28] I. Antoniadis, C. P. Bachas , C. Kounnas , Nucl. Phys. B 289 (1987) 87; H. Kawai, D. C. Lewellen, S. H. Henry Tye , Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 1832; Nucl. Phys. B 288 (1987) 1; A. E. Faraggi , Phys. Lett. B 278 (1992) 131; Nucl. Phys. B 387 (1992) 239 [hep-th/9208024].
- [29] L. E. Ibanez, H. P. Nilles, F. Quevedo, Phys. Lett. B 187 (1987) 25; L. E. Ibanez, J. E. Kim, H. P. Nilles, F. Quevedo, Phys. Lett. B 191 (1987) 282; L. E. Ibanez, H. P. Nilles, F. Quevedo , Phys. Lett. B 192 (1987) 332; L. E. Ibanez, J. Mas , H. P. Nilles, F. Quevedo , Nucl. Phys. B 301 (1988) 157; A. Font , L. E. Ibanez , H. P. Nilles, F. Quevedo , Nucl. Phys. B 307 (1988) 109; A. Font , L. E. Ibanez , H. P. Nilles, F. Quevedo , Phys. Lett. 210 B (1988) 101.
- [30] A. Sagnotti, hep-th/9509080; Nucl. Phys. Proc. Suppl. 56 B (1997) 332 [hep-th/9702093].
- [31] E. Dudas, C. Grojean, Nucl. Phys. B 507 (1997) 553, [ hep-th/9704177] ; I. Antoniadis , M. Quiros , Nucl. Phys. B 505 (1997) 109 [hep-th/9705037].
- [32] I. Antoniadis, E. Dudas and A. Sagnotti, Nucl. Phys. B 544 (1999) 469 [hep-th/9807011] ; I. Antoniadis, G. D’Appollonio, E. Dudas and A. Sagnotti, Nucl. Phys. B 553 (1999) 133 [hep-th/9812118]; B 565 (2000) 123 [hep-th/9907184]; A. L. Cotrone, Mod. Phys. Lett. A 14 (1999) 2487 [hep-th/9909116]; R. Blumenhagen and L. Gorlich, Nucl. Phys. B 551, 601 (1999) [hep-th/9812158]; C. Angelantonj, I. Antoniadis and K. Forger, Nucl. Phys. B 555, 116 (1999) [hep-th/9904092].
- [33] I. Antoniadis, E. Dudas and A. Sagnotti, Phys. Lett. B 464 (1999) 38 [hep-th/9908023]; C. Angelantonj, Nucl. Phys. B 566, 126 (2000) [hep-th/9908064]; G. Aldazabal and A. M. Uranga, JHEP 9910 (1999) 024 [hep-th/9908072]; G. Aldazabal, L. E. Ibanez and F. Quevedo, JHEP 0001, 031 (2000) [hep-th/9909172]; C. Angelantonj, I. Antoniadis, G. D’Appollonio, E. Dudas and A. Sagnotti, Nucl. Phys. B 572 (2000) 36 [hep-th/9911081]; M. Bianchi, J. F. Morales and G. Pradisi, Nucl. Phys. B 573 (2000) 314 [hep-th/9910228] C. Angelantonj, R. Blumenhagen and M. R. Gaberdiel, Nucl. Phys. B 589, 545 (2000) [hep-th/0006033].
- [34] C. Bachas, hep-th/9503030.
- [35] M. Berkooz, M. R. Douglas et R. G. Leigh, Nucl. Phys. B 480 (1996) 265 [hep-th/9606139]; V. Balasubramanian and R. G. Leigh, Phys. Rev. D55 (1997) 6415 [hep-th/9611165]; N. Otha et P. K. Townsend, Phys. Lett. B 418 (1998) 77[hep-th/9710129]; R. Blumenhagen, L. Gorlich et B. Kors, Nucl. Phys. B 569 (2000) 209 [hep-th/9908130], JHEP 0001 (2000) 040 [hep-th/9912204]; G. Pradisi, Nucl. Phys. B 575 (2000) 134 [hep-th/9912218]; R. Blumenhagen, L. Gorlich, B. Kors et D. Lust, JHEP 0010 (2000) 006 [hep-th/0007024]; C. Angelantonj, I. Antoniadis, E. Dudas et A. Sagnotti, Phys. Lett. B 489 (2000) 223 [hep-th/0007090]; C. Angelantonj et A. Sagnotti, hep-th/0010279; G. Aldazabal, S. Franco, L. E. Ibanez, R. Rabadan et A. M. Uranga, JHEP 0102 (2001) 047 [hep-ph/0011132]; M. Cvetic, G. Shiu et A. M. Uranga, Nucl. Phys. B 615 (2001) 3 [hep-th/0107166]; C. Kokorelis, JHEP 0209 (2002) 029 [hep-th/0205147]; D. Bailin, G. V.N. Kraniotis et A. Love, Phys. Lett. B 553 (2003) 79 [hep-th/0210219]; G. Honeker, Nucl. Phys. B 666 (2003) 175 [hep-th/0303015]; M. Larosa et G. Pradisi, Nucl. Phys. B 667 (2003) 261 [hep-th/0305224].
- [36] C. Angelantonj, M. Bianchi, G. Pradisi, A. Sagnotti, Ya.S. Stanev , Phys. Lett. B385 (1996) 96 [hep-th/9606169]; Z. Kakushadze , Nucl. Phys. B 512 (1998) 221 [hep-th/9704059] ; Z. Kakushadze, G. Shiu, Phys. Rev. D56 (1997) 3686 [hep-th/9705163] ; Z. Kakushadze , G. Shiu, S. H. Henry Tye , Phys. Rev. D58 086001 (1998) [hep-th/9803141]; G. Aldazabal , A. Font , L. E. Ibanez, G. Violero , Nucl. Phys.: B 536 (1998) 29 [hep-th/9804026].
- [37] E. Dudas et J. Mourad, Nucl. Phys. B 598 (2001) 189 [hep-th/0010179].
- [38] L. Kofman, A. Linde et A. A. Starobinsky, "Towards the theory of reheating after inflation", hep-th/9704452.
- [39] A. Linde, "Particle physics and inflationary cosmology", Harwood Academic publishers GmbH, Chur, Switzerland, 1990.
- [40] A. A. Starobinsky, Phys. Lett. B 91 (1980) 99.
- [41] A. H. Guth, Phys. Rev. D 23 (1981) 347.
- [42] A.D. Linde, Phys. Lett. B 108 (1982) 389; A. Albrecht and P.J. Steinhardt, Phys. Rev. Lett.48 (1982) 1220.
- [43] A.D. Linde, Phys. Lett. B 129 (1983) 177.
- [44] A.D. Linde, Phys. Lett. B 49 (1994) 748 [astro-ph/9307002].
- [45] M. Gasperini and G. Veneziano, hep-th/0207130
- [46] J. Khoury, B. A. Ovrut, P. J. Steinhardt and N. Turok, Phys. Rev. D 64 (2001) 123522 [hep-th/0103239] ; J. Khoury, B. A. Ovrut, N. Seiberg, P. J. Steinhardt and N. Turok, Phys. Rev. D 65 (2002) 086007 [hep-th/0108187] ; N. Seiberg, hep-th/0201039; V. Balasubramanian, S. F. Hassan, E. Keski-Vakkuri and A. Naqvi, hep-th/0202187; L. Cornalba and M. S. Costa, hep-th/0203031 ; N. A. Nekrasov, hep-th/0203112 ; L. Cornalba, M. S. Costa and C. Kounnas, Nucl. Phys. B 637 (2002) 378 [hep-th/0204261]; A. J. Tolley and N. Turok, hep-th/0204091; C. P. Burgess, F. Quevedo, S. J. Rey, G. Tasinato and C. . Zavala, hep-th/0207104.
- [47] P. Horava et E. Witten, Nucl. Phys. B 460 (1996) 506; B 475 (1996) 94; A. Lukas, B. A. Ovrut et D. Waldram, Nucl. Phys. B 532 (1998) 43; Phys. Rev. D 57 (1998) 7529; A. Lukas, B. A. Ovrut, K. S. Stelle et D. Waldram, Phys. Rev. D 59 (1999) 086001.
- [48] P. J. Steinhardt and N. Turok, hep-th/0111030.
- [49] G. R. Dvali et S. H. H. Tye, "Brane inflation", Phys. Lett. B 450, 72 (1999) [hep-ph/9812483].
- [50] S. Kachru, R. Kallosh, A. Linde, J. Maldacena, L. MeAllister et S. P. Trivedi, "Towards inflation in string theory", JCAP 0310, 013 (2003) [hep-th/0308055].
- [51] T. Banks and L. Susskind, "Brane-Antibrane Forces", hep-th/9511194.
- [52] U. H. Danielsson, "Lectures on string theory and cosmology", hep-th/0409274.
- [53] M.B. Green, J. Schwarz and E. Witten, "Superstring Theory", 2 vols., Cambridge Univ. Press, 1988. D; Lüst and S. Theisen, "Lectures on String Theory", Lect. Notes Phys. 346 (1989) 1. E. Kiritsis, "Introduction to Superstring Theory", Leuven Univ. press, Leuven, 1988, hep-th/9709062. J. Polchinski, "String Theory", 2 vols., Cambridge Univ. Press, 1999.
- [54] J. Polchinski, S. Chaudhuri, C. V. Johnson, "Notes on D-branes", hep-th/9602052. C. P. Bachas, "Lectures on D-branes", Lectures given at the Isaac Newton Institute 1997, hep-th/9806199; C.V. Johnson, "D-Brane Primer", Lectures given at ICTP, TASI and BUSSTEPP, hep-th/0007170.
- [55] G. T. Horowitz and J. Polchinski, hep-th/0206228
- [56] N. A. Nekrasov, hep-th/0203112 ; J. Simon, JHEP 0206, 001 (2002) [hep-th/0203201] ; H. Liu, G. Moore and N. Seiberg, JHEP 0206 (2002) 045 [hep-th/0204168] ; arXiv:hep-th/0206182 ; A. Lawrence, JHEP 0211, 019 (2002) [hep-th/0205288] ; G. T. Horowitz and J. Polchinski, hep-th/0206228 ; C. Bachas and C. Hull, JHEP 0212, 035 (2002) [hep-th/0210269] ; K. Okuyama, JHEP 0302, 043 (2003) [hep-th/0211218].
- [57] M. Berkooz, B. Craps, D. Kutasov et G. Rajesh, hep-th/0212215
- [58] N. A. Nekrasov, "Milne universe, tachyons, and quantum group", hep-th/0203112 ; B. Pioline, M. Berkooz, "Strings in an electric field and the Milne universe", JCAP 0311:007 (2003) [hep-th/0307280].
- [59] K. A. Olive, "Big Bang nucleosynthesis, implications of recent CMB data and supersymmetric dark matter, astro-ph/0202486.
- [60] E. Dudas, J. Mourad et C. Timirgaziu, Nucl. Phys. B 660 (2003) 3 [hep-th/0209176].
- [61] E. Dudas et J. Mourad, Phys. Lett. B 486 (2000) 172 [hep-th/0004165].
- [62] J. Polchinski et E. Witten, Nucl. Phys. B 460 (1996) 525 [hep-th/9510169].
- [63] E. Dudas, J. Mourad et C. Timirgaziu, JCAP 0403 005 (2004) [hep-th/0309057].
- [64] E. Dudas et C. Timirgaziu, JHEP 0403 060 (2004) [hep-th/0401201].
- [65] E. Cremmer, S. Ferrara, C. Kounnas and D. V. Nanopoulos, Phys. Lett. B 133, 61 (1983) ; J. R. Ellis, C. Kounnas and D. V. Nanopoulos, Nucl. Phys. B 241, 406 (1984).
- [66] S. Gukov, C. Vafa and E. Witten, Nucl. Phys. B 584 (2000) 69 [hep-th/9906070] ; T. R. Taylor and C. Vafa, Phys. Lett. B 474 (2000) 130 [hep-th/9912152].
- [67] S. B. Giddings, S. Kachru and J. Polchinski, Phys. Rev. D 66 (2002) 106006 [hep-th/0105097] ; S. Kachru, M. B. Schulz and S. Trivedi, JHEP 0310 (2003) 007 [hep-th/0201028] ; A. R. Frey and J. Polchinski, Phys. Rev. D 65 (2002) 126009 [hep-th/0201029].