![[Uncaptioned image]](/html/cond-mat/0406682/assets/x1.png)
Remerciements
Cette thèse s’est déroulée de septembre 2000 à juin 2004 au laboratoire de physique théorique de l’Ecole Normale Supérieure. Je remercie ses directeurs successifs Jean Iliopoulos et Eugène Cremmer d’avoir bien voulu m’y accueillir, ainsi que les secrétaires Michelle Leliepvre, Marcelle Martin et Nicole Ribet, dont la gentillesse, la compétence et le dévouement sont pour beaucoup dans la qualité de vie au laboratoire.
Je ne saurais trop insister ici sur la gratitude que j’éprouve envers ma directrice de thèse, Leticia Cugliandolo. Ses compétences scientifiques et le temps qu’elle a consacré à m’en faire bénéficier m’ont été extrêmement profitables. La confiance et le soutien qu’elle m’a prodigués m’ont aussi particulièrement aidé tout au long de ces quatre années.
J’ai eu aussi le plaisir de collaborer directement avec Simona Cocco, Rémi Monasson, Andrea Montanari et Martin Weigt. De tous j’ai beaucoup appris et je les remercie très chaleureusement de m’avoir fait partager leur expérience.
Mon initiation à la physique statistique des systèmes désordonnés a eu lieu au cours d’un stage à l’université d’Oxford, je suis très reconnaissant à David Sherrington d’avoir accompagné ces premiers pas.
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l’égard de Bernard Derrida, Satya Majumdar et Cris Moore pour avoir accepté de participer au jury de cette thèse, ainsi que mes plus vifs remerciements à Ton Coolen et Marc Mézard pour avoir assuré l’exigeante tâche de rapporteur.
Parmi les chercheurs avec qui j’ai eu la chance de discuter, je tiens à remercier en particulier Alain Barrat, Michel Bauer, Giulio Biroli, Jean-Philippe Bouchaud, Werner Krauth et Jorge Kurchan.
J’ai assuré au cours des deux dernières années des travaux dirigés au sein du magistère de l’Ecole Normale. Mes très sincères remerciements vont à ses responsables Jean-Marc Berroir et Christophe Dupraz de m’avoir accueilli au sein de leur équipe, ainsi qu’aux enseignants et chargés de TD avec qui j’ai travaillé : Henk Hilhorst, Jean Iliopoulos, Chi-Tuong Pham, Nicolas Régnault, Vincent Rivasseau et Jean Zinn-Justin.
Un grand merci aussi aux thésards avec qui la cohabitation dans le même bureau fut un plaisir, à savoir Christophe Deroulers, Serge Florens, Steffen Metzger, Sébastien Ray, et tout particulièrement Grégory Schehr.
Chapitre 1 Introduction
1.1 Les verres de spin
Le domaine de la physique dans lequel cette thèse prend place est né de l’effort théorique fourni pour expliquer les résultats d’expériences sur les verres de spin, composés produits en laboratoire à partir des années 70 [1]. Expérimentalement, un verre de spin est un alliage entre un élément noble, non magnétique, et une faible fraction d’atomes dotés de propriétés magnétiques. Ce mélange est effectué à haute température, les deux espèces formant alors une phase liquide. Lorsque l’alliage est refroidi, le composé se solidifie; le métal noble cristallise dans un réseau régulier, tandis que les éléments magnétiques, largement minoritaires, jouent le rôle d’impuretés placés aléatoirement au sein du réseau régulier.
Dans une telle situation, les interactions entre moments magnétiques des impuretés dépend de la distance les séparant d’une manière très particulière 111Ce phénomène, dit interaction RKKY d’après les noms de Ruderman, Kittel, Kasuya et Yosida, est expliqué dans la plupart des livres de physique du solide, par exemple [2].. Comme on peut s’y attendre, l’intensité de l’interaction décroît pour des atomes de plus en plus éloignés. Ce qui est notable, c’est que le signe de l’interaction est une fonction oscillante de la distance les séparant. Autrement dit, certaines des interactions entre moments magnétiques sont ferromagnétiques, tendant à les aligner dans le même sens, alors que d’autres sont antiferromagnétiques et favorisent donc les configurations antiparallèles.
La présence simultanée de ces deux types d’interaction va provoquer une dépendance originale des propriétés du système par rapport à la température 222On reste toujours en dessous de la température de fusion du verre de spin, les positions des impuretés magnétiques, et donc la valeur des interactions entre elles, restent gelées à partir de la préparation de l’échantillon.. Rappelons en effet la situation dans le cas où toutes les interactions sont ferromagnétiques. Les propriétés d’équilibre d’un tel système résultent d’une compétition entre un effet énergétique, les interactions tendant à aligner tous les spins dans la même direction, et un effet entropique, l’agitation thermique favorisant plutôt un état désordonné. A haute température c’est la contribution entropique à l’énergie libre qui est dominante, on a donc un état paramagnétique dans lequel les spins fluctuent autour d’une valeur moyenne nulle. Quand on abaisse la température on assiste à une transition de phase : en dessous d’une température critique, les effets énergétiques l’emportent, et le système acquiert une aimantation macroscopique, tous les spins étant alignés dans une direction commune. L’aimantation macroscopique est ici un paramètre d’ordre, qui croît continument de zéro quand on diminue la température en dessous de sa valeur critique.
Que devient cette image dans le cadre d’un verre de spin ? A haute température la phase paramagnétique n’est pas modifiée, mais la phase de basse température est différente. Le système cherche toujours à se bloquer autour d’une configuration des spins qui minimise son énergie, mais cette configuration ne peut pas être celle avec tous les spins alignés, puisqu’une partie des interactions sont antiferromagnétiques. On a donc une transition de phase où certains degrés de liberté se figent (ce qui se traduit par une singularité sur la chaleur spécifique de l’échantillon), mais sans apparition d’une aimantation macroscopique (ni même d’aucun ordre magnétique régulier).
Une première modélisation des verres de spin a été proposée par Edwards et Anderson en 1975 [3]. Elle consiste à placer spins d’Ising sur les sommets d’un réseau en dimension finie , avec des couplages entre proches voisins de signe quelconque. L’hamiltonien du modèle est donc :
| (1.1) |
Les indices désignent les sites du réseau, et la somme porte uniquement sur les couples de sites voisins. Insistons sur le caractère différent des variables et . Ces dernières sont supposées fixées, ou gelées (quenched) de la même façon que les impuretés magnétiques ne se déplacent pas dans un échantillon de verre de spin tant qu’on ne le fait pas fondre. Les variables sont par contre soumises à des fluctuations thermiques, selon la loi de probabilité de Gibbs-Boltzmann. Le paramètre d’ordre qui décrit la transition vers la phase de basse température est défini à partir des magnétisations locales (les crochets désignent la moyenne avec le poids de Gibbs-Boltzmann) comme
| (1.2) |
A cause du signe fluctuant des interactions, l’aimantation totale reste nulle dans la phase de basse température. Le paramètre d’Edwards-Anderson que l’on vient de définir sera par contre positif, chaque spin acquièrant une magnétisation non nulle, dont la direction fluctue d’un site à l’autre.
S’il était nécessaire de connaître les positions et les couplages entre impuretés magnétiques pour prédire le comportement d’un échantillon macroscopique de verre de spin, tout travail de modélisation serait voué à l’echec, tout comme si l’on devait connaître les positions de toutes les molécules d’un gaz pour établir son équation d’état. Heureusement ce n’est pas le cas : deux échantillons de verres de spins préparés selon le même protocole expérimental seront certes très différents au niveau microscopique, mais l’on s’attend à ce que leurs propriétés macroscopiques (chaleur spécifique, température de transition,…) soient identiques. D’un point de vue théorique, cela suggère de définir des ensembles d’échantillons microscopiques qui correspondent au même procédé expérimental de fabrication. Au sein de cet ensemble les variables gelées microscopiques varient d’un échantillon à l’autre, mais les observables macroscopiques sont toutes quasiment identiques. On peut donc identifier les valeurs moyennes de ces observables avec les valeurs typiquement observées pour un échantillon donné. Dans le cadre du modèle d’Edwards-Anderson par exemple, les seront des variables aléatoires indépendantes. Leur loi de probabilité autorise des couplages positifs et négatifs de manière à reproduire la frustration présente dans les verres de spin. Il reste ensuite à calculer la valeur moyenne de l’énergie libre par rapport à cette distribution pour prédire les propriétés thermodynamiques du système.
1.2 Modèles complètement connectés
La résolution exacte du modèle d’Edwards-Anderson à trois dimensions semble une tâche impossible : pour le cas purement ferromagnétique le calcul de la fonction de partition n’a été effectué qu’à deux dimensions, et la présence de désordre dans les interactions rend le problème encore plus difficile. Une simplification du modèle, de type champ moyen, a été introduite par Sherrington et Kirkpatrick (SK) [4, 5]. Leur modèle est un analogue de celui de Curie-Weiss du ferromagnétisme : chacun des spins d’Ising du modèle interagit avec tous les autres, d’où le nom de « complètement connecté » que l’on attribue à ce type de modèle. L’hamiltonien considéré s’écrit alors
| (1.3) |
la somme portant sur toutes les paires de spins. Les couplages gelés sont des variables aléatoires positives ou négatives, leur variance étant d’ordre pour que l’hamiltonien soit extensif 333Le « volume » du système est ici le nombre de spins.. Alors que la résolution du modèle ferromagnétique complètement connecté est triviale (cf. la section 4.2), celle du modèle de Sherrington-Kirkpatrick s’est avérée très subtile et a conduit à l’introduction de concepts nouveaux en physique statistique. L’étude des modèles désordonnés de champ moyen repose souvent sur la méthode des répliques. Cette méthode n’est pas, dans sa formulation originelle, complètement rigoureuse d’un point de vue mathématique : une fonction calculée pour un nombre de répliques doit être prolongée dans la limite . Comme est a priori entier, ce prolongement n’est pas unique et nécessite l’intoduction d’hypothèses supplémentaires. La plus naturelle, utilisée par Sherrington et Kirpatrick, est dite « symétrique dans les répliques » (RS). Cet ansatz n’est pas correct à basse température car il prédit une entropie de température nulle négative, ce qui est impossible pour un modèle dont les degrés de liberté sont discrets. Un calcul de stabilité effectué par de Almeida et Thouless [6] a montré que c’était l’hypothèse RS qui était fautive : elle entraînait l’apparition de directions de fluctuations instables dans une intégrale calculée par la méthode du col.
On doit à Parisi [7, 8, 9] la formulation de l’ansatz correct pour le modèle SK. Celui-ci brise la symétrie entre les répliques (RSB), dans un schéma itératif : les répliques sont divisés en groupes de répliques, eux-mêmes sous-divisés, et ainsi de suite. Pour une reproduction des articles importants de cette époque ainsi que pour une discussion de la signification du phénomène de RSB, on pourra se reporter à [10]. Mentionnons simplement que cette brisure de symétrie est reliée à la nature particulière de la phase de basse température des verres de spin. Un système d’Ising ferromagnétique possède deux « états purs » en dessous de la température critique, correspondant aux deux signes possibles de la magnétisation : tous les moments magnétiques s’alignent dans une direction donnée de façon à minimiser l’énergie du système. Dans un verre de spins tel que le modèle SK, la situation est beaucoup plus compliquée : la frustration induite par les signes aléatoires des couplages entraîne une dégénerescence des configurations de basse énergie. On a donc un grand nombre d’états purs, l’ansatz de Parisi traduisant leur organisation dans l’espace des configurations du système.
Une preuve rigoureuse de l’exactitude de l’énergie libre prédite par l’ansatz de Parisi pour le modèle SK est apparue très récemment. Cette preuve, finalisée par Talagrand [11], s’appuie sur une méthode d’interpolation due à Guerra [12].
On peut reformuler le problème des verres de spin d’une manière légèrement différente. A très basse température, le comportement d’un système physique est, de manière générale, déterminé par ses configurations de plus basse énergie. Pour un modèle avec spins d’Ising, il y a configurations , chacune avec une énergie . Ces énergies sont, dans un modèle désordonné, des variables aléatoires : elles dépendent en effet des interactions gelées . Il conviendrait donc, pour comprendre le système à basse température, d’étudier les propriétés statistiques du minimum de ces variables aléatoires, ou plus généralement des plus petites. Il est assez facile de déterminer les propriétés des extrèmes de variables aléatoires indépendantes. La difficulté dans un verre de spin est que les énergies des configurations sont des variables aléatoires corrélées : elles dépendent toutes d’un nombre beaucoup plus petit de variables indépendantes, les couplages . Derrida [13] a introduit le modèle à énergies aléatoires (REM) comme une simplification d’un problème de verres de spin, dans lequel les énergies des configurations sont indépendantes. Ce modèle présente une transition vers une phase de basse température dans laquelle le système se gèle sur un petit nombre de configurations de basse énergie. Dans ce même article il est aussi montré que le REM peut s’obtenir à partir de la généralisation suivante du modèle SK. Dans ce dernier, les variables interagissent par paires. Dans les modèles dits « -spin », les variables interagissent par . L’hamiltonien de champ moyen correspondant est donc :
| (1.4) |
La somme porte sur tous les -uplets de variables possibles, et les intensités des interactions sont des variables aléatoires indépendantes. Dans la limite (en rééchellant judicieusement l’intensité des couplages), les énergies de deux configurations perdent toute corrélation, et on retrouve donc la définition du REM. Cette limite a aussi été étudiée par Gross et Mézard [14], qui ont trouvé que la phase de basse température était alors décrite par une version simplifiée de l’ansatz de Parisi : un seul pas dans le schéma itératif décrit plus haut est nécessaire, on parle alors de 1RSB 444Gardner [15] a montré que pour fini, il existe une deuxième température critique plus basse, en dessous de laquelle le système doit être décrit par une brisure complète de la symétrie des répliques., alors que dans le modèle SK il faut faire un nombre infini de pas de brisure des sous-groupes de répliques.
Une interprétation de la brisure à un pas de la symétrie des répliques en termes de propriétés extrémales de variables aléatoires corrélées a été donné par Bouchaud et Mézard [16].
1.3 Analogies avec des problèmes d’optimisation
Il existe une analogie, dont l’exploitation s’est avérée très fructueuse, entre les systèmes physiques du type verres de spin et les problèmes d’optimisation étudiés en mathématiques et en informatique.
Un des plus célèbres exemples de problème d’optimisation est sûrement celui du voyageur de commerce : étant données les positions de villes, on voudrait connaître le chemin fermé qui passe une et une seule fois par toutes les villes, et qui minimise le kilométrage parcouru par le représentant. Autrement dit, on veut minimiser une fonction de coût (la distance totale à parcourir) par rapport à certains degrés de liberté (l’ordre dans lequel on visite les villes), en maintenant certains paramètres (la position des villes) fixes. Si l’on remplace « fonction de coût » par énergie, « position des villes » par interactions gelées, et « trajet du voyageur » par configuration des variables thermiques, on a traduit le problème d’optimisation en la recherche du fondamental d’un système de physique statistique, c’est-à-dire en l’étude de ses propriétés de basse température.
Un problème d’optimisation est défini par certaines règles (ici, chercher le chemin de longueur minimale) et par des données qui caractérisent une instance particulière du problème (la position spécifique de chacune des villes). « Instance » est donc la traduction d’échantillon dans ce nouveau langage. De plus, il est souvent intéressant de définir un ensemble d’instances muni d’une loi de probabilité (par exemple en répartissant uniformément villes dans un carré de côté ), et de s’intéresser aux propriétés statistiques du problème d’optimisation correspondant (notamment la distribution des longueurs optimales des tournées du voyageur de commerce). Ceci correspond aux distributions du désordre gelé utilisées dans les modélisations des verres de spin.
Cette analogie a été exploitée dès les années 80 dans deux directions complémentaires : les méthodes analytiques développées pour l’étude des verres de spin ont été réemployées dans ce contexte, voir par exemple [17] pour une étude du problème du voyageur de commerce. Il a d’autre part été suggéré d’utiliser les procédures numériques du type Monte Carlo pour trouver des solutions aux problèmes d’optimisation, une démarche intitulée « simulated annealing » [18] . L’idée consiste à introduire une température fictive et à échantillonner l’ensemble des configurations avec le poids de Boltzmann correspondant. La limite de température nulle de cet échantillonnage doit conduire au fondamental du système, c’est-à-dire à la solution du problème d’optimisation. En fait l’espace des configurations des problèmes d’optimisation est souvent très irrégulier, et cette procédure peut rester bloquée dans des états métastables d’énergie plus élevée que celle de la configuration optimale.
1.4 Modèles dilués
Dans le modèle SK, chaque degré de liberté interagit avec tous les autres. Cette connectivité infinie est très éloignée de celle d’un système réel, ou d’un modèle sur un réseau géométrique de dimension , chaque variable n’ayant alors qu’un nombre fini de voisins ( pour un réseau hypercubique). Viana et Bray [19] ont introduit un modèle dans lequel la connectivité des variables reste finie dans la limite thermodynamique. L’hamiltonien est toujours de la forme (1.3), mais la loi de distribution des couplages est maintenant
| (1.5) |
où est la distribution de Dirac et une distribution de probabilité régulière. Pour un site donné, il y a en moyenne interactions non nulles, autrement dit le site interagit avec voisins. Bien que la connectivité soit finie, ce modèle est de type champ moyen : les voisins sont choisis aléatoirement parmi les sites du système, il n’y a donc pas de notion de distance euclidienne entre sites. L’essentiel du travail de thèse présenté ici concerne de tels « modèles dilués » ayant une connectivité locale finie sans pour autant respecter une géométrie euclidienne. On rencontrera d’autres exemples de ces modèles dans la suite. L’intérêt porté à ces problèmes peut être motivé par quelques remarques :
-
—
Une question ouverte concerne la pertinence en dimension finie de l’image obtenue pour les modèles complètement connectés par la méthode des répliques 555Une approche assez radicalement différente des verres de spin en dimension finie est donné par l’image des gouttelettes [20, 21], dans laquelle la phase de basse température ne comporte qu’un nombre fini d’états purs.. Les modèles dilués sont certes toujours de type champ moyen, mais corrigent la peu vraisemblable connectivité infinie de leurs prédécesseurs. On peut donc espérer que leurs propriétés seront plus proches de celles des systèmes de dimension finie.
-
—
Ils comportent en particulier de nouveaux ingrédients physiques par rapport aux modèles complètement connectés. En effet, dans le modèle de Viana-Bray la connectivité locale d’un site est une variable fluctuante. Ceci va entraîner l’apparition de phénomènes de type phase de Griffiths [22, 23], à cause d’évènements rares concernant des zones du système qui interagissent plus fortement que la moyenne. En conséquence, la relaxation vers l’équilibre dans une telle phase est anormalement lente, à cause d’une distribution large des temps d’équilibration des sous-systèmes [24, 25].
-
—
Une dernière motivation réside dans l’analogie déjà évoquée avec les problèmes d’optimisation. Il se trouve que les problèmes centraux en théorie de l’optimisation combinatoire conduisent, une fois traduits en termes physiques, à des modèles de spin qui ont une connectivité finie. L’exemple le plus frappant est celui de la « satisfiabilité », auquel on trouvera une très bonne introduction dans [26]. Une instance de ce problème, appelée formule, est définie par un jeu de contraintes logiques, dites clauses, sur des variables booléenes. Le problème consiste à déterminer l’existence ou pas d’une configuration des variables satisfaisant toutes les contraintes, autrement dit une solution de la formule. La satisfiabilité joue un rôle central dans la théorie de la complexité computationnelle, c’est en effet le premier problème dont la NP-complétude ait été démontrée [27]. Par ailleurs un ensemble aléatoire de formules aux propriétés remarquables a été découvert [28]. Celui-ci est défini par deux paramètres, le nombre de variables et un ratio de contraintes par variables . Quand est très petit les formules sont peu contraintes et possèdent beaucoup de solutions. Si au contraire est très grand des contradictions logiques apparaissent et les formules ne peuvent plus être satisfaites. Le point remarquable est que dans la « limite thermodynamique » , le passage d’un régime à l’autre se fait de manière abrupte : il existe une valeur seuil séparant les formules presque toujours 666C’est à dire avec une probabilité tendant vers un dans la limite thermodynamique. satisfiables de celles presque toujours insatisfiables. En termes physiques il existe une transition de phase pour cette valeur du paramètre de contrôle. On trouvera des définitions précises du problème de la satisfiabilité et de l’ensemble aléatoire de formules dans la partie 4.4, accompagnées de références plus complètes.
La contrepartie de cette richesse physique des modèles dilués est une plus grande difficulté technique par rapport aux modèles complètement connectés 777D’aucuns classeront cette difficulté supplémentaire au rang des motivations.. Comparons en effet grossièrement le modèle de Sherrington-Kirpatrick à celui de Viana-Bray. Dans le premier, chaque spin subit une faible influence de la part d’un grand nombre de voisins, alors que dans le deuxième il a un nombre fini de voisins avec qui il interagit fortement. La première situation est typique du théorème central limite sur les sommes de variables aléatoires, l’« influence » (plus précisément le champ magnétique effectif) ressentie par un spin est donc une variable aléatoire gaussienne. Dans le cas du modèle de Viana-Bray, comme dans celui des autres modèles dilués, cette simplification disparaît. Ceci explique que la mise au point de l’ansatz brisant la symétrie des répliques a été bien plus tardif que pour le modèle SK. En effet, même dans l’approximation de symétrie des répliques, le paramètre d’ordre, qui était un simple nombre pour le modèle SK, devient une fonction dans les modèles dilués. Ce paramètre d’ordre RS, solution d’une équation fonctionnelle, a été d’abord calculé pour le modèle de Viana-Bray au voisinage de la ligne de transition [19] et à température nulle [29].
Le problème de la satisfiabilité aléatoire évoqué ci-dessus a été introduit dans la communauté de physique statistique par Monasson et Zecchina [30]. Suivant l’analogie habituelle, les variables booléennes sont représentées par des spins d’Ising et l’on introduit une fonction énergie qui compte le nombre de contraintes non satisfaites. Une formule est donc satisfiable (possède des solutions) si le fondamental a une énergie nulle, et le phénomène de seuil à se traduit par une transition de phase vers un régime où l’énergie du fondamental est non-nulle. Le modèle de spin ainsi obtenu a une connectivité finie, à l’instar de celui de Viana-Bray.
Le traitement de ce problème dans le cadre de l’ansatz symétrique des répliques reproduit l’existence d’une transition de satisfiabilité, mais la valeur du seuil prédit n’est pas en accord avec les simulations numériques. Il faut donc briser la symétrie des répliques, une tâche particulièrement difficile pour ces systèmes dilués. Le paramètre d’ordre, qui est déjà une fonction au niveau RS, devient une fonctionnelle au niveau du premier pas de brisure de la symétrie des répliques [31, 32]. Une résolution approchée de ces équations 1RSB a été obtenue par Biroli, Monasson et Weigt [33] à l’aide d’une approche variationnelle. Celle-ci a notamment conduit à une image plus raffinée des propriétés des formules aléatoires. En effet, en plus de la transition de satisfiabilité à , une deuxième valeur du paramètre sépare un régime satisfiable où les solutions de la formule sont réparties uniformément dans l’espace des configurations d’un autre où elles se regroupent en groupes de solutions nettement séparés les uns des autres.
Un nouveau cap dans la compréhension des systèmes désordonnés dilués a été franchi par Mézard et Parisi [34]. Ces auteurs ont reconsidéré le problème des verres de spin à connectivité finie par la méthode de la cavité, une méthode équivalente à celle des répliques mais qui, dans le cas des systèmes dilués, conduit à des équations ayant une forme plus facile à traiter. En particulier, celles obtenues au niveau du premier pas de RSB peuvent être résolues numériquement par une méthode de dynamique de populations. Cette approche a ensuite été utilisée dans le cas de la satisfiabilité par Mézard et Zecchina [35], qui ont calculé le seuil et mis à profit l’image de l’espace des configurations suggéré par les calculs 1RSB pour proposer un nouvel algorithme de résolution des formules, intitulé « survey propagation ». Plus récemment des calculs de stabilité de la solution 1RSB par Montanari et Ricci-Tersenghi [36, 37] ont montré que la solution 1RSB n’était pas stable pour toutes les valeurs de , et que dans certaines régions une brisure complète de la symétrie des répliques était nécessaire.
Cette méthode de la cavité a été très féconde, un grand nombre de modèles ont été étudiés le long de ces lignes. Je citerai notamment le problème du coloriage de graphes [38] et le problème de la XORSAT [39]. Ce dernier est une variante du problème de la satisfiabilité, qui a été indépendamment introduit en physique et en informatique. Dans le contexte de la physique, il correspond à la version diluée du modèle -spin. Un résultat très intéressant est la preuve de l’exactitude du schéma 1RSB pour ce modèle à température nulle [40, 41].
1.5 Aspects dynamiques
1.5.1 Dynamiques physiques
Tournons-nous maintenant vers les propriétés dynamiques des verres de spin et de leurs modélisations de champ moyen, qui seront l’objet principal de ce manuscrit. Rappelons d’abord deux propriétés auxquelles on s’attend pour un système « normal » :
-
—
Lorsqu’on le met en contact avec un thermostat, le système se met rapidement à l’équilibre avec le bain thermique extérieur. Il perd alors la mémoire de son instant de préparation et sa dynamique devient stationnaire : les résultats d’une expérience sont indépendants de l’instant auquel on l’effectue.
-
—
Les fonctions d’auto-corrélation et de réponse à une perturbation extérieure sont reliées par le théorème de fluctuation-dissipation (FDT). Ce théorème, dont une des versions les plus célèbres est la relation de Stokes-Einstein entre coefficients de diffusion et de traînée d’une particule brownienne, est très général. Il ne fait pas intervenir les détails microscopiques du système, mais seulement la température du thermostat extérieur.
On dit qu’une dynamique est « d’équilibre » quand elle vérifie ces deux propriétés. Pour un système « normal » ce régime dynamique est atteint rapidement, sur l’échelle des temps expérimentaux, après sa mise en contact avec un thermostat.
Une étude de la dynamique du modèle SK était présente dans l’article originel [5], et fut complétée par Sompolinsky et Zippelius [42]. Cependant ces approches n’étaient pas cohérentes dans la phase de basse température pour la raison suivante : les modèles de verres de spin ne sont pas « normaux », ils restent hors d’équilibre pendant des temps très longs 888Plus précisément, le temps d’équilibration du système diverge avec la taille du système. Si la limite thermodynamique est prise avant la limite des temps longs, on reste toujours hors d’équilibre.. Il faut donc abandonner l’hypothèse de stationnarité du système et le théorème de fluctuation-dissipation.
La première étude de la dynamique de basse température des modèles de verres de spin en champ moyen qui tienne compte de cette situation est due à Cugliandolo et Kurchan [43]. Elle portait sur la dynamique de Langevin du modèle -spin sphérique999Dans un modèle sphérique les variables d’Ising sont remplacées par des variables continues, on reviendra en détail sur ce point dans le corps du manuscrit., et mettait en lumière les modifications suivantes des propriétés d’équilibre :
-
—
ce modèle n’est pas stationnaire à basse température, on dit qu’il vieillit [44] : sa dynamique dépend toujours de son « âge », c’est-à-dire du temps écoulé depuis sa mise en contact avec le thermostat extérieur. En termes plus techniques, les fonctions de corrélation et de réponse à deux temps dépendent réellement des deux temps, et non pas seulement de la différence entre les deux comme dans une dynamique stationnaire.
De plus, la dépendance de la dynamique vis-à-vis de l’âge du système n’est pas complètement arbitraire : le système reste certes hors d’équilibre à tous les temps, mais son évolution est de plus en plus lente. Cette particularité permet des simplifications dans le traitement analytique de ce type de système.
-
—
le théorème de fluctuation-dissipation n’est pas respecté par les fonctions de corrélation et de réponse à deux temps. Cependant, ces dernières sont reliées par une modification relativement simple du FDT, le caractère hors d’équilibre se traduisant par l’apparition d’une température effective différente de celle du thermostat extérieur.
Les modèles de verres de spin de champ moyen constituent donc une classe particulière de systèmes hors d’équilibre, pour lesquels la violation des propriétés d’équilibre obéit à un scénario assez précis [45, 46]. J’en donnerai plus de détails dans la partie 5.4.
Les phénomènes de vieillissement et de violation du FDT ne sont pas des artefacts de la modélisation théorique : ils ont été au contraire observés dans un grand nombre d’expériences. Celles-ci sont notamment conduites sur des verres de spin [47], pour lesquels une mesure directe de la violation du théorème de fluctuation-dissipation a été obtenue récemment par Hérisson et Ocio [48]. Les verres structuraux présentent aussi un comportement similaire [49], avec une phase vitreuse vieillissante à basse température. Signalons dans ce dernier cas que la théorie de couplage de modes [50] utilisée pour la description des liquides surfondus au dessus de la température de transition vitreuse est intimement reliée aux modèles -spin introduits ci-dessus. Ce lien a été dévoilé par Kirkpatrick, Thirumalai et Wolynes [51, 52, 53] et approfondi dans [54].
Les travaux sur la dynamique des modèles dilués sont relativement rares comparés à ceux sur les modèles complètement connectés. On peut citer en particulier les investigations numériques de Barrat et Zecchina [55], et de Montanari et Ricci-Tersenghi [56, 57]. Ces études ont mis en évidence la richesse du comportement dynamique de ces modèles, notamment à cause des fluctuations locales de connectivité qui les rendent très hétérogènes.
1.5.2 Algorithmes d’optimisation
La section précédente était intitulée « dynamiques physiques » car elles concernaient des modélisations censées représenter l’influence d’un bain thermique extérieur au système qui lui impose sa température. L’évolution des degrés de liberté du système vérifient alors certaines règles « physiques » (condition de balance détaillée pour des spins discrets, équations de Langevin pour des variables continues) telles que l’équilibre de Gibbs-Boltzmann est un point fixe de l’évolution.
Au cours de cette thèse je me suis intéressé aussi à une autre famille de dynamiques, reliée aux problèmes d’optimisation. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison a priori d’imposer les mêmes règles aux lois microscopiques d’évolution : le but est de répondre le plus rapidement possible à une question, par exemple l’existence d’une solution à un problème de satisfiabilité, et non d’échantillonner l’espace des configurations avec le poids de Gibbs. De plus, certains types d’algorithme n’ont rien à voir avec les dynamiques stochastiques locales dans l’espace des configurations qui sont habituellement utilisées en physique. Les mouvements d’une configuration à l’autre peuvent être arbitrairement grands, ou bien s’effectuer dans un espace peu naturel du point de vue physique. Certains algorithmes de résolution de la satisfiabilité procédent par construction d’un arbre de recherche, dans lequel chaque nœud est associé à un ensemble de configurations des variables booléennes.
On pourrait alors se demander quelle est la pertinence des outils de la physique statistique pour étudier de tels problèmes. Les travaux initiés par Cocco et Monasson [58] ont cependant montré qu’une telle approche était possible et fructueuse, complétant les études rigoureuses des mathématiciens et des informaticiens. On trouvera dans la publication C2 une revue des travaux de la communauté de physique statistique sur ces problèmes d’algorithmes d’optimisation.
1.6 Résumé du travail de thèse
On va présenter dans la suite du manuscrit les résultats de travaux plus ou moins directement reliés au même objectif : une meilleure compréhension analytique des dynamiques hors d’équilibre dans les modèles dilués. Au delà du défi technique que cet objectif représente, il serait appréciable de capturer par une approche analytique certains des traits nouveaux de ces modèles qui étaient absents dans le cas complètement connecté. Une deuxième direction de travail a consisté à appliquer des méthodes de physique statistique pour décrire le comportement d’un algorithme de recherche locale de solutions du problème de la satisfiabilité.
Le manuscrit est organisé de la manière suivante. Un premier chapitre précise les définitions et les propriétés géométriques des modèles dilués. A cette occasion on décrira une méthode générale de développement à faible connectivité, qui a fait l’objet de la publication P1 et qui a été mise à profit dans d’autres parties de la thèse.
Les deux chapitres suivants ont été divisés selon la nature (continue ou discrète) des variables des modèles. Cette division est un peu arbitraire, mais correspond à des formalismes et des méthodes d’approximation différents. Le chapitre 3 expose les résultats des publications P2, P3 et une partie de la publication P5. Ces différentes études sont reliées ainsi : un des modèle dilués les plus simples que l’on peut imaginer correspond à la version sphérique du modèle de Viana-Bray. On montre d’abord que ce problème se ramène à la détermination du spectre d’un certain type de matrices aléatoires. On adapte alors la méthode d’approximation « à un seul défaut » de Biroli et Monasson [59] à l’ensemble de matrices qui nous intéresse ici (publication P2). On tire ensuite les conséquences des propriétés de ces matrices aléatoires sur la dynamique du modèle (P3). Finalement un formalisme général apte à traiter la dynamique de tous les modèles de champ moyen (complètement connectés ou dilués) pour des variables continues est développé, en s’appuyant sur une analogie avec le problème de matrices aléatoires. Dans le cas dilué le résultat obtenu est trop formel pour pouvoir en tirer directement des prédictions physiques, de possibles approximations sont suggérées. Une différence apparaît entre modèles complètement connectés et modèles dilués : ces derniers ne sont pas caractérisés uniquement par leurs fonctions de corrélation et de réponse à deux temps.
Le chapitre 4 regroupe deux travaux de natures a priori différentes : le premier (publication P6) concerne la dynamique d’un modèle ferromagnétique dilué, le deuxième (P4 et C1) traite d’un algorithme de résolution de formules de satisfiabilité. Une approche commune est d’abord présentée en termes génériques, avant d’être appliquée à ces deux problèmes. On fera notamment le lien avec la méthode dynamique des répliques de Coolen et Sherrington [60, 61]. Trois appendices à ce chapitre exposent des résultats numériques et analytiques non publiés sur des variantes du problème d’optimisation.
Le chapitre 5 verra la réconciliation des variables continues et discrètes : les propriétés d’équilibre des fonctions de corrélation avec un nombre quelconque de temps y seront explorées. La publication P5 traitait le cas continu, on fera dans le manuscrit les démonstrations dans le cas discret pour insister sur la généralité de ces résultats. On présente également une version du théorème de fluctuation qui résume ces propriétés. Finalement des conjectures sur leurs généralisations dans les situations hors d’équilibre du type verres de spin dilués sont avancées.
J’ai essayé, dans la mesure du possible, de faire de ce manuscrit un ensemble cohérent en ne présentant pas les publications dans un ordre chronologique. L’organisation retenue permettra, je l’espère, d’insister sur les liens entre ces différents travaux. Je me suis donc efforcé de présenter les méthodes dans une certaine généralité avant de les appliquer aux cas particuliers. Pour cette raison je me suis permis de changer certaines notations par rapport à celles utilisées dans les articles, et de présenter dans certaines parties les démonstrations avec peut-être trop de détails. L’utilisation des mêmes lettres pour des quantités différentes d’un chapitre sur l’autre n’a pu être complètement évitée, j’espère que la lisibilité du manuscrit n’en sera pas trop affectée.
Chapitre 2 Propriétés géométriques des modèles dilués
La plupart des études présentées dans ce manuscrit partagent une structure sous-jacente commune, qui porte en physique le nom générique de modèle dilué. Ce chapitre est consacré à quelques propriétés « géométriques » de ces systèmes, étudiés en mathématiques sous le nom de graphes et d’hypergraphes aléatoires. L’adjectif géométrique n’est pas à prendre au sens strict ici. En effet ces structures ne sont pas définies à partir d’un espace euclidien de dimension finie, et par nombre de leurs caractéristiques elles appartiennent à la famille des problèmes de champ moyen.
Dans les premières parties de ce chapitre on trouvera une introduction sommaire à quelques modèles de graphes et d’hypergraphes aléatoires. Suit la présentation d’une méthode systématique de développement dans un régime de faible concentration, qui a fait l’objet de la publication P1 et que l’on retrouvera à plusieurs reprises dans la suite de la thèse.
2.1 Le graphe aléatoire d’Erdös et Rényi
Ce modèle, introduit en mathématiques dans les années 60 [62], est l’archétype des systèmes dilués. Il a été très largement étudié par les mathématiciens, un grand nombre de ses propriétés sont connues rigoureusement et avec une très grande finesse (on pourra se reporter par exemple à [63, 64, 65, 66]). On se contente ici d’une approche non rigoureuse et de quelques résultats utiles pour la suite.
2.1.1 Définition d’un graphe
Du point de vue mathématique, un graphe de taille est constitué de :
-
—
un ensemble de sommets (vertices), de cardinalité (nombre d’éléments de l’ensemble) . On peut donc prendre sans perdre en généralité.
-
—
un ensemble de liens (edges), c’est-à-dire de paires non orientées de sommets, .
Selon les cas on peut autoriser ou non les liens d’un sommet à lui-même, ainsi que les répétitions du même lien dans l’ensemble . Cette distinction entre « graphes simples » et « multi-graphes » ne sera pas utilisée dans la suite, pas plus que la notion de graphe orienté, pour lequel les liens portent une direction.
Il est clair qu’une représentation naturelle d’un graphe ainsi défini consiste à dessiner les sommets comme des points d’un plan, et les liens comme des courbes reliant ces sommets. En général on est obligé de faire se croiser certains liens, si l’on peut dessiner le graphe sans qu’aucun lien ne se croise il est dit planaire.
Définissons quelques notions générales sur les graphes, avant de parler d’ensembles aléatoires. La plupart de ces définitions sont intuitives, mais il sera utile pour la suite de les formaliser un peu.
-
—
Deux sommets et sont dits adjacents dans un graphe si le lien appartient à l’ensemble .
-
—
Deux sommets sont dits connectés s’il existe une suite de sommets successivement adjacents (i.e. un chemin) qui les relient. Un graphe est dit connexe si toute paire de ses sommets est connectée. Une composante connexe d’un graphe est un sous-graphe maximal (au sens de l’inclusion) connexe. Il sera loisible dans la suite de considérer un sommet isolé comme une composante connexe du graphe.
-
—
Une boucle est un chemin fermé de sites adjacents. Un arbre est un graphe connexe sans boucles. On peut en donner une caractérisation plus simple : si un graphe connexe a sommets et liens, c’est un arbre pour .
-
—
Le théorème de Cayley affirme qu’il y a arbres distincts avec sommets. « Distincts » est à prendre ici au sens des graphes étiquetés, c’est à dire que chacun des sommets porte un indice de , et deux étiquetages sont différents si et seulement si l’ensemble des liens correspondants est différent. Par exemple pour un arbre à trois sommets, les trois étiquetages distincts sont , et .
-
—
Deux graphes étiquetés et sont isomorphes s’il existe une bijection entre et telle que si et seulement si . Cette définition correspond à la notion intuitive de forme d’un graphe. Par exemple, les trois arbres à trois sommets cités précédemment sont isomorphes. Pour on a par contre deux types différents d’arbres non isomorphes. La figure 2.1 illustre ces définitions avec les différents types d’arbres pour entre 1 et 4. On a noté le nombre d’étiquetages distincts pour chacun des types. Pour , l’arbre avec un site central et trois voisins a quatre étiquetages distincts, selon le choix du site central. L’arbre linéaire a lui douze étiquetages distincts, et donc conformément au théorème de Cayley on a bien arbres étiquetés à quatre sommets.
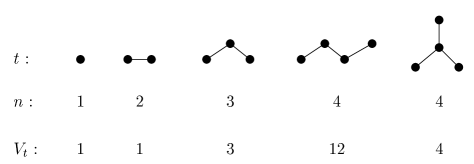
Figure 2.1: Les différents types d’arbres à sommets, pour entre 1 et 4. est le nombre d’étiquetages distincts. -
—
Une clique à sommets est un graphe complètement connecté, c’est-à-dire dont les liens sont présents. Le nombre chromatique d’un graphe est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier les sommets de façon telle qu’aucun lien ne relie deux sommets de la même couleur. Le nombre de clique d’un graphe est la taille de la plus grande clique contenue comme sous-graphe. Ces deux exemples de propriétés ne seront pas utilisées dans la suite, mais illustrent le type de questions d’intérêt en mathématiques.
2.1.2 Graphe aléatoire
Muni de ces définitions formelles, on constate que le nombre de graphes de taille est fini (il vaut ) , on peut donc définir sans difficulté une loi de probabilité sur l’ensemble des graphes de taille , et se poser des questions probabilistes sur cet ensemble. Si on a une propriété qu’on peut définir pour tout graphe , par exemple « contient une clique de cinq sommets » , on peut se demander quelle est la probabilité que cette propriété soit vérifiée quand on tire au hasard un graphe selon la loi .
La loi de probabilité la plus étudiée, qu’on nomme graphe aléatoire de Erdös et Rényi, consiste à considérer indépendamment les liens possibles parmi les sommets, et à prendre chacun de ces liens présent (resp. absent) avec probabilité (resp. ). Autrement dit, si l’on note le nombre de liens dans un graphe donné , on peut écrire la loi de probabilité des graphes comme
| (2.1) |
Comme il y a graphes avec liens, cette loi est bien normalisée.
Le choix d’une probabilité de présence de lien qui dépend de la taille du système comme n’est évidemment pas le fruit du hasard. Comme on va le voir, ce régime permet d’obtenir une limite thermodynamique () intéressante.
Dans la suite du chapitre on notera les moyennes sur les ensembles de graphe comme
| (2.2) |
Toutes les limites et les équivalents sont à comprendre dans le sens de la limite thermodynamique sauf mention explicite du contraire.
2.1.3 Ses propriétés
On va étudier ici quelques propriétés simples du graphe aléatoire défini par la loi (2.1).
-
—
Considérons tout d’abord , le nombre de liens présents dans un graphe. C’est ici une variable aléatoire binomiale, dont on calcule aisément la moyenne et l’écart quadratique moyen,
(2.3) (2.4) se concentre donc dans la limite thermodynamique autour de sa valeur moyenne , à des fluctuations d’ordre près. On reviendra sur ce point au cours de la discussion des autres modèles de graphes aléatoires. Notons que le choix de la dépendance en de la probabilité de présence d’un lien permet d’obtenir un nombre extensif (proportionnel au « volume » du système) de liens en moyenne.
-
—
On peut aussi s’intéresser aux propriétés locales d’un graphe aléatoire. Cherchons par exemple la probabilité (par rapport à la distribution (2.1)) qu’un sommet donné ait exactement voisins. On parle de connectivité (ou de degré) du sommet égal à . On a
(2.5) la limite thermodynamique étant prise avec fixé. En effet, on est libre de choisir les sites voisins parmi les autres sites, chacun de ces liens doit être présent, et le site central ne doit pas être relié à d’autres sites. On constate que la connectivité d’un site devient une loi de Poisson avec paramètre dans la limite thermodynamique. On appelle souvent le graphe aléatoire d’Erdös-Rényi un graphe poissonien à cause de cette propriété. La loi de Poisson est typique d’un nombre d’évènements se réalisant avec une probabilité individuelle faible ( ici), mais sur un grand nombre de tentatives ().
-
—
On peut aussi calculer la probabilité d’observer un site avec voisins, conditionnée à ce qu’il en ait au moins un, ce que l’on peut se représenter plus facilement avec la figure 2.2.
(2.6) Dans la limite thermodynamique est aussi une loi poissonnienne de paramètre . Un petit argument permet de pressentir à partir de ce résultat que la valeur va être particulière. Supposons en effet que l’on choisisse dans le graphe aléatoire un site racine au hasard, et que l’on explore le graphe en suivant les liens (ou branches) qui en émergent. Si l’on appelle génération le nombre de pas que l’on a fait au cours de l’exploration depuis la racine, on a descendants de première génération avec probabilité . Chacun de ces descendants va avoir descendants, qui seront donc de deuxième génération, avec probabilité , car les sites de première génération ont été, par définition, atteints par un lien présent entre eux et la racine. En continuant l’exploration on construit ainsi un arbre où le nombre de descendants est à chaque génération déterminée par la loi conditionnelle . Si , ce processus de branchement meurt rapidement, alors que pour il continue éternellement. On va voir plus bas que cette différence de comportement s’interprète ici comme une transition de percolation.

Figure 2.2: Dans le calcul de la probabilité conditionnelle (2.6), on suppose la présence d’un lien, en tirets ici, et l’on cherche la probabilité d’avoir voisins supplémentaires. -
—
En élargissant le champ des questions posées, on peut maintenant se demander quelle va être la probabilité que la composante connexe d’un site donné soit un certain type de graphe , avec sites et liens. Un peu de dénombrement conduit à
(2.7) (2.8) Expliquons ces différents facteurs. On doit d’abord choisir les autres sites de la composante connexe, parmi les sites du graphe, puis une des différentes façons d’étiqueter la composante connexe. Les liens doivent être présents, avec donc la probabilité . Il faut finalement exclure les autres liens pouvant reliant les sommets entre eux, ainsi que ceux relieraient les sommets au reste du graphe. Notons que l’équivalent a été pris en supposant que et restaient finis dans la limite thermodynamique, cette expression n’est donc valable que pour des composantes connexes de taille finie.
On constate que si , cette expression tend vers 0 dans la limite thermodynamique. Or pour un graphe connexe, , avec égalité si et seulement si le graphe est un arbre. Plus précisément, la probabilité qu’un site appartienne à une composante connexe de taille finie et qui contient des boucles est d’ordre , où est le nombre de boucles indépendantes. On peut de la même façon montrer que la probabilité qu’un site appartienne à une boucle de taille finie (sans imposer que sa composante connexe soit de taille finie) est d’ordre . Remarquons que cela ne signifie pas qu’il n’y a aucune boucle de taille finie dans la limite thermodynamique : la probabilité étant d’ordre , mais le nombre de sites étant , il y en a en moyenne un nombre fini.
-
—
Dans le cas particulier où l’on cherche la probabilité d’appartenance à un arbre quelconque à sommets, on peut simplifier la formule (2.8) en utilisant le théorème de Cayley
(2.9) pour obtenir
(2.10) Comme on a vu que les seules composantes connexes de taille finie qui ont une probabilité (par site) finie dans la limite thermodynamique sont des arbres, la somme compte la fraction de sites qui sont dans des composantes de taille finie. On peut montrer que cette somme converge vers 1 pour , dans ce cas presque tous les sites sont dans des composantes de taille finie. Par contre, quand , la somme vaut , où est la solution non nulle de l’équation , représentée sur la figure 2.3. est donc la fraction des sites qui ne sont pas dans des composantes de taille finie, autrement dit c’est la fraction de sites dans l’« amas infini » de percolation qui envahit un nombre extensif de sites à partir de . On peut en fait justifier l’équation sur de la manière suivante : un site appartient à l’amas infini dès qu’un de ses voisins y appartient. Réciproquement, pour qu’un site n’y appartienne pas, il faut qu’aucun de ses voisins n’y appartienne :
(2.11) Un tel raisonnement, où l’on néglige les corrélations entre les probabilités d’appartenance à l’amas infini des voisins d’un site donné, serait faux en dimension finie. Il est correct ici grâce au caractère champ moyen du modèle, qui ne repose pas sur un réseau géométrique régulier.
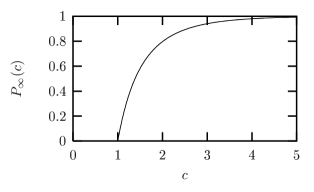
Pour résumer cette étude sommaire, on a vu que la connectivité d’un site est une loi de Poisson avec paramètre , que si on regarde un graphe aléatoire sur une échelle finie dans la limite thermodynamique on voit toujours une structure en arbre avec grande probabilité, et qu’il y a une transition de percolation à . Pour des connectivités plus faibles, une fraction des sites qui tend vers 1 dans la limite thermodynamique sont contenues dans des composantes connexes de taille finie, par contre quand une composante connexe de taille extensive apparaît.
Les études mathématiques de ce problème ont conduit à de nombreux autres résultats très précis. Citons par exemple qu’à la transition (), la taille de la plus grande composante connexe diverge dans la limite thermodynamique comme et que pour la plus grande composante est de taille . De plus les graphes aléatoires ne sont en arbre que sur des échelles finies, on trouve en fait un grand nombre de boucles de longueur . Cette taille peut se comprendre à partir de l’argument sur la descendance d’un processus de branchement poissonien exposé précédemment. Pour le nombre de sites a la génération croît typiquement comme . Quand est d’ordre ce nombre de sites devient d’ordre , on est donc obligé alors de retrouver des sites déjà présents dans le processus de branchement, ce qui implique la présence de boucles.
2.2 Hypergraphes
Une généralisation naturelle du point de vue de la physique consiste à remplacer les liens par des « hyperliens » qui joignent un nombre arbitraire de sommets, les graphes habituels correspondants à . Un hypergraphe est alors la donnée d’un ensemble de sommets et d’un ensemble d’hyperliens. C’est ce type de généralisation qui conduit du modèle de Sherrington-Kirkpatrick aux modèles dits -spin. Pour une valeur de donnée, il y a hyperliens possibles. On peut par exemple définir une loi de probabilité sur les -hypergraphes en prenant chacun des hyperliens indépendamment présent avec probabilité , absent avec probabilité . Notant toujours un hypergraphe, et le nombre d’hyperliens présents, la loi de probabilité est
| (2.12) |
A nouveau la dépendance en a été choisie de manière à avoir un nombre moyen de liens présents qui soit extensif, dans la limite thermodynamique. On notera dans la suite de ce paragraphe pour simplifier certaines écritures. Dans le même but on omettra le préfixe « hyper » quand il n’y a pas de confusion possible.
Des raisonnements combinatoires similaires à ceux présentés dans le cas du graphe aléatoire conduisent à :
-
—
La probabilité d’avoir liens autour d’un site donné est, dans la limite thermodynamique, une loi de Poisson de paramètre . On appellera aussi cet ensemble « hypergraphe poissonien » .
-
—
La probabilité d’avoir liens autour d’un site atteint par un hyperlien déjà présent est aussi une loi de Poisson de paramètre . Généralisant l’argument qualitatif présenté pour , on rencontre sites à chaque nouvelle génération explorée, on peut donc penser que le seuil de la transition de percolation sera ici .
-
—
En effet, pour qu’un site n’appartienne pas à l’amas infini il faut qu’aucun des sites voisins n’y appartienne. Un site de degré ayant voisins, on obtient en notant la probabilité d’appartenance à l’amas infini :
(2.13) équation qui a une solution non triviale pour .
-
—
On généralise sans difficultés la notion de composante connexe et de boucle à un hypergraphe. Un graphe connexe avec sommets et liens est en arbre si . On trouve comme pour que les composantes connexes finies avec des boucles ont une probabilité négligeable dans la limite thermodynamique. On a alors la généralisation de (2.8) pour la probabilité qu’un site donnée appartienne à une composante connexe en arbre ,
(2.14) est à nouveau le nombre d’étiquetage distincts de l’arbre . On en donnera des exemples dans la partie 2.4.
2.3 Autres types d’ensemble
L’ensemble des graphes (resp. hypergraphes) peut être muni d’une structure probabiliste avec des loi différentes de (2.1) (resp. (2.12)). On mentionne ici quelques possibilités.
-
—
Une variante relativement inoffensive consiste à fixer le nombre de liens présents dans le système, à une valeur notée traditionnellement . Les graphes aléatoires sont alors générés en choisissant fois un -uplet de sommets de manière indépendante et non biaisée. On s’attend à ce que dans la limite thermodynamique, les propriétés typiques de cet ensemble aléatoire soient les mêmes que celles décrites dans la partie 2.2, du moment que et sont tels que le nombre moyen de liens dans le premier ensemble soit égal à celui (fixé strictement) dans le deuxième. C’est une variation du type ensemble canonique vs microcanonique en mécanique statistique. Il faut tout de même garder à l’esprit que certaines propriétés ne vont pas être équivalentes dans les deux ensembles, les fluctuations et les corrections de taille finie notamment. L’exemple trivial du nombre de liens, strictement fixé dans un cas, avec des fluctuations relatives d’ordre dans l’autre, suffit à illustrer le problème. Certains calculs ou simulations numériques pouvant s’avérer plus simple dans un ensemble que dans l’autre, on pourra être amené à utiliser les deux.
-
—
Comme on l’a vu, la connectivité locale des graphes définis ci-dessus ont des lois de probabilité de Poisson, qui décroissent donc vite pour les grandes connectivités. Un certain nombre d’études expérimentales dans des domaines aussi divers que la structure de la toile Internet, les collaborations scientifiques ou d’acteurs de cinéma, j’en passe et des meilleures, établissent des réseaux, ou graphes, à partir de ces données (voir [69, 70] pour des revues). Les sommets correspondent par exemple aux différents acteurs, un lien entre deux acteurs étant présent s’ils ont participé à un tournage en commun. Il se trouve que dans un grand nombre de ces situations, la loi de probabilité des connectivités des sommets est très éloigné d’une poisonnienne. En particulier, le comportement pour les très grandes connectivités est du type loi de puissance, d’où le nom de « scale-free » associé à ces réseaux. A la suite de ces études statistiques, un certain nombre de modèles ont été introduits qui permettaient de reproduire ce type de comportement. D’une part, certains modèles sont dits dynamiques, les sommets sont introduits un par un avec des lois d’attachement préférentiel à certains sites, qui privilégient les sites ayant déjà une grande connectivité. On trouvera une construction rigoureuse d’un tel modèle dans [71]. D’autre part, des modèles statiques consistent à considérer l’ensemble des graphes présentant une distribution de connectivité donnée comme équiprobables [72]. On peut alors par exemple étudier la transition de percolation de ces graphes. Signalons aussi que le modèle d’Ising ferromagnétique défini sur ces graphes avec des distributions de connectivité arbitraire a été étudié dans [73, 74].
-
—
Comme cas très particulier de graphes dont on fixe la distribution empirique de connectivités, on va rencontrer dans la suite les modèles dilués à connectivité fixe. C’est donc un ensemble aléatoire où l’on garde les graphes (resp. hypergraphes) tels que chaque sommet appartient à un nombre fixé de liens (resp. hyperliens). Localement, c’est à dire sur une échelle petite devant , ces graphes sont des arbres réguliers, mais sur des échelles plus grandes on s’aperçoit qu’ils contiennent des boucles, qui traduisent le caractère aléatoire de leur définition. On peut se poser la question de l’intérêt d’une telle construction, alors qu’il semblerait plus simple de considérer des arbres parfaitement réguliers, sans boucle. Le problème de ce deuxième point de vue est que le nombre de sites à la « surface » d’un arbre régulier est du même ordre que le volume intérieur dans la limite thermodynamique, ce qui conduit à des effets de bords très importants. Si l’on peut traiter ces effets de bords de manière relativement simple pour un modèle ferromagnétique (en n’étudiant que la magnétisation du site central par exemple), la situation est assez inextricable pour un modèle de verre de spin : la frustration sur un arbre ne peut venir que des conditions aux bords à la surface, qu’il faut donc traiter avec beaucoup de soin. La définition du graphe à connectivité fixe permet de s’affranchir de ce problème, le graphe n’a plus de surface puisque tous les sites sont statistiquement équivalents. La frustration vient dans ce cas des boucles aléatoires. On trouvera une discussion plus détaillée de ce sujet dans [34].
2.4 Développements en clusters pour les graphes poissonniens
Une méthode très élémentaire, qui a fait l’objet de la publication P1, s’est révélée utile pour l’étude de différents problèmes présentés dans cette thèse. On va l’exposer ici sous une forme générique. Signalons que l’idée de cette méthode est présente, bien que peu explicitée, dans un travail antérieur de Hartmann et Weigt sur le vertex cover [75]. Dans une perspective plus large on pourrait la rattacher aux développements de basse densité dans les systèmes de particules, la connectivité remplaçant ici la densité.
2.4.1 Formulation générale
Notons un élément de l’ensemble aléatoire d’hypergraphes, muni de la loi de probabilité (2.12). Chaque hypergraphe peut se décomposer comme l’union disjointe de ses composantes connexes (appelés ici « clusters »), . Considérons une fonction qui à un graphe associe un nombre réel, avec les propriétés suivantes :
-
—
additivité vis-à-vis de la décomposition en clusters, .
-
—
indépendance par rapport à l’étiquetage du graphe, autrement dit renvoie la même valeur pour deux graphes isomorphes.
L’exemple présenté sur la figure 2.4 (pour ) devrait clarifier ces définitions.
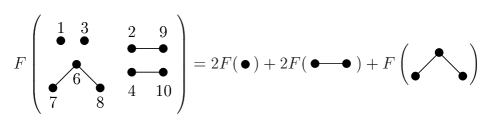
Ces deux propriétés permettent d’écrire
| (2.15) |
où la somme porte sur les différents types de composantes connexes, est la valeur que prend la fonction sur un graphe isomorphe à , et est le nombre de clusters de type dans le graphe .
On s’intéresse à la valeur moyenne d’une telle fonction sur l’ensemble aléatoire. On définit donc la densité associée :
| (2.16) |
avec le nombre moyen de clusters de type . On peut facilement se convaincre que , où est le nombre de sommets d’un cluster de type , et la probabilité qu’un site donné soit dans un cluster de type . Le calcul exact de cette somme est a priori impossible pour une fonction compliquée. On peut cependant se simplifier considérablement la tâche si l’on se contente d’un développement de la fonction en puissances de , autour de . En effet, dans un voisinage de , la somme (2.16) est dominée dans la limite thermodynamique par les contributions des arbres de taille finie : on a vu qu’en dessous du seuil de percolation la fraction des sites dans de tels clusters tendait vers 1 dans la limite thermodynamique. On peut alors utiliser (2.14) pour écrire
| (2.17) |
et la somme est prise seulement sur les arbres 111Je discuterai la différence de notation entre et dans la partie 2.4.3.. Rappelons que est le nombre de clauses dans le cluster de type , avec car est un arbre. Le facteur de symétrie s’avère plus utile que le nombre d’étiquetages dont il découle.
On s’aperçoit finalement que les clusters comportant un nombre de liens ne contribuent qu’aux ordres supérieurs ou égaux à dans le développement en puissances de . Pour développer à un ordre donné en il suffit donc de calculer les facteurs de symétries pour les premiers arbres, ce qui est un simple exercice d’énumération, et les valeurs de correspondantes. Selon la fonction étudiée cette deuxième tâche peut se révéler plus ou moins fastidieuse, comme on le verra dans la partie 4.4 où l’on appliquera cette méthode au calcul du temps mis par un algorithme de recherche locale pour résoudre un problème d’optimisation combinatoire.
Donnons le développement à l’ordre pour une fonction quelconque :
Les clusters sont représentés sur la figure 2.5, et on trouvera dans la table 2.1 les facteurs de symétrie qui ont été utilisés pour obtenir (2.4.1).
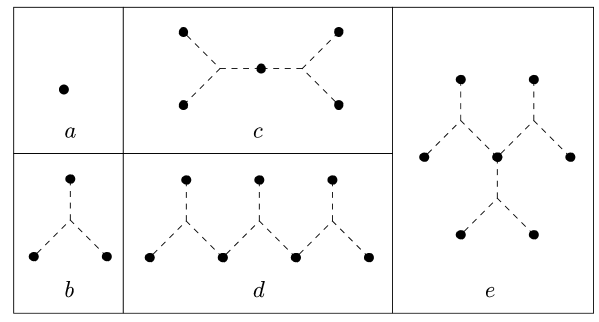
2.4.2 L’énergie libre du modèle de Viana-Bray à faible connectivité
Cette méthode a été appliquée dans la publication P1 au calcul de l’entropie du fondamental d’un problème de satisfiabilité, et à celui de l’énergie libre du modèle de Viana-Bray [19] dans la phase de basse connectivité. Revenons ici sur la deuxième de ces applications.
On considère donc un graphe aléatoire d’Erdös et Rényi de connectivité moyenne , et pour chacun des liens présents entre les sites et on tire aléatoirement une interaction avec la même loi de probabilité . On notera les moyennes sur la loi . On place sur les sommets du graphe des spins d’Ising et on définit l’hamiltonien
| (2.19) |
avec si le lien entre les sommets et est absent. Viana et Bray ont introduit ce modèle afin d’expliquer les propriétés du composé qui, selon la concentration , peut présenter différents types de transition. La connectivité dans cette modélisation permet de reproduire ce phénomène de dilution. La température de transition va notamment dépendre de . Dans l’article originel [19], le problème était traité au niveau symétrique des répliques, près de la ligne de transition. Kanter et Sompolinsky [29] ont étudié la limite de température nulle, toujours avec l’hypothèse RS.
On peut appliquer la méthode présentée dans cette partie au calcul de l’énergie libre pour de petites concentrations. En effet, la fonction de partition du système peut s’écrire comme un produit de fonctions de partition pour chacune des composantes du graphe. De plus, si l’on fait la moyenne sur les intensités des interactions pour un graphe donné, on obtient une énergie libre qui vérifie les propriétés suffisantes pour établir le développement en clusters. On a une simplification supplémentaire ici : il est facile de montrer par récurrence que la fonction de partition d’un système d’Ising sur un arbre se factorise comme un produit de termes de liens et de termes de sites. Une fois que la moyenne sur la loi est prise, tous les arbres de même taille contribuent de la même façon, quelque soit leur forme. Ceci permet de resommer le développement en clusters dans toute la phase non percolante ,
| (2.20) |
où est la densité d’énergie libre moyennée sur la distribution des graphes et sur l’intensité des couplages. Ce résultat est bien sûr trivial pour une phase paramagnétique, il ne peut pas y avoir de transition à température finie car presque tous les sites sont dans des composantes connexes de taille finie. Cependant la méthode pourrait sûrement être rendue rigoureuse et fournir des bornes de concentration sur l’énergie libre dans ce cas-là. En effet la méthode dite du deuxième moment en mathématiques permet de montrer que le nombre de clusters d’un type donné devient très piqué autour de sa valeur moyenne dans la limite thermodynamique. Il faut pour cela calculer l’écart quadratique moyen de et montrer qu’il est négligeable devant sa valeur moyenne. Une autre approche bien plus générale et puissante repose sur l’idée de l’interpolation de Guerra [12], appliquée au modèle de Viana-Bray par Guerra et Toninelli [76].
On peut facilement étendre le développement en clusters pour calculer les corrections de taille finie à une grandeur extensive, toujours dans la limite de faible connectivité. Il faut pour cela considérer d’une part les corrections d’ordre à la probabilité d’apparition d’un cluster en arbre, et d’autre part tenir compte aussi des contributions des clusters contenant des boucles. Ce calcul était présenté dans la publication P1 pour l’énergie libre du modèle de Viana-Bray, malheureusement le résultat était entaché d’une erreur [77], j’en donne donc ici une version moins fausse :
2.4.3 Domaine de validité de la méthode
Je voudrais revenir maintenant sur le problème de la validité de cette méthode de développement en clusters. Mon point de vue sur la question a sensiblement évolué depuis la rédaction de la publication P1 dans laquelle on argumentait en faveur d’une singularité de ces développements au seuil de percolation du graphe. Il convient d’être un peu plus précis dans cette discussion.
Considérons d’abord l’expression (2.16) qui définit la fonction . Cette série doit prendre en compte toutes les composantes connexes, il faudrait donc la calculer pour une taille finie, puis prendre la limite thermodynamique après que la somme sur les clusters ait été effectuée. La fonction de l’équation (2.17) est au contraire obtenue en intervertissant ces deux opérations : on a simplifié l’expression de la probabilité d’un cluster de taille finie dans la limite thermodynamique avant de faire la somme sur les différents types d’arbre. On doit donc avoir pour puisque dans ce régime presque tous les sites sont dans des composantes de taille finie ; par contre ces deux fonctions seront différentes pour des connectivités plus grandes, négligeant la contribution de l’amas infini.
On peut donner un exemple très élémentaire de cette distinction : pour , la fonction compte le nombre total de sites dans un graphe, qui est bien sûr . On a donc quelque soit la valeur de , alors que ne compte que la fraction de sites dans des composantes de taille finie. Cette dernière fonction est donc égale à 1 en dessous du seuil de percolation et vaut au delà de , désignant la fraction de sites dans le cluster infini.
Revenons maintenant au cas d’une fonction générique. Si l’on savait calculer en sommant la série (2.17), cette fonction aurait une singularité à et sa valeur ne nous saurait d’aucune utilité pour prédire la valeur de dans le régime de percolation de l’amas infini. La plupart du temps (sauf dans des cas simples comme le modèle de Viana-Bray dans la phase de basse connectivité) cette resommation est impossible. On se contente donc de couper la série après quelques termes et de développer les exponentielles de pour réordonner le développement en puissances de . C’est cette opération qui a conduit au résultat final (2.4.1). Autrement dit, on a calculé le début du développement de Taylor de au voisinage de . Comme et coïncident sur un intervalle fini , c’est aussi le développement de Taylor de la fonction , objet de notre étude. Si cette fonction, a priori inconnue, est bien définie et régulière sur , avec (même si l’on n’a pas de justification pour la régularité de à ), le développement en cluster peut très bien être convergent jusqu’à .
Un exemple très clair de ce phénomène est l’entropie de température nulle du modèle -spin dilué (alias XORSAT), qui a été calculée rigoureusement [40, 41]. Pour (avec ), l’entropie est une fonction linéaire de , alors que . Le calcul des premiers ordres du développement en clusters est en accord avec ce résultat rigoureux, dont le domaine de validité est bien plus étendu que la phase non percolée.
On verra aussi dans la partie 4.4 un autre exemple d’application de la méthode au calcul du temps de résolution d’un algorithme de recherche locale pour le problème de la satisfiabilité. Dans ce cas il n’y a pas de résultats exacts, mais on peut faire des simulations numériques avec des systèmes de très grande taille (dans le régime intéressant pour cette question, la complexité croît seulement linéairement avec la taille du système, au contraire du problème exponentiel de l’entropie considéré dans la publication P1). Ces simulations sont très convaincantes en faveur de l’absence de singularité à , la fonction étant régulière jusqu’à une valeur de de l’ordre de (pour ) où elle diverge.
A titre de remarque, soulignons finalement la similitude entre le développement (2.4.1) et un principe d’« inclusion-exclusion » : le coefficient du terme est donné, à des facteurs de symétrie près, par la contribution des graphes de clauses, auquel on soustrait celle des sous-composantes de taille inférieure pour éviter un double comptage. Ceci provient du développement des termes de (2.17) qui imposait aux arbres de sites d’être déconnectés du reste du graphe. Dans le développement final cette condition n’est plus imposée, ce qui permet d’étendre la validité du résultat au delà de .
Chapitre 3 Dynamiques de spins continus
Ce chapitre s’articule autour de l’étude du modèle de Viana-Bray dans sa version sphérique. On commence par rappeler quelques généralités sur les modèles sphériques, dont les propriétés sont facilement déduites du spectre de leur matrice d’interaction. Avec cette motivation en tête on fera ensuite un détour du côté des matrices aléatoires. Les conséquences de cette investigation sur la dynamique seront alors présentées, en insistant sur les nouvelles propriétés du modèle dilué par rapport au cas complètement connecté. Le cas particulier étudié ici souffrant de certaines pathologies, on introduit finalement un formalisme plus général qui constitue un premier pas vers le traitement systématique de la dynamique des modèles dilués à variables continues.
Ces travaux ont fait l’objet des publications P2 pour la partie concernant les matrices aléatoires, P3 pour le modèle sphérique, et d’une partie de P5 pour la généralisation.
3.1 Généralités sur le modèle sphérique
3.1.1 Statique
Considérons un système de spins d’Ising , interagissant par paires avec l’hamiltonien
| (3.1) |
La matrice définit les couplages entre les spins. Pour un ferromagnétique en dimension finie par exemple, l’indice représente les coordonnées du site sur un réseau à dimensions, étant positif si et sont des sites voisins du réseau, nul sinon. Pour un verre de spins le signe des interactions est aléatoire.
Hormis quelques cas particuliers (problèmes unidimensionnels, ferromagnétique bidimensionnel, graphes complètement connectés), on ne sait pas calculer exactement la fonction de partition d’un tel modèle. Une simplification possible consiste à modifier la nature des variables . Berlin et Kac [78] ont introduit en 1952 le modèle sphérique, dans lequel les deviennent des variables continues, soumises à la contrainte globale . L’espace des configurations qui était constitué des sommets de l’hypercube à dimensions pour le modèle d’Ising est ainsi étendu à l’hypersphère passant par ces sommets. Cette modification est a priori arbitraire et introduit une interaction entre tous les spins par l’intermédiaire de la contrainte. Stanley [79] a cependant montré que pour des interactions ferromagnétiques en dimension finie, le modèle sphérique est la limite du modèle dit , où chaque spin appartient à une sphère -dimensionnelle, quand . Le modèle d’Ising correspond à dans cette classification, le modèle XY à et celui d’Heisenberg à . Le fait qu’on puisse obtenir le modèle de Berlin et Kac comme la limite d’une famille de modèles plus réalistes constituait un argument en sa faveur. On trouvera une discussion plus détaillée de cette équivalence dans [80].
Les propriétés statiques du modèle sphérique sont faciles à calculer car elles font intervenir des intégrales gaussiennes à la place des sommes sur les spins d’Ising. La fonction de partition s’écrit
| (3.2) | |||||
| (3.3) |
L’intégrale sur se fait dans le plan complexe, parallèlement à l’axe imaginaire et dans le domaine tel que les valeurs propres de aient toutes une partie réelle positive. Dans ce cas l’intégrale gaussienne à dimensions converge, et l’on a
| (3.4) |
où les sont les valeurs propres de la matrice . Dans la limite thermodynamique on peut finalement calculer cette intégrale par la méthode du col.
On voit ici la simplification par rapport au modèle d’Ising : quelque soit le type d’interaction, la seule information sur la matrice dont on a besoin est la distribution de ses valeurs propres. Pour un système de spins d’Ising cela n’est pas suffisant, il faut aussi des quantités impliquant les vecteurs propres de la matrice qui sont plus difficiles à obtenir.
3.1.2 Dynamique
On modélise généralement l’évolution dynamique d’un système de spins continus en contact avec un thermostat de température par l’équation de Langevin,
| (3.5) |
où est un bruit blanc gaussien avec
| (3.6) |
Dans cette partie les moyennes sur les histoires du bruit thermique sont notées . Ici et dans tout le manuscrit la constante de Boltzmann est prise égale à 1. La modélisation de l’influence du thermostat par des équations de Langevin trouve sa justification dans le fait qu’elles conduisent aux temps longs, pour un système de taille finie, à l’équilibre de Gibbs-Boltzmann.
En toute rigueur l’équation (3.5) n’est pas bien définie sous cette forme : les bruits blancs sont si irréguliers que n’est dérivable nulle part, ce qui rend la signification du membre de gauche douteuse. En fait il faut se donner une convention de lecture de ces équations (les plus connues étant celles d’Ito et de Stratanovitch), en discrétisant l’axe des temps. Dans la suite on éludera ce problème, objet d’études mathématiques sous le nom d’« équations différentielles stochastiques ».
Dans le cas du modèle sphérique considéré ici l’équation de Langevin devient
| (3.7) |
où est un multiplicateur de Lagrange dynamique destiné à imposer la contrainte sphérique .
La matrice étant symétrique réelle, on peut la diagonaliser par un changement de base orthogonal. Notons la coordonnée de dans la direction du vecteur propre de associé à la valeur propre . Le jeu d’équations de Langevin devient dans cette base :
| (3.8) |
Comme le changement de base est orthogonal, est encore un bruit blanc gaussien avec les mêmes cumulants que , cf. (3.6). Chaque mode vérifie donc indépendamment l’équation correspondant au mouvement d’une particule dans le potentiel harmonique . Les modes sont couplées implicitement par le multiplicateur de Lagrange .
Ces équations s’intègrent sans difficultés en
| (3.9) |
l’instant initial ayant été fixé à . Introduisant la notation , on peut mettre ce résultat sous la forme
| (3.10) |
Il ne reste plus qu’à déterminer le multiplicateur de Lagrange , ou de manière équivalente sa version intégrée pour avoir une solution explicite de la dynamique du système. Exprimons donc la fonction de corrélation
| (3.11) |
où l’on a utilisé l’orthogonalité de la matrice de passage pour établir la deuxième égalité. En supposant que la condition initiale est aléatoire avec 111On modélise donc une trempe instantané d’une très haute température vers la température du bain extérieur. , et en notant , on obtient
| (3.12) |
La condition de sphéricité s’écrit alors , soit
| (3.13) |
ce qui est une équation intégrale de Volterra.
A partir de la solution explicite des équations du mouvement, on peut exprimer toutes les quantités intéressantes en fonction de et . Par exemple la fonction de réponse à un champ extérieur et l’énergie s’écrivent
| (3.14) | |||||
| (3.15) |
Notons que la condition de sphéricité n’est imposée ici qu’en moyenne par rapport aux histoires du bruit thermique et non pour chacune de ses réalisations. C’est la version dite « mean spherical » du modèle.
On peut conclure de ces généralités que tant la statique que la dynamique de ces modèles sphériques sont déterminées par la distribution de valeurs propres de la matrice d’interaction. Dans le cas complètement connecté, c’est-à-dire la version sphérique du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, la matrice d’interaction appartient à l’ensemble gaussien orthogonal, pour lequel les valeurs propres sont distribués selon la loi du demi-cercle de Wigner. Il est naturel de s’intéresser aussi à la version sphérique du modèle de Viana-Bray, qui est potentiellement un des plus simples modèles dilués. D’après ce que l’on vient de dire, il convient donc de déterminer la distribution des valeurs propres de la matrice d’interaction définie sur le graphe aléatoire poissonnien. Cet objectif est à l’origine de la publication P2 que l’on va exposer dans la section suivante.
3.2 Un problème de matrices aléatoires
3.2.1 Introduction
Les matrices aléatoires ont fait leur apparition en physique dans les années 50 avec les travaux de Wigner et Dyson sur les niveaux d’excitation des noyaux complexes. Elles ont depuis envahies un tel nombre de domaines de la physique qu’il serait difficile de seulement les mentionner tous. Citons simplement parmi les sujets connexes à celui que l’on va développer ici le problème de la localisation d’Anderson dans les systèmes désordonnés [81, 82, 83]. Je renvoie le lecteur intéressé au livre classique de Mehta [84] et à une collection de revues [85] pour une discussion des développements récents du sujet.
Comme son nom l’indique, la théorie des matrices aléatoires consiste à munir un ensemble de matrices d’une loi de probabilité. On cherche alors à déterminer les propriétés statistiques de certaines grandeurs, par exemple la densité moyenne de valeurs propres. Des quantités plus fines sont aussi étudiées, comme la distribution de la plus grande valeur propre, ou encore la distribution des intervalles entre valeurs propres successives.
On va s’intéresser ici à un cas particulier, où les matrices (de taille ) que l’on étudie sont réelles symétriques (elles sont donc diagonalisables, avec valeurs propres réelles). Les éléments de matrice sont tirées indépendamment avec la même loi de probabilité (on distingue seulement les éléments diagonaux des autres),
| (3.16) |
On notera dans cette partie les moyennes sur l’ensemble de matrices. L’exemple le plus connu dans cette famille est l’ensemble Gaussien Orthogonal, pour lequel et sont des lois gaussiennes de moyenne nulle et de variance respectivement et . est une grandeur finie, la dépendance en de ces variances est choisie de manière à ce que le spectre des valeurs propres soit borné dans la limite thermodynamique. Une forme équivalente pour la loi de probabilité de la matrice est alors
| (3.17) |
à une constante de normalisation près.
Les considérations générales sur le modèle sphérique incitent à s’intéresser aux spectres de ces matrices. Si l’on note les valeurs propres pour une réalisation donnée de la matrice , on définit la densité de valeurs propres comme
| (3.18) |
Sa valeur moyenne sur l’ensemble de matrices sera notée . Dans le cas de l’ensemble Gaussien Orthogonal, il est bien connu que tend dans la limite thermodynamique vers la loi du demi-cercle de Wigner. Une démonstration heuristique par la méthode des répliques est donnée dans [86], et l’on retrouvera ce résultat comme cas particulier dans la suite de ce chapitre. Pour une preuve rigoureuse et des résultats plus forts sur le type de convergence on pourra consulter [80].
Notons que d’autres modèles de matrice, notamment dans le cadre de la gravitation bidimensionnelle [87], utilisent des lois de probabilité de la forme :
| (3.19) |
avec un polynôme quelconque. Quand a des termes d’ordre supérieur à 2, les éléments de matrice ne sont pas indépendants ; ces modèles sortent donc du cadre de l’étude présentée ici.
3.2.2 Matrices diluées
Le graphe aléatoire poissonien d’Erdös-Rényi conduit naturellement à la définition d’un ensemble de matrices aléatoires diluées. Pour cela, il suffit de prendre si le lien entre les sommets et est absent du graphe, et de tirer la valeur de avec une loi de probabilité si et sont des sommets adjacents. On peut aussi poser car on considère qu’il n’y a pas de liens entre un sommet et lui-même. En appelant la connectivité moyenne du graphe, on a avec les notations de la section précédente
| (3.20) |
où ne contient pas de delta de Dirac en (cela revient sinon à modifier la définition de ). Si , autrement dit si les éléments non nuls de la matrice sont égaux à , on a construit la matrice d’adjacence du graphe. Dans la suite on va supposer plus généralement que
| (3.21) |
Commençons par quelques remarques simples à la lumière de la discussion sur la géométrie du graphe aléatoire présentée au chapitre 2. Si l’on renomme les sommets de façon à les regrouper selon leur appartenance aux différentes composantes connexes du graphe, il est clair que la matrice va se décomposer sous une forme bloc-diagonale, avec un bloc pour chacune des composantes connexes. La détermination des valeurs propres de la matrice peut donc se faire indépendamment pour chacune des composantes du graphe, et la densité de valeurs propres est une fonction additive par rapport à la décomposition en clusters.
On a vu que pour , c’est-à-dire en dessous du seuil de percolation, une fraction qui tend vers 1 dans la limite thermodynamique de sites sont dans des composantes connexes de taille finie, sans boucles. Considérons deux types d’arbre pour lesquels on peut facilement déterminer les valeurs propres de la matrice qui leur est associée.
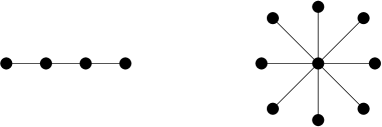
Prenons d’abord un graphe linéaire de sites (partie de gauche de la figure 3.1). La matrice correspondante est tridiagonale et ses valeurs propres se calculent facilement,
| (3.22) |
qui sont bornées sur quelque soit la valeur de .
Si l’on considère au contraire un graphe « en étoile » où un site central est relié à voisins (partie de droite de la figure 3.1), la matrice associée possède valeurs propres nulles, et deux valeurs propres en .
En choisissant un site racine au sein d’un arbre, que l’on décompose en plusieurs branches partant de cette racine, on peut assez facilement obtenir des relations de récurrence entre les polynômes caractéristiques des matrices correspondantes. Cette méthode, expliquée dans la publication P2, permet notamment de montrer que le spectre de tout arbre est invariant si l’on change les signes des éléments non nuls de la matrice correspondante. L’indépendance vis-à-vis du paramètre de la densité moyenne de valeurs propres est donc prouvé, dans la limite thermodynamique, pour . Golinelli [88] a mis à profit ces récurrences pour calculer le spectre des arbres formés d’un squelette linéaire de sites, sur chacun desquels on greffe un bouquet de feuilles. En considérant toutes les valeurs possibles de et , il a ainsi montré que l’ensemble des valeurs propres associées aux arbres de taille finie était dense dans l’ensemble des réels.
Tirons les conséquences de ces remarques :
-
—
Pour , tous les vecteurs propres sont localisés sur des composantes connexes de taille finie.
-
—
Un graphe poissonien comporte un nombre extensif de clusters en étoiles, pour toutes les connectivités du site central . La densité de valeurs propres comporte donc des pics à toutes les valeurs , elle est donc non bornée. Ceci reste d’ailleurs vrai pour toute valeur de : il y a toujours un nombre extensifs de ces clusters, que soit plus grand ou plus petit que le seuil de percolation.
-
—
Le résultat de Golinelli implique de plus que la densité de valeurs propres est formée d’une somme dense de pics de Dirac.
Quand la connectivité moyenne diverge, si l’on rééchelle correctement l’amplitude , on doit retrouver l’ensemble gaussien orthogonal (on rendra cette remarque plus précise dans la section suivante). Pour ce dernier, le comportement du spectre est très différent, et en particulier tous les vecteurs propres sont étendus. On s’attend donc à voir une transition de délocalisation d’une partie du spectre pour une valeur (cette transition de délocalisation a été estimée numériquement à dans [89]). Le fait que les vecteurs propres soient localisés ou étendus ne se traduit pas directement dans le caractère continu ou discret de la densité de valeurs propres, mais dans des quantités plus fines comme les corrélations entre valeurs propres successives, ou les produits de fonctions de Green.
3.2.3 Méthode des répliques
En utilisant l’identité
| (3.23) |
où est positif et infinitésimal, on peut mettre la densité de valeurs propres d’une matrice sous la forme
| (3.24) |
avec la matrice identité . Il est sous-entendu à partir de maintenant que a une partie imaginaire infinitésimale positive. Les propriétés des intégrales gaussiennes permettent de reformuler cette expression comme un problème de mécanique statistique,
| (3.25) | |||||
| (3.26) |
La convergence de l’intégrale gaussienne est assurée par le choix des exposants complexes grâce à la partie imaginaire de . Afin d’obtenir la densité moyenne de valeurs propres, il faut donc calculer , en moyennant sur les « variables gelées » . Le calcul direct de la moyenne d’un logarithme étant difficile, on utilise la méthode des répliques qui repose sur l’identité
| (3.27) |
Le passage à la limite des valeurs de entières vers 0 peut dans certains cas nécessiter la prise en compte d’effets subtils de brisure de symétrie des répliques. L’exemple le plus fameux est donné par la phase de basse température du modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Dans le cas présent du calcul d’une densité de valeurs propres de tels effets ne sont pas attendus [90, 92] (il faudrait par contre briser la symétrie des répliques pour calculer les corrélations entre valeurs propres, cf. [94]).
va s’exprimer comme l’intégrale sur des champ « répliqués » fois, que l’on notera . La moyenne sur l’ensemble des matrices fait apparaître un couplage entre les différentes répliques. Dans le cadre des systèmes dilués, le paramètre d’ordre global qui s’est avéré utile est la fraction des sites portant un champ donné [32] ,
| (3.28) |
On va faire le calcul avec une loi de probabilité des éléments de matrice quelconque. Cela permettra de retrouver la loi du demi-cercle dans le cas de l’ensemble gaussien orthogonal et de démontrer son « universalité » avant de traiter le cas dilué. On doit calculer
| (3.29) |
L’intégration sur et le doivent être compris ici dans un sens fonctionnel : l’égalité (3.28) est imposée pour toutes les valeurs du champ . Comme les éléments de matrice pour sont indépendants, la moyenne sur l’ensemble des matrices se factorise en un produit sur toutes les paires de sites. En définissant
| (3.30) |
il vient
Il reste à effectuer l’intégrale sur les champs initiaux , ce qui va faire apparaître un terme entropique due à la multiplicité des configurations des variables qui conduisent au même . Une façon de faire ce calcul consiste à introduire une fonctionnelle conjuguée pour exponentier la contrainte, puis effectuer l’intégrale sur les champs , et finalement celle sur avec la méthode du col :
| (3.32) |
L’équation de col pour cette dernière intégrale s’écrit
| (3.33) |
En insérant ce résultat dans (3.2.3), on obtient finalement
| (3.34) | |||
où l’on reconnaît le terme entropique en . Cette intégrale fonctionnelle, dont le domaine d’intégration doit être restreint aux normalisées, peut se calculer par la méthode du col dans la limite thermodynamique. Le col est solution de
| (3.35) |
Une fois cette équation résolue, la densité moyenne de valeurs propres découle de (3.26) et (3.27) :
| (3.36) |
L’ensemble gaussien orthogonal et son universalité
La démarche présentée jusqu’ici est valable quelque soit l’ensemble de matrices utilisé, les différents ensembles conduisant à différentes formes de la fonction . Commençons par traiter le cas de l’ensemble gaussien orthogonal, pour lequel les éléments de matrice sont tirées avec une loi gaussienne de moyenne nulle et de variance . On trouve alors que est quadratique, . La solution de l’équation de col (3.35) est obtenue avec un gaussien,
| (3.37) |
dont la variance est solution de l’équation du deuxième ordre :
| (3.38) |
La densité de valeurs propres est alors donnée par . En résolvant l’équation sur , on trouve le résultat attendu : pour à l’extérieur de est réel et donc est nul. Sur cet intervalle les valeurs propres sont par contre distribuées selon la loi du demi-cercle,
| (3.39) |
Discutons la généralité de ce résultat (l’argumentation est adaptée de [92]). Il est clair que dès que est quadratique, on obtient une telle densité d’états. De plus, si l’on veut que le spectre soit indépendant de dans la limite , il faut que soit d’ordre dans cette limite. D’après la définition (3.30), si ne contient pas de delta en 0, il faut que la distribution soit supporté par les d’ordre pour que soit d’ordre 1, et alors elle est forcément quadratique. Dans ce cas on avait tous les éléments de la matrice non-nuls, et d’ordre . On peut essayer de « diluer » la matrice, c’est-à-dire de ne prendre en moyenne que termes non nuls par ligne, avec . Plus précisément, posons
| (3.40) |
avec une loi de probabilité paire, sans Dirac en 0. Si , il faut que soit significative pour des d’ordre , toujours pour avoir d’ordre 1, et dans ce cas-là à nouveau seul le terme quadratique de survit dans la limite thermodynamique.
Il ne reste en fait que le cas pour échapper à la loi du demi-cercle. En effet, est alors supporté par les d’ordre 1, et donc peut être quelconque. Dans la situation , le graphe associé aux éléments de matrice non nuls est précisément un graphe aléatoire d’Erdös et Rényi, auquel on va s’intéresser dans la suite de cette partie. On suivra la méthode dite d’approximation à un seul défaut, introduite par Biroli et Monasson [59].
Notons avant cela que l’on a supposé que la loi de probabilité des était paire. Si ce n’est pas le cas, possède un terme linéaire, ce qui peut entraîner l’apparition d’une valeur propre isolée [86]. Enfin, le raisonnement ci-dessus est pris en défaut quand les éléments de matrice sont distribuées avec une loi qui ne décroît qu’algébriquement à l’infini : c’est le cas des matrices de Lévy qui ont été étudiées par Cizeau et Bouchaud [95]. L’argument fait ici supposait que la variance des était bien définie, hypothèse violée par les lois larges de Lévy.
L’approximation du milieu effectif (EMA)
On reprend à partir de maintenant la forme (3.20), avec , ce qui conduit à
| (3.41) |
Dans ce cas on ne peut pas avoir une résolution analytique exacte de l’équation (3.35). On peut cependant, inspiré par la résolution du cas complètement connecté, faire un ansatz gaussien pour , en utilisant la forme (3.37). On cherche donc un point col dans le sous-ensemble des paramètres d’ordre de cette forme. Si l’on insère cet ansatz gaussien dans l’expression de l’action (3.34), on obtient une expression qui n’est plus fonction que du paramètre variationnel
| (3.42) |
Remarquons que cette expression est indépendante du paramètre de biais .
L’extremum de l’action dans le sous-espace correspondant à cet ansatz est atteint quand vérifie l’équation cubique suivante :
| (3.43) |
On peut vérifier que dans la limite avec on retrouve l’équation quadratique de l’ensemble gaussien orthogonal. Pour fini on peut résoudre cette équation cubique, et trouver une valeur qui sépare deux régimes :
-
—
à l’extérieur de l’intervalle , est réelle, et donc la densité de valeurs propres s’annule.
-
—
à l’intérieur de cet intervalle a une partie imaginaire non nulle, on a donc une densité de valeurs propres positive, qui s’annule à comme une racine carrée.
L’expression de et de n’étant pas particulièrement éclairantes, je ne les reproduit pas ici. L’allure de la densité d’états ainsi prédites est représentée sur la figure 3.2.
L’ansatz gaussien pour n’est pas justifié par un argument variationnel au sens strict : on n’a pas une borne sur l’action qui justifierait de chercher un extremum sur un sous-ensemble de l’espace des paramètres d’ordre. La justification tient plutôt dans la coïncidence avec le résultat correct (loi du demi-cercle) dans la limite où diverge.
Notons finalement que ce résultat est clairement en désaccord avec les remarques qualitatives de la section précédente : le spectre est borné sur , alors que l’on avait montré qu’il devait s’étendre sur tout l’axe réel. Cette différence s’explique simplement : les très grandes valeurs propres sont dues aux sites avec une grande connectivité. Or l’approximation du milieu effectif consiste justement à traiter tous les sites sur le même pied, et donc à négliger les fluctuations de la connectivité.
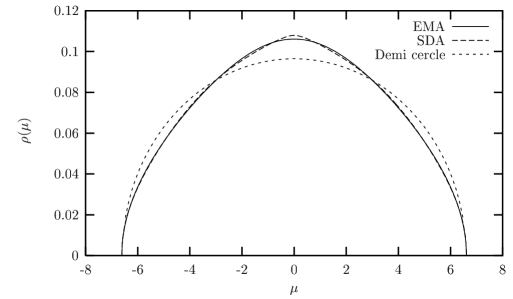
L’approximation à un seul défaut (SDA)
On peut aller au-delà de l’approximation du milieu effectif, avec l’objectif de gommer la contradiction que l’on vient de mentionner.
L’idée consiste à se servir de l’expression gaussienne pour obtenue avec l’EMA comme le point de départ d’une série d’itérations qui devraient conduire à des améliorations successives de la prédiction pour . Reformulons l’équation du point col (3.35) sous la forme
| (3.44) |
où est un facteur de normalisation. On injecte alors la forme gaussienne approchée de dans le membre de droite, et le membre de gauche en fournit une nouvelle forme, que l’on espère meilleure. On peut penser qu’en répétant ces itérations un certain nombre de fois, on va se rapprocher du vrai point col.
Considérons le résultat de la première itération. On obtient pour une somme de gaussiennes, qui conduisent à l’expression de la densité de valeurs propres :
| (3.45) |
où est la solution de l’équation cubique obtenue dans l’approximation du milieu effectif.
L’interprétation de cette équation est la suivante : un site donné a connectivité avec une loi poissonnienne de paramètre , et ses voisins sont décrits de manière approchée par l’intermédiaire du calculé précédemment dans l’approximation gaussienne. Ceci explique le nom d’approximation à un seul défaut, on traite exactement un site (défaut) au milieu d’un réseau homogène effectif. A nouveau le paramètre de biais a disparu de l’expression des grandeurs physiques.
Dans la zone où l’approximation gaussienne prédisait une densité d’états non nulle, était déjà imaginaire, la nouvelle expression (3.45) modifie un peu la forme de (cf. figure 3.2).
Une grande différence entre les deux niveaux d’approximations apparaît dans la zone : alors que l’EMA prédisait une densité d’états nulle, ici on a une série de pics de Dirac quand le dénominateur de (3.45) s’annule (rappelons que a une partie imaginaire infinitésimale). Leur position est donc , et leur poids , avec
| (3.46) |
On peut en particulier s’intéresser au régime asymptotique . Il est facile de montrer à partir de (3.43) que dans cette limite . On trouve donc que les pics sont situés asymptotiquement en , avec un poids donné par la moitié (à cause des deux signes possibles) de la loi de Poisson de paramètre . En remarquant que quand , on peut formuler une approximation continue pour la densité d’états dans ce régime,
| (3.47) |
soit en utilisant la formule de Stirling et en changeant de variables
| (3.48) |
Cette expression avait été obtenue par Rodgers et Bray [90] après un traitement assez subtil d’une équation intégrale, inspiré par un travail de Kim et Harris [96]. Ce résultat prend ici un sens géométrique très simple : les sites dont la connectivité est très supérieure à la connectivité moyenne portent des vecteurs propres fortement localisés sur eux, qu’ils soient strictement isolés du reste du graphe comme dans un cluster en étoile, ou que leur environnement soit remplacé par un milieu effectif comme l’on vient de le faire.
La figure 3.3 présente les résultats d’une étude numérique, où l’on a diagonalisé des matrices tirées aléatoirement avec la loi de probabilité étudiée ici. L’accord avec l’approximation à un seul défaut est très bon dans la partie centrale du spectre. On constate aussi qu’il y a une queue s’étendant au delà de . Cependant le calcul SDA n’est pas capable de prédire quantitativement la densité de valeurs propres au voisinage de , il faudrait pour cela être capable d’aller aux niveaux supérieurs d’itérations dans ce schéma d’approximation. L’expression (3.48) n’est en effet valable que dans la limite . Or le poids dans ces queues, dues à des évènements rares (grandes fluctuations dans la connectivité) est très faible, et donc quasiment impossible à observer dans ces simulations numériques où l’on génère seulement des graphes typiques. Une possibilité pour explorer numériquement ce régime de grande déviation [97] consisterait à biaiser la génération des graphes en faveur de ceux qui présentent des grandes valeurs propres, une méthode déjà utilisée dans un cadre un peu différent [98].
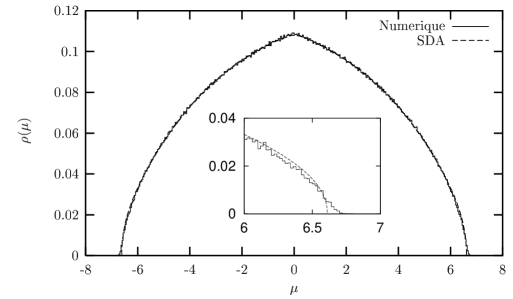
3.2.4 Perspectives
Plusieurs questions restent ouvertes sur ce problème du spectre des matrices d’adjacence de graphes aléatoires d’Erdös-Rényi. La première concerne la validité des résultats obtenus ici par une méthode itérative dont on ne contrôle pas explicitement la convergence vers la vraie solution. Comme on l’a vu, dans la limite de grande connectivité moyenne , le premier niveau d’approximation est correct : l’approximation du milieu effectif redonne en effet la loi du demi-cercle dans cette limite. A fini, le développement asymptotique pour les grandes valeurs propres (3.48) est aussi sûrement correct. La coïncidence avec le résultat obtenu par Rodgers et Bray [90] à l’aide d’une méthode un peu différente est rassurante de ce point de vue, ainsi que la simplicité de l’argument géométrique dont il provient. Les vecteurs propres correspondants étant très fortement localisés autour de sites particulièrement connectés, ils sont asymptotiquement insensibles à leur environnement. Bauer et Golinelli [93] ont établis des relations de récurrence sur les moments de la densité d’états de ces matrices, il serait peut-être possible d’en tirer une autre preuve du développement asymptotique (3.48). Signalons au passage que leurs résultats justifient l’indépendance par rapport au biais que l’on a constaté ici ordre par ordre dans la résolution itérative. En effet, le calcul d’un moment d’ordre fini ne dépend que de l’environnement à distance finie d’un site. Dans la limite thermodynamique les graphes aléatoires étant localement des arbres, le signe des interactions n’est pas pertinent.
Dans une perspective plus rigoureuse, il serait aussi intéressant de connaître la nature du spectre à une échelle plus fine. Comme on l’a discuté dans la partie 3.2.2, la densité de valeurs propres comporte une infinité de pics de Dirac à toutes les positions correspondant aux valeurs propres d’arbres de taille finie, c’est-à-dire un ensemble qui est dense dans les réels [88]. Les vecteurs propres correspondants sont fortement localisés sur un nombre fini de sites. Apparaissent aussi, pour une valeur de suffisamment grande, des vecteurs propres étendus sur l’amas infini de percolation. Le seuil calculé ici est une estimation approchée d’un seuil de mobilité séparant une région où coexistent des vecteurs propres localisés et étendus d’une région extérieure où tous les vecteurs propres sont localisés. A ma connaissance le seul résultat analytique sur ce problème [99] concerne le comportement de la valeur propre nulle de la matrice d’adjacence, qui présente un phénomène de délocalisation et de relocalisation à deux valeurs de .
La méthode itérative utilisée ici a été introduite par Biroli et Monasson [59] pour l’étude des matrices dites Laplaciennes : les éléments diagonaux de ces matrices sont ajustés en fonctions des éléments hors-diagonale, de manière telle que la somme des éléments sur une ligne s’annule. Ce problème a été aussi étudié dans [100, 101]. Des matrices similaires apparaissent aussi dans l’étude des matrices aléatoires euclidiennes [102], en rapport avec l’étude des modes instantanés de vibration dans les liquides surfondus [103]. Dans ce dernier article notamment une résolution numérique d’une équation de col proche de celle rencontrée ici était proposée. Signalons finalement que le spectre de matrice d’adjacence des graphes « scale-free » a été l’objet de travaux numériques et analytiques [104, 105, 106].
3.3 Conséquences sur le modèle sphérique
3.3.1 Rappels sur le cas complètement connecté
Afin de faciliter l’exposition des résultats dans le cas dilué, je vais commencer par rappeler brièvement le comportement du modèle sphérique dans le cas où la matrice d’interaction appartient à l’ensemble gaussien orthogonal. La partie statique a été traitée dans [107] et celle dynamique dans [108, 109, 110], pour une approche mathématiquement rigoureuse on pourra se reporter à [111].
En redéfinissant l’échelle de température, on se ramène à une densité de valeurs propres distribuées selon la loi du demi-cercle sur ,
| (3.49) |
La fonction de partition du modèle est obtenue dans la limite thermodynamique en évaluant l’intégrale (3.4) par la méthode du col. Les sommes sur les valeurs propres sont alors remplacées par des intégrales,
| (3.50) |
Le col de l’intégrale (3.4) vérifie l’équation suivante :
| (3.51) |
On doit par ailleurs imposer pour que l’intégrale gaussienne initiale (cf. (3.3)) soit convergente.
A haute température l’équation de col a une solution qui vérifie cette condition : . Quand on réduit la température le point col se rapproche du point de branchement de l’intégrale en , qui est atteint pour . A des températures plus basses que cette température critique, l’intégrale sur est dominé par le voisinage du point de branchement, le chemin d’intégration reste « collé » à la coupure. De plus, cette transition de phase se traduit par une « condensation » un peu similaire à la transition de Bose-Einstein pour un système de bosons. En effet, la projection de la configuration des spins sur le vecteur propre de plus grande valeur propre devient d’ordre à basse température. Le préfacteur, qui mesure le taux de condensation sur ce vecteur propre, croît continûment et linéairement de 0 à la température critique jusqu’à atteindre 1 à température nulle. L’équilibre à basse température correspond donc à une condensation macroscopique sur le mode de plus grande valeur propre.
La dynamique de ce modèle présente une transition de phase à la même température222La coïncidence des températures de transition statique et dynamique est une particularité de ce modèle où les interactions se font entre paires de spins : les modèles -spin avec ont deux températures critiques différentes.. Comme on l’a vu dans la partie générale 3.1.2, la première quantité à calculer pour déterminer les propriétés dynamiques est la fonction . Dans le cas d’un densité de valeurs propres en demi-cercle cette intégrale est une représentation d’une fonction de Bessel ; le point le plus important pour la suite est son comportement asymptotique,
| (3.52) |
On peut le déterminer sans utiliser les propriétés des fonctions de Bessel : l’intégrale définissant est dominé par le voisinage de . Le comportement exponentiel est dû à l’annulation de pour , et l’exposant de la correction algébrique vient de son annulation en racine carrée. Une fois déterminée, il convient de résoudre l’équation intégrale (3.13) sur . On peut le faire ici en introduisant les transformées de Laplace et ,
| (3.53) |
L’équation de Volterra prend une forme assez simple en terme de ces transformées,
| (3.54) |
Dynamique à haute température
Etudions d’abord la situation à haute température (). On trouve alors que a un pôle en et une coupure sur . Le comportement de aux temps longs est contrôlé par la singularité de sa transformée de Laplace qui a la plus grande partie réelle. C’est donc le pôle qui est pertinent ici, et on a à un préfacteur constant près. On vérifie alors aisément à partir des équations (3.12), (3.14) et (3.15) que :
-
—
L’énergie relaxe exponentiellement vite vers sa valeur d’équilibre.
-
—
Les fonctions de corrélation et de réponse sont stationnaires (après un bref régime transitoire) : et .
-
—
Elles sont reliées par le théorème de fluctuation-dissipation,
(3.55)
On a donc à haute température toutes les caractéristiques d’une dynamique d’équilibre.
Dynamique à basse température
A la température de transition le pôle de rejoint le bord de la coupure, et cette dernière contrôle le comportement asymptotique de . Celui-ci prend donc la forme d’une exponentielle modifiée par un préfacteur algébrique, , à une constante multiplicative près.
Ce nouveau comportement pour va se traduire par une dynamique hors d’équilibre333Soulignons ici que la limite thermodynamique est prise avant la limite des temps longs. Dans le cas d’un système fini évoluant selon des équations de Langevin on tend asymptotiquement vers l’équilibre thermodynamique., que l’on peut mettre en évidence par différentes observations :
-
—
La décroissance de l’énergie vers sa valeur d’équilibre se fait avec une loi de puissance, et non plus exponentiellement comme à haute température. On ne peut donc plus définir de temps caractéristique de relaxation.
-
—
Les fonctions de corrélation et de réponse à deux temps présentent le phénomène de vieillissement : même dans la limite des temps longs, elles dépendent explicitement des deux temps, et non de la différence entre les deux comme pour une dynamique d’équilibre. Plus précisément, si l’on considère et , on a deux régimes différents selon la valeur de .
Si , les fonctions sont quasi-stationnaires, , , avec et reliées par le théorème de fluctuation-dissipation.
Par contre quand la séparation des temps est du même ordre que le temps d’attente depuis la préparation du système, les corrélations et réponses dépendent des deux temps par l’intermédiaire du ratio : et . L’« âge » du système fixe donc, dans ce régime, l’échelle de temps sur laquelle le système relaxe. Les fonctions et sont reliées par une modification du théorème de fluctuation-dissipation où apparaît une température effective. On reviendra dans de plus grands détails sur ce scénario de dynamique hors d’équilibre dans la partie 5.4. Signalons simplement que le cas traité ici n’est pas représentatif du comportement générique de la famille des modèles -spin. En particulier la température effective est ici infinie, ce qui n’est pas vrai pour .
-
—
Finalement, on peut noter que le multiplicateur de Lagrange tendant vers 2, l’équation de Langevin (3.8) régissant l’évolution du mode correspondant à la plus grande valeur propre voit son potentiel de confinement disparaître aux temps longs. Rappelons que l’équilibre à basse température correspondant à une condensation macroscopique sur ce mode (c’est-à-dire que la projection de la configuration dans cette direction est d’ordre ). On conçoit donc que cette situation ne peut être atteinte que sur des échelles de temps divergeant avec la taille du système. La limite thermodynamique ayant ici été prise en premier lieu, le système n’atteint jamais cet équilibre.
3.3.2 Le cas dilué
Etudions maintenant le cas où la matrice d’interaction est défini à partir d’un graphe poissonien de connectivité moyenne . On va se concentrer sur le cas mais fini, la limite correspondant au graphe complètement connecté de la section précédente. On prend pour valeur des éléments de matrice non nuls , de manière à obtenir pour la loi du demi-cercle sur dans la limite .
Résumons les conclusions de l’étude de ces matrices (le schéma de la figure 3.4 illustre ces différents points) :
-
—
A cause des fluctuations non bornées de la connectivité locale, le spectre des valeurs propres n’est pas borné.
-
—
Quand , la densité de valeurs propres comporte une partie centrale qui ressemble à un demi-cercle, et des queues dues aux évènements rares de sites très connectés. Ces queues disparaissent dans la limite , elles ont un poids non perturbatif par rapport à , et l’on a trouvé l’expression asymptotique suivante pour la densité de valeurs propres :
(3.56) à un facteur multiplicatif près.
-
—
Le passage d’un régime à l’autre se fait autour d’une valeur . Ce crossover est la trace de l’annulation stricte de dans la limite complètement connectée.
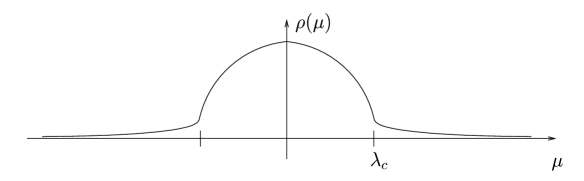
Il faut maintenant examiner les conséquences de ces propriétés sur le modèle sphérique défini avec de telles interactions.
La première remarque à faire est que la statique du modèle n’est pas bien définie dans la limite thermodynamique. En effet, le spectre des valeurs propres n’étant pas borné, la valeur de la plus grande valeur propre diverge avec . Autrement dit la valeur du multiplicateur de Lagrange telle que l’intégrale (3.3) existe diverge avec la taille du système, et l’énergie libre n’est pas extensive dans la limite .
On peut cependant étudier la dynamique de Langevin d’un tel système. La pathologie des propriétés statiques se traduira par une divergence de l’énergie aux temps longs.
Les différents régimes asymptotiques
Suivant la méthode rappelée dans le cas complètement connectée, il nous faut d’abord évaluer la fonction . La séparation de la densité de valeurs propres en une zone centrale et des queues entraîne l’existence de deux régimes asymptotiques pour . Le premier est très similaire à celui étudié dans le cas complètement connecté : pour des valeurs de telles que la contribution dominante de l’intégrale provient du voisinage de , on aura
| (3.57) |
à une constante multiplicative près. L’exposant de la correction algébrique tend vers dans la limite .
Pour des temps encore plus longs, la contribution dominante à l’intégrale va venir du domaine des très grandes valeurs propres. Utilisant la forme asymptotique (3.56) pour évaluer l’intégrale donnant par la méthode du col, on trouve que l’équation du col est asymptotiquement . En prenant la réciproque de ce développement asymptotique, il vient . On a donc dans ce régime des très longs temps l’expression suivante pour ,
| (3.58) |
La séparation entre les deux régimes asymptotiques n’est évidemment pas franche, ce n’est qu’un crossover quand est fini. Dans la limite le deuxième régime disparaît. On peut donner une estimation de , le temps où le comportement de passe d’exponentiel (à une correction algébrique près) à ce deuxième régime (3.58) plus rapide qu’exponentiel, comme la valeur de où les arguments des exponentielles sont égaux. Dans la limite on trouve que : comme attendu ce temps diverge avec , le deuxième régime asymptotique disparaissant dans cette limite.
Il faut ensuite déterminer comme solution de l’équation de Volterra (3.13) (rappelons qu’à température nulle ). Ici on ne peut pas utiliser les transformées de Laplace, qui ne sont pas définies pour des fonctions divergeant à l’infini plus vite que des exponentielles. Une analyse qualitative, confirmée par l’intégration numérique de cette équation, va suffire pour dégager le comportement du système. Remarquons tout d’abord que pour des temps inférieurs à , les queues dans la densité de valeurs propres jouent un rôle négligeable, et a en première approximation le même comportement que dans le cas complètement connecté. La détermination de par l’équation de Volterra est causale, autrement dit ne dépend que du comportement de sur . Il s’ensuit donc que se comporte comme dans le cas complètement connecté jusqu’au temps de crossover. On a donc une température (proche de 1 pour suffisamment grand) telle que pour , avec , au moins jusqu’au temps de crossover. Pour , on a par contre , à une correction algébrique près. Dans ce cas la dépendance en température n’est que dans le préfacteur, pas dans le comportement exponentiel. Reste à déterminer le comportement de pour des temps supérieurs à . Remarquons que l’équation de Volterra implique . Dans le cas , on a donc nécessairement un changement de comportement de à , puisque se met alors à croître plus vite qu’un exponentielle. A haute température par contre, la forme reste valable jusqu’à ce que , suite à quoi . Ce temps de crossover peut s’exprimer dans la limite de haute température où , . Comme on l’a vu dans la section précédente, on a une dynamique d’équilibre quand a une dépendance exponentielle en temps.
La figure 3.5 résume l’étude que l’on vient de faire : à haute température, pour des temps intermédiaires on a un régime de pseudo-équilibre, puis au bout d’un temps d’autant plus grand que la température est élevée, un crossover vers un régime hors-équilibre contrôlé par les queues de la densité de valeurs propres. A basse température, on passe d’un régime hors-équilibre ressemblant à celui présent dans le cas complètement connecté (contrôlé par la partie centrale du spectre) à celui dû aux queues. Le temps de crossover est approximativement constant dans la phase de basse température.
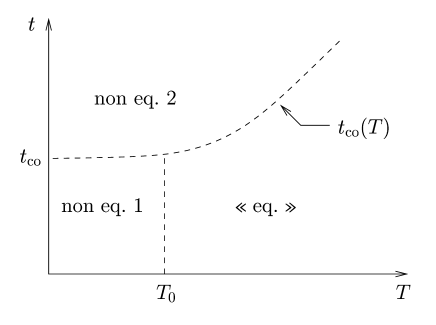
Comportement des observables
La figure 3.6 présente l’évolution temporelle de l’énergie du système pour différentes températures. On a dans un premier temps un plateau qui est atteint soit exponentiellement (pour ) soit algébriquement (pour ) vite, puis un décrochement à quand le système explore les queues de la densité d’états. Dans la limite des très longs temps, l’énergie diverge comme .
On peut également étudier le comportement des fonctions de corrélation et de réponse dans le régime des temps contrôlés par les queues du spectre. Leurs formes sont détaillées dans la publication P3. On trouve en particulier qu’elles sont non-stationnaires, et qu’on peut les mettre sous la forme
| (3.59) |
La fonction qui définit un « âge » effectif du système est différente de celle rencontrée dans l’étude du modèle complètement connecté (on a vu en effet qu’alors ). Dans le cas d’une fonction de corrélation stationnaire pour laquelle , on peut aussi écrire , en utilisant .
On est donc ici dans une situation intermédiaire, où diverge plus vite que dans le cas complètement connecté, mais moins vite qu’à l’équilibre. Ce comportement est parfois qualifiée de « sub-aging » [47] (on en trouvera un autre exemple dans [112]).
La température effective dans ce deuxième régime asymptotique est également infinie.
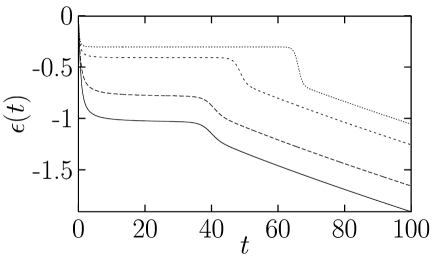
3.3.3 Perspectives
Le modèle que l’on vient d’étudier présente certains défauts : son comportement statique est pathologique, et la dynamique à haute température n’a des propriétés d’équilibre que pendant un temps fini.
Cependant quelques unes de ses caractéristiques sont intéressantes, et devraient subsister dans des modèles dépourvus des défauts sus-citées. Insistons en particulier sur l’existence de deux régimes hors d’équilibre distincts, l’un provenant des propriétés « moyennes » du système, l’autre des « évènements rares ». Si ces deux régimes apparaissent ici de manière caricaturale, leur présence constitue sûrement un ingrédient universel de la dynamique de tout système vitreux localement hétérogène, que ce soit un modèle dilué ou des cas plus réalistes en dimension finie. L’exemple des verres structuraux qui présentent de fortes fluctuations spatiales de densité et de « vitesse de réarrangement » serait un des plus intéressants dans cette perspective.
D’un point de vue plus technique, mentionnons que dans le cas de systèmes inhomogènes comme celui considéré ici les modèles sphériques et la limite du modèle ne sont pas tout à fait équivalents (plus précisément, les multiplicateurs de Lagrange introduits pour imposer la contrainte varient de site à site, alors que le modèle sphérique les suppose homogène). Ce dernier modèle a alors une statique bien définie [113], et sa relaxation à haute température est anormalement lente à cause des fluctuations de connectivité (cf. [24] pour des arguments similaires en dimension finie). Il serait donc intéressant d’étudier la phase de basse température de ce modèle, en espérant y trouver une trace de ces deux régimes hors d’équilibre.
3.4 Vers une méthode générale pour les modèles de spins continus dilués
La méthode utilisée ci-dessus est limitée à ce cas particulier où les spins sont continus avec une contrainte sphérique globale, et où l’hamiltonien ne fait interagir que des paires de spins. C’est en effet à ces deux conditions que l’on peut diagonaliser le système d’équations de Langevin et résoudre chacune des équations indépendamment.
On va présenter dans cette partie une méthode qui permet, au moins formellement, de traiter les modèles où le nombre de spins dans chaque interaction est arbitraire, et comportant des termes du type « soft-spin » . On désigne sous ce vocable des potentiels qui s’appliquent localement à chacun des spins (toujours des variables continues), correspondant dans l’hamiltonien à un terme , où le potentiel est souvent choisi comme
| (3.60) |
Une telle contribution à l’énergie favorise les configurations où les sont tous autour de , on s’attend donc à ce que ces modèles ait des comportements similaires à ceux des modèles d’Ising correspondant. Cela se justifie dans les systèmes ferromagnétiques par des arguments d’universalité au voisinage de la transition, il est moins évident que le rapprochement entre les modèles soft-spins et Ising soit aussi pertinente pour les verres de spins [114, 115].
On peut aussi faire une remarque sur la valeur du coefficient . On dit souvent que l’on doit prendre la limite afin de retrouver le modèle d’Ising. C’est certainement le cas si l’on s’intéresse à la statique et si l’on calcule une fonction de partition. En ce qui concerne les propriétés dynamiques, cette affirmation mérite d’être nuancée : le potentiel introduit une barrière énergétique pour passer d’un puits à l’autre. Dans la limite où la hauteur de la barrière diverge, les transitions d’un minimum à l’autre du potentiel soft-spin n’auront lieu que sur des échelles de temps exponentiellement grandes en , et non sur des temps finis comme on le souhaiterait. Il faudrait donc soit redéfinir l’échelle de temps, soit, et c’est la voie toujours suivie à ma connaissance, garder une hauteur de barrière finie (elle est même la plupart du temps traitée comme une perturbation).
Ces réserves sur l’équivalence avec les modèles du type Ising étant posées, on peut considérer les versions soft-spins comme dignes d’intérêt pour elles-mêmes. On les prend donc comme point de départ dans la suite de cette partie, où l’on présentera le formalisme bien connu de Martin-Siggia-Rose, puis sa reformulation en terme de champs supersymétriques. L’analogie formelle entre ces notations supersymétriques et les calculs statiques par la méthode des répliques est ensuite exploitée pour formuler les équations dynamiques des modèles de champ moyen tant complètement connectés que dilués. Finalement, une méthode itérative de résolution, inspirée de celle utilisée dans la partie 3.2.3, est suggérée pour le cas dilué.
3.4.1 Formalisme fonctionnel
Considérons un système décrit par les variables continues , avec un hamiltonien générique . On introduit une notation pour les dérivées partielles de ,
| (3.61) |
On cherche à étudier le comportement de ce système lorsque son évolution est régie par des équations de Langevin :
| (3.62) |
avec un bruit blanc gaussien déterminé par ses deux premiers moments, , . Les champs sont des champs extérieurs qui vont permettre de calculer les fonctions de réponse du système (ils correspondent à l’ajout de termes à l’hamiltonien, ils sont donc couplés naturellement aux variables ). On prend comme instant initial de l’évolution , instant auquel la configuration a une certaine loi de probabilité. La solution de l’équation de Langevin dépend de la condition initiale , et de toute l’histoire des champs extérieurs et du bruit thermique entre l’instant initial et l’instant . Pour simplifier les notations dans la suite, on appellera la solution des équations de Langevin, la dépendance en , et étant sous-entendue.
Le système est caractérisé par ses fonctions de corrélation et de réponse, définies par
| (3.63) | |||||
où désigne une moyenne sur la condition initiale et sur les histoires du bruit thermique.
Une méthode de calcul de ces fonctions, initiée par Martin, Siggia et Rose [116], Jannsen [117] et de Dominicis [118], consiste à écrire une fonctionnelle génératrice dynamique pour l’évolution des spins,
| (3.64) |
Les fonctions de corrélation et de réponse peuvent alors s’exprimer comme des dérivées fonctionnelles de par rapport à la « source » et au champ extérieur ,
| (3.65) | |||||
Pour éviter d’expliciter la solution des équations de Langevin, on insère formellement une représentation de l’identité comme une intégrale de chemin sur les trajectoires ,
| (3.66) |
La contrainte sélectionne la seule trajectoire qui nous intéresse, . Le produit sur les instants doit être compris comme une discrétisation infinitésimale de l’axe temporel. On a aussi intégré la loi de probabilité sur la condition initiale à la mesure fonctionnelle .
Introduisons la fonctionnelle de suivante :
| (3.67) |
Les équations de Langevin peuvent alors se réécrire , et l’identité (3.66) devient après le changement de variables :
| (3.68) |
est le jacobien de ce changement de variables, que l’on explicitera dans quelques lignes. On a seulement besoin pour l’instant d’admettre qu’il est indépendant des champs . On peut maintenant exponentier la contrainte à l’aide de champs (il est sous-entendu qu’ils sont à intégrer le long de l’axe imaginaire). Le bruit apparaît alors comme . Ce bruit ayant une distribution gaussienne, l’intégrale sur se fait immédiatement, pour conduire à :
| (3.69) | |||||
| (3.70) |
On voit alors à partir des expressions (3.65) que les fonctions de corrélation et de réponse s’expriment comme des moyennes des champs et avec le poids , on peut donc supprimer à partir de maintenant les sources et .
Explicitons le jacobien 444En toute rigueur il dépend de la règle de lecture utilisée dans la discrétisation des équations de Langevin. On passera cette subtilité sous silence.. Il est de la forme
| (3.71) |
où le déterminant est à la fois matriciel (à cause des indices de sites) et opératoriel (à cause de la dépendance temporelle) :
| (3.72) |
Cette expression étant indépendante des champs , leur abandon dans la suite est justifié. En supprimant la valeur absolue dans le jacobien (les équations de Langevin étant causales, il y a univocité du changement de variables, le déterminant a donc toujours le même signe), on peut l’exponentier avec des champs de variables de Grassmann et . Ceci conduit à un poids avec l’action
| (3.73) | |||||
Les termes de la première ligne sont indépendants du modèle, alors que ceux de la deuxième varient selon l’hamiltonien considéré.
Les équations de Langevin purement conservatives, c’est à dire dont les forces découlent d’un potentiel comme on l’a supposé ici, conduisent à des actions fonctionnelles qui présentent un certain nombre de symétries [119, 120, 121]. Certaines mélangeant les champs « bosoniques » et ceux « fermioniques » , on parle souvent de supersymétrie (SUSY) à leur égard. On va ici se servir de la supersymétrie plutôt comme une notation compacte, et pour exploiter l’analogie qu’elle permet de tracer avec les calculs par la méthode des répliques.
Etendons donc la coordonnée temporelle en une « super-coordonnée » , où et sont deux variables de Grassmann. Il s’avère alors utile de réunir les différents champs dans un « super-champ » fonction de ,
| (3.74) |
Notons que chacun de ces termes faisant intervenir un nombre pair de variables de Grassmann, le superchamp a les propriétés d’un nombre commutant habituel. L’action (3.73) se réécrit en termes du superchamp comme
| (3.75) |
où est l’élément d’intégration sur la coordonnée étendue, et désigne un opérateur différentiel,
| (3.76) |
La partie de l’action dépendant de l’hamiltonien a pris une forme extrêmement simple. On peut se convaincre de sa véracité en faisant un développement limité de en puissance des variables de Grassmann et : par définition le développement s’arrête après un nombre fini de termes puisque les variables de Grassmann sont nilpotentes. On constate ensuite que les seuls termes qui survivent à l’intégrale sur et sont ceux présents dans (3.73).
On notera à partir de maintenant les moyennes sur les super-champs avec le poids donné par l’équation (3.75). Les super-fonctions de corrélation contiennent les fonctions de corrélation et de réponse initiales, puisque a été défini à partir des champs et . En particulier la fonction à deux points s’écrit
| (3.77) |
On a utilisé ici certaines symétries de l’action pour transformer les corrélateurs fermioniques en fonctions de réponse [121]. Par contre on n’a pas imposé l’invariance par translation dans le temps et le théorème de fluctuation-dissipation (on reviendra sur ces propriétés dans la suite).
La forme supersymétrique (3.75) de l’action a l’avantage d’être d’une part très compacte, et d’autre part de présenter une analogie avec les calculs statiques par la méthode des répliques (cf. [122] pour une présentation approfondie de cette analogie). Au terme cinétique près (qui est quadratique et local dans l’espace des sites), l’action est donnée par l’hamiltonien du système dans lequel on a remplacé la variable par le super-champ , et cette expression est sommée sur la super-coordonnée . Or la puissance -ème de la fonction de partition, que l’on calcule dans la méthode des répliques, s’écrit :
| (3.78) |
On a formellement la même expression, l’indice des répliques correspondant à la super-coordonnée de l’approche dynamique, le champ répliqué au super-champ.
Le paragraphe suivant s’appuiera de manière cruciale sur cette analogie : les calculs seront essentiellement les mêmes que ceux menés pour le problème de matrices aléatoires, on ne répétera donc pas tous les détails.
Définissons avant cela deux types de produit pour des fonctions supersymétriques à deux points du type de (3.77) :
| (3.79) |
Le premier, dit produit de convolution, s’interprète comme un produit de matrices si l’on regarde les coordonnées supersymétriques comme des indices discrets, ce qui est le cas dans l’analogie avec une théorie répliquée. Dans ce contexte le produit direct de la deuxième définition correspond à un produit de Hadamard.
3.4.2 Modèles de champ moyen
La démonstration de la forme (3.75) de l’action dynamique présentée ci-dessus est valable quelque soit l’hamiltonien du système. Intéressons-nous maintenant au cas où l’hamiltonien contient des variables gelées, et notons les moyennes sur ce désordre gelé. On s’attend à ce que les fonctions de corrélation et de réponse globales soient auto-moyennantes (concentrés autour de leur moyennes par rapport à la distribution du désordre), on veut donc calculer leurs valeurs moyennes. Prenons par exemple un hamiltonien qui contient des termes soft-spins et une partie d’interaction entre spins,
| (3.80) |
On supposera que les couplages sont des variables aléatoires gelées indépendantes, et identiquement distribués avec une loi .
Comme la fonctionnelle génératrice dynamique évaluée sans sources vaut 1 indépendamment de la réalisation du désordre [118], il suffit de calculer la moyenne de et non celle de son logarithme, ce qui évite l’introduction de répliques (sauf si la condition initiale est correlée avec le désordre gelée, une situation considérée par exemple dans [123, 124]).
Autrement dit, les fonctions de corrélation moyennées sur le bruit thermique et sur le désordre gelé sont données par
| (3.81) |
La contribution de qui dépend du désordre est . Pour calculer sa moyenne, il est naturel d’introduire alors l’analogue supersymétrique du paramètre d’ordre [32] utilisé pour le calcul de la densité d’état des matrices :
| (3.82) |
où impose l’égalité pour toutes les super-coordonnées , à l’instar de l’équation (3.28) où l’égalité était imposée pour tous les indices de réplique. Définissons alors
| (3.83) |
de manière analogue à (3.30). La moyenne du terme dépendant du désordre dans le poids des trajectoires des super-champs s’exprime donc, dans la limite thermodynamique, comme
On peut alors suivre la même démarche que dans le calcul du spectre de matrices pour intégrer sur les champs originels , ce qui conduit à :
Dans la limite thermodynamique cette intégrale est dominée par la contribution du col , qui vérifie
où est une constante de normalisation. Une fois cette équation résolue, on peut obtenir les fonctions de corrélation et de réponse moyenne globale,
| (3.86) |
Il ne reste plus qu’à expliciter les composantes bosoniques de ces super-corrélateurs pour exprimer les fonctions de corrélation et de réponse qui étaient l’objectif initial de l’étude.
3.4.3 Le cas complètement connecté
Afin de rendre l’étude précédente, pour le moins abstraite, un peu plus explicite, considérons le cas du modèle -spin sphérique complètement connecté. Celui-ci a été largement étudié dans le passé, on pourra trouver une revue de ses propriétés dans [125].
Dans l’hamiltonien d’interaction (3.80), on suppose donc que les couplages sont distribués selon une loi gaussienne de moyenne nulle, avec . On a donc selon la définition (3.83) . Comme le modèle est sphérique, la contrainte doit être imposée par un multiplicateur de Lagrange dépendant du temps , qui apparaît dans (3.80) comme . Ce terme étant quadratique en , on peut de manière équivalente l’incorporer dans , et noter ce nouvel opérateur. étant une fonction quadratique, l’équation (3.4.2) va admettre une solution gaussienne, en analogie avec le calcul de la densité de valeurs propres de l’ensemble gaussien orthogonal.
Posons en effet
| (3.87) |
où l’inverse est par rapport au produit de convolution . Le membre de droite de (3.4.2) peut alors se calculer, en particulier
| (3.88) |
L’équation de point col (3.4.2) est donc vérifiée si les noyaux des gaussiennes des deux membres sont égaux, autrement dit si
| (3.89) |
Multiplions (de convolution) les deux membres de cette équation par pour obtenir finalement :
| (3.90) |
Ceci est la forme supersymétrique des équations dynamiques pour ce modèle [54], que l’on peut expliciter en termes des fonctions de corrélation et de réponse à deux points (on prend pour simplifier les notations) :
| (3.91) | |||||
où les noyaux et sont donnés par
| (3.92) |
On pourra consulter [46] pour une discussion détaillée des propriétés de ces équations, en particulier le comportement hors d’équilibre de leur solution à basse température, ainsi que pour leur relation avec les versions schématiques de la théories du couplage de modes des liquides surfondus [50]. On reviendra sur ce sujet dans la partie 5.4.
Une interprétation alternative de ce résultat consiste à imaginer l’évolution d’un seul degré de liberté (« single spin equation ») qui conduirait aux mêmes équations pour la corrélation et la réponse. Cela correspond à une équation de Langevin généralisée (une démonstration par la méthode de la cavité dans le cas du modèle SK se trouve dans [10]),
| (3.93) |
est toujours le bruit blanc gaussien modélisant l’interaction avec le bain thermique à la température , mais l’influence du reste du système se traduit par l’apparition :
-
—
d’un bruit coloré gaussien, de variance .
-
—
d’une interaction retardée par l’intermédiaire du noyau .
Autrement dit l’élimination des degrés de liberté du système de départ a fait perdre le caractère markovien des équations de Langevin dont on est parti, et se traduit par l’apparition d’un bain coloré dont les propriétés doivent être déterminées de manière auto-cohérente par l’intermédiaire des équations (3.92).
On trouvera dans le chapitre suivant d’autres exemples de ce phénomène : assez généralement, l’élimination d’une partie des degrés de liberté d’un système conduit à des équations effectives plus compliquées que celles qui décrivaient la dynamique microscopique originelle.
3.4.4 Le cas dilué
La relative simplicité du cas complètement connecté se traduit par le caractère quadratique de , ce qui permet de trouver une solution de l’équation du col (3.4.2) avec une forme gaussienne 555Ceci n’est en toute rigueur vrai que pour les modèles sphériques : les interactions soft-spin, même pour un modèle complètement connecté, sont non quadratiques. On peut cependant les traiter en perturbation en espérant que la physique ne sera pas trop modifiée.. On peut s’interroger sur la généralité de cette situation. En fait le même phénomène d’« universalité » discuté dans la partie sur le spectre des matrices aléatoires se produit ici. Rappelons que dans le cadre des matrices aléatoires, on avait conclu que pour des éléments de matrice distribués indépendamment et de manière identique, la seule distribution qui ne conduise pas à la loi du demi-cercle correspondait au graphe aléatoire poissonien (à l’exception des lois larges de Lévy pour lesquelles l’argument n’est pas valable). On peut faire ici le même type de raisonnement pour montrer que dans la limite thermodynamique, si l’on veut que la fonction définie par (3.83) reste finie sans être quadratique, on doit prendre une loi de probabilité des couplages de la forme
| (3.94) |
Autrement dit les interactions forment un hypergraphe poissonien avec en moyenne plaquettes présentes. Rappelons que dans ce cas la connectivité d’une variable, i.e. le nombre d’interactions auxquelles elle appartient, est une variable aléatoire poissonnienne de moyenne . On trouve alors pour la fonction :
| (3.95) |
Prenons par exemple une distribution bimodale symétrique en , pour laquelle .
Avant de poursuivre cette étude, il convient de vérifier si les modèles dilués avec des variables continues vont présenter le même genre de pathologie que celle du modèle de Viana-Bray sphérique. Un petit raisonnement montre que la situation pour des modèles sphériques est encore plus grave : les couplages étant d’ordre 1 dans le cas dilué, on peut imaginer que les variables vont se localiser très fortement sur un nombre fini de sites. Leurs composantes sur ces sites seront d’ordre pour vérifier la contrainte sphérique, l’énergie de ces plaquettes sera donc d’ordre , donc largement favorisée par rapport aux configurations où toutes les variables sont d’ordre 1, qui ont une énergie extensive. Heureusement, ce phénomène de forte localisation peut être contrecarré par l’introduction de termes soft-spins, par exemple
| (3.96) |
Dans la situation de forte localisation sur un nombre fini de sites, la contribution de à l’hamiltonien sera d’ordre . Il suffit donc de prendre pour empêcher la localisation d’être énergétiquement favorisé.
Revenons à l’équation du point col (3.4.2). Elle peut se réécrire comme
| (3.97) | |||
On peut interpréter cette équation comme ceci : est la probabilité que la trajectoire du superchamp d’un site choisi au hasard soit égale à . Le premier facteur du membre de droite correspond à l’évolution « libre » , c’est-à-dire l’influence du bain thermique et du potentiel local . Dans la deuxième ligne, correspond au nombre d’interactions auxquelles la variable appartient, pour chacune de ces plaquettes les trajectoires des superchamps des autres variables sont combinées pour exprimer leur influence sur la variable choisie.
3.4.5 Perspectives
On pourrait, par pure provocation, dire que le problème de la dynamique des modèles dilués est ici résolu : il « suffit » simplement de résoudre cette dernière équation pour calculer toutes les fonctions de corrélation et de réponse de ces modèles. Cela n’est bien sûr qu’une boutade, car résoudre exactement cette équation semble sans espoir. On peut cependant suggérer une méthode itérative approchée, inspirée de celle de Biroli et Monasson pour les matrices aléatoires. Elle consisterait à chercher une solution approchée avec un gaussien, comme dans la limite complètement connectée, insérer cette solution approchée dans le membre de droite de (3.97), et prendre le membre de gauche comme nouvelle forme approchée. On aurait ainsi une prise en compte successive des fluctuations de connectivité locale du graphe. Pour l’instant cette idée n’a pas été complètement mise en œuvre, mais cette piste mériterait sûrement d’être explorée.
Remarquons aussi que l’approche par une équation effective single-spin du type de (3.93) présente elle aussi des difficultés. Si l’on peut écrire formellement une telle équation, elle fait apparaître des termes de friction retardée avec un nombre arbitraire de temps précédents, et la distribution du bruit effectif est quelconque, au lieu d’être gaussienne dans le cas complètement connecté.
Notons avant de conclure cette partie que la solution de l’équation de col dans le cas dilué n’étant pas gaussienne, les fonctions de corrélation et de réponse à points ne s’expriment plus en fonction uniquement des fonctions à deux points, comme c’est le cas pour des modèles complètement connectés. Cette remarque a motivé l’étude présentée dans le chapitre 5, où l’on s’intéressera aux propriétés des fonctions de corrélation et de réponse à plus que deux temps. Ceci devrait faciliter, à terme, la déduction de prédictions physiques à partir de l’équation (3.97).
Chapitre 4 Dynamiques de spins discrets
On va présenter dans ce chapitre les résultats des publications P4 sur la dynamique d’un algorithme d’optimisation, et P6 qui concerne celle d’un ferromagnétique dilué. Ces modèles sont de natures assez différentes, la dynamique de l’algorithme ne vérifiant pas de condition de balance détaillée. On peut pourtant étudier les deux problèmes en suivant des démarches similaires.
Dans une première partie je commencerai par présenter la méthode de résolution en termes génériques. Elle permet de se concentrer sur l’évolution d’observables macroscopiques en « projetant » les degrés de liberté microscopiques. A titre d’illustration j’applique ensuite cette méthode au cas trivial du modèle de Curie-Weiss, avant de passer à l’étude des deux travaux en question.
4.1 Généralités
4.1.1 Opérateurs de projection
Considérons un système décrit par des configurations microscopiques que l’on suppose discrètes, et qui a une évolution stochastique contrôlée par l’équation maîtresse
| (4.1) |
Le temps est discret ici, les sont donc des probabilités de transition entre deux configurations. L’exemple canonique est un système de spins d’Ising , on a alors configurations microscopiques. Une modélisation habituelle de la dynamique d’un système physique en contact avec un thermostat consiste à imposer les conditions de balance détaillée aux probabilités de transition , de manière à atteindre l’équilibre thermodynamique aux temps longs. On reviendra plus en détail sur ce point dans la suite de ce chapitre ainsi que dans le suivant.
Il est a priori impossible et pas directement intéressant de résoudre le grand nombre d’équations couplées (4.1) pour suivre individuellement les probabilités de chacune des configurations microscopiques. L’information intéressante sur le système est contenue dans un plus petit nombre de grandeurs macroscopiques (énergie, magnétisation, densité de particules, ou d’autres selon les situations). Petit ne veut pas nécessairement dire fini : pour un système de particules sur un réseau tridimensionnel par exemple, on peut s’intéresser aux fluctuations de densité de tout vecteur d’onde.
On peut se « débarrasser » de l’information microscopique superflue et obtenir directement des équations d’évolution pour les quantités macroscopiques, mais le prix à payer pour cette perte d’information sera l’abandon du caractère markovien de l’évolution. Cette idée peut se formaliser en utilisant des opérateurs de projection, une méthode attribuée à Mori [126] et Zwanzig [127], et sur laquelle repose notamment la théorie du couplage de modes pour les liquides surfondus [50].
Introduisons à cet effet une matrice et un vecteur colonne , indicés par les configurations microscopiques,
| (4.2) |
L’équation maîtresse se réécrit alors comme un produit matriciel,
| (4.3) |
Notons l’observable macroscopique à laquelle on s’intéresse. Pour alléger les écritures on laisse sous-entendu le fait qu’elle pourrait être elle-même vectorielle. On peut partitionner l’ensemble des configurations selon les valeurs de qui leur sont associées. La matrice définie par
| (4.4) |
est un projecteur () dont l’action sur un vecteur colonne consiste à le « lisser » en faisant une moyenne sur chacune des partitions engendrées par l’observable . On va poser la loi de probabilité lissée, et son complément. En projetant l’équation maîtresse il vient
| (4.5) |
où désigne la matrice identité. En itérant la deuxième équation il est possible d’éliminer :
| (4.6) |
en supposant que la probabilité au temps initial est telle que .
Par définition ne dépend de que par l’intermédiaire de la valeur de l’observable . L’équation projetée (4.6) détermine donc l’évolution des probabilités d’observation des différentes valeurs de . Comme on pouvait s’y attendre, la perte d’information due à la projection est compensée par l’apparition d’une mémoire de l’évolution passée de l’observable.
On nommera approximation markovienne dans la suite de ce chapitre l’approximation qui consiste à remplacer (4.6) par
| (4.7) |
c’est-à-dire à négliger tous les termes de mémoire. Cette approximation est a priori incontrôlée, on verra au cas par cas la qualité des prédictions à laquelle elle conduit. Faisons deux remarques :
-
—
Les résultats d’une telle approximation dépendent bien sûr de l’observable sur laquelle on projette. Plus celle-ci contient une description fine de la configuration microscopique, moins on perd d’information en passant au processus projeté, et meilleurs devraient être les résultats de l’approximation.
-
—
En termes plus parlants, cette approximation consiste à supposer qu’à chaque instant toutes les configurations microscopiques correspondant à une même valeur de l’observable sont équiprobables. En effet dans ce cas, et (4.7) est alors correcte. Cette interprétation sera utile dans la suite.
4.1.2 Processus « markoviens locaux »
L’évolution des observables macroscopiques d’un système physique présente souvent des caractéristiques particulières. Pour un système de spins d’Ising par exemple, la magnétisation totale est extensive, proportionnelle à la taille du système. De plus on considère souvent des probabilités de transition qui relient les configurations ne différant que par le renversement d’un spin : la magnétisation ne varie donc que d’une quantité finie sur un pas de temps élémentaire. On va étudier dans cette partie les propriétés de tels processus stochastiques, dans un cadre un peu plus général.
Considérons une variable aléatoire à dimensions, qui prend des valeurs discrètes, et qui évolue à chaque pas de temps selon l’équation maîtresse markovienne
| (4.8) |
Cela pourrait notamment être le résultat de l’approximation markovienne à partir d’une description microscopique ; on a explicité ici la possibilité pour l’observable d’être multidimensionnelle, et on réutilise la notation en espérant qu’il n’y aura pas de confusion avec les probabilités de transition microscopiques.
Supposons que l’on ait dans notre problème un paramètre , et que les valeurs typiques de soient d’ordre . Le processus est dit ici « local » si la variation typique de sur un pas de temps est d’ordre , et si les probabilités de transition ne varient sensiblement que lorsque ses arguments varient sur des quantités d’ordre . Autrement dit,
| (4.9) |
avec non nulle pour d’ordre , et suffisamment régulière dans la deuxième variable.
Introduisons deux notations :
| (4.10) |
La première correspond à une moyenne sur les trajectoires possibles de la dynamique, la deuxième sur les transitions possibles de cette marche aléatoire au voisinage d’un point donné. Cette dernière moyenne est bien normalisée car l’équation maîtresse définie par les conserve la probabilité totale.
On va d’abord s’intéresser à l’évolution temporelle de la valeur moyenne de . Pour deux instants successifs, il vient très simplement
| (4.11) |
Comme on va le voir dans la suite, est fortement piqué autour de sa valeur moyenne dans la limite thermodynamique. On peut donc intervertir les deux opérations et dans le dernier terme de l’équation (4.11). Il est alors naturel de définir un temps (quasi-) continu , ainsi que la densité de la valeur moyenne de ,
| (4.12) |
Posant la dérive moyenne au voisinage du point , on obtient en développant (4.11) l’équation différentielle ordinaire
| (4.13) |
En résolvant cette équation avec la condition initiale appropriée, on a déterminé le comportement moyen du processus stochastique. C’est en fait aussi son comportement typique, les fluctuations de autour de sont d’ordre .
Intéressons nous maintenant à ces déviations autour de l’évolution moyenne. Afin de rendre plus claire la suite de l’exposé il est peut-être utile de rappeler quelques propriétés des sommes de variables aléatoires indépendantes. Soit donc la somme de variables, distribuées selon la loi . On utilisera à nouveau la notation pour dénoter les moyennes sur cette loi , et on pose . D’après le théorème central limite, est une variable aléatoire gaussienne centrée sur , avec des fluctuations d’ordre . Cependant cette forme gaussienne n’est valable qu’autour de , les queues de la loi pour les valeurs improbables de ne sont pas décrites par le théorème central limite. Ce régime de grande déviation est l’objet du théorème de Cramer, que l’on va retrouver ici de manière heuristique. Notons
| (4.14) |
la fonction génératrice de . Comme est la somme de variables indépendantes, il vient
| (4.15) |
Dans la limite la somme dans le membre de gauche s’évalue par la méthode du col. En posant , on s’aperçoit que la fonction de grande déviation et la fonction génératrice sont des transformées de Legendre l’une de l’autre,
| (4.16) |
Le théorème central limite s’obtient à partir de ce théorème plus puissant en développant autour de , ce qui revient à développer autour de .
Revenons à notre problème de processus stochastique. La valeur de à l’instant est aussi la somme d’un grand nombre, , de variables aléatoires , mais qui ne sont ni indépendantes ni tirées avec la même loi de probabilité puisque dépend de la position . L’idée dans la suite de cette partie consiste à exploiter les propriétés de « localité » du processus : sur un intervalle de temps avec le déplacement du processus est la somme de variables que l’on supposera distribuées avec la même loi . On utilisera donc le théorème de Cramer sur des petits intervalles de temps pour lesquels la marche n’a pas trop bougé.
Il y a deux manières d’exploiter cette idée. La première consiste à écrire une équation aux dérivées partielles sur la fonction génératrice.
Inspiré par le résultat du théorème de Cramer, on pose
| (4.17) |
Introduisons aussi la fonction génératrice
| (4.18) |
En évaluant la somme sur par la méthode du col, on constate que est la transformée de Legendre de , . Cherchons maintenant à écrire l’équation qui régit l’évolution de . On obtient facilement
| (4.19) |
Le membre de gauche devient, en développant l’argument temporel de ,
| (4.20) |
Définissons aussi la fonction génératrice des déplacements microscopiques autour d’une position donnée,
| (4.21) |
Le membre de droite de (4.19) peut alors être évalué par la méthode du col,
| (4.22) |
où est le point col de l’intégrale. D’après les propriétés des transformées de Legendre, on a en fait . D’où finalement l’équation aux dérivées partielles qui gouverne l’évolution de la fonction génératrice :
| (4.23) |
Une fois que cette équation, complétée par une condition initiale , est résolue, il reste à effectuer une transformée de Legendre inverse pour obtenir la fonction de grande déviation . On peut facilement vérifier deux propriétés attendues de (4.23) :
-
—
elle conserve , qui traduit la normalisation des probabilités.
-
—
elle permet de réobtenir l’équation (4.13) pour l’évolution de la position moyenne avec .
De plus on retrouve naturellement la forme habituelle du théorème de Cramer quand est indépendant de .
L’équation (4.23) se traduit en une équation équivalente sur la fonction de grande déviation :
| (4.24) |
Cette deuxième forme est d’une moindre utilité pratique, étant souvent plus irrégulière que . Par exemple pour une condition initiale où est fixé à une certaine valeur , on a , alors que vaut partout sauf en où il s’annule.
Une deuxième approche à ce problème de grande déviation consiste à écrire, sous forme d’intégrale de chemin, la probabilité de toute une trajectoire pour . On l’obtient en découpant l’axe des temps en intervalle de longueur et en utilisant le théorème de Cramer sur chacun des intervalles. Prenant finalement la limite il vient
| (4.25) |
De cette représentation en intégrale de chemin on peut obtenir la fonction de grande déviation à l’instant comme
| (4.26) |
où l’intégrale fonctionnelle sur les trajectoires doit être restreinte à celles qui vérifient , et doit être pondérée selon la distribution de probabilité de à l’instant initial.
Le lien entre l’approche par la fonction génératrice (4.23) et celle de l’intégrale de chemin fait apparaître, de manière assez frappante, une analogie avec le formalisme de la mécanique analytique. En effet, l’évaluation de l’intégrale de chemin (4.26) par la méthode du col conduit aux équations suivantes pour les trajectoires dominantes :
| (4.27) |
c’est-à-dire des équations de mouvement classique où et sont des moments conjugués l’un de l’autre. La fonction s’interprète comme un hamiltonien, et l’équation sur la fonction génératrice (4.23) correspond à l’équation de Hamilton-Jacobi de ce problème de mécanique. On peut donc interpréter comme la fonction génératrice du changement de variables canonique, qui n’est autre que la transformée de Legendre de l’action (au sens mécanique du terme). Cette action apparaît aussi comme le poids de l’intégrale de chemin, ce qui nous ramène à l’interprétation originelle de et comme transformées de Legendre l’une de l’autre.
Pour conclure cette partie, remarquons que la présentation utilisée était loin d’être rigoureuse. En particulier la notation ne désignait pas des vrais équivalents, puisque seulement les termes exponentiels en ont été conservés, en négligeant tous les préfacteurs algébriques. Ces résultats peuvent pourtant, au prix d’énoncés plus précis, prendre un sens mathématique. La concentration de l’évolution typique autour de l’évolution moyenne solution de l’équation différentielle ordinaire (4.13) est par exemple un cas particulier du théorème de Wormald [128]. Ce type de raisonnement est souvent utilisé en informatique pour prouver des bornes inférieures sur le seuil de satisfiabilité [129]. Pour un énoncé rigoureux des principes de grande déviation, on pourra se référer à [130].
4.2 Le modèle de Curie-Weiss
Dans cette partie on va illustrer ce formalisme générique dans un cas très simple. Considérons à cet effet le modèle de Curie-Weiss, alias le ferromagnétique sur le graphe complet. Chacun des spins d’Ising du modèle interagit avec tous les autres, et avec un champ extérieur d’intensité , ce qui conduit à l’hamiltonien
| (4.28) |
Le couplage entre spins est d’ordre de manière à avoir un hamiltonien extensif. On prendra dans la suite, ce qui revient à redéfinir l’échelle de température.
Les propriétés statiques du modèle sont déterminées très simplement. L’hamiltonien ne dépend en effet de la configuration microscopique que par l’intermédiaire de la magnétisation , la fonction de partition s’écrit donc
| (4.29) |
Dans la limite thermodynamique on peut évaluer le coefficient binomial avec la formule de Stirling et transformer la somme en une intégrale, que l’on calcule par la méthode du col. On aboutit alors à l’expression de l’énergie libre par site
| (4.30) |
où est la magnétisation par site. On reconnaît dans cette expression la décomposition en partie énergétique et entropique. La magnétisation spontanée du système minimise l’énergie libre. Elle vérifie l’équation , avec donc une température inverse critique en champ nul de .
Les propriétés dynamiques de ce modèle ont été étudiées dans [131]. On reconsidère ici cette étude, en s’appuyant sur le formalisme développé dans la partie précédente.
Prenons l’évolution dynamique habituelle pour des systèmes de spins d’Ising : à chaque pas de temps, un des spins est choisi au hasard, on calcule la variation d’énergie que son renversement induirait dans le système, et on effectue le renversement avec une probabilité . De manière à atteindre l’équilibre thermodynamique à la température inverse , on impose la condition de balance détaillée sur , sous la forme
| (4.31) |
Les taux de transition les plus connus, qui respectent tous deux cette condition, sont ceux de Metropolis et de Glauber,
| (4.32) |
| (4.33) |
Ici la projection de la dynamique est triviale. Il est clair en effet que les configurations microscopiques avec la même magnétisation sont équiprobables à tout instant si l’on part d’une condition initiale uniforme sur les configurations d’une magnétisation donnée. Autrement dit on ne perd pas d’information en passant à la dynamique sur la magnétisation, qui reste markovienne. De plus l’énergie d’une configuration s’exprime en fonction de sa magnétisation. Dans une configuration de magnétisation par site , le spin choisi au hasard est de signe avec la probabilité , et la variation d’énergie du système s’il est flippé vaut (à des termes d’ordre près). La magnétisation totale varie alors de . On est donc dans le cadre général d’un processus markovien local étudié dans la section précédente, avec
| (4.34) | |||||
| (4.35) | |||||
| (4.36) |
Suivant toujours les notations générales, la variation moyenne de la magnétisation lors d’un pas de temps à partir d’une configuration de magnétisation s’écrit
| (4.37) |
La magnétisation moyenne évolue donc selon l’équation différentielle . Utilisons la condition de balance détaillée pour transformer cette équation en
| (4.38) |
Partant d’une condition initiale quelconque, on atteint aux temps longs une magnétisation stationnaire telle que . Sous la forme (4.38) il est facile de voir que vérifie . Comme il se doit, la condition de balance détaillée sur les probabilités de transition implique que les points fixes de l’évolution dynamique sont les extrema de l’énergie libre thermodynamique. L’équation (4.38) permet en outre de décrire la relaxation vers l’équilibre à partir d’une magnétisation initiale qui en est arbitrairement éloignée.
On va étudier plus en détails la stabilité de ces points fixes, ainsi que le comportement critique au voisinage de . Prenons pour simplifier . On a par définition . La stabilité du point fixe , ainsi que le comportement du système aux temps longs, est contrôlée par le développement de autour de . En définissant le temps de relaxation par , on obtient
| (4.39) |
En accord avec la stabilité thermodynamique, le point fixe paramagnétique est dynamiquement stable à haute température ( pour ), et instable à basse température (). Dans ce dernier cas ce sont les solutions ferromagnétiques qui attirent la dynamique aux temps longs.
La divergence du temps de relaxation quand on s’approche de dans la phase paramagnétique s’obtient facilement à partir de cette expression,
| (4.40) |
Dans la phase ferromagnétique, il faut développer (4.39) autour de , on trouve alors
| (4.41) |
L’amplitude de ces divergences dépend de la dynamique microscopique par l’intermédiaire de , mais le rapport des deux amplitudes est universel, il vaut quelque soit la dynamique microscopique.
Exactement à , le premier ordre du développement de en puissances de s’annule, le deuxième est nul pour des raisons de symétrie par renversement du signe des spins, c’est donc le troisième ordre qui est pertinent. On a aux temps longs , ce qui implique que la magnétisation (si elle était non nulle dans l’état initial) s’annule comme . Comme l’énergie est le carré de la magnétisation, elle va vers sa valeur d’équilibre comme .
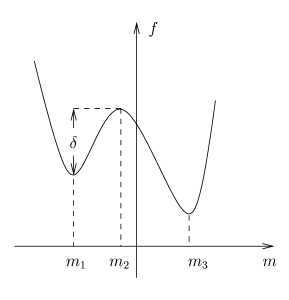
Il reste un dernier aspect de la dynamique à traiter. Supposons que l’on soit en présence d’un champ extérieur , et que la température soit suffisamment basse, de telle sorte que l’énergie libre ait l’allure schématisée sur la figure 4.1. Si la magnétisation initiale est plus petite que , le calcul du comportement typique présenté ci-dessus conduit à la conclusion : quand . Autrement dit le système reste bloqué dans l’état métastable de magnétisation . Il est clair que l’on arrive à ce résultat parce que la limite thermodynamique a été prise avant la limite de temps longs . Pour un système de taille finie, la condition de balance détaillée implique qu’aux temps suffisamment longs, les configurations sont échantillonnées par la dynamique selon la distribution d’équilibre de Gibbs-Boltzmann, et donc la magnétisation typique vaut , quelque soit la condition initiale. Comme le temps de relaxation du processus de Markov diverge avec la taille du système, quand on prend la limite thermodynamique avant celle des temps longs l’ergodicité est brisée et le système reste confiné dans l’état métastable.
On peut être plus précis et calculer la divergence de ce temps d’ergodicité dans la limite thermodynamique. Il faut pour cela étudier la fonction de grande déviation . Sa transformée de Legendre évolue selon l’équation (4.23), où
| (4.42) |
En utilisant la condition de balance détaillée, on peut montrer que la solution stationnaire atteinte aux temps longs, vérifie
| (4.43) |
En intégrant cette équation avec la condition , on obtient finalement
| (4.44) |
Les grandes déviations autour de la magnétisation typique métastable sont contrôlées par l’énergie libre grâce à la condition de balance détaillée. En particulier la probabilité d’une grande déviation jusqu’au maximum de l’énergie libre est exponentiellement petite, en . Le temps de vie de l’état métastable va diverger de manière inversement proportionnelle à cette probabilité,
| (4.45) |
A nouveau le signe d’équivalence n’est pas utilisé dans son sens mathématique, ce résultat est affecté d’un préfacteur polynomial en , calculé dans [131].
Ce résultat n’est évidemment pas surprenant, puisqu’il correspond au temps d’activation d’Arrhénius pour passer une barrière d’énergie libre de hauteur . C’est cependant un des cas, assez rares, où l’on peut le calculer explicitement. Un autre exemple où ce calcul est possible est celui du problème de Kramers pour une particule brownienne dans un potentiel métastable. Dans ce dernier cas la divergence des temps prend place à la limite de basse température, et non à celle thermodynamique comme dans le modèle de champ moyen considéré ici.
4.3 Le ferromagnétique à connectivité fixe
Le modèle de Curie-Weiss que l’on vient d’étudier est l’archétype des modèles ferromagnétiques de type champ moyen. Le fait qu’il soit complètement connecté, c’est à dire que chacun des spins interagisse avec tous les autres, rend sa description très simple, puisque toutes les configurations microscopiques correspondant au même paramètre d’ordre macroscopique (la magnétisation) sont équivalentes.
On va considérer dans cette partie un autre modèle, lui aussi ferromagnétique et de type champ moyen, mais cette fois-ci il sera dilué. La connectivité finie rend le problème plus difficile, et l’on n’obtiendra pas une solution exacte de l’évolution dynamique. On va donc s’efforcer de développer une série d’approximations de plus en plus précises. Ce travail a fait l’objet de la publication P6.
4.3.1 Définition du modèle, propriétés thermodynamiques
Le modèle en question est un système de spins d’Ising , interagissant par des couplages ferromagnétiques sur un arbre de Bethe de connectivité . Comme il a été discuté dans le chapitre 2.3, arbre de Bethe signifie dans ce contexte graphe aléatoire régulier. Autrement dit, le graphe d’interaction est localement un arbre où chaque variable a voisines, mais il y a des boucles de longueur dans le système. Ainsi chaque site est statistiquement équivalent, et on évite le problème des effets de bords puisque le graphe n’a pas de surface.
On prend pour hamiltonien
| (4.46) |
est donc un entier positif qui compte le nombre d’interactions frustrées, c’est à dire le nombre de liens dans le graphe dont les extrémités portent des spins de signe opposés. On notera aussi l’énergie d’une configuration, la magnétisation totale, et , les quantités par spin correspondantes.
Déterminons les propriétés thermodynamiques du modèle par la méthode de la cavité, utilisée ici dans sa version la plus élémentaire dite symétrique dans les répliques. On se reportera à la figure 4.2 pour une illustration des définitions.
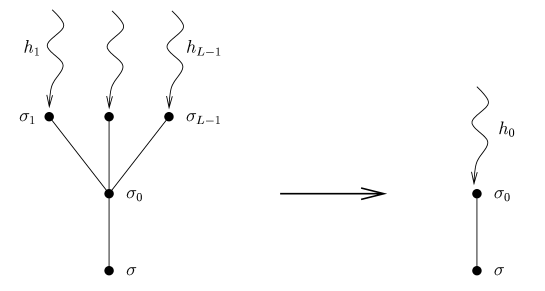
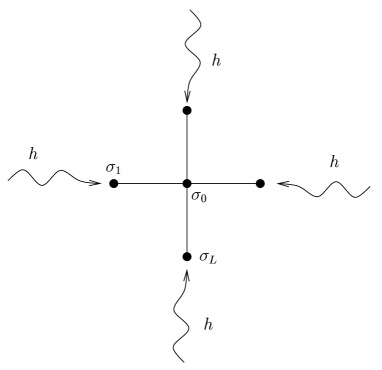
Supposons pour commencer que le graphe d’interactions soit un arbre. On prend pour site central la variable notée , ses voisins sont séparées en un site qui représente l’« aval » du graphe, et sites en « amont » . La loi de probabilité d’une configuration microscopique des variables est donnée par . Le champ de cavité s’exerçant sur la variable est défini de la manière suivante. Lorsque l’on somme la loi sur toutes les variables de la branche du graphe en amont de , la probabilité marginale résultant de cette sommation partielle a une dépendance en de la forme
| (4.47) |
où est l’énergie du lien entre deux spins. L’équation (4.47) constitue une définition du champ de cavité . On peut maintenant, en faisant la trace sur les variables , écrire une équation de récurrence donnant le champ de cavité en fonction des champs :
| (4.48) |
Une fois cette récurrence établie, on l’applique au graphe aléatoire régulier pour lequel tous les sites sont équivalents, et l’on cherche donc une solution homogène de cette équation,
| (4.49) |
Il peut sembler contradictoire d’utiliser ici l’équation de récurrence (4.48), qui n’est strictement valable que pour un arbre, alors que le graphe aléatoire possède des boucles. On peut cependant espérer que cette approche soit rendue légitime par la divergence de la longueur des boucles dans la limite thermodynamique.
On voit facilement que (4.49) ne possède à haute température que la solution triviale , alors que deux solutions se développent continuement en dessous d’une température critique , dont l’inverse vaut .
Il reste à calculer les grandeurs thermodynamiques du problème. Considérons à cet effet la situation schématisée sur la figure 4.3, où le spin est entourée de ses voisins , l’influence du reste du graphe ayant été incorporée dans les champs de cavité , solution de l’équation (4.49). La loi de probabilité de ces variables est, à une normalisation près,
| (4.50) |
De cette forme on peut tirer la magnétisation par site
| (4.51) |
ainsi que l’énergie par site,
| (4.52) |
L’apparition d’une solution non triviale correspond donc à une transition ferromagnétique. Notons au passage que la magnétisation s’annule à la température critique en racine carrée de , ce qui redonne bien sûr l’exposant critique de champ moyen.
Il nous sera utile pour la suite de connaître la probabilité qu’un site ait spin et soit entouré de liens frustrés. A l’équilibre, l’expression (4.50) conduit à :
| (4.53) |
où est une constante de normalisation. On peut transformer cette expression en utilisant les densités d’énergie et de magnétisation d’équilibre, ce qui conduit à
| (4.54) |
4.3.2 Les descriptions approchées de la dynamique
On va étudier la même dynamique que celle utilisée sur le modèle de Curie-Weiss : à chaque pas de temps un des spins est sélectionné au hasard, puis renversé avec une probabilité dépendant de la variation d’énergie que ce renversement induit dans le système. On s’intéressera uniquement à des taux de transition qui vérifient la condition de balance détaillée, de manière à assurer la convergence aux temps longs vers l’équilibre thermodynamique.
Premier niveau : l’approximation binomiale
Comme ce sont les deux paramètres qui permettent de décrire complètement l’état d’équilibre, il est naturel d’essayer de bâtir une description dynamique en termes de l’énergie et de la magnétisation. Suivant les idées générales décrites précédemment, il faudrait pour cela être capable de déterminer les probabilités de variation de ces deux grandeurs au cours d’un pas de temps élémentaire. Supposons connue la probabilité que la variable choisie au cours du pas porte un spin et soit entourée de liens frustrés, c’est-à-dire que parmi les variables voisines portent un spin . Alors la variation d’énergie si le renversement de la variable est effectué vaut (les liens frustrés deviennent satisfaits et vice versa), et la variation de la magnétisation totale est . Dans cette partie désignera la probabilité que le flip (renversement) soit accepté. La condition de balance détaillée s’exprime donc comme
| (4.55) |
Dans la limite thermodynamique le temps devient continu et l’on obtient les équations différentielles qui régissent l’évolution des moyennes de l’énergie et de la magnétisation :
| (4.56) |
A nouveau les trajectoires typiques seront proches de ces valeurs moyennes dans la limite thermodynamique.
Les équations d’évolution de et font intervenir la fonction , qui a priori contient plus d’informations. Cela n’est pas surprenant au vu de la discussion du début du chapitre sur les propriétés des dynamiques projetées. Il va donc falloir faire une approximation pour fermer les équations (4.56) en termes de et seulement. Faisons le raisonnement suivant : par définition de la magnétisation, la variable choisi aléatoirement aura spin avec probabilité . A ce niveau de description, on peut seulement supposer que les liens autour de la variable en question sont frustrés avec la même probabilité . Ceci conduit donc à une loi binomiale (d’où le nom de l’approximation),
| (4.57) |
Reste à déterminer . Pour cela, remarquons que chaque lien frustré relie un spin et un spin . L’énergie doit donc s’exprimer, de manière cohérente, comme le nombre de variables autour de celles , et vice versa. Autrement dit,
| (4.58) | |||||
| (4.59) |
Cette équation détermine en fonction de et , on obtient donc finalement l’expression approchée de comme
| (4.60) |
Cette forme est en fait exacte à l’équilibre (cf. (4.54)), l’approximation consiste à supposer qu’elle reste vraie en remplaçant et par leurs valeurs et , en général différentes de celles d’équilibre.
Une fois admise cette forme approchée de , les équations sur et se ferment. On s’est ramené à un système de deux équations différentielles ordinaires, du premier ordre en temps, couplées. On discutera dans la section suivante leur comportement et la précision d’une telle approximation. Notons au passage que ce niveau d’approximation devrait devenir exact dans la limite , en prenant des intensités de couplage entre spins d’ordre : on retrouve dans cette limite le modèle de Curie-Weiss, pour lequel l’évolution de la magnétisation est markovienne.
Résumons ce que l’on vient de faire : partant d’une description minimale de l’état du système par deux observables macroscopiques ( et ), on a eu besoin d’une nouvelle quantité macroscopique () pour écrire les équations d’évolution exactes de nos observables de départ. Une approximation a alors été nécessaire pour fermer les équations sur et seulement. Une autre possibilité consiste à écrire une équation d’évolution pour elle-même, qui va faire intervenir une nouvelle observable contenant plus de détails sur l’état microscopique du système, et l’on devra à nouveau faire une approximation pour fermer l’équation sur , ou bien écrire une équation pour la nouvelle observable… A chaque itération de ce processus apparaissent des observables de plus en plus précises mais qui obéissent à des équations de plus en plus compliquées, et que l’on doit de toute façon couper de manière approchée à un certain stade, à moins de vouloir suivre l’évolution microscopique originelle, ce que l’on cherche à éviter depuis le début. Cette situation rappelle bien sûr un grand nombre de problèmes physiques où apparaissent des hiérarchies de fonctions que l’on doit tronquer à un certain ordre, notamment la hiérarchie dite BBGKY (d’après Bogoliubov, Born, Green, Kirkwood et Yvon) pour la dynamique des systèmes de particules en interaction.
Dans la publication P6 nous avons exploré les deux étapes suivant l’approximation binomiale dans cette hiérarchie. Je ne discuterai ici, par souci de simplicité, que la première des deux.
On utilisera dans la suite la notation
| (4.61) |
Contrairement aux apparences, ce n’est pas une moyenne normalisée pour une valeur donnée de , mais seulement quand on ajoute les deux valeurs possibles, .
Deuxième niveau : l’approximation des voisins indépendants
On veut donc écrire une équation d’évolution pour . Au cours d’un pas de temps , ces quantités évoluent de deux manières différentes. Tout d’abord, supposons que la variable sélectionnée pour un renversement potentiel porte un spin et soit entourée de liens frustrés. Si elle est renversée, elle devient de type . On a donc qui augmente de , et qui diminue de . Ce n’est pas la seule contribution : les variables voisines de la variable flippée ont leur spin qui reste inchangé, mais le nombre de liens frustrés autour d’elles augmente ou diminue de .
Suivons d’abord un des liens frustrés autour de la variable flippée. La variable ainsi atteinte a nécessairement un spin . Quel est le nombre de liens frustrés autour de cette nouvelle variable ? On doit faire ici une approximation pour fermer l’équation sur seulement. Elle consiste à supposer que la variable ainsi atteinte est de type avec une probabilité proportionnelle à , donc par normalisation cette probabilité vaut . Si l’on prenait un lien frustré au hasard dans le graphe, c’est avec cette probabilité que la variable de spin aurait liens frustrés autour d’elle. L’approximation consiste donc à oublier les corrélations entre et . La variable que l’on atteint ainsi voit le nombre de liens frustrés autour d’elle diminuer de 1 au cours du renversement, ce nombre passe donc de à . En faisant le même raisonnement pour les liens non frustrés autour de la variable flippé, on obtient
On peut effectuer les sommes, ce qui conduit à
| (4.63) | |||||
On a donc obtenu, de manière approchée, un jeu d’équations différentielles couplées pour ces fonctions . Comme ici on travaille sur un graphe dont la connectivité est fixe, ne peut prendre qu’un nombre fini de valeurs. L’expression (4.63) résume donc un jeu de équations couplées.
Une fois ces équations résolues, on peut en déduire l’énergie et la magnétisation du système, avec , et . Notons que la dernière équation impose une condition de cohérence sur les fonctions . On peut vérifier que si cette condition est respectée au temps initial, elle sera conservée par les équations (4.63).
Interprétation des hypothèses de fermeture
Les raisonnement présentés ci-dessus pour fermer approximativement les équations dynamiques peuvent sembler assez vagues. On va préciser ici les hypothèses faites implicitement. Si l’on raisonne en termes d’opérateurs de projection, les différents niveaux de troncature correspondent chacun à une approximation markovienne, où l’observable sur laquelle on projette est pour l’approximation binomiale, pour la suivante, et ainsi de suite. En effet, on a indiqué précédemment que l’approximation markovienne consiste à supposer que toutes les configurations microscopiques avec la même valeur de l’observable macroscopique sont équiprobables. Dans la publication P6 on a montré explicitement que les fermetures dérivées heuristiquement peuvent également s’obtenir à partir de cette hypothèse d’équiprobabilité des configurations microscopiques.
Cette vérification permet aussi de comprendre la profonde similitude de cette approche avec la théorie dynamique des répliques (DRT) de Coolen et Sherrington [60, 61]. La DRT a été appliquée au calcul des propriétés dynamiques du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, en faisant aussi des hypothèses d’équipartition des probabilités microscopiques sur les sous-ensembles définies par des observables macroscopiques. Dans un premier niveau d’approximation [60] la projection de la dynamique se fait sur la magnétisation et l’énergie, puis une version plus raffinée [61] a été développée, dans laquelle le paramètre d’ordre est fonctionnel. Dans ces articles la méthode des répliques était utilisée pour faire des moyennes sur le désordre avec l’hypothèse d’équiprobabilité microscopique, et conduisait à des calculs relativement lourds. De manière assez paradoxale, l’étude des modèles dilués par cette méthode s’avère plus simple que pour des modèles complètement connectés : comme on l’a vu, on peut dériver les relations de fermeture par des raisonnements combinatoires, et l’utilisation de la méthode de la cavité à la place de celle des répliques simplifie les vérifications explicites.
4.3.3 Résultats
A chacun des niveaux successifs de cette hiérarchie d’approximation, on se ramène à un jeu d’équations différentielles couplées pour un nombre fini d’observables macroscopiques : au premier niveau on suit seulement l’énergie et la magnétisation, au deuxième niveau la fonction , au troisième (non décrit ici mais que l’on trouvera exposé dans la publication) un objet un peu plus complexe . Ces équations différentielles peuvent être sans difficulté intégrées numériquement, et leurs prédictions comparées aux résultats de simulations numériques Monte-Carlo de la dynamique microscopique originelle. On s’est intéressé en particulier à la relaxation vers l’équilibre à partir de conditions initiales qui en sont arbitrairement éloignées. Une manière simple de les générer consiste à tirer la valeur des spins aléatoirement et de manière indépendante, avec un biais pour donner au système une certaine magnétisation.
L’image générale qui découle de la comparaison entre simulations et calculs est la suivante : aux temps courts et aux temps longs, les différents niveaux d’approximation sont en fait exacts. La raison est qu’aux temps courts, pour ce type de conditions initiales, les hypothèses de fermeture de la hiérarchie d’équations, qui reposent sur l’absence de corrélations, sont correctes. De même aux temps longs, comme la dynamique microscopique vérifie la condition de balance détaillée, le système évolue vers l’équilibre thermodynamique. On a vu qu’alors la forme de supposée dans l’approximation binomiale devenait exacte. Il en va de même pour les hypothèses de fermeture aux niveaux suivants d’approximation. Par contre aux temps intermédiaires, il y a comme prévu des déviations systématiques entre les prédictions des calculs approchés et le comportement observé des simulations numériques. De manière satisfaisante, les niveaux d’approximation successifs, qui voient croître la finesse des observables, fournissent des résultats de plus en plus précis. La figure 4.4 présente un résumé de cette étude. L’accord est très satisfaisant, même pour les niveaux d’approximations les plus simples.
Une résolution analytique des équations différentielles couplées qui apparaissent dans cette étude semble difficile. On peut néanmoins étudier assez simplement leurs solutions stationnaires. En particulier, il est possible de vérifier explicitement que la condition de balance détaillée implique que ces points fixes de l’évolution correspondent bien aux états d’équilibre thermodynamique. Ceci est possible ici car les hypothèses de fermeture deviennent exactes dans de telles conditions. On vérifie aussi que dans le régime de basse température l’état paramagnétique est dynamiquement instable. Finalement, l’étude du voisinage du point critique conduit à des résultats très proches de ceux du modèle de Curie-Weiss :
-
—
Les temps de relaxation divergent à comme . Les deux amplitudes pour la divergence dans les phases ferromagnétique et paramagnétique dépendent des détails microscopiques de la dynamique, mais leur ration en est indépendant, et vaut à nouveau .
-
—
Exactement à la température critique, la magnétisation s’annule en et l’énergie tend vers sa valeur d’équilibre comme .
Les détails de ces calculs peuvent se trouver dans la publication. La coïncidence des exposants et du ratio d’amplitude avec ceux du modèle de Curie-Weiss était attendue puisque ces deux modèles sont de champ-moyen. Toutefois il n’était pas évident a priori que l’on puisse les expliciter dans le cas du modèle dilué, pour lequel on n’a pas une description exacte de la dynamique aux temps intermédiaires.
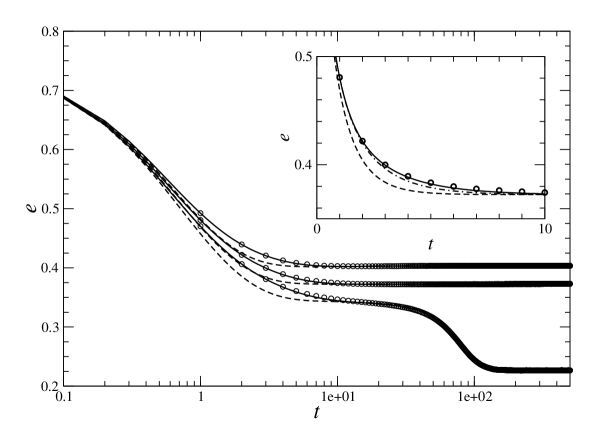
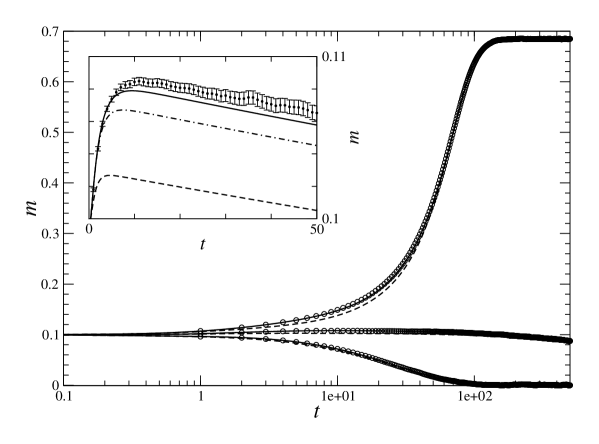
4.3.4 Corrélations à deux temps
On a donc vu comment caractériser approximativement l’état du système au cours de son évolution vers l’équilibre par un certain nombre d’observables macroscopiques. Cette description n’épuise pas toutes les questions que l’on peut se poser sur la dynamique du système. Définissons par exemple la fonction de corrélation à deux temps
| (4.64) |
qui vaut si les configurations des spins aux deux temps et sont identiques (notamment pour ), si elles sont complètement décorrelées. On prendra dans la suite pour simplifier les notations. Si on laisse le système évoluer suffisamment longtemps avant de commencer les mesures de corrélation (), on va obtenir une fonction de corrélation à l’équilibre qui ne dépend que de la différence de temps entre les deux instants d’observation, . Même si dans cette limite toutes les quantités thermodynamiques ont atteint leurs valeurs d’équilibre, et que la fonction de corrélation y est stationnaire, celle-ci contient une information non triviale sur la vitesse à laquelle le système « oublie » le détail microscopique de ses configurations antérieures. Selon la température, la fonction de corrélation d’équilibre décroît à (haute température, phase paramagnétique) ou vers le carré de la magnétisation d’équilibre (basse température, phase ferromagnétique). Dans ce deuxième cas l’ergodicité du système est brisée, on reste dans un des deux états purs avec un signe défini de la magnétisation. Cette brisure d’ergodicité n’est complète que dans la limite thermodynamique, dans un système de taille finie l’ergodicité est restaurée par les fluctuations de la magnétisation.
On peut en outre s’interroger sur le comportement des fonctions de corrélation à deux temps dans le régime transitoire qui précède l’équilibre. On a alors effectivement une dépendance dans les deux temps (et pas seulement dans leur différence), à cause de la préparation à l’instant initial qui brise l’invariance par translation temporelle.
Une extension des méthodes d’approximation présentées précédemment permet de calculer, de manière approchée, ces fonctions de corrélation. L’idée consiste toujours à projeter la dynamique sur un petit nombre d’observables macroscopiques, mais cette fois-ci en incluant des quantités qui gardent une trace de la configuration microscopique à l’instant antérieur . Le plus simple serait de suivre en fonction de l’ensemble de paramètres , et d’écrire des équations différentielles sur ces quantités. On trouve alors les équations (4.56) muni de l’approximation binomiale (4.60) pour , et une nouvelle équation différentielle pour ,
| (4.65) |
L’interprétation en est assez simple. est la probabilité d’acceptation d’un flip au temps . A chaque fois qu’une variable est renversée, on suppose qu’elle a une probabilité d’être dans le même état aux instants et , alors diminue de , tandis qu’avec probabilité elle augmente de .
Ce niveau d’approximation conduit à des résultats médiocres, mais on peut l’améliorer à l’image des approximations successives de la partie précédente. La quantité qui s’est avéré fournir un bon compromis entre qualité des résultats et simplicité des calculs est , fraction de sites qui ont un spin (resp. à l’instant (resp. ), et dont, parmi les liens qui l’entourent, sont frustrés aux deux temps, sont frustrés à et satisfait à , dans la situation inverse, et le reste () sont satisfaits aux deux temps. De cette quantité on peut tirer la fonction de corrélation comme
| (4.66) | |||||
Il ne reste plus qu’à écrire une équation d’évolution pour , qui s’obtient avec le même type de raisonnement que celui utilisé pour le niveau d’approximation des voisins indépendants. On doit tenir compte de l’effet du renversement d’un spin sur le type de la variable en question, , et de l’effet sur ses voisines. On obtient finalement :
| (4.67) | |||||
où l’on a utilisé la notation
| (4.68) |
Ce jeu d’équations différentielles couplées est complété par des conditions aux bords quand , et par des conditions de cohérence pour que l’énergie, soit au temps soit au temps , soit la même quand on la calcule comme le nombre de spins autour des , ou l’inverse. On peut alors intégrer numériquement ces équations, et les comparer avec des simulations Monte-Carlo. A nouveau la concordance de ces deux approches est très satisfaisante, comme on peut le voir sur la figure 4.5.
Pour des différences de temps qui divergent, la fonction de corrélation tend vers le produit des magnétisations aux deux temps. Ceci explique pourquoi cette valeur est correctement prédite par le calcul approché quand ou , puisque dans ces deux cas les magnétisations en jeu sont celles de la configuration initiale et/ou de l’équilibre, qui sont correctement capturées par l’approximation. Par contre pour une valeur intermédiaire , la magnétisation au temps n’est qu’approchée, et la prédiction pour n’est pas exacte. Ces arguments sont confirmées par les résultats de la figure 4.5.
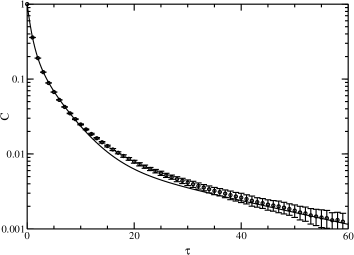
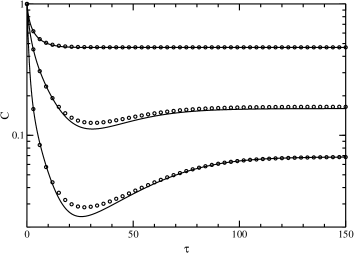
4.3.5 Perspectives
Le modèle que l’on vient d’étudier est certainement un des plus simples que l’on puisse imaginer dans la classe des problèmes de dynamique sur des systèmes dilués. En effet, il vérifiait la condition de balance détaillée et l’état d’équilibre thermodynamique était atteint sur des échelles de temps finies (dans la phase de basse température l’ergodicité est brisée de la même façon que dans le modèle de Curie-Weiss, il n’y a pas de vieillissement par croissance de domaine comme en dimension finie [132]). L’aspect « hors d’équilibre » de ce travail vient seulement de ce que l’on s’est attaché à décrire le régime transitoire à partir de conditions initiales éloignées de l’équilibre. De plus, la présence de désordre était assez anecdotique, puisqu’il apparaissait seulement par l’intermédiaire des longues boucles.
On peut imaginer un grand nombre de situations plus compliquées. Dans la partie suivante on étudiera une dynamique d’origine algorithmique qui ne vérifie pas la condition de balance détaillée. En restant dans le cadre de dynamiques « physiques » qui vérifient cette condition, on peut tracer deux directions pour des travaux plus poussés :
-
—
Une première serait de conserver un modèle avec des interactions ferromagnétique entre paires de spins, mais en introduisant du désordre dans les couplages. On pourrait soit garder un modèle à connectivité fixe, et des couplages d’intensité aléatoires, soit des couplages d’intensité constante, mais en autorisant des fluctuations dans la connectivité des variables, en utilisant par exemple un graphe aléatoire d’Erdös et Rényi. Ce dernier cas serait la version ferromagnétique du modèle de Viana-Bray. On s’attend alors à avoir un phénomène connu sous le nom de phase de Griffiths [22, 23, 24, 25]: la relaxation dans la phase paramagnétique est anormalement lente (plus lente qu’une exponentielle), à cause de régions rares dans le système qui ont, localement, une plus grande tendance à s’ordonner. Dans le cas du modèle de Viana-Bray, cela peut découler de la présence de sites avec une grande connectivité (comme on l’a vu, de manière un peu caricaturale, dans la version sphérique du chapitre précédent), pour un modèle à connectivité fixe on peut avoir des grandes régions où l’intensité des couplages est plus grande que la moyenne.
-
—
Une deuxième direction, plus ambitieuse encore, serait d’étudier des modèles dont la phase de basse température est vitreuse. Pour cela on peut mettre du désordre dans le signe des couplages de manière à induire de la frustration. En fait sur le graphe aléatoire régulier, un modèle purement antiferromagnétique devrait aussi être vitreux, la frustration provenant des boucles de longueur impaires. Une variante qui pourrait sembler sans gravité mais qui fait tomber dans le cadre des systèmes vitreux consiste à considérer des interactions qui font intervenir 3, ou plus, spins par interactions. Dans ce cas-là, même des interactions ferromagnétiques conduisent à des phénomènes vitreux par une frustration dynamiquement induite [133].
Dans tous ces cas l’équilibre ne sera pas atteint, la dynamique présentera des caractéristiques de vieillissement dans ses fonctions de corrélation et de réponse. Une des difficultés à résoudre pour entreprendre l’étude de tels modèles par l’approche présentée ici consiste à déterminer une description macroscopique judicieuse du système. Pour cela, la connection avec la théorie dynamique des répliques sera peut-être utile, puisque ce formalisme permet de traiter en principe les cas de RSB.
Enfin, une étude récente [57] de la phase de basse température d’un verre de spin dilué a mis en évidence des effets très intéressants de dépendance de l’état stationnaire obtenu aux temps longs selon l’histoire du système. Il serait très appréciable de pouvoir capturer de tels effets par une approche analytique, même aussi approchée que celle présentée ici.
4.4 Un algorithme de recherche locale
La fin de ce chapitre sera consacrée à l’étude d’un algorithme de recherche de solutions d’un problème d’optimisation combinatoire. A l’inverse des dynamiques étudiées jusqu’à maintenant, celle-ci ne respecte pas de condition de balance détaillée, et le comportement aux temps longs du système ne correspond pas à une mesure d’équilibre de Boltzmann. De plus on s’intéresse au comportement de l’algorithme sur des problèmes tirés d’un ensemble aléatoire, ce qui introduit un désordre gelé dans la définition du processus dynamique. Ces caractéristiques rendent ce problème plus difficile que le modèle ferromagnétique à connectivité fixe, cependant il en partage certaines propriétés : on peut aussi le représenter comme l’évolution d’un système de spins d’Ising, où à chaque pas de temps un seul spin est renversé. En outre les observables macroscopiques intéressantes sont extensives et varient peu au cours d’un pas de temps élémentaire, ce qui nous met en position d’utiliser une fois de plus les méthodes générales développées en début de chapitre.
Ce travail a d’abord été publié dans un journal de physique (publication P4), puis réécrit pour le rendre plus accessible à la communauté informaticienne à laquelle il a été présenté dans une conférence, cf. la publication C1. Il a aussi constitué une partie de la revue C2. Une étude très similaire a été conduite simultanément par Barthel, Hartmann et Weigt [134].
4.4.1 Définitions
Le problème de la satisfiabilité
Le problème d’optimisation auquel on s’attache ici est celui de la -satisfiabilité. On a variables booléennes qui peuvent être vraies ou fausses. Une clause de longueur est le OU logique (disjonction, notée ) de variables parmi les , certaines de ces variables pouvant être niées (la négation de vrai étant faux, et vice-versa). Une clause est donc vraie dès qu’une des variables est dans l’état imposé par la clause. Par exemple, pour , est vraie dès que est vraie, ou est fausse, ou est vraie. Une instance du problème est une formule constituée par le ET logique (conjonction, notée ) d’un certain nombre de clauses. Une formule est donc vraie si et seulement si toutes ses clauses sont vraies. On dit qu’une formule est satisfiable s’il existe une valeur des variables telle que la formule soit vraie. Une telle configuration, est alors appelée une solution de la formule. La plupart du temps il n’y a pas unicité de la solution.
Devant une formule donnée, la première question que l’on peut se poser est de savoir si elle est satisfiable ou pas, et de prouver cette affirmation. Si le nombre de variables et le nombre de clauses sont petits, on peut toujours faire une recherche exhaustive de toutes les configurations pour vérifier si l’une d’entre elle est une solution ou pas. Ceci est seulement possible pour très faible, le nombre de configurations croissant comme . Dans toutes les affirmations concernant la difficulté du problème, on sous-entendra que l’on s’intéresse à de grandes formules.
Prouver la satisfiabilité ou l’insatisfiabilité d’une formule sont deux tâches très différentes. Dans le premier cas il « suffit » d’exhiber une solution, la vérification que la formule est en effet satisfaite par cette configuration est possible en un nombre d’opérations qui croît comme un polynôme avec le nombre de variables. Il est bien sûr très difficile en général de trouver effectivement une solution. En termes plus précis, la -satisfiabilité est un problème dit NP-complet pour , c’est-à-dire que si l’on connaissait un algorithme capable de trouver une solution en un nombre polynomial d’opérations élémentaires pour n’importe quelle formule satisfiable, tous les problèmes d’optimisation de la famille dite NP seraient aussi solubles en un temps polynomial. L’hypothèse la plus probable à l’heure actuelle est qu’un tel algorithme n’existe pas, c’est cependant un problème ouvert des mathématiques. Pour plus de détails sur les définitions des différentes familles de problèmes d’optimisation et sur la théorie de la complexité, on pourra consulter [135].
Montrer qu’une formule n’est pas satisfiable est conceptuellement plus difficile, il faut mettre en évidence une contradiction qui empêche toutes les configurations d’être des solutions.
Différents types d’algorithmes
On dit qu’un algorithme est complet s’il est capable de donner le statut (satisfiable ou pas) de toute formule qu’on lui présente, et de justifier sa réponse en exhibant soit une solution si la formule est satisfiable, soit une contradiction dans le cas contraire. L’exemple le plus connu est l’algorithme de Davis-Putnam-Loveland-Logeman (DPLL) [136] qui explore d’une manière systématique l’espace des configurations des variables booléennes, en éliminant le plus rapidement possible les régions où il est sûr de ne pas trouver de solutions. On trouvera plus de détails et de références sur ce type d’algorithme dans la revue C2.
D’autres algorithmes, « incomplets », ne se prononcent avec certitude que dans certains cas. Par exemple, un algorithme de recherche locale comme celui que l’on va étudier dans la suite du chapitre, peut trouver une solution de la formule qu’on lui présente. Dans ce cas-là, celle-ci était sans aucun doute satisfiable. Il se peut aussi que l’algorithme, au bout d’un temps défini à l’avance, n’ait pas trouvé de solution. Alors on ne peut pas conclure : soit la formule n’était pas satisfiable, soit l’algorithme n’a pas été assez astucieux pour trouver une des solutions.
Signalons aussi que les méthodes de la physique statistique des systèmes désordonnées ont récemment conduit à un nouveau type d’algorithme incomplet, appelé « survey propagation » [35]. Celui-ci exploite l’intuition sur la structure de l’espace des configurations acquise grâce à la méthode des répliques et de la cavité pour repérer les variables cruciales du problème.
Un algorithme de recherche locale
On va considérer dans la suite l’algorithme Pure Random WalkSAT (PRWSAT), introduit par Papadimitriou [137] pour en 1992. Il fonctionne de la manière suivante :
-
1.
A l’instant initial, la valeur des variables booléennes est choisie aléatoirement, égale à vrai ou faux avec probabilité .
-
2.
A chaque pas de temps ultérieur, si toutes les clauses sont satisfaites, on a trouvé une solution et l’algorithme se termine. Sinon, on choisit aléatoirement et uniformément une des clauses non satisfaites, puis (toujours aléatoirement et uniformément ) une des variables de cette clause, et on la renverse (elle passe de vraie à fausse, ou réciproquement).
-
3.
On retourne au point précédent, à moins qu’une limite sur le nombre de pas de temps ait été dépassée. Dans ce cas, on quitte la boucle sans pouvoir conclure sur l’existence ou pas d’une solution.
La motivation du deuxième point est la suivante : lorsqu’on renverse une variable d’une clause non satisfaite, elle devient forcément satisfaite. Bien sûr, il est possible que cette même variable appartienne à d’autres clauses qui étaient auparavant satisfaites et qui ne le sont plus après le renversement.
Il existe quelques résultats rigoureux concernant cet algorithme, valables quelque soit la formule étudiée. Le premier est dû à Papadimitriou [137] : si , c’est-à-dire si toutes les clauses comportent deux variables, et si la formule admet au moins une solution, PRWSAT la trouve en un temps d’ordre , avec grande probabilité (par rapport aux choix aléatoires de la configuration initiale et des choix aux différents pas de l’algorithme). Le problème de la 2-satisfiabilité est en fait polynomial, et il existe des algorithmes déterministes qui résolvent toute formule en un temps linéaire, l’approche stochastique n’est donc pas optimale ici.
Pour le cas plus intéressant de la 3-satisfiabilité, qui est donc NP-complet, Schöning [138] a montré qu’une formule satisfiable était résolue par PRWSAT en un temps borné par . La borne est exponentielle dans ce cas, ce qui est attendu à cause de la NP-complétude du problème. Le a été amélioré un petit peu depuis, grâce à des choix plus élaborés de la condition initiale [139]. Il faut noter que cette borne est exponentiellement meilleure que le temps nécessaire pour une énumération exhaustive de toutes les configurations.
Les résultats de Papadimitriou et Schöning ont de profondes implications : même si cet algorithme n’est pas complet dans un sens strict puisqu’il peut se tromper (ne pas trouver de solutions à une formule satisfiable), la probabilité qu’il fasse une erreur peut-être rendue aussi faible que désirée. Il est donc « probabilistiquement complet » . On trouvera une discussion détaillée de ce type d’algorithmes dans [140].
4.4.2 L’ensemble des formules aléatoires
Définition et propriétés statiques
La théorie de la complexité algorithmique brièvement évoquée ci-dessus s’intéresse à la difficulté d’un problème dans le pire des cas. S’il est vraisemblable que l’on ne puisse pas construire d’algorithmes résolvant n’importe quelle formule en un temps polynomial, cela pourrait être dû à quelques formules particulièrement difficiles mais rares, alors que la majorité des formules sont faciles. Pour donner un sens plus précis à ces idées de complexité typique, un ensemble probabiliste de formules a été défini dans [28].
Une formule de cet ensemble est construite de la manière suivante. Chacune des clauses est générée indépendamment des autres, en choisissant un -uplet de variables uniformément parmi les possibilités, et chacune des variables dans la clause est niée ou pas avec probabilité . Le régime qui nous intéresse est celui de la limite thermodynamique où le nombre de variables et le nombre de clauses tendent simultanément vers l’infini avec un ratio fixé. Les clauses forment donc un hypergraphe poissonnien de connectivité moyenne .
La probabilité qu’une formule ainsi générée soit satisfiable présente un comportement de seuil, ou transition de phase : avec grande probabilité (c’est-à-dire avec une probabilité qui tend vers 1 dans la limite thermodynamique), la formule est satisfiable si , non satisfiable si . Pour , le seuil est à . Ce phénomène a d’abord été constaté numériquement.
La preuve de l’existence du seuil de satisfiabilité n’est pas achevée [141], des bornes rigoureuses ont cependant été établies : s’il existe, le seuil est compris entre 3.145 [129] et 4.506 [142]. D’autres travaux [143, 144] ont permis de resserrer l’écart entre bornes inférieures et supérieures dans la limite d’un grand nombre de variables par clause.
Ce problème a été étudié par des méthodes de physique statistique, en utilisant l’analogie décrite dans l’introduction avec les problèmes de verres de spin. Le travail originel de Monasson et Zecchina [30] reposait sur l’utilisation de la méthode des répliques avec l’hypothèse de symétrie des répliques, et montrait entre autres que le nombre de solutions dans la phase satisfiable était exponentiellement grand dans la taille du système. Les difficultés techniques de la brisure de symétrie des répliques dans les systèmes à la connectivité finie [32] ont retardés l’apparition de la solution à un pas de brisure. Une étape intermédiaire a été entreprise par Biroli, Monasson et Weigt [33] qui ont trouvé une forme variationnelle de l’ansatz 1RSB, et montré l’existence d’une deuxième transition dans la zone satisfiable : pour très faible, l’ensemble des solutions est réparti uniformément dans l’espace des configurations des variables. Quand on augmente le ratio de contraintes par variables, il apparaît une structure dans l’ensemble des solutions, qui se regroupent par amas de solutions proches, séparées par des zones vides de solution. Cette transition est dite de « clustering » . Plus récemment, la reformulation des équations 1RSB par la méthode de la cavité [34] a permis de les résoudre numériquement par une méthode de dynamique de populations. Cette méthode a été appliquée au problème de la satisfiabilité par Mézard et Zecchina [35], et prédit la valeur du seuil de satisfiabilité pour à . Par ailleurs Franz et Leone [145] ont montré, en utilisant la méthode d’interpolation de Guerra [12], que les seuils de satisfiabilité calculés au niveau 1RSB était des bornes supérieures rigoureuses.
Il est plus difficile de donner une valeur précise du seuil de clustering. La solution 1RSB apparaît à , mais jusqu’à elle est instable vis-à-vis d’une brisure complète de la symétrie des répliques [36, 37, 146]. Entre ces deux valeurs l’ensemble des solutions acquiert donc une structure, mais elle est plus compliquée que l’image 1RSB de clusters de solutions.
Le comportement de PRWSAT sur des formules aléatoires
On va étudier dans la suite le comportement de l’algorithme PRWSAT dans le cas où la formule qu’on lui propose de résoudre est tirée de l’ensemble aléatoire dont on vient de décrire les propriétés statiques.
Il est très facile de générer de telles formules et de simuler numériquement le comportement de PRWSAT. Les deux tracés de la figure 4.6 représentent la fraction de clauses non satisfaites au cours de l’évolution de l’algorithme. De manière à avoir une limite thermodynamique bien définie, on a placé en ordonnées la fraction de clauses et non le nombre total de clauses non satisfaites (énergie ), qui sont donc reliés par . Le temps est, pour la même raison, défini comme , avec le nombre de pas discrets de l’algorithme. La valeur initiale de s’interprète aisément : la configuration initiale étant choisi aléatoirement, chaque clause a une probabilité d’être violée, puisqu’une seule parmi les configurations des variables ne la satisfait pas. On a donc , aux fluctuations de taille finie près. Chacune des deux courbes de la figure 4.6 a été obtenue à partir d’une seule simulation, pour des des formules assez petites (). Pour une première valeur de , ici , la courbe de gauche montre une décroissance relativement régulière (aux fluctuations près) et rapide de l’énergie. Lorsqu’elle s’annule, l’algorithme a trouvé une solution de la formule et s’arrête. La figure de droite, tracée pour , a une allure bien différente. Aux temps courts le comportement est similaire (voir l’inset), mais ne décroît pas jusqu’à 0, et tend (en moyenne) vers une valeur positive. Comme le système est de taille finie, il y a des fluctuations autour de ce plateau. Au bout d’un certain temps, une de ces fluctuations est suffisamment grande pour atteindre l’énergie nulle, une solution est alors trouvée.
On s’attend à ce que dans la limite thermodynamique, l’évolution de pour une seule simulation soit concentrée autour de sa valeur moyenne (par rapport au choix de la formule et aux choix stochastiques de l’algorithme), avec des fluctuations d’ordre . La figure 4.7 permet de confirmer cette intuition. On a répété cent simulations indépendantes, en tirant à chaque fois une nouvelle formule et une nouvelle histoire de l’algorithme, pour deux valeurs de ( et ) et deux valeurs de ( et ). Pour chacun de ces groupes de cent simulations on a mesuré la moyenne et l’écart quadratique moyen de . Comme attendu, les valeurs moyennes sont quasiment indépendantes de la taille du système, et les écarts quadratiques sont approximativement deux fois plus faibles pour la taille quatre fois plus grande.
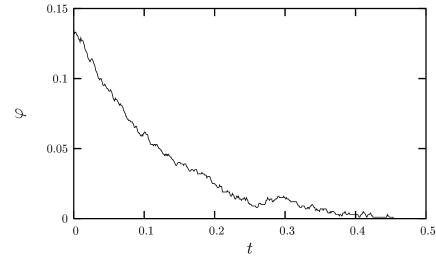
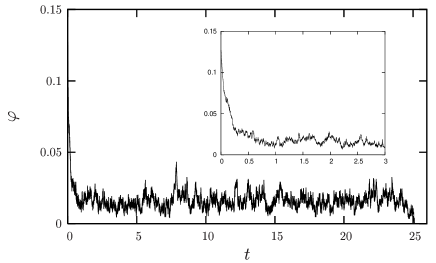
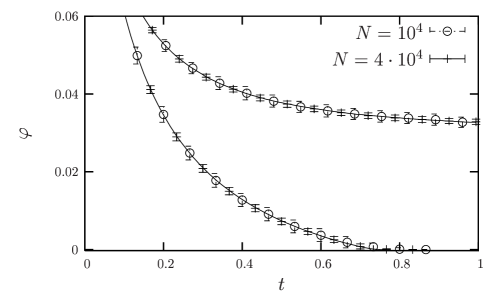
La courbe autour de laquelle se concentre dans la limite thermodynamique présente deux comportements très différents selon la valeur de : quand ce paramètre est suffisamment faible, elle s’annule en un temps fini que l’on notera . A plus grand, elle reste toujours positive et tend vers une valeur de plateau . La valeur du paramètre qui sépare ces deux régimes sera notée . Des simulations plus complètes présentées dans la suite montrent que .
Le phénomène de concentration implique par conséquent que pour une solution de la formule est typiquement trouvée en pas de l’algorithme, qui a donc une complexité typique linéaire pour ces formules. Par contre quand , une solution n’est trouvée que par l’intermédiaire d’une grande fluctuation de la densité d’énergie autour de sa valeur moyenne. Ces grandes déviations ayant des probabilités exponentiellement faibles pour des grands systèmes, le temps de résolution va croître avec comme .
On peut parler de métastabilité pour le comportement à : il existe des solutions avec grande probabilité, qui sont les états absorbants de la dynamique, mais le temps pour les atteindre diverge dans la limite thermodynamique. Le système reste donc pendant très longtemps dans un état métastable d’énergie . Cette métastabilité est similaire à celle d’autres systèmes physiques. En particulier, le processus de contact [147, 148] présente une phénoménologie très proche. Dans ce modèle, on a des particules sur les sites d’un réseau, avec au maximum une particule par sommet. Chaque particule disparaît avec un taux constant, et les sites vides deviennent occupés avec un taux proportionnel au nombre de sommets voisins déjà occupés par une particule. Il y a un état absorbant dans le système, qui correspond à un réseau complètement vide. Selon la densité de particules dans l’état initial, cet état absorbant est atteint en un temps logarithmique dans la taille du système, ou bien sur des échelles de temps exponentiellement grandes par l’intermédiaire de fluctuations. Il y a deux différences dans le cas de PRWSAT : l’état absorbant a une grande dégénérescence, puisque toutes les solutions (en nombre typiquement exponentiel pour une formule aléatoire) bloquent l’évolution de l’algorithme, et de plus il y a un désordre gelé dans la définition des règles dynamiques, à cause du choix aléatoire de la formule. A ces différences près, le comportement des deux systèmes est très similaire.
Cette parenthèse refermée, on va présenter dans les sections suivantes les résultats analytiques obtenus dans le but d’expliquer les constatations numériques. Le problème serait complètement résolu si l’on pouvait calculer exactement la limite thermodynamique de la fonction pour toutes les valeurs de , (on obtiendrait ainsi , et ), ainsi que la loi de probabilité des grandes déviations de pour (ce qui permettrait de calculer , le taux de croissance exponentiel des temps de résolution). Ce programme est bien sûr trop ambitieux, les résultats suivants sont soit des développements soit des approximations, en assez bon accord avec les simulations numériques.
A ma connaissance il n’existe qu’un seul résultat rigoureux concernant le comportement de PRWSAT sur des formules aléatoires : Alekhnovich et Ben-Sasson [149] ont montré que pour , une formule de l’ensemble 3-SAT aléatoire était résolu presque toujours en un nombre de pas qui croît linéairement avec le nombre de variables. Ce résultat est bien en accord avec les simulations numériques que l’on vient de présenter puisqu’on a trouvé un seuil dynamique . Signalons aussi un travail numérique sur la phase à petit [150].
4.4.3 Développements en clusters dans la phase linéaire
Un premier angle d’attaque repose sur l’utilisation de la méthode du développement en clusters présentée dans la partie 2.4. Cette méthode consistant à calculer une série de Taylor autour de , on s’intéresse à la phase , dans laquelle l’algorithme trouve une solution après un nombre de pas proche de la valeur moyenne . On va donc chercher un développement de la fonction en puissances de .
Notons le nombre de pas effectué par l’algorithme avant de trouver une solution. Cette variable est aléatoire, et ce pour plusieurs raisons :
-
—
Le choix de la formule dans l’ensemble -sat aléatoire. Comme on l’a vu la génération d’une formule consiste à choisir un hypergraphe poissonnien (par le choix des variables dans chaque clause), puis à choisir les négations des variables dans les clauses.
-
—
Le choix de la configuration initiale des variables.
-
—
Les choix aléatoires que l’algorithme effectue à chaque pas de temps.
La décomposition de l’hypergraphe en ses composantes connexes se traduit naturellement par une décomposition de la formule en sous-formules indépendantes . On s’aperçoit alors que est la somme de variables aléatoires, une pour chaque composante connexe : par définition, une solution de est trouvée quand toutes les sont résolues, et le nombre total de pas de l’algorithme est la somme des pas effectués dans chacune des sous-formules. Notons la valeur moyenne de par rapport aux choix des négations des variables, de la configuration initiale et des pas de temps de l’algorithme. Cette quantité est additive par rapport à la décomposition en clusters, et on peut donc appliquer le formalisme générique de la partie 2.4. La seule tâche restant à effectuer est le dénombrement du nombre moyen de pas de temps pour résoudre chaque type de cluster, dont on va donner quelques exemples maintenant.
Pour un cluster constitué d’une seule clause, avec probabilité la configuration initiale est déjà une des solutions. Sinon, un seul renversement de variable sera suffisant pour satisfaire la clause. Le temps moyen pour résoudre un tel cluster est donc .
Considérons maintenant un cluster fait de deux clauses. Deux cas sont à considérer :
-
—
les deux clauses portent le même signe sur la variable commune, un exemple pour est . La configuration initiale viole les deux clauses avec probabilité , une seule clause avec , et aucune sinon. Si la configuration initiale viole une seule clause, une solution est forcément trouvée après le renversement d’une variable. Si elle viole les deux clauses, une solution peut être trouvée en un seul pas de temps si c’est la variable commune qui est renversée la première (avec donc probabilité ), il faut sinon deux pas de temps. On a donc dans ce cas un temps moyen de :
(4.69) -
—
les choses se compliquent un peu si les deux clauses ont des exigences contradictoires pour la variable commune, par exemple . En effet, imaginons que l’on soit dans la configuration des variables telle que la première clause soit violée, et que la deuxième ne soit satisfaite que par la variable commune (dans l’exemple ci-dessus, ce serait le cas si les trois variables étaient vraies). L’algorithme choisit de renverser une des variables de la première clause ; si par malheur il prend la variable commune aux deux clauses, on se retrouve dans une situation symétrique, où c’est la deuxième clause qui est violée, et la première qui n’est satisfaite que par la variable commune. L’algorithme peut donc « hésiter » plusieurs fois entre ces deux configurations avant de trouver une solution. On trouve après un petit calcul que le nombre de pas moyen pour trouver une solution est ici :
(4.70) En prenant la moyenne de ces deux résultats on obtient la ligne de la table 4.1.
Ce dernier exemple met en évidence d’une part un des défauts de cet algorithme très simplifié, d’autre part les complications qui apparaissent quand on fait ce type de dénombrement avec des clusters de plus en plus grands. Les résultats de l’énumération pour des formules avec trois clauses au maximum sont résumés dans la table 4.1, ce qui donne en utilisant (2.4.1) la formule suivante :
Notons qu’il y a un facteur par rapport à (2.4.1) car on divise par au lieu de dans la définition de .
Cette expression est comparée aux résultats de simulations numériques dans la figure 4.8. Comme attendu pour un développement de Taylor au voisinage de 0, l’accord entre les deux se dégrade quand augmente. En particulier la divergence à (non montrée sur la figure) n’est évidemment pas reproduite par un développement polynomial.
Les simulations numériques pour déterminer peuvent être faites avec des systèmes de très grande taille, car dans ce régime les temps de calcul ne croissent que linéairement avec le nombre de variables. Ceci permet de s’affranchir des effets de taille finie et de travailler dans la « limite thermodynamique numérique » . En particulier on peut se convaincre raisonnablement que la fonction ne présente pas de singularité à la transition de percolation de l’hypergraphe , et a priori elle est régulière jusqu’à sa divergence à . Sur cet exemple, l’intérêt de la méthode de développements en clusters est assez clair, puisqu’on a pu faire des prédictions de nature non triviale (temps d’arrêt d’une dynamique assez élaborée) valables (perturbativement) dans toute la région , à partir de dénombrements sur des objets finis qui, s’ils sont pénibles à effectuer en pratique, ne présentent pas de difficultés de principe.
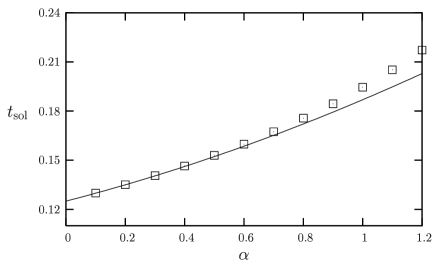
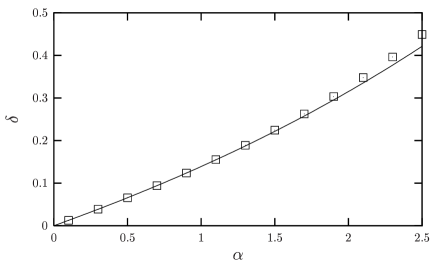
Au delà du temps mis pour résoudre une formule, on peut aussi s’interroger sur la ressemblance entre la configuration initiale et la solution trouvée. On définit plus précisément la distance de Hamming entre ces deux configurations comme le nombre de variables qui sont différentes de l’une à l’autre. On peut en fait calculer la moyenne de cette distance en utilisant la même propriété d’additivité sur les clusters et en faisant des énumérations similaires. On obtient pour le développement de , la valeur typique de :
| (4.72) | |||
qui est aussi en bon accord avec les simulations numériques comme le montre la figure 4.8.
Ce calcul était motivé par la constatation suivante. Il serait intéressant de localiser comme le point où diverge. Comme on n’a qu’un petit nombre de termes du développement, il est difficile d’utiliser les techniques habituelles pour estimer le rayon de convergence de la série (4.4.3). Au contraire, est par définition toujours borné, donc une approximation polynomiale va être de meilleure qualité. A première vue, comme en se rapprochant de le temps nécessaire pour trouver une solution, donc le nombre de fois où les variables sont renversées, diverge, on peut penser que la solution aura perdu toute corrélation avec la configuration initiale, et donc que . Ceci fournirait un bon critère pour déterminer le seuil à partir du développement (4.72). En fait cette condition n’est pas tout à fait vraie. Par exemple, les variables qui n’appartiennent à aucune clause ne sont jamais renversées au cours de l’algorithme, et il y en a une fraction finie . Une question ouverte serait donc de déterminer , autrement dit de savoir quelle partie d’une formule au seuil dynamique se décorrelle au cours de l’évolution. On pourrait par ailleurs imaginer que cette approche fournisse une borne rigoureuse sur .
4.4.4 Une caractérisation approchée du comportement typique
La méthode de développement présentée dans la section précédente n’est pas suffisante pour expliquer toutes les caractéristiques du problème : elle n’est pas capable de prédire simplement la valeur du seuil dynamique , ni, pour , la valeur du plateau atteint aux temps longs et la loi des fluctuations autour de celui-ci. On va donc utiliser maintenant une description approchée de la dynamique qui capture qualitativement toutes les propriétés du problème, et qui est en assez bon accord quantitatif avec les données numériques.
L’idée a déjà été exploitée à plusieurs reprises dans ce chapitre : on veut se débarrasser des détails microscopiques du système, ici la configuration des variables, et se contenter d’une description en termes d’observables macroscopiques. Dans le cas présent, la plus importante est le nombre de clauses non satisfaites dans la formule, dont on notera la valeur après pas d’évolution de l’algorithme. Le processus stochastique qui régit l’évolution des variables microscopiques est markovien d’après la définition de PRWSAT donnée en 4.4.1. La projection de la dynamique sur une variable macroscopique fait perdre ce caractère markovien, comme on l’a vu dans la première partie de ce chapitre. On va cependant faire l’approximation, a priori assez brutale, que l’évolution de est markovienne.
On a donc besoin de la probabilité de passer de à clauses non satisfaites au cours d’un pas de temps, probabilité notée . A chaque pas de temps, une clause non satisfaite est choisie au hasard, ainsi qu’une des variables de cette clause. Cette variable appartient à clauses en plus de la clause sélectionnée. En l’absence d’informations microscopiques plus précises, on ne peut que supposer que la loi de probabilité de est une loi de Poisson avec paramètre , ce qui serait le cas si la clause était sélectionnée de manière purement aléatoire (cf. Sec. 2.2). Parmi ces clauses, sont non satisfaites avant le renversement de la variable. A nouveau, faute de plus d’informations, on suppose que chacune des clauses a la probabilité d’être non satisfaite. a donc une distribution binomiale de paramètre parmi tentatives. Le renversement de la variable va permettre de satisfaire les clauses non satisfaites autour de la variable considérée. Par ailleurs, certaines des clauses satisfaites vont être violées après le renversement. Cela concerne les clauses qui n’étaient satisfaites que par la variable flippée. Puisque l’on sait seulement que ces clauses sont satisfaites, la probabilité qu’elles le soient par la variable renversée est (cette notation est introduite pour simplifier la discussion de la section 4.4.6). En notant , on obtient donc :
qui a la forme avec d’ordre 1, et une dépendance régulière de en .
Une fois établie cette approximation markovienne pour l’évolution de , on peut utiliser le formalisme général du chapitre. Commençons par calculer le comportement typique de ce processus stochastique.
La variation moyenne de au cours d’un pas de temps démarrant à est
| (4.74) |
L’évolution moyenne est donc solution de l’équation différentielle ordinaire
| (4.75) |
La condition initiale (chaque clause a probabilité d’être violée par une configuration aléatoire des variables) peut se récrire . On a donc
| (4.76) |
Cette expression est en accord qualitatif avec les observations numériques : pour , l’énergie s’annule au bout d’un temps fini
| (4.77) |
alors que pour on a une valeur asymptotique positive,
| (4.78) |
Comme ici , la valeur du seuil prévu dans le cadre de cette approximation est
| (4.79) |
soit pour au lieu de la valeur observée numériquement d’environ . La figure 4.9 présente le résultat de ce calcul pour la valeur du plateau, comparé aux résultats de simulations numériques. L’accord n’est certes pas parfait, ce qui ne saurait être surprenant vu l’approximation que l’on a faite ici, mais n’est pas non plus complètement déraisonnable.
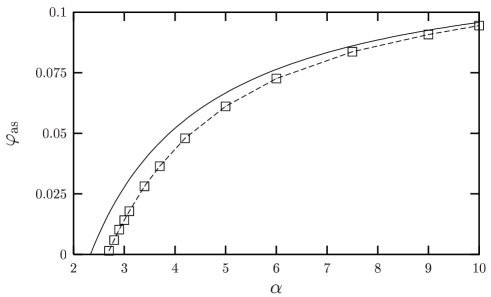
4.4.5 Calcul approché des grandes déviations
Il reste maintenant à étudier les fluctuations autour du plateau dans le régime . On s’intéressera en particulier aux grandes déviations qui conduisent à la découverte d’une solution.
Restant dans le cadre de l’approximation markovienne introduite ci-dessus, on remplace l’évolution microscopique du système par les probabilités de transition de l’équation (4.4.4). L’étude des propriétés générales des processus markoviens locaux de la section 4.1.2 nous a montré comment calculer les grandes déviations d’un tel processus. Introduisons donc la fonction de grande déviation comme
| (4.80) |
Pour suivre les conventions utilisés dans cette partie on prend au lieu de comme grand paramètre, ce qui ne change pas la discussion puisque et sont du même ordre. La transformée de Legendre de , notée , est solution de l’équation aux dérivées partielles (4.23) où
| (4.81) |
On calcule aisément la fonction à partir de la forme (4.4.4) pour , ce qui conduit à l’équation suivante sur :
| (4.82) |
A titre de vérification, on peut réobtenir l’équation (4.75) sur la valeur moyenne avec . L’équation aux dérivées partielles sur doit être complétée par une condition initiale. Les clauses étant initialement non satisfaites avec probabilité , on a
| (4.83) |
Notons la solution stationnaire de (4.82), atteinte dans la limite . En utilisant le fait que est nulle pour , on peut exprimer cette solution stationnaire comme
| (4.84) |
Par transformée de Legendre inverse de cette fonction on reconstruit alors la fonction de grande déviation pour des temps longs, . En particulier, la probabilité d’une fluctuation vers une configuration d’énergie nulle, , s’obtient à partir de
| (4.85) |
où est la valeur de qui annule l’intégrand de l’équation (4.84). On trouve ainsi que , qui est nul pour , croît continument avec : plus l’énergie du plateau est élevée, moins probable est une fluctuation jusqu’à 0.
Comme dans le calcul du temps d’ergodicité du modèle de Curie-Weiss, les temps de résolution par l’intermédiaire de ces fluctuations vont être inversement proportionnel à la probabilité de ces grandes fluctuations, et doivent donc diverger comme . On s’attend plus précisément à observer une distribution exponentielle des temps de résolution, de moyenne . Le raisonnement est le suivant. La probabilité que l’on vient de calculer est celle de découverte d’une solution sur un intervalle de temps grand mais fini dans la limite thermodynamique, autrement dit en un nombre de pas linéaire dans la taille du système. Découpons donc l’axe des temps en segments de longueur , avec mais indépendant de , et supposons que sur chacun de ces intervalles une solution est trouvée avec probabilité , si elle n’a pas été trouvé avant, auquel cas l’algorithme se serait arrêté. La probabilité que l’on obtienne une solution dans le -ème intervalle est donc . Comme est exponentiellement petit, on doit avoir exponentiellement grand pour que la limite thermodynamique de cette probabilité ne soit pas trivialement nulle. On a alors une distribution des temps de résolution qui suit une loi exponentielle ayant pour moyenne . Dans tout ce qui précède on a négligé tous les préfacteurs, ce résultat ne doit donc être que l’ordre dominant dans la limite thermodynamique.
La figure 4.10 présente un histogramme des temps de résolution dans la phase , pour différentes tailles des formules. Le comportement est en accord qualitatif avec les prévisions analytiques, les temps typiques divergent exponentiellement avec . Cependant le taux de divergence, qui devrait valoir , n’est pas quantitativement prédit par l’approximation markovienne.

4.4.6 XORSAT
XORSAT [39] est une variante du problème de la satisfiabilité dans laquelle les variables au sein d’une clause sont reliés par des OU EXCLUSIF logiques à la place du OU standard. En termes de variables d’Ising ceci correspond à une interaction habituelle où l’énergie est le produit de spins. Une clause est satisfaite si et seulement si le produit des spins de la clause est égal à une certaine variable gelée à . Parmi les configurations des variables d’une clause, la moitié la satisfait, l’autre moitié viole cette contrainte. Du point de vue de la complexité dans le pire des cas, XORSAT est un problème facile. On peut en effet le reformuler comme un problème d’algèbre linéaire modulo 2, soluble par des algorithmes polynomiaux.
Un ensemble aléatoire de formules de XORSAT peut être défini exactement de la même façon que pour la -satisfiabilité, les variables de chaque clause étant choisies uniformément parmi les -uplets possibles. Il y a dans ce cas aussi un phénomène de seuil : pour presque toutes les formules ont des solutions, pour presqu’aucune formule n’en a. La valeur du seuil est quand . Le clustering des solutions dans la phase satisfiable est aussi présent, et se produit à . La présence de ces deux phénomènes, ainsi que les valeurs des seuils, ont été prouvées rigoureusement [40, 41].
On peut utiliser l’algorithme PRWSAT sur les formules de XORSAT. Les simulations numériques sur des formules aléatoires présentent le même type de comportement, avec une phase de basse concentration où une solution est trouvée en un nombre linéaire de pas de temps, alors qu’un plateau dans l’énergie se développe au dessus d’un seuil dynamique. L’étude analytique dans le cadre de l’approximation markovienne est très similaire à celle effectuée pour la -SAT. En fait la seule différence est que pour XORSAT, une clause satisfaite dont on renverse une variable devient automatiquement non satisfaite. Autrement dit, toute les formules des sections 4.4.4 et 4.4.5 restent valable en prenant . En particulier le seuil est dans ce cas prévu à . L’accord est quantitativement meilleur pour XORSAT, comme on pourra le constater sur les figures de la publication P4.
4.4.7 Limite de grand
L’approximation markovienne a permis de reproduire qualitativement les résultats des simulations numériques, mais n’est évidemment pas quantitativement exacte. De plus, cette approximation ne fait pas apparaître de manière évidente un petit paramètre qui contrôlerait l’importance des termes négligés. On peut cependant faire deux conjectures sur des limites dans lesquelles l’approximation markovienne serait exacte.
Une première situation est celle où le ratio devient très grand. Dans ce cas le calcul approché prédit que le plateau tend vers , qui n’est autre que la valeur de pour une configuration aléatoire des variables. Autrement dit, la formule est tellement surcontrainte que l’algorithme se contente de renverser des variables sans faire décroître l’énergie. Ceci suggère donc que pourrait être un petit paramètre dans une amélioration systématique de l’approximation. La courbe de la figure 4.9 semble indiquer que cette hypothèse est correcte.
Une autre limite, plus riche, est celle d’un grand nombre de variables par clauses. Le seuil dynamique est alors équivalent à , et l’on pose pour avoir une limite non triviale. Considérons par exemple le temps de résolution dans l’approximation markovienne donné par l’équation (4.77). Posons aussi . Il vient alors dans la limite :
| (4.86) |
Le point encourageant est que le développement en clusters (4.4.3), une fois exprimé en termes des quantités rééchellées et , conduit au même résultat dans la limite . Cette coïncidence donne du crédit à l’hypothèse d’exactitude de l’approximation markovienne dans cette limite.
La figure 4.11 est un autre élément en faveur de cette hypothèse. Elle présente des résultats de simulations numériques pour la hauteur du plateau avec différentes valeurs de . On a pris les échelles et pour pouvoir comparer les différentes valeurs de sur la même courbe. On constate que quand augmente l’accord avec la prédiction de l’approximation markovienne s’améliore.
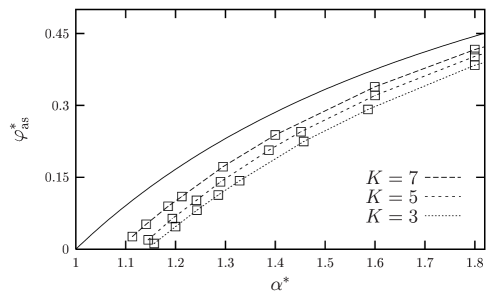
4.4.8 Perspectives
Esquissons quelques directions dans lesquelles cette étude pourrait être approfondie.
D’une part, une description quantitativement meilleure de la dynamique de cet algorithme serait souhaitable. Une possibilité consiste à projeter sur une observable macroscopique plus fine que celle utilisée ici. Dans la publication P4 nous avons suivi cette idée en distinguant plusieurs types de clauses. La précision de l’approximation en est légèrement améliorée, mais la valeur prédite pour le seuil n’est pas modifiée. Les auteurs de [134] ont utilisé comme observable une fonction ressemblant au de la partie 4.3. Cela conduisait à des résultats meilleurs, au prix de l’intégration numérique d’un jeu d’équations différentielles couplées. Il y a ici une difficulté supplémentaire par rapport au cas du ferromagnétique sur l’arbre de Bethe : la connectivité des variables n’étant pas borné dans l’ensemble des formules aléatoires, il apparaît un nombre infini d’équations couplées. En pratique il faut donc mettre une coupure pour les résoudre numériquement. Une autre possibilité consisterait à garder l’observable la plus simple possible, mais à tenir compte des effets non markoviens dans son évolution. On peut s’attendre alors à ce que l’équation donnant l’énergie moyenne soit une généralisation de (4.75) du type
| (4.87) |
où devrait s’exprimer de manière autocohérente en termes de . C’est ce type d’équation qui a été obtenue par Deroulers et Monasson dans leur étude du processus de contact [148]. Dans leur cas l’approximation markovienne correspondait à une limite de dimension infinie, et est d’ordre . D’après la discussion de la partie 4.4.7 il est raisonnable de s’attendre ici à un noyau d’ordre . On peut espérer obtenir un tel développement soit en adaptant la méthode de [148] à ce problème, plus difficile à cause de la présence de désordre gelé dans les règles dynamiques, soit en utilisant les opérateurs de projection de manière plus astucieuse.
Les appendices 4.5 et 4.6 présentent deux petits calculs non publiés pour des variantes simplifiées du problème, qui pourraient constituer d’autres points de départ pour une amélioration systématique de l’approximation.
D’autre part, on peut aussi noter que le processus stochastique étudié ici n’est que la version la plus simple d’une famille d’algorithmes, connue sous le nom générique de WalkSAT [151]. Il est raisonnable de choisir une clause non satisfaite à chaque pas de temps d’un algorithme de recherche locale, puisque nécessairement une de ses variables doit être renversée avant qu’on trouve une solution. Mais on a une très grande liberté pour choisir, au sein de cette clause, la variable à renverser. Comme on l’a vu dans les énumérations de la partie 4.4.3, le choix purement aléatoire peut être dangereux quand il conduit à violer des clauses qui n’étaient jusque là satisfaites que par la variable que l’on va flipper. Des dizaines d’heuristiques différentes ont été inventées pour améliorer ce choix [152, 153]. Certaines d’entre elles sont « markoviennes », au sens où elles n’utilisent que l’information sur la configuration présente pour faire le choix de la variable à flipper, d’autres gardent au contraire une mémoire de l’évolution passée. On présente dans l’appendice 4.7 deux de ces heuristiques plus élaborées.
Au moins pour les heuristiques markoviennes, on peut s’attendre, et on a en partie vérifié numériquement, à ce que l’image décrite ici d’un régime à faible où les formules sont résolues après un nombre de pas proportionnel à leur taille reste valable. Un argument en faveur de cette hypothèse est que le développement en cluster du temps de résolution reste faisable pour de telles heuristiques. La question se pose alors naturellement de connaître les seuils dynamiques des différentes heuristiques, et de savoir s’il existe une barrière intrinsèque, strictement inférieure au seuil de satisfiabilité, au delà de laquelle aucun algorithme de recherche locale ne serait capable de trouver une solution. Cette question, assez ouverte, est discutée dans la revue C2. L’idée selon laquelle le seuil de clustering doit jouer ce rôle est partiellement basé sur l’étude de la dynamique de Langevin du modèle -spin sphérique [43]. Toutefois, les algorithmes de recherche locale ne vérifient pas de condition de balance détaillée, il n’est donc pas évident que les caractéristiques du « paysage d’énergie libre » soient pertinents pour eux. De plus, une étude récente de Montanari et Ricci-Tersenghi [57] incite à reconsidérer les intuitions basées sur les résultats du -spin sphérique, qui semble être un cas très particulier dans la famille des modèles désordonnés en champ moyen.
Finalement, on peut faire deux remarques au vu de l’activité dans la communauté informaticienne. Les formules de l’ensemble aléatoire étudié théoriquement sont très différentes de celles rencontrées dans les applications pratiques de la satisfiabilité. Ces dernières sont souvent produites par des logiciels qui convertissent un premier problème en une formule de satisfiabilité, celle-ci étant ensuite soumise à l’algorithme proprement dit. Les formules vont donc porter la marque de cette traduction, et une structure particulière, sûrement très différente d’un hypergraphe poissonien, doit apparaître. De plus, les problèmes de départ sont souvent définis dans un espace euclidien, par exemple les problèmes de routage de circuit imprimé ont une structure naturelle planaire. Il serait donc intéressant de définir un ensemble aléatoire (car cela permet d’utiliser des méthodes probabilistes) dont les formules typiques ressembleraient un peu plus à celles intéressantes pour les applications. Une étape intermédiaire consisterait peut-être à s’inspirer des graphes dits « small-world » qui interpolent entre une structure euclidienne et un voisinage aléatoire de type champ moyen [154]. Une solution encore plus satisfaisante de ce dilemme serait de pouvoir donner des prédictions formule par formule et non pas typiquement sur un ensemble. L’utilisation de la méthode de la cavité dans l’algorithme de survey propagation [35] semble ouvrir une porte dans cette direction ; il n’est cependant pas encore évident que cette méthode soit généralisable à des formules très différentes de l’ensemble -SAT aléatoire. La dernière remarque concerne le problème dit de MAX-K-SAT, qui consiste à trouver une configuration optimale, c’est-à-dire minimisant le nombre de clauses violées, d’une formule non satisfiable. C’est un problème très difficile; des versions moins exigeantes, dites d’approximabilité, se contentent de trouver une configuration satisfaisant plus qu’un certain pourcentage du nombre optimal de contraintes satisfiables simultanément. Les études numériques de PRWSAT présentées ici montrent que cet algorithme trouve, en temps linéaire et avec grande probabilité pour des formules de l’ensemble -SAT aléatoire, une configuration violant moins que clauses, où est la hauteur du plateau et est arbitraire. Ce résultat serait peut-être utile dans le contexte des algorithmes d’approximation.
4.5 Appendice : Une dynamique algorithmique exactement soluble
Considérons la variante suivante du modèle de -SAT aléatoire. Une formule est toujours constituée de clauses de longueur , tirées uniformément parmi les -uplets possibles sur variables. La différence est que les litéraux ne sont jamais niés, autrement dit la seule configuration qu’une clause interdit est celle où les variables qu’elle contient sont toutes fausses. Il est clair que pour toute valeur de , la formule est satisfiable, puisqu’il suffit de prendre toutes les variables vraies (i.e. tous les spins ) pour obtenir une solution.
On peut étudier le comportement de l’algorithme PRWSAT sur ce modèle-là, même si évidemment l’intérêt en est assez académique. Supposons donc qu’une configuration initiale aléatoire des spins soit choisie, et qu’à chaque pas de temps une des clauses non satisfaites soit sélectionnée, puis une de ses variables renversées.
Décrivons l’état du système après pas de l’algorithme par , nombre de variables entourées par clauses non satisfaites. On posera le temps continu dans la limite thermodynamique, et la fraction de variables de « type » . Les moyennes avec cette loi seront notées :
| (4.88) |
Comme c’est une clause non satisfaite qui est choisie à chaque pas de temps, la variable renversée est de type avec une probabilité proportionnelle à , donc par normalisation cette probabilité est égale à . La variable devient de type après son renversement. Les voisines sont de type avec probabilité si l’on néglige les corrélations entre voisins (cf. l’approximation des voisins indépendants de la partie 4.3.2) et voient leur type diminuer de . Regroupant ces différentes contributions, on obtient l’équation d’évolution :
| (4.89) |
Calculons la condition initiale . Avec probabilité la variable est vraie (), et donc elle est de type . Si la variable est fausse, elle appartient à clauses avec une loi de Poisson de paramètre , chacune de ces clauses est non satisfaite avec probabilité puisqu’il faut pour cela que les autres variables soient elles aussi fausses. On a donc
| (4.90) | |||||
| (4.91) |
avec et .
On trouve en fait une solution de l’équation d’évolution (4.89) avec
| (4.92) |
où les paramètres et dépendent du temps. En insérant cette forme dans (4.89) on obtient des équations différentielles pour et , qui conduisent à
| (4.93) |
et donc finalement la fraction de clauses non satisfaites vaut
| (4.94) |
Cette fonction décroît de à jusqu’à pour , avec
| (4.95) |
Les simulations numériques sont en parfait accord avec le calcul. Il est sans doute exact : les variables étant flippées au maximum une fois, il n’y a pas de corrélation entre clauses voisines et l’approximation des voisins indépendants doit être correcte. Une autre manière de rendre rigoureux ce calcul consiste à voir l’évolution de l’algorithme comme un processus de décimation de graphe. En effet, au bout de pas de temps le nombre de variables fausses (de spins ) est , car les variables flippées le sont toujours de fausses vers vraies. De plus, l’ensemble des clauses fausses forme un hypergraphe poissonnien de clauses sur variables. A chaque pas de temps on enlève une variable, et clauses, où est tirée avec une loi de Poisson de paramètre : est la densité de clauses dans le sous-graphe composé seulement des clauses violées. En calculant le nombre moyen de clauses qui survivent à la décimation jusqu’à l’instant , on retrouve le résultat (4.94).
L’intérêt de ce calcul ne réside pas dans le résultat, mais dans la possibilité que l’on puisse s’en servir comme point de départ pour un développement perturbatif : si dans la génération d’une formule de -SAT on choisit de nier un litéral avec probabilité , l’ensemble aléatoire habituel correspond à , le calcul exact que l’on vient de faire à . Peut-être pourrait-on systématiser un développement en puissances de .
4.6 Appendice : Une deuxième variante
Je voudrais présenter ici des résultats numériques et analytiques concernant la dynamique de PRWSAT sur une autre variante du problème de satisfiabilité.
On va s’intéresser à des formules de -XORSAT, en d’autres termes un modèle du type -spin dilué, mais au lieu de prendre un hypergraphe poissonien on va utiliser un hypergraphe à connectivité fixe : chaque variable appartient à clauses. Pour les formules ne sont jamais satisfiables, on peut cependant s’intéresser à la dynamique de PRWSAT sur ce problème, et en particulier à l’énergie stationnaire atteinte aux temps longs.
Je ne détaillerais pas les calculs qui sont très proches de ceux présentés dans le corps du chapitre. En définissant la fraction de clauses non satisfaites après pas de temps, on obtient dans l’approximation binomiale (c’est-à-dire l’approximation markovienne pour une projection sur le nombre de clauses non satisfaites) :
| (4.96) |
Dans l’approximation des voisins indépendants on suit , la fraction de sites entourées de clauses frustrées, dont on sous-entend la dépendance temporelle pour alléger les notations. On définit aussi
| (4.97) |
On obtient à ce niveau d’approximation une équation d’évolution pour :
| (4.98) | |||||
que l’on peut intégrer numériquement.
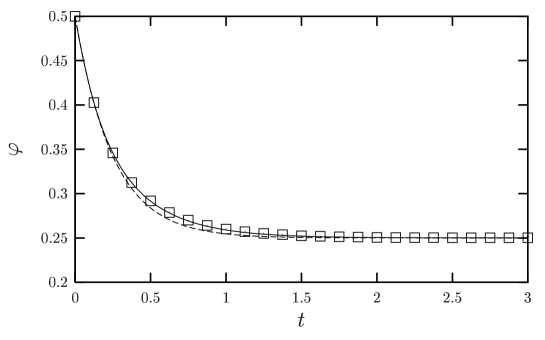
La figure 4.12 présente les résultats des simulations numériques comparées à ces deux niveaux d’approximation. Comme l’on pouvait s’y attendre, la deuxième approximation conduit à un meilleur accord avec les simulations numériques. Pour il reste cependant une erreur systématique, trop petite pour être vue sur la figure.
Le point qui me paraît le plus intéressant est la limite des temps longs. L’approximation binomiale prédit
| (4.99) |
La solution stationnaire des équations (4.98) n’a pas une forme binomiale (sauf dans la limite ), mais conduit cependant à la même fraction de clauses violées que l’approximation binomiale. De plus, ce résultat (4.99) est compatible, aux fluctuations de taille finie près, avec les simulations numériques. Ces dernières étant été réalisés sur des systèmes de très grande taille (, on peut difficilement faire plus à cause de la taille de la mémoire vive des ordinateurs actuels), il est raisonnable de faire la conjecture que le résultat (4.99) est exact.
On aurait déterminé alors une des caractéristiques de l’état stationnaire de ce processus hors-d’équilibre (rappelons que la dynamique de PRWSAT ne vérifie pas la condition de balance détaillée), bien que l’état stationnaire soit non trivial, la forme de n’étant pas binomiale. Dans une comparaison un peu hasardeuse, on peut faire un rapprochement avec le processus d’exclusion complètement asymétrique : le diagramme des phases de ce dernier problème est correctement prédit par une approximation de champ moyen. Pourtant son état stationnaire est plus riche que ne le suggère la solution de champ moyen, comme l’indique sa représentation exacte en termes de produits de matrices vérifiant une certaine algèbre [155]. On peut se demander si cette similitude est purement fortuite ou si les méthodes développées dans le cadre du processus d’exclusion pourrait être adaptées aux problèmes algorithmiques.
4.7 Appendice : Deux heuristiques plus performantes
L’algorithme WalkSAT/SKC
Comme on l’a discuté dans la section 4.4.8, le choix de la variable renversée dans une clause non satisfaite peut donner lieu à des stratégies plus ou moins raffinées. De manière générale, leur objectif est d’éviter de flipper une variable lorsque celle-ci appartient à une clause satisfaite seulement par la variable en question.
Parmi les heuristiques que l’on a qualifiées de markoviennes, considérons celle nommée WalkSAT/SKC [151] : à chaque pas de temps de l’algorithme une des clauses non satisfaites est choisie au hasard. On examine ensuite ses variables, et pour chacune on définit son breakcount comme le nombre de clauses satisfaites qui deviendraient non satisfaites si elle était renversée. S’il y a des variables qui ont un breakcount nul, on flippe au hasard une de celles-ci. Si au contraire elles ont toutes un breakcount strictement positif :
-
—
Avec une certaine probabilité , on flippe une des variables au hasard.
-
—
Avec probabilité , on flippe une des variables ayant un breakcount minimal.
Des expériences numériques montrent qu’au moins pour , le nombre de pas nécessaires pour trouver une solution à une formule aléatoire croît linéairement avec la taille des formules. On a représenté sur la figure 4.13 les moyennes de ces temps déterminés numériquement, en utilisant à nouveau l’unité .
Comme dans le cas de PRWSAT, la distribution de est fortement piquée autour de sa valeur moyenne dans la limite thermodynamique. On peut aussi calculer cette fonction ordre par ordre en grâce à la méthode du développement en clusters, le temps de résolution moyen étant ici encore une fonction additive grâce au caractère markovien de l’heuristique de choix de la variable flippée.
Cette modification rend donc l’algorithme beaucoup plus performant, puisqu’on est passé de à , donc un seuil dynamique très proche du seuil de satisfiabilité . Il est assez difficile d’estimer avec beaucoup de précision le seuil . Les simulations numériques sur des formules de taille suggèrent (cette valeur est aussi avancée dans [156]), mais paradoxalement ces tailles sont peut-être trop petites pour être débarrassées des effets de taille finie (bien que l’on atteigne quasiment la limite de mémoire vive des ordinateurs actuels). En effet, les calculs statiques [37] prédisent pour ces valeurs de des « états métastables » dont l’énergie pourrait être de l’ordre de grandeur du bruit de taille finie. On ne peut donc pas trancher ici à propos de la pertinence ou pas des prédictions statiques pour l’existence d’un seuil intrinsèque à tous les algorithmes de recherche locale.
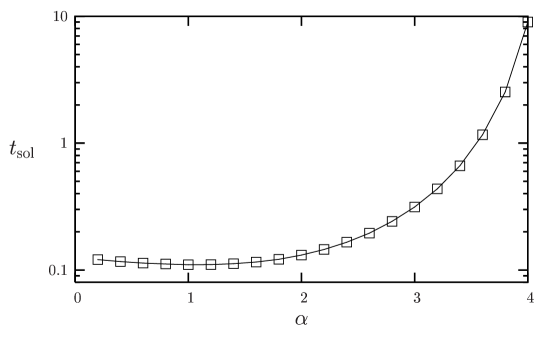
L’algorithme RRT (Record to Record Travel)
Une autre variante, introduite par Seitz et Orponen [156], tombe dans la classe des heuristiques non markoviennes. La modification de PRWSAT est la suivante :
-
—
On garde en mémoire au cours de l’évolution de l’algorithme la valeur , qui est la plus basse valeur de l’énergie (nombre de clauses violées) que l’on ait rencontré depuis le début de l’exécution.
-
—
A chaque pas de temps, on choisit une clause violée au hasard, ainsi qu’une de ses variables uniformément (comme dans PRWSAT). Cette variable n’est renversée que si l’énergie après le renversement est plus petite que , où est un paramètre fixé pour toute l’évolution. Sinon on ne change pas la configuration des variables.
est une mesure du « laxisme » de l’algorithme : si ce paramètre est très grand la plupart des mouvements vont être acceptés.
La figure 4.14 montre l’évolution de l’énergie pour différentes valeurs de et de . Examinons d’abord la figure du haut, qui se concentre sur une seule valeur de . On a seulement représenté la fin de l’évolution, pour que la figure soit plus claire. Pour , les énergies croissent avec : à cet instant l’évolution la moins permissive a conduit à la meilleure configuration. Cependant aux temps plus longs, cette courbe reste bloquée à une énergie strictement positive, alors que les autres évolutions, plus laxistes, finissent par trouver une solution et s’avèrent donc plus efficaces. On constate cependant que la courbe avec le plus grand met le plus de temps pour trouver une solution. Il y a donc, pour une valeur de donnée, une tolérance optimale pour trouver une solution le plus rapidement possible. La partie du bas de la figure 4.14 complète cette description : pour c’est qui est optimal, pour les choix et se valent, tandis que pour le paramètre devient optimal.
Le schéma 4.15 résume le comportement de l’algorithme : pour une tolérance donnée, le temps de résolution (compté dans l’unité réduite nombre de pas divisé par nombre de clauses) croît avec et diverge à une valeur . Cette valeur seuil est d’autant plus grande que l’évolution est permissive.
Dans leur article, Seitz et Orponen ont déterminé pour entre 5 et 9 par un ajustement de données expérimentales sur la divergence des temps de résolution en fonction de , puis extrapolé le comportement de quand tend vers l’infini. Cela conduit à , autrement dit cet algorithme serait capable de résoudre en un nombre de pas linéaire dans le nombre de variables, jusqu’au seuil de satisfiabilité (avec cependant qui diverge à ). Cette hypothèse est assez frappante, à nouveau de possibles effets de taille finie sont difficiles à estimer ici.
Soulignons que , qui est d’ordre 1, est une tolérance dans le nombre de clauses non satisfaites, lui même d’ordre . Modifier d’une quantité finie la hauteur des « barrières » que l’on s’autorise à franchir modifie radicalement le comportement de cet algorithme, dont une description analytique semble difficile à l’heure actuelle.
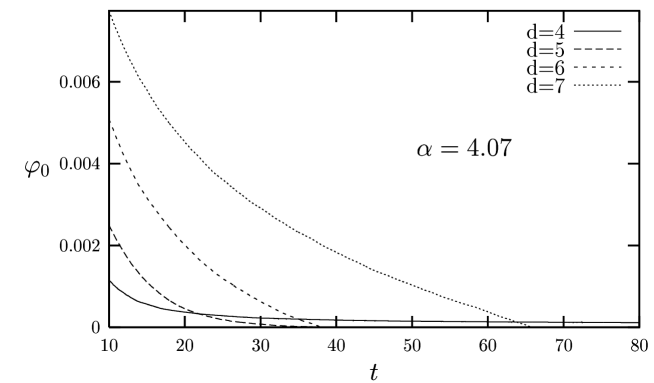
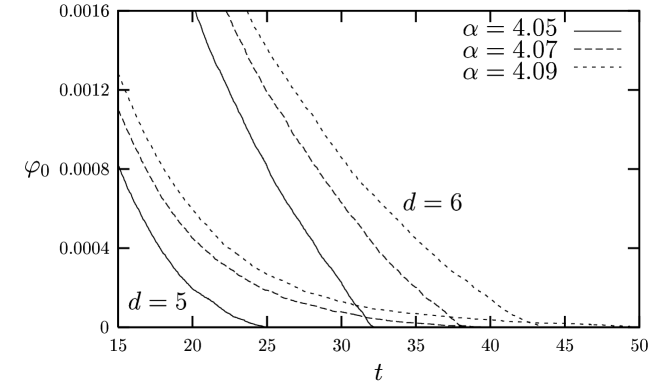
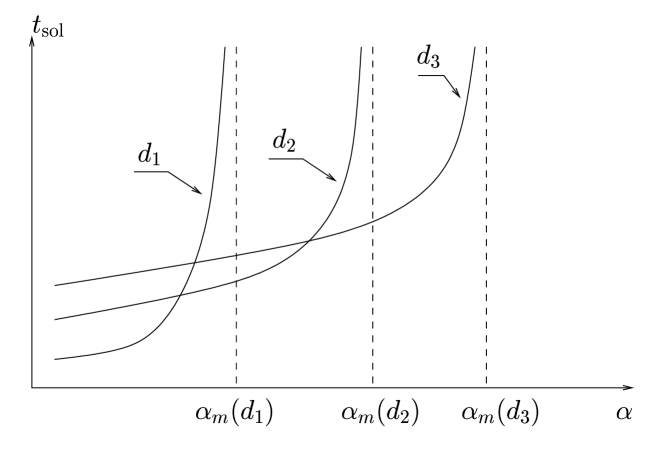
Chapitre 5 Autour d’un théorème de fluctuation
La dynamique des systèmes à l’équilibre thermique vérifie des propriétés caractéristiques comme l’invariance par translation dans le temps et le théorème de fluctuation-dissipation (FDT) qui relie fonctions de réponse et de corrélation. Parmi les différentes familles de systèmes hors d’équilibre, les verres de spin présentent des violations de ces deux propriétés d’un type particulier (vieillissement et apparition de températures effectives). Ce phénomène a été initialement étudié dans le cadre des modèles de champ moyen complètement connectés. Pour cette famille de modèle, toutes les fonctions de corrélation et de réponse découlent de celles à deux temps, comme on l’a vu dans la partie 3.4 111Ceci n’est en toute rigueur vrai que pour les modèles sphériques, et pour les contributions dominantes dans la limite thermodynamique. Le calcul de la partie connexe des fonctions à quatre temps du modèle SK sphérique peut se trouver dans [157]. Dans ce modèle complètement connecté ces parties connexes sont des corrections d’ordre .. En toute logique, celles-ci ont été les objets d’étude principaux des investigations théoriques.
Dans le cas des modèles dilués, il faut en principe connaître toute la hiérarchie des fonctions de corrélation et de réponse pour caractériser le système. Cette constatation a motivé l’étude présentée dans ce chapitre, qui a fait l’objet d’une partie de la publication P5.
La première partie rappelle des résultats classiques sur les propriétés d’équilibre des fonctions de corrélation et de réponse à deux temps. On étudie ensuite la généralisation de ces propriétés aux fonctions à plus de deux temps. La troisième partie est consacrée à une version du théorème de fluctuation qui unifie toutes ces relations. Finalement des conjectures sur la modification de ces résultats pour des systèmes hors d’équilibre du type verres de spin dilués sont avancées.
5.1 Propriétés d’équilibre des fonctions à deux temps
5.1.1 Enoncés
Considérons un système physique en contact avec un thermostat à la température . Pour deux observables génériques et du système, leur fonction de corrélation à deux temps est définie comme
| (5.1) |
La notation désigne une moyenne d’ensemble, c’est-à-dire sur la répétition d’un grand nombre de mesures.
Supposons que l’on rajoute un champ extérieur , couplé linéairement à l’observable : l’énergie du système est modifiée par un terme . Dans le cas de système de spins homogènes, il est naturel de considérer un champ magnétique couplé à la magnétisation totale. Pour des systèmes désordonnés, il peut être nécessaire de considérer des champs variables dans l’espace.
On notera les moyennes d’ensemble en présence de la perturbation extérieure. Si cette dernière est suffisamment faible, la théorie de la réponse linéaire s’applique :
| (5.2) |
où est le temps initial de préparation du système. Cette relation définit la fonction de réponse comme
| (5.3) |
La fonction de réponse mesure donc la variation moyenne de l’observable à l’instant pour une perturbation couplée à appliquée pendant un intervalle de temps infinitésimal autour de .
Enonçons maintenant les propriétés de ces fonctions de corrélation et de réponse.
Causalité
La borne supérieure de l’intégration dans (5.2) est prise en par causalité : une perturbation ne peut modifier le système avant d’avoir été appliquée. De manière équivalente, si . Ces exigences de causalité restent valables hors de l’équilibre.
Invariance par translation temporelle
Pour un système à l’équilibre, toutes les fonctions de corrélation et de réponse sont invariantes par translation temporelle, en particulier celles à deux temps ne sont fonction que de la différence entre les deux temps, et . Cette situation est vérifiée si le système est préparé à l’instant initial dans une configuration typique de la distribution de Gibbs-Boltzmann, ou bien si l’on laisse le système relaxer suffisamment longtemps après sa mise en contact avec le thermostat.
Théorème de fluctuation-dissipation
Les fonctions de corrélation et de réponse d’équilibre ne sont pas indépendantes. Le théorème de fluctuation-dissipation impose en effet la relation suivante :
| (5.4) |
Cette relation est assez remarquable car elle relie des propriétés de natures différentes (« fluctuation » : décroissance de la fonction de corrélation au cours du temps en l’absence de perturbations extérieures vs « dissipation » : réponse du système à une perturbation, dont le travail fourni doit être dissipé). Elle est par ailleurs indépendante du système considéré, et ne fait intervenir que la température du bain thermique.
Relation d’Onsager
Enfin, les relations de réciprocité d’Onsager impliquent
| (5.5) |
ce qui n’est pas complètement trivial si les observables et sont distinctes.
5.1.2 Une preuve
Dans la publication P5 ces propriétés sont démontrées pour une dynamique microscopique de variables continues qui évoluent selon l’équation de Langevin. Pour compléter cette approche et insister sur la généralité des résultats on va utiliser une modélisation légèrement différentes.
Définitions
On suppose que le système a un espace de configurations discrètes, et que l’influence du thermostat se traduit par une évolution microscopique stochastique, selon l’équation maîtresse en temps continu :
| (5.6) |
représente le taux de transition entre les configurations et . est la probabilité que le système soit dans la configuration à l’instant , les moyennes d’ensemble seront donc effectués selon cette probabilité. De plus les observables sont de simples fonctions de la configuration, .
La conservation des probabilités implique une condition sur les taux de transition,
| (5.7) |
On prend donc pour les élements diagonaux de :
| (5.8) |
Le bain thermique extérieur au système l’entraîne vers la distribution d’équilibre de Gibbs-Boltzmann . Pour que cette loi de probabilité soit une solution stationnaire de l’équation maîtresse, on suppose que les taux de transition vérifient la condition de balance détaillée
| (5.9) |
Cette condition est suffisante (mais pas nécessaire) pour que l’équilibre thermique soit un point fixe de l’évolution. On reviendra plus tard sur sa signification microscopique.
Introduisons aussi la probabilité conditionnelle d’observer la configuration à l’instant sachant que le système était en à . Si les taux de transition sont indépendants du temps, cette probabilité conditionnelle n’est fonction que de la différence , on la notera alors . Elle vérifie l’équation maîtresse sous la forme
| (5.10) |
Explicitons avec ces notations une fonction de corrélation à deux temps, pour ,
| (5.11) |
où est la distribution de probabilité au temps initial .
On va introduire une notation matricielle plus compacte qui simplifiera les généralisations de la partie suivante, et qui ressemble à celle utilisée dans la publication P5. Considérons des matrices indicées par les configurations , et en particulier et qui correspondent à la probabilité conditionnelle et aux taux de transition :
| (5.12) |
Ces matrices sont reliées par l’équation maîtresse , avec la matrice identité. La solution de cette équation s’écrit donc formellement .
On notera aussi sous forme de matrices diagonales les observables et les distributions de probabilité,
| (5.13) |
La notation de « bra-kets » à la Dirac sera utile dans la suite. On définit en particulier le vecteur ligne dont tous les éléments valent , et son transposé. On a donc
| (5.14) |
Ces définitions permettent de réécrire la fonction de corrélation (5.11) comme
| (5.15) |
Dans cette notation matricielle :
-
—
la conservation des probabilités s’exprime par : , et de manière équivalente . désigne l’opération de transposition matricielle.
-
—
la condition de balance détaillée devient . Comme , en développant l’exponentielle en série on a aussi
(5.16) -
—
la stationnarité de la distribution de Gibbs-Boltzmann s’écrit ici , et donc .
Il reste maintenant à considérer l’effet d’un champ extérieur couplé linéairement à une observable du système. Faisons l’hypothèse que les taux de transition en présence du champ vérifient la condition de balance détaillée par rapport à ce nouvel hamiltonien,
| (5.17) |
On vérifie alors aisément l’équation suivante sur la dérivée à champ nul de ,
| (5.18) |
On a, comme pour la matrice , des propriétés dues à la conservation des probabilités pour tout champ extérieur qui impliquent et .
La fonction de réponse (5.3) est définie par une dérivation fonctionnelle par rapport au champ extérieur. Il faut donc prendre un champ d’intensité pendant un intervalle autour du temps de dérivation, puis dériver par rapport à et prendre la limite . On peut se convaincre que dans le formalisme utilisé ici, cela revient à insérer la matrice dans le bra-ket à l’instant correspondant. Par exemple, la fonction (5.3) s’exprime pour comme
| (5.19) |
Ces longues définitions préliminaires étant posés, les démonstrations sont quasi-immédiates.
Causalité
Si , la fonction de réponse (5.19) devient . Or , on a donc bien annulation de la réponse à une excitation postérieure à l’observation, que le système soit équilibré ou pas.
Pour la preuve des propriétés d’équilibre, on suppose qu’au temps le système est équilibré, .
Invariance par translation temporelle
On peut lire la propriété d’invariance par translation temporelle sur les équations (5.15) et (5.19) : si , et les fonctions ne dépendent que de la différence des temps :
| (5.20) | |||||
| (5.21) |
Théorème de fluctuation-dissipation
Le théorème de fluctuation-dissipation s’obtient en insérant la propriété (5.18) dans l’expression de la réponse que l’on vient d’établir, et en utilisant pour simplifier le résultat :
| (5.22) |
Comme , on reconnait dans (5.22) la dérivée temporelle de la fonction de corrélation, ce qui prouve
| (5.23) |
Relation d’Onsager
5.2 Généralisations pour des fonctions à temps
Le formalisme développé dans la partie précédente a le mérite de faciliter la généralisation de ces résultats a des fonctions de corrélation et de réponse à un nombre arbitraire de temps. Définissons par exemple une fonction de corrélation à points,
| (5.25) |
où les sont des observables quelconques du système. On va supposer sans perdre de généralité que les temps sont classés selon . On a alors, en supposant que le système est équilibré à un temps ,
| (5.26) |
La propriété d’invariance par translation temporelle est claire : si l’on ajoute la même quantité à tous les temps , la corrélation n’est pas modifiée.
Relation d’Onsager
On peut aussi construire une relation d’Onsager sur cette fonction de corrélation. Prenons, à l’image de la démonstration faite pour la fonction à deux temps, la transposée de cette expression,
| (5.27) | |||||
| (5.28) | |||||
| (5.29) |
On reconnait une fonction de corrélation où l’ordre temporel des observables a été renversé. Définissons pour être plus précis une opération de renversement temporel autour d’un point ,
| (5.30) |
Grâce à la propriété d’invariance par translation, le choix de est complètement arbitraire. On peut alors écrire la relation précédente sous la forme
| (5.31) |
ce que l’on visualise facilement sur le schéma de la figure 5.1.
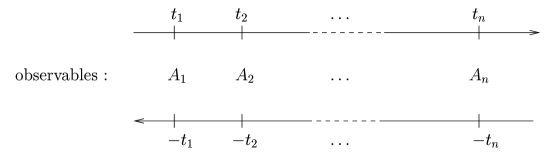
Théorème de fluctuation-dissipation
Comme décrit dans le chapitre 3, on peut définir plusieurs fonctions de réponse à temps, selon le nombre de perturbations et le nombre d’observables avec ,
| (5.32) |
Ici chaque champ peut être couplé à une observable différente. On peut facilement montrer que ces fonctions sont causales, c’est-à-dire qu’elles s’annulent dès qu’un des temps de perturbation est plus grand que le maximum des temps d’observation . En effet on a alors l’insertion d’un dans un bra-ket à gauche des , ce qui annule la fonction correspondante à cause de .
Commençons par discuter le cas des fonctions à trois temps, et plus particulièrement la réponse d’une perturbation sur la moyenne de deux observables, i.e. dans la définition ci-dessus. Posons
| (5.33) |
avec un champ couplé à . On supposera sans perte de généralité que . Par contre peut se situer dans différents secteurs :
-
—
Si , par causalité.
-
—
Si , autrement dit si la perturbation est antérieure aux deux temps d’observation,
(5.34) On peut alors suivre les mêmes étapes que celles conduisant à la preuve du FDT à deux points en transformant , et obtenir
(5.35) Cette relation est une généralisation naturelle du FDT habituel.
-
—
Si le système est perturbé entre les deux temps d’observation, , on a
(5.36) (5.37) La deuxième ligne a été obtenue en prenant la transposée de la première. On peut maintenant utiliser (5.18) pour transformer ceci en
(5.38) (5.39) La première ligne de cette équation correspond à une fonction de réponse avec des arguments temporels renversés dans le temps, tandis que la deuxième peut se réecrire comme une dérivée temporelle de la fonction de corrélation. On obtient finalement
(5.40) où l’on a réutilisé l’opération de renversement temporel. Il n’était pas complètement évident de prévoir cette relation qui fait intervenir deux fonctions de réponse, au vu du FDT sur les fonctions à deux temps.
On peut sans difficulté généraliser cette relation au cas d’un produit de observables avec une perturbation appliquée au temps ,
| (5.41) |
Il resterait à étudier les relations sur les fonctions de réponse à plusieurs perturbations. Dans la publication on pourra trouver le cas de la réponse d’une observable à deux perturbations.
5.3 Un théorème de fluctuation
Dans les démonstrations de la partie précédente on a souvent utilisé l’opération de transposition matricielle, qui correspond physiquement à un renversement temporel. La condition de balance détaillée est profondément reliée à cette notion : elle exprime la réversibilité microscopique des transitions entre deux configurations. En conséquence le flux de probabilité entre deux configurations microscopiques s’annule pour un ensemble de systèmes à l’équilibre, et l’on ne peut plus distinguer le sens temporel de l’évolution.
Les relations d’Onsager sont une reformulation de cette invariance, et les fonctions de réponse sont dans un certain sens une mesure de l’irréversibilité de l’évolution induite par les perturbations extérieures.
A la lumière de ces remarques, il n’est pas étonnant que l’on puisse reformuler toutes les propriétés démontrées jusqu’ici dans une expression qui fait jouer un rôle central au renversement temporel de l’évolution. Ce principe, que l’on va présenter dans cette partie, ressemble beaucoup à certaines formes du théorème de fluctuation [158, 159] pour des dynamiques microscopiques stochastiques [160, 161]. On pourra consulter [162] pour une revue de ces travaux, et [163] pour une mise au point sur le bon usage du nom de théorème de fluctuation.
Nous nous sommes aperçus, malheureusement après la publication de l’article, que ce résultat avait été obtenu antérieurement par Crooks [164].
On va à nouveau changer un petit peu la modélisation et les notations par rapport à la publication et à la partie précédente. On considère maintenant un processus stochastique où l’espace des configurations et le temps sont discrets. L’évolution du système est régie par l’équation-maîtresse
| (5.42) |
Les sont ici des probabilités de transition et non plus des taux de transition par unité de temps. On suppose qu’un champ extérieur est couplé à une observable , et que la dépendance temporelle explicite des probabilités de transition ne se fait que par l’intermédiaire de ce champ :
| (5.43) |
Fixons-nous un intervalle de temps pendant lequel on observe le système. On appelera trajectoire l’ensemble des configurations occupées successivement par le système au cours de cet intervalle de temps, . Définissons aussi la trajectoire du champ extérieur . La probabilité d’observation d’une trajectoire des configurations étant donné une trajectoire du champ extérieur s’exprime comme le produit des probabilités de transition,
| (5.45) | |||||
désignant la loi de probabilité des configurations au temps . On note maintenant et les trajectoires renversées dans le temps autour de . Le quotient de la probabilité d’observation d’une trajectoire dans un champ par la quantité correspondante après renversement temporel des trajectoires s’écrit :
| (5.46) |
Faisons deux hypothèses supplémentaires :
-
—
Au temps le système est équilibré par rapport à la mesure de Gibbs en champ nul, i.e. . On peut imaginer que le système ait été préparé bien avant et qu’on l’ait laissé évoluer sans champ jusqu’au temps .
-
—
Les probabilités de transition vérifient la condition de balance détaillée par rapport à l’hamiltonien total :
(5.47)
Avec ces deux nouvelles hypothèses, (5.46) se simplifie en
| (5.48) |
On aurait obtenu une forme analogue en partant d’une dynamique en temps continu :
| (5.49) |
où désigne la dérivée de le long de la trajectoire .
Cette relation exprime en champ nul la micro-réversibilité de l’évolution, et donc l’équiprobabilité d’une trajectoire et de sa renversée temporelle. Un champ extérieur non nul brise cette invariance ; on peut interpréter [164] l’exposant de (5.48) comme la partie du travail du champ extérieur que le bain thermique doit dissiper, ce qui entraîne l’irréversibilité du processus.
Ce théorème de fluctuation contient toutes les relations de la partie précédente. Considérons pour commencer le cas où le champ est nul. On peut facilement en déduire les relations d’Onsager en multipliant les deux membres de l’équation par le produit des observables concernées :
| (5.50) |
Sommant ensuite sur les trajectoires il vient
| (5.51) |
La notation désigne ici la somme sur les trajectoires , et la deuxième égalité vient du changement de variables d’intégration . On a ainsi réobtenu la relation d’Onsager (5.31).
On peut aussi déduire toutes les relations de fluctation-dissipation de l’équation (5.49). La méthode, que l’on n’explicitera ici que pour la fonction à deux points, consiste à nouveau à multiplier les deux membres de l’équation par les observables et à sommer sur les trajectoires :
| (5.52) |
Prenant la dérivée fonctionnelle à champ nul de cette équation, il vient en prenant soin de la dépendance temporelle renversée du deuxième membre
| (5.53) |
qui est bien la forme habituelle du FDT, puisqu’une des deux réponses s’annule par causalité selon que ou . On peut suivre la même procédure pour retrouver les relations entre corrélations et réponses à trois temps obtenues dans la partie précédente, ainsi que leurs généralisations à un nombre arbitraire de temps.
5.4 Généralisations hors d’équilibre
La motivation de l’étude présentée dans ce chapitre réside dans la constatation que la dynamique des modèles de spin dilués ne peut pas s’exprimer en termes des fonctions à deux temps uniquement. On a exploré pour l’instant les propriétés qu’auraient les fonctions de corrélation et de réponse à plus de deux temps si le système atteignait l’équilibre. On s’attend cependant à ce que la phase de basse température de ces modèles aient des propriétés vitreuses, et donc que le système reste hors d’équilibre à tous les temps. On s’intéressera donc dans la fin de ce chapitre à la forme que prennent les fonctions à plusieurs temps dans cette phase de basse température.
Je commence avant cela par faire un rappel sommaire de l’image de la dynamique hors d’équilibre des verres de spin qui a émergé des travaux sur les modèles complètement connectés.
5.4.1 Le scénario hors d’équilibre à une échelle de corrélation
Le cadre théorique dans lequel on se place ici a vu le jour avec l’article de Cugliandolo et Kurchan [43] sur la dynamique de basse température du modèle -spin sphérique. En effet, jusque là les études dynamiques de ces modèles s’étaient cantonnés à la phase d’équilibre à haute température.
Les équations sur les fonctions de corrélation et de réponse de ce modèle, pour une préparation initiale imitant un refroidissement instantané depuis la température infinie vers celle du bain extérieur, ont été données dans la partie 3.4. Leur résolution, dont le principe est expliqué en grand détail dans [46], révèle l’existence d’une température de transition entre deux régimes.
A haute température, la configuration initiale relaxe rapidement, et après ce court régime transitoire les fonctions de corrélation et de réponse sont stationnaires. Le théorème de fluctuation-dissipation est aussi vérifié, l’équilibre est donc atteint. Quand on se rapproche de par valeurs supérieures, la fonction de corrélation prend une allure particulière, schématisée sur la figure 5.2. La décroissance se fait en deux temps, d’abord de la valeur initiale jusqu’à une valeur de plateau , puis du plateau à 0. La durée de ce plateau augmente quand on diminue la température, et finit par diverger à . Quelques remarques s’imposent ici. Tout d’abord, cette description ne concerne que le cas : on a vu dans la partie 3.3.1 que pour , c’est-à-dire la version sphérique du modèle de Sherrington-Kirpatrick, le paramètre d’ordre croissait continument à la température de transition. Il n’y a donc pas l’apparition d’un tel plateau dans la phase de haute température. Signalons aussi que la version sphérique du modèle -spin a été introduite par Crisanti et Sommers [165], ces auteurs ayant aussi étudié la dynamique de haute température dans [166]. Finalement, on peut souligner la similitude de cette forme de la fonction de corrélation avec celles prédites pour les liquides structuraux par la théorie du couplage de modes (MCT) [50]. Cette similitude n’est pas accidentelle : comme l’ont remarqué Kirkpatrick, Thirumalai et Wolynes [51, 52, 53], les équations dynamiques du modèle -spin sphérique ont la même forme que les versions schématiques de la MCT. On trouvera une discussion plus détaillée de cette relation, et de ses possibles implications à basse température, dans [54].
Concentrons-nous maintenant sur la phase de basse température. Dans ce cas la dynamique est hors d’équilibre. L’invariance par translation temporelle est brisée par le temps initial de préparation du système, qui n’est jamais « oublié ». Il est donc nécessaire de conserver explicitement le temps d’attente passé dans la phase de basse température avant le début des mesures d’auto-corrélation et de réponse. Il se trouve que la fonction de corrélation , pour des temps d’attente suffisamment longs, a aussi l’allure donnée sur la figure 5.2. Autrement dit il y a une première décorrélation vers le plateau 222Ce paramètre d’ordre dépend de la température et croît discontinument quand on passe en dessous de , pour alléger les notations je laisse implicite cette dépendance en température. qui est indépendante du temps d’attente, et la décroissance finale de la corrélation se fait sur des échelles de temps d’autant plus grandes que le système est resté longtemps dans la phase de basse température. Les systèmes les plus « vieux » évoluent le plus lentement dans ce régime. La valeur de la corrélation permet donc de distinguer entre un régime rapide, stationnaire, et un régime lent qui dépend de l’âge du système. Plus précisément, on peut utiliser la paramétrisation suivante de la fonction de corrélation :
| (5.54) |
où est une fonction croissante. Cette décomposition n’est valable que dans la limite . Je me permettrai cependant d’utiliser un signe d’égalité dans la suite pour simplifier les écritures. Pour un temps d’attente donné, les temps ultérieurs se divisent en deux époques : si n’est pas trop grand, la partie lente de la corrélation est quasiment constante, égale à , tandis que la partie rapide décroît de à 0. Pour des temps beaucoup plus grand, la partie rapide s’est annulé, toute la dépendance temporelle vient alors de la partie lente de la corrélation. On dira dans la suite que deux temps et sont proches (resp. éloignés) si (resp. ).
La fonction encode la dépendance de la dynamique vis à vis de l’âge du système. Dans la plupart des cas elle n’a pas été déterminée analytiquement ; le traitement des équations dans la limite des longs temps d’attente repose sur l’abandon de certains termes, ce qui fait apparaître une invariance par reparamétrisation de la fonction .
Le scénario présenté ici pour la dépendance temporelle de la fonction de corrélation est dit à brisure faible d’ergodicité (WEB) [167, 168]. En effet, la décroissance de la partie rapide de la corrélation ne se fait que jusqu’à une valeur positive de la corrélation, comme si l’ergodicité était brisé par un confinement du système dans une partie de l’espace des phases de taille . Cette brisure n’est pas complète car sur des échelles de temps beaucoup plus longues le système arrive à échapper à ce confinement, la corrélation finissant par décroître jusqu’à 0.
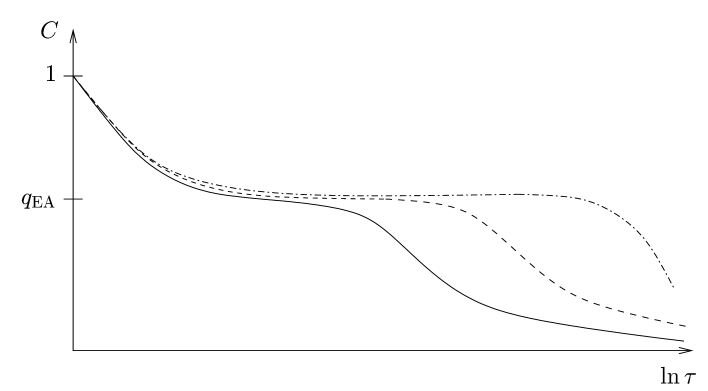
La fonction de réponse présente aussi une décomposition similaire en deux contributions :
| (5.55) |
Le quotient s’annule pour des longs temps d’attente, ceci fait partie du scénario « à faible mémoire à long terme » (WLTM).
Les fonctions de corrélation et de réponse pour des faibles différences de temps vérifient le théorème de fluctuation-dissipation avec la température du bain thermique extérieur :
| (5.56) |
Ce théorème est violé dans le régime vieillissant : la température du thermostat est remplacée par une température effective générée spontanément par le système. Pour deux temps éloignés, on a
| (5.57) |
Cette température effective, qui peut s’exprimer en fonction des caractéristiques du modèle, possède certaines propriétés attendues pour une « température », comme le contrôle du sens des échanges d’énergie entre deux systèmes. Ces propriétés sont l’objet notamment de [169].
Le scénario présenté ici est le plus simple dans la famille des dynamiques hors d’équilibre de verres de spins champ moyen : il n’y a qu’une valeur , donc seulement deux régimes temporels (un d’équilibre, un vieillissant) et deux températures (celle du bain extérieur, et celle auto-induite sur les degrés de liberté lents). On peut rencontrer d’autres situations plus compliquées, notamment dans la version soft-spin du modèle de Sherrington-Kirkpatrick [170]. Il apparaît alors une infinité d’échelles de corrélation. Cette différence de comportement est reliée aux deux types de brisure de la symétrie des répliques rencontrés dans les études statiques. Pour le -spin sphérique un seul pas de brisure est suffisant, alors que le SK présente une brisure complète de la symétrie.
On utilisera dans la suite le scénario à une échelle de corrélation, l’adaptation des résultats au scénario du SK étant par ailleurs possible.
5.4.2 Conséquences sur les fonctions à trois temps
On a donc une forme très particulière pour la violation des théorèmes d’équilibre dans la dynamique de basse température du modèle -spin sphérique. Il serait intéressant d’avoir un modèle dans lequel les fonctions à plus de deux temps ne découlent pas directement de celles à deux temps, et pour lequel on puisse expliciter les équations régissant les fonctions de corrélation et de réponse à plus de deux temps. Il conviendrait alors de chercher l’analogue des formes asymptotiques trouvées sur les fonctions à deux temps dans le modèle complètement connecté. On va se contenter d’une approche un peu détournée : supposons que l’on ait une variable scalaire qui évolue selon un processus stochastique gaussien (par exemple une équation single-spin pour une variable effective). On peut alors calculer tous les cumulants de ce processus en fonction des premiers cumulants. Si l’on prend pour ces derniers le scénario hors d’équilibre à une échelle de temps, on peut en explorer les conséquences sur les fonctions à points. On supposera finalement que ces relations resteront vraies dans un modèle non gaussien.
Définissons donc un processus gaussien couplé linéairement à un champ extérieur . On suppose sa moyenne non nulle pour avoir des fonctions à trois points non triviales, dans le cas contraire il faudrait écrire les relations à quatre points ce qui alourdirait la discussion. Le processus est complètement caractérisé par la donnée de sa moyenne, de la corrélation à champ nul et de la fonction de réponse :
| (5.58) |
Un calcul immédiat d’intégrales gaussiennes permet d’exprimer les fonctions à trois temps :
| (5.59) |
Supposons que tous les temps mis en jeu soient grands devant un temps microscopique, de sorte que la moyenne ait atteint une valeur asymptotique , et que la décomposition des fonctions à deux temps en une partie rapide et une partie lente soit valable. On cherche donc les relations entre les fonctions à trois points que cette décomposition induit. Rappelons que l’on a démontré à l’équilibre :
| (5.60) |
où la notation désigne le renversement temporel par rapport à un temps arbitraire, . Pour le processus gaussien étudié ici, il suffit d’insérer les formes asymptotiques des fonctions à deux points dans les relations (5.59) pour établir les généralisations de la relation d’équilibre (5.60). Les différents cas à considérer sont détaillés dans la publication P5, je donne ici un résumé des résultats obtenus :
-
—
Supposons d’abord que le temps de perturbation soit antérieur aux deux temps d’observation, . Il faut alors distinguer deux possibilités :
-
—
si et sont proches, c’est à dire , le FDT est vérifié avec la température du bain extérieur,
(5.61) -
—
si et sont éloignés, i.e. , c’est la température effective qui contrôle la relation de fluctuation-dissipation :
(5.62)
Notons que le temps est « spectateur » ici : qu’il soit proche ou loin de ne change pas la forme de la relation.
-
—
-
—
Intéressons-nous maintenant au cas d’une perturbation faite à un temps intermédiaire. On trouve que la relation d’équilibre (5.60) est vérifié dès qu’au moins un des deux temps ou est proche de . Par contre si les deux en sont éloignés, c’est-à-dire si et , la généralisation hors-d’équilibre prend la forme :
(5.63) Il y a deux modifications par rapport à (5.60) : comme on pouvait s’y attendre, la température effective remplace celle du bain thermique. Le point le plus original ici est que l’on doit définir une nouvelle opération de « renversement temporel dans l’échelle vieillissante »,
(5.64) où est un temps arbitraire, éloigné de , laissé invariant par cette opération de renversement. désigne ici la réciproque de , autrement dit le temps et son renversé sont reliés par . On vérifie aisément que pour la forme d’équilibre cette définition coïncide avec celle du renversement temporel standard.
On pourrait de la même façon étudier les conséquences du scénario hors d’équilibre sur des fonctions avec un plus grand nombre de temps.
5.4.3 Généralisation du théorème de fluctuation
La section 5.3 présentait une formulation compacte des propriétés de la dynamique d’équilibre à l’aide d’un théorème de fluctuation. Celui-ci était essentiellement une quantification de la brisure d’invariance par renversement temporel que le travail d’un champ extérieur induit. On va voir maintenant que les relations hors d’équilibre postulées dans le paragraphe précédent découlent, elles aussi, d’une modification du théorème de fluctuation.
Décomposons pour cela l’évolution microscopique du système en une partie rapide, d’équilibre, et une partie lente vieillissante. Une telle décomposition a été utilisé par Franz et Virasoro dans [171]. L’idée consiste à définir la partie lente de l’évolution comme une moyenne sur un intervalle de temps suffisamment grand :
| (5.65) |
où est défini par . Le degré de liberté lent est donc la moyenne sur tous les temps proches de . Le champ extérieur peut être de la même manière décomposé en une partie rapide et une partie lente.
On peut vérifier alors que les relations hors d’équilibre s’obtiennent en supposant que :
-
—
La partie rapide vérifie le théorème de fluctuation habituel (cf. eq. (5.49)) avec la température du thermostat, seule la partie rapide du champ extérieur agissant sur .
-
—
Les degrés de liberté lents du système sont soumis à un principe généralisé,
(5.66) La température du bain a été remplacée par la température effective, et l’opération de renversement temporel par sa contrepartie dans le domaine vieillissant définie par l’équation (5.64).
A nouveau ce résultat n’est qu’une conjecture, et il serait intéressant de tester sa véracité sur des modèles suffisamment simples pour être solubles, mais non trivialement gaussiens.
5.4.4 Perspectives
La démarche suivie pour établir ces relations hors d’équilibre est criticable : les relations hors d’équilibre (5.62) et (5.63) sont ici des conséquences directes de l’hypothèse faite sur les fonctions à deux temps. La conjecture avancée dans la publication P5 est qu’il existe des modèles non triviaux pour lesquels ces relations restent vraies. Le travail exposé dans la partie 3.4 montre que cette hypothèse est au moins cohérente pour les modèles -spin dilués. En effet, même si l’on ne sait pas résoudre l’équation de point-col sur le paramètre d’ordre dans ce cas-là, les fonctions à points peuvent formellement s’exprimer par un développement diagrammatique perturbatif autour d’une théorie gaussienne. Ces diagrammes sont construits à partir des opérations de convolution et de produit direct de noyaux supersymétriques. Or ces deux opérations conservent les décompositions en différentes époques temporelles : si les fonctions de réponse et de corrélation de deux noyaux et ont une partie rapide et une partie lente séparées par une certaine échelle de corrélation, les produits et vont aussi présenter le même type de séparation d’échelles.
Une direction alternative serait de tester ces prédictions à l’aide de simulations numériques. Parmi les plus simples de ces vérifications, on peut remarquer que le théorème de fluctuation généralisé, pris sans champ extérieur, donne lieu à des relations d’Onsager dans le régime vieillissant. On a notamment pour trois temps tous éloignés les uns des autres :
| (5.67) |
où est défini par . Ce type de relation devrait être assez facile à tester dans des simulations numériques de verres de spin dilués, et donnerait plus de crédit à cette assez surprenante idée de « renversement temporel dans l’échelle vieillissante ».
Signalons enfin deux études récentes concernant, dans des contextes un peu différents, des généralisations du théorème de fluctuation dans des situations hors d’équilibre [172, 173].
Chapitre 6 Conclusion
Ici s’achève la présentation des résultats obtenus au cours de cette thèse consacrée à la dynamique hors d’équilibre des systèmes dilués. Comme on l’a vu au cours des différents chapitres, la connectivité finie de ces systèmes est à l’origine d’un certain nombre de difficultés techniques. Plusieurs schémas d’approximation ont par conséquent été proposés et partiellement exploités. On peut espérer que ces travaux préliminaires pourront être approfondis et conduire à des prédictions physiques plus complètes sur le comportement de cette famille de système, qui est loin d’avoir été élucidé ici.
J’ai essayé de donner à la fin de chaque partie des directions d’approfondissements possibles, je me contenterai d’en reprendre quelques unes ici :
-
—
La formulation supersymétrique de l’intégrale de chemin de Martin-Siggia-Rose complétée par l’introduction d’un paramètre d’ordre inspiré de la théorie statique (section 3.4) a permis d’écrire formellement l’équation régissant la dynamique des versions soft-spin des modèles dilués. Il serait certainement intéressant de pousser plus avant cette approche ; l’approximation à un seul défaut de Biroli et Monasson, présentée dans le cadre des matrices aléatoires, devrait pouvoir être adaptée aux calculs dynamiques. Les résultats obtenus dans le chapitre 5 sur la forme hors d’équilibre des fonctions à points seront peut-être utiles dans cette tentative.
-
—
Le travail sur le ferromagnétique à connectivité fixe (section 4.3) pourrait par ailleurs constituer un point de départ pour une investigation de la phase de Griffiths dans les modèles à connectivité fluctuante.
-
—
L’étude de l’algorithme d’optimisation exposé dans la partie 4.4 ouvre de nombreuses portes, tant vers des travaux analytiques pour une meilleure description quantitative de ce processus « non-physique » que vers des investigations numériques d’algorithmes plus performants. Une des questions importantes à clarifier dans cette perspective concerne le lien entre la structure du paysage des configurations microscopiques et les propriétés de tels algorithmes qui ne respectent pas les conditions physiques de type balance détaillée. Il serait souhaitable que des échanges fructueux s’établissent entre la communauté de physique statistique et celle d’informatique, dont les objets d’étude sont étroitement liés. La confrontation d’approches et de méthodes assez radicalement différentes peut sûrement apporter beaucoup aux deux domaines.
Je voudrais finalement souligner un point qui n’a été que très peu abordé dans ce manuscrit. Les systèmes dilués sont des modèles de champ moyen, et toutes les paires de sites ont la même probabilité a priori d’être en interaction. Si l’on considère un échantillon donné, on peut par contre définir une distance entre deux sites comme la longueur minimum des chemins qui les relient. On a donc une notion de « géométrie », qui permet de définir par exemple des corrélations spatiales dans le système. Cet aspect a été perdu dans les études présentées ici, par exemple dans l’approche fonctionnelle de la section 3.4, car on s’est intéressé aux propriétés moyennées sur l’ensemble des échantillons. La nécessité et/ou la possibilité de travailler sur un échantillon donné dans ces systèmes dilués suggère des perspectives assez fascinantes. Les applications de la méthode de cavité l’ont montré pour les propriétés statiques, il reste des possibilités pour étendre cette démarche à la dynamique.
Références
- [1] J.A. Mydosh. Spin glasses: an experimental introduction. Taylor and Francis, 1993.
- [2] N.W. Ashcroft and D. Mermin. Solid state physics. International Thomson Publishing, 1976.
- [3] S.F. Edwards and P.W. Anderson. Theory of spin glasses. J. Phys. F: Metal Phys., 5, 965 (1975).
- [4] D. Sherrington and S. Kirkpatrick. Solvable Model of a Spin-Glass. Phys. Rev. Lett., 35, 1792 (1975).
- [5] D. Sherrington and S. Kirkpatrick. Infinite-ranged models of spin-glasses. Phys. Rev. B, 17, 4384 (1978).
- [6] J.R.L. de Almeida and D.J. Thouless. Stability of the Sherrington-Kirkpatrick solution of a spin glass model. J. Phys. A, 11, 983 (1978).
- [7] G. Parisi. A sequence of approximated solutions to the S-K model for spin glasses. J. Phys. A, 13, L115 (1980).
- [8] G. Parisi. The order parameter for spin glasses: A function on the interval 0-1. J. Phys. A, 13, 1101 (1980).
- [9] G. Parisi. Magnetic properties of spin glasses in a new mean field theory. J. Phys. A, 13, 1887 (1980).
- [10] M. Mézard, G. Parisi, and M.A. Virasoro. Spin glass theory and beyond. World-Scientific, 1987.
- [11] M. Talagrand. The generalized Parisi formula. C.R.A.S., 337, 111 (2003).
- [12] F. Guerra. Replica broken bounds in the mean field spin glass model. Communications Math. Phys., 233, 1 (2003).
- [13] B. Derrida. Random-energy model: An exactly solvable model of disordered systems. Phys. Rev. B, 24, 2613 (1981).
- [14] D.J. Gross and M. Mézard. The simplest spin glass. Nuclear Physics B, 240, 431 (1984).
- [15] E. Gardner. Spin glasses with -spin interaction. Nuclear Physics B, 257, 747 (1985).
- [16] J.-P. Bouchaud and M. Mézard. Universality classes for extreme-value statistics. J. Phys. A, 30, 7997 (1997).
- [17] M. Mézard and G. Parisi. A replica analysis of the travelling salesman problem. J. Physique, 47, 1285 (1986).
- [18] S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt, and M.P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. Science, 220, 671 (1983).
- [19] L. Viana and A.J. Bray. Phase diagrams for dilute spin-glasses. J. Phys. C: Solid State Phys., 18, 3037 (1985).
- [20] D.S. Fisher and D.A. Huse. Ordered phase of short range Ising spin glasses. Phys. Rev. Lett., 56, 1601 (1986).
- [21] D.S. Fisher and D.A. Huse. Nonequilibrium dynamics of spin glasses. Phys. Rev. B, 38, 373 (1988).
- [22] R.B. Griffiths. Nonanalytic behavior above the critical point in a random Ising ferromagnet. Phys. Rev. Lett., 23, 17 (1969).
- [23] A.J. Bray and D. Huifang. Griffiths singularities in random magnets: Results for a soluble model. Phys. Rev. B, 40, 6980 (1989).
- [24] A.J. Bray. Nature of the Griffiths phase. Phys. Rev. Lett., 59, 586 (1987).
- [25] M. Randeria, J.P. Sethna, and R.G. Palmer. Low-frequency relaxation in Ising spin-glasses. Phys. Rev. Lett., 54, 1321 (1985).
- [26] B. Hayes. Can’t get no satisfaction. American Scientist, 85, 108 (1997).
- [27] S. Cook. The complexity of theorem proving procedures. In Proceedings of the third annual ACM symposium on theory of computing, page 151, 1971.
- [28] D. Mitchell, B. Selman, and H. Levesque. Hard and easy distribution of SAT problems. Proceedings of the AAAI-92 conference, page 440 (1992).
- [29] I. Kanter and H. Sompolinsky. Mean-field theory of spin-glasses with finite coordination number. Phys. Rev. Lett., 58, 164 (1987).
- [30] R. Monasson and R. Zecchina. Statistical mechanics of the random K-Sat problem. Phys. Rev. E, 56, 1357 (1997).
- [31] C. de Dominicis and P. Mottishaw. Replica symmetry breaking in weak connectivity systems. J. Phys. A, 20, L1267 (1987).
- [32] R. Monasson. Optimization problems and replica symmetry breaking in finite connectivity spin glasses. J. Phys. A, 31, 513 (1998).
- [33] G. Biroli, R. Monasson, and M. Weigt. A variational description of the ground-state structure in random satisfiability problems. Eur. Phys. J. B, 14, 551 (2000).
- [34] M. Mézard and G. Parisi. The Bethe lattice spin glass revisited. Eur. Phys. J. B, 20, 217 (2001).
- [35] M. Mézard and R. Zecchina. Random K-satisfiability problem: From an analytic solution to an efficient algorithm. Phys. Rev. E, 66, 056126 (2002).
- [36] A. Montanari and F. Ricci-Tersenghi. On the nature of the low-temperature phase in discontinuous mean-field spin glasses. Eur. Phys. J. B, 33, 339 (2003).
- [37] A. Montanari, G. Parisi, and F. Ricci-Tersenghi. Instability of one-step replica-symmetry-broken-phase in satisfiability problems. J. Phys. A, 37, 2073 (2004).
- [38] R. Mulet, A. Pagnani, M. Weigt, and R. Zecchina. Coloring random graphs. Phys. Rev. Lett., 89, 268701 (2002).
- [39] N. Creignou and H. Daudé. Satisfiability threshold for random XOR-CNF formulas. Discrete Applied Mathematics, 96-97, 41 (1999).
- [40] S. Cocco, O. Dubois, J. Mandler, and R. Monasson. Rigorous decimation-based construction of ground pure states for spin glass models on random lattices. Phys. Rev. Lett., 90, 047205 (2003).
- [41] M. Mézard, F. Ricci-Tersenghi, and R. Zecchina. Two solutions to diluted p-spin models and XORSAT problems. J. Stat. Phys., 111, 505 (2003).
- [42] H. Sompolinsky and A. Zippelius. Relaxational dynamics of the Edwards-Anderson model and the mean-field theory of spin-glasses. Phys. Rev. B, 25, 6860 (1982).
- [43] L.F. Cugliandolo and J. Kurchan. Analytical solution of the off-equilibrium dynamics of a long-range spin-glass model. Phys. Rev. Lett., 71, 173 (1993).
- [44] L.C.E. Struik. Physical aging in amorphous polymers and other materials. Elsevier, 1976.
- [45] J.-P. Bouchaud, L.F. Cugliandolo, J. Kurchan, and M. Mézard. Out of equilibrium dynamics in spin-glasses and other glassy systems. In A.P. Young, editor, Spin glasses and random fields. World-Scientific, 1998.
- [46] L.F. Cugliandolo. Dynamics of glassy systems. In J.L. Barrat, M. Feigelman, J. Kurchan, and J. Dalibard, editors, Slow relaxations and nonequilibrium dynamics in condensed matter, Les Houches lecture notes. Session LXXVII, page 367. 2003.
- [47] E. Vincent, J. Hammann, M. Ocio, J.-P. Bouchaud, and L. F. Cugliandolo. Slow dynamics and aging in glassy systems. In M. Rubí, editor, Sitges 1996. Springer, 1997.
- [48] D. Herisson and M. Ocio. Fluctuation-dissipation ratio of a spin glass in the aging regime. Phys. Rev. Lett., 88, 257202 (2002).
- [49] W. Kob. Supercooled liquids, the glass transition, and computer simulations. In J.L. Barrat, M. Feigelman, J. Kurchan, and J. Dalibard, editors, Slow relaxations and nonequilibrium dynamics in condensed matter, Les Houches lecture notes. Session LXXVII, page 199. 2003.
- [50] W. Götze. Aspects of structural glass transitions. In J.P. Hansen, D. Levesque, and J. Zinn-Justin, editors, Liquids, freezing and glass transition, Les Houches lecture notes. Session LI, page 287. 1989.
- [51] T.R. Kirkpatrick and D. Thirumalai. Dynamics of the structural glass transition and the -spin interaction spin-glass model. Phys. Rev. Lett., 58, 2091 (1987).
- [52] T.R. Kirkpatrick and D. Thirumalai. -spin interaction spin-glass model: Connections with the structural glass problem. Phys. Rev. B, 36, 5388 (1987).
- [53] T. R. Kirkpatrick and P. G. Wolynes. Stable and metastable states in mean-field Potts and structural glasses. Phys. Rev. B, 36, 8552 (1987).
- [54] J.-P. Bouchaud, L.F. Cugliandolo, J. Kurchan, and M. Mézard. Mode-coupling approximations, glass theory and disordered systems. Physica A, 226, 243 (1996).
- [55] A. Barrat and R. Zecchina. Time scale separation and heterogeneous off-equilibrium dynamics in spin models over random graphs. Phys. Rev. E, 59, R1299 (1999).
- [56] A. Montanari and F. Ricci-Tersenghi. Aging dynamics of heterogeneous spin models. Phys. Rev. B, 68, 224429 (2003).
- [57] A. Montanari and F. Ricci-Tersenghi. On the cooling-schedule dependence of the dynamics of mean-field glasses. cond-mat/0401649, (2004).
- [58] S. Cocco and R. Monasson. Trajectories in phase diagrams, growth processes and computational complexity: how search algorithms solve the 3-Satisfiability problem. Phys. Rev. Lett., 86, 1654 (2001).
- [59] G. Biroli and R. Monasson. A single defect approximation for localized states on random lattices. J. Phys. A, 32, L255 (1999).
- [60] A.C.C. Coolen and D. Sherrington. Order-parameter flow in the SK spin glass. I. Replica symmetry. J. Phys. A, 27, 7687 (1994).
- [61] S.N. Laughton, A.C.C. Coolen, and D. Sherrington. Order-parameter flow in the SK spin glass: II. Inclusion of microscopic memory effects. J. Phys. A, 29, 763 (1996).
- [62] P. Erdös and A. Rényi. On the evolution of random graphs. Publ. Math. Inst. Hungar. Acad. Sci., 5, 17 (1960).
- [63] B. Bollobas. Random Graphs. Cambridge University Press, 2nd edition, 2001.
- [64] S. Janson, T. Luczak, and A. Rucinski. Random Graphs. Wiley-Interscience, 2000.
- [65] S. Janson, D. Knuth, T. Luczak, and B. Pittel. The birth of the giant component. Random Structures and Algorithms, 4, 233 (1993).
- [66] N. Alon and J.H. Spencer. The probabilistic method. Wiley-Interscience, 2nd edition, 2000.
- [67] A. Engel, R. Monasson, and A.K. Hartmann. On large deviation properties of Erdös-Rényi random graphs. cond-mat/0311535, (2003).
- [68] O. Rivoire. Properties of atypical graphs from negative complexities. cond-mat/0312501, (2003).
- [69] R. Albert and A.-L. Barabasi. Statistical mechanics of complex networks. Rev. Mod. Phys., 74, 47 (2002).
- [70] M. E. J. Newman, S. H. Strogatz, and D. J. Watts. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 45, 167 (2003).
- [71] B. Bollobas, O. Riordan, G. Tusnary, and J. Spencer. The degree sequence of a scale-free random graph process. Random Structures and Algorithms, 18, 279 (2001).
- [72] M. Molloy and B. Reed. A Critical Point for Random Graphs with a Given Degree Sequence. Random Structures and Algorithms, 6, 161 (1995).
- [73] S.N. Dorogovtsev, A.V. Goltsev, and J.F.F. Mendes. Ising model on networks with an arbitrary distribution of connections. Phys. Rev. E, 66, 016104 (2002).
- [74] M. Leone, A. Vazquez, A. Vespignani, and R. Zecchina. Ferromagnetic ordering in graphs with arbitrary degree distribution. Eur. Phys. J. B, 28, 191 (2002).
- [75] A.K. Hartmann and M. Weigt. Statistical mechanics perspective on the phase transition in vertex covering finite-connectivity random graphs. Theoretical Computer Science, 265, 199 (2001).
- [76] F. Guerra and F.L. Toninelli. The high temperature region of the Viana-Bray diluted spin glass model. J. Stat. Phys., 115, 531 (2004).
- [77] F.L. Toninelli. Private communication.
- [78] T.H. Berlin and M. Kac. The spherical model of a ferromagnet. Phys. Rev., 86, 821 (1952).
- [79] H.E. Stanley. Spherical model as a limit of infinite spin dimensionality. Phys. Rev., 176, 718 (1968).
- [80] A.M. Khorunzhy, B.A. Khoruzenkho, L.A. Pastur, and M.V. Scherbina. The large limit in statistical mechanics and the spectral theory of disordered systems. In C. Domb and J.L. Lebowitz, editors, Phase transitions and critical phenomena, volume 15, page 73. 1992.
- [81] D.J. Thouless. Anderson’s theory of localized states. J. Phys. C: Solid State Phys., 3, 1559 (1970).
- [82] R. Abou-Chacra, P.W. Anderson, and D.J. Thouless. A selfconsistent theory of localization. J. Phys. C: Solid State Phys., 6, 1734 (1973).
- [83] B. Derrida and G.J. Rodgers. Anderson model on a Cayley tree: the density of states. J. Phys. A, 26, L457 (1993).
- [84] M.L. Mehta. Random matrices. Academic Press, 2nd edition, 1991.
- [85] P.J. Forrester, N.C. Snaith, and J.J.M. Verbaarschot eds. J. Phys. A special issue, 36(12) (2003).
- [86] S.F. Edwards and R.C. Jones. The eigenvalue spectrum of a large symmetric random matrix. J. Phys. A, 9, 1595 (1976).
- [87] P. Di Francesco, P. Ginsparg, and J. Zinn-Justin. 2D gravity and random matrices. Phys. Rep., 254, 1 (1995).
- [88] O. Golinelli. Statistics of delta peaks in the spectral density of large random trees. cond-mat/0301437, (2003).
- [89] S.N. Evangelou and E.N. Economou. Spectral density singularities, level statistics, and localization in a sparse random matrix ensemble. Phys. Rev. Lett., 68, 361 (1992).
- [90] G.J. Rodgers and A.J. Bray. Density of states of a sparse random matrix. Phys. Rev. B, 37, 3557 (1988).
- [91] G.J. Rodgers and C. de Dominicis. Density of states of sparse random matrices. J. Phys. A, 23, 1567 (1990).
- [92] A.D. Mirlin and Y.V. Fyodorov. Universality of level correlation function of sparse random matrices. J. Phys. A, 24, 2273 (1991).
- [93] M. Bauer and O. Golinelli. Random incidence matrices: moments of the spectral density. J. Stat. Phys., 103, 301 (2001).
- [94] A. Kamenev and M. Mézard. Wigner-Dyson statistics from the replica method. J. Phys. A, 32, 4351 (1999).
- [95] P. Cizeau and J.P. Bouchaud. Theory of Lévy matrices. Phys. Rev. E, 50, 1810 (1994).
- [96] D.J. Thouless. Density of states of the random-hopping model on a Cayley tree. Phys. Rev. B, 31, 7393 (1985).
- [97] W. Krauth. Private communication.
- [98] W. Krauth and M. Staudacher. Eigenvalue Distributions in Yang-Mills Integrals. Phys.Lett. B, 453, 253 (1999).
- [99] M. Bauer and O. Golinelli. Exactly solvable model with two conductor-insulator transitions driven by impurities. Phys. Rev. Lett., 86, 2621 (2001).
- [100] A.J. Bray and G.J. Rodgers. Diffusion in a sparsely connected space: A model for glassy relaxation. Phys. Rev. B, 38, 11461 (1988).
- [101] D.S. Dean. An approximation scheme for the density of states of the Laplacian on random graphs. J. Phys. A, 35, L153 (2002).
- [102] S. Ciliberti, T. S. Grigera, V. Martin-Mayor, G. Parisi, and P. Verrocchio. Anderson Localization in Euclidean Random Matrices. cond-mat/0403122, (2004).
- [103] A. Cavagna, I. Giardina, and G. Parisi. Analytic computation of the instantaneous normal modes spectrum in low-density liquids. Phys. Rev. Lett., 83, 108 (1999).
- [104] S.N. Dorogovtsev, A.V. Goltsev, J.F.F. Mendes, and A.N. Samukhin. Spectra of complex networks. Phys. Rev. E, 68, 046109 (2003).
- [105] I.J. Farkas, I. Derényi, A.-L. Barabási, and T. Vicsek. Spectra of "real-world" graphs: Beyond the semicircle law. Phys. Rev. E, 64, 026704 (2001).
- [106] M. Mihail and C.H. Papadimitriou. On the eigenvalue power law. (2002).
- [107] J.M. Kosterlitz, D.J. Thouless, and R.C. Jones. Spherical model of a spin-glass. Phys. Rev. Lett., 36, 1217 (1976).
- [108] S. Ciuchi and F. de Pasquale. Nonlinear relaxation and ergodicity breakdown in random anisotropy spin glasses. Nucl. Phys. B, 300, 31 (1988).
- [109] L.F. Cugliandolo and D.S. Dean. Full dynamical solution for a spherical spin-glass model. J. Phys. A, 28, 4213 (1995).
- [110] W. Zippold, R. Kühn, and H. Horner. Non-equilibrium dynamics of simple spherical spin models. Eur. Phys. J. B, 13, 531 (2000).
- [111] G. Ben Arous, A. Dembo, and A. Guionnet. Aging of spherical spin glasses. Prob. Th. Rel. Fields, 120, 1 (2001).
- [112] L. Berthier. Sub-aging in a domain growth model. Eur. Phys. J. B, 17, 689 (2000).
- [113] A.J. Bray and M.A. Moore. On the eigenvalue spectrum of the susceptibility matrix for random systems. J. Phys. C: Solid State Phys., 15, L765 (1982).
- [114] G. Szamel. Glauber dynamics of the SK model: theory and simulations in the high-temperature phase. J. Phys. A, 31, 10045 (1998).
- [115] G. Szamel. Glauber dynamics of the SK model: theory and simulations in the low-temperature phase. J. Phys. A, 31, 10053 (1998).
- [116] P.C. Martin, E.D. Siggia, and H.A. Rose. Statistical dynamics of classical systems. Phys. Rev. A, 8, 423 (1973).
- [117] H.K. Janssen. Lagrangean for classical field dynamics and renormalization group calculations of dynamical critical properties. Z. Phys. B, 23, 377 (1976).
- [118] C. De Dominicis. Dynamics as a substitute for replicas in systems with quenched random impurities. Phys. Rev. B, 18, 4913 (1978).
- [119] G. Parisi and N. Sourlas. Supersymmetric field theories and stochastic differential equations. Nucl. Phys. B, 206, 321 (1982).
- [120] J. Zinn-Justin. Quantum field theory and critical phenomena. Oxford University Press, 3rd edition, 1996.
- [121] J. Kurchan. Supersymmetry in spin glass dynamics. J. Physique I France, 2, 1333 (1992).
- [122] J. Kurchan. Supersymmetry, replica and dynamic treatments of disordered systems: a parallel presentation. cond-mat/0209399, (2002).
- [123] A. Houghton, S. Jain, and A. P. Young. Role of initial conditions in the mean-field theory of spin-glass dynamics. Phys. Rev. B, 28, 2630 (1983).
- [124] A. Barrat, R. Burioni, and M. Mézard. Dynamics within metastable states in a mean-field spin glass. J. Phys. A, 29, L81 (1996).
- [125] A. Barrat. The p-spin spherical spin glass model. cond-mat/9701031, (1997).
- [126] H. Mori. Transport collective motion and brownian motion. Progr. Theor. Phys., 33, 423 (1965).
- [127] R. Zwanzig. Ensemble method in the theory of irreversibility. J. Chem. Phys., 33, 1338 (1960).
- [128] N.C. Wormald. Differential equations for random processes and random graphs. Ann. Appl. Prob., 5, 1217 (1995).
- [129] D. Achlioptas. Lower bounds for random 3-SAT via differential equations. Theoretical computer science, 265, 159 (2001).
- [130] A. Dembo and O. Zeitouni. Large deviations techniques and applications. Springer-Verlag, 2nd edition, 1998.
- [131] R.B. Griffiths, C.-Y. Weng, and J.S. Langer. Relaxation times for metastable states in the mean-field model of a ferromagnet. Phys. Rev., 149, 301 (1966).
- [132] A.J. Bray. Theory of phase-ordering kinetics. Adv. Phys., 43, 357 (1994).
- [133] S. Franz, M. Mézard, F. Ricci-Tersenghi, M. Weigt, and R. Zecchina. A ferromagnet with a glass transition. Europhys. Lett., 55, 465 (2001).
- [134] W. Barthel, A.K. Hartmann, and M. Weigt. Solving satisfiability problems by fluctuations: The dynamics of stochastic local search algorithms. Phys. Rev. E, 67, 066104 (2003).
- [135] C.H. Papadimitriou and K. Steiglitz. Combinatorial optimization : algorithms and complexity. Prentice-Hall, 1982.
- [136] M. Davis, G. Logemann, and D. Loveland. A machine program for theorem proving. Communications of the ACM, 5, 394 (1962).
- [137] C.H. Papadimitriou. On selecting a satisfying truth assignment. In Proceedings of the 32th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, page 163, 1991.
- [138] U. Schöning. A probabilistic algorithm for k-SAT based on limited local search and restart. Algorithmica, 32, 615 (2002).
- [139] S. Baumer and R. Schuler. Improving a probabilistic 3-sat algorithm by dynamic search and independant clause pairs. Proceedings of SAT03, Lecture Notes in Computer Science, 2919, 150 (2004).
- [140] R. Motwani and P. Raghavan. Randomized algorithms. Cambridge University Press, 1995.
- [141] E. Friedgut. Sharp threshold of graph properties, and the k-sat problem. Journal of the A.M.S., 12, 1017 (1999).
- [142] O. Dubois, Y. Boufkhad, and J. Mandler. Typical random 3-SAT formulas and the satisfiability threshold. Proc. 11th ACM-SIAM Symp. on Discret Algorithms, page 124 (2000).
- [143] D. Achlioptas and C. Moore. The asymptotic order of the k-SAT threshold. Proceedings of FOCS-02, (2002).
- [144] D. Achlioptas and Y. Peres. The threshold for random k-SAT is . Extended Abstract in STOC’03, page 223 (2003).
- [145] S. Franz and M. Leone. Replica bounds for optimization problems and diluted spin systems. J. Stat. Phys., 111, 535 (2003).
- [146] S. Mertens, M. Mézard, and R. Zecchina. Threshold values of random -SAT from the cavity method. cs.CC/0309020, (2003).
- [147] T.M. Liggett. Interacting particle systems. Springer, 1985.
- [148] C. Deroulers and R. Monasson. Field-theoretic approach to metastability in the contact process. Phys. Rev. E, 69, 016126 (2004).
- [149] M. Alekhnovich and E. Ben-Sasson. Linear upper bounds for random walk on small density random 3-CNFs. In Proceedings of the 44th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 2003.
- [150] A.J. Parkes. Scaling properties of pure random walk on random 3-SAT. Lecture Notes in Computer Science, 2470, 708 (2002).
- [151] B. Selman, H. Kautz, and B. Cohen. Noise strategies for improving local search. Proceedings of the AAAI-94 conference, page 337 (1994).
- [152] D. McAllester, B. Selman, and H. Kautz. Evidence for invariants in local search. Proceedings of the AAAI-97 conference, (1997).
- [153] H.H. Hoos and T. Stützle. Local search algorithms for SAT: An empirical evaluation. J. Automated reasoning, 24, 421 (2000).
- [154] D. J. Watts and S. H. Strogatz. Collective dynamics of ’small-world’ networks. Nature, 393, 440 (1998).
- [155] B. Derrida, M.R. Evans, V. Hakim, and V. Pasquier. Exact solution of a 1D asymmetric exclusion model using a matrix formulation. J. Phys. A, 26, 1493 (1993).
- [156] S. Seitz and P. Orponen. An efficient local search method for random 3-satisfiability. Proc. LICS’03 Workshop on Typical Case Complexity and Phase Transitions. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 16 (2003).
- [157] M. Campellone, G. Parisi, and P. Ranieri. Dynamical fluctuations in an exactly solvable model of spin glasses. J. Phys. A, 31, 1893 (1998).
- [158] D.J. Evans, E.G.D. Cohen, and G.P. Morriss. Probability of second law violations in shearing steady states. Phys. Rev. Lett., 71, 2401 (1993).
- [159] G. Gallavotti and E.G.D. Cohen. Dynamical ensembles in nonequilibrium statistical mechanics. Phys. Rev. Lett., 74, 2694 (1995).
- [160] J. Kurchan. Fluctuation theorem for stochastic dynamics. J. Phys. A, 31, 3719 (1998).
- [161] J.L. Lebowitz and H. Spohn. A Gallavotti-Cohen-type symmetry in the large deviation functional for stochastic dynamics. J. Stat. Phys., 95, 333 (1999).
- [162] F. Ritort. Work fluctuations, transient violations of the second law and free-energy recovery methods: Perspectives in theory and experiments. Poincare Seminar, 2, 195 (2003).
- [163] G. Gallavotti. Fluctuation theorem revisited. cond-mat/0404699, (2004).
- [164] G. Crooks. Path-ensemble averages in systems driven far from equilibrium. Phys. Rev. E, 61, 2361 (2000).
- [165] A. Crisanti and H.J. Sommers. The spherical -spin interaction spin glass model: the statics. Z. Phys. B, 87, 341 (1992).
- [166] A. Crisanti, H. Horner, and H.J. Sommers. The spherical -spin interaction spin glass model: the dynamics. Z. Phys. B, 92, 257 (1993).
- [167] J.-P. Bouchaud. Weak ergodicity breaking and aging in disordered systems. J. Physique I (France), 2, 1705 (1992).
- [168] J.-P. Bouchaud and D.S. Dean. Aging on Parisi’s tree. J. Physique I (France), 5, 265 (1995).
- [169] L.F. Cugliandolo, J. Kurchan, and L. Peliti. Energy flow, partial equilibration and effective temperatures in systems with slow dynamics. Phys. Rev. E, 55, 3898 (1997).
- [170] L.F. Cugliandolo and J. Kurchan. On the out-of-equilibrium relaxation of the Sherrington-Kirkpatrick model. J. Phys. A, 27, 5749 (1994).
- [171] S. Franz and M.A. Virasoro. Quasi-equilibrium interpretation of ageing dynamics. J. Phys. A, 33, 891 (2000).
- [172] F.Zamponi, G.Ruocco, and L.Angelani. Generalized fluctuation relation and effective temperatures in a driven fluid. cond-mat/0403579, (2004).
- [173] F. Ritort. Stimulated and spontaneous relaxation in glassy systems. cond-mat/0311370, (2003).
Table des publications
Publications dans des journaux de physique
[P1] G. Semerjian and L.F. Cugliandolo, Cluster expansions in dilute systems: Applications to satisfiability problems and spin glasses, Phys. Rev. E 64 , 036115 (2001).
[P2] G. Semerjian and L.F. Cugliandolo, Sparse random matrices: the eigenvalue spectrum revisited, J. Phys. A 35, 4837 (2002).
[P3] G. Semerjian and L.F. Cugliandolo, Dynamics of dilute disordered models: A solvable case, Europhys. Lett. 61, 247 (2003).
[P4] G. Semerjian and R. Monasson, Relaxation and metastability in a local search procedure for the random satisfiability problem, Phys. Rev. E 67, 066103 (2003).
[P5] G. Semerjian, L.F. Cugliandolo and A. Montanari, On the stochastic dynamics of disordered spin models, J. Stat. Phys 115, 493 (2004).
[P6] G. Semerjian and M. Weigt, Approximation schemes for the dynamics of diluted spin models: the Ising ferromagnet on a Bethe lattice, J. Phys. A 37, 5525 (2004).
Publications dans des actes de conférences d’informatique
[C1] G. Semerjian and R. Monasson, A Study of Pure Random Walk on Random Satisfiability Problems with « Physical » Methods, Proceedings of the SAT 2003 conference, E. Giunchiglia and A. Tacchella eds., Lecture Notes in Computer Science 2919, 120 (2004).
[C2] S. Cocco, R. Monasson, A. Montanari and G. Semerjian, Approximate analysis of search algorithms with « physical »methods, Computational Complexity and Statistical Physics, A. Percus, G. Istrate and C. Moore eds., Oxford, in press.
Résumé
Cette thèse est consacrée à l’étude des propriétés dynamiques des modèles dilués. Ces derniers sont des systèmes de physique statistique de type champ moyen, mais dont la connectivité locale est finie. Leur étude est notamment motivée par l’étroite analogie qui les relient aux problèmes d’optimisation combinatoire, la -satisfiabilité aléatoire par exemple.
On expose plusieurs approches analytiques visant à décrire le régime hors d’équilibre de ces systèmes, qu’il soit dû à une divergence des temps de relaxation dans une phase vitreuse, à l’absence de condition de balance détaillée pour un algorithme d’optimisation, ou à une préparation initiale dans une configuration loin de l’équilibre pour un ferromagnétique. Au cours de ces études on rencontrera également un problème de matrices aléatoires, et une généralisation du théorème de fluctuation-dissipation aux fonctions à temps.
Abstract
This thesis is devoted to the study of dynamical properties of diluted models. These are mean field statistical mechanics systems, but with finite local connectivity. Among other reasons, the interest for these models arises from their deep relationship with combinatorial optimization problems, random -satisfiability for instance.
Several analytical descriptions of their out of equilibrium regime are described. This regime can be due to long relaxation times in glassy phases, lack of detailed balance condition for optimization algorithms, or transient relaxation from an arbitrary initial condition for ferromagnets. In the course of these studies some attention will also be given to random matrix theory, and to a generalization of fluctuation-dissipation theorem for -times functions.