![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/ED_EDMH-h.jpg)
![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logoEvry.jpg)
![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logoLAMME.jpg)
THÈSE DE DOCTORAT
de
l’Université Paris-Saclay
École doctorale de mathématiques Hadamard (EDMH, ED 574)
Établissement d’inscription : Université d’Évry-Val d’Essonne
Laboratoire d’accueil :
Laboratoire de mathématiques et modélisation d’Évry, UMR 8071 CNRS-INRA
Spécialité de doctorat : Mathématiques appliquées
Oscar JARRÍN
Descriptions déterministes de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes
Date de soutenance : 20 Juin 2018
Après avis des rapporteurs : Isabelle GALLAGHER (Université-Diderot) Taoufik HMIDI (Université de Rennes 1)
Jury de soutenance :
Lorenzo BRANDOLESE
(Université Claude-Bernard-Lyon 1) Examinateur
Diego CHAMORRO
(Université d’Évry-Val d’Essonne) Codirecteur de thèse
Isabelle GALLAGHER
(Université-Diderot) Rapporteur
Pierre Gilles LEMARIÉ-RIEUSSET
(Université d’Évry-Val d’Essonne) Directeur de thèse
Roger LEWANDOWSKI
(Université de Rennes 1) Président de jury
![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/logo_fmjh.jpg) NNT : 2018SACLE010
NNT : 2018SACLE010
![]()
” Il était permis à un étudiant en mathématiques d’être incroyablement ignorant. C’était mon cas, et il m’en reste une grande naïveté dans beaucoup de domaines importants. Mais j’avais et j’ai conservé le goût de résoudre des problèmes ”
Jean-Pierre Kahane
Remerciements
Toute cette aventure pour venir en France et continuer ma formation scientifique a été pleine de personnes avec qui j’ai partagé de nombreux moments. Dans ces lignes je ne fais que les mentionner mais ces mots expriment un fort et sincère remerciement.
Je tiens tout d’abord à remercier mes directeurs de thèse, Diego Chamorro et Pierre-Gilles Lemarié-Rieusset, pour toutes ces années de travail et pour m’avoir initié à la recherche. Je les remercie non seulement pour leur qualité scientifique mais aussi pour leur qualité humaine. Je poursuis leur bon exemple de chercheurs sérieux en envisageant toujours des résultats de la plus haute qualité possible.
Je remercie également mes rapporteurs de thèse Mme. Isabelle Gallagher et M. Taoufik Hmidi qui m’ont fait le grand honneur de rapporter ce travail de recherche et pour les commentaires précieux qu’ils ont effectués. De la même façon, toute ma gratitude va à M. Lorenzo Brandolese et M. Roger Lewandowski pour avoir accepté de faire partie de mon jury de soutenance.
Je veux remercier les membres du Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Évry qui m’ont accompagné pendant ma thèse. Je remercie particulièrement Arnaud Gloter, directeur du laboratoire, et aussi les autres membres avec qui j’ai partagé de nombreux déjeuners très agréables: Stéphane Menozzi, Christophe Profeta, Abass Sagna et Vincent Torri.
Un grand remerciement à Valérie Picot, secrétaire du Laboratoire de Mathématiques d’Évry, pour sa grande efficacité et aussi pour sa grande gentillesse et bienveillance. Je remercie également El Maouloud Ould Baba, ingénieur informatique du laboratoire, pour toute son aide aux divers problèmes informatiques.
Je remercie aussi les autres doctorants du laboratoire: Igor, Mohammed et Chiara, en leur souhaitant une bonne continuation dans leurs travaux de recherche. Un grand remerciement à Kawther Mayoufi, avec qui nous avons partagé beaucoup d’expériences comme étudiants en thèse, les hautes et les basses de la recherche, ainsi que de nombreuses conférences partout en France.
Pendant ma dernière année de thèse j’ai fait aussi partie du département de mathématiques dans le cadre d’un poste d’ATER à l’Université-Dauphine . Je voudrais remercier également les membres de ce département, particulièrement Daniela Tonon et Alexandre Afgoustidis, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler en assurant leurs cours de travaux dirigés.
Por otro lado, quiero agradecer a las personas que han estado presentes en todo este camino. A Ricardo por su gran amistad y su ayuda en todo este tiempo. De igual manera a Yandira e Israel quienes me acompañaron durante los primeros años de tesis.
A Joan por estar siempre presente a pesar de la distancia y por toda la alegría que trajo en sus visitas a París.
A Elizabeth y María José por su amistad y su apoyo. En particular por la deliciosa comida ecuatoriana de Majo.
A Pedro, Randy y Ana Julia quienes han hecho que la fuerza ecuatoriana esté presente.
A todos ellos les deseo la más exitosa carrera profesional, esperando verlos pronto convertidos en colegas con los cuales podamos trabajar juntos por la escuela matemática ecuatoriana.
Agradezco igualmente a Marco Calahorrano y Juan Carlos Trujillo, profesores de la Escuela Politécnica Nacional, quienes me guiaron en los primeros años de estudio de la matemática.
En este punto no puedo dejar de agradecer a la Asociación AMARUN, gracias a la cual toda esta aventura de venir a Francia fue posible; y gracias a la cual tuve la oportunidad de desarrollar otras competencias tan importantes en el quéhacer de un investigador.
Agradezco también a los demás amigos y personas que me han acompañado de una manera u otra: Fernando, Jessi, Pato, Esteban y a mis primos Dany y Martín.
Finalmente, un gran agradecimiento a mi familia por toda su ayuda y apoyo incondicional. En particular a mi hermano y mis padres: la culminación de esta etapa es también el resultado de todos los esfuerzos cotidianos que hicieron por mi hermano y por mí.
Chapitre 1 L’étude déterministe de la loi de dissipation d’énergie
1.1 Introduction
Dans ce chapitre nous allons étudier d’un point de vue déterministe la loi de dissipation d’énergie proposée par la théorie de la turbulence de Kolmogorov également appelée “théorie K41”. Cette loi de dissipation d’énergie fut développée par A.N. Kolmogorov dans les articles [41], [42] et [43] et correspond à une étude expérimentale de la quantité d’énergie cinétique dissipée (sous forme de chaleur) dans un fluide qui se trouve en régime turbulent.
Étant donné que les équations de Navier-Stokes donnent un modèle mathématique pour étudier le comportement des fluides, le but de ce chapitre est d’étudier aussi rigoureusement que possible la loi de dissipation d’énergie dans le cadre des équations de Navier-Stokes déterministes que nous introduisons rapidement: nous nous intéressons donc à l’évolution au cours du temps d’un fluide, via l’étude de son champ de vitesse en tout point de l’espace et à chaque instant. Nous supposons que le fluide est de densité constante (sa masse volumique est constante), qu’il est incompressible (l’espace occupé par une certaine quantité de fluide à chaque instant peut changer de forme, mais pas de volume), et l’on supposera qu’il est visqueux. Les équations qui décrivent un tel fluide sont les équations de Navier-Stokes qui s’écrivent de la façon suivante:
| (1.1) |
Dans ce système d’équations aux dérivées partielles non linéaires, la fonction vectorielle représente le champ de vitesse du fluide tandis que la fonction scalaire représente sa pression, ces deux fonctions et sont les inconnues, tandis que la constante de densité du fluide (qui représente sa masse volumique et qui est constante pour les fluides incompressibles), la constante de viscosité dynamique du fluide (qui caractérise la résistance à l’écoulement d’un fluide incompressible), la fonction vectorielle (qui correspond à l’ensemble des forces extérieures agissant sur le fluide) et la fonction vectorielle (qui représente la donnée initiale) sont les données du problème. L’équation et représente la condition d’incompressibilité du fluide au cours du temps.
Observons maintenant que comme nous avons supposé que le fluide est de densité constante alors nous pouvons diviser les équations ci-dessus par la constante de densité et en écrivant maintenant la force , qui correspond à la densité massique des forces agissant sur le fluide; la pression cinétique et la constante de viscosité cinétique du fluide , qui est le quotient entre la viscosité dynamique et la masse volumique et qui représente la capacité de cohésion entre les particules du fluide; nous obtenons ainsi le système de Navier-Stokes avec lequel l’on travaillera tout au long de cette thèse:
| (1.2) |
À ce stade, il convient de préciser que nous avons tout d’abord présenté le système de Navier-Stokes (1.1) car dans la Section 1.1.1 nous aurons besoin de revenir à ce système pour introduire quelques quantités physiques associées à ces équations. Néanmoins, la densité étant toujours constante nous avons alors que les équations (1.1) sont équivalentes aux équations (1.2) et donc nous continuerons notre exposé en considérant ces dernières équations.
L’existence des solutions faibles globales en temps du problème de Cauchy (1.2) est un résultat classique qui a été développé par J. Leray en [51]: pour une donnée initiale et une force extérieure, les solutions faibles du problème (1.2) vérifient:
et de plus elles vérifient certaines propriétés fondamentales comme par exemple l’inégalité d’énergie: pour tout , on a
cette inégalité sera un outil qui sera largement utilisé par la suite.
Pour étudier la loi de dissipation d’énergie de Kolmogorov dans le modèle déterministe des équations de Navier-Stokes, nous allons considérer les solutions faibles de Leray de ces équations car, comme nous expliquerons plus en détail dans la Section 1.1.1 ci-dessous, nous aurons besoin de travailler avec des solutions globales en temps.
Une fois que nous avons introduit rapidement les équations de Navier-Stokes, nous nous concentrons maintenant sur la loi de dissipation d’énergie proposée par la théorie K41 et pour énoncer cette loi, tout d’abord, nous avons besoin de faire une courte introduction sur l’idée phénoménologique sous-jacente.
Le but de la théorie K41 est de décrire le comportement du champ de vitesse dans un certain intervalle de temps et aux échelles de longueur où le fluide se trouve dans un état de turbulence pleine. Indiquons rapidement que les différentes échelles de longueur qui interviennent dans l’étude de la turbulence seront expliquées par le biais du modèle de cascade d’énergie et nous y reviendrons plus tard.
Maintenant il convient de faire une discussion importante sur l’intervalle du temps où l’on s’attend à étudier la turbulence.
À partir d’une donnée initiale qui représente le champs de vitesse à l’instant et d’une force nous nous intéressons à étudier l’évolution du fluide au cours du temps au moyen de son champ de vitesse qui est une solution de Leray des équations de Navier-Stokes. Nous allons supposer que la force agit suffisamment fort sur le fluide de sorte qu’à partir d’un certain temps le fluide est en état de turbulence pleine. De plus, si nous supposons que cette force vérifie alors on sait que la solution de Leray vérifie
(voir le livre [46], Corollaire page 357 pour une preuve de ce résultat) et alors nous observons qu’à partir d’un certain temps le fluide quitte son état de turbulence pleine; et donc nous sommes censés étudier la turbulence dans l’intervalle de temps .
Néanmoins, il n’est pas totalement trivial de donner une estimation précise de cet intervalle et dans l’état actuel de nos connaissances cette question n’a pas de réponse satisfaisante, que ce soit du point de vue mathématique ou du point de vue physique (voir les articles [25] et [73]). Nous pouvons alors remarquer que l’étude déterministe de la turbulence dans le cadre d’une force extérieure qui dépend de la variable temporelle est un problème très compliqué car nous sommes obligés de trouver un certain intervalle où l’on puisse assurer que le fluide est en turbulence pleine. Ce problème ne sera donc pas considéré ici et de cette façon nous considérons dorénavant une force extérieure stationnaire.
Cette condition d’une force stationnaire pour l’étude déterministe de la turbulence est largement considérée dans la littérature (voir par exemple l’article [14] de S. Childress, les notes du cours [16] de P. Constantin, les articles [22, 24, 23] de F. Foias, R. Temam et al., ainsi que le livre [26] de ces derniers auteurs) et se base sur l’idée suivante: comme est une fonction qui ne dépend que de la variable d’espace alors cette force agit sur le fluide de façon indépendante du temps et donc une fois que le fluide est en régime turbulent nous pouvons supposer que ce fluide restera dans ce régime turbulent au cours du temps. Dans le monde réel nous pouvons observer aussi des fluides qui sont constamment en état turbulent: si l’on regarde, par exemple, une cascade d’eau de grande hauteur alors on observe que l’eau qui tombe par cette cascade est toujours en état turbulent.
Ainsi, la force étant une fonction stationnaire nous allons alors faire une étude déterministe de la théorie K41 dans le régime asymptotique lorsque le temps tend vers l’infini et ce régime asymptotique sera caractérisé par des moyennes en temps long sur le champ de vitesse du fluide (voir la Définition 1.1.3, page 1.1.3 pour une définition précise). Ce régime en temps long nous permettra donc d’étudier la théorie K41 en prenant en compte seulement les différentes échelles de longueur où le fluide se trouve en état turbulent.
Expliquons maintenant comment la turbulence peut être visualisée lorsqu’on regarde ces échelles de longueur. Cette théorie se base sur le modèle de cascade d’énergie, introduite par L. F. Richardson en dans son livre [65] et formalisée par A.N. Kolmogorov dans son article [41] en , qui postule que si l’énergie cinétique est introduite dans le fluide par l’action d’une force extérieure , alors, dans un régime turbulent le mécanisme de dissipation d’énergie sous forme de chaleur (dû aux forces de viscosité du fluide) n’est pas effectif et l’action de l’énergie cinétique est expliquée par une “cascade d’énergie”.
Cette cascade d’énergie explique tout simplement que les grands tourbillons se cassent en des tourbillons plus petits. Soyons un peu plus précis: si la force extérieure agit (ou se fait ressentir) à une échelle , échelle qui sera nommée “l’échelle d’injection d’énergie” et si est le taux d’injection d’énergie (qui provient de divers facteurs) à l’échelle , alors l’énergie cinétique, introduite à cette échelle au taux , est transférée aux échelles de longueur plus petites (avec ) à un certain taux .
Ainsi, cette cascade d’énergie continue jusqu’à l’échelle de longueur , nommée l’échelle de dissipation de Kolmogorov (voir l’expression (1.4) pour une définition plus précise) et à cette échelle l’énergie cinétique provenant de l’échelle de longueur supérieure (avec ) est finalement dissipée sous forme de chaleur (au taux ) par l’action directe des forces de viscosité du fluide.
Cette cascade d’énergie a lieu pour les échelles de longueur qui appartiennent à l’intervalle , nommé l’intervalle d’inertie, et pour faire une exposition plus complète du modèle cascade d’énergie nous nous concentrons sur les échelles et qui définissent cet intervalle d’inertie.
Nous avons déjà mentionné que l’échelle d’injection d’énergie est l’échelle de longueur à laquelle la force extérieure introduit l’énergie cinétique dans le fluide. On peut penser, par exemple, à un agitateur de taille qui en agitant un fluide visqueux et incompressible lui communique constamment de l’énergie cinétique. Cette échelle est un paramètre du modèle qui sera donc fixé par la force .
Une fois que l’énergie est injectée à l’échelle , cette énergie est transférée par les forces d’inertie du fluide vers des échelles de plus en plus petites et ce processus s’arrête lorsqu’on arrive à l’échelle qui est suffisamment petite () pour que l’énergie y soit dissipée sous forme de chaleur. Dans sa théorie K41, Kolmogorov introduit l’idée que cette échelle ne dépend que du taux de dissipation d’énergie et de la constante de viscosité du fluide et Kolmogorov suggère de définir l’échelle de dissipation d’énergie par la relation
| (1.3) |
où l’on cherche a déterminer les exposants qui ne dépendent pas du fluide (voir les articles [41], [42] et [43] ou le livre [53] pour une discussion à ce sujet et pour plus de détails).
De cette façon, pour déterminer les exposants ci-dessus, Kolmogorov réalise une analyse des dimensions physiques: en effet, observons tout d’abord que le taux de dissipation a une dimension physique . En effet, si est la vitesse “caractéristique” du fluide, qui représente la vitesse moyenne du mouvement (voir la Définition 1.1.3, page 1.1.3), nous savons que la quantité est la quantité moyenne d’énergie cinétique du fluide (voir les livres [37] et [53]) et comme la vitesse caractéristique a une une dimension physique alors la quantité moyenne d’énergie a une dimension physique . Ensuite, étant donné que le taux de dissipation d’énergie mesure la variation de l’énergie cinétique par rapport au temps (voir toujours les livres [37] et [53]) nous savons que a une dimension physique et comme l’énergie est mesurée en nous obtenons ainsi que a une dimension . D’autre part la constante de viscosité caractérise la résistance du milieu à un écoulement écoulement uniforme et cette constante a une dimension physique (voir le livre [53] pour plus de détails).
Ainsi, le terme à droite de (1.3) a une dimension physique , mais, comme ce terme doit avoir une dimension de alors il faut que l’on ait les identités et d’où nous avons et . De cette façon, en remplaçant ces valeurs de et dans (1.3), Kolmogorov a obtenu que l’échelle de dissipation est donnée par
| (1.4) |
Nous observons que cette échelle n’est pas un paramètre du modèle (contrairement à l’échelle d’injection d’énergie ) car dépend de la quantité qui elle même dépend finalement de la solution des équations (1.2) (voir toujours la Définition 1.1.3).
Une fois que nous avons introduit le modèle de cascade d’énergie qui est valable dans l’intervalle nous pouvons maintenant présenter la loi de dissipation d’énergie de Kolmogorov dont le domaine de validité est donné par ce même intervalle. Ainsi, conformément au modèle de cascade d’énergie, nous savons que l’énergie cinétique introduite dans le fluide à l’échelle est transférée à un taux par les forces inertielles du fluide jusqu’à l’échelle .
Le but de la loi de dissipation d’énergie est de donner une expression quantitative du taux auquel cette énergie cinétique est alors dissipée par les force visqueuses.
Pour cela, tout d’abord, nous avons besoin de caractériser l’état turbulent de ce fluide et nous allons introduire rapidement les nombres de Reynolds (voir la page 1.1.3, pour une exposition plus complète sur ces nombres). Pour la vitesse caractéristique du fluide, sa constante de viscosité et l’échelle d’injection d’énergie, le nombre de Reynolds peut être défini par la relation
| (1.5) |
et ce nombre mesure l’importance relative des forces inertielles qui transfèrent l’énergie cinétique (représentées par le numérateur ) sur les forces visqueuses qui dissipent cette énergie (qui sont représentées par le dénominateur ). Ainsi, l’état turbulent du fluide est caractérisé lorsque
ce qui représente le fait que les forces inertielles sont beaucoup plus fortes que les effets visqueux et alors la cascade d’énergie décrite ci-dessus a lieu.
Dans ce régime turbulent des grandes valeurs du nombre de Reynolds, on peut observer de façon expérimentale (voir par exemple les expériences physiques [34] et [71]) que le taux d’injection d’énergie à l’échelle est du même ordre de grandeur que le taux de transfert et est aussi du même ordre de grandeur que le taux de dissipation d’énergie à l’échelle , c’est à dire, nous avons
et alors, comme on veut donner une expression quantitative de , grâce à cette estimation111Il convient de préciser la notation . Pour nous dirons que le nombre est du même ordre de grandeur que le nombre s’il existent deux constates , qui ne dépendent d’aucun paramètre physique telles que . Lorsque les nombres et sont du même ordre de grandeur nous écrirons . il est équivalent de donner une expression quantitative de .
Ainsi, pour estimer Kolmogorov considère les trois paramètres physiques suivants: l’échelle d’injection d’énergie , la vitesse caractéristique du fluide et la constante de viscosité du fluide .
Étant donné qu’on se trouve dans le régime turbulent caractérisé par , alors les forces visqueuses du fluide sont négligeables par rapport aux forces inertielles, ce qui amène Kolmogorov à faire l’hypothèse suivante: le taux d’injection d’énergie est indépendant de la constante de viscosité .
En supposant cette hypothèse, Kolmogorov introduit l’idée que le taux doit alors s’exprimer seulement en fonction des paramètres et , ce qui l’amène à écrire l’estimation . Pour déterminer les exposants , en procédant par une analyse des dimensions physiques de la même façon que l’on a fait pour obtenir l’échelle donnée dans (1.4) on obtient .
De cette façon, comme on a (expérimentalement) , on obtient alors l’estimation du taux de dissipation d’énergie .
Finalement, pour simplifier la notation, nous allons écrire dorénavant le taux de dissipation d’énergie comme et ainsi nous énonçons la loi de dissipation de Kolmogorov pour des fluides en état turbulent:
(1.6)
Nous rappelons que notre but est l’étude déterministe de cette loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) pour un fluide visqueux et incompressible modélisé mathématiquement par les équations de Navier-Stokes (1.2) dans l’espace tout entier.
Néanmoins, pour mieux comprendre les enjeux de cette théorie, dans la section qui suit nous analyserons le cadre d’un fluide périodique en variable d’espace. Le passage par un cadre périodique nous permettra, tout d’abord, de faire une courte introduction de l’état actuel des connaissances sur l’étude de la loi (1.6) et ensuite de mettre en perspective quelques difficultés lorsqu’on considère un fluide non périodique dans tout l’espace comme nous le verrons à la fin de cette introduction.
1.1.1 Le cadre d’un fluide périodique
Nous considérons donc une longueur (qui sera la période) et les équations de Navier-Stokes périodiques sur le cube :
| (1.7) |
où le champ de vitesse , la pression sont toujours les inconnues, est la donnée initiale, périodique et à divergence nulle et finalement nous considérons une force extérieure périodique, à divergence nulle et stationnaire, c’est à dire, nous avons .
Ainsi, pour une force et une donnée initiale telles que
| (1.8) |
nous considérons les solutions de Leray (globales en temps) des équations périodiques (1.7):
où la condition (1.8) nous permet de construire des solutions qui satisfont, pour tout temps ,
| (1.9) |
et de cette propriété de moment nul nous pouvons en tirer l’inégalité de Poincaré: pour une constante qui dépend de la période on a l’estimation
| (1.10) |
qui nous sera fondamentale par la suite (voir les livres [6] et [26] pour une preuve de cette inégalité).
Ces solutions vérifient en plus les propriétés suivantes:
-
(i)
pour tout temps , est périodique sur le cube ,
-
(ii)
pour tout temps on a l’inégalité d’énergie
(1.11)
Pour l’existence de ces solutions voir les livres [17] et [26] de C. Foias et al., le mémoire [51] de J. Leray ainsi que le livre [70] de R. Temam et al.
Finalement, observons que ces solutions appartiennent à l’espace où nous remarquons que
le fait que ces solutions soient globalement bornées en temps provient de l’inégalité d’énergie ci-dessus et de l’inégalité de Poincaré (1.10), tandis que, le fait que ces solutions soient localement carré intégrables en temps () provient de l’hypothèse d’une force extérieure stationnaire.
1) Des quantités physiques associées au fluide
Maintenant, en suivant les articles [22], [25] et le livre [26] de F. Foias, R. Temam et al., (voir aussi les articles [44], [60]) nous allons introduire certaines quantités physiques qui sont nécessaires pour l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) dans ce cadre périodique.
-
La longueur caractéristique du fluide et l’échelle d’injection d’énergie.
En mécanique des fluides, la longueur caractéristique du fluide est la taille de l’écoulement considéré où nous allons étudier son comportement turbulent. Par exemple, si nous considérons un fluide dans un tuyau de diamètre , alors la longueur caractéristique de ce fluide correspond naturellement au diamètre .
Lorsqu’on considère un modèle plus artificiel d’un cadre périodique sur le cube nous avons aussi une définition naturelle de la longueur caractéristique du fluide:Définition 1.1.1 (Longueur caractéristique)
Dans le cadre périodique nous définissons la longueur caractéristique comme la période .
Dans ce cadre périodique nous voulons étudier le comportement turbulent d’un fluide dans un cube et en revenant au modèle de cascade d’énergie nous savons que pour obtenir un comportement turbulent il faut qu’une force extérieure agite ce fluide. L’action de la force sur le fluide est effectuée à une échelle de longueur et nous avons
Définition 1.1.2 (Échelle d’injection d’énergie)
Nous définissons l’échelle d’injection d’énergie comme l’échelle de longueur à laquelle la force agit sur le fluide.
Comme nous avons déjà mentionné dans l’introduction nous pouvons penser, par exemple, à un agitateur de taille qui communique constamment de l’énergie cinétique au fluide.
Une fois que nous avons défini l’échelle d’injection d’énergie nous voulons donc savoir quelle est la relation entre cette échelle et la longueur caractéristique donnée dans la Définition 1.1.1. Ainsi, étant donné que le fluide se trouve dans un cube alors il est naturel de supposer que la force agit sur le fluide à l’intérieur de ce cube, ce qui nous amène à supposer que(1.12) -
La vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie .
L’objectif ici est de donner une définition rigoureuse des quantités , qui correspond à la vitesse caractéristique du fluide, et qui est le taux de dissipation d’énergie. Ainsi, pour une solution des équations (1.7) et la longueur caractéristique du fluide donnée par la Définition 1.1.1, nous définissons les quantités(1.13) et
(1.14) qui correspondent à l’énergie cinétique du fluide et au taux de dissipation d’énergie à l’instant respectivement. En effet, si nous supposons pour l’instant que la solution ci-dessus est assez régulière, de sorte que l’inégalité d’énergie (1.11) devient une égalité (voir le livre [6]), et si nous considérons pour simplifier une force nulle, alors, nous pouvons écrire l’identité
ce qui justifie le nom de “taux de dissipation d’énergie” pour la quantité .
Nous observons maintenant que les quantités associées au champ de vitesse, données par les formules (1.13) et (1.14) ci-dessus dépendent de chaque instant du temps et dans des expériences physiques ces quantités fluctuent fortement (voir les articles [34, 71, 74]). Néanmoins, d’après la théorie K41 les moyennes en temps de ces quantités sont censées présenter un comportement universel et afin de capturer ce comportement nous considérons les moyennes en temps de la façon suivante: tout d’abord pour un temps , dans les expressions (1.15) et (1.16) ci-dessus nous considérons ses moyennes sur l’intervalle de temps :et
Ensuite, rappelons que nous considérons une force extérieure stationnaire, alors agit sur le fluide en introduisant l’énergie cinétique indépendamment du temps et donc, une fois que le fluide est en régime turbulent nous allons supposer qu’il restera dans cet état au cours du temps. Pour cette raison, nous allons étudier le comportement des quantités ci-dessus dans le régime asymptotique lorsque et nous considérons ainsi les moyennes en temps suivantes:
(1.15) et
(1.16) où sera l’énergie cinétique moyenne du fluide et est le taux moyen de dissipation ( ou plus simplement le taux de dissipation.
Cette moyenne en temps, , également appelée moyenne en temps long, est très utilisée dans la littérature pour l’étude déterministe de la turbulence (voir les articles [22], [25] [44], [60] et le livre [26]).Remarque 1.1
Observons que comme nous allons considérer cette moyenne en temps long alors nous avons besoin de considérer des solutions de Leray des équations (1.7) qui sont globales en temps.
Il est nécessaire maintenant de justifier rigoureusement que les quantités (1.15) et (1.16) ont bien un sens mathématique, c’est à dire, pour une solution de Leray quelconque des équations (1.7), nous voulons nous assurer que l’on a bien et . Nous avons donc la proposition suivante.
Proposition 1.1.1
Soit la période , soient une force donnée et une donnée initiale. Soit une solution de Leray des équations (1.7) associée aux données . Alors:
-
1)
et
-
2)
Preuve.
-
1)
Soit . Dans l’inégalité l’inégalité d’énergie (1.11) nous prenons l’intégrale sur l’intervalle de temps et nous obtenons
d’où, comme est une quantité positive nous pouvons écrire
(1.17) et nous allons maintenant étudier le terme . Par l’inégalité de Poincaré (1.10) nous écrivons , d’où en intégrant en temps et en multipliant par nous avons la minoration
Ainsi, en remplaçant cette minoration dans le terme à gauche de l’estimation (1.17) nous pouvons écrire
Ensuite, nous divisons chaque terme de cette estimation par , puis nous appliquons l’inégalité de Cauchy-Schwarz et les inégalités de Young dans le deuxième terme à droite ci-dessus et nous obtenons alors
Nous prenons maintenant la limite et nous avons l’estimation
(1.18) Finalement, nous divisons chaque terme de cette estimation par pour récupérer ainsi la vitesse caractéristique et nous avons .
-
2)
Comme et , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz (en variable d’espace) nous écrivons
d’où, par les inégalités de Young et comme est une fonction stationnaire nous obtenons
Maintenant, en remplaçant cette inégalité dans le deuxième terme à droite de (1.17) nous pouvons écrire
d’où nous obtenons
et alors en divisant par et en prenant la limite nous pouvons écrire
ce qui termine la preuve de la proposition.
Remarque 1.2
Observons que la preuve du point de la Proposition 1.1.1 est basée sur l’inégalité d’énergie (1.11) vérifiée par le champ de vitesse et sur l’inégalité de Poincaré (1.10) qui est valable dans ce cadre périodique. D’autre part, la preuve du point de la Proposition 1.1.1 repose uniquement sur l’inégalité d’énergie (1.11).
Ainsi nous avons
Définition 1.1.3
Dans le cadre de la Proposition 1.1.1 ci-dessus, où nous avons montré que les quantités et ci-dessous sont bien définies, nous définissons les quantités moyennes:
-
1)
La vitesse caractéristique du fluide: .
-
2)
Le taux de dissipation d’énergie: .
-
1)
-
Les nombres de Reynolds.
Plusieurs nombres sans dimensions permettent de caractériser le comportement de l’écoulement des fluides (voir le livre [6]) et ici nous allons nous intéresser au nombre de Reynolds qui caractérise le régime laminaire ou turbulent d’un fluide comme nous l’expliquerons dans cette section.
Ainsi, pour introduire le nombre de Reynolds nous avons besoin de considérer les équations de Navier-Stokes (1.1) que nous avons introduit dans l’introduction de ce chapitre:où est la constante de densité du fluide et est la constante de viscosité dynamique du fluide.
Dans le cadre de ces équations, le nombre de Reynolds a été mis en évidence par Osborne Reynolds dans l’année 1883 [53] et mesure le rapport entre l’ordre de grandeur du terme de transport et l’ordre de grandeur du terme de viscosité . Nous allons voir que le nombre de Reynolds apparaît naturellement dans les équations de Navier-Stokes ci-dessus.
En effet, pour la longueur caractéristique du fluide dans le sens de la Définition 1.1.1 et la vitesse caractéristique du fluide donnée par la Définition 1.1.3, nous définissons les variables et opérateurs adimensionnels suivants(1.19) et alors les équations de Navier-Stokes ci-dessus se réécrivent, après simplification par le facteur , comme
Le nombre de Reynolds est alors défini comme l’inverse de la constante qui se trouve devant le terme de viscosité, c’est à dire: , mais comme la constante de viscosité dynamique est définie par (où est la constante de viscosité cinétique) nous avons l’identité et donc nous avons
Définition 1.1.4
Le nombre de Reynolds est défini par
(1.20) Ce nombre sert à caractériser la nature du régime du mouvement du fluide: laminaire ou turbulent. En effet, le régime laminaire est caractérisé par les faibles valeurs du nombre , où les forces visqueuses sont dominantes: deux particules du fluide qui étaient voisines à un instant donné resteront voisines à l’instant suivant et les couches du fluide maintiennent leur cohésion au cours du temps. Par contre, si le fluide est en régime turbulent alors on s’attend avoir des valeurs élevées du nombre (voir les résultats expérimentaux dans les articles [34], [74] et le livre [53]) ce qui exprime le fait que le fluide est dominé par les force d’inertie, qui tendent à produire des tourbillons chaotiques et autres instabilités: les particules qui étaient voisines à un instant donné ne seront plus voisines à l’instant suivant. Voir la Figure 1.1 ci-dessous pour une image d’une expérience physique des régimes laminaire et turbulent correspondant à différentes valeurs du nombre de Reynolds.
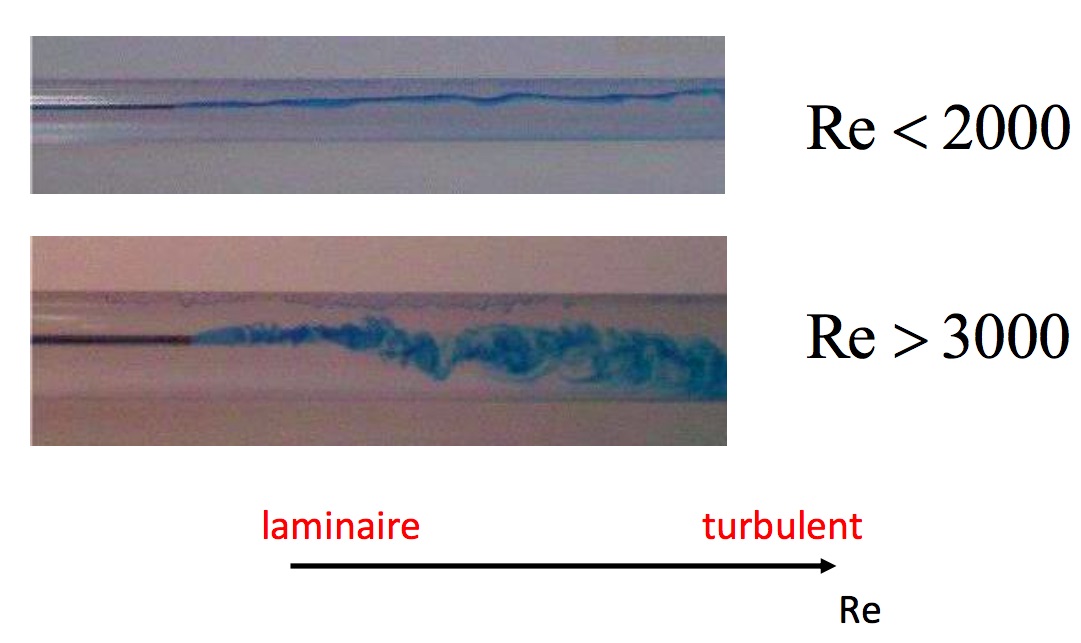
Figure 1.1: Expérience réalisée par N.H. Johannesen et C. Lowen avec de l’eau colorée introduite dans un tube, [72]. Dans cette expérience, pour faire varier le nombre de Reynolds , où la longueur caractéristique correspond au diamètre du tube et la constate de viscosité de l’eau est fixé par , la vitesse caractéristique du fluide est incrémentée par un agitateur extérieur. Une fois que nous avons définit le nombre de Reynolds ci-dessus, il convient de faire les remarques suivantes.
Remarque 1.3
-
La définition du nombre de Reynolds n’est pas universelle dans le sens qu’elle dépend directement des définitions de la vitesse caractéristique du fluide et de la longueur . En effet, si dans la formule (1.19) nous considérons une autre définition de vitesse caractéristique et une autre définition de longueur alors par la formule (1.20) nous obtenons le nombre de Reynolds donné par .
-
Dans le cadre du point ci-dessus, observons que pour définir le nombre de Reynolds dans (1.20) on a utilisé la longueur caractéristique tandis que pour définir le nombre de Reynolds (1.5) dans l’introduction de ce chapitre, l’échelle d’injection d’énergie a été utilisée. Ce choix entre la longueur ou l’échelle n’empêche pas que le régime turbulent soit caractérisé par des grandes valeurs du nombre de Reynolds car, étant donné que les quantités et sont fixes alors pour obtenir des grandes valeurs du nombre c’est la vitesse caractéristique qui doit incrémenter.
-
Comme la vitesse caractéristique du fluide est définie à partir de la solution des équations (1.7) alors le nombre de Reynolds dépend de cette solution et pour cette raison ce nombre nous fourni une caractérisation a posteriori du régime du fluide, qu’il soit laminaire ou turbulent.
Revenons maintenant à la loi de dissipation d’énergie (1.6) proposée par la théorie K41.
Nous savons que la loi de dissipation d’énergie (1.6) que nous souhaitons établir rigoureusement propose un encadrement du taux de dissipation d’énergie lorsque le fluide est en régime turbulent.
Nous venons de voir également que ce régime turbulent est caractérisé par des grands nombres de Reynolds; ce qui nous donne alors un cadre de travail assez naturel et nous supposerons souvent que .
2) La loi de dissipation d’énergie dans le cadre périodique
Maintenant que nous avons les ingrédients nécessaires nous pouvons énoncer la loi de dissipation d’énergie.
Pour une solution de Leray des équations de Navier-Stokes périodiques (1.7) sur le cube , on considère la vitesse caractéristique et le taux de dissipation données par la Définition 1.1.3. La longueur caractéristique du fluide est donnée par la Définition 1.1.1 et ainsi avec ces objets nous pouvons considérer le nombre de Reynolds .
Donc, pour une échelle d’injection d’énergie donnée par la Définition 1.1.2, l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.6) donnée page 1.6 nous ramène à établir l’encadrement du taux de dissipation suivant:
| (1.21) |
où , sont des constantes indépendantes du nombre de Reynolds .
Pour ce cadre périodique, lorsqu’on considère une échelle d’injection d’énergie égale à la longueur caractéristique du fluide (c’est à dire ) il est alors possible de démontrer la majoration du taux de dissipation
| (1.22) |
qui est obtenue dans différents contextes techniques où est une constante convenable qui reste bornée même dans le régime asymptotique lorsque le nombre de Reynolds est assez grand (voir l’article [14] de S. Childress, les articles [24], [25], [23] et le livre [26] de C. Foias, R. Temam et. al. ainsi que les articles [44] de W. Layton et [73] de F. Vigneron).
D’autre part, dans l’article [22] de C. Foias, on considère un cadre plus général où l’échelle d’injection d’énergie n’est pas forcément égale à la longueur caractéristique du fluide . En effet, dans cet article la quantité est définie par , avec un paramètre entier positif. De plus, en considérant une force extérieure particulière , il est encore possible d’obtenir la majoration
| (1.23) |
avec une constante qui ne dépend pas des paramètres et .
Si nous comparons cette majoration ci-dessus du taux de dissipation d’énergie avec la majoration donnée dans (1.22) nous pouvons observer que cette majoration est plus proche de la loi de dissipation d’énergie (1.21) car elle fait intervenir une échelle d’injection d’énergie qui n’est pas forcément du même ordre que la longueur caractéristique du fluide .
Maintenant, quant à la minoration du taux de dissipation
cette estimation reste encore un problème ouvert que l’on sait pas résoudre, même dans le cadre périodique. En effet, les majorations du taux de dissipation d’énergie (1.22) et (1.23) reposent essentiellement sur l’inégalité d’énergie vérifiée par les solutions de Leray des équations de Navier-Stokes, mais, dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne savons pas comment utiliser cette inégalité d’énergie pour étudier la minoration du taux de dissipation d’énergie ci-dessus.
1.1.2 Le cadre non périodique
Maintenant nous retournons au cadre d’un fluide non périodique posé dans l’espace tout entier. Notre modèle déterministe pour étudier la loi de dissipation d’énergie est alors donné par les équations de Navier-Stokes posées sur l’espace :
| (1.24) |
où, en suivant les idées exposées dans la section précédente, dans les équations ci-dessus nous considérons une force extérieure, stationnaire et à divergence nulle telle que . Ainsi, si on considère les équations ci-dessus nous avons que les solutions de Leray vérifient
c’est à dire, ces solutions sont localement bornées temps et localement de carré intégrables en temps (voir le livre [46] pour les détails).
Une fois que nous avons rapidement introduit les équations de Navier-Stokes (1.24) sur tout l’espace , nous voulons maintenant établir de façon rigoureuse l’encadrement (1.21) et il est important de souligner qu’il y a très peu de références à ce sujet. Une idée suggérée dans les notes de cours [16] de P. Constantin est la suivante.
Tout d’abord, on considère une échelle d’injection d’énergie donnée par la Définition 1.1.2 page 1.1.2 et en s’inspirant de la Définition 1.1.3 page 1.1.3, pour une solution de Leray des équations (1.24) on considère la vitesse caractéristique et le taux de dissipation par les expressions:
| (1.25) |
Ainsi, pour étudier l’encadrement du taux de dissipation donné dans (1.21) il nous manque un ingrédient et nous avons besoin de définir une longueur (que ce soit comme dans (1.21) où comme dans (1.22)) et ceci pose un certain nombre de problèmes.
En effet, rappelons tout d’abord que dans le cadre d’un fluide périodique sur le cube nous avons vu dans la Définition 1.1.1 que la
longueur caractéristique du fluide est donnée de façon naturelle par la période , mais, comme nous considérons maintenant un fluide posé sur l’espace tout entier, alors on perd toute notion physique et mathématique de cette longueur caractéristique et la définition adéquate de cette longueur est une question qui n’est pas évidente à répondre.
Dans ce contexte, comme la force extérieure est une donnée du modèle d’un fluide non périodique, toujours dans [16] il est suggéré de considérer une longueur caractéristique en fonction de la force extérieure de la façon suivante: tout d’abord, pour l’échelle d’injection d’énergie nous supposons que la transformée de Fourier de la force extérieure est localisé aux fréquences . Cette hypothèse sur la force extérieure représente le fait que, selon le modèle de cascade d’énergie, l’énergie cinétique est introduite dans le fluide par la force extérieure aux échelles de longueur de l’ordre de et donc aux fréquences de l’ordre de .
Ensuite, nous définissons la moyenne en norme de la force par la quantité
| (1.26) |
et, toujours en suivant [16], la longueur est définie comme
| (1.27) |
La signification physique de la longueur caractéristique n’est pas totalement claire mais cette longueur apparaît dans les calculs faits dans [16] et de cette façon, le but de P. Constantin dans ses notes est de montrer que si l’on considère un fluide posé dans tout l’espace alors, pour le taux de dissipation , pour la vitesse caractéristique (donnés dans (1.25)) et pour cette longueur caractéristique ci-dessus, on peut obtenir l’estimation du taux de dissipation suivante:
| (1.28) |
où nous observons que, dans le régime asymptotique des nombres de Reynolds suffisamment grands, on peut alors obtenir l’estimation du taux de dissipation ce qui généralise au cadre l’estimation (1.22), page 1.22, obtenue dans le cadre périodique.
Néanmoins, l’estimation (1.28) ci-dessus présente quelques lacunes d’un point de vue mathématique et met en évidence quelques contraintes techniques lorsqu’on considère un fluide posé sur tout l’espace . Dans la section qui suit nous expliquons plus en détail ces contraintes techniques.
1.1.3 Problèmes dans le cadre non périodique
1) Une vitesse caractéristique potentiellement mal posée.
La première contrainte technique relative à l’estimation (1.28) porte sur les solutions de Leray des équations (1.24). En effet, pour une solution de Leray quelconque nous devons considérer les quantités moyennes suivantes
où est l’échelle d’injection d’énergie. Néanmoins (en toute généralité) nous ne pouvons pas assurer que la vitesse caractéristique ci-dessus est une quantité bien définie. En effet, nous allons nous concentrer sur la moyenne en temps long qui apparaît dans la vitesse caractéristique :
| (1.29) |
où nous observons que l’on a l’identité
| (1.30) |
et nous allons maintenant observer que cette moyenne en temps long est potentiellement mal posée. En effet, si nous écrivons l’inégalité d’énergie vérifiée par la solution :
| (1.31) |
où, pour le dernier terme à droite de cette inégalité, comme et , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous pouvons écrire
et de plus, comme est une fonction stationnaire, par les inégalités de Young nous avons
De cette façon, en remplaçant cette estimation dans l’inégalité d’énergie (1.31) nous obtenons
d’où nous pouvons en tirer le contrôle en temps suivant pour la quantité :
| (1.32) |
mais, lorsqu’on applique la moyenne en temps long à cette inégalité nous avons
| (1.33) | |||||
et nous ne connaissons pas un meilleur contrôle en temps du type (1.32) de la quantité pour assurer que l’on a bien .
D’autre part, nous ne savons pas non plus si la quantité donnée dans (1.33) diverge: dans l’état actuel de nos connaissances nous ne savons pas construire des solutions de Leray particulières telles qu’elles aient, par exemple, le comportement suivant
| (1.34) |
où nous pouvons observer que si l’on prend la moyenne en temps long alors nous obtenons
et donc on pourrait en conclure que la moyenne en temps long est effectivement mal posée lorsqu’on considère un fluide dans tout .
Un des premiers résultats de cette thèse sera de donner un sens mathématique rigoureux à cette quantité et cet objectif sera atteint en utilisant un modèle particulier des équations de Navier-Stokes dans la Section 1.2 ci-dessous.
2) Une longueur caractéristique mal posée
Passons maintenant à la deuxième contrainte technique dans l’estimation (1.28) qui porte sur la définition de la longueur caractéristique donnée par l’expression (1.27). Afin d’expliquer de façon plus claire cette contrainte, nous reprenons les grandes lignes des calculs faits dans [16]. En effet, la preuve de l’estimation (1.28) repose sur l’inégalité
| (1.35) |
où la force moyenne est donnée dans l’expression (1.26), la vitesse caractéristique est donnée dans l’expression (1.30), et le taux de dissipation est donné par la formule (1.25). Pour prouver l’inégalité (1.35) ci-dessus, dans [16], on considère les équations de Navier-Stokes
où est une solution de Leray et est une force extérieure régulière, stationnaire, à divergence nulle et telle que pour une échelle d’injection d’énergie. On multiplie alors ces équations par puis on intègre en variable d’espace:
et on cherche à faire apparaître les termes et qui interviennent dans l’inégalité (1.35). Dans l’identité ci-dessus, en utilisant des intégrations par parties, l’inégalité de Hölder et la moyenne on arrive à l’estimation suivante (voir les notes de cours [16] pour les détails)
d’où, par les expressions des quantités et on obtient
Dans cette estimation nous écrivons
et, en utilisant le fait que la longueur est définie par alors, dans le premier terme de l’estimation ci-dessus nous pouvons écrire
| (1.36) |
Si nous comparons cette estimation avec l’estimation recherchée (1.35) nous pouvons observer que dans l’expression ci-dessus on veut faire apparaître le terme et pour cela, dans [16], l’inégalité suivante est utilisée
| (1.37) |
indiquons rapidement que cette inégalité pose problème et nous y reviendrons dans les lignes qui suivent. Mais, en supposant pour l’instant que cette estimation est vraie, on peut écrire l’estimation
et de cette façon, dans (1.36) on obtient l’inégalité cherchée (1.35).
Revenons donc à l’estimation (1.37) et nous allons voir que les calculs ci-dessus présentent une lacune dans cette inégalité. En effet, la force est supposée régulière et sa transformée de Fourier vérifie ; donc par les inégalités de Bernstein nous avons la majoration de la quantité :
mais, dans (1.37) nous avons besoin d’une minoration de la quantité et nous ne savons pas déduire une telle estimation à partir des hypothèses de la fonction .
Ainsi, en revenant à la dernière expression de l’inégalité (1.36) ci-dessus, nous pouvons observer que la longueur caractéristique apparaît naturellement dans le terme mais non dans le terme de cette expression.
Donc, en résumé, nous pouvons observer que l’estimation du taux de dissipation (1.28) proposée dans les notes de cours [16] possède deux contraintes techniques: d’une part pour une solution de Leray des équations de Navier-Stokes posées sur tout , nous ne savons pas si la moyenne en temps long donnée par l’expression (1.29) est une quantité bien définie (et donc par l’identité (1.30) on ne sait pas si ).
D’autre part, la longueur caractéristique ne convient pas pour obtenir l’inégalité (1.35) à partir de laquelle P. Constantin déduit l’estimation du taux de dissipation (1.28).
Pour régler le problème de la définition de la moyenne en temps long , dans la section qui suit nous proposons une modification des équations de Navier-Stokes (1.24). Ensuite, dans la Section 1.3 nous ferons une discussion sur la notion de longueur caractéristique lorsqu’on travaille sur tout l’espace où nous remarquerons le fait qu’une définition adéquate de telle longueur pour l’étude de l’encadrement du taux de dissipation (1.21) semble actuellement hors de portée.
1.2 Les équations de Navier-Stokes amorties
Dans cette section, nous allons considérer un modèle particulier des équations de Navier-Stokes en introduisant un terme d’amortissement.
L’étude de ce modèle nous permettra tout d’abord de bien définir la vitesse caractéristique et d’étudier ensuite l’encadrement du taux de dissipation d’énergie (1.21), ce qui sera fait dans la section suivante.
1.2.1 Motivation du modèle
Dans la Section 1.1.3 ci-dessus, nous avons observé que lorsqu’on considère une solution de Leray des équations de Navier-Stokes posées dans l’espace tout entier, alors nous n’avons pas un contrôle convenable en temps de la quantité de sorte que l’on puisse assurer que la moyenne en temps
soit bien une quantité finie. De cette façon, afin d’entraîner un contrôle sur la quantité , nous proposons ici de modifier les équations de Navier-Stokes en introduisant un terme additionnel où est un paramètre d’amortissement.
Ainsi le modèle sur lequel nous allons travailler dans tout ce chapitre est donné par le système d’équations suivant:
(1.38)
Ce terme d’amortissement permet d’obtenir comme nous allons le voir un contrôle en temps de la quantité pour une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties ci-dessus. En effet, dans le Théorème 1.2.2 ci-dessous nous démontrons que les solutions faibles de ces équations (solutions qui seront construites dans le Théorème 1.2.1) vérifient le contrôle en temps:
| (1.39) |
et dans cette estimation le terme (où ) entraîne comme nous le verrons dans le Corollaire 1.2.1. Ainsi, la vitesse la moyenne en temps long définies dans (1.29) sera bien définie dans le cadre des équations de Navier-Stokes amorties (1.38).
Avant de donner une preuve rigoureuse de ces faits, ce qui sera fait dans la sous-section 1.2.2 ci-dessous, il convient de faire maintenant une très courte discussion sur le terme d’amortissement que nous venons d’ajouter aux équations de Navier-Stokes posées sur .
Remarque 1.4
Dans la Remarque 1.1.1 page 1.1.1 nous avons observé que si l’on considère un fluide périodique en variable d’espace alors l’inégalité de Poincaré nous permet d’assurer que la moyenne en temps est bien une quantité finie. Pour assurer que la quantité est bien définie dans le cas de l’espace tout entier où l’on ne dispose pas d’un équivalent de l’inégalité de Poincaré, on verra que le terme d’amortissement peut dans un certain sens remplacer cette inégalité de Poincaré: c’est précisément l’utilité et l’intérêt d’introduire cette modification dans les équations de Navier-Stokes.
Observons aussi que dans l’estimation (1.39) nous avons le terme et comme nous avons que ce terme n’est pas contrôlable lorsque tend vers zéro et donc l’estimation (1.39) est seulement valable dans le cadre des équation de Navier-Stokes amorties (1.38).
Pour finir cette motivation, il est intéressant de souligner que pour entraîner le contrôle il est possible de considérer d’autres termes d’amortissement. Nous pouvons considérer par exemple le terme d’amortissement , où le terme est défini au niveau de Fourier par
| (1.40) |
où est une fréquence de troncature et dénote la transformée de Fourier de par rapport à la variable spatiale. Ainsi, dans un premier temps nous avons considéré le terme pour obtenir un premier modèle d’équations de Navier-Stokes amorties:
| (1.41) |
car ce terme supplémentaire entraîne un contrôle en temps de la quantité du même type que le contrôle (1.39) et donc les solutions des équations ci-dessus (qui sont construites de la même façon que les solutions des équations (1.38)) vérifient aussi . En effet, en suivant les mêmes lignes de la démonstration du Théorème 1.2.2 on peut démontrer que toute solution des équations (1.41) vérifie le contrôle en temps suivant: pour ,
| (1.42) |
et nous observons alors que ce contrôle en temps qui peut être obtenu grâce au terme d’amortissement est équivalent au contrôle (1.39) qui sera obtenue par le biais du terme et donc tous les résultats que nous allons obtenir dans le cadre des équations (1.38) peuvent être aussi obtenus dans le cadre des équations (1.41).
Néanmoins, nous allons préférer le terme d’amortissement au lieu du terme car ce premier terme est plus naturel d’un point de vue physique. En effet, le terme d’amortissement , également appelé terme de friction, a été considéré dans des modèles océaniques [61] et ce terme permet de modéliser la friction de l’eau avec le fond marin. D’autre part, le terme est un terme de troncature des hautes fréquences comme l’on peut observer dans la formule (1.40) mais ce terme n’a, à notre connaissance, aucune signification physique.
Notre étude se décomposera de la façon suivante: dans la Section 1.2.2 nous établissons les résultats de base par rapport aux équations (1.38) (existence, inégalités) et ensuite dans la Section 1.2.3 nous verrons comment calibrer convenablement le paramètre pour obtenir des résultats intéressants sur l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov (1.21) dans le cadre des équations (1.38).
1.2.2 Existence et propriétés
Dans cette section on commence par donner une preuve de l’existence de solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38). Dans le Théorème 1.2.1 ci-dessous nous construisons dans un premier temps des solutions localement bornées en temps pour ensuite vérifier dans le Théorème 1.2.2 que ces solutions satisfont le contrôle en temps (1.39) et qu’alors ces solutions sont globalement bornées en temps.
Théorème 1.2.1
Soit une donnée initiale à divergence nulle, soit une force extérieure stationnaire et à divergence nulle. Alors, pour tout il existe des fonctions et qui sont solution faible du système (1.38).
La preuve de l’existence de ces solutions suit essentiellement les mêmes lignes que celle de l’existence des solutions de Leray des équations de Navier-Stokes classiques (voir le livre [46], Section pour tous les détails) et par conséquent nous détaillerons seulement les estimations réalisées sur le terme d’amortissement .
Démonstration. Nous appliquons le projecteur de Leray aux équations (1.38) et comme et alors nous obtenons
| (1.43) |
Maintenant, soit une fonction positive telle que , pour on considère la fonction donnée par et on étudie alors l’équation intégrale régularisée suivante
| (1.44) | |||||
Nous allons dans un premier temps appliquer un argument de point fixe dans l’espace
muni de la norme . Pour cela nous étudions la quantité
Les termes et sont classiques à estimer. En effet, en utilisant le Théorème du livre [46] nous avons les estimations
| (1.45) |
et comme la force est indépendante de la variable de temps nous avons
ce qui nous permet d’écrire la deuxième estimation de (1.45) comme suit
De cette façon, pour le terme ci-dessus nous pouvons écrire l’estimation
| (1.46) |
Pour le terme nous avons directement l’estimation
| (1.47) |
voir le livre [46] page pour les détails.
Donc, nous avons besoin d’étudier uniquement le terme . En remplaçant par dans la deuxième estimation de (1.45) nous avons
| (1.48) | |||||
Une fois que nous avons les estimations (1.46), (1.47) et (1.48), pour un temps suffisamment petit et pour , nous pouvons appliquer l’argument de point fixe de Picard pour construire une fonction telle que et est solution des équations approchées (1.44).
Une fois que l’on a construit une solution (locale en temps) nous prouvons l’existence globale de cette solution: pour une solution des équations régularisées
| (1.49) |
nous pouvons écrire
| (1.50) | |||||
d’où, en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz et puis les inégalités de Young sur le terme , nous obtenons
| (1.51) | |||||
et alors, comme est une quantité négative, nous avons donc l’estimation
Finalement, nous intégrons en temps sur l’intervalle pour obtenir l’estimation
| (1.52) |
et alors la solution locale en temps peut être étendue à l’intervalle .
Nous passons maintenant à la convergence vers une solution faible des équations (1.43). En effet, par le lemme de Rellich-Lions (voir le Théorème du livre [46]) il existe une suite de nombres positifs et une fonction telles que converge fortement vers dans . De plus, pour tout , cette suite converge vers dans la topologie faible étoile des espaces et .
Ainsi, par les convergences ci-dessus nous obtenons que le terme converge vers dans la topologie faible étoile de l’espace et donc la limite est une solution des équations de Navier-Stokes amorties (1.43).
Une fois que l’on a construit une solution nous récupérons maintenant la pression reliée a cette solution. En effet, comme vérifie les équations (1.43) et comme et nous pouvons écrire
et par les propriétés du projecteur de Leray (voir le livre [46]) il existe telle que
De plus, en appliquant l’opérateur de divergence à chaque côté de cette identité nous obtenons la relation
et comme alors nous avons et donc par la relation ci-dessus nous obtenons .
Une fois que nous avons montré l’existence globale des solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38), dans la proposition qui suit nous montrons que ces solutions vérifient une inégalité d’énergie qui sera exploitée tout au long de la Section 1.3 ci-après.
Proposition 1.2.1
Pour montrer l’inégalité ci-dessus nous suivrons les mêmes lignes de la preuve de l’inégalité d’énergie des solutions de Leray des équations de Navier-Stokes classiques faite dans le Théorème du livre [46].
Preuve. Notre point de départ est l’identité (1.50), d’où, pour en intégrant sur l’intervalle nous obtenons
Maintenant, on régularise cette égalité en variable du temps et pour cela nous considérons la fonction test positive telle que . De cette façon, dans l’identité ci-dessus nous obtenons
| (1.54) | |||||
À ce stade, nous avons besoin de vérifier que la suite converge faiblement vers dans . En effet, nous avons et alors par l’inégalité (1.52) nous obtenons cette convergence. De plus, nous savons en plus que la suite converge vers dans la topologie faible étoile de et (pour tout ) et alors par l’inégalité (1.54) nous pouvons écrire
Donc, pour un point de Lebesgue de l’application nous obtenons l’inégalité d’énergie (1.53) et en plus, cette égalité est étendue à tout temps par la continuité faible de l’application (voir le Théorème du livre [46] pour les détails).
Nous avons maintenant à notre disposition tout les outils pour montrer que les solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties (1.38) vérifient le contrôle en temps (1.39) où nous allons pouvoir apprécier le rôle du terme d’amortissement dans ces estimations.
Théorème 1.2.2
Démonstration. Nous allons montrer ce contrôle en temps pour la fonction (solution de l’équation régularisée (1.49)) et ensuite, par convergence faible étoile de vers dans l’espace nous récupérons ce contrôle en temps pour la solution .
On commence donc par l’inégalité (1.51):
d’où, comme est une quantité négative nous pouvons écrire
et par une application de l’inégalité de Grönwall nous obtenons
| (1.56) |
pour tout temps .
Maintenant, nous récupérons ce contrôle en temps pour la solution et pour cela on suit encore l’argument utilisé dans la démonstration de la Proposition 1.2.1. En effet, on régularise la quantité en variable de temps en prenant le produit de convolution avec une fonction positive telle que . De cette façon, dans l’inégalité (1.56) ci-dessus nous avons
Ensuite, comme converge vers dans la topologie faible étoile de l’espace alors converge faiblement vers dans et de cette façon nous obtenons
Ainsi, par la continuité faible de l’application (voir le Théorème du livre [46],) nous avons le contrôle en temps cherché.
Corollaire 1.2.1
Toute solution faible des équations (1.38), , vérifie
Preuve. Cette estimation est une conséquence directe du contrôle en temps
donné par le Théorème 1.2.2. En effet, nous écrivons
et comme la force est une fonction stationnaire alors en prenant la limite nous obtenons l’estimation recherchée.
Nous observons de cette façon que le terme d’amortissement dans les équations (1.38) nous a permis d’obtenir un contrôle en temps de la quantité donné par le biais du Théorème 1.2.2 et ce résultat est valable pour tout paramètre d’amortissement . Dans la sous-section qui suit nous allons fixer le paramètre d’une façon convenable et cette valeur particulière de va nous permettre de faire ensuite (dans la Section 1.3) une discussion sur la loi de dissipation d’énergie dans le cadre des équations (1.38).
1.2.3 Le paramètre d’amortissement
Nous fixons ici le paramètre dans le terme d’amortissement des équations (1.38) et pour fixer les idées nous avons besoin de considérer pour l’instant le cadre d’un fluide périodique en variable d’espace qui a été introduit dans la Section 1.1.1.
Rappelons que dans le cadre périodique nous considérons une période , où est toujours une échelle d’injection fixe (voir l’estimation (1.12) pour tous les détails ); et nous considérons les équations de Navier-Stokes périodiques sur le cube . Rappelons maintenant que pour toute solution de Leray , par l’inégalité d’énergie (1.11) et l’inégalité de Poincaré (1.10) nous avons l’estimation (1.18) qui nous rappelons ci-dessous:
où est la constante de viscosité du fluide (voir toujours l’estimation (1.18) page 1.18 pour tous les détails de la preuve de cette estimation). Nous observons ainsi que dans le cadre périodique nous avons toujours un contrôle sur la moyenne en temps long de la quantité et que ce contrôle est dû à l’inégalité de Poincaré.
De cette estimation nous nous intéressons au terme devant la moyenne en temps long car ce terme nous permettra de fixer une valeur assez naturelle du paramètre dans le terme d’amortissement des équations (1.38) comme nous l’expliquons tout de suite.
Revenons à présent au cadre d’un fluide non périodique posé dans l’espace tout entier et à notre modèle des équations de Navier-Stokes amorties (1.38). Dans ce cadre, par le Corollaire 1.2.1 nous savons que toute solution faible des équations (1.38) vérifie l’estimation:
| (1.57) |
et si nous comparons maintenant cette estimation avec l’estimation ci-dessus nous pouvons observer que le paramètre joue le rôle du terme qui apparaît dans le cadre d’un fluide périodique où est la période. De cette façon, par analogie au cadre périodique, pour une échelle d’injection d’énergie fixe, nous intégrons à notre modèle une longueur qui est un paramètre du modèle tout comme la constante de viscosité du fluide et qui représente un analogue à la période dans le cadre d’un fluide périodique; et nous allons fixer le paramètre d’amortissement par l’expression
| (1.58) |
Ainsi dans ce chapitre nous allons dorénavant travailler avec le système d’équations de Navier-Stokes amorties suivant:
| (1.59) |
Dans la section qui suit nous allons faire une discussion plus précise sur la longueur ci-dessus et nous allons voir le rôle de cette longueur dans l’étude déterministe de la loi de dissipation de d’énergie (1.6) dans le cadre des équations ci-dessus.
1.3 Discussion sur la loi de dissipation d’énergie dans les équations de Navier-Stokes amorties
Le but de cette section est de faire une discussion rigoureuse sur l’étude de l’encadrement du taux de dissipation d’énergie :
| (1.60) |
qui est censé être observé dans le régime turbulent des grandes valeurs du nombre de Reynolds
| (1.61) |
selon la loi de dissipation d’énergie (1.6) énoncée page 1.6 et proposée par la théorie K41.
Dans cet encadrement la vitesse caractéristique et le taux de dissipation sont définies à partir des solutions faibles des équations de Navier-Stokes amorties données dans (1.59) où est une force extérieure stationnaire et à divergence nulle sur laquelle nous ferons quelques hypothèses supplémentaires, tandis que est l’échelle d’injection d’énergie qui sera fixée par la force ci-après.
Nous commençons donc par définir quelques quantités dont nous aurons besoin pour faire notre étude et la première chose à faire est de fixer la force extérieure . Nous définissons cette force en considérant un champ de vecteurs stationnaire, c’est à dire , à divergence nulle et tel que sa transformée de Fourier satisfait
| (1.62) |
pour une échelle d’injection d’énergie donnée et fixée une fois pour toute; et où sont deux constantes qui ne dépendent d’aucun paramètre physique. Cette localisation de la transformée de Fourier de représente le fait que, selon le modèle de cascade d’énergie, l’énergie cinétique est introduite dans le fluide (par la force extérieure) uniquement aux échelles de longueur de l’ordre de et donc aux fréquences de l’ordre .
Nous voulons maintenant définir la vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie . Pour une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à la force ci-dessus il s’agit de moyenner cette fonction et toutes ses dérivées tout d’abord en variable d’espace et ensuite en variable du temps pour obtenir de cette façon une vitesse caractéristique et un taux moyen de dissipation d’énergie respectivement. Néanmoins, pour moyenner ces deux fonctions en variable d’espace nous allons voir que l’on rencontre quelques difficultés.
1.3.1 La notion de longueur caractéristique du fluide
Dans cette section nous expliquons que l’essentiel des difficultés que l’on rencontre lorsqu’on considère un fluide posé sur tout l’espace repose sur la notion de longueur caractéristique du fluide.
Rappelons rapidement que dans le cadre d’un fluide périodique cette longueur caractéristique est définie de façon naturelle par la période (voir toujours la Définition 1.1.1) mais si le fluide est posé dans tout l’espace nous pouvons alors observer que l’on perd toute notion physique et mathématique de cette longueur caractéristique. Ainsi, nous nous posons alors la question de comment choisir une longueur adéquate pour définir la moyenne en espace des fonctions et en termes de la norme , mais la réponse à cette question n’est pas évidente.
Dans ce cadre, les notes de cours [16] de P. Constantin suggèrent de considérer (où est toujours l’échelle d’injection d’énergie définie das (1.62)) pour définir la moyenne en espace ci-dessus mais nous allons maintenant observer que le choix de cette longueur présente quelques lacunes. En effet, rappelons tout d’abord que la force est une fonction localisée aux fréquences de l’ordre de (voir l’expression (1.62)) et par cette localisation fréquentielle nous observons que la quantité
| (1.63) |
est une moyenne naturelle en termes de la norme de la transformée de Fourier de . Après, par l’identité de Plancherel nous savons que et alors dans [16] on considère la moyenne en espace de la force comme la quantité
| (1.64) |
Mais en variable d’espace nous n’avons aucune information supplémentaire sur la localisation de la fonction et alors la moyenne ci-dessus n’est pas bien comprise. Dans la Section 2.2.2 du chapitre suivant nous revisitons ce problème et nous construisons un exemple concret de force qui est une fonction bien localisée en variable de fréquence mais aussi en variable d’espace.
Ensuite, toujours dans [16], il est suggéré de considérer cette même moyenne en espace (1.64) pour les fonctions et et l’on a ainsi les quantités
néanmoins, le choix de la longueur pour définir cette moyenne en espace pour les fonctions et n’est pas du tout clair car il n’a aucune explication rigoureuse que ce soit du point de vue physique ou mathématique; et comme nous voulons faire une discussion aussi rigoureuse que possible de la loi de dissipation d’énergie (1.60) alors nous n’allons pas considérer ici cette moyenne en espace.
Nous observons de cette façon que dans le cadre d’un fluide dans tout l’espace, une définition convenable de moyenne en espace pour le champ de vitesse et ses dérivées est une question que l’on ne sait pas répondre de façon tout à fait satisfaisante car cette question est directement reliée au problème de trouver une définition convenable de longueur caractéristique . Ainsi, pour pouvoir faire une étude rigoureuse de l’encadrement du taux de dissipation (1.60), dans un premier temps nous allons seulement considérer la moyenne en temps long des quantités et qui sont définies de la façon suivante.
La moyenne en temps de la quantité a été introduite dans l’expression (1.29) page 1.29 mais pour la commodité du lecteur nous allons récrire cette moyenne donnée par l’expression:
| (1.65) |
où rappelons que, dans le cadre des ces équations amorties, le Corollaire 1.2.1 nous assure que la moyenne en temps long est une quantité bien définie.
Rappelons aussi que cette moyenne en temps long a bien une signification mathématique: la force étant toujours une fonction stationnaire alors nous nous intéressons à étudier le comportement turbulent du fluide dans le régime asymptotique lorsque le temps tend vers l’infini (voir toujours la Section 1.1.1 page 1.15 pour plus de détails à ce sujet).
Ensuite, en suivant les idées ci-dessous nous allons maintenant définir la moyenne en temps long de la quantité par l’expression:
| (1.66) |
Une fois que nous avons introduit les quantités et ci-dessus expliquons de façon plus précise pourquoi nous allons considérer ici ces quantités pour l’étude de l’encadrement (1.60). Nous pouvons observer que cet encadrement fait intervenir la vitesse caractéristique et le taux moyen de dissipation , qui dans le cadre d’un fluide périodique sur le cube s’écrivent de façon rigoureuse par les expressions:
| (1.67) |
Si nous comparons maintenant les quantités et avec les quantités et respectivement nous observons que si nous considérons n’importe quelle longueur , qui pourrait représenter un analogue à la période dans le cadre d’un fluide périodique, alors nous avons les relations
| (1.68) |
et alors il s’agit donc d’étudier l’encadrement (1.60) tout d’abord dans le cadre rigoureux des quantités et et ceci sera fait dans le Théorème 1.3.1 dans la Section 1.3.2 ci-dessous. Ensuite dans la Section 1.3.3 nous allons observer qu’à partir de ce résultat et en considérant les quantités et , avec n’importe quelle longueur , nous obtenons alors une estimation du type bien qu’il s’agisse d’une estimation partielle par rapport à l’encadrement (1.60).
1.3.2 Quelques estimations rigoureuses
Comme annoncé, dans cette section nous allons étudier l’encadrement du taux de dissipation (1.60): , dans le cadre plus rigoureux des moyennes en temps long et introduites précédemment. Plus précisément, dans le Théorème 1.3.1 ci-dessous nous allons montrer l’estimation:
| (1.69) |
où la quantité est définie de la façon suivante: rappelons tout d’abord que la force est une fonction localisée aux fréquences et alors nous définissons la fonction comme la localisation du champ de vitesse aux mêmes fréquences:
| (1.70) |
où dénote la transformée de Fourier inverse; et ensuite la quantité est définie comme la moyenne en temps long de cette fonction:
| (1.71) |
Avant d’entrer dans les détails techniques de la preuve de l’estimation (1.69) nous allons tout d’abord expliquer cette estimation et
pour cela nous avons besoin de rappeler rapidement l’étude de la loi de dissipation d’énergie (1.60) dans le cadre d’un fluide périodique qui a été exposée dans la Section 1.1.1.
Rappelons que dans le cadre périodique on a une estimation du taux de dissipation :
| (1.72) |
et nous maintenant expliquer les grandes lignes de la preuve de cette estimation (voir aussi l’article [22] de C. Doering et C. Foias pour tous les détails des calculs). Dans ce cadre périodique nous définissons la force moyenne comme , le nombre de Reynolds ; et l’estimation (1.72) repose essentiellement sur les deux inégalités techniques suivantes:
| (1.73) |
et
| (1.74) |
En effet, dans le régime turbulent caractérisé lorsque dans l’inégalité (1.73) nous obtenons alors , et en multipliant par à chaque côté de cette inégalité nous avons , d’où,
par l’inégalité (1.74) nous pouvons finalement écrire ce qui nous donne l’estimation (1.72).
À ce stade il est important de souligner que, dans l’état actuel de nos connaissances, l’étude déterministe de l’estimation (1.72) que l’on peut trouver dans la littérature suit essentiellement les grandes lignes expliquées ci-dessus et que les résultats que l’on obtient (toujours dans le cadre périodique) dans différentes contextes techniques sont toujours similaires à cette estimation.
Avec ces idées en tête, revenons à présent à notre cadre d’étude d’un fluide dans tout l’espace . Soit donc la force définie par (1.62) et soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59). Dans le Théorème 1.3.1 nous allons vérifier l’estimation (1.69) qui s’agit d’une estimation analogue à l’estimation (1.72) (obtenue dans le cadre périodique) mais en considérant seulement les quantités , , , et qui ont bien un sens mathématique.
Ainsi, pour vérifier l’estimation (1.69) nous allons suivre les grandes lignes de la preuve de l’estimation (1.72) et alors il s’agit de vérifier des inégalités analogues à celles données dans
(1.73) et (1.74)
(dans le cadre périodique). Observons tout d’abord que l’estimation (1.73) fait intervenir le nombre de Reynolds qui est défini à partir de la vitesse caractéristique comme
mais comme nous ne disposons pas ici d’une définition rigoureuse de cette vitesse caractéristique, en suivant les idées précédentes, nous allons alors remplacer cette quantité par la moyenne en temps long et nous allons donc considérer le nombre de Reynolds défini comme
| (1.75) |
où est toujours l’échelle d’injection d’énergie fixée par la force dans (1.62) et est toujours la constante de viscosité du fluide.
Étudions maintenant la relation entre ce nouveau nombre de Reynolds et le nombre de Reynolds classique , où nous pouvons observer que pour toute longueur on a
| (1.76) |
En effet, il suffit de remarquer que pour une longueur , par la relation (1.68) on a d’où nous avons directement .
Maintenant que l’on dispose de cette identité, nous allons expliquer comment le nombre nous permet aussi de caractériser le régime turbulent du fluide. Il s’agit de fixer le nombre suffisamment grand de sorte que ceci entraîne (qui caractérise le régime turbulent du fluide) et pour cela nous allons suivre le raisonnement suivant: pour l’échelle d’injection d’énergie rappelons que nous fixons le paramètre qui représente la longueur caractéristique du fluide. Ensuite, si nous fixons le nombre tel que alors on a et donc, par la Proposition 1.76 on obtient .
Nous observons ainsi que le régime asymptotique des grandes valeurs du nombre () entraîne le régime turbulent caractérisé par de grandes valeurs du nombre et comme le nombre fait intervenir la moyenne en temps long au lieu de la vitesse caractéristique nous allons préférer ici ce nombre de Reynolds pour caractériser le régime turbulent.
Une fois que l’on a introduit le nombre de Reynolds ci-dessus, dans l’estimation suivante nous obtenons une inégalité analogue à l’inégalité (1.73) obtenue dans le cadre périodique.
Proposition 1.3.1 (Première estimation dans le cadre non périodique)
Soit une échelle d’injection d’énergie définie par la force dans (1.62). Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à cette force. Soit la moyenne en temps long définie à partir de la solution dans l’expression (1.65). Soit enfin le nombre de Reynolds défini dans l’expression (1.75). Alors on a l’estimation
| (1.77) |
Preuve. L’inégalité (1.77) repose essentiellement sur l’estimation technique suivante.
Lemme 1.3.1
Dans le cadre la Proposition 1.3.1 on a l’estimation:
| (1.78) |
La preuve de cette estimation suit les grandes lignes des notes de cours [16] de P. Constantin et pour la commodité du lecteur nous ferons tous les calculs en détail à la fin du chapitre.
Nous allons maintenant étudier le premier et deuxième terme à droite de l’estimation ci-dessus et alors, étant donnée que la force est localisée aux fréquences , par les inégalités de Bernstein nous avons qu’il existe une constante , qui ne dépend d’aucun paramètre physique, telle que l’on a
Nous remplaçons maintenant les estimations ci-dessus dans (1.78) et nous obtenons l’estimation
d’où nous pouvons écrire
et comme l’on a définit le nombre de Reynolds (donné dans (1.75)) par l’expression nous obtenons l’estimation cherchée .
Nous allons maintenant étudier une inégalité analogue à l’inégalité (1.74): , obtenue dans le cadre périodique et pour cela on commence par faire la remarque suivante: observons que dans l’inégalité (1.74) interviennent les termes , et ; et étant donné que ces termes sont définis à partir des moyennes en temps long , (données dans les expression (1.66) et (1.65) respectivement), la quantité et la période comme: , et ; nous pouvons alors écrire , d’où nous obtenons l’estimation
| (1.79) |
Nous observons que la période ne joue aucun rôle dans cette estimation et ainsi, par analogie au cadre périodique, nous voulons alors étudier une estimation du même type que celle ci-dessus.
Proposition 1.3.2 (Deuxième estimation dans le cadre non périodique)
Soit une échelle d’injection d’énergie définie par la force dans (1.62). Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) associée à cette force. Soient les moyennes en temps et définies à partir de la solution par les expressions (1.66) et (1.71) respectivement. Alors on a l’estimation:
| (1.80) |
Si nous comparons cette inégalité (1.80) avec l’inégalité (1.79) nous pouvons observer que cette première est plus précise car cette inégalité fait intervenir la quantité au lieu de la quantité dans (1.79). En effet, rappelons que la quantité est définie dans (1.71) est il correspond à la moyenne en temps long de la fonction qui est la localisation fréquentielle du champ de vitesse (voir l’expression (1.70) pour une définition de la fonction ) et ainsi, comme l’on a nous avons alors
| (1.81) |
Preuve de la Proposition 1.3.2. La preuve de cette estimation repose sur l’inégalité d’énergie vérifiée par la solution et qui a été obtenue dans la Proposition 1.2.1:
d’où, étant donné que est une quantité positive et de plus, comme est une quantité négative, nous pouvons écrire
| (1.82) |
Nous allons maintenant étudier le deuxième terme à droite de cette estimation et pour la fonction définie dans l’expression (1.70) comme
nous allons montrer que l’estimation
| (1.83) |
En effet, comme la force est localisée aux fréquences: nous appliquons l’identité de Parseval pour écrire
et ensuite, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, l’identité de Plancherel et par la définition de la fonctions ci-dessus nous avons
Finalement, nous prenons l’intégrale sur l’intervalle de temps à chaque côté de cette inégalité où, étant donné que est une fonction stationnaire et en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz (en variable de temps) nous pouvons alors écrire l’estimation (1.83).
Une fois que l’on a cette estimation, nous la remplaçons dans l’estimation (1.82) et nous obtenons
Ainsi, nous divisons cette estimation par , puis nous prenons la limite supérieure lorsque et par la définition des moyennes en temps long et nous obtenons finalement l’estimation cherchée
Nous avons maintenant tous les ingrédients dont on a besoin pour étudier l’estimation (1.69) et nous avons ainsi le résultat suivant.
Théorème 1.3.1 (Loi de dissipation d’énergie dans le cadre non périodique)
Soit la constante de viscosité du fluide. Soit une force à divergence nulle et qui vérifie la localisation fréquentielle
pour une échelle d’injection d’énergie donnée et fixée; et où sont deux constantes qui ne dépendent pas d’aucun paramètre physique. Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties
obtenue par le biais du Théorème 1.2.1, et à partir de laquelle on considère , et les moyennes en temps long données par les expressions (1.65), (1.66) et (1.71) respectivement.
Si , où , alors on a l’estimation donnée dans (1.69):
où est une constante numérique qui ne dépend d’aucun paramètre physique ci-dessus.
Démonstration. Ce résultat repose sur les estimations (1.77) et (1.80) obtenues dans les Propositions 1.3.1 et 1.3.2 respectivement. En effet, observons tout d’abord que si l’on suppose que le nombre est suffisamment grand: , ce qui caractérise le régime turbulent grâce à l’identité 1.76; alors le terme devient négligeable et par l’estimation (1.77) nous pouvons écrire
Ensuite, nous multiplions à chaque côté de cette estimation par la quantité et nous obtenons l’estimation suivante:
Finalement, par l’estimation (1.80) nous savons que l’on a et ainsi nous pouvons écrire l’estimation cherché:
où nous observons que la constante est indépendante de tout paramètre physique de notre modèle et alors il s’agit d’une constante universelle.
Maintenant que l’on a vérifié l’estimation du terme de dissipation d’énergie (1.69), dans la section qui suit nous allons faire quelques remarques sur cette estimation par rapport à l’étude déterministe de la loi de dissipation de Kolmogorov .
1.3.3 Conclusions
Dans cette section nous allons faire une discussion sur l’estimation (1.69) obtenue dans le Théorème 1.3.1. Insistons tout d’abord sur le fait que cette estimation du terme de dissipation d’énergie est une estimation rigoureuse car tous les termes qui interviennent ont bien un sens mathématique. Nous souhaitons maintenant d’expliquer comment, à partir de cette inégalité, on peut récupérer des estimations du taux moyen de dissipation d’énergie selon la loi de Kolmogorov:
| (1.84) |
Rappelons rapidement l’essentiel du problème: étant donné qu’on travail sur tout l’espace alors la longueur caractéristique du fluide n’est pas rigoureusement définie et donc la vitesse caractéristique et le taux moyen de dissipation d’énergie ne le sont pas non plus. Ainsi, avant d’étudier l’estimation (1.84) nous avons tout d’abord étudié l’estimation (1.69) où cette longueur n’intervient pas.
Dans ce cadre, en suivant les idées de la Section 1.2.3, nous allons considérer la longueur tout simplement comme un paramètre pour définir (toujours formellement) les quantités moyennes et , et à partir de l’estimation rigoureuse (1.69) nous allons étudier l’estimation (1.84). Toutes les estimations que nous allons obtenir sont des corollaires du Théorème 1.3.1 et étant donné que nous allons diviser notre étude en regardant deux cas: nous allons tout d’abord considérer pour ensuite étudier le cas lorsque .
A) Le cas
Rappelons rapidement que dans la formule (1.64) page 1.64 nous avons expliqué que les notes de cours [16] de P. Constantin suggèrent de considérer la longueur (où est toujours une échelle d’injection d’énergie fixe) pour définir les quantités moyennes et . Nous suivons donc ici cette idée (même si elle n’a pas aucune explication rigoureuse) et nous avons les estimations suivantes par rapport à la loi de Kolmogorov.
Proposition 1.3.3
Soit une échelle d’injection d’énergie fixée par la force dans (1.62). On fixe la longueur caractéristique . Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) et soient les moyennes en temps et définies à partir de la solution par les expressions (1.66) et (1.71). Soient enfin la vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie . Alors on a l’estimation:
où la constante ne dépend d’aucun paramètre physique ci-dessus.
Nous observons ainsi que le choix nous donne une estimation du taux de dissipation qui est bien en accord avec la loi de dissipation de Kolmogorov, néanmoins insistons sur le fait que cette estimation n’est pas tout à fait rigoureuse
dans le sens que nous ne disposons d’aucun argument supplémentaire (ni physique ni mathématique) pour justifier le choix de l’échelle pour définir les quantités moyennes et ci-dessus.
Preuve. Par l’estimation (1.69) on commence par écrire , et nous allons étudier en plus le terme . En effet, la force étant localisée aux fréquences de l’ordre de (voir toujours la formule (1.62)) alors par les inégalités de Bernstein nous avons l’estimation ; et en remplaçant cette estimation dans l’estimation précédente nous avons . De plus, par l’estimation (1.81) nous avons et dans l’estimation précédente nous pouvons écrire . On divise chaque côté de cette estimation par et comme l’on a défini et on obtient alors .
Dans ce cas lorsque nous pouvons aussi en déduire l’estimation du taux de dissipation faite dans [16] et qui a été exposée dans la Section 1.1.2: rappelons rapidement que dans [16] on considère les équation de Navier-Stokes classiques (sans terme d’amortissement) et l’on définit une longueur par le biais de la force comme:
| (1.85) |
avec (voir la formule (1.27) pour tous les détails); et avec cette longueur, toujours dans [16], on obtient l’estimation suivante .
Néanmoins, dans la Section 1.1.3 nous avons aussi expliqué que cette estimation présente quelques lacunes techniques et l’une de ces lacunes étant que la vitesse caractéristique est potentiellement mal posée dans le cadre des équations de Navier-Stokes classiques (voir l’estimation (1.33) page 1.33 pour tous les détails à ce sujet).
Proposition 1.3.4
Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) et soient soient les moyennes en temps et définies à partir de la solution par les expressions (1.66) et (1.71). Soit une échelle d’injection d’énergie fixée par la force dans (1.62), soit la longueur et soient la vitesse caractéristique et le taux de dissipation d’énergie . Soit enfin longueur est définie dans (1.85). Alors on a l’estimation
Preuve. Comme nous avons (voir toujours l’estimation (1.81)) alors par l’estimation (1.69) nous avons d’où nous écrivons
, et nous allons maintenant vérifier l’encadrement . Par la définition de la longueur ci-dessus nous savons que , et comme alors nous écrivons
. De plus, par la localisation fréquentielle de la force (voir toujours la formule 1.62) et par les inégalités de Bernstein nous avons
de plus ; et ainsi l’on a l’encadrement ci-dessus. Nous écrivons donc puis nous divisons chaque terme par pour écrire .
Soulignons maintenant le fait que cette estimation est encore moins rigoureuse que l’estimation obtenue dans la Proposition 1.3.3 car ici on ne comprend pas tout à fait la signification de la longueur .
En conclusion, nous observons que si l’on considère la longueur caractéristique alors l’estimation du taux de dissipation donnée par la Proposition 1.3.3 est préférable à l’estimation donnée dans la Proposition 1.3.4 car cette première estimation est plus en accord à ce qu’on s’attend selon la théorie K41.
B) Le cas
Nous considérons ici un cas plus général où la longueur caractéristique n’est pas forcément égale à l’échelle d’injection d’énergie . Dans ce cas nous avons une estimation du taux de dissipation suivante:
Proposition 1.3.5
Soit une échelle d’injection d’énergie fixée par la force dans (1.62). On fixe la longueur caractéristique . Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes amorties (1.59) et soient les moyennes en temps et définies à partir de la solution par les expressions (1.66) et (1.71). Soient la vitesse caractéristique , le taux de dissipation d’énergie et soit la force moyenne . Soit enfin la constante donnée dans l’estimation (1.69) qui ne dépend d’aucun paramètre physique ci-dessus. Alors on a l’estimation
Avant de donner une preuve de cette estimation il convient tout d’abord d’expliquer ce résultat et nous allons maintenant observer que cette estimation donne, dans un certain sens, une généralisation des estimations obtenues dans les Propositions 1.3.3 et 1.3.4 dans le cas .
En effet, observons tout d’abord que si nous supposons que la force vérifie en plus la propriété
| (1.86) |
alors par l’estimation du taux de dissipation d’énergie ci-dessus nous pouvons écrire
| (1.87) |
ce qui nous donne une estimation de analogue à celle obtenue dans la Proposition 1.3.3 et qui est en avec la loi de Kolmogorov.
Remarquons maintenant que l’hypothèse supplémentaire sur la force donnée dans (1.86) peut être vérifié dans le cadre de certains forces particulières. En effet, la Définition 2.2.4 du chapitre suivant nous donnons un exemple concret de force qui vérifie cette propriété (voir la Remarque 2.2 page 2.2 pour plus de détails à ce sujet).
D’autre part, quant à l’estimation du taux de dissipation d’énergie obtenue dans la Proposition 1.3.4, nous allons maintenant observer que dans le cas lorsque nous pouvons obtenir une estimation similaire. En effet, il suffit d’observer le fait que la force étant localisée aux fréquences de l’ordre de alors par les inégalités de Bernstein nous pouvons écrire et donc, par l’estimation de obtenue dans la proposition ci-dessus nous avons . Ensuite, rappelons que dans [16] on considère la longueur donnée dans (1.85): ; et nous obtenons ainsi l’estimation
Néanmoins, comme l’on a déjà expliqué dans le cas , cette estimation est moins intéressante que l’estimation (1.87) car l’on ne sait pas donner une interprétation rigoureuse à cette longueur mais elle apparaît de façon relativement naturelle dans les calculs faits dans [16].
Preuve de la Proposition 1.3.5. Toujours par l’estimation (1.69) on commence par écrire , et comme nous avons (voir l’estimation (1.81)) alors nous écrivons , et comme l’on a défini la force moyenne nous avons . Finalement, nous divisons chaque terme de cette estimations par pour écrire .
1.4 Lemme technique: preuve du Lemme 1.3.1 page 1.3.1
Pour nous avons , , et de plus, la force étant localisée aux fréquences alors appartient à tous les espaces de Sobolev () et donc, en multipliant les équations de Navier-Stokes amorties par et en intégrant en variables d’espace nous pouvons écrire
Dans cette identité nous cherchons à faire apparaître les termes , , et et pour cela on commence par écrire
| (1.88) | |||||
et nous avons les remarques suivantes: pour le premier terme à droite ci-dessus nous pouvons écrire
car est stationnaire. Pour le deuxième terme de (1.88), par une intégration par parties et en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous obtenons
Pour le troisième terme de (1.88), étant une fonction à divergence nulle et en utilisant les propriétés du projecteur de Leray, par une intégration par parties et par l’inégalité de Hölder nous avons
Finalement, pour le quatrième terme de (1.88), par l’inégalité de Cauchy-Schwarz et de plus étant donné que l’on a alors nous avons
De cette façon, par les remarques ci-dessus, dans l’identité (1.88) nous obtenons
et maintenant, pour nous prenons la moyenne en temps et comme est stationnaire nous avons
ensuite, nous prenons la limite et nous obtenons
| (1.90) | |||||
Dans cette inégalité, pour le premier terme à droite, par le Théorème 1.2.2 nous savons que la vitesse vérifi l’estimation
et alors en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous avons
d’où nous avons
| (1.91) |
D’autre part, pour le troisième et quatrième terme à droite de l’estimation (1.90), en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz en variable de temps nous avons
| (1.92) |
De cette façon, en remplaçant les inégalités (1.91) et (1.92) dans (1.90) nous obtenons
d’où, par la définition de la moyenne en temps long nous pouvons écrire l’estimation cherchée
Chapitre 2 Les solutions stationnaires amorties
Dans le chapitre précédent nous avons introduit les équations de Navier-Stokes amorties
| (2.1) |
où la force est une fonction stationnaire; et nous avons étudié la loi de dissipation d’énergie de Kolmogorov dans le cadre des ces équations où le terme d’amortissement nous a permis de donner un sens mathématique rigoureux aux quantités considérées.
Le fait que la force ne dépende pas de la variable du temps suggère d’étudier les équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires:
| (2.2) |
où le champ de vitesse et la pression ne dépendent que de la variable spatiale et dans ce chapitre nous allons étudier un tout autre problème relié à la turbulence dans le cadre de ces équations stationnaires. Plus précisément nous allons étudier ici la stabilité et la décroissance en variable d’espace des solutions .
En effet, si le fluide est en régime laminaire on s’attend à ce que la solution soit stable au sens suivant: si nous considérons n’importe quelle donnée initiale à divergence nulle et une solution faible du problème de Cauchy des équations (2.1) (obtenue par le biais du Théorème 1.2.1 page 1.2.1) alors on a:
| (2.3) |
ce qui exprime le fait qu’à partir de n’importe quelle donnée initiale l’évolution au cours du temps du champs de vitesse converge toujours vers la solution stationnaire dans le régime asymptotique du temps long; et nous allons observer que cette propriété de stabilité de la solution , qui sera étudiée plus tard dans le Théorème 2.3.2 (page 2.3.2), est seulement valable dans le cadre d’un fluide en régime laminaire tandis que, dans le cadre plus général d’un fluide en régime turbulent, nous allons montrer une toute autre propriété des solutions stationnaires qui porte sur leur décroissance à l’infini en variable d’espace. Plus précisément, dans le Théorème 2.3.3 (page 2.3.3) nous allons montrer si la force est une fonction bien localisée en variable d’espace alors toute solution des équations (2.2) vérifie une décroissance
| (2.4) |
Cette décroissance est intéressante car rappelons rapidement que dans le cadre des équations de Navier-Stokes classiques (sans terme d’amortissement) on s’attend à ce que les solutions n’aient pas une meilleure décroissance à l’infini que et nous allons montrer le terme d’amortissement introduit dans les équations (2.2) entraîne cette décroissance précise à l’infini.
Dans la Section 2.1.1 nous allons expliquer plus en détail l’intérêt d’étudier les équations stationnaires (2.2) et ensuite dans la Section 2.1.2 nous montrons un résultat général sur l’existence des solutions des ces équations.
Une fois que le système d’équations sera posé, nous allons étudier dans la Section 2.2 sous quelles conditions on se trouve dans un régime laminaire ou turbulent. Nous verrons ainsi que pour faire une étude qui ne dépende pas explicitement des solutions des équations de Navier-Stokes, il sera préférable d’utiliser les nombres de Grashof au lieu des nombres de Reynolds introduits dans le chapitre précédent; et ces nombres nous permettront de déterminer le régime laminaire et le régime turbulent. En particulier, le régime laminaire sera caractérisé par un contrôle sur les nombres de Grashof et pour obtenir ce régime laminaire, nous avons besoin de choisir correctement une force extérieure et ceci sera fait dans la sous-section 2.2.2.
Une fois que nous avons tous les ingrédients de notre étude à disposition (les équations stationnaires, les nombres de Grashof et la force extérieure bien préparée) nous pourrons étudier dans la Section 2.3 la propriété de stabilité (2.3) et la décroissance en variable d’espace (2.4) des solutions des équations stationnaires (2.2).
2.1 Introduction
Comme annoncé nous commençons par expliquer plus en détail notre intérêt pour étudier les équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires (2.2).
2.1.1 Motivation: le problème en temps long
Le fait que la force soit une fonction stationnaire motive l’étude du comportement des solutions lorsque le temps tend vers l’infini, ce qui est également appelé le problème en temps long pour les équations de Navier-Stokes; et pour expliquer comment ce problème en temps long nous amène à l’étude des équations stationnaires (2.2) nous avons besoin de considérer pour l’instant les équations de Navier-Stokes avec le même terme d’amortissement mais en deux dimensions:
| (2.5) |
où est toujours une force stationnaire.
Le problème en temps long pour les équations (2.5) (en dimension 2) a été étudié par A. Ilyin et. al. en dans l’article [36] et nous allons expliquer très rapidement les grandes lignes de cette étude: tout d’abord, dans le Théorème de [36], à partir d’une donnée initiale à divergence nulle on montre l’existence d’une unique solution des équations (2.5) qui vérifie
| (2.6) |
et il s’agit d’étudier le comportement de cette solution lorsque . Cette étude faite dans [36] est plutôt technique mais nous expliquons tout de suite les idées générales.
L’étude du problème en temps long des équations de Navier-Stokes amorties et en deux dimensions (2.5) repose essentiellement sur deux ingrédients: la notion de solution éternelle donnée dans la Définition 2.1.1 ci-dessous et l’unicité de la solution du problème de Cauchy pour ces équations. On commence donc par introduire la notion de solution éternelle:
Définition 2.1.1
Une fonction est une solution éternelle des équations de Navier-Stokes amorties (2.5) si et si la fonction vérifie ces équations.
Nous allons maintenant voir comment ces solutions éternelles nous permettent d’étudier le comportement en temps long de la solution (voir toujours l’article [36] pour tous les détails des calculs). On considère une suite telle que et telle que lorsque ; et pour tout on considère le problème de Cauchy des équations (2.5) avec la condition initiale
| (2.7) |
où nous pouvons observer que l’on prend ici la même donnée initiale mais maintenant au temps au lieu du temps . Ainsi, toujours par le Théorème dans [36] nous savons qu’il existe une fonction définie sur qui est l’unique solution du problème de Cauchy avec la condition (2.7). Ensuite, dans le Théorème dans [36] on montre que la suite de fonctions converge dans la topologie forte de l’espace vers une solution éternelle donnée dans la Définition 2.1.1. De plus (toujours dans le Théorème de l’article [36]) on montre que l’on a aussi la convergence
| (2.8) |
et cette convergence et l’unicité des solutions du problème de Cauchy des équations (2.5) vont nous permettre d’étudier le comportement en temps long de la solution .
En effet, dans les expressions (2.6) et (2.7) nous pouvons observer que les solutions et sont construites à partir de la même donnée et ainsi, par l’unicité de la solution, nous observons que la solution est en réalité un décalage de la solution au temps initial et nous pouvons ainsi écrire l’identité
| (2.9) |
pour tout . Si nous remplaçons maintenant cette identité dans l’expression (2.8) nous pouvons alors écrire
| (2.10) |
pour observer que la solution converge (via la suite ) vers la solution éternelle des équations (2.5) lorsque le temps tend vers l’infini et ceci nous permet de comprendre le comportement en temps long de cette solution.
Revenons à présent à notre cas d’étude donné par les équations de Navier-Stokes amorties sur l’espace (2.1). Rappelons que nous voulons étudier le comportement en temps long des solutions et pour cela il serait naturel de suivre les lignes exposées ci-dessus (dans le cadre des équations en deux dimensions ) mais nous allons voir que l’on a ici une contrainte technique qui porte sur l’unicité des solutions et que nous expliquons tout suite.
Soit donc une donnée initiale à divergence nulle et soit une suite telle que et lorsque . En suivant les idées ci-dessus nous considérons le problème de Cauchy pour les équations (2.1) avec une condition initiale
| (2.11) |
pour tout ; et alors par le Théorème 1.2.1 (page 1.2.1) nous savons qu’il existe une solution . De plus, en suivant exactement les mêmes lignes de la preuve du Théorème dans [36] (toutes les estimations s’adaptent sans aucun problème lorsqu’on considère les équations en trois dimensions) nous avons que cette suite des solutions converge vers une solution éternelle (au sens de la Définition 2.1.1) des équations (2.1):
et de plus (toujours par le Théorème dans [36]) nous avons
| (2.12) |
Mais, dans ce cas où l’on considère les équations de Navier-Stokes posées sur l’unicité des solutions du problème de Cauchy est encore une question ouverte, que ce soit pour les équations de Navier-Stokes amorties ou pour les équations de Navier-Stokes classiques (sans terme d’amortissement); et cette fois-ci on ne peut pas écrire l’identité pour ainsi obtenir un résultat similaire à celui donné dans l’expression (2.10) qui nous a permis de comprendre le comportement en temps long des équations amorties en deux dimensions.
Ainsi, l’étude du comportement en temps long des solutions des équations de Navier-Stokes amorties et en dimension deux (2.5) fait dans l’article [36] ne peut pas être appliqué en toute généralité à notre cadre des équations amorties en dimension trois (2.1) et l’essentiel du problème repose sur le manque d’information sur l’unicité des solutions du problème de Cauchy.
Néanmoins cette étude nous suggère de considérer les solutions éternelles des équations (2.1) et un cas particulier des solutions éternelles sont les solutions stationnaires . En effet, comme la fonction
est constante en temps alors cette fonction est bien évidemment définie pour tout temps et de plus, comme la fonction vérifie les équations (2.2) et comme l’on a , alors cette fonction vérifie aussi les équations (2.1).
Nous observons alors que l’étude du problème en temps long des équations (2.1) nous amène finalement à l’étude des équations stationnaires (2.2) et dans la Section 2.3.1 nous allons voir que les solutions de ces équations stationnaires nous permettent de comprendre le comportement en temps des solutions des équations non stationnaires (2.1) dans un cadre particulier lorsque le fluide est en régime laminaire. Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d’abord étudier un peu plus les équations stationnaires (2.2) et nous allons montrer un résultat général sur l’existence des solutions de ces équations.
2.1.2 Existence
Comme annoncé nous considérons ici le système de Navier-Stokes amorti et stationnaire (2.2) et nous allons construire des solutions dans le cadre de l’espace de Sobolev , mais, avant de construire ces solutions il convient d’expliquer un peu plus en détails pourquoi nous cherchons à construire des solutions dans cet espace fonctionnel. Le choix de l’espace est une conséquence des estimations a priori suivantes: si nous supposons que la vitesse et la force sont suffisamment régulières et intégrables alors, en multipliant les équations (2.2) par et puis en intégrant en variable d’espace nous avons (formellement)
d’où, comme , par une intégration par parties nous avons (toujours formellement) les identités
et alors nous obtenons l’identité
d’où nous pouvons écrire
Dans le dernier terme à droite ci-dessus nous observons que si l’on a et alors en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans ce dernier terme nous obtenons
d’où nous écrivons (au moins formellement) l’estimation a priori suivante:
| (2.13) |
Avec ces estimations formelles, nous pouvons observer que l’espace est un espace naturel pour la force et avec nous sommes censés obtenir des solutions dans l’espace .
Observons aussi que le terme d’amortissement entraîne un contrôle sur la norme des solutions . Dans la Section 2.3 nous allons étudier quelques propriétés intéressantes des solutions qui sont entraînées par ce terme .
Une fois que nous avons fait ces calculs préliminaires, nous allons construire des solutions des équations stationnaires (2.2) et pour cela nous procéderons de la façon suivante: comme nous travaillons dans l’espace tout entier, dans un premier temps nous appliquons le projecteur de Leray aux équations (2.2) et comme et nous obtenons ainsi les équations
d’où nous pouvons écrire
où est l’opérateur identité. Dans cette expression nous observons que ces équations s’écrivent formellement comme le problème de point fixe équivalent suivant:
| (2.14) |
Ainsi, nous utiliserons un principe de point fixe pour résoudre ce problème et ensuite, à partir de la solution nous pourrions récupérer le terme de pression qui est relié à cette fonction par la relation .
À ce stade il est important de souligner qu’il y a plusieurs façons de résoudre le problème de point fixe (2.14). En effet, une manière classique de résoudre ce problème est d’utiliser le principe de contraction de Picard, où l’on obtient l’existence et l’unicité de la solution, mais avec cette méthode nous sommes obligés de contrôler la taille de la force : et alors nous avons l’existence et l’unicité de la solution seulement pour des forces suffisamment petites. En effet, pour appliquer le principe de contraction de Picard nous devons contrôler le terme et pour cela nous devons finalement obtenir un contrôle sur la taille de la force : l’opérateur s’exprime au niveau de Fourier par le symbole et comme nous avons l’estimation nous obtenons alors l’estimation .
Une deuxième façon de résoudre le problème de point fixe (2.14) repose sur l’estimation a priori (2.13) où en utilisant le principe de point fixe de Schaefer (voir le Lemme 2.1.1 ci-dessous) nous pouvons construire des solutions pour n’importe quelle force et donc il s’agit d’une façon plus générale de construire ces solutions. Néanmoins comme nous allons le voir cette méthode nous ne fournit aucune information supplémentaire sur l’unicité des solutions.
Nous allons préférer ici cette deuxième façon de construire des solutions du problème (2.14) (et donc de construire des solutions des équations (2.2)) car le fait de ne pas contrôler la taille force nous permettra après de caractériser le régime turbulent du fluide, ce qui sera expliqué plus en détail dans la Section 2.2; et ensuite dans la Section 2.3.2 nous étudierons quelques propriétés des solutions dans ce régime turbulent.
Nous avons de cette façon le résultat suivant sur l’existence des solutions des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires.
Théorème 2.1.1
Avant de prouver ce théorème faisons les remarques suivantes. La preuve de ce théorème suit les grandes lignes de la preuve du Théorème du livre [46]; et comme l’on a déjà mentionné cette preuve repose essentiellement sur l’estimation à priori (2.13) et le théorème de point fixe de Schaefer que nous énonçons en toute généralité comme suit (voir le Théorème du livre [46] pour plus de références sur ce résultat).
Lemme 2.1.1
Soit un espace de Banach et un opérateur qui satisfait:
-
1)
est un opérateur continu,
-
2)
est un opérateur compact,
-
3)
Estimation a priori: il existe une constante telle que, pour tout , si vérifie l’équation alors on a .
Alors, il existe une solution du problème de point fixe .
Ainsi, dans le cadre de ce lemme nous définissons l’espace comme
| (2.15) |
muni de la norme et de plus, nous définissons l’opérateur par l’expression (2.14):
| (2.16) |
et nous voulons maintenant vérifier que cet opérateur satisfait les hypothèses du Lemme 2.1.1 mais nous trouvons ici une contrainte technique. En effet, le point ci-dessus sera vérifié par le Lemme 2.1.2 ci-après, tandis que, le point sera vérifié par l’estimation (2.13), néanmoins, nous allons voir que le point qui porte sur la compacité de l’opérateur pose des problèmes techniques. En effet, si nous prenons une suite bornée dans l’espace défini dans (2.15), nous savons qu’il existe une sous suite qui converge faiblement dans cet espace et alors par la continuité de l’opérateur nous avons seulement la convergence faible la suite et non pas sa convergence forte et ainsi la compacité de l’opérateur T semble hors de portée.
De ce cadre, nous allons contourner ce problème technique de la façon suivante: il s’agit d’approcher l’opérateur par une famille d’opérateurs compacts qui vérifient les hypothèses du Lemme 2.1.1 et alors nous obtiendrons une famille de solutions approchées où pour tout . Ensuite, par un lemme de Rellich-Lions nous prouvons que cette famille converge vers une solution des équations (2.2).
Démonstration du Théorème 2.1.1. Soit telle que , si et si et soit . Nous définissons la fonction de troncature par et alors, dans le terme bilinéaire de (2.16) nous écrivons , et nous définissons ainsi l’opérateur approché par
et pour mener à bien les estimations dont on a besoin nous récrivons cette opérateur comme
| (2.17) |
Vérifions maintenant que cet opérateur satisfait les hypothèses du Lemme 2.1.1.
-
Continuité. Soient et nous avons
d’où, nous écrivons
(2.18) et alors nous obtenons
(2.19) À ce stade nous avons besoin de l’estimation suivante:
Lemme 2.1.2
Pour tout tels que et on a:
Preuve. On commence par écrire
où par les lois de produit (voir le livre [46]) nous pouvons finalement écrire
Ainsi, nous appliquons cette estimation à chaque terme à droite de l’inégalité (4.45) et nous avonsD’autre part, nous étudions un peu plus le dernier terme à droite où l’on a l’estimation
et alors nous pouvons écrire
d’où nous concluions la continuité de l’opérateur sur l’espace .
-
2)
Compacité. Soit donc une suite bornée dans . Alors, la suite est aussi bornée dans et en plus, comme la fonction est définie par et la function de test satisfait , alors, nous avons et donc , pour tout nous avons
De cette façon, par le lemme de Rellich-Lions il existe une sous-suite , qui pour simplifier l’écriture sera notée comme , et il existe telles que la suite converge fortement vers dans mais aussi dans pour .
Ainsi, pour vérifier la compacité de l’opérateur nous allons montrer que la suite converge fortement vers dans . En effet, par l’identité (2.18) nous commençons par écrireet pour traiter les termes à droite ci-dessus nous avons l’estimation suivante:
Lemme 2.1.3
On a pour tout .
Nous prouverons ce lemme à la fin du chapitre et maintenant, en appliquant ce lemme à chaque terme de l’identité précédente nous avons
et nous cherchons à montrer que les termes et ci-dessus convergent vers zéro lorsque tend à l’infini. Pour traiter les termes et nous utiliserons l’identité suivante: soient et deux fonctions vectorielles, alors on peut écrire
(2.20) Ainsi, pour étudier le terme , dans l’identité ci-dessus nous prenons et et alors nous pouvons écrire
Nous avons encore besoin d’étudier les termes et ci-dessus. Pour le terme , par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder nous avons
d’où, comme la suite est bornée dans et comme , nous avons donc que cette suite bornée dans et alors elle est aussi bornée dans . De cette façon, par les estimations précédentes nous pouvons écrire
d’où, comme la suite converge fortement vers dans nous avons alors que le terme converge vers zéro lorsque tend vers l’infini.
Pour le terme , toujours par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder nous pouvons écrired’où, comme la suite comme la suite converge fortement vers dans nous avons ainsi que le terme converge vers zéro lorsque tend vers l’infini et de cette façon le terme n’annule si .
La vérification que le terme converge vers zéro lorsque suit essentiellement les mêmes lignes que le terme .
Nous avons donc que converge fortement vers dans et alors est un opérateur compact sur cet espace. -
3)
Estimation a priori. Soit donc , si satisfait l’équation de point fixe , par la définition de l’opérateur nous avons l’identité
d’où nous pouvons écrire
et alors nous observons que satisfait l’équation
(2.21) Maintenant, comme alors nous savons que et dans l’équation ci-dessus nous obtenons l’identité
où, comme et par les propriétés du projecteur de Leray nous avons
et de cette façon, par une intégration par parties nous écrivons
d’où nous avons
De plus, comme , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz et les inégalités de Young nous pouvons écrire
et alors nous obtenons
(2.22) Finalement, nous posons la constante et nous vérifions de cette façon le point du Lemme 2.1.1.
Ainsi, par une application de ce lemme il existe solution de l’équation de point fixe .
Une fois que l’on a montré l’existe des solutions (pour fixe) du problème de point fixe ci-dessus nous allons montrer que la famille de solutions converge vers une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires et amorties. Tout d’abord, par l’estimation (2.22) nous savons que est uniformément bornée dans l’espace et alors
pour tout De cette façon, par le lemme de Rellich-Lions et en appliquant la méthode d’extraction diagonale de Cantor, il existe une suite de nombres positifs , tels que , et il existe telle que la suite converge fortement vers dans . Mais, toujours par l’estimation (2.22) nous avons que converge faiblement dans ce qui nous donne .
De plus, par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous savons que est uniformément bornée dans et donc converge fortement vers dans pour .
Maintenant, nous allons prouver que le terme non linéaire converge vers dans . En effet, pour fixé, comme , nous pouvons écrire
et comme converge fortement vers dans et de plus, étant donné que lorsque , alors nous avons que converge fortement vers dans et de cette façon nous obtenons que converge fortement vers dans . Ainsi, nous avons que converge vers dans et comme, pour nous avons en plus que , nous pouvons écrire .
Une fois que l’on a la convergence de vers dans alors nous avons l’identité suivante au sens des distributions
| (2.23) |
D’autre part, comme vérifie l’équation
et comme et nous pouvons écrire
et alors il existe telle que
À partir de cette identité nous pouvons observer que le rotationnel du terme de gauche ci-dessus est égal à zéro et alors, par l’identité (2.23) nous en tirons que
et alors il existe
telle que . De plus, toujours par la relation et comme nous avons que .
Pour finir la preuve de ce théorème vérifions maintenant que toute solution vérifie l’estimation (2.13). En effet, il suffit de remarquer que si alors par les lois de produit nous avons , et comme alors nous avons . Ainsi, étant donné que vérifie les équations (2.2) nous pouvons écrire
d’où nous pouvons en tirer l’estimation (2.13).
Nous observons ainsi que cette méthode nous permet de construire des solutions des équations (2.2) sans faire aucune hypothèse supplémentaire sur la force extérieure. Mais, cette méthode ne fournit pas d’information additionnelle sur l’unicité de ces solutions et cette question est encore ouverte dans le cadre d’une force extérieure non nulle. En revanche, si l’on considère le cas particulier d’une force alors nous avons le corollaire suivant:
Corollaire 2.1.1
La solution triviale est l’unique solution des équations
Preuve. Par le Théorème 2.1.1 nous savons que toute solution satisfait l’estimation (2.13): , d’où nous observons que si alors est l’unique solution des équations ci-dessus.
Néanmoins, dans ce chapitre nous allons travailler avec une force non nulle et cette force sera le fil conducteur dans notre étude comme nous l’expliquerons plus tard dans la Section 2.2.2.
Une fois que nous avons construit des solutions des équations (2.2) dans la Section 2.3 nous rentrons dans le vif du sujet et nous étudions quelques propriétés intéressantes de ces solutions: leur stabilité et la localisation en variable d’espace.
Mais avant d’entrer dans les détails techniques, nous avons besoin de préciser encore un peu plus notre cadre de travail et c’est pour cette raison que dans la section suivante nous allons introduire deux objets qui seront à la base de notre étude.
2.2 Le régime laminaire et le régime turbulent
Ces deux régimes du fluide seront caractérisés par le nombre de Grashof que nous introduisons tout de suite.
2.2.1 Les nombres de Grashof
Dans la Section 1.1.1 page 1.1.1 nous avons expliqué comment le nombre de Reynolds sert à caractériser le régime du mouvement du fluide laminaire (ou turbulent) mais cette quantité dépend des solutions des équations de Navier-Stokes et alors ce nombre nous donne une caractérisation a posteriori du régime laminaire ou turbulent du fluide.
Dans ce cadre, afin d’obtenir une caractérisation a priori du régime laminaire (ou turbulent) nous allons introduire une quantité équivalente au nombre de Reynolds et en suivant une idée des articles [22], [24] et [25] de C. Foias, R. Temam et al. nous allons considérer ici le nombre Grashof. Mais avant de définir ce nombre nous avons besoin d’introduire tout d’abord quelques quantités physiques.
En effet, pour définir le nombre de Grashof nous avons besoin de considérer une longueur caractéristique (comme dans la définition du nombre de Reynolds ci-dessus) mais cette longueur est très particulière car elle correspond à une signification physique bien précise: dans le cadre périodique elle représente la période et dans les autres cas elle est sensée représenter la dimension du domaine utilisé. Étant donné que cette notion physique est délicate à mettre en place lorsqu’on travaille sur l’espace tout entier, et en suivant les idées du chapitre précédent nous allons intégrer cette longueur comme un paramètre du modèle: il s’agira alors d’une donnée du problème tout comme la constante de viscosité . Avec cette idée en tête nous commençons par fixer tous les paramètres physiques que nous considérerons dans ce chapitre.
Définition 2.2.1 (Les paramètres physiques)
-
1)
est toujours la constante de viscosité du fluide.
-
2)
est la longueur caractéristique du fluide: la plus grande échelle de longueur sur laquelle on veut étudier le comportement laminaire ou turbulent du fluide.
-
3)
(avec ) est l’échelle d’injection d’énergie: l’échelle de longueur à laquelle la force agira sur le fluide.
-
4)
est l’amplitude que l’on donnera à la force extérieure .
Une fois que l’on a fixé les paramètres physiques ci-dessus nous pouvons maintenant introduire les nombres de Grashof où sera un paramètre d’interpolation.
En effet, dans la littérature, il n’y a pas de façon standard pour définir le nombre de Grashof et pour les paramètres physiques donnés dans la définition ci-dessus, dans les notes de cours [16] de P. Constantin, il est suggéré de définir le nombre de Grashof par
où nous pouvons observer que seule la longueur caractéristique est considérée et l’échelle d’injection d’énergie n’a pas été prise en compte.
D’autre part, dans les articles [22], [24] et [25] de C. Foias, R. Temam et. al. les auteurs considèrent le nombre de Grashof
où cette fois-ci la longueur caractéristique a été négligée et seule l’échelle d’injection d’énergie est considérée.
Remarquons que comme la longueur caractéristique vérifie toujours la relation (voir le point de la Définition 2.2.1) alors on obtient la relation
et bien sûr ces deux quantités sont égales si l’on a .
Dans ce cadre, dans la définition du nombre de Grashof que nous allons mettre en œuvre ici, nous allons interpoler entre les échelles et et nous définissons une famille de nombres de la façon suivante.
Définition 2.2.2 (Nombres de Grashof)
Soient les paramètres physiques donnés dans la Définition 2.2.1. Pour nous définissons le nombre de Grashof par
Dans cette définition nous pouvons observer que si l’on prend le paramètre alors obtient le nombre et si l’on fixe le paramètre on a bien ce qui correspond aux définitions du nombre de Grashof considérées dans la littérature.
Une fois que l’on a définit la famille de nombres de Grashof nous étudions la relation entres ces nombres.
Proposition 2.2.1
Si alors on a .
Preuve. En effet, nous pouvons écrire , d’où, par le point de la Définition 2.2.1 nous avons et alors . De cette façon, en revenant a l’identité précédente nous obtenons
Nous pouvons alors observer que si l’on contrôle un nombre de Grashof , alors on contrôle tous les nombres de Grashof avec .
Le régime laminaire que nous allons considérer tout au long de la Section 2.3.1 correspond à un contrôle sur le nombre de Grashof , pour un certain paramètre et une constante que nous fixerons plus tard.
Observons maintenant qu’étant donné que la force extérieure des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires (2.2) est une donnée de notre modèle, nous voulons à présent relier le contrôle sur le nombre de Grashof avec un contrôle sur cette force et donc, dans le section qui suit nous cherchons à construire une force extérieure de sorte que la taille de cette fonction puisse être directement reliée avec le nombre de Grashof . L’idée sous-jacente étant de contrôler avec un seul paramètre la turbulence et la force.
2.2.2 Une force extérieure bien préparée
Dans cette section nous définissons une force extérieure très particulière qui sera utilisée tout au long de ce chapitre et pour cela nous avons besoin d’introduire l’ondelette suivante.
Définition 2.2.3
Soit un champ de vecteurs dans la classe de Schwartz tel que:
-
1)
est un vecteur à divergence nulle.
-
2)
Pour deux constantes fixées, on a , pour tout .
-
3)
Pour tout champ de vecteurs dans la classe de Schwartz qui vérifie la propriété ci-dessus, on a
pour tout et où est la fonction delta de Kronecker.
Dans le lemme qui suit nous énonçons quelques propriétés bien connues sur les ondelettes qui nous seront utiles par la suite, voir les livres [38] de J.P. Kahane & P.G. Lemarié-Rieusset et [56] de Y. Meyer pour une preuve de ces résultats classiques et pour plus de détails sur les ondelettes.
Lemme 2.2.1
Soit le champ de vecteurs donné par la Définition 2.2.3. Pour tout on définit Alors:
-
1)
Pour tout il existe une constante telle que, pour tout nombre réel , on a la majoration:
-
2)
Pour il existe deux constantes , qui ne dépendent que de et , telles que, pour toute suite on a la propriété de presque-orthogonalité:
Une fois que nous avons introduit l’ondelette ci-dessus nous pouvons construire la force extérieure . Ainsi, pour la longueur caractéristique du fluide, donnée dans la Définition 2.2.1, nous considérons le cube . Comme l’échelle d’injection d’énergie est telle que alors, dans le cube , nous allons considérer les points de la forme où avec , voir la Figure ci-dessous.
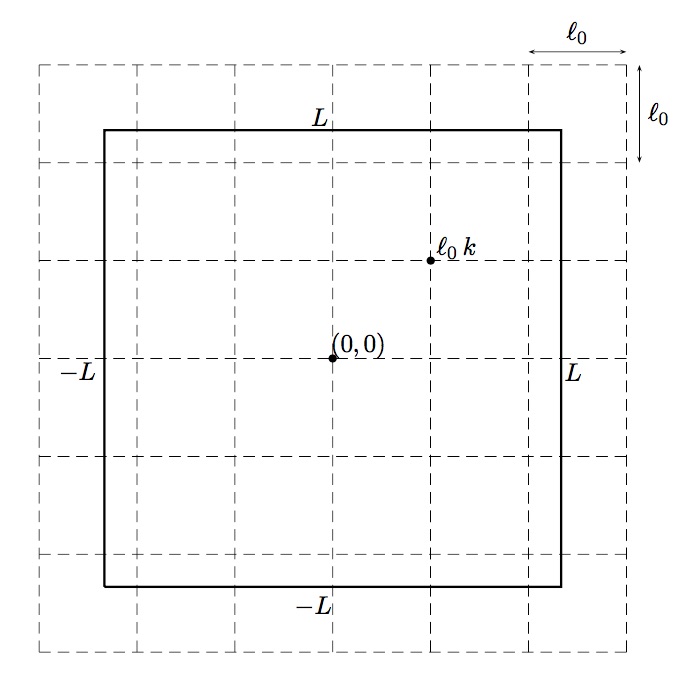
De cette façon, en suivant une idée de l’article [22] de C. Doering et C. Foias (qui a été donnée dans le cadre périodique), nous construisons la force par translation de la fonction en chaque point (avec ) et par dilatation à l’échelle . Nous avons donc:
Définition 2.2.4 (La force extérieure)
Grâce à cette définition nous observons directement que la force est un champ de vecteurs dans la classe de Schwartz et à divergence nulle.
Dans les deux lemmes ci-dessous nous étudions maintenant quelques propriétés de ce champ de vecteurs qui nous seront utiles par la suite.
Lemme 2.2.2
Soient la longueur caractéristique du fluide donnée dans la Définition 2.2.1, la force donnée par la Définition 2.2.4 et . Nous avons les points suivants:
-
1)
Concentration en variable spatiale. Pour tout nombre réel considérons le cube dilaté et son complémentaire . Alors la quantité
est à décroissance rapide lorsque tend vers l’infini.
-
2)
Support fréquentiel. On a , où sont les constantes données dans le point de la Définition 2.2.3.
Preuve.
- 1)
-
2)
Ce point est une conséquence directe de la Définition 2.2.4.
Il convient maintenant de faire la remarque suivante.
Remarque 2.1
Le Lemme 2.2.2 nous donne des informations intéressantes par rapport à la concentration de la force extérieure en variable spatiale ou en fréquence. En effet:
-
i)
En variable d’espace. La quantité mesure la concentration de la fonction hors du cube dilaté et donc, comme la quantité est à décroissance rapide lorsque tend vers l’infini nous observons donc que la fonction est essentiellement concentrée sur le cube .
-
ii)
En variable de fréquence. La transformée de Fourier de la force est localisée aux fréquences ce qui correspond au fait que, selon le modèle de cascade d’énergie expliqué dans l’introduction du chapitre précédent, cette force introduit l’énergie cinétique aux échelles de longueur de l’ordre de et donc aux fréquences de l’ordre de .
Nous étudions maintenant une deuxième propriété utile de la force .
Lemme 2.2.3
Preuve. Pour tout nous avons
où la suite est définie par
Alors, en prenant la norme à chaque côté de l’identité ci-dessus et ensuite en utilisant le point du Lemme 2.2.1, on a qu’il existe deux constantes telles que
| (2.24) |
pour . D’autre part, par la définition de la suite nous observons que est le nombre de points de la forme dans le cube et alors, il existe deux constantes (indépendantes des paramètres et ) telles que
et donc, en posant les constantes et par l’expression (2.24) nous obtenons l’estimation cherchée.
Remarque 2.2
Comme les constantes et sont indépendantes des paramètres , nous écrirons par la suite
| (2.25) |
d’où nous avons les estimations suivantes: si , alors on a , pour tout . En particulier, pour on obtient et donc nous observons que l’amplitude de la force est bien donnée par le paramètre introduit dans la Définition 2.2.1. De plus, comme et comme est essentiellement concentrée sur le cube (voir le point du Lemme 2.2.2) alors le paramètre mesure aussi la moyenne de la force en norme , avec .
L’intérêt principal de travailler avec cette force repose sur le fait que grâce à l’estimation (2.25) ci-dessus nous allons pouvoir contrôler la taille de cette fonction par un contrôle direct sur le nombre de Grashof . En effet, nous avons le résultat suivant.
Proposition 2.2.2
Preuve. Par le Lemme 2.2.3, pour et nous avons l’estimation
Maintenant, si nous posons et alors nous obtenons la relation
ce qui termine la preuve de cette proposition.
Ainsi, nous pouvons écrire d’où nous observons que si nous contrôlons le nombre de Grashof alors nous contrôlons la taille de la force dans l’espace de Sobolev .
Cette relation sera utilisée dans la Section 2.3.1 où nous étudierons quelques propriétés des solutions des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires (2.2) dans le régime laminaire.
2.3 Quelques propriétés des solutions stationnaires
Maintenant que nous avons tous les ingrédients nécessaires nous allons rentrer dans le vif du sujet. Soit une solution des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires
| (2.26) |
obtenue par le biais du Théorème 2.1.1 et où est la force donnée dans la Définition 2.2.4.
Nous allons étudier maintenant quelques propriétés de ces solutions. Dans la Section 2.3.1 ci-dessous nous étudions une première propriété relative à la stabilité de la solution : si nous considérons une donnée initiale et une solution faible du problème de Cauchy pour les équations de Navier-Stokes amorties (construite dans le Théorème 1.2.1 du chapitre précédent à partir de la donnée initiale ) alors nous voulons étudier la convergence
| (2.27) |
et cette convergence est également appelée la stabilité de la solution car nous pouvons observer qu’à partir de n’importe quelle donnée initiale initiale alors toute solution faible des équations de Navier-Stokes amorties associée à cette donnée initiale converge toujours vers la solution stationnaire lorsque le temps tend vers l’infini.
Comme mentionné au début de ce chapitre, l’intérêt d’étudier la stabilité de la solution stationnaire donnée dans (2.27) est que cette propriété nous permet de donner une réponse au problème du comportement en temps long des solutions que l’on a introduit dans la Section 2.1.1. Plus précisément, dans le Théorème 2.3.2 ci-après, nous montrons que si l’on a un contrôle sur le nombre de Grashof (avec un paramètre choisi convenablement) alors on a la convergence (2.27) et nous pouvons ainsi observer que toute solution faible des équations de Navier-Stokes amorties se comporte comme une solution stationnaire de ces équations dans le régime asymptotique lorsque .
Il est aussi important de remarquer que la propriété de stabilité (2.27) est seulement valable lorsqu’on contrôle le nombre de Grashof (ce qui caractérise le régime laminaire du mouvement du fluide) et qu’une étude précise du comportement en temps long des solutions dans le cadre plus général d’un fluide en régime turbulent (où l’on ne contrôle pas le nombre de Grashof ) est une question ouverte (voir la Section 2.1.1 pour tous les détails à ce sujet).
Dans la Section 2.3.2 nous étudions une toute autre propriété des solutions stationnaires qui porte sur la localisation spatiale de ces solutions: rappelons que la force donnée dans le Définition
2.2.4 est une fonction qui appartient à la classe de Schwartz et donc cette force est bien localisée en variable d’espace; il s’agit alors d’étudier la localisation spatiale en variable d’espace des solutions associées à cette force et dans ce cadre, dans le Théorème 2.3.3, nous allons prouver que toute solution des équations (2.26) a une décroissance
| (2.28) |
lorsque est suffisamment grand.
Soulignons maintenant que pour vérifier l’estimation (2.28) on n’a pas besoin de faire aucun contrôle sur le nombre de Grashof et ainsi ce résultat est valable que dans le régime laminaire mais aussi dans le régime turbulent du fluide et donc il s’agit d’un résultat général sur la localisation spatiale des solutions des équations (2.26).
Expliquons maintenant l’intérêt d’étudier cette localisation spatiale. Dans la Section 1.3.1 du chapitre précédent nous avons fait une discussion sur la difficulté de trouver une notion adéquate de longueur caractéristique (qui représente la plus grande échelle de longueur où l’on veut le comportement turbulent du fluide) lorsqu’on considère un fluide dans tout l’espace . Dans ce cadre, dans la Section 2.2.1 nous avons fixé cette longueur comme un paramètre du modèle (tout comme la constante de viscosité du fluide) et nous avons construit la force de sorte que cette fonction est essentiellement localisée en variable d’espace sur le cube (voir le point du Lemme 2.2.2 et le point de la Remarque 2.1 pour tous les détails): l’idée sous-jacente étant que pour une longueur fixe nous voulons étudier le comportement turbulent du fluide dans le cube et la force est bien localisée sur ce cube.
Nous voulons maintenant savoir comment la solution stationnaire associée à la force est localisée sur le cube ci-dessus et pour cela par la décroissance en variable d’espace de cette solution donnée dans (2.28) nous pouvons en tirer l’estimation
où dénote l’ensemble complémentaire du cube , et cette estimation nous donne une mesure plus précise de la façon comment la solution stationnaire est localisée sur le cube . En effet, nous pouvons observer que le volume de la solution en dehors de ce cube, qui est mesuré par l’intégrale à gauche dans l’estimation ci-dessus, est de l’ordre de .
2.3.1 Stabilité dans le cadre laminaire
Le but de cette section est de montrer la convergence (2.27) et pour cela nous aurons besoin de contrôler le nombre de Grashof . Ainsi, dans cette section nous supposons que nous avons le contrôle , avec un certain paramètre qui apparaîtra dans les estimations dont on aura besoin; et où est une constante qui ne dépend d’aucun paramètre physique donné dans la Définition 2.2.1 ni du paramètre d’amortissement des équations (2.26).
Expliquons maintenant pourquoi nous avons besoin de supposer ce contrôle sur le nombre de nombre de Grashof . Dans le Théorème 2.1.1 nous avons montré un résultat général d’existence des solutions des équations stationnaires (2.26) où ces solutions vérifient toujours l’estimation (voir l’estimation (2.13) page 2.13), néanmoins, pour étudier la convergence (2.27) nous avons besoin d’un contrôle plus précis sur la taille de la solution et pour cela, dans le point ci-dessous, nous allons tout d’abord montrer que si l’on contrôle le nombre de Grashof alors nous pouvons construire une solution des équations (2.26) de sorte que la taille de cette solution peut être contrôlée convenablement par ce nombre et ceci sera fait dans le Théorème 2.3.1 ci-après. Ensuite, dans le point , nous allons voir que ce contrôle sur la taille de la solution nous permettra finalement de vérifier la propriété de stabilité de cette solution donnée dans (2.27) et ceci sera fait dans le Théorème 2.3.2 qui, comme l’on a déjà, mentionné est le résultat principal de cette section.
A) Contrôle sur la solution stationnaire
Si nous supposons un contrôle sur le nombre de Grashof nous allons voir que l’on peut utiliser le principe de contraction de Picard pour construire une solution des équations (2.26) telle que la taille de cette solution est contrôlée par ce nombre . Dans ce cadre nous commençons donc par écrire les équations (2.26) comme un problème de point fixe équivalent (voir l’expression (2.14) page 2.14):
où, pour mener à bien les estimations dont on aura besoin il convient de réécrire ce problème comme suit:
| (2.29) |
où l’opérateur est défini au niveau de Fourier par le symbole et comme pour tout , nous avons que est un opérateur linéaire et borné dans tous les espaces de Sobolev (): pour tout on a la majoration
| (2.30) |
Nous cherchons à trouver un espace fonctionnel dans lequel on puisse vérifier la continuité de la forme bilinéaire
| (2.31) |
pour tout , avec une constante indépendante de et et en plus, dans lequel on puisse relier la condition de petitesse sur le terme par le contrôle sur le nombre de Grashof :
| (2.32) |
avec une valeur convenable du paramètre . Donc, pour vérifier les points (2.31) et (2.32) nous introduisons l’espace fonctionnel défini par
| (2.33) |
et muni de la norme
| (2.34) |
où est la longueur caractéristique du fluide et est l’échelle d’injection d’énergie. Nous observons que l’on a l’inclusion et alors:
Théorème 2.3.1
Soient et les paramètres physiques donnés dans la Définition 2.2.1, soit la force donnée dans la Définition 2.2.4 et soit le nombre de Grashof . Il existe une constante , qui ne dépend pas des paramètres physiques ci-dessus, telle que si alors il existe solution des équations de Navier-Stokes stationnaires et amorties (2.26) qui est l’unique solution qui vérifie l’estimation
| (2.35) |
où est une constante indépendante des paramètres physiques.
Si nous comparons ce résultat avec le Théorème 2.1.1 page 2.1.1 nous pouvons observer que si nous supposons un contrôle sur le nombre de Grashof alors nous pouvons construire une solution des équations (2.26) qui vérifie en plus l’estimation (2.35) et cette estimation va nous permettre d’étudier la stabilité cette solution dans le point ci-après.
Démonstration. Étant donné que nous écrivons le terme non linéaire comme et nous étudions la quantité
Nous commençons par vérifier la continuité du terme bilinéaire sur l’espace et pour cela nous avons besoin d’estimer chaque terme de la norme donnée par l’expression (2.34). Pour le premier terme qui compose la norme par la continuité de l’opérateur (voir l’inégalité (2.30)) et par la continuité du projecteur de Leray, nous avons
d’où, par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder nous obtenons
Ensuite, pour le deuxième terme de la norme , toujours par la continuité de l’opérateur et du projecteur de Leray, nous avons
d’où, par l’inégalité de Hölder et les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous pouvons écrire
Finalement, pour le troisième terme de la norme par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons
d’où,
Dans la dernière expression ci-dessus, nous appliquons encore les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder pour obtenir
De cette façon, la propriété de continuité du terme bilinéaire sur l’espace énoncée dans (2.31) est bien vérifiée par les estimations ci-dessus, où on pose la constante
| (2.36) |
qui, comme nous pouvons observer, ne dépend d’aucun paramètre physique.
Vérifions maintenant le contrôle sur le terme donné dans (2.32) et pour cela nous avons besoin tout d’abord de vérifier l’estimation
| (2.37) |
Nous allons estimer chaque terme de la norme donnée par l’expression (2.34). Pour le premier terme de la norme , par la continuité de l’opérateur nous pouvons écrire
mais, par le point du Lemme 2.2.2, page 2.2.2, nous savons que la fonction est essentiellement concentrée sur le cube et alors nous introduisons la fonction de troncature suivante: soit telle que est égale à sur la boule et qui s’annule en dehors de la boule et nous considérons sa dilatation à l’échelle , notée , de sorte que nous avons pour et pour . De cette façon, nous pouvons écrire
| (2.38) |
avec une constante qui ne dépend d’aucun paramètre. Donc, par l’inégalité de Hölder nous avons
et alors nous obtenons
D’autre part, par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons , d’où, par les estimations ci-dessus nous écrivons
| (2.39) |
Pour le deuxième terme de la norme , toujours par la continuité de l’opérateur nous avons
et en utilisant l’identité de Plancherel nous écrivons , mais par le point du Lemme 2.2.2 nous savons que et alors nous pouvons écrire
ce qui équivaut à l’inégalité
et en suivant les mêmes estimations réalisées dans (2.38) et (2.39), nous obtenons
Étudions maintenant le troisième terme de la norme . Par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et par la continuité de l’opérateur nous écrivons
De cette façon, par l’inégalité ci-dessus nous obtenons l’estimation (2.37).
Une fois que nous disposons de cette estimation nous allons maintenant contrôler la quantité . En effet, par la Proposition 2.2.2 (en prenant et ) nous avons
et alors, dans l’inégalité précédente nous obtenons
Nous observons que le nombre de Grashof apparaît naturellement dans cette estimation et alors nous pouvons écrire
où la constante ne dépend d’aucun paramètre.
Une fois que nous avons les estimations (où la constante est donnée dans (2.36)) et , afin d’obtenir une solution des équations (2.29), nous devons vérifier la condition qui équivaut à l’inégalité
| (2.40) |
Nous observons que la dépendance du paramètre a disparu dans cette inégalité et que la constante ci-dessus ne dépend d’aucun paramètre physique ni du paramètre d’amortissement . De cette façon, on obtient une fonction qui est solution de (2.29) et qui est l’unique solution dans la boule .
B) Stabilité de la solution stationnaire
Une fois que nous avons construit une solution qui vérifie l’estimation (2.35) nous pouvons étudier maintenant la stabilité de cette solution.
Théorème 2.3.2
Soient et les paramètres physiques donnés dans la Définition 2.2.1, soit la force donnée dans la Définition 2.2.4 et soit le nombre de Grashof . Soit le sous-espace donné dans (3.54) et soit l’unique solution des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires,
obtenue par le biais du Théorème 2.3.1.
D’autre part, soit une donnée initiale à divergence nulle et soit une solution faible du problème de Cauchy
construite dans le Théorème 1.2.1.
Si , où est la constante donnée dans (2.37) et qui ne dépend d’aucun paramètre physique alors on a
| (2.41) |
Nous observons ainsi que si l’on a le contrôle sur le nombre de Grashof: , alors à partir de n’importe quelle donnée initiale on a que l’évolution au cours du temps du champ de vitesse associé à cette donnée initiale converge toujours vers la solution stationnaire lorsque le temps tend vers l’infini; et l’on obtient ainsi une description précise du comportement en temps long des solutions dans le cadre d’un fluide en régime laminaire.
Démonstration. Soit une solution de faible des equations de Navier-Stokes amorties construite à partir d’une donnée initiale et la solution stationnaires de ces équations. On pose
où , et l’on cherche à montrer que . Pour cela nous avons besoin de vérifier que la fonction satisfait l’inégalité d’énergie suivante:
Lemme 2.3.1
Pour tout on a:
| (2.42) | |||||
La preuve de ce lemme technique repose essentiellement sur l’inégalité d’énergie vérifiée par la solution et qui a été étudiée dans la Proposition 1.2.1 page 1.2.1; et cette preuve sera faite à la fin du chapitre page 2.4.2. Ainsi, nous supposons pour l’instant que l’inégalité d’énergie ci-dessus est vraie et dans le troisième terme à droite de cette inégalité, en utilisant le fait et , nous pouvons écrire
et comme , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, l’inégalité de Hölder et les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous écrivons
Alors, en remplaçant cette dernière estimation dans (2.42) nous obtenons
| (2.43) |
Mais, par la définition de la norme donnée par l’expression (2.34) nous savons que et de plus, par le Théorème 2.3.1 nous avons l’estimation et donc nous obtenons .
De cette façon, si nous supposons le contrôle sur le nombre de Grashof: , alors dans l’estimation précédente de la quantité nous obtenons ; et alors nous avons que la quantité est une quantité négative de sorte que, en revenant à l’estimation (2.43), nous pouvons écrire
Finalement, nous appliquons le lemme de Grönwall pour obtenir l’estimation
d’où nous pouvons en tirer que
.
Nous pouvons observer que l’essentiel de cette preuve du Théorème 2.3.2 repose sur le contrôle de la taille de la solution stationnaire : ; et ce contrôle repose finalement sur un contrôle sur le nombre de Grashof .
Dans ce cadre, nous observons que l’étude de la stabilité de la solution stationnaire que nous venons de faire dans le Théorème 2.3.2 est seulement valable dans le cadre d’un régime laminaire et une étude analogue de cette propriété de stabilité dans un cadre général où l’on ne contrôle pas le nombre de Grashof semble actuellement hors de portée.
Dans la section qui suit nous étudions une toute autre propriété des solutions stationnaires et
nous allons voir que, contrairement à la propriété de stabilité, la localisation spatiale de la solution , valable dans le cadre général où l’on ne fait aucun contrôle sur le nombre de Grashof .
2.3.2 Localisation en variable d’espace dans le cadre turbulent
Dans cette section nous considérons une solution des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires (2.26) où est toujours la force donnée dans la Définition 2.2.4; et nous allons étudier ici la localisation spatiale de la solution obtenue dans le Théorème 2.1.1. Plus précisément, la force étant une fonction bien localisée en variable d’espace (car appartient à la classe de Schwartz) il s’agit d’étudier une estimation du type
| (2.44) |
pour un certain paramètre et pour suffisamment grand.
Lorsqu’on veut étudier cette décroissance en variable d’espace, il est naturel de se poser la question de quel est le plus grand paramètre que l’on peut espérer dans (2.44) et dans ce cadre, pour motiver le résultat obtenu dans le Théorème 2.3.3 ci-dessous nous allons maintenant expliquer pourquoi on s’attend à ce que la solution n’ait pas une meilleure décroissance à l’infini que , même si la force appartient à la classe de Schwartz; et pour expliquer ce fait nous avons besoin de rappeler (rapidement) quelques résultats classiques sur l’étude de la décroissance (2.44) qui ont été obtenus dans le cadre des équations de Navier-Stokes stationnaires sans terme d’amortissement (lorsque ).
Considérons donc pour l’instant le paramètre d’amortissement et les équations de Navier-Stokes stationnaires classiques
| (2.45) |
Si l’on suppose en plus que la force vérifie la condition de petitesse suivante: pour un multi-indice et une constante (suffisamment petite),
| (2.46) |
alors par le Théorème du livre [46] nous avons qu’il existe une solution (classique) des équations (2.45) qui vérifie
| (2.47) |
et alors nous avons le résultat classique suivant:
Proposition 2.3.1
Preuve. Supposons pour l’instant que la solution a une décroissance à l’infini , avec , et on va obtenir une contradiction. Si nous considérons la solution stationnaire ci-dessus comme étant la donnée initiale du problème de Cauchy
| (2.48) |
et comme vérifie la propriété (2.47) alors par le Théorème du livre [46] nous avons qu’il existe un temps (qui dépend de et ) et une fonction qui est l’unique solution du problème de Cauchy (2.48). De plus, comme l’on a supposé que , avec nous avons et alors nous pouvons appliquer le Théorème
du livre [46] pour obtenir que la solution ne peut décroître à l’infini plus rapidement que . Mais, observons que la solution stationnaire est aussi une solution du problème de Cauchy (2.48) et alors, par l’unicité de la solution nous avons et donc la solution stationnaire ne décroît pas à l’infini plus rapidement que .
Nous observons ainsi que si l’on suppose une condition de petitesse sur la force et qui est donnée dans (2.46), alors les solutions classiques des équations (2.45) ne peuvent pas avoir une meilleure décroissance à l’infini que . Ce fait est un résultat classique (voir toujours le Chapitre du livre [46] pour plus de détails) et dans le résultat suivant nous étudions cette décroissance précise à l’infini dans le cadre des équations stationnaires et amorties (2.26).
Ainsi, nous allons montrer que le terme d’amortissement introduit dans ces équations entraîne une décroissance à l’infini du type pour toute solution faible des équations (2.26) et sans aucune condition de petitesse sur la force et donc sans aucun contrôle sur le nombre de Grashof et alors le résultat que nous allons montrer ci-dessous est valable que ce soit dans le régime laminaire et aussi dans le régime turbulent du fluide.
Théorème 2.3.3
Démonstration. La preuve de ce résultat repose essentiellement sur une étude préliminaire de la localisation spatiale de la solution qui est faite dans la proposition suivante:
Proposition 2.3.2
Pour prouver cette proposition nous avons besoin de passer par le cadre de la théorie de la régularité partielle développée principalement dans l’article [8] de Caffarelli-Kohn et Niremberg (voir aussi les Chapitres et du livre [46] pour plus de détails sur cette théorie) et ceci sera fait en détail dans l’appendice à la fin du chapitre. Plus précisément, dans le Théorème 2.4.2 page 2.4.2 nous allons remarquer que cette théorie de la régularité s’adapte facilement au cadre des équations de Navier-Stokes amorties et à partir de ce résultat nous pourrons vérifier la décroissance de la solution donnée dans (2.50). Ainsi, nous allons maintenant supposer la Proposition 2.3.2 et nous allons voir comment à partir de ce résultat nous pouvons démontrer le Théorème 2.3.3.
Soit donc une solution des équations (2.26). Pour étudier la décroissance spatiale (2.49) on commence par écrire cette solution comme la solution du problème de point fixe équivalent (voir l’expression (2.14) page 2.14):
| (2.51) |
et nous allons étudier la décroissance spatiale des deux termes ci-dessus. Plus précisément, nous allons montrer qu’il existe deux constantes et telles que l’on a
| (2.52) |
et
| (2.53) |
pour tout .
Nous allons tout d’abord étudier l’estimation (2.53) car les estimations que nous allons faire avec ce terme nous seront aussi utiles pour étudier après l’estimation (2.52).
L’estimation (2.53) sera une conséquence du lemme suivant:
Lemme 2.3.2
Soit qui vérifie une décroissance , pour et pour tout . Alors il existe une constante telle que l’on a: pour tout ,
| (2.54) |
La preuve de ce lemme sera faite à la fin du chapitre page 2.4.2 et elle repose essentiellement sur le fait que l’on peut écrire
où est le noyau du potentiel de Bessel ; et ce noyau vérifie de bonnes propriétés de décroissance.
Une fois que nous avons énoncé le Lemme 2.3.2 nous pouvons maintenant en tirer l’estimation (2.53) directement de ce lemme. En effet, rappelons que la force donnée dans la Définition 2.2.4 est un champ de vecteurs dans la classe de Schwartz et alors par le Lemme 2.3.2 nous avons que la fonction appartient aussi à la classe de Schwartz (avec ) et donc en prenant dans l’estimation (2.54) nous avons l’estimation (2.53).
Une fois que nous disposons de l’estimation (2.53) nous pouvons maintenant vérifier l’estimation (2.52) et pour mener à bien les estimations dont on a besoin on commence par écrire le terme
de la façon équivalente suivante: tout d’abord, étant donnée que et que alors on peut écrire le terme bilinéaire comme et ensuite nous écrivons
et nous allons maintenant étudier le terme à droite de l’identité ci-dessus. Plus précisément, nous allons montrer que ce terme peut s’écrire comme le produit de convolution avec un noyau et pour définir ce noyau (ce qui sera fait dans l’expression (2.59) ci-après) nous devons tout d’abord étudier le terme .
Nous allons maintenant observer que le terme ci-dessus s’écrit comme le produit de convolution , où est un tenseur avec une fonction homogène de degré . En effet, étant donné que le projecteur de Leray est défini en variable d’espace comme
où avec la i-ème transformée de Riesz; et de plus, étant donné que
nous écrivons alors
| (2.55) | |||||
et en prenant la transformée de Fourier dans chaque terme de la somme ci-dessus nous obtenons .
Nous définissons alors la fonction au niveau de Fourier par
| (2.56) |
où nous pouvons observer que est une fonction homogène de degré et de classe en dehors de l’origine et alors est une fonction homogène de degré .
De cette façon, en revenant à l’identité (2.55) nous écrivons
où, pour simplifier l’écriture on pose le tenseur
| (2.57) |
et par un abus de notation nous allons écrire dorénavant
| (2.58) |
Une fois que l’on a définit le tenseur ci-dessus nous définissons maintenant le noyau comme le tenseur
| (2.59) |
c’est à dire, pour ; et alors par les identités (2.58) et (2.59) nous pouvons alors écrire
| (2.60) |
Une fois que nous disposons de cette identité nous observons que l’estimation (2.52) et alors équivalente a l’estimation
| (2.61) |
pour tout et où est une constante. Vérifions donc l’estimation (2.61). La première chose à faire c’est étudier la décroissance en variable d’espace du noyau ci-dessus et nous avons le lemme technique suivant:
Lemme 2.3.3
Soit le noyau défini par l’expression (2.59). Ce noyau vérifie une décroissance suivante:
| (2.62) |
où est une constante qui dépend seulement de et .
Expliquons rapidement les grandes lignes de la preuve de ce lemme qui, pour la commodité du lecteur, sera faite en détail à la fin du chapitre. Cette preuve suit essentiellement les idées de la preuve du Lemme 2.3.2 mais nous devons contourner quelques contraintes techniques. En effet, observons
par la définition du noyau donnée dans l’expression (2.59) nous savons que
(où le tenseur est défini par les expressions (2.56) et (2.57)) et alors nous pouvons écrire , néanmoins, on ne peut pas appliquer directement ici le Lemme 2.3.2: pour appliquer ce lemme il faut que la fonction appartienne à l’espace mais ceci n’est pas possible car nous allons montrer que cette fonction a une décroissance et alors elle n’est pas intégrable à l’origine. Dans la page 2.4.2 nous allons voir comment contourner ce problème et nous donnons une preuve du Lemme 2.3.3.
Une fois que nous disposons de l’information nécessaire sur la décroissance du noyau , nous revenons maintenant au terme pour vérifier l’estimation (2.61). L’idée pour vérifier cette estimation est la suivante: nous allons tout d’abord montrer que la solution vérifie la décroissance ci-dessous :
Lemme 2.3.4
Pour tout on a .
La preuve de ce lemme repose essentiellement sur le fait que par les identités (2.51) et (2.60) nous pouvons alors écrire la solution des équations (2.26) comme
Ensuite, par la Proposition 2.3.2 nous savons que la solution stationnaire vérifie une décroissance
et par cette décroissance, l’estimation du noyau donnée dans le Lemme 2.3.3 et l’estimation (2.53), nous pouvons montrer que la solution vérifie la décroissance donnée dans le Lemme 2.3.4. Tous les calculs seront faits en détail à la fin du chapitre page 2.4.2; et maintenant nous allons nous servir de ce lemme pour vérifier l’estimation cherchée (2.61).
En effet, pour fixe on commence par écrire
| (2.63) | |||||
et l’on cherche à estimer les termes et ci-dessus.
Pour le terme , comme nous considérons ici alors nous avons les inégalités suivantes: , d’où, étant donné que nous écrivons pour obtenir et ainsi, par l’estimation (2.62) obtenue dans le Lemme 2.3.3 nous avons , et nous pouvons écrire
| (2.64) |
Pour le terme , on commence par écrire
| (2.65) | |||||
et l’on doit estimer chaque terme de l’identité ci-dessus. Pour estimer le terme nous allons utiliser la décroissance de la solution donnée dans le Lemme 2.3.4. En effet, comme nous considérons ici (où comme alors on a ) par ce lemme nous pouvons alors écrire . D’autre part, comme nous considérons aussi , toujours par l’estimation (2.62) (obtenue dans le Lemme 2.3.3) nous savons que ; et nous obtenons de cette façon
| (2.66) |
Pour estimer le terme , rappelons que nous considérons ici et ainsi, toujours par l’estimation (2.62), nous savons que et alors, en suivant les mêmes lignes que l’estimation (2.64) nous obtenons
| (2.67) |
Une fois que nous disposons des estimations (2.66) et (2.67) nous posons maintenant la constante et en revenant à l’identité (2.65) nous pouvons écrire . Ainsi, par cette estimation et par l’estimation (2.64) nous revenons maintenant à l’identité (2.64) où nous obtenons l’estimation cherchée (2.61).
2.4 Appendice
Dans la Section 2.4.1 ci-dessous nous revisitons la théorie de la régularité partielle de Caffarelli, Kohn et Nirenberg dans le cadre des équations de Navier-Stokes stationnaires et amorties; et nous donnons une preuve de la Proposition 2.3.2. Ensuite, dans la Section 2.4.2 nous prouvons les lemmes techniques.
2.4.1 La théorie de la régularité de Caffarelli, Kohn et Nirenberg
Le but de cette section est de donner une preuve de la Proposition 2.3.2 (page 2.3.2) et comme annoncé nous avons besoin de passer par le cadre de la théorie de la régularité partielle de Caffarelli, Kohn et Niremberg [8] (CKN). Pour exposer les idées de la preuve de cette proposition d’une façon plus claire nous avons divisé cet appendice comme suit: dans le point ci-dessous on commence par expliquer les grandes lignes de la preuve de la Proposition 2.3.2 et nous expliquons comment nous allons utiliser ici la théorie CKN. Ensuite, dans le point nous faisons un rappel sur un résultat classique de la théorie CKN dont on a besoin et après nous adaptons ce résultat au cadre des équations de Navier-Stokes stationnaires et amorties; et ceci sera fait dans le Théorème 2.4.2. Finalement, dans le point , à l’aide du Théorème 2.4.2 nous donnons une preuve de la Proposition 2.3.2.
A) Les idées de la preuve de la Proposition 2.3.2
Rappelons rapidement que dans cette proposition nous considérons les équations
| (2.68) |
avec la force donnée dans la Définition 2.2.4; et nous voulons montrer que toute solution (obtenue par le Théorème 2.1.1) vérifie une décroissance en variable d’espace:
| (2.69) |
où est une constante qui dépend de la solution , la constante de viscosité et le paramètre d’amortissement .
Dans l’expression (2.69) nous pouvons observer que cette estimation équivaut aux estimations suivantes:
| (2.70) |
et
| (2.71) |
et il s’agit alors de vérifier ces deux estimations. L’estimation (2.70) sera vérifié dans le Lemme 2.4.1 du point ci-après (où nous allons montrer que la solution appartient à l’espace ) et cette estimation ne présente aucun problème particulier. Mais, l’estimation (2.71) est plus délicate à vérifier car a priori nous ne disposons d’aucune information supplémentaire pour que la solution ait une décroissance comme celle donnée dans (2.71); et pour vérifier cette décroissance nous allons adapter un résultat de la théorie CKN au cadre des équations (2.68).
B) La théorie de la régularité CKN pour les équations amorties
On commence donc par faire un très court rappel sur un résultat de cette théorie. Pour un exposé complet sur l’état de l’art de la théorie de la régularité CKN voir les Chapitres et du livre [46].
Le résultat dont on a besoin est obtenu dans le cadre des équations de Navier-Stokes classiques (sans terme d’amortissement):
| (2.72) |
où est une force qui vérifie pour un temps ; et nous allons maintenant introduire quelques définitions et notations. Pour , et nous considérons le domaine et nous avons les définitions suivantes:
Définition 2.4.1 (Solution faible et solution adaptée)
Maintenant que l’on a introduit ces définitions nous pouvons énoncer le résultat suivant qui s’agit d’un critère de régularité de la théorie CKN (pour une preuve de ce résultat voir le Théorème page du livre [46])
Théorème 2.4.1
Soit le domaine . Soit une solution faible des équations de Navier-Stokes (2.72). Si:
-
1)
,
-
2)
, avec ,
-
3)
est une solution adapté au sens du point de la Définition 2.4.1,
alors il existe deux constantes et , qui ne dépendent que de la constante de viscosité et de , telles que: si pour on a:
-
4)
et
-
5)
;
alors est bornée sur le sous-domaine et l’on a
| (2.74) |
Ce résultat de la théorie CKN a été aussi étudié dans différentes contextes (voir par exemple le Chapitre du livre [45]) et nous n’allons pas faire ici une discussion sur ce sujet. Notre intérêt au Théorème 2.4.1 repose essentiellement sur l’estimation (2.74) comme nous l’expliquons tout de suite: dans cette estimation nous observons que pour tout nous avons , et alors, si pour , où , on pose alors par l’estimation (2.74) nous observons que pour nous pouvons écrire
| (2.75) |
Cette estimation est intéressante car nous pouvons observer qu’ici l’on obtient une décroissance similaire à la décroissance cherchée (2.71) et nous pouvons aussi observer que cette décroissance est valide pour tout car la constante ne dépend pas de .
En suivant ces idées, nous voulons donc adapter le Théorème 2.4.1 au cadre des équations de Navier-Stokes amorties et stationnaires (2.68) pour ensuite pouvoir vérifier l’estimation (2.71). Nous avons ainsi le résultat suivant:
Théorème 2.4.2
Soit la force donnée dans la Définition 2.2.4 et soit une solution des équations (2.68) obtenue dans le Théorème 2.1.1. Soit , et soit la boule . Si:
-
1)
et
-
2)
, avec ,
alors il existe deux constantes et , qui ne dépendent que de la constante de viscosité , le paramètre et le paramètre d’amortissement , telles que: si pour on a:
-
3)
et
-
4)
,
alors la solution est bornée sur la boule et l’on a l’estimation:
| (2.76) |
Démonstration. Comme le champ de vitesse est une fonction stationnaire alors nous avons ; et de plus, comme le couple est une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires et amorties (2.68) alors est aussi une solution des équations de Navier-Stokes amorties:
| (2.77) |
et alors nous allons maintenant montrer que l’on peut appliquer le Théorème 2.4.1 aux équations ci-dessus.
Soit un temps et soit donc le domaine . Observons tout d’abord que est une solution faible des équations (2.77) sur le domaine au sens du point de la Définition 2.4.1. En effet, comme ne dépend que de la variable spatiale et comme nous avons ici un intervalle du temps borné: , alors nous avons . De même façon, comme est une fonction stationnaire nous avons .
Observons maintenant que le champs de vitesse , la pression et la force vérifient les hypothèses , et du Théorème 2.4.1. En effet, Les points et du Théorème 2.4.1 sont une conséquence directe des hypothèses et données dans le Théorème 2.4.2 et du fait que les fonctions et ne dépendent pas de la variable du temps. Quant au point du Théorème 2.4.1, nous allons maintenant montrer que la solution est une fonction adaptée au sens du point de la Définition 2.4.1.
Il s’agit de montrer que la solution vérifie l’inégalité locale (2.73) et pour cela nous remarquons que comme le couple vérifie les équations (2.77) et comme nous avons en plus et alors les fonctions et sont suffisamment régulières et nous pouvons écrire l’identité au sens des distributions suivante:
| (2.78) |
Observons maintenant que le terme ci-dessus a un signe négatif et alors par cette identité nous pouvons aussi écrire l’inégalité (toujours au sens des distributions) suivante:
qui est l’inégalité d’énergie locale (2.73); et donc la solution est bien une solution adaptée au sens de la Définition 2.4.1.
Une fois que l’on a vérifié les points , et du Théorème 2.4.1, par ce théorème avons alors la conclusion suivante: il existe deux constantes et , qui ne dépendent que , et de , telles que: si pour on a
-
i)
et
-
ii)
;
alors est bornée sur le sous-domaine et l’on a
| (2.79) |
Observons finalement que cette conclusion est la même conclusion énoncée dans le Théorème 2.4.2: étant donné que les fonctions , et sont toujours des fonctions stationnaires alors les estimations données dans les points et ci-dessus sont équivalentes aux estimations énoncées dans les points et du Théorème 2.4.2. En effet, comme alors par l’estimation donnée dans nous pouvons écrire
ce qui équivaut à écrire , qui est l’estimation donnée dans le point du Théorème 2.4.2. En suivant le même raisonnement nous avons que l’estimation donnée dans le point équivaut à l’estimation de ce théorème. De plus, nous pouvons aussi observer que l’estimation (2.79) équivaut à l’estimation (2.76) et alors le Théorème 2.4.2 est maintenant démontré.
Maintenant que l’on dispose de l’estimation (2.76) nous pouvons montrer que la solution vérifie l’estimation (2.69).
C) Preuve de la Proposition 2.3.2
Comme expliqué dans le point on commence par vérifier l’estimation (2.70).
Lemme 2.4.1
Preuve. Comme nous avons l’inclusion nous allons donc montrer que la solution appartient à l’espace . Nous écrivons cette solution comme la solution du problème de point fixe suivant:
| (2.80) |
voir l’identité (2.14) pour tous les détails des calculs; où nous observons tout d’abord que comme la force appartient à la classe de Schwartz alors et il s’agit alors de vérifier que l’on a aussi . En effet, comme nous écrivons et nous avons alors l’identité
| (2.81) |
et nous allons maintenant vérifier que le terme à droite de cette identité appartient à l’espace . Étant donné que alors par les lois de produit nous avons d’où nous obtenons ; et alors par l’identité (2.81) et l’identité (2.80) nous avons . Avec l’information , toujours par le lois de produit nous avons et nous avons .
Ainsi, toujours par l’identité (2.80) nous obtenons et donc .
Dans le lemme suivant (qui s’agit d’un corollaire du Théorème 2.4.2) nous vérifions maintenant l’estimation (2.71).
Lemme 2.4.2
Preuve. La première chose à faire est de vérifier les points et du Théorème 2.4.2 pour obtenir l’estimation (2.76). Soient , et soit la boule . Pour vérifier le point du Théorème 2.4.2 il suffit de montrer que la pression appartient à l’espace et pour cela nous écrivons
où est toujours la transformée de Riesz; et comme l’opérateur est borné dans l’espace alors pour obtenir nous allons montrer que pour , ce qui équivaut à montrer . En effet, comme par les inégalités de Hölder nous avons . D’autre par le Lemme 2.4.1 nous avons aussi et alors, comme , nous avons ; et par interpolation nous obtenons .
Pour vérifier le point Théorème 2.4.2 il suffit de remarquer que la force appartient à la classe de Schwartz (voir toujours la Définition 2.2.4) et nous avons directement avec . Ainsi, par le Théorème 2.4.2 il existe deux constantes et , qui ne dépendent que de , et , telle que: si pour , on a :
| (2.82) |
et
| (2.83) |
alors la solution vérifie l’estimation (2.76); et pour pouvoir écrire cette estimation nous devons maintenant vérifier les estimation (2.82) et (2.83).
Fixons tout d’abord . Pour vérifier l’estimation (2.82) nous allons montrer les estimations suivantes
| (2.84) |
En effet, pour monter la première estimation de (2.84) observons tout d’abord que comme alors par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons et ensuite par les inégalités de interpolation nous obtenons . Ainsi, pour il existe tel que si alors nous avons .
Pour vérifier la deuxième estimation de (2.84), rappelons que l’on a et alors pour il existe tel que si alors nous avons l’estimation .
Ainsi, on pose alors la constante
| (2.85) |
et pour nous pouvons alors écrire les estimations données dans (2.84) et donc nous avons vérifié l’estimation (2.82).
Vérifions maintenant l’estimation (2.83). Pour nous prenons ici le rayon de la boule comme
| (2.86) |
et alors l’estimation (2.83) s’écrit comme
| (2.87) |
et pour vérifier cette estimation nous devons étudier un peu plus le terme à gauche ci-dessus. Toujours par le fait que la force appartient à la classe de Schwartz alors pour nous pouvons écrire , pour tout ; et alors par cette estimation nous avons
et en passant à des cordonnées radiales nous obtenons
et alors nous pouvons finalement écrire
Par cette estimation nous observons que pour vérifier l’estimation (2.87) il suffit de vérifier l’estimation et ceci équivaut à écrire .
Ainsi, on pose la constante , où la constante est donnée dans (2.85), et pour tout et nous avons l’estimations (2.82) et (2.83) et donc nous pouvons écrire (2.76):
Ainsi, comme la constante ne dépend pas de et en écrivant maintenant alors pour tout par l’estimation ci-dessus nous pouvons écrire l’estimation cherchée .
De cette façon par les Lemmes 2.4.1 et 2.4.2 on pose maintenant la constante et pour tout nous pouvons écrire , qui est l’estimation cherchée (2.69) et alors la Proposition 2.3.2 est maintenant montrée .
2.4.2 Les lemmes techniques
Preuve du Lemme 2.3.1 page 2.3.1
Nous commençons par écrire
| (2.88) |
où le deuxième terme à droite peut s’écrire comme
En effet, comme est stationnaire nous avons et de plus, comme nous pouvons écrire
Mais, comme alors nous avons et donc nous obtenons . Ainsi, en remplaçant cette identité dans l’identité précédente nous avons
Finalement, on intègre par rapport à la variable de temps et nous obtenons de cette façon
De cette façon, en appliquant cette identité au deuxième terme de (2.88) nous avons
| (2.89) |
Maintenant, comme la solution de Leray vérifie l’inégalité d’énergie obtenue dans la Proposition 1.2.1:
alors en remplaçant cette estimation du terme dans (2.89) nous pouvons écrire
| (2.90) | |||||
où nous avons besoin d’étudier les termes , et ci-dessus. Pour le terme nous écrivons directement
| (2.91) |
Ensuite, pour le terme nous allons vérifier que l’on a l’identité suivante
| (2.92) | |||||
En effet, comme la solution stationnaire vérifie l’équation , nous avons
où, nous intégrons par parties le premier terme à droite et de plus, nous utilisons les propriétés du projecteur de Leray dans le deuxième terme à droite pour obtenir l’identité
Finalement nous intégrons par rapport au temps et nous avons de cette façon l’identité recherchée (2.92).
Étudions maintenant le terme et pour cela, comme nous utilisons la relation
mais, afin de mener à bien les calculs plus bas, il convient d’écrire le terme non linéaire comme
de sorte que vérifie l’équation
De cette façon nous avons
Dans cette identité, dans les trois premiers termes à droite nous intégrons par parties et nous utilisons les propriétés du projecteur de Leray. De plus, pour le quatrième terme a droite, comme alors nous avons et donc nous obtenons
Finalement, nous intégrons par rapport à la variable de temps pour obtenir
| (2.93) | |||||
Une fois que nous avons les estimations (2.91), (2.92) et (2.93), nous les remplaçons dans (2.90) et nous obtenons
| (2.94) | |||||
À ce stade nous avons les remarques suivantes: tout d’abord, étant donné que alors, dans le troisième terme à droite de l’estimation ci-dessus nous pouvons écrire
de sorte que
D’autre part, toujours par la relation , dans le dernier terme de (2.94) nous pouvons écrire
et alors
De cette façon, en remplaçant les estimations ci-dessus dans (2.94) nous obtenons l’inégalité d’énergie recherchée.
Preuve du Lemme 2.3.2 page 2.3.2
Soit le noyau du potentiel de Bessel qui vérifie l’estimation suivante: pour une constante qui dépend seulement de et on a
| (2.95) |
Soit qui vérifie une décroissance
| (2.96) |
pour avec et pour tout ; et soit enfin fixe tel que . Nous écrivons
| (2.97) |
et nous allons estimer chaque terme ci-dessus. Pour le terme , comme l’on considère alors l’on a , et de plus, étant donné que alors par l’inégalité précédente l’on a aussi et ainsi, par l’estimation (2.95) et comme nous pouvons écrire
| (2.98) |
Pour le terme , nous écrivons:
et nous devons encore estimer chaque terme ci-dessus. Pour le terme , comme l’on considère ici alors par l’estimation (2.95) nous savons que l’on a . De plus, comme l’on considère aussi alors pour l’estimation (2.96) nous savons que l’on a ; et alors nous pouvons écrire
Ensuite, pour le terme , comme nous considérons ici alors nous écrivons
et par les estimations ci-dessus nous avons
| (2.99) |
Une fois que l’on a vérifié les estimations
(2.98) et (2.99), on pose la constante , et nous revenons à l’identité (4.36) pour écrire .
Preuve du Lemme 2.3.3 page 2.3.3
Nous allons montrer ici l’estimation (2.62). Rappelons tout d’abord que par la définition du noyau donnée dans l’expression (2.59) nous savons que , où le tenseur est défini par les expressions (2.56) et (2.57); et alors nous pouvons écrire . Ensuite, étant donné que l’action du potentiel de Bessel s’écrite comme un produit de convolution avec le noyau donné (2.95) nous écrivons alors . Ainsi, pour vérifier l’estimation (2.62) nous allons maintenant montrer l’estimation
| (2.100) |
et ensuite nous allons vérifier l’estimation
| (2.101) |
Pour montrer l’estimation (2.100) nous écrivons . D’autre part, observons que l’on a les estimations
| (2.102) |
et
| (2.103) |
En effet, l’estimation (2.102) est une conséquence directe de la définition du noyau donnée dans (2.62) tandis que l’estimation (2.103) vient du fait que le tenseur le tenseur est défini comme où pour chaque la fonction définie dans (2.56) est une fonction homogène de degré . De cette façon, pour tout nous pouvons écrire
et en particulier cette estimation est valide pour , ce qui nous donne l’estimation (2.100).
Vérifions maintenant l’estimation (2.101). Soit fixe. On définit la fonction de troncature comme telle que: , si et si , et ; et nous écrivons
| (2.104) |
où nous allons monter que et et pour cela nous allons suivre les idées de la preuve du Lemme 2.3.2. En effet, nous écrivons chaque produit de convolution ci-dessus comme une intégrale sur et nous divisons cette intégrale en deux morceaux: et . Pour le terme , par la définition de la fonction nous savons que si et alors nous avons
et en intégrant par parties nous pouvons écrire
Ensuite, nous développons le terme pour écrire
| (2.105) | |||||
Nous devons encore estimer ces trois termes ci-dessus mais avant de faire ça il convient de rappeler tout d’abord que l’on considère ici et comme l’on a fixé alors on a et alors par l’estimation (2.95) on a
| (2.106) |
Avec cette estimation en tête nous étudions maintenant les trois termes ci-dessus.
Pour le terme : par l’estimation (2.106) nous pouvons écrire et comme nous avons . Ensuite, par l’estimation (2.103) nous savons que . De plus, étant donné que , alors nous écrivons
| (2.107) |
Pour le terme : en suit les mêmes idées pour estimer le terme ci-dessus: toujours par l’estimation (2.106) nous pouvons écrire et comme nous avons aussi par la définition de , alors nous écrivons
| (2.108) |
Pour le terme : nous écrivons ici et comme alors nous avons:
| (2.109) |
Ainsi, en revenant à l’estimation (2.105), par les estimations (2.107), (2.108) et (2.109) nous avons .
Vérifions maintenant que l’on a , où rappelons que le terme est donné dans (2.104) par l’expression . Observons tout d’abord que dans ce terme nous avons la fonction , où étant donné que si alors on a que si et donc nous écrivons
Ensuite, nous avons besoin d’étudier un peu plus le terme , où, étant donné que pour chaque la fonction est une fonction homogène de degré alors la fonction est une fonction homogène de degré et donc, comme le tenseur est définie par , nous avons l’estimation et comme nous considérons ici nous avons l’estimation Avec cette estimation en tête nous revenons à l’identité ci-dessus pour écrire .
Preuve du Lemme 2.3.4 page 2.3.4
Expliquons tout d’abord l’idée de la preuve de ce lemme. Nous allons tout d’abord montrer que le terme vérifie une décroissance
| (2.110) |
pour . D’autre part, par l’estimation (2.53) nous savons pour l’on a
| (2.111) |
d’où nous pouvons en tirer l’estimation
| (2.112) |
et étant donné que l’on a l’identité
| (2.113) |
nous obtiendrons ainsi que la solution vérifie une décroissance: pour tout ,
Vérifions donc l’estimation (2.110). Pour fixe on commence par écrire
| (2.114) | |||||
et l’on cherche à estimer les termes et ci-dessus.
Pour le terme , comme nous considérons ici alors nous avons les inégalités suivantes: , d’où, étant donné que nous écrivons pour obtenir et ainsi, par l’estimation (2.62) obtenue dans le Lemme 2.3.3 nous avons , et nous pouvons écrire
| (2.115) |
Ainsi, comme l’on a nous pouvons écrire
| (2.116) |
Pour le terme , on commence par écrire
| (2.117) | |||||
et on doit estimer chaque terme de l’identité ci-dessus. Pour estimer le premier terme nous allons utiliser la décroissance de la solution donnée dans (2.69). En effet, par cette estimation nous pouvons écrire , et comme nous considérons ici (et comme alors on a aussi ) alors nous avons l’estimation . D’autre part, comme nous considérons aussi , toujours par l’estimation (2.62) (obtenue dans le Lemme 2.3.3) nous savons que ; et nous obtenons de cette façon
| (2.118) |
Pour estimer maintenant le terme , rappelons que nous considérons ici et alors toujours par l’estimation (2.62) nous savons que et ainsi, et suivant les mêmes lignes que l’estimation (2.115) nous obtenons
| (2.119) |
et comme nous pouvons alors écrire
| (2.120) |
Une fois que nous disposons des estimations (2.118) et (2.120) nous posons maintenant la constante et en revenant à l’identité (2.117) nous pouvons écrire . Ainsi, par cette estimation et par l’estimation (2.116) nous revenons maintenant à l’identité (3.19) où nous obtenons l’estimation cherchée (2.110).
Chapitre 3 Décroissance fréquentielle
Dans le chapitre précédent nous avons étudié les équations de Navier-Stokes stationnaires avec un terme d’amortissement supplémentaire et ce terme nous a permis d’étudier quelques propriétés intéressantes des solutions de ces équations.
Néanmoins, il y a d’autres propriétés des solutions, comme celle que nous étudierons dans ce chapitre, que l’on peut étudier que ce soit dans le cadre des équations amorties ou dans le cadre des équations classiques (sans terme d’amortissement); et alors nous allons préférer les équations classiques car ces équations correspondent à un modèle physique plus réaliste que les équations amorties.
Dans ce chapitre nous revenons donc aux équations de Navier-Stokes stationnaires mais cette fois-ci sans aucun terme supplémentaire d’amortissement:
| (3.1) |
et dans le cadre de ces équations nous allons étudier un autre problème relié à l’étude déterministe de la turbulence qui porte sur la décroissance de la transformée de Fourier de la solution .
Comme nous l’expliquerons plus en détail ci-après, si le fluide est en régime laminaire on s’attend à observer que la quantité a une décroissance du type suivant
| (3.2) |
aux fréquences et cette décroissance correspond au fait que dans ce régime les forces de viscosité dissipent rapidement l’énergie cinétique introduite par la force , tandis que si le fluide est en régime turbulent alors les forces de viscosité du fluide n’interviennent qu’aux hautes fréquences et ainsi on s’attend à observer cette même décroissance (3.2) mais seulement lorsque . En effet, selon la théorie K41, dans le régime turbulent on s’attend à observer un intervalle de fréquences (nommé l’intervalle d’inertie) où la quantité est censée avoir tout d’abord une décroissance polynomiale pour ensuite avoir une décroissance exponentielle aux très hautes fréquences.
Ainsi, le but de ce chapitre est alors d’étudier la décroissance (3.2) dans le cadre des équations (3.1) sans aucun terme d’amortissement supplémentaire et pour cela dans la Section 3.1.1 nous allons tout d’abord rappeler un résultat classique d’existence des solutions . Ensuite, dans la Section 3.1.2 nous allons revenir à la théorie de la turbulence K41 pour expliquer de façon plus précise pourquoi la solution est censée avoir la décroissance fréquentielle (3.2).
Dans la Section 3.2 on s’attaquera finalement à l’étude déterministe de la décroissance (3.2) et en suivant les idées du chapitre précédent nous allons étudier cette décroissance en regardant tout d’abord le régime laminaire et ensuite le régime turbulent.
Rappelons que le régime laminaire a été caractérisé dans le chapitre précédent par un contrôle sur le nombre de Grashof qui induisait comme nous l’avons vu un contrôle sur la force , tandis que dans le régime turbulent on ne suppose aucun contrôle sur le nombre ce qui laissera la force libre; et nous pouvons alors observer que l’idée sous-jacente pour caractériser le régime laminaire ou turbulent du fluide repose essentiellement sur le fait de contrôler ou non la force extérieure.
Dans ce chapitre nous allons en revanche caractériser le régime laminaire du fluide en supposant un contrôle direct sur la force tandis que dans le régime turbulent nous ne ferons aucun contrôle sur cette fonction et nous n’utiliserons plus les nombres de Grashof. Cette façon de caractériser le mouvement du fluide va nous permettre de considérer des forces dans des différents cadres fonctionnels et ainsi d’étudier la décroissance (3.2) des solutions dans ces cadres fonctionnels associés aux forces.
3.1 Introduction
Comme annoncé nous allons tout d’abord rappeler un résultat général d’existence des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) pour ensuite expliquer le type de décroissance fréquentielle qu’il est possible d’obtenir dans ce cadre.
3.1.1 Les équations de Navier-Stokes stationnaires
Dans la Section 2.1.2 du chapitre précédent nous avons vérifie un résultat général sur l’existences des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaire et amorties; et dans cette section nous suivons ces mêmes idées mais dans le cadre des équations classiques (3.1).
Pour trouver un espace fonctionnel où l’on puisse construire des solutions des ces équations nous allons faire les estimations a priori suivantes: si l’on suppose pour l’instant que la vitesse est une fonction suffisamment régulière et intégrable; et si l’on multiplie l’équation ci-dessus par et puis l’on intègre en variable d’espace on obtient (formellement) l’identité
d’où comme on a (toujours formellement) les identités
et ainsi, par une intégration par parties nous écrivons
Dans cette identité nous pouvons observer que si l’on considère une force et si alors en appliquant l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans le terme à droite ci-dessus on a
d’où on obtient l’estimation a priori
| (3.3) |
Nous observons donc que l’espace est un espace fonctionnel naturel pour la force et dans ce cadre on veut construire des solutions dans l’espace . De plus, étant donné que la pression est toujours reliée à la vitesse par la relation alors on a . En effet, comme nous écrivons le terme non linéaire et si alors par le lois de produit on a et donc
| (3.4) |
et ainsi, par la relation ci-dessus on obtient (formellement) .
L’existence des solutions pour n’importe quelle force est un résultat classique qui a été développé dans les travaux de R. Finn [21] en 1961 et les travaux de O. Ladyzhenskaya [48] en 1959 et [49] en 1963. Ces résultats sont basés sur l’estimation (3.3) et nous avons:
Théorème 3.1.1
Il s’agit donc d’un résultat général d’existence de solutions où l’on ne fait aucune hypothèse supplémentaire sur la force . Néanmoins, comme nous pouvons observer ce résultat ne donne aucune information sur l’unicité de ces solutions.
D’autre part, si nous comparons ce résultat avec le Théorème 2.1.1 où l’on considère les équations amorties, nous pouvons observer le terme d’amortissement ( avec ) entraîne que les solutions des équations amorties appartiennent à l’espace , tandis que dans le résultat ci-dessus nous observons que les solutions des équations (3.1) appartiennent seulement à l’espace .
Pour une démonstration de ce résultat voir le livre [46] (Théorème page 530). L’idée de la preuve suit les grandes lignes suivantes: on écrit les équations (3.1) comme le problème de point fixe équivalent:
| (3.5) |
où en utilisant l’estimation (3.3) et le principe de point fixe de Shaefer (voir le Lemme 2.1.1) on construit tout d’abord une solution pour ensuite récupérer la pression .
Une fois que nous avons énoncé ce résultat d’existence des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires nous allons maintenant expliquer le type de décroissance fréquentielle que nous voulons étudier pour ces solutions.
3.1.2 La décroissance fréquentielle selon la théorie K41
Pour expliquer la décroissance fréquentielle que nous voulons étudier, nous avons besoin de revenir à la théorie de la turbulence K41 dont on a déjà parlé tout au début du Chapitre 1. Plus précisément, nous allons rappeler rapidement l’idée phénoménologique de cette théorie qui se base sur le modèle de cascade d’énergie et qui explique le processus d’introduction, transfert et dissipation de l’énergie cinétique dans un fluide en état turbulent.
En effet, on considère un fluide visqueux et incompressible sur lequel agit une force extérieure et cette force introduit de l’énergie cinétique dans le fluide à une échelle de longueur qui a été appelée l’échelle d’injection d’énergie. Nous allons supposer que les effets de cette force sont suffisamment forts de sorte que le fluide se trouve dans un état turbulent et alors le modèle de cascade d’énergie explique que l’énergie cinétique introduite dans le fluide à l’échelle d’injection est transférée aux échelles de longueur plus petites (avec ) et ce transfert d’énergie est effectué jusqu’à que l’on arrive à l’échelle de dissipation (voir (1.3) page 1.3 pour la définition de cette échelle) avec . Ainsi, à partir de l’échelle d’échelle les forces de viscosité dissipent sous forme de chaleur l’énergie cinétique provenant des échelles plus grandes.
Nous pouvons observer que le domaine de validité du modèle de cascade d’énergie est donné par l’intervalle et nous pouvons aussi observer que pour expliquer ce modèle nous avons pris en compte des différents échelles de longueur. Néanmoins, pour étudier la décroissance fréquentielle et comme nous l’expliquerons ci-après, il est plus intéressant ici d’étudier ce modèle par une approche différente et alors au lieu de considérer les échelles de longueur nous allons maintenant considérer les fréquences . L’intérêt de regarder le modèle de cascade d’énergie d’un point de vue fréquentiel repose sur le fait que la théorie de la turbulence K41 propose une caractérisation intéressante de ce modèle que nous expliquons tout de suite (voir également les articles [41], [42] et [43] de A.N. Kolmogorov ainsi que le livre [37] de L. Jacquin et P. Tabeling).
Pour une échelle d’injection d’énergie nous définissons la fréquence d’injection d’énergie,
pour l’échelle de dissipation nous définissons la fréquence de dissipation et alors le modèle de cascade d’énergie se traduit au niveau fréquentiel de la façon suivante: dans un fluide qui se trouve en régime turbulent, l’énergie cinétique qui est introduite dans ce fluide (toujours par l’action d’une force ) à la fréquence est alors transférée aux plus hautes fréquences jusqu’à la fréquence de dissipation à partir de laquelle cette énergie est dissipée comme chaleur.
Dans ce cadre, il s’agit tout d’abord d’étudier la quantité d’énergie cinétique aux fréquences où d’après le modèle ci-dessus l’énergie cinétique est transférée; et ensuite il s’agit d’étudier la quantité aux hautes fréquences où l’énergie cinétique est dissipée comme chaleur. Cette quantité sera appelée le spectre d’énergie et elle est définie par l’expression
| (3.6) |
où est la transformée de Fourier du champ de vitesse et est la mesure de la sphère unité.
On souhaite donc étudier la décroissance de cette quantité lorsque . Pour cela nous avons besoin de faire un court rappel de quelques quantités physiques qui interviennent: pour caractériser le régime turbulent dans la théorie K41 on considère le nombre de Reynolds où nous rappelons que pour la vitesse caractéristique du fluide, l’échelle d’injection d’énergie et la constante de viscosité du fluide ce nombre est défini par
| (3.7) |
De cette façon le régime turbulent sera caractérisé lorsque .
Ainsi, pour estimer la quantité , Kolmogorov considère les trois paramètres physiques suivants: la constante de viscosité , la fréquence et le taux de dissipation d’énergie ; et étant donné qu’on se trouve dans le régime turbulent alors les forces visqueuses du fluide sont négligeables par rapport aux forces inertielles, ce qui amène a Kolmogorov à faire l’hypothèse suivante: la quantité d’énergie cinétique est indépendante de la constante de viscosité .
En supposant cette hypothèse, Kolmogorov introduit l’idée que cette quantité doit alors s’exprimer seulement en fonction des paramètres et , ce qui lui amène à écrire l’estimation . Pour déterminer les exposants on fait l’analyse de dimensions physiques suivante: comme le taux de dissipation a une dimension physique et la fréquence a une dimension physique alors la quantité a une dimension physique . D’autre part, comme le spectre d’énergie mesure la quantité d’énergie cinétique à chaque fréquence alors cette quantité a une dimension physique et donc une dimension physique . Ainsi, dans l’estimation il faut que l’on ait les valeurs et .
Nous obtenons de cette façon l’estimation du spectre d’énergie pour les fréquences :
(3.8)
qui est connue comme la loi de Kolmogorov et qui est valable seulement dans l’intervalle d’inertie .
Maintenant, il est important de remarquer que l’estimation (3.8), partiellement observée dans des expériences physiques et numériques (voir les articles [40],[54] ainsi que les livres [53], [71]), a une explication purement phénoménologique et que l’étude déterministe rigoureuse de cette estimation dans le cadre des équations de Navier-Stokes est encore hors de portée. En effet, il y a très peu de références à ce sujet et la difficulté principale de cette étude déterministe porte sur le fait que les outils qu’on connait pour étudier les équations de Navier-Stokes ne suffissent pas pour étudier l’encadrement (3.8) et ce problème ne sera donc pas considéré ici.
Dans ce chapitre nous allons plutôt nous concentrer à l’étude déterministe du spectre d’énergie dans l’intervalle de dissipation, c’est à dire, pour les hautes fréquences . En effet, dans le modèle de cascade d’énergie ci-dessus et une fois que l’on arrive à la fréquence de dissipation , on a que les forces de viscosité du fluide sont censées annuler tous les mouvements de l’écoulement aux fréquences supérieures à et donc l’énergie cinétique est rapidement dissipée sous forme de chaleur.
Dans les expériences physiques et numériques [34],[74] et [54] il est souvent observé que dans cet intervalle de dissipation alors le spectre d’énergie est à décroissance rapide et cette quantité présente le comportement
| (3.9) |
De cette façon, étant donné que la quantité est définie la transformée de Fourier du champ de vitesse dans l’expression (3.6), pour les fréquences nous allons alors étudier la décroissance (3.2):
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet il convient tout d’abord de préciser un peu plus notre cadre d’étude: le régime laminaire et le régime turbulent.
3.1.3 De retour au régime laminaire et turbulent
Dans la section précédente nous avons expliqué que la décroissance (3.2) est censée être observée aux fréquences , où est la fréquence de dissipation d’énergie; et nous allons maintenant étudier en peu plus en détail cet intervalle des fréquences dans le régime laminaire et dans le régime turbulent.
Lorsqu’on considère un fluide en régime laminaire, à un nombre de Reynolds borné , on s’attend à ce la fréquence de dissipation d’énergie soit du même ordre de grandeur que la fréquence d’injection d’énergie . En effet, les fluides en régime laminaire peuvent êtres caractérisés par un taux de dissipation d’énergie de l’ordre (voir le livre [26], Chapitre II de R. Temam et. al. ainsi que le livre [37] de L. Jacquin and P. Tabeling) et en utilisant maintenant cette valeur de dans la formule (3.11) nous avons
| (3.10) |
et comme nous obtenons les inégalités et donc la fréquence de dissipation
est du même ordre de grandeur que la fréquence d’injection d’énergie .
De cette façon nous observons que pour les fluides en régime laminaire la décroissance (3.2 doit être observée dans l’intervalle de fréquences qui commence à partir de la fréquence d’injection d’énergie et non seulement à partir de la fréquence de dissipation .
D’autre part, dans le cadre d’un fluide en régime turbulent nous allons observer que l’on a et donc la décroissance (3.2) a lieu aux hautes fréquences. En effet, observons tout d’abord que la fréquence est définie comme l’inverse de la longueur de dissipation et cette longueur a été définie dans (1.4) page 1.4 par l’expression , nous avons de cette façon
| (3.11) |
où est le taux de dissipation d’énergie et est toujours la constante de viscosité du fluide. Mais, dans l’introduction de Chapitre 1 nous avons vu que la loi de dissipation de Kolmogorov explique que si le nombre de Reynolds est suffisamment grand alors le taux de dissipation est estimé par et en remplaçant cette valeur de dans (3.11), comme et nous obtenons
| (3.12) |
Ainsi, lorsque on a .
Dans la section qui suit nous allons étudier ces deux cadres du mouvement du fluide où l’on obtiendra une décroissance fréquentielle (3.2) des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) et cette décroissance sera obtenue à partir des bases fréquences dans le régime laminaire et seulement aux hautes fréquences dans le régime turbulent.
Insistons sur le fait que dans ce chapitre nous allons caractériser le mouvement du fluide par une approche différente par rapport au chapitre précédent et ici le régime laminaire sera représenté par un contrôle directe sur la taille de la force tandis que dans le régime turbulent nous ne ferons aucun contrôle la taille de cette fonction.
3.2 Décroissance fréquentielle des équations de Navier-Stokes stationnaires
On commence donc par étudier la décroissance fréquentielle dans le cadre d’un fluide en régime laminaire.
3.2.1 Quelques résultats dans le régime laminaire
Pour étudier la décroissance fréquentielle (3.2) nous proposons dans cette section deux approches différentes. Dans la première approche qui sera étudiée dans le point ci-dessous nous supposerons tout d’abord que la force est une fonction localisée en fréquence et dans ce cadre nous utiliserons la méthode développée par Oseen pour la construction des solutions classiques des équations de Navier-Stokes (voir le livre [46], Chapitre pour plus de détails sur cette méthode) et cette méthode sera combinée avec la notion de nombres de Catalan utilisés en combinatoire (voir le livre [15] pour plus de références) pour construire une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) qui vérifie la décroissance fréquentielle ponctuelle pour supérieur à une certaine fréquence.
Ensuite, dans la deuxième approche qui sera étudiée dans le point ci-après, on considère une force qui n’est pas localisée en fréquence mais qui vérifie une décroissance fréquentielle exponentielle et en utilisant la notion de classe de Gevrey (voir la Définition 3.2.2 page 3.2.2 pour une définition précise) nous construirons une solution des équations (3.1) qui vérifie une décroissance fréquentielle , pour tout
Dans ces deux approches nous aurons besoin de supposer des conditions de petitesse sur la taille de la force : et pour cette raison ces résultats sont valables seulement dans le cadre d’un fluide en régime laminaire.
A) Première approche: localisation fréquentielle de la force
Soit une force et soit une échelle d’injection d’énergie. Nous allons supposer que cette force vérifie
| (3.13) |
où sont deux constantes fixeset nous allons voir maintenant comment on peut construire une solution des équations (3.1) qui ait une décroissance fréquentielle exponentielle.
Pour cela nous allons adapter à ce cadre stationnaire la méthode d’Oseen qui fût utilisée pour construire des solutions classiques des équations de Navier-Stokes non-stationnaires et nous obtiendrons une solution qui s’écrit comme une série où le terme sera donné par l’expression (3.26) ci-dessous. Ainsi, la force étant localisée aux fréquences nous observerons que cette localisation entraîne une localisation fréquentielle convenable de chaque terme de la série ci-dessus et cette propriété nous permettra obtenir une décroissance fréquentielle exponentielle pour cette solution , qui sera étudiée dans le Théorème 3.2.1 ci-dessous.
Une fois que nous avons expliqué les grandes lignes de notre étude nous allons maintenant entrer dans les détails et la première chose à faire est de construire une solution des équations (3.1) dans un sous-espace de . En effet, comme l’on travaille sur tout on considère les équations (3.1) comme un problème de point fixe équivalent
| (3.14) |
Pour résoudre ce problème nous allons utiliser le principe de contraction de Picard et alors nous cherchons un espace fonctionnel où l’on puise vérifier la continuité de la forme bilinéaire
| (3.15) |
pour tout et où l’on puise relier la condition de petitesse sur le terme par un contrôle direct sur la norme :
| (3.16) |
où est fixée par (3.13). Donc, pour vérifier les points (3.15) et (3.16) nous introduisons l’espace
| (3.17) |
muni de la norme
| (3.18) |
À ce stade, il convient de souligner que par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et par les inégalités d’interpolation dans l’espaces de Lebesgue nous avons et dans la norme ci-dessus nous observons que nous aurons besoin de contrôler la quantité .
Observons aussi que l’on a et nous avons:
Proposition 3.2.1
Preuve. Il s’agit de vérifier tout d’abord le point (3.15) et pour cela nous avons besoin d’estimer chaque terme de la norme donnée par l’expression (3.18). Pour le premier qui compose la norme par la continuité du projecteur de Leray et par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder nous obtenons
| (3.19) |
Ensuite, pour le deuxième terme de la norme , en suivant le même raisonnement ci-dessus nous avons
| (3.20) |
Finalement, pour le troisième terme de la norme , par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons
d’où, toujours par la continuité du projecteur de Leray nous écrivons
| (3.21) |
Dans la dernière expression ci-dessus, nous appliquons encore les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder pour obtenir
| (3.22) |
De cette façon, la propriété de continuité du terme bilinéaire sur l’espace énoncé dans (3.15) est bien vérifiée par les estimations ci-dessus où l’on pose la constante .
Nous allons étudier le point (3.16) et pour cela nous avons le lemme technique suivant.
Lemme 3.2.1
Preuve. Nous allons estimer chaque terme de la quantité . En effet, pour le premier terme de cette quantité, comme est localisée aux fréquences nous pouvons écrire
d’où nous obtenons l’estimation
| (3.23) |
Ensuite, pour le deuxième terme de la quantité nous pouvons écrire directement
| (3.24) |
Finalement, pour le troisième terme de cette quantité, par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons
et alors, toujours en utilisation la localisation fréquentielle de nous écrivons
d’où nous pouvons en tirer l’estimation
| (3.25) |
Ainsi, par les estimations (3.23), (3.24) et (3.25) on fixe la constante et nous écrivons alors l’estimation
Ainsi, si pour une constante suffisamment petite alors par le lemme ci-dessus et par l’estimation (3.15) nous pouvons appliquer le principe de contraction de Picard pour obtenir une solution des équations (3.1) et qui est l’unique solution dans la boule . La Proposition 3.2.1 est maintenant vérifiée.
Une fois que nous avons construit la solution nous allons maintenant revisiter la méthode d’Oseen dans ce cadre des équations de Navier-Stokes stationnaires. Remarquons au passage que cette méthode a été aussi utilisée dans l’article [1] de P. Aucher et P. Tchamitchian pour obtenir des solutions des équations de Navier-Stokes non-stationnaires dans le cadre de différents espaces fonctionnels comme les espaces de Sobolev, Besov et Morrey.
Proposition 3.2.2
Preuve. Tout d’abord, pour simplifier l’écriture nous allons écrire le terme comme et en suivant l’idée d’Oseen on considère l’équation
| (3.27) |
et l’on développe la solution comme la série:
| (3.28) |
Pour déterminer les termes en remplace (3.28) dans (3.27) et nous obtenons
| (3.29) |
et comme nous pouvons écrire
En utilisant les propriétés du terme bilinéaire nous obtenons
et nous trouvons que le terme et bien donné par la formule (3.26).
Nous allons maintenant prouver que la série (3.28) converge fortement vers la solution dans l’espace et pour cela, nous prouvons tout d’abord que converge fortement dans et ensuite nous allons observer que cette série est en fait une solution de l’équation (3.27).
Pour montrer la convergence forte de série ci-dessus nous introduisons les nombres de Catalan d’une façon légèrement détournée et adaptée à notre problème: par l’expression (3.26) nous pouvons observer que pour tout entier le terme est la somme de toutes les façons possibles de multiplier fois le terme en utilisant la forme bilinéaire . En effet, en prenant dans la formule (3.26) nous avons , pour nous avons , et dans cette identité en remplaçant par nous obtenons et ainsi de suite pour . Une fois que l’on a remarqué ce fait, pour nous définissons les ensemble comme l’ensemble de tous les produits de fois le terme en utilisant , par exemple:
et donc, avec cette définition des ensembles , nous pouvons écrire .
Maintenant, nous définissons les nombres et pour tout le nombre est le cardial de l’ensemble . Cette suite de nombres est connue en combinatoire par les nombres de Catalan. Pour une application des nombres de Catalan dans le problème de Navier-Stokes voir le livre [46], Théorème et voir aussi le livre [15] pour les propriétés générales de ces nombres.
Dans notre étude nous aurons besoin uniquement de deux propriétés de ces nombres. Tout d’abord, la suite vérifie la relation de récurrence:
| (3.30) |
Ensuite, par cette formule de récurrence il est possible de montrer (voir le livre [15]) que sa série génératrice vérifie :
| (3.31) |
Maintenant nous avons tous les outils pour prouver que . En effet, par la continuité de la forme bilinéaire dans l’espace étudiée dans (3.15) nous obtenons l’estimation suivante pour tout :
et de plus, comme nous écrivons
| (3.32) |
d’où nous obtenons
Ainsi, comme , par le Lemme 3.2.1 nous savons que et alors si pour une constante suffisamment petite nous obtenons et de cette façon, par la formule (3.31) nous obtenons
et donc la série est normalement convergente dans , elle est une solution de l’équation (3.29) et elle définit un élément de dans la boule .
Finalement, comme l’équation (3.27) s’agit de la même (3.1) par l’unicité des solutions de ces équations dans la boule nous avons .
La décomposition obtenue dans la Proposition 3.2.2 nous permettra d’étudier de façon précise la décroissance fréquentielle de la solution et pour cela nous étudions maintenant l’information sur le support fréquentielle de chaque terme de cette décomposition.
Proposition 3.2.3
Dans le cadre de la Proposition 3.2.2, soit une force qui vérifie la localisation fréquentielle pour une échelle d’injection d’énergie et soit la solution des équations des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) que nous assumons décomposée comme la série où et pour tout les termes sont donnés par la formule (3.26). Alors les supports des transformées de Fourier des termes vérifient les inclusions:
Preuve. En effet, par la localisation de la force et comme nous avons directement que
| (3.33) |
Pour , par la formule (3.26) nous avons l’expression suivante pour les termes :
et comme le symbole de l’opérateur est une fonction homogène de degré , en prenant la transformation de Fourier dans l’expression ci-dessus nous pouvons écrire
| (3.34) |
Pour le cas , nous observons facilement que le support de dépend du support de et par (3.33) nous avons
Donc, en utilisant l’expression (3.34), nous obtenons par récurrence les inclusions cherchées:
Une fois que nous avons étudié les supports fréquentiels des termes de la série nous avons maintenant tous les outils dont on a besoin pour étudier le décroissance fréquentielle de la solution et nous avons donc un tout premier résultat dans le cadre d’un fluide en régime laminaire.
Théorème 3.2.1 (Première étude de la décroissance fréquentielle: cadre laminaire)
Soit une force à divergence nulle telle que sa transformée de Fourier est bornée et localisée aux fréquences pour une échelle d’injection d’énergie fixe. Alors, il existe une constante (suffisamment petite) telle que si alors la solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1), obtenue par le biais de la Proposition 3.2.1, vérifie la décroissance fréquentielle:
| (3.35) |
où (avec la constante de viscosité du fluide) et .
Nous observons ainsi que cette décroissance fréquentielle est obtenue aux fréquences ce qui correspond au fait que si l’on considère un fluide en régime laminaire (ce qui est caractérisé par la condition de petitesse sur la force) alors la décroissance exponentielle du spectre d’énergie a également lieu pour les fréquences de l’ordre de et non seulement aux hautes fréquences.
Démonstration. Par la Proposition 3.2.2 nous décomposons la solution comme la série , où et pour tout les termes sont donnés par l’expression (3.26). En prenant la transformée de Fourier dans cette série et ensuite, en multipliant par la quantité nous obtenons
| (3.36) |
où nous allons montrer que les termes et ci-dessus sont contrôlés par une constante .
Pour estimer le terme de (3.36) nous utilisons la Proposition 3.2.3 d’où l’on sait que et alors nous pouvons écrire
d’où, étant donné que et de plus, comme et comme alors nous avons
et nous obtenons ainsi l’estimation
| (3.37) |
Nous allons maintenant estimer le terme de (3.36). Il s’agit d’estimer tout d’abord chaque terme et pour cela nous utiliserons ici les nombres de Catalan définis par la formule (3.30) où nous allons montrer qu’il existe deux constantes et telle que pour tout entier nous avons l’estimation suivante:
| (3.38) |
En effet, par l’inégalité (3.34) nous écrivons
| (3.39) |
et comme nous obtenons
D’autre part, par la Proposition 3.2.3 nous savons que et alors dans l’estimation précédente nous pouvons écrire
d’où, par l’inégalité de Hölder et en utilisant la définition de la norme donnée par la formule (3.18) nous avons
| (3.40) | |||||
À ce stade, nous avons besoin d’estimer le terme et pour cela nous revenons à l’inégalité (3.32) pour pouvoir écrire
où est la constante donnée dans (3.15) et sont les nombres de Catalan. Ainsi, par l’identité et par le Lemme 3.2.1 nous avons alors l’estimation et donc nous obtenons
Une fois que nous disposons de cette estimation nous pouvons revenir à l’estimation (3.40) ci-dessus pour écrire
et alors par la formule de récurrence donnée dans (3.30) nous avons
et alors si on pose les constantes et et nous obtenons ainsi l’estimation (3.38).
Une fois que l’on a cette estimation nous pouvons écrire
et par la propriété (3.31) des nombres de Catalan, si , avec une constante suffisamment petite, alors nous avons
d’où nous obtenons l’estimation
| (3.41) |
Maintenant que nous disposons des estimations (3.37) et (3.41) nous pouvons les remplacer dans l’estimation (3.36) en fixant la constante et la constante , et nous avons finalement l’estimation cherchée (3.35).
Comme nous pouvons observer la décroissance fréquentielle exponentielle obtenue dans le Théorème 3.2.1 repose essentiellement sur la localisation fréquentielle de la force extérieure qui entraîne une localisation fréquentielle convenable des termes lorsqu’on décompose la solution comme .
Dans la partie ci-dessous, nous étudions cette décroissance fréquentielle dans un cadre un peu plus général où la force extérieure n’est pas localisée en fréquence mais elle vérifie une décroissance fréquentielle exponentielle.
B) Deuxième approche: décroissance fréquentielle de la force
Comme annoncé nous supposons ici que la force vérifie une décroissance fréquentielle et nous étudierons un comportement similaire pour les solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1).
On sait que les propriétés de décroissance de la transformée de Fourier d’une fonction peuvent être regardées comme des propriétés de régularité de telle fonction dans les espaces de Sobolev (avec ), néanmoins, ces espaces ne nous permettent pas d’étudier de façon précise une décroissance fréquentielle exponentielle et nous avons besoin de passer par le cadre de la classe de Gevrey qui nous introduisons comme suit: la première chose à faire est de définir l’opérateur de la façon suivante:
Définition 3.2.1
Soit . On définit l’opérateur au niveau de Fourier par l’identité , pour tout qui appartient à la classe de Schwartz.
Cet opérateur nous sera très utile pour l’étude de la décroissance fréquentielle exponentielle car le symbole nous permettra capturer ce comportement comme nous le verrons dans la définition suivante:
Définition 3.2.2 (La classe de Gevrey)
Soit l’espace de Sobolev avec , soit et soit l’opérateur donné dans la Définition 3.2.1. On définit la classe de Gevrey par
Grâce à cette définition nous observons que la quantité exprime la décroissance exponentielle de la transformée de Fourier de la fonction . En effet, il suffit d’écrire
pour observer que si cette quantité est finie alors il faut que ait une décroissance exponentielle à l’infini.
Observons aussi que l’on a et en plus, l’espace étant un espace de Banach pour alors on a que pour ces valeurs du paramètre la classe de Gevrey est aussi un espace de Banach muni de la norme .
Cet espace fonctionnel a été introduit par M. Gevrey en 1918 dans [31] pour l’étude analytique de quelques propriétés de régularité du noyau de la chaleur et cet espace a été aussi utilisé pour l’étude de l’analycité en temps des solutions mild des équations de Navier-Stokes non stationnaires (voir l’article [27] de C. Foias et R. Temam et l’article [47] de P.G. Lemarié-Rieusset pour plus de références à ce sujet). Dans cette section nous utiliserons la classe de Gevrey pour étudier la décroissance fréquentielle exponentielle des solutions des équations de Navier-Stokes dans le cadre stationnaire et nous avons ainsi une première caractérisation de ce comportement.
En effet, nous allons montrer que si la force a une décroissance fréquentielle exponentielle, qui est exprimée par le fait que , et si nous supposons en plus un contrôle sur la taille de cette force alors nous pouvons utiliser le principe de contraction de Picard pour construire une solution des équations (3.1) dans la classe de Gevrey . Le choix du paramètre dans cette classe de Gevrey (ainsi que le choix du paramètre dans la classe ) est purement technique et nous avons:
Proposition 3.2.4
Soit et soit une force à divergence nulle. Il existe une constante telle que si alors il existe solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) qui est l’unique solution dans la boule .
Preuve. Nous écrivons les équations (3.1) comme un problème de point fixe
et nous allons appliquer le principe de contraction Picard dans la classe de Gevrey . Pour vérifier la continuité de la forme bilinéaire ci-dessus sur cet espace, nous avons besoin de l’inégalité suivante:
Lemme 3.2.2
On a
Preuve. On commence par écrire
et dans le dernier terme ci-dessus, nous utilisons l’inégalité triangulaire pour écrire
et alors, en revenant à l’estimation précédente nous obtenons
Maintenant, par le Lemme 3.2.2, par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev et l’inégalité de Hölder nous pouvons écrire
et ainsi nous avons vérifié la continuité de la forme bilinéaire ci-dessus sur la classe de Gevrey .
Nous allons maintenant estimer le terme et étant donné que nous pouvons écrire directement
.
Ainsi, il existe une constante (suffisamment petite) telle que si alors par le principe de contraction de Picard il existe solution des équations (3.1) qui est l’unique solution dans la boule .
Dans la Proposition 3.2.4 nous pouvons observer que comme alors nous avons
ce qui exprime le fait que la solution a une décroissance fréquentielle exponentielle aux hautes fréquences et cette information est mesurée en termes de la norme . Néanmoins, comme expliqué à la Section 3.1.3, dans le cadre d’un fluide en régime laminaire la décroissance fréquentielle exponentielle est censée être observée aussi aux basses fréquences et non seulement aux hautes fréquences comme l’on peut regarder dans la quantité ci-dessus.
Ainsi, ce résultat n’exprime pas de façon tout à fait satisfaisante la décroissance fréquentielle exponentielle d’un fluide en régime laminaire mais il nous sera fondamental pour étudier une décroissance fréquentielle plus précise dans le cadre d’un fluide en régime laminaire (caractérisé par un contrôle sur la force).
Théorème 3.2.2 (Deuxième étude de la décroissance fréquentielle: cadre laminaire)
Soit une force à divergence nulle telle que pour une constante et qui vérifie
| (3.42) |
où et est une constante suffisamment petite. Alors, il existe solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) qui vérifie la décroissance fréquentielle ponctuelle:
| (3.43) |
pour tout et où est une constante qui dépend de .
Démonstration. Nous commençons donc par construire une solution .
Lemme 3.2.3
Il existe une constante telle que si alors il existe solution des équations (3.1) qui est l’unique solution qui vérifie .
Preuve. On commence par écrire la solution comme
| (3.44) |
et nous allons appliquer le principe de contraction de Picard dans l’espace (où l’on a ). Pour cela on a besoin d’estimer chaque terme de la norme .
En effet, pour le premier de , par l’estimation (3.19) et les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons
| (3.45) |
Ensuite, pour le deuxième terme de , par l’estimation (3.20) et toujours par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons
| (3.46) |
Finalement, par l’estimation (3.21) et l’estimation (3.21) nous avons
| (3.47) |
Ainsi, par les estimations (3.45), (3.46) et (3.46) nous avons la continuité de la forme bilinéaire dans l’espace .
Nous étudions maintenant le terme . Comme nous pouvons écrire
De cette façon, pour pouvoir appliquer le principe de contraction de Picard il suffit d’avoir le contrôle , avec une constante suffisamment petite.
Nous allons maintenant montrer que la solution ci-dessus vérifie la décroissance fréquentielle (3.43). Dans chaque terme de l’identité (3.44) nous prenons la transformée de Fourier et nous avons
d’où, en multipliant par à chaque côté de cette inégalité on a
| (3.48) |
et l’on cherche à estimer chaque terme à droite de cette inégalité.
Pour estimer le premier terme à droite de (3.48) nous avons besoin de vérifier tout d’abord que la solution obtenue par le biais du Lemme 3.2.3 appartient à la classe de Gevrey .
En effet, comme la force vérifie (3.42) nous commençons par vérifier que cette force appartient aussi à la classe de Gevrey : par (3.42) nous avons l’estimation
et alors nous pouvons écrire
Ainsi, pour la constante de la Proposition 3.2.4 et pour la constante du Lemme 3.2.3 on fixe maintenant la constante de sorte que , et nous obtenons et de cette façon, par la Proposition 3.2.4 il existe solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) qui est l’unique solution dans la boule , mais, nous avons l’estimation
d’où nous obtenons
et ainsi, par l’unicité de la solution construite dans le Lemme 3.2.3 nous avons et donc .
Une fois que nous avons nous pouvons maintenant estimer le premier terme à droite de (3.48). En effet, par l’inégalité triangulaire et l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous écrivons
| (3.49) |
et nous devons maintenant contrôler le dernier terme à droite ci-dessus. Par le Lemme 3.2.3 nous avons et comme nous pouvons alors écrire
De cette façon, en revenant à l’estimation (3.49) nous obtenons
| (3.50) |
Nous allons maintenant estimer le deuxième à droite de (3.48) et pour cela par l’estimation (3.42) nous écrivons
| (3.51) |
Une fois que nous disposons des estimations (3.50) et (3.51) nous les remplaçons dans l’estimation (3.48) pour pouvoir écrire
et ainsi ce théorème est maintenant démontré.
Dans la démonstration du Théorème 3.2.2 que nous venons de faire nous observons que si l’on a un contrôle sur la force (et donc l’on est dans un régime laminaire) et si cette force a une décroissance fréquentielle exponentielle alors nous pouvons construire une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires avec la même décroissance fréquentielle.
Dans la section qui suit nous verrons comment la classe de Gevrey nous permet aussi d’étudier une décroissance fréquentielle exponentielle des solutions mais dans un cadre plus général où l’on ne suppose aucun contrôle sur le force et donc le fluide peut atteindre un état turbulent.
3.2.2 Quelques résultats dans le régime turbulent
Dans la section précédente nous avons introduit la classe de Gevrey pour étudier la décroissance fréquentielle des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1); dont les résultats obtenus reposent sur le contrôle qu’on a fait sur la force et donc ces résultats correspondent au cadre d’un fluide en régime laminaire.
Le but de cette section est de généraliser ces résultats précédents au cadre d’un fluide en régime turbulent et alors nous ne ferons ici aucun contrôle sur la la taille de la force . Dans la Section 3.1.3 nous avons expliqué que si le fluide est en état turbulent alors la décroissance fréquentielle exponentielle de la solution est censée être observée uniquement aux hautes fréquences et nous allons voir comment la classe de Gevrey nous permettra capturer ce comportement fréquentiel dans ce cadre turbulent.
En effet, pour n’importe quelle force par le Théorème 3.1.1 nous avons l’existence d’au moins une solution des équations (3.1) et dans le Théorème 3.2.3 ci-dessous nous allons montrer que si la force vérifie en plus (où ) alors toute solution associée à cette force vérifie pour une certaine constante .
De cette façon, par la définition de la classe de Gevrey nous avons alors que la quantité
| (3.52) |
est une quantité finie et donc nous pouvons observer que a une décroissance exponentielle aux hautes fréquences.
Théorème 3.2.3 (Étude de la décroissance fréquentielle: cadre turbulent)
Soit une force stationnaire à divergence nulle et soit . Si alors toute solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) associée à cette force appartient à la classe de Gevrey où .
Avant de passer à la démonstration de ce théorème nous allons faire les remarques suivantes: si nous comparons ce théorème avec les résultats obtenus dans la section précédente (le Théorème 3.2.1 et le Théorème 3.2.2) nous pouvons observer que ce théorème est plus générale dans le sens qu’ici nous n’avons fait aucun contrôle sur la taille force et ce résultat est valable aussi dans le cadre d’un fluide en régime turbulent, tandis que les résultats de la section précédente (où l’on a contrôlé la taille de la force) sont valables uniquement dans le cadre d’un fluide en régime laminaire.
En revanche, observons maintenant que dans le régime laminaire on obtient une décroissance fréquentielle exponentielle de la solution plus précise que celle obtenue dans le Théorème 3.2.3 (dans le cadre turbulent). En effet, toujours dans les Théorèmes 3.2.1 et Théorème 3.2.2 démontrés dans le cadre laminaire nous observons que l’on construit une solution qui vérifient une décroissance fréquentielle ponctuelle: , tandis que dans le Théorème 3.2.3 cette décroissance fréquentielle exponentielle en mesurée en termes de la norme (voir l’expression (3.52)) et nous n’avons ici une décroissance ponctuelle.
Démonstration du Théorème 3.2.3. Pour démontrer ce théorème nous avons besoin de considérer pour l’instant le problème d’évolution des équations de Navier-Stokes :
| (3.53) |
où pour on a une force à divergence nulle et est une donnée initiale à divergence nulle. L’existence et l’unicité d’une solution (locale en temps) est un résultat classique qui a été développé par H. Fujita et T. Kato dans [28]:
Lemme 3.2.4
Il existe un temps et il existe une fonction qui est l’unique solution des équations (3.53).
Pour une preuve ce résultat voir le livre [46], Théorème .
Une fois que nous avons la solution ci-dessus la première chose à faire est d’étudier la décroissance fréquentielle de cette solution et pour cela nous introduisons l’espace fonctionnel suivant: soit et , on défini l’espace
| (3.54) |
muni de la norme , où l’opérateur est donné dans la Définition 3.2.1. Nous avons ainsi le résultat suivant.
Proposition 3.2.5
Preuve. Nous allons étudier la quantité
| (3.55) |
Les deux premiers termes de cette expression sont faciles à estimer et nous avons
| (3.56) |
Pour le dernier terme de (3.55), par la définition de la norme , l’identité de Plancherel et la continuité du Projecteur de Leray nous avons
et comme nous avons l’estimation ponctuelle
| (3.57) |
dû au fait que pour tout , alors nous obtenons
En revenant maintenant à la variable spatiale nous pouvons écrire
| (3.58) | |||||
Une fois que nous disposons des estimations (3.56) et (3.58) on fixe maintenant suffisamment petit de sorte qu’en appliquant le principe de contraction de Picard nous obtenons une solution des équations (3.53). Mais, étant donné que on a et par l’unicité de la solution on a et donc .
Revenons maintenant aux équations de Navier-Stokes stationnaires (3.1) pour monter que toute solution vérifie avec une constante que l’on fixera plus tard.
En effet, dans le système d’évolution (3.53) nous prenons la donnée initiale et la force , avec ; et nous allons maintenant vérifier que cette force satisfait les hypothèses du Lemme 4.2.1 et de la Proposition 3.2.5, c’est à dire, nous devons vérifier que et ; et pour cela nous allons tout d’abord vérifier que l’on a . On commence donc par écrire
Comme par la définition de cet espace fonctionnel nous avons et ainsi, en fixant le paramètre tel que nous pouvons alors écrire
d’où nous avons et alors et .
Ainsi, par le Lemme 4.2.1 il existe un temps et une unique solution des équations (3.53). De plus, comme alors par la Proposition 3.2.5 nous avons .
D’autre part, comme est une fonction constante en variable de temps nous avons et de plus, comme et nous pouvons alors observer que est aussi une solution de l’équation (3.53) ci-dessus et donc, par l’unicité de la solution nous obtenons que . Ensuite, comme alors nous avons pour tout . Ainsi, on fixe et alors on a
et donc . Le Théorème 3.2.3 est maintenant démontré.
Chapitre 4 Des théorèmes de type Liouville
Dans le chapitre précédent nous avons étudié la décroissance fréquentielle des solutions des équations de Navier-Stokes stationnaires:
| (4.1) |
mais, avant de faire cet étude, nous avons tout d’abord énoncé un résultat sur l’existence des solutions dans le cadre de l’espace de Sobolev . Plus précisément, par le Théorème 3.1.1 page 3.1.1 nous observons que si l’on considère une force alors il existe une solution des équations (4.1) qui vérifie l’estimation
| (4.2) |
Dans ce chapitre nous allons étudier un tout autre problème relié à l’estimation (4.2): dans cette estimation nous observons que si nous prenons maintenant une force nulle () alors la solution des équations
| (4.3) |
obtenue par le Théorème 3.1.1 est forcément la solution triviale ; et nous nous posons alors la question de savoir si cette solution est l’unique solution des équations (4.3) dans l’espace . Néanmoins, comme nous l’expliquerons plus en détail ci-après, cette question est encore une question ouverte
et le problème repose essentiellement sur le fait que, dans l’état actuel de nos connaissances, on ne sait pas montrer que toute solution des équations (4.3) vérifie l’estimation (4.2).
Le but de ce chapitre est alors d’étudier d’autres espaces fonctionnels tels que si est une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) et si alors on ait l’identité . Autrement dit, il s’agit de trouver des espaces fonctionnels dans lesquelles les équations (4.3) possèdent comme unique solution la solution triviale . Ce problème est également appelé le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires.
Dans la Section 4.1 ci-dessous nous expliquons plus en détail les enjeux du problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) et nous exposerons quelques résultats connus sur ce problème. Ensuite, dans la Section 4.2 nous démontrerons quelques résultats nouveaux que nous avons obtenu sur ce sujet.
4.1 Introduction
Comme annoncé nous allons rappeler ici quelques résultats connus sur le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) et pour cela nous allons commencer par expliquer un peu plus en détail ce problème.
4.1.1 Le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires
Dans cette section nous introduisons le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) que nous allons étudier tout au long de ce chapitre mais, avant d’entrer dans les détails de ce problème, il convient tout d’abord de préciser un peu plus notre cadre de travail et on commence donc par rappeler la définition de solution faible des ces équations.
Définition 4.1.1 (Solution faible)
Une fonction est une solution faible des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) si et s’il existe telle que le couple vérifie ces équations au sens des distributions.
Observons que dans cette définition nous avons et cette propriété de la solution nous permet d’assurer que le terme non linéaire des équations (4.3) est bien défini dans . En effet, comme et comme alors nous pouvons écrire l’identité (toujours au sens des distributions) , où nous observons que si la solution appartient à l’espace alors par l’inégalité de Cauchy-Schwarz nous avons que le terne non linéaire appartient à l’espace et donc le terme est bien défini dans . Ainsi, par l’identité précédente nous avons que le terme est ainsi bien défini au sens des distributions.
Maintenant que l’on a précisé notre cadre de travail qui est donné par l’espace , nous cherchons à trouver des espaces fonctionnels où l’on puisse résoudre le problème de Liouville suivant:
Si est une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) et si de plus cette solution vérifie alors on a .
Avant d’expliquer les espaces que nous allons considérer il est important de remarquer tout d’abord que la condition supplémentaire est vraiment nécessaire pour résoudre ce problème de Liouville.
En effet, dans l’exemple ci-dessous nous allons observer que dans le cadre général de l’espace on ne peut pas s’attendre à ce que la solution triviale soit l’unique solution des équations (4.3). Considérons la fonction définie comme suit: pour ,
| (4.4) |
et à partir de cette fonction nous définissons maintenant les fonctions et par les identités
| (4.5) |
et
| (4.6) |
À ce stade, observons que la fonction appartient à l’espace . En effet, par la définition de la fonction ci-dessus et par l’identité (4.5) nous pouvons écrire
| (4.7) |
pour observer que l’on a l’estimation d’où nous pouvons en tirer ; et nous avons en plus le résultat suivant:
Lemme 4.1.1
Preuve. Observons tout d’abord que par l’identité (4.7) nous avons et alors par l’identité (4.6) nous obtenons . Nous allons maintenant montrer que le couple vérifie les équations (4.3).
Par l’identité (4.4) nous avons et ainsi nous pouvons écrire
Ensuite, par le calcul vectoriel nous avons l’identité
où, comme alors nous avons , et donc nous pouvons écrire
Avec ces identités et comme nous obtenons l’identité
De plus, toujours par l’identité (4.7) nous pouvons en tirer .
Nous observons de cette façon que dans le cadre de l’espace les équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) ont au moins deux solutions: la solution triviale et la solution non nulle donnée par l’expression (4.5), et alors on a besoin de chercher des espaces fonctionnels adéquats où l’on puisse résoudre le problème de Liouville ci-dessus.
Nous avons mentionné précédemment que l’espace semblerait être un espace naturel pour résoudre ce problème de Liouville et ce fait repose essentiellement sur quelques estimations formelles que nous avons fait dans le chapitre précédent (voir l’estimation (3.3) page 3.3) et que nous avons besoin de rappeler rapidement. On commence par rappeler le résultat suivant:
Lemme 4.1.2
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si alors et .
Pour une preuve de ce résultat voir le Théorème du livre [29] page .
De cette façon, pour une solution des équations (4.3), par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev nous avons et alors , d’où, par le Lemme 4.1.2 nous obtenons et et nous pouvons multiplier chaque terme de l’équation (4.3) par la solution . Ensuite, nous intégrons en variable d’espace sur pour obtenir l’identité:
| (4.8) |
et si nous supposons pour l’instant que la solution est suffisamment intégrable alors, pour le deuxième terme et le troisième terme à gauche de l’identité ci-dessus, comme et par une intégration par parties nous pouvons formellement écrire
et
Ainsi, par l’identité (4.8) nous pouvons en tirer l’identité suivante:
| (4.9) |
et par cette identité on s’attend à ce que l’unique solution des équations (4.3) soit la solution triviale .
Néanmoins, pour l’identité (4.8) est purement formelle et l’on ne dispose d’aucune information supplémentaire pour assurer que les termes
| (4.10) |
sont bien définies. En effet, si alors nous avons ce qui exprime une certaine décroissance à l’infini de cette fonction, mais pour donner un sens rigoureux aux quantités donnés dans (4.10) nous avons besoin que la solution décroisse plus rapidement à l’infini: si nous supposons pour l’instant que la solution vérifie en plus alors nous pouvons vérifier le résultat suivant
Lemme 4.1.3
Si alors on a et .
Ce résultat est purement technique et sera prouvé à la fin du chapitre page 4.3. Nous pouvons ainsi observer que si la solution vérifie une décroissance plus rapide à l’infini que celle donnée par la propriété et qui est maintenant mesurée en termes de la norme de l’espace , alors les quantités données dans la formule (4.10) sont bien définies et donc cette fois-ci nous pouvons écrire l’identité (4.9) qui finalement entraîne l’identité cherchée . Mais, à partir de l’information malheureusement nous n’avons aucun argument supplémentaire pour en déduire que appartient à l’espace .
Nous observons ainsi que le problème de Liouville dans l’espace s’agit d’un problème délicat et ce fait repose essentiellement sur la décroissance à l’infini de la solution . En revanche, nous allons observer que les espaces de Lebesgue nous fournissent un cadre convenable pour étudier ce problème.
En effet, grâce au Lemme 4.1.3 nous pouvons montrer un premier résultat sur le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires:
Proposition 4.1.1
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si alors .
Preuve. Par le Lemme 4.1.3 nous savons que et et comme vérifie les équations (4.3) nous écrivons pour obtenir . Comme nous avons l’information nous disposons alors des identités et qui nous permettent d’écrire l’identité (4.9) et d’en déduire .
Motivés par ce premier résultat, nous allons tout d’abord étudier le problème de Liouville pour les équations (4.3) dans le cadre des espaces de Lebesgue . Plus précisément, il s’agit d’étudier d’autres valeurs possibles du paramètre d’intégration avec lesquels on puisse obtenir des résultats similaires à celui obtenu dans la Proposition 4.1.1. Ensuite, nous allons voir qu’il est aussi possible d’étudier ce problème de Liouville dans des espaces plus générales que les espaces de Lebesgue et dans ce cadre les espaces de Morrey (qui seront définis dans la section qui suit) nous permettent d’obtenir des résultats intéressants sur ce problème.
Mais, pour expliquer les résultats que nous avons obtenu nous avons besoin de faire tout d’abord un très court rappel des résultats démontrés précédemment.
4.1.2 Des résultats connus
Dans cette section nous exposons quelques résultats connus sur le problème de Liouville pour les équations (4.3) à partir desquels nous allons établir des résultats nouveaux dans la Section 4.2 ci-après.
Comme annoncé, nous nous intéressons à étudier ce problème de Liouville dans le cadre des espaces de Lebesgue et de Morrey et on commence donc par étudier ce qui à été démontré dans le cadre des espaces de Lebesgue.
A) Quelques résultats dans les espaces de Lebesgue
Un des résultats le plus connu est celui obtenue par G. Galdi en dans son livre [29]:
Théorème 4.1.1 ([29], Théorème )
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si alors .
Si nous comparons ce résultat avec le résultat obtenu dans la Proposition 4.1.1 nous pouvons observer que dans le Théorème 4.1.1 nous prouvons l’unicité de la solution des équations (4.3) avec une condition de décroissance à l’infini moins forte que celle de la Proposition 4.1.1. En effet, dans le Théorème 4.1.1 nous observons que la solution appartient à l’espace tandis que dans la Proposition 4.1.1 la solution appartient à l’espace et alors dans ce cas cette solution décroît plus rapidement à l’infini.
Expliquons maintenant les grandes lignes de la preuve du Théorème 4.1.1. Ce résultat repose essentiellement sur le fait que si la solution appartient à l’espace alors nous pouvons vérifier rigoureusement l’estimation (4.9) ce qui entraîne tout d’abord que cette solution appartienne en plus à l’espace et ensuite que l’on ait l’identité . Pour vérifier l’estimation (4.9) on montre alors l’estimation technique suivante (voir toujours le Théorème , page du livre [29] pour tous les détails des calculs): pour soit la boule , et l’on a
| (4.11) |
où est une constante qui dépend du champ de vitesse et de la pression mais qui ne dépend pas de . Ainsi, comme nous avons
| (4.12) |
et donc en revenant à l’estimation (4.11) nous obtenons l’identité , qui est l’identité cherchée (4.9).
Il est ainsi intéressant d’observer que la décroissance à l’infini de la solution exprimée de façon précise par l’identité (4.12) entraîne l’identité (4.9) qui, comme mentionné précédemment, est hors de portée lorsqu’on considère en toute généralité une solution .
Étudions maintenant un deuxième résultat intéressant sur le problème de Liouville dans les espaces de Lebesgue. Nous savons que l’espace est inclut dans l’espace (par les inégalités de Hardy-Littlewood-Sobolev) et alors nous nous posons la question de savoir si l’on peut résoudre le problème de Liouville pour les équations (4.3) dans cet espace de Lebesgue. Néanmoins, avec les outils que nous avons à notre disposition nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse à cette question. En effet, dans la section précédente nous avons déjà souligné le fait que l’information ne suffit pas pour obtenir rigoureusement l’identité .
Dans ce cadre, le résultat obtenu par G. Seregin en dans son article [67] montre que si l’on ajoute une hypothèse supplémentaire sur la solution: , alors on obtient l’identité cherchée .
Pour définir l’espace nous avons besoin d’introduire rapidement l’espace (voir le Chapitre du livre [32]). Soit donc et la boule dans . On définit tout d’abord la quantité comme la moyenne de la fonction sur la boule :
et ensuite on définit l’oscillation moyenne de cette fonction par la quantité
Ainsi, l’espace est défini de la façon suivante:
c’est à dire, l’espace est l’espace des fonctions localement intégrables à oscillations moyennes bornées.
Ensuite, en suivant [67], nous dirons que le champ de vecteurs appartient à l’espace s’il existe un champ de vecteurs où pour ; tel que l’on a
| (4.13) |
Nous avons ainsi le résultat suivant.
Théorème 4.1.2 ([67], Théorème )
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si alors .
Nous allons maintenant expliquer comment cette hypothèse nous permet d’obtenir l’identité .
La preuve du Théorème 4.1.2 donnée dans l’article [67] suit essentiellement les grandes lignes de la preuve du Théorème 4.1.1; et cette preuve est divisée principalement en deux étapes:
-
La premier chose à faire est de montrer que si la solution des équations (4.3) appartient à l’espace alors cette solution appartient aussi à l’espace . Comme alors par la définition (4.13) on peut écrire avec et l’on montre qu’il existe une constante , telle que pour tout on a l’estimation
(4.14) Cette constante ne dépend pas de et alors si nous prenons la limite lorsque dans l’estimation (4.14) nous obtenons .
-
Une fois que l’on dispose de l’information , il s’agit de montrer l’identité . La preuve de cette identité donnée dans [67] est technique mais nous allons maintenant observer qu’en passant par le cadre des espaces de Besov on peut vérifier plus facilement l’identité .
Rappelons rapidement que pour un paramètre et une fonction on définit la quantité(4.15) où dénote toujours le noyau de la chaleur, et alors l’espace de Besov homogène est défini comme
(4.16) Une propriété des espaces de Besov qui nous sera très utile par la suite est la suivante:
Lemme 4.1.4
Soit un espace de Banach tel que:
-
1)
pour tout et pour tout on a , et
-
2)
pour tout et pour tout on a .
Alors .
Pour une preuve de ce résultat voir le Chapitre du livre [45].
Maintenant que l’on a introduit les espaces de Besov que nous allons utiliser nous pouvons en déduire l’identité . En effet, par le Lemme 4.1.4 nous avons et comme alors nous obtenons et donc . Ainsi, par les inégalités de Sobolev précisées (voir l’article [30] de P. Gérard, Y. Meyer et F.Oru) nous pouvons écrire(4.17) pour obtenir et alors, par la Proposition 4.1.1, nous avons l’identité .
-
1)
Nous pouvons ainsi observer que l’information , est bien exploitée à chaque étape et ci-dessus et cette information entraîne essentiellement (voir les estimations (4.14) et 4.17) ci-dessus) d’où on obtient l’identité .
Observons aussi que nous alors cette solution appartient à deux espaces fonctionnels avec des homogénéités différentes: l’espace est une espace homogène de degré tandis que l’espace est un espace homogène de degré . Dans ce cadre, nous allons maintenant observer que l’on peut remplacer l’espace et l’espace par des espaces de Morrey ( chacun avec la même homogénéité de et ) pour obtenir un résultat similaire à celui obtenu dans le Théorème 4.1.2.
B) Un résultat dans les espaces de Morrey
On commence par la définition suivante:
Définition 4.1.2 (Espace de Morrey homogène)
Soient . On définit l’espace de Morrey homogène comme
où
| (4.18) |
Les espaces de Morrey sont des espaces fonctionnels plus généraux que les espaces de Lebesgue et qui mesurent la décroissance (en moyenne) à l’infini d’une fonction avec les paramètres . En effet, observons tout d’abord que par l’expression (4.18) nous pouvons en tirer l’inclusion et le fait que est un espace homogène de degré .
Ensuite, toujours par l’expression (4.18), nous observons que si alors pour tout et nous pouvons écrire
ce qui exprime le fait que lorsque est suffisamment grand alors la moyenne de la fonction (en termes de la norme ) sur la boule décroît à l’infini comme où l’exposant correspond à homogénéité de l’espace .
Les espaces de Morrey ont été largement étudiés en connexion avec la régularité des solutions faibles de certaines équations aux dérivées partielles (voir par exemple le Chapitre du livre [46] pour des applications à l’étude de la théorie de la régularité des équations de Navier-Stokes); et nous allons maintenant voir comment ces espaces permettent aussi d’étudier le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires. Nous avons ainsi le résultat suivant obtenu par G. Seregin en dans l’article [68].
Théorème 4.1.3 ([68], Théorème )
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si alors .
Si nous comparons ce résultat avec le résultat obtenu dans le Théorème 4.1.2, où l’on a comme hypothèse , nous pouvons observer qu’ici on a remplacé l’espace par l’espace de Morrey qui a la même homogénéité (plus précisément on a ), tandis que l’espace a été remplacé par l’espace de Morrey qui a la même homogénéité .
La preuve du Théorème 4.1.3 suit les grandes lignes de la preuve du Théorème 4.1.2 et cette fois-ci on a que si la solution appartient à l’espace alors il existe une constante telle que pour tout on a une même estimation que celle donnée dans (4.14):
| (4.19) |
et alors en prenant la limite lorsque on obtient . Ensuite comme et comme par le Lemme 4.1.4 l’on a l’inclusion alors nous avons et donc par les inégalité de Sobolev précisées (4.17) nous avons et finalement grâce à la Proposition 4.1.1 nous pouvons écrire l’identité .
En résumé, nous observons que le problème de Liouville pour les équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) peut être résolu dans certains espaces de Lebesgue et de Morrey; et que l’essentiel de la preuve de ces résultats repose sur le fait que l’on a besoin d’une certaine décroissance à l’infini de la solution qui est caractérisée en termes des normes des ces espaces fonctionnels.
Avec cette idée en tête, dans la section qui suit nous démontrons quelques résultats nouveaux sur le problème de Liouville pour les équations (4.3).
4.2 Quelques résultats sur le problème de Liouville
En suivant les idées de la section précédente dans la Section 4.2.1 ci-dessous on commence par traiter le cadre des espaces de Lebesgue pour ensuite traiter le cadre des espaces de Morrey dans la Section 4.2.2.
4.2.1 Le cadre des espaces de Lebesgue
Dans la section précédente nous avons énoncé trois résultats connus sur le problème de Liouville pour les équations (4.3) dans les espaces de Lebesgue: dans la Proposition 4.1.1 et dans le Théorème 4.1.1 nous avons observé que ce problème est résolu dans les l’espaces et respectivement, tandis que dans le Théorème 4.1.2 nous observons que ce problème est aussi résolu dans un sous-espace particulier de donné par . Nous nous posons alors la question s’il est possible d’étudier le problème de Liouville dans des espaces avec d’autres valeurs du paramètre d’intégration .
Dans ce cadre nous allons démontrer que l’on peut résoudre le problème de Liouville pour les équations (4.3) dans l’espace avec et pour ces valeurs du paramètre n’avons pas besoin d’aucune hypothèse additionnelle sur la solution . En revanche, si nous considérons l’espace avec le paramètre alors l’hypothèse ne suffit pas pour pouvoir obtenir l’identité cherchée et, en suivant les idées du Théorème 4.1.2, nous avons besoin de considérer un sous-espace de qui est donné par l’espace , où l’espace de Besov est défini dans l’expression (4.16).
Nous avons ainsi le résultat suivant:
Théorème 4.2.1
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3).
-
1)
Si avec alors on a .
-
2)
Si avec alors on a .
Dans ce résultat nous pouvons observer que l’espace (considéré dans le Théorème 4.1.1 de G. Galdi) semble être un espace limite pour résoudre le problème de Liouville dans le sens où pour les valeurs du paramètre d’intégration on a besoin d’ajouter une hypothèse sur la solution comme nous l’observons dans le point ci)dessus.
Soulignons aussi que le problème de Liouville dans les espaces de Lebesgue pour les valeurs du paramètre d’intégration ou est encore (dans nos connaissances actuelles) une question ouverte.
Démonstration du Théorème 4.2.1.
-
1)
Nous supposons que la solution vérifie avec . Nous allons montrer l’identité et pour cela nous allons suivre les grandes lignes de la preuve du Théorème 4.1.1 donnée dans le livre [29].
On commence par introduire la fonction de troncature suivante: soit telle que , si et si . Soit , on définit la fonction par où nous pouvons observer que l’on a si et si .
Nous multiplions maintenant l’équation (4.3) par la fonction , ensuite nous intégrons sur la boule et nous obtenons l’identitéObservons maintenant que comme avec alors et par le Lemme 4.1.2 nous obtenons et . Ainsi, chaque terme de l’identité ci-dessus est suffisamment régulier et par des intégrations par parties nous pouvons écrire
D’autre part, comme si alors nous avons
et par l’identité précédente nous obtenons l’estimation
(4.20) et nous allons maintenant montrer que pour .
En effet, pour le terme , par les inégalités de Hölder (avec ) nous avonsDe plus, comme nous avons
et comme nous pouvons écrire
Dans cette estimation, observons que comme alors on a d’où nous obtenons .
Étudions maintenant le terme . On commence par observer que comme si et si alors on a , et nous pouvons écrireoù, pour étudier ces deux termes ci-dessus nous allons suivre essentiellement les mêmes lignes dans l’étude du terme . En effet, pour le terme , toujours par les inégalités de Hölder avec , et par la définition de la fonction nous avons
Ainsi, comme alors on a et comme on obtient et par l’estimation précédente nous pouvons écrire
d’où, étant donné que alors nous obtenons .
Pour étudier le terme , rappelons tout d’abord que comme la vitesse appartient à l’espace alors par les inégalités de Hölder et par la continuité du projecteur de Leray nous avons que la pression appartient à l’espace et ainsi, toujours par les inégalités de Hölder nous pouvons écrireet en suivant les mêmes estimations ci-dessus nous obtenons . De cette façons nous avons .
Maintenant que l’on dispose de l’information pour ; nous revenons à l’estimation (4.20) où, en prenant la limite lorsque , nous obtenons , et de cette façon nous avons l’identité cherchée . -
2)
Nous supposons maintenant avec et nous allons montrer que . La preuve de ce résultat suit les grandes lignes de la preuve du Théorème 4.1.2 donnée dans l’article [67] et la première chose à faire est vérifier la proposition suivante.
Proposition 4.2.1
Soit avec une solution des équations (4.3). Alors .
Preuve. La preuve de cette proposition repose essentiellement sur l’estimation suivante: soit et la boule , alors on a
(4.21) où avec une constante qui dépend seulement de la solution et qui ne dépend pas de .
Pour vérifier l’estimation (4.21) nous allons suivre quelques idées des articles [67] et [68] de G. Seregin et nous introduisons les fonctions de test et de la façon suivante: pour fixe, nous définissons tout d’abord la fonction en considérant telle que vérifie: , pour fixes on a si , si ; et .
Ensuite, nous définissons la fonction comme la solution du problème(4.22) où par le Lemme page 162 du livre [29] il existe une solution qui vérifie en plus l’estimation
(4.23) Avec les fonctions et ci-dessus, et avec la solution des équations (4.3) nous considérons maintenant la fonction et nous écrivons
d’où nous avons
À ce stade, soulignons que comme avec alors et donc par le Lemme 4.1.2 nous avons et . De cette façon, chaque terme de l’identité ci-dessus est bien défini.
Dans cette identité nous étudions le deuxième terme à gauche où, étant donné que la fonction vérifie l’équations (4.22) et que , par une intégration par parties nous avonset nous pouvons ainsi écrire
et toujours par des intégrations par parties nous obtenons l’identité suivante
(4.24) Nous devons estimer les termes et ci-dessus et nous avons ainsi le lemme technique suivant:
Lemme 4.2.1
Soit une solution des équations (4.3). On a les estimations suivantes:
-
1)
Comme alors il existe une constante numérique telle que l’on a
-
2)
Comme alors il existe une constante , qui ne dépend que de la solution , telle que l’on a
L’estimation donnée dans le point repose essentiellement sur les inégalités de Höder, tandis que l’estimation donnée dans le point repose sur quelques propriétés des espaces de Besov et nous allons vérifier ces estimations en détail a la fin du chapitre page 4.3. Ainsi, avec les estimations ci-dessus on pose tout d’abord la constante et on définit la quantité
(4.25) Avec cette quantité nous revenons maintenant à l’identité (4.24) pour écrire
D’autre part, comme si alors nous avons , et par l’estimation précédente nous écrivons
où, en appliquant les inégalités de Young au terme de droite nous obtenons l’estimation
(4.26) et nous allons choisir les paramètres et (avec ) convenablement pour obtenir l’estimation cherchée (4.21).
En effet, pour tout positif on pose , et dans l’estimation (4.26) on pose les paramètres et (où l’on a ) pour écrireNous devons maintenant étudier le deuxième terme à droite ci-dessus. Étant donné que alors nous avons , et ainsi nous écrivons
d’on nous obtenons l’estimation
et comme et nous écrivons la formule de récurrence suivante
À cette stade, on itère cette formule de récurrence pour et comme nous obtenons
d’où, en prenant maintenant la limite lorsque nous avons l’estimation
Finalement, par l’identité (4.25) nous savons que d’où nous obtenons . Ainsi, on pose la constante
et nous obtenons finalement l’estimation (4.21).
Maintenant que l’on dispose de cette estimation, observons que comme , et comme l’on a alors l’exposant est une quantité négative et donc on a . Ainsi, en prenant la limite lorsque dans l’estimation (4.21) et de plus, étant donné que nous obtenons . Nous avons de cette façon et la Proposition 4.2.1 est maintenant vérifiée.
Par la Proposition 4.2.1 nous avons que la solution appartient à l’espace et comme l’on a en plus nous pouvons alors vérifier que , pour un certain . En effet, si l’on pose (où comme alors on a ) alors par les inégalités de Sobolev précisées (voir toujours l’article [30]) nous pouvons écrireavec et ; et par ces identités nous avons la relation où, comme alors nous obtenons .
Une que nous disposons de la l’information avec alors par la Proposition LABEL:Prop:unicite-Lp-intermediaire nous avons l’identité cherchée . Le Théorème 4.2.1 est maintenant démontré.
-
1)
Dans la section qui suit nous nous intéressons à étudier le problème de Liouville pour les équations (4.3) lorsque la solution appartient à certains espaces de Morrey.
4.2.2 Le cadre des espaces de Morrey
Comme annoncé nous considérons dans cette section les espaces de Morrey (avec ) qui ont été introduits dans la Définition 4.1.2; et en suivant les idées de la section précédente nous étudions pour quelles valeurs des paramètres et ci-dessus nous pouvons résoudre le problème de Liouville suivant: si la solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) vérifie alors .
Rappelons rapidement que par le Théorème 4.1.3 (obtenue par G. Seregin dans l’article [68]) nous avons que ce problème de Liouville est résolu dans l’espace et l’essentiel des idées de la preuve de ce résultat (voir la Section 4.1.2 pour plus de détails) repose sur le fait que pour obtenir l’identité nous avons besoin de considérer deux espaces de Morrey avec homogénéités différentes: l’espace est espace homogène de degré , tandis que l’espace est un espace homogène de degré .
Dans ce cadre, nous allons observer que l’on peut généraliser ce résultat de la façon suivante: nous allons supposer maintenant que la solution vérifie , avec , où nous observons que l’on a conservé un espace de Morrey homogène de degré : , mais l’espace a été remplacé par n’importe quel espace qui a une homogénéité , et c’est dans ce sens que le résultat suivant est une généralisation du Théorème 4.1.3.
Théorème 4.2.2
Soit une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si avec alors .
Démonstration. Nous considérons tout d’abord la solution stationnaire comme la donnée initiale du problème de Cauchy pour les équations de Navier-Stokes:
| (4.27) |
Ensuite, par le Théorème du livre [46] il existe un temps , et une fonction qui est une solution du problème de Cauchy (4.27) et qui vérifie en plus l’estimation
| (4.28) |
De plus, par le Théorème du livre [46] nous avons que la solution est l’unique solution de (4.27) et comme est aussi une solution du problème (4.27) nous avons alors l’identité . Ainsi, par l’estimation (4.28) nous pouvons écrire
| (4.29) |
pour obtenir .
Maintenant que l’on dispose de l’information , nous utilisons l’information additionnelle pour montrer que . La première chose à faire est de vérifier la proposition suivante:
Proposition 4.2.2
Si est une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3) alors .
Preuve. En suivant quelques idées des articles [67] et [68] nous considérons la fonction de troncature suivante: pour fixe, la fonction est telle que , si , si et l’on a et où est une constante qui ne dépend pas de .
Une fois que l’on a introduit la fonction ci-dessus, pour la solution nous considérons maintenant la fonction et comme et vérifie les équations (4.3) nous pouvons écrire
où dénote toujours la boule . Nous allons maintenant étudier cette identité et pour cela nous avons besoin du résultat technique suivant:
Lemme 4.2.2
Soit . Alors on a .
La preuve de ce lemme repose sur les inégalités de interpolation et elle sera faite en détail à la fin du chapitre page 4.3. Avec l’information , observons tout d’abord que l’on a et alors par le Lemme 4.1.2 on obtient et . De cette façon, nous pouvons faire une intégration par parties dans l’identité précédente et nous obtenons
| (4.30) |
où nous cherchons à estimer les termes et .
Pour le terme de l’identité (4.30), comme nous avons
et alors, comme nous pouvons écrire , d’où nous obtenons l’estimation
| (4.31) |
Pour le terme de l’identité (4.30), étant donné que alors nous avons
| (4.32) |
et nous avons encore besoin d’estimer les termes et ci-dessus. Pour le terme , toujours comme nous pouvons écrire et alors nous obtenons
| (4.33) |
Nous allons maintenant étudier le terme de l’identité (4.32) et pour cela nous avons besoin du lemme technique suivant.
Lemme 4.2.3
Soient une solution des équations de Navier-Stokes stationnaires (4.3). Si avec et alors .
La preuve de ce lemme repose essentiellement sur la continuité du projecteur de Leray sur les espaces de Morrey et cette preuve sera faite à la fin du chapitre page 4.3. Comme alors par le Lemme 4.2.3 nous avons ; et par les inégalités de Hölder nous écrivons
| (4.34) | |||||
Ainsi, avec les estimations (4.33) et (4.34) nous revenons à l’inégalité (4.32) pour écrire
| (4.35) |
Revenons maintenant à l’identité (4.30) où, étant donné que si , et de plus, par les estimations (4.31) et (4.35), nous pouvons alors écrire
d’où, nous prenons la limite lorsque et nous avons . La Proposition 4.2.2 est démontrée.
Maintenant nous avons l’information dont on a besoin pour montrer l’identité . En effet, par le Lemme 4.1.4 nous avons et comme alors . Ensuite, para la Proposition 4.2.2 nous avons ainsi et alors par les inégalités de Sobolev précisées (4.17) nous avons . Ainsi, par le point du Théorème 4.2.1 nous avons finalement . Le théorème 4.2.2 est maintenant démontré
Dans la démonstration du Théorème 4.2.2 que nous venons de faire nous pouvons observer que nous avons besoin de l’information et (avec ) pour obtenir l’identité . Néanmoins, dans le théorème ci-dessous nous allons observer que si l’on considère maintenant un sous-espace particulier de alors nous n’avons pas besoin de considérer un deuxième espace de Morrey (avec une homogénéité différente) pour obtenir .
Nous commençons donc par introduire, en toute généralité, les espaces fonctionnels qui nous utiliserons ci-après.
Définition 4.2.1 (L’espace )
Soient . On définit l’espace comme l’adhérence de l’espace des fonction de test dans l’espace de Morrey donné dans la Définition 4.18.
Une fois que l’on a défini ces espaces fonctionnels, on fixe maintenant le paramètre et pour on considère l’espace . Observons tout d’abord que par la définition ci-dessus nous avons et comme l’on a aussi l’inclusion alors l’espace est un sous-espace de et il est un espace homogène de degré .
Nous allons démontrer que l’on peut résoudre un problème de Liouville pour les équations (4.3) lorsque la solution appartient à l’espace pour des valeurs convenables du paramètre .
Théorème 4.2.3
Si nous comparons ce résultat avec le Théorème 4.2.2 nous observons que dans le cadre particulier de l’espace on n’a pas besoin de faire aucune hypothèse additionnelle sur la solution pour obtenir l’identité .
Démonstration. Pour démontrer ce théorème nous allons suivre les grandes lignes de la démonstration du Théorème 4.2.2 et on commence par considérer la solution comme la donnée initiale du problème de Cauchy (4.27). Ainsi, toujours par Théorème du livre [46]
il existe une fonction qui est l’unique solution du problème de Cauchy (4.27) (grâce au Théorème du livre [46]) et qui vérifie en plus l’estimation
| (4.36) |
Mais, comme la solution stationnaire est aussi une solution du problème (4.27) alors on a et donc la solution vérifie l’estimation (4.36) d’où nous pouvons en tirer .
Maintenant que l’on dispose de l’information nous allons montrer l’identité . En effet, rappelons tout d’abord que l’on a l’inclusion et nous avons ainsi . Ensuite, par la Proposition 4.2.2 nous avons et alors
, d’où, toujours par les inégalités de Sobolev précisées (4.17) nous avons , et par le point du Théorème 4.2.1 nous pouvons finalement écrire .
4.3 Preuve des lemmes techniques
Preuve du Lemme 4.1.3 page 4.1.3
On commence par montrer que si alors on a . En effet, pour le champ de vitesse nous pouvons écrire la pression comme , où nous observons que comme alors par les inégalités de Hölder nous avons (pour ) et donc . De cette façon nous obtenons .
Vérifions maintenant que . Nous écrivons la solution comme
| (4.37) |
où nous observons que comme alors toujours par les inégalités de Hölder nous avons et donc . Ainsi, par l’identité (4.37) nous avons et alors .
Nous écrivons finalement pour obtenir .
Preuve du Lemme 4.2.1 page 4.2.1
-
1)
On commence par estimer le terme . En utilisant les inégalités de Hölder (avec ) et comme nous pouvons écrire
(4.38) Estimons maintenant le terme . En utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz et comme la fonction vérifie nous avons
(4.39) -
2)
Étudions maintenant le terme défini par
(4.40) On commence par observer que l’on peut toujours écrire . En effet, il suffit de définir
(4.41) et comme on a l’identité
Observons aussi le fait que comme alors par l’identité (4.41) on a . De plus, pour mener à bien les estimations dont on aura besoin nous allons poser la fonction et comme l’on a (car est un vecteur constant) et nous allons écrire , c’est à dire, nous avons les identités où les indices sont ordonnés par la règle de la main droite.
De cette façon, dans l’expression (4.40) nous remplaçons par et nous obtenons l’identité suivante:et en faisant une intégration par parties nous avons
(4.42) Nous devons étudier encore les termes et ci-dessus. Pour le terme , comme les indices sont ordonnées par la règle de la main droite nous avons alors et donc nous avons
(4.43) Pour le terme nos écrivons
où, toujours par le fait que les indices sont ordonnés par la règle de la main droite nous avons que le terme ci-dessus est égale à zéro et ainsi nous avons
(4.44) Une fois que nous disposons des identités (4.43) et (4.44) nous revenons au terme donné dans (4.42) pour écrire
d’où nous avons
Dans les deux termes à droite de cette estimation nous appliquons tout d’abord l’inégalité de Cauchy-Schwarz, ensuite l’inégalité de Hölder (avec ) et comme et , alors nous obtenons
Dans cette dernière estimation nous avons besoin d’étudier le terme . Rappelons que , et comme alors et donc est une fonction Hölderienne avec et nous avons ainsi , d’où nous obtenons , avec .
Á ce stade, rappelons aussi que , et comme alors nous obtenonsd’où, en posant la constante nous avons estimation cherchée:
Observons finalement que la constante dépend de la fonction qui dépend finalement de solution par l’identité (4.41) et nous écrivons alors .
Preuve du Lemme 4.2.2 page 4.2.2
Nous allons montrer l’estimation
| (4.45) |
Soient et et soir la boule . Par les inégalités d’interpolation nous avons l’estimation
et alors nous pouvons écrire
d’où, dans l’estimation à gauche ci-dessus nous écrivons , dans l’estimation à droite ci-dessus nous écrivons pour obtenir
et donc nous avons
Ainsi, par la définition des quantités et données dans la Définition 4.1.2 nous écrivons l’estimation cherchée (4.45).
Preuve du Lemme 4.2.3 page 4.2.3
Pour le champ de vitesse nous écrivons la pression comme
où est la transformée de Riesz. Ainsi, étant donné que l’opérateur est borné dans les espaces de Morrey avec et (voir le livre [46], page ) et par les inégalités de Hölder nous avons l’estimation
Références
- [1] P. Aucher & P. Tchamitchian. Espaces critiques pour le système des équations de Navier-Stokes incompressibles. ArXiv e-prints, arXiv 0812.1158 (2008).
- [2] A.Biswas. Gevrey regularity for a class of dissipative equations with applications to decay. J. Differential Equations 253 (2012) 2739–2764.
- [3] C. Bjorland & M. E. Schonbek. Existence and stability of steady-state solutions with finite energy for the navier-stokes equation in the whole space. Nonlinearity, 22(7), 1615-1637, (2009).
- [4] C. Bjorland, L. Brandolese, D. Iftimie & M. E. Schonbek. -solutions of the steady-state Navier–Stokes equations with rough external forces. Communications in Partial Differential Equations, 36(2), 216-246, (2010).
- [5] J. Boussinesq. Essai sur la théorie des eaux courantes. Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Sciences 23(1), 1–660 Paris (1877).
- [6] F. Boyer & P. Fabrice. Élements d’analyse pour l’étude de quelques modèles d’écoulements de fluides visqueux incompressibles. Springer Vol. 52, (2000).
- [7] O. Cadot. Introduction à la turbulence. Cours de l’école d’ingénieur l’ENSTA-ParisTech (2013).
- [8] L. Caffarelli, R. Kohn & L. Niremberg. Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations. Comm. Pure Appl. Math., 35:771-831 (1982).
- [9] M. Cannone. Ondelettes, paraproduits et Navier–Stokes, Diderot, Paris (1995).
- [10] T. Chácon Rebollo & R. Lewandowski. Mathematical and Numerical Foundations of Turbulence Models and Applications. Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, Birkhäuser Basel, Springer NY, (2014)
- [11] D. Chae. Liouville-type theorems for the forced Euler equations and the Navier-Stokes equations. Comm. Math. Phys., 326:37-48 (2014).
- [12] D. Chamorro, O. Jarrín & P.G. Lemarié-Rieusset. Frequency decay for Navier-Stokes stationary solutions. Preprint. C. R. Acad. Sci. (2017).
- [13] A. Cheskidov. An inviscid dyadic model of turbulence: the global attractor. AIMS., 26:781 - 794 (2010).
- [14] S. Childress. Bounds on dissipation for Navier-Stokes flow with Kolmogorov forcing. Physica D Nonlinear Phenomena., 158: 105-128 (2001).
- [15] L. Comtet. Analyse combinatoire - Tome premier. Collection Sup - Le mathématicien, Presses Universitaires de France, (1970).
- [16] P. Constantin. Euler equations Navier-Stokes equations and turbulence, Mathematical Foundation of Turbulent Viscous Flows, Vol. 1871 of the series Lecture Notes in Mathematics: 1-43 (2005).
- [17] P. Constantin & C. Foias. Navier-Stokes Equations, The University of Chicago Press. (1988)
- [18] P. Constantin & F. Ramos. Inviscid Limit for Damped and Driven Incompressible Navier-Stokes Equations in . Communications in Mathematical Physics., 275,Issue 2, 529–551 (2007).
- [19] P. Constantin. Bounds for second order structure functions and energy spectrum in turbulence. Physics of fluids., 11 (1999).
- [20] R. Dascaliuc & Z. Grulić. On energy cascades in the forced 3D Navier-Stokes equations: J Nonlinear Sci., 22:683-715 (2016).
- [21] R. Finn. On the steady-state solutions of the Navier-Stokes equations, III. Acta Math., 105:197-244 (1961).
- [22] C. Doering & C. Foias. Energy dissipation in body-forced turbulence, Journal of Fluid Mechanics., 467:289- 306 (2002).
- [23] C. Foias. Bounds for the mean dissipation of 2-D enstrophy and 3-D energy in turbulent flows, Phys. Lett. A 174:210–215 (1993).
- [24] C. Foias. Estimates for the energy cascade in three-dimensional turbulent flows. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, Série I., 332:509-514 (2001).
- [25] C. Foias. Kolmogorov theory via finite-time averages. Physica D: Nonlinear Phenomena Volume., 212:245-270 (2005).
- [26] C. Foias. Navier-Stokes Equations and Turbulence, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Vol. 83, Cambridge University Press, Cam- bridge, (2001).
- [27] C. Foias & R. Temam. Gevrey class regularity for the solutions of the Navier–Stokes equations, J. Funct. Anal. 87 (1989) 359–369.
- [28] H. Fujita & T. Kato. On the Navier-Stokes initial value problem. I. Arch. Ration. Mech. Anal., 16 :269-315 (1964).
- [29] G. Galdi. An introduction to the mathematical Theory of the Navier-Stokes equations: Steady-state problems. Springer monographs in mathematics (1994).
- [30] P. Gérard, Y. Meyer & F. Oru. Inégalités de Sobolev précisées. Séminaire Équations aux dérivées partielles. Vol. 1996-1997: 1-8 (1996-1997).
- [31] M. Gevrey. Sur la nature analytique des solutions des équations aux dérivées partielles. Premier mémoire. Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure, Série 3 : Tome 35 , p. 129-190 (1918).
- [32] L. Grafakos. Modern Fourier Analysis. Second Edition, Springer monographs in mathematics (2009).
- [33] Z. Grujic & I. Kukavica. Space analyticity for the Navier–Stokes and related equations with initial data in Lp , J. Funct. Anal. 152 (1998) 247–466.
- [34] G. Houël. Estimations du taux de dissipation d’énergie cinétique turbulente. Projet de recherche en laboratoire MEC559-MEC569, École Polytechnique, (2004).
- [35] A. Iliyin & E. Titi. The Damped-Driven 2D Navier–Stokes System on Large Elongated Domains. J. math. fluid mech. 10: 159-175 (2008).
- [36] A. Iliyin, K. Patni & S. Zelik. Upper bounds for the attractor simension of damped Navier-Stokes equations in . Discrete and continous dynamical systems. Vol.36, N. 4: 2085–2102 (2016).
- [37] L. Jacquin & P. Tabeling. Turbulence et Tourbullons. Majeure 1, MEC555, École Polytechnique (2006).
- [38] J.P. Kahane & P.G. Lemarié-Rieusset. Séries de Fourier et ondelettes. Cassini, Paris, (1998).
- [39] V.K Kalantarov, B. Levant & E.S. Titi. Gevrey Regularity for the Attractor of the 3D Navier–Stokes–Voight Equations. J Nonlinear Sci 19: 133-149, (2009).
- [40] S.Kida & S.A. Orszag. Energy and spectral dynamics in decaying compressible turbulence. J. Sci. Comput. 7 , no. 1, 1–34 (1992).
- [41] A. N. Kolmogorov. The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 30 (1941).
- [42] A. N. Kolmogorov. On Degeneration of Isotropic turbulence in an incompressible viscous liquid. Dokl. Akad. Nauk SSSR 31 (1941).
- [43] A. N. Kolmogorov. Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence. Dokl. Akad. Nauk SSSR 32, (1941)
- [44] W. Layton. Bounds on energy and helicity dissipation rates of approximate deconvolution models of turbulence. SIAM Journal on Mathematical Analysis;, 39(3), 916-931 (2007)
- [45] P.G. Lemarié-Rieusset. Recent developments in the Navier-Stokes problem, Chapman & Hall/CRC, (2002).
- [46] P.G. Lemarié-Rieusset. The Navier-Stokes Problem in the 21st Century, Chapman & Hall/CRC, (2016).
- [47] P.G. Lemarié-Rieusset. Une remarque sur l’analyticité des solutions milds des équations de Navier-Stokes dans . (French). C. R. Acad. Sci. Paris Série. I Math. 330 (2000), no. 3, 183–186.
- [48] O. Ladyzhenskaya. The study of Navier-Stokes equations for stationnary motion of an imcompressible liquid. Usp. Mat. Nawk, 15:75-97 (1959).
- [49] O. Ladyzhenskaya. The mathematical theory of viscous incompressible flow; Gordon and Breach, New York-London (1963)
- [50] Y. Le Jan & A.S. Sznitman. Stochastic cascades and 3-dimensional Navier- Stokes equations, Probab. Theory Related Fields., 109 (3):343–366, (1997).
- [51] J. Leray. Essai sur le mouvement dun fluide visqueux emplissant l’espace. Acta Math. 63, 193-248 (1934).
- [52] R. Lewandowski. Long time turbulence model deduced from the Navier-Stokes Equations, Chinese Annals of Mathematics, Serie B, Vol 36, No. 5, pp. 883-894, (2015)
- [53] J. M. McDonough. Introductory lectures on turbulence: Physics, Mathematics and Modeling. Departments of Mechanical Engineering and Mathematics, University of Kentucky, (2004).
- [54] D.O. Martinez. Energy spectrum in the dissipation range of fluid turbulence. J. Plasma Physics., 57:195-201 (1996).
- [55] A. Mazzucato. On the energy spectrum for weak solutions of the Navier-Stokes equations. Nonlinearity,18 (2004).
- [56] Y. Meyer. Ondelettes et Opérateurs, Tome 1. Hermann, Éditeurs des sciences et des arts, (1990).
- [57] A.M. Obukhoff. On the energy distribution in the spectrum of a turbulent flow. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 32, (1941).
- [58] C. Odasso. Spatial smoothness of the stationary solutions of the 3D Navier–Stokes equations. arXiv:math/0512057.
- [59] M. Oliver & E.S. Titi. Remark on the rate of decay of higher order derivatives for solutions to the Navier–Stokes equations in Rn, J. Funct. Anal. 172 (1) (2000).
- [60] F. Otto & F. Ramos. Universal bounds for the Littlewood-Paley first-order moments of the 3-D Navier-Stokes equations, 2009. Commun. Math. Phys., 300: 301-315, (2010).
- [61] J. Pedlosky. Geophysical Fluid Dynamics. Springer, New-York (1979).
- [62] T. Van Phan & N.C. Phuc. Stationary Navier-Stokes equations with critically singular external forces: existence and stability results. Adv. Math., 241:1371-161, (2013).
- [63] N. Prioux. Méthodes d’analyse harmonique pour l’étude des équations de Navier-Stokes, de Boussinesq et de la Magnéto-Hydrodynamique, Thèse de doctorat de l’université de Marne-la-Vallée (2007).
- [64] O. Reynolds. An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels. Philosophical Transactions of the Royal Society. 174, 935–982 (1883).
- [65] L. F. Richardson. Weather prediction by Numerical Process, Cambridge University Press, (1922).
- [66] D. Ruelle. Chance et Chaos. Princeton University Press, Princeton (1991).
- [67] G. Seregin. Liouville type theorem for stationnary Navier-Stokes equations, Nonlinearity, 29: 2191:2195 (2015).
- [68] G. Seregin. A Liouville type theorem for steady-state Navier-Stokes equations, arXiv:1611.01563 (2016).
- [69] G. Stokes. On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums. Transactions of the Cambridge Philosophical Society. 9, 8–106 (1851).
- [70] R. Temam. Navier-Stokes Equations. Theory and Numerical Analysis, Studies in Mathematics and its Applications, 3rd edition, North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York (1984).
- [71] H. Tennekes & J.L. Lumley. A First Course in Turbulence. The MIT Press (1972).
- [72] M. Van Dyke. An album of fluid motion. Departement of Mechanical Engineering, Stanford University. (1982).
- [73] F. Vigneron. Free turbulence on and . Dynamics of PDE., 7:107-160, (2010).
- [74] D. Wilcox. Turbulence model for CFD. DCW Industries, Inc (1994).
- [75] X. Liu. A Note on Gevrey Class Regularity for the Solutions of the Navier-Stokes Equations. Journal of Mathematical Analysis ans Applications, 167: 588-595 (1992).
![[Uncaptioned image]](/html/1806.10430/assets/ED_EDMH-h.jpg)
Titre : Descriptions déterministes de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes Mots Clefs : Équations de Navier-Stokes; système stationnaire; théorie K41 Résumé : Cette thèse est consacrée à l’étude déterministe de la turbulence dans les équations de Navier-Stokes; et elle est divisée en quatre chapitres indépendants. Le premier chapitre s’agit d’une discussion rigoureuse sur l’étude la loi de dissipation d’énergie, proposée par théorie de la turbulence K41, dans le cadre déterministe des équations de Navier-Stokes homogènes et incompressibles, avec une force externe stationnaire (la force ne dépende que de la variable spatiale) et posées sur l’espace tout entier. Le but de ce chapitre est de mettre en évidence le fait que si nous considérons les équations de Navier-Stokes posées sur alors certains quantités physiques, nécessaires pour l’étude de la loi de dissipation de Kolmogorov, n’ont pas une définition rigoureuse et alors pour donner un sens à ces quantités on propose de considérer les équations de Navier-Stokes mais avec un terme additionnel d’amortissement . Dans le cadre de ces équations de Navier-Stokes amorties, on obtient des estimations du taux de dissipation d’énergie selon la loi de dissipation de Kolmogorov. Dans le deuxième chapitre on s’intéresse à l’étude des solutions stationnaires des équations de Navier-Stokes amorties introduites dans le chapitre précédent. Ces solutions stationnaires correspondent à un type particulier des solutions qui ne dépendent que de la variable d’espace: la motivation pour étudier ces solutions stationnaires étant donné que la force externe que nous considérons tout au long de cette thèse est une fonction stationnaire. Dans ce chapitre on étudie essentiellement deux propriétés des solutions stationnaires: la première propriété correspond à la stabilité de ces solutions où on montre que si l’on contrôle la force externe des équations de Navier-Stokes amorties alors toute solution non stationnaire (qui dépend de la variable d’espace et aussi de la variable de temps) converge vers une solution stationnaire lorsque le temps tend à l’infini. La deuxième propriété porte sur l’étude de la décroissance en variable spatiale des ces solutions stationnaires. Dans le troisième chapitre on continue à étudier les solutions stationnaires des équations de Navier-Stokes, mais cette fois-ci on considère les équations de Navier-Stokes classiques (sans aucun terme d’amortissement) . Le but de ce chapitre est d’étudier un tout autre problème relié à l’étude déterministe de la turbulence et qui porte sur la décroissance de la transformée de Fourier des solutions stationnaires. En effet, selon la théorie de la turbulence K41, si le fluide est en régime laminaire on s’attend à observer une décroissance exponentielle de la transformée de Fourier des solutions stationnaires et cette décroissance à lieu dès les bases fréquences, tandis que si le fluide est en régime turbulent alors on s’attend à observer cette même décroissance exponentielle mais seulement aux hautes fréquences. Ainsi, à l’aide des outils de l’analyse de Fourier, dans ce chapitre on donne des descriptions précises sur cette décroissance exponentielle fréquentiel (dans le régime laminaire et dans le régime turbulent) des solutions stationnaires. Dans le quatrième et dernier chapitre on revient aux solutions stationnaires des équations de Navier-Stokes (on considère toujours les équations classiques) et on étude l’unicité de ces solutions dans le cas particulier où la force externe est nulle. En suivant essentiellement quelques idées des travaux précédents de G. Seregin, on étudie l’unicité des ces solutions tout d’abord dans les cadres des espaces de Lebesgue et ensuite dans le cadre plus général des espaces de Morrey.
Title : Deterministic descriptions of the turbulence in the Navier-Stokes equations Keys words : Navier-Stokes equations; stationary system; K41 theory Abstract : This PhD thesis is devoted to deterministic study of the turbulence in the Navier-Stokes equations. The thesis is divided in four independent chapters. The first chapter involves a rigorous discussion about the energy’s dissipation law, proposed by theory of the turbulence K41, in the deterministic setting of the homogeneous and incompressible Navier-Stokes equations, with a stationary external force (the force only depends of the spatial variable) and on the whole space . The energy’s dissipation law, also called the Kolmogorov’s dissipation law, characterizes the energy’s dissipation rate (in the form of heat) of a turbulent fluid and this law was developed by A.N. Kolmogorov in 1941. However, its deduction (which uses mainly tools of statistics) is not fully understood until our days and then an active research area consists in studying this law in the rigorous framework of the Navier-Stokes equations which describe in a mathematical way the fluids motion and in particular the movement of turbulent fluids. In this setting, the purpose of this chapter is to highlight the fact that if we consider the Navier-Stokes equations on then certain physical quantities, necessary for the study of the Kolmogorov’s dissipation law, have no a rigorous definition and then to give a sense to these quantities we suggest to consider the Navier-Stokes equations with an additional damping term. In the framework of these damped equations, we obtain some estimates for the energy’s dissipation rate according to the Kolmogorov’s dissipation law. In the second chapter we are interested in study the stationary solutions of the damped Navier-Stokes introduced in the previous chapter. These stationary solutions are a particular type of solutions which do not depend of the temporal variable and their study is motivated by the fact that we always consider the Navier-Stokes equations with a stationary external force. In this chapter we study two properties of the stationary solutions: the first property concerns the stability of these solutions where we prove that if we have a control on the external force then all non stationary solution (with depends of both spatial and temporal variables) converges toward a stationary solution. The second property concerns the decay in spatial variable of the stationary solutions. These properties of stationary solutions are a consequence of the damping term introduced in the Navier-Stokes equations. In the third chapter we still study the stationary solutions of Navier-Stokes equations but now we consider the classical equations (without any additional damping term). The purpose of this chapter is to study an other problem related to the deterministic description of the turbulence: the frequency decay of the stationary solutions. Indeed, according to the K41 theory, if the fluid is in a laminar setting then the stationary solutions of the Navier-Stokes equations must exhibit a exponential frequency decay which starts at lows frequencies. But, if the fluid is in a turbulent setting then this exponential frequency decay must be observed only at highs frequencies. In this chapter, using some Fourier analysis tools, we give a precise description of this exponential frequency decay in the laminar and in the turbulent setting. In the fourth and last chapter we return to the stationary solutions of the classical Navier-Stokes equations and we study the uniqueness of these solutions in the particular case without any external force. Following some ideas of G. Seregin, we study the uniqueness of these solutions first in the framework of Lebesgue spaces of and then in the a general framework of Morrey spaces.