Construction impaire et étude de l’anneau des arcs de Khovanov
Grégoire Naisse
Promoteur: Pedro Vaz
Université catholique de Louvain
Faculté des Sciences
École de Mathématique
2014–2015
English summary
In this master thesis, we give an oddification of the Khovanov’s arc rings from [Khovanov]. Our construction is based on the odd Khovanov homology from P. Ozsvath, J. Rasmussen and Z. Szabo (see [OddKhovanov]) and thus depends on some choices of signs. More precisely we have to choose an order and an orientation for the saddle points. Set be the set of all such choices.
Theorem 1.
For each we have a family of rings .
By explicit computations, we show that for all and all , the ring is non-associative. Of course, it is associative up to sign and by tensoring with we get the same ring as the mod reduction of Khovanov’s rings.
Example 1.
As an example of non-associative elements in for arbitrary consider (see [Khovanov] for a definition of ) such that
If we take and , where is the element in the exterior algebra generated by one of the circles from the diagram and is the involution which flips the diagram vertically, we get
There is also an example of a choice with such that if we take , and we get .
Like in the even case (see [HnCenter]), there is a link between these rings and the cohomology of the Springer varieties. In the context of odd theory we consider an extended version of the center which includes the anti-commutative elements and we call it the "odd center" or "supercenter". We write it . We show that there is a link with the oddification of the cohomology of the Springer variety constructed by A. Lauda and H. Russell in [OddSpringer], denoted in our work.
Theorem 2.
The odd center of is an associative ring and does not depends on the choice of . Furthermore, there is an isomorphism of graded rings
The proof of this theorem is split in three main steps :
-
1.
We construct a graded morphism from the ring of odd polynomials in variables (see in [OddSpringer]) to which is similar to the isomorphism from [HnCenter]. Then, by showing that the ideal used to define is in the kernel of , we get an induced graded morphism
-
2.
Using the equivalence modulo between the odd and the even case, the existence of a basis for and the isomorphism , we prove that is injective.
-
3.
Finally, we show that the rank of is the same as that of and consequently that is bijective. To do so, we construct a variety , in a way similar to the from [HnCenter] but using circles instead of spheres. By employing similar arguments as Khovanov, we get an isomorphism of non-graded rings between the cohomology and and we prove that the rank of is what we are looking for.
Also, we get a non-graded isomorphism between and and thus this proves that the construction of A. Lauda and H. Russell gives a presentation for the cohomology ring of if we replace the degrees of the generators by 1 instead of 2.
In the last section of the thesis, thanks to Krzysztof Putyra, we construct an associator for which is based on the degrees and the diagrams of the elements. Then, we find a sufficient condition for having isomorphic rings with two different choices of order and orientations for the saddle points.
Theorem 3.
Let and be in . If the associator of and are the same, then there is an isomorphism of graded rings
Acknowledgment
None of this would have been possible without the help of my thesis supervisor Pedro Vaz.
Remerciements
Je remercie tout d’abord mon promoteur, Pedro Vaz, pour ses qualités de mentor, son soutien durant l’écriture de ce mémoire et sa grande disponibilité ainsi que pour m’avoir ouvert la voie à la théorie des nœuds et à toutes les mathématiques qu’elle implique.
Je remercie aussi Krzysztof Putyra pour ses explications et ses idées qui ont permis d’enrichir fortement le Chapitre 4.
Je souhaite remercier tous mes professeurs de l’Université catholique de Louvain pour avoir partagé avec moi leur savoir et leur amour des mathématiques.
Je remercie également mes parents Anne et Frédéric pour leur soutien et pour m’avoir permis de faire ces études. De même je remercie mon frère Corentin pour avoir toujours été un modèle exemplaire pour moi.
Enfin je voudrais remercier Isaure pour son affection et son soutien, ainsi que tous mes amis pour être géniaux.
Introduction
La théorie des nœuds étudie principalement le plongement de cercles dans l’espace, qu’on appelle des entrelacs. La grande question est de pouvoir déterminer si deux entrelacs sont isotopes. Actuellement, on ne peut répondre que partiellement à cette question, et ce, en utilisant des invariants, c’est-à-dire des objets algébriques associés à chaque entrelacs : deux entrelacs ayant des invariants différents étant assurément non-isotopes.
Le monde de la théorie des nœuds fut révolutionné en 1985 par V. F. R. Jones [Jones] qui a construit un invariant polynomial très simple à calculer puisqu’il s’obtient à partir de la relation d’écheveau locale :
Cela fut révolutionnaire puisqu’avant cette date, les seuls invariants connus étaient soient très peu puissants (comme par exemple le nombre d’entrelacements), soit difficilement calculables (comme le groupe fondamental du complément d’un nœud). Par après, on a vu apparaitre toute une série d’autres invariants du même type (par exemple le polynôme de HOMFLY ou encore celui de Kauffman) jusqu’à une seconde révolution dans le milieu due à M. Khovanov [KhovanovHomology] qu’il qualifia de "catégorification du polynôme de Jones".
La catégorification imaginée par M. Khovanov consiste en un invariant homologique, c’est-à-dire qu’on calcule l’homologie d’un certain complexe de chaines associé à un diagramme d’entrelacs et cette homologie permet de distinguer certains entrelacs non-isotopes. Pour construire ce complexe, on transforme un diagramme d’entrelacs en une famille de collections de cercles et ces collections sont reliées par des cobordismes. On définit alors un foncteur qui envoie une collection de cercles vers le produit tensoriel de copies d’un certain groupe abélien gradué et un cobordisme entre deux telles collections vers un homomorphismes de modules gradués sur . À un diagramme d’entrelacs , on associe donc des groupes de cohomologie doublement gradués, noté , étant l’indice du groupe de cohomologie et le degré induit par . M. Khovanov a montré que ces groupes de cohomologie constituent des invariants d’entrelacs. De plus, l’homologie de Khovanov forme un foncteur de la catégorie des entrelacs (avec les flèches données par des cobordismes plongés dans ) vers les groupes abéliens. On peut définir une caractéristique d’Euler graduée pour ces groupes de cohomologie par :
et par la construction de l’homologie de Khovanov, cela livre le polynôme de Jones de (à renormalisation près). Cette situation est comparable au cas des CW-complexes, où la caractéristique d’Euler n’est que l’ombre d’une structure beaucoup plus riche que sont les groupes d’homologie cellulaire du complexe.
En plus de cette structure additionnelle, l’intérêt de l’invariant de M. Khovanov réside dans le fait qu’il est strictement plus fort que celui de Jones [khstrongerJ], qu’il permet de détecter le nœud trivial [unknot] (ce qui est une conjecture pour le polynôme de Jones) et qu’il ouvre la porte à toute une série de nouveaux invariants homologiques (on cite par exemple la généralisation de l’homologie de Khovanov pour des polynômes coloriés).
De façon générale, L. Crane et I. Frenkel définissent une catégorification comme "une procédure informelle qui transforme les entiers en groupes abéliens, les espaces vectoriels en catégories abéliennes ou triangulées et les opérateurs en foncteurs entre ces catégories", dans [categorification]. On obtient alors une structure additionnelle donnée par les transformations naturelles de foncteurs qu’on ne trouve pas avant la catégorification. L’objectif de cette procédure était de transformer des invariants quantiques de variétés de dimension 3 en invariants de variétés de dimension 4. L. Crane propose aussi dans son article [clockcate] d’utiliser le concept de catégorification pour construire une théorie quantique de la gravitation de dimension 3+1 à partir de théories qui fonctionnent pour la dimension 3. La construction de M. Khovanov est donc bien une catégorification puisque les entiers du polynôme de Jones sont transformés en groupes abéliens gradués (les groupes de cohomologie avec la graduation de ), la somme directe de ces groupes formant donc une catégorie bigraduée dont une des deux graduations correspond aux puissances de du polynôme de Jones.
Par ailleurs, on peut étendre le polynôme de Jones pour en faire un foncteur de la catégorie des enchevêtrements (qui consistent en le plongement de cercles et d’intervalles dans l’espace, reliant points fixés sur une droite à points fixés sur une autre) vers la catégorie des espaces vectoriels. Ce foncteur envoie les points vers , où est la représentation irréductible de dimension 2 du groupe quantique , et les points vers . À un enchevêtrement orienté reliant points à points, ce foncteur associe un opérateur qui entrelace l’action de (voir sources [quantumj],[quantumsl]). Ce foncteur est tel que si on prend , on obtient le polynôme de Jones. De plus, se restreint à un foncteur sur les enchevêtrements, c’est-à-dire les enchevêtrements reliant points à points, envoyant les points sur l’espace des applications multilinéaires sur invariantes par rapport à l’action de et envoyant un enchevêtrement sur un entrelacement en prenant la restriction de sur ces espaces (voir [quantumj],[spider2]).
M. Khovanov a étendu son invariant aux enchevêtrements dans [Khovanov] en catégorifiant . Cette catégorification transforme en la catégorie triangulée des complexes de modules gradués (à homotopie de chaine près) sur un certain anneau et en le foncteur donné par la tensorisation par un certain complexe de bimodules sur (,). On appelle ces anneaux les anneaux des arcs de Khovanov. On associe donc à un enchevêtrement un complexe de bimodules sur (,), dont la classe d’équivalence à homotopie de chaines près donne un invariant d’enchevêtrements. Cette categorification étend l’homologie de Khovanov puisque si on prend , le complexe obtenu est celui utilisé pour calculer les groupes d’homologies , où est un enchevêtrement sans point d’extrémités, c’est-à-dire un entrelacs.
En 2013, P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo ont construit dans [OddKhovanov] une "oddification" de l’homologie de Khovanov, le terme "odd", qu’on traduit par impair, signifiant qu’on retrouve une certaine antisymétrie dans les objets. Cette construction impaire utilise un foncteur projectif différent de l’homologie de Khovanov, le terme projectif signifiant qu’il n’est bien défini qu’à signe près. Ce foncteur envoie les collections de cercles, non pas sur des produits tensoriels, mais sur des produits extérieurs. On peut montrer qu’on obtient alors un nouvel invariant d’entrelacs qui ne dépend pas des signes et qui forme une autre catégorification du polynôme de Jones. Cette homologie impaire permet de distinguer des nœuds que la version paire ne distingue pas, comme l’a montré A. Shumakovitch dans [shumakovich]. J. Bloom a montré dans [bloom] que l’homologie impaire est invariante sous opération de mutation alors qu’il existe des exemples d’entrelacs mutants qui ont des homologies paires différentes (voir [wehrli]). De plus, l’homologie de Khovanov est équivalente à sa version impaire si on les considère toutes deux en modulo 2. Récemment, K. Putyra a construit dans [Covering] un cadre qui permet de retrouver l’homologie de Khovanov et sa version impaire, avec un paramètre permettant d’obtenir l’une ou l’autre.
On se demande alors ce que donnerait une construction similaire à celle des anneaux des arcs de Khovanov, mais en utilisant le foncteur de P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo.
Cela livre une "oddification" des anneaux et constitue le premier objectif de ce travail. Puisqu’il y a un choix de signes à faire, on construit des familles d’anneaux , chacun étant caractérisé par des choix de signes notés . De plus, pour que cela soit bien défini et que le foncteur projectif de [OddKhovanov] devienne un foncteur au sens usuel, on a besoin d’une catégorie plus structurée que celle des cobordismes et on utilise donc la catégorie des cobordismes avec chronologies, définie par K. Putyra dans [Putyra] (il utilise aussi cette catégorie pour construire son cadre dans [Covering]).
Par ailleurs, dans [HnCenter], M. Khovanov a relié ses anneaux à la cohomologie de la variété de Springer pour une partition , montrant que le centre de l’anneau est isomorphe en tant qu’anneau gradué à l’anneau de cohomologie de cette variété. En 2014, A. Lauda et H. Russell ont proposé de leur côté, dans [OddSpringer], une construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer pour une partition quelconque, construction basée sur les polynômes impairs et donnant par conséquent une antisymétrie aux éléments.
On s’interroge donc légitiment quant à l’existence d’un lien entre la construction impaire de introduite dans ce travail et la construction de A. Lauda et H. Russell.
On répond par l’affirmative et, en étendant le centre de aux éléments anticommutatifs, ce qu’on appelle le centre impair, on obtient un anneau qui est isomorphe à la construction impaire de la cohomologie de Springer pour une partition .
Plan général
Ce travail est séparé en 4 chapitres et est muni d’un ensemble d’annexes. Le premier chapitre vise à définir les anneaux des arcs de Khovanov , en définissant d’abord la catégorie de Temperley-Lieb et la catégorie des cobordismes de dimension 2 qui sont des bases nécessaires à la construction de ces anneaux. On définit ensuite le foncteur de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des espaces vectoriels, utilisé par M. Khovanov pour construire son homologie, et enfin on définit les anneaux .
Une construction impaire des anneaux étant l’objectif principal du Chapitre , on définit d’abord le foncteur de P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo en utilisant le travail de K. Putyra sur les cobordismes avec chronologies. On établit ensuite la construction impaire des anneaux des arcs, notée , avec des choix de signes . On propose un système de calculs basé sur des diagrammes coloriés afin de faciliter les calculs dans . Finalement, dans la dernière section du chapitre, on montre quelques résultats sur les anneaux , notamment qu’ils sont non-associatifs pour et qu’ils sont équivalents aux anneaux quand on les tensorise tous deux par .
Dans le Chapitre , on rappelle dans une première section quelques propriétés du centre de et des variétés de Springer pour une partition . On étudie ensuite dans la deuxième section les propriétés du centre de et on introduit la notion de centre impair. On définit dans la section suivante la construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer due à A. Lauda et H. Russell et, dans la section finale, on démontre le résultat principal de ce travail qui consiste à construire un isomorphisme entre et cette construction impaire pour une partition .
Dans le dernier chapitre, on propose une série de questions avec pistes de réflexions afin de construire de nouveaux objets à partir des anneaux et d’approfondir la compréhension de ceux-ci, notamment en étudiant les classes d’isomorphismes de pour des choix de signes différents ou encore en transformant en anneau associatif. Ensuite, on propose une idée de construction imaginée par K. Putyra afin de définir une notion de modules et bimodules qui aurait du sens sur et qui pourrait mener à une catégorification impaire de et donc potentiellement à un nouvel invariant d’enchevêtrements.
Enfin, les annexes sont destinées à rappeler des définitions et des résultats qui facilitent la compréhension de ce travail.
Chapitre 1 Anneaux des arcs de Khovanov
L’objectif de ce chapitre est de définir les anneaux des arcs de Khovanov , comme introduits par M. Khovanov dans [Khovanov]. À cette fin, on rappelle d’abord les définitions et quelques propriétés de la catégorie de Temperley-Lieb, notée , et de la catégorie des cobordismes de dimension . On décrit ensuite le foncteur utilisé par M. Khovanov pour construire son homologie et finalement on construit les anneaux grâce à ce foncteur.
1 Catégorie de Temperley-Lieb
L’objectif de cette section est de définir la catégorie de Temperley-Lieb dont les objets sont des collections de paires de points et les morphismes sont des enchevêtrements plats à isotopie près.
Définition 1.1.
Un -enchevêtrement plat entre deux collections de et points consiste en le plongement dans le plan d’une collection de intervalles qui ne se croisent pas, , appelés brins, et d’un nombre fini de composantes de cercles libres. On demande en plus que les bords des brins soient envoyés sur tous les points de et de , qu’on appelle points de base. On demande aussi que les brins soient perpendiculaires autour de ces points.
On note comme étant l’ensemble des classes de enchevêtrements plats, à isotopie préservant les points de base près, et comme étant ceux ne possédant pas de composante cercle. On note aussi et .
Le terme plat vient du fait qu’on ne permet pas aux brins de se croiser contrairement à l’appellation d’enchevêtrement au sens classique. Par ailleurs, il existe aussi une définition pour un enchevêtrement plat avec des collections impaires de et points, mais on n’en a pas besoin dans ce travail.
On dessine toujours un enchevêtrement comme allant de bas en haut, c’est-à-dire qu’on place les points en haut et les en bas. On donne un exemple d’élément de , donc de -enchevêtrement plat, en Figure 1.

Exemple 1.2.
Etant donné qu’on utilise principalement dans ce travail, on observe que est composé des deux classes d’enchevêtrements plats données par
Exemple 1.3.
De même est composé des cinq classes d’enchevêtrements plats suivant
Définition 1.4.
On définit la composition d’un et d’un -enchevêtrements plats en plaçant le premier au dessus du second et en faisant une homothétie divisant la hauteur totale par deux, c’est-à-dire que pour et on a
Il est clair que cette composition donne un -enchevêtrement plat puisque, par la condition de perpendicularité, ils se recollent de façon lisse, comme illustré en Figure 2. Il faut noter qu’en général, une composition d’un élément de avec un de n’est pas dans mais dans puisqu’on peut faire apparaitre des composantes de cercles libres.

On pose comme étant le -enchevêtrement plat donné les segments de droites pour . Par exemple on a
Il est facile de voir que pour et on a et .
Définition 1.5.
On définit la catégorie de Temperley-Lieb, notée , comme étant la catégorie ayant pour objets les collections de points , pour tout , et pour flèches les -enchevêtrements plats, à isotopie préservant les points de base près, et munis de la composition définie au dessus. L’identité est donnée par .
Par ailleurs, on remarque que est caractérisé par la façon de relier points ensemble par demi-cercles vers le bas qui ne peuvent pas se croiser, livrant la propriété suivante :
Proposition 1.6.
La cardinalité de est donnée par le -ème nombre de Catalan
Démonstration.
Comme expliqué dans [catalan, Chapitre 6], calcule le nombre de chaines de caractères de taille qu’on peut engendrer avec les caractères et telles qu’aucun segment initial ne contient plus de que de , c’est-à-dire les chaines bien parenthésées. On peut voir un élément de comme une telle chaine en notant un quand un arc part d’un point et un quand il y arrive (dans l’exemple précédent, pour , on obtient et ) puisqu’on ne peut pas fermer plus d’arcs que ce qu’on en a ouvert. De même, toute telle chaine de caractères peut être attribuée à un élément de en parcourant cette chaine et en reliant par un demi-cercle inférieur tout rencontré au précédent qui n’a pas encore été relié à un .
Définition 1.7.
On définit l’application d’involution sur un enchevêtrement plat qui retourne l’enchevêtrement en envoyant . On a alors
| et |
On observe que et donne donc une collection de cercles. Tous ces cercles intersectent l’axe , chacun en au moins deux points de , et donc on peut induire un ordre total sur ces cercles en considérant les abscisses minimales de ces points (un cercle est plus petit qu’un autre si son point d’intersection d’abscisse minimale est plus petit que celui de l’autre), comme le montre par exemple la Figure 3.
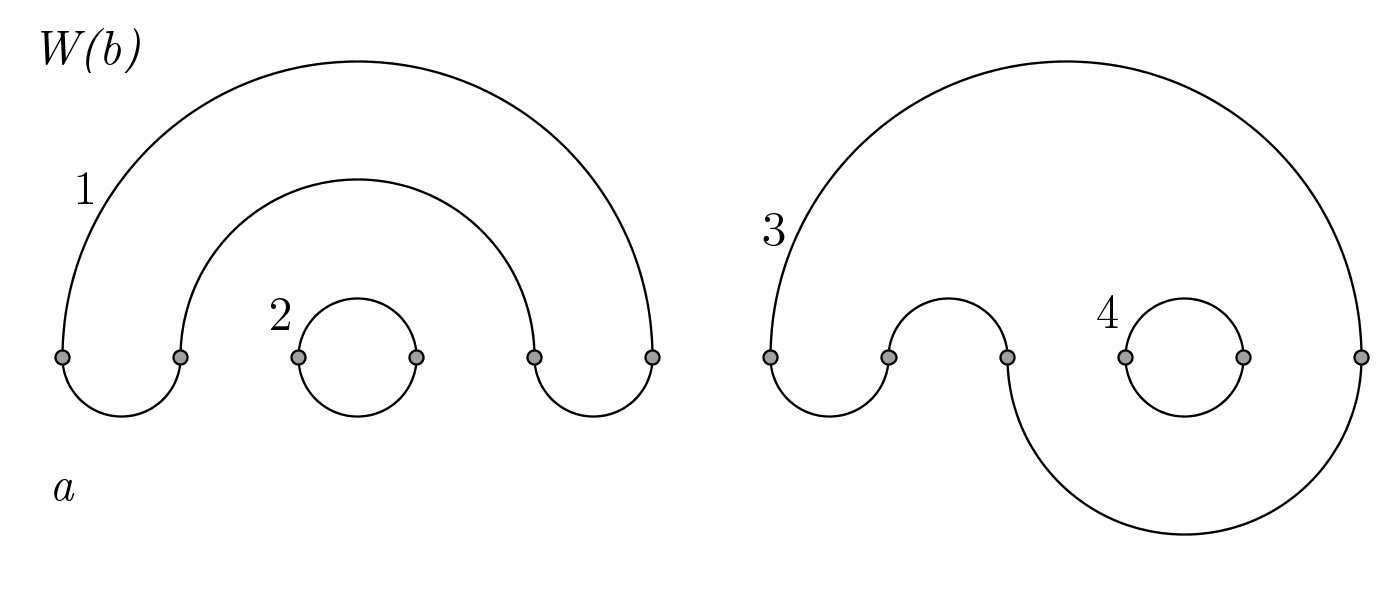
2 Catégorie des cobordismes
Cette section vise à définir la catégorie des cobordismes de dimension . Toutes les variétés considérées dans cette section sont lisses.
Définition 1.8.
Un cobordisme entre deux variétés et de même dimension est une variété à bord notée telle que son bord soit difféomorphe à l’union disjointe de et
On peut définir une notion de composition pour ces cobordismes.
Définition 1.9.
On définit le recollement de deux cobordismes ayant des bords et tels que par le cobordisme obtenu en prenant
On a une notion d’équivalence de cobordismes donnée par des difféomorphismes qui préservent les bords.
Définition 1.10.
On dit que deux cobordismes et ayant comme bords les même variétés et sont équivalents s’il existe un difféomorphisme tel que le diagramme
commute et où les morphismes de gauche et de droite sont les restrictions des difféomorphismes et .
On est maintenant en mesure de définir la catégorie des cobordismes.
Définition 1.11.
On note la catégorie monoïdale dont les objets sont des variétés de dimension un, compactes et sans-bord (c’est-à-dire des unions de cercles disjointes et finies) et les flèches sont des cobordismes orientables compacts entre ces variétés, à équivalence près, munis de la composition donnée par recollement de cobordismes et de la multiplication monoïdale donnée par l’union disjointe.
Par ailleurs, la catégorie possède une structure algébrique intéressante puisque par la théorie de Morse et le théorème de classification des surfaces on a le Théorème 1.12, dont on peut trouver une preuve dans [Cobordismes, Section 1.3] par exemple. Ce théorème permet de représenter les cobordismes sous forme de diagrammes qu’on lit de bas en haut, qu’on compose en les plaçant les uns au-dessus des autres et qu’on multiplie en les juxtaposant.
Théorème 1.12.
La catégorie des cobordismes est générée par les multiplications et compositions de l’identité, donnée par un cylindre, et des 5 cobordismes élémentaires : la naissance de cercle, la fusion, la scission, la mort de cercle et la permutation
sous les relations suivantes :
-
1.
Commutativité et co-commutativité
, -
2.
Associativité et coassociativité
, -
3.
Relations de Frobenius
-
4.
Unité et counité
, -
5.
Relations de permutations
, -
6.
Permutations de l’unité et de la counité
, -
7.
Permutations de la fusion et de la scission
,
3 Le foncteur
M. Khovanov définit un foncteur dans [Khovanov] (qui se trouve aussi dans [KhovanovHomology] pour construire l’homologie de Khovanov) de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des modules gradués sur . Ce foncteur associe à une collection de cercles le module donné par le produit tensoriel sur de fois un certain module défini comme suit :
où et est le décalage du degré par comme expliqué dans les Annexes à la Section A.3. Autrement dit, est le groupe abélien libre gradué engendré par et avec et .
Par le Théorème 1.12, il suffit de définir ce foncteur sur chacun des cobordismes élémentaires pour qu’il soit défini sur tous. La permutation et l’identité sont bien évidemment envoyés respectivement sur la permutation des dans le produit tensoriel et sur l’identité. À la naissance de cercle, on associe l’application unité
À la fusion on associe la multiplication dans en remplaçant le produit tensoriel par le produit de polynômes
La scission est envoyée sur l’application de comultiplication
Et enfin à la mort de cercle on associe la trace
On note que muni de comme multiplication, comme forme de Frobenius et comme comultiplication forme une algèbre de Frobenius. On obtient donc une "two dimensional topological quantum field theory" (2D-TQFT) qui donne la fonctorialité de . On renvoie vers [TQFT] pour plus de détails mais, grossièrement, une 2D-TQFT est un foncteur monoïdal de la catégorie des cobordismes vers une catégorie algébrique. Il est aussi possible de simplement montrer que est bien défini pour les relations du Théorème 1.12 si on ne veut pas parler de TQFT. De plus on obtient aisément le résultat suivant :
Proposition 1.13.
associe à un cobordisme un homomorphisme de degré égal à moins la caractéristique d’Euler du cobordisme
Démonstration.
On vérifie aisément avec les définitions de et que l’équation tient puisque et .
Exemple 1.14.
On calcule avec
qui est donc une naissance suivie d’une mort. On obtient alors
et donc .
Exemple 1.15.
On calcule avec
qui est donc une naissance suivie d’une scission, d’une fusion et enfin d’une mort. On obtient alors
et donc est donné par la multiplication par dans .
4 Définition des anneaux des arcs
Pour , on définit l’anneau des arcs de Khovanov d’indice vu comme groupe abélien gradué par la somme directe
| où | (1.1) |
Comme remarqué dans la Section 1, et est donc une union disjointe de cercles, d’où le fait qu’on puisse lui appliquer le foncteur .
Remarque 1.16.
On note que décaler le degré des éléments par permet d’obtenir un groupe positivement gradué. En effet, l’élément qui contient le plus grand nombre de composantes de cercles est donné par un élément de la forme et contient donc composantes. Dès lors, le plus grand produit tensoriel contient éléments et l’élément de degré minimal de est de degré .
Pour faire de un anneau, il reste à définir une multiplication et une unité. On pose pour et si . Il reste encore à définir la multiplication
L’idée est de construire un cobordisme de vers afin d’obtenir une multiplication donnée par l’image de ce cobordisme par . On observe que donne tous des demi cercles, chacun possédant sa symétrie horizontale en face, comme par exemple :
On peut donc construire des ponts donnant des "cobordismes avec bords" possédant un unique point de selle et qui envoient à chaque fois une paire de demi cercles vers deux segments de droite, comme représenté en Figure 4.
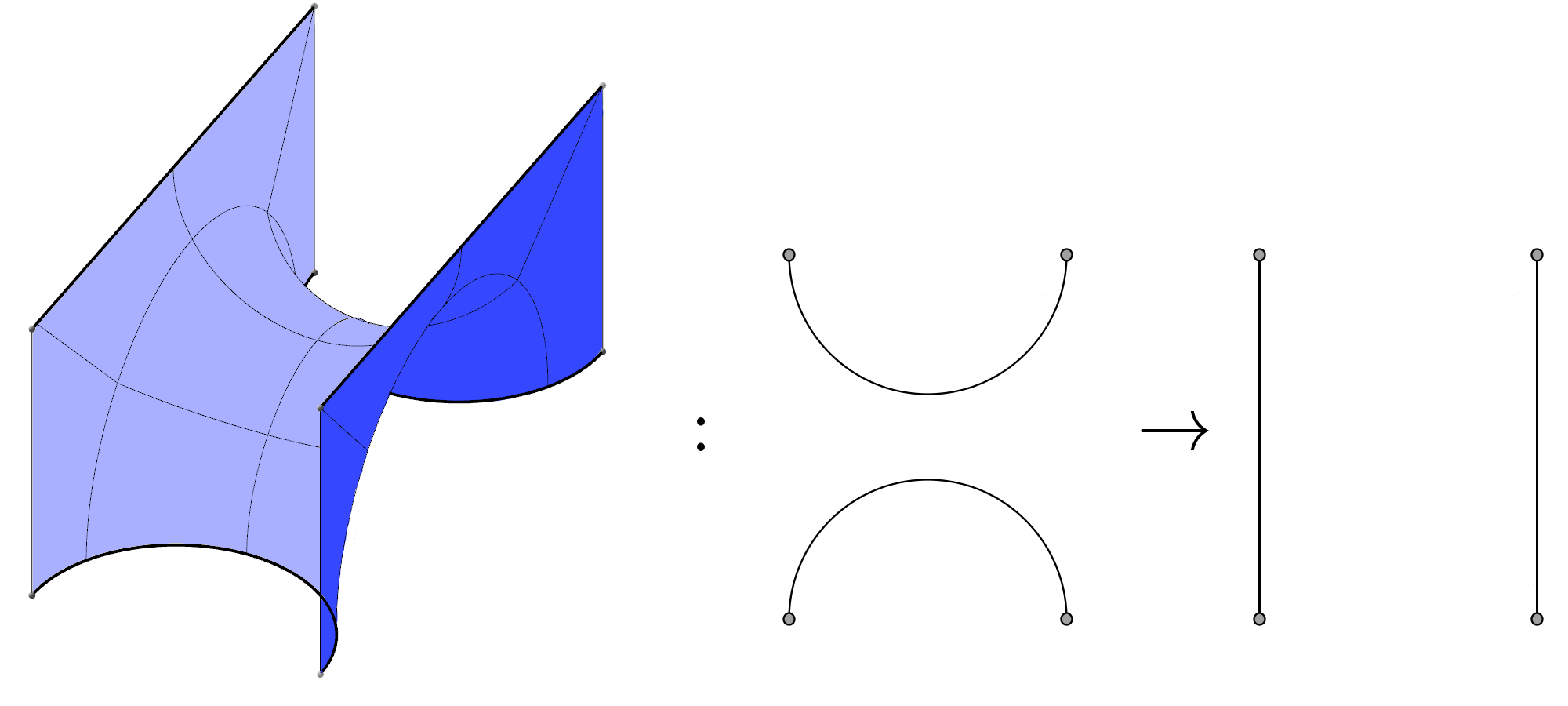
En composant ces ponts, on obtient un cobordisme de vers possédant points de selle (un pour chaque pont), qu’on nomme . On donne un exemple de film en Figure 5 où chaque vignette représente la coupe horizontale du corbordisme en différentes hauteurs.
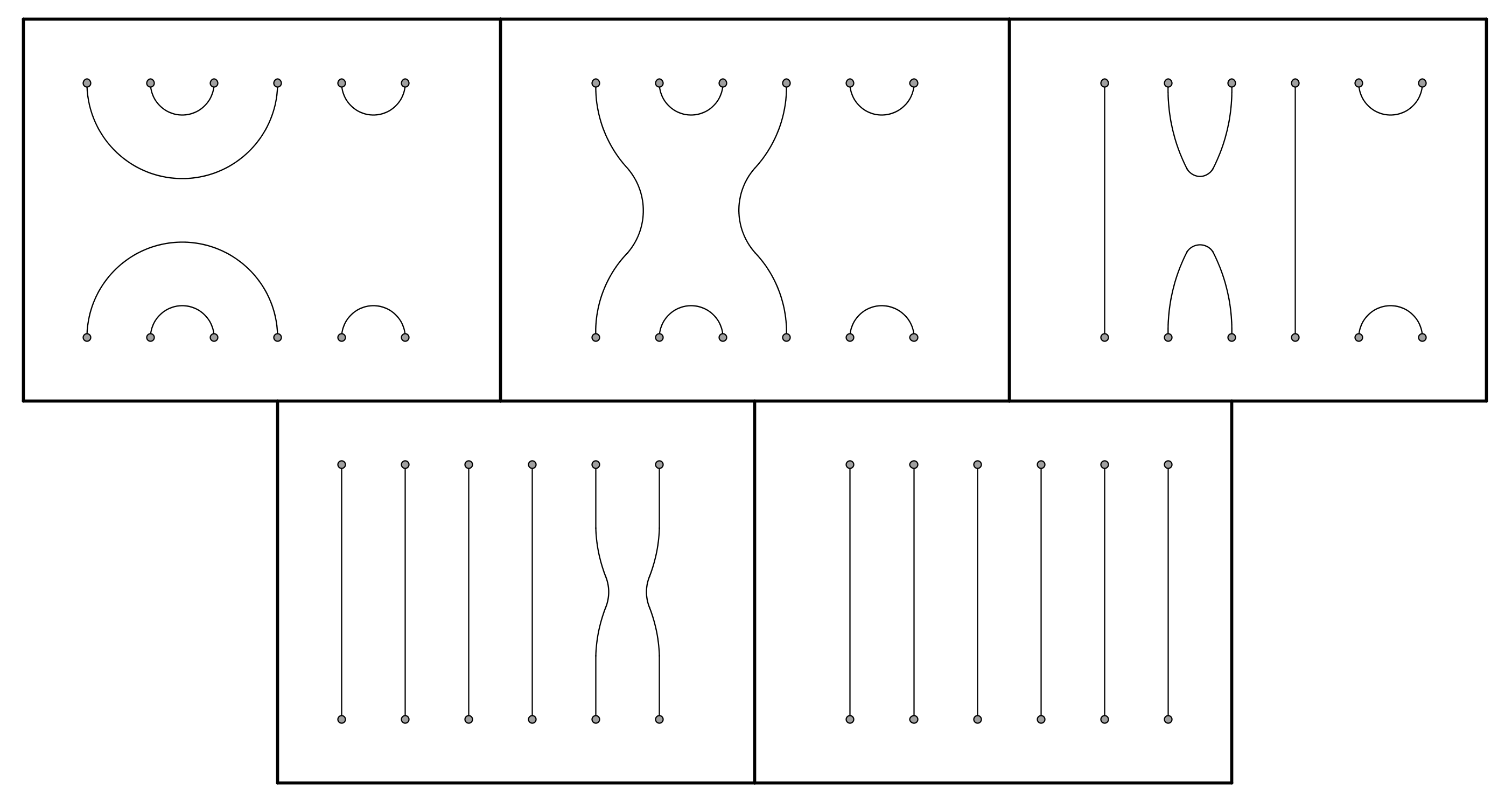
En prolongeant ce "cobordisme avec bord" avec l’identité sur et sur , on obtient un cobordisme de
qui donne un homomorphisme de modules en lui appliquant
| (1.2) |
Puisque et sont tous deux des unions disjointes de cercles, on a un isomorphisme canonique
On obtient en composant cet isomorphisme avec le morphisme (1.2) un homomorphisme
Puisque le cobordisme a points de selles, il a une caractéristique d’Euler valant et par la Proposition 1.13 le morphisme obtenu a un degré . On obtient alors un homomorphisme
| (1.3) |
qui préserve le degré. On définit la multiplication en utilisant le diagramme commutatif suivant où les isomorphismes viennent de (1.1) :
On définit pour ,
où est un abus de notation pour dire qu’on prend l’unité dans dont on a décalé le degré par . On vérifie que pour on a et si et pour , on a et . On définit alors l’unité comme la somme
On obtient l’associativité par fonctorialité de et associativité/co-associativité des cobordismes. Finalement, la distributivité est claire par définition.
On termine le chapitre par quelques exemples de calculs dans afin de familiariser le lecteur avec ces anneaux.
Exemple 1.17.
On peut montrer que puisque ne contient qu’un seul élément donné par un demi-cercle qui relie les deux points. On a alors un isomorphisme de groupes gradués et, n’étant composé que d’un seul cercle, on a . Par ailleurs, la multiplication
est composée uniquement d’une fusion et est donc équivalente à la multiplication polynomiale, montrant le résultat voulu.
Exemple 1.18.
On prend et on pose
On observe
où on note et les cercles de avec le cercle extérieur et le cercle intérieur. De même on note le cercle de et . Pour éviter toute confusion, on note la variable du associé par le foncteur à la composante de cercle d’étiquette et de même pour . On considère la multiplication
et on calcule
En effet, on a
puisqu’on a juste deux fusions.
Exemple 1.19.
En prenant les même notations que l’exemple précédent, on calcule maintenant
dans
En effet, on a
puisqu’on a une fusion suivie d’une scission.
Chapitre 2 Constructions impaires des anneaux des arcs de Khovanov
Dans [OddKhovanov], P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo construisent une version impaire de l’homologie de Khovanov. Pour ce faire, ils définissent un foncteur projectif de la catégorie des cobordismes vers la catégorie des modules sur . Ce foncteur est projectif dans le sens où deux cobordismes équivalents peuvent livrer des morphismes de signes différents et qu’il y a un choix d’orientations à faire pour les composantes de cercles des scissions. Ils montrent ensuite que ces signes n’influencent pas l’homologie qu’on obtient. On propose dans ce chapitre de construire des anneaux similaires à en utilisant le foncteur de [OddKhovanov] à la place de celui de M. Khovanov. Le choix de signes devenant important et pouvant potentiellement livrer des anneaux différents, on redéfinit ce foncteur sur une catégorie un peu plus structurée que celle des cobordismes : la catégorie des cobordismes avec chronologies, introduite par K. Putyra dans [Putyra].
5 Cobordismes avec chronologies
Les cobordismes avec chronologies (ou cobordismes chronologiques) sont des cobordismes où on donne un ordre sur les points critiques (donc un ordre sur une fonction de Morse possédant un seul point critique par niveau), ce qu’on appelle une chronologie, et un choix d’orientation pour ceux-ci (c’est-à-dire pour les fusions et les scissions, les naissances et morts de cercles ayant des orientations constantes). Plus précisément, l’orientation des points critiques d’indice 1 est donnée par le choix d’une base pour l’espace propre de la sous-matrice définie négative de la matrice hessienne de la chronologie et ceux d’indice 2 ont l’orientation induite par l’orientation du cobordisme. On donne un exemple de cobordisme avec chronologie en Figure 6. Deux cobordismes chronologiques sont dits équivalents s’il existe un difféomorphisme préservant les bords entre les deux et qui conserve l’ordre de la chronologie ainsi que l’orientation des points critiques. Tout cela se définit de façon formelle et on renvoie à [Putyra] pour plus de détails.

Il y a une autre différence par rapport aux cobordismes sans chronologie qui se situe dans la multiplication monoïdale. En effet, on ne peut pas simplement prendre l’union disjointe des deux cobordismes en les mettant "côte à côte" car on pourrait obtenir plusieurs points critiques au même niveau de leurs chronologies. On définit alors la multiplication à gauche de et comme union disjointe l’identité sur composé avec l’identité sur union disjointe , c’est à dire qu’on décale pour avoir tous ses points critiques après ceux de , comme représenté en Figure 7. De même on définit une multiplication à droite où on décale cette fois.

On note alors la catégorie dont les objets sont des collections de cercles et les flèches des classes d’équivalence de cobordismes avec chronologies. Il n’est pas nécessaire pour la discussion d’entrer plus dans les détails de la construction des cobordismes avec chronologies et donc on utilise seulement la présentation en générateurs et relations de ces objets, calculée aussi par K. Putyra.
Remarque 2.1.
La catégorie n’est pas monoïdale puisqu’on a pas de multiplication au sens usuel. Dans [Putyra], K. Putyra propose une définition de catégorie chronologiquement monoïdale où la multiplication chronologique est un demi-foncteur et qui correspond au comportement de pour la multiplication à gauche.
Théorème 2.2.
(K. Putyra, [Putyra, Théorème 4.1]) La catégorie des cobordismes avec chronologies est engendrée par les compositions et multiplications à gauche et à droite des huit générateurs suivants :
quotientés par les relations suivantes :
-
1.
Relations de permutations
, -
2.
Permutations de l’unité et de la counité
, -
3.
Permutations de la fusion et de la scission
, -
4.
Anti-commutativité et anti-co-commutativité
,
Les flèches sur les scissions et fusions représentent l’orientation des points critiques d’indice 1 (c’est-à-dire le "sens" de la base choisie pour la sous-matrice hessienne), les points d’indice 0 et 2 ayant une orientation induite par la surface.
Remarque 2.3.
Par l’anti-commutativité et l’anti-co-commutativité, on peut retirer deux générateurs puisque si on a une fusion avec une orientation on peut obtenir celle avec l’autre et pareillement pour la scission.
6 Le foncteur impair
Le but de cette section est d’expliquer la construction du foncteur impair défini par P. Ozsvath, J. Rasmussen et Z. Szabo dans [OddKhovanov], mais dans le cadre des cobordismes chronologiques. On souhaite donc définir un foncteur allant de la catégorie des cobordismes avec chronologies vers la catégorie des modules gradués sur .
Tout d’abord, à un objet de , c’est-à-dire une collection de cercles, on associe le groupe abélien libre gradué généré par les composantes de où on attribue à chaque générateur un degré . On définit ensuite l’image de par comme l’algèbre extérieure de modules (voir la Section A.4 des Annexes)
| (2.1) |
où est le nombre de composantes de cercles de . Par le Théorème 2.2 et la Remarque 2.3, il suffit de définir le foncteur sur les cobordismes d’identité, de permutation, de naissance et de mort de cercle, ainsi que de fusion et scission avec une orientation donnée. Attention que la catégorie n’est pas monoïdale au sens stricte du terme et donc non plus. Dès lors, on doit considérer ces cobordismes avec l’identité partout ailleurs sur les autres composantes de cercles.
Bien évidemment l’identité est donnée par l’homomorphisme d’identité. Pour une permutation qui permute les deux cercles et , on permute les deux éléments dans l’algèbre extérieure,
avec et des produits extérieurs sans facteur ni . On associe à la naissance de cercle l’application d’inclusion d’algèbres extérieures
induite par l’inclusion de groupes . La mort d’un cercle est donnée par la contraction avec le dual de (voir Définition A.4.2)
Pour une fusion qui joint les cercles , la flèche représentant l’orientation de la fusion, en un cercle , il y a une identification naturelle
et on définit
comme étant l’application induite par la projection
Remarque 2.4.
On voit aisément que l’image de la fusion ne dépend pas de l’orientation choisie, donnant
De même, on peut observer que les fusions donnent les relations d’associativité et d’unité du Théorème 1.12. À partir de maintenant, on ne note donc plus l’orientation des fusions dans ce travail.
Finalement, on considère une scission qui scinde un cercle en deux cercles et dans avec , la flèche indiquant l’orientation de la scission. On a alors une identification naturelle
qui induit un isomorphisme
puisqu’on a l’égalité des équations suivantes :
On définit alors
comme la composition
On remarque donc que est envoyé sur .
Remarque 2.5.
On note que c’est ici que le choix d’orientation a son importance puisque l’isomorphisme
est de signe opposé à celui où on choisit qui donne
Exemple 2.6.
On donne d’abord deux exemples du foncteur appliqué sur des objets de , c’est-à-dire sur deux collections de cercles :
avec et , ensuite
avec , et .
Exemple 2.7.
On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la naissance de et on calcule :
Exemple 2.8.
On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la mort de et on calcule :
Exemple 2.9.
On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la fusion de et en et on calcule :
Exemple 2.10.
On pose et ainsi que le cobordisme comme étant la scission de en et on calcule :
Puisque n’est pas bien définir sur , il n’est pas une TQFT au sens strict du terme et il nous faut vérifier qu’il est bien défini sur .
Proposition 2.11.
est un foncteur de vers la catégorie des modules sur .
Démonstration. Il suffit de vérifier que les morphismes de modules qu’on a défini respectent chacune des relations du Théorème 2.2 pour que le foncteur soit bien défini puisqu’il respecte déjà la composition par définition. On donne les détails de deux des relations, toutes les autres étant des calculs similaires.
-
1.
On considère la permutation de la counité
qui donne donc en termes de morphismes de modules
et qui sont donc égaux car on identifie et comme éléments de sortie.
-
2.
On considère l’anti-co-commutativité
qui donne les morphismes
qui sont bien égaux.
Tout comme pour le foncteur , on retrouve la propriété suivante.
Proposition 2.12.
Pour tout cobordisme chronologique , on a
Démonstration.
La naissance de cercle envoie un produit extérieur vers le même, l’espace d’arrivée ayant juste une composante en plus et donc un degré décalé par puisque dans (2.1) on définit l’image avec un degré décalé par le nombre de composantes. La fusion ne change pas la longueur du produit extérieur mais diminue le nombre de composantes de , donc on obtient un décalage de . La scission augmente la longueur du produit extérieur de , augmentant le degré de , et augmente le nombre de composantes de , donnant au final un décalage du degré par . Enfin, la mort de cercle diminue la longueur du produit extérieur de et le nombre de composantes de , donnant un décalage du degré par . Par ailleurs, on calcule aisément que
puisqu’on a des surfaces avec trous et ou bord(s). Pour terminer, le résultat est clair pour la permutation et l’identité.
Par ailleurs, on vérifie bien que si on regarde sur les cobordismes sans chronologie, il n’est bien défini qu’à signe près. De plus, soit les deux homomorphismes sont les mêmes, soit ils sont de signes opposés, c’est-à-dire que le signe ne dépend pas des éléments sur lesquels on applique les homomorphismes.
Proposition 2.13.
Pour toute paire de cobordismes (sans chronologie) équivalents on a
Démonstration.
Il suffit d’observer le comportement du foncteur sous les relations du Théorème 1.12 en ajoutant toutes les possibilités d’orientations. On donne comme exemple le cas de la co-commutativité, les autres étant similaires. Si on oublie l’orientation et la chronologie, par le Théorème 1.12, on a l’équivalence des cobordismes suivants :
On suppose qu’à gauche on scinde en et que à droite on scinde en puis qu’on les permute. On obtient alors respectivement pour le cobordisme de gauche puis celui de droite
avec qui est où on change tous les en et donc cela signifie que les morphismes sont de signes opposés.
Par contre, on remarque que seules les scissions et morts de cercles peuvent engendrer un changement de signe.
Proposition 2.14.
Pour toute paire de cobordismes chronologiques équivalents et se décomposant en seulement des fusions, permutations et identités on a
Démonstration.
On termine cette section par des exemples de calculs du foncteur appliqué à des cobordismes semblables à ceux des Exemples 1.14 et 1.15 ainsi qu’un autre qui montre la non-coassociativité venant d’un changement de chronologie, c’est-à-dire une équivalence de cobordismes qui change l’ordre des points critiques.
Exemple 2.15.
On calcule avec
qui est donc une naissance suivi d’une mort. On obtient alors
et donc .
Exemple 2.16.
On calcule avec
qui est donc une naissance suivi d’une scission avec orientation arbitraire, d’une fusion et enfin d’une mort. On obtient alors
et donc , ce qui est différent du cas paire puisqu’on avait une multiplication par . On obtient le même résultat si on choisit une autre orientation.
En utilisant la Proposition 2.13 et le théorème de classification des surfaces, on peut même montrer que tout cobordisme sans bord est envoyé par le foncteur sur l’application nulle.
L’exemple suivant montre la nécessité d’avoir une chronologie sur les points critiques puisque deux cobordismes équivalent dans peuvent donner deux morphismes différents par .
Exemple 2.17.
On considère 3 collections de cercles : et et deux compositions de scissions : qui scindent en puis en et qui scinde en et en , comme illustré en Figure 8. Il est clair que ces compositions sont équivalentes et on calcule leurs images par :

7 Construction impaire des anneaux des arcs
L’objectif de cette section est de définir une famille d’anneaux unitaires par une construction similaire à celle de l’anneau de Khovanov mais en utilisant le foncteur de la section précédente. Cela donne alors une construction impaire, ou "oddification" en anglais, de .
Pour , on définit le groupe impair des arcs de Khovanov d’indice comme le groupe abélien gradué donné par la somme directe
| où | (2.2) |
Remarque 2.18.
Comme dans , le fait de définir avec un décalage du degré par rend positivement gradué. En effet, le degré minimal d’un élément de est obtenu en regardant dedans qui a un degré de au minimum puisqu’on a un maximum de composantes.
Pour faire de un anneau, il faut définir une multiplication dessus. On veut la définir de façon similaire à celle de mais en utilisant des cobordismes avec chronologies. Comme pour , on observe que donne tous des demi cercles, chacun possédant sa symétrie horizontale en face. On peut donc à nouveau construire des ponts qui s’emboitent, donnant des cobordismes qui envoient à chaque fois une paire de demi cercle vers l’identité, mais cette fois on doit se fixer un ordre dans lequel on construit ces ponts pour avoir une chronologie et on doit orienter les scissions. Il n’y a a priori aucune raison de choisir un ordre plutôt qu’un autre ou une orientation particulière et donc on propose de tous les considérer.
Définition 2.19.
On définit une règle de multiplication pour comme les données de, pour chaque triplet :
-
—
un ordre sur les points de base , donc sur les extrémités des arcs de , tel que si est relié à dans et que pour l’ordre usuel alors ou dans l’ordre de la règle,
-
—
une orientation ou pour tout tels que est relié à par un arc de .
Autrement dit, on donne un ordre (qui dépend de et de ) sur les arcs de ainsi qu’une orientation pour chacun de ceux-ci et on ne permet pas qu’un arc arrive avant un autre dans l’ordre si est imbriqué dans , c’est-à-dire si les points d’extrémités de sont entre les points d’extrémités de . Cette condition est imposée afin qu’on ne construise pas un pont qui traverserait le restant de la surface si on la plongeait dans . On demande cela puisque M. Khovanov construit ses cobordismes comme des surfaces plongées dans l’espace pour définir , même si cela n’a pas d’influence dans le cas pair.
On construit alors une famille de cobordismes chronologiques pour une règle de multiplication
par la procédure suivante, illustrée en Figure 9, appliquée pour tout :
-
1.
On pose et . Quitte à redimensionner, on peut supposer que les points de base de sont alignés sur et ceux de sur . On considère l’ordre sur les points pour de la règle de multiplication .
-
2.
Si est relié par un segment de droite à dans , alors on ne fait rien et on pose . Sinon on considère l’autre extrémité de l’arc de passant par . On construit comme étant où on supprime l’arc de passant par et l’arc de passant par et on relie à et à par des segments de droites verticales et . On construit ensuite un cobordisme de à comme étant l’identité partout sauf pour un pont envoyant les arcs opposés de et passant par le -ème point vers deux segments de droites verticales et l’identité partout ailleurs sur . Si ce pont engendre une scission, en notant et les composantes de passant respectivement par et , on l’oriente si et sinon.
-
3.
On pose . Si , on passe à la prochaine étape, sinon on revient à l’étape 2.
-
4.
On a pose comme étant la composition des cobordismes et puisque cela construit un cobordisme avec chronologie .

En d’autres termes, on parcourt les arcs de dans l’ordre donné par la règle de multiplication en construisant le pont associé et s’il sépare un cercle en deux on lui donne l’orientation donnée par l’orientation de l’arc. De plus, on note que possède points de selles et on a donc
Remarque 2.20.
Puisque la fusion ne dépend pas de l’orientation dans le cadre de , on ne s’occupe pas de l’orienter. Cependant, on pourrait le faire de sorte à être totalement rigoureux en orientant la composante passant par vers celle passant par ou alors tout simplement en prenant un choix arbitraire d’orientations pour les fusions.
A partir de cette collection de cobordismes on définit une multiplication similaire à celle de et on note l’anneau obtenu en munissant de cette multiplication. Si , on pose , sinon on remarque que et sont tous deux des unions disjointes de cercles et donc on a un isomorphisme canonique
avec le groupe abélien libre engendré par les éléments de l’ensemble . Cela induit des inclusions
et donc en prenant le produit extérieur on obtient un homomorphisme
| (2.3) |
On obtient alors en composant (2.3) avec l’image du cobordisme par un homomorphisme
Puisque le cobordisme a une caractéristique d’Euler valant , le morphisme obtenu a un degré et donc on obtient un homomorphisme
| (2.4) |
qui préserve le degré. On définit alors la multiplication en utilisant le diagramme commutatif suivant, où les isomorphismes viennent de (2.2) :
On note pour ,
et on vérifie par la proposition suivante que pour on a et si et pour on a et . On définit alors l’unité de comme la somme
Proposition 2.21.
Les multiplications
sont calculées en utilisant uniquement des fusions de sorte que le produit est obtenu en prenant juste le produit extérieur après avoir renommé les éléments suivant les composantes de . Autrement dit et sont des cobordismes qui se décomposent en fusions.
Démonstration.
On sait que la multiplication
est obtenue en prenant un cobordisme de vers composé de ponts, donc fusions ou scissions. Par ailleurs, est constitué de composantes de cercle et en est constitué de , donc on doit fusionner au moins composantes. On en conclut qu’on a exactement fusions.
On propose une règle de multiplication parmi d’autres pour définir une collection de cobordismes qui nous sert à illustrer ce travail par des exemples. Pour tout , on ordonne selon l’ordre usuel des entiers naturels et on oriente si pour l’ordre usuel aussi. Un exemple de construction de cobordisme par cette règle de multiplication est illustré en Figure 10. Afin d’alléger la notation, on note .
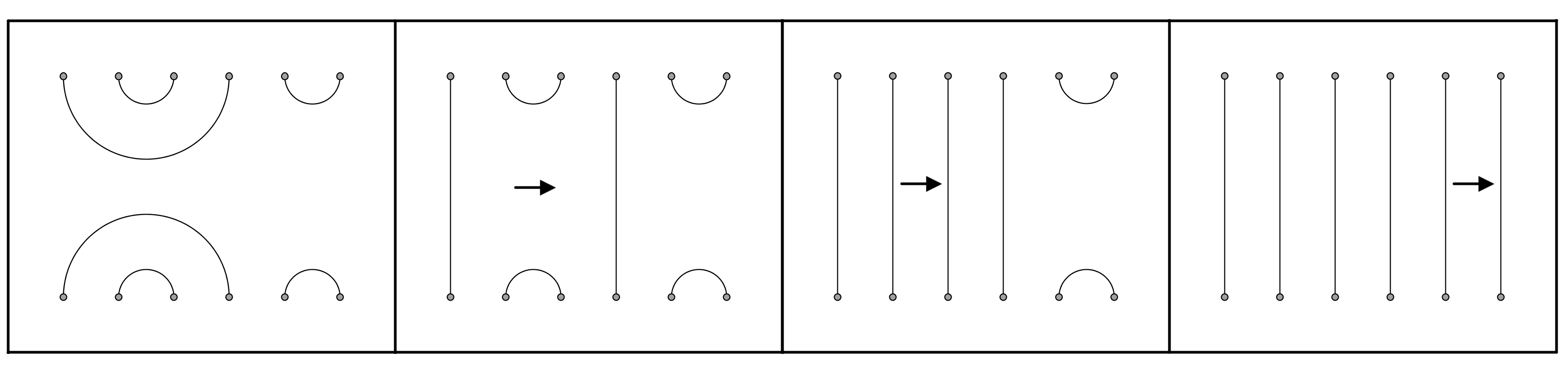
Exemple 2.22.
On peut montrer que puisque ne contient qu’un seul élément donné par un demi-cercle qui relie les deux points. On a alors un isomorphisme de groupes gradués et, n’étant composé que d’un seul cercle, on a . Par ailleurs, la multiplication
est composée uniquement d’une fusion et est donc équivalente au produit extérieur, montrant le résultat voulu.
Exemple 2.23.
On considère et on pose
donnant donc
On note et les cercles de avec le cercle extérieur et le cercle intérieur. De même on note le cercle de et .
On considère la multiplication dans
et on calcule par exemple
où est l’unité pour le produit extérieur.
En effet, on a une fusion
suivie d’une scission
la flèche sur le diagramme représentant l’orientation de cette scission.
Exemple 2.24.
On considère et on pose
avec
On calcule par exemple
dans
En effet, on a une fusion
ensuite une scission
et enfin une dernière fusion
On obtient le résultat puisque correspond avec dans .
8 Calcul diagrammatique dans
Afin de faciliter le calcul de produits d’éléments dans , on propose une technique de calcul diagrammatique utilisant des couleurs.
Définition 2.25.
On définit un -diagramme colorié comme le plongement dans le plan d’une union disjointe de cercles pouvant être coloriés ou non (avec une seule couleur disponible, on dessine en rouge gras les cercles coloriés et en noir pointillés les autres) tel qu’ils recouvrent les points de base et qui se restreint à des segments de droite verticales autour de chacun de ceux-ci.
On munit les points de base d’un ordre induit par l’ordre sur les abscisses (de gauche à droite). Cet ordre induit un ordre sur les composantes du diagramme passant par les points de base en attribuant à chaque composante l’ordre de son point de base minimal. On étend cet ordre à un ordre partiel en disant que toutes les autres composantes, qu’on appelle libres, sont plus grandes, comme illustré en Figure 11. On dit que deux -diagrammes sont équivalents s’il existe une isotopie ambiante préservant les points et qui transforme l’un en l’autre en conservant les couleurs. On note l’ensemble des diagrammes à équivalence près et les classes d’équivalences sans composante libre.
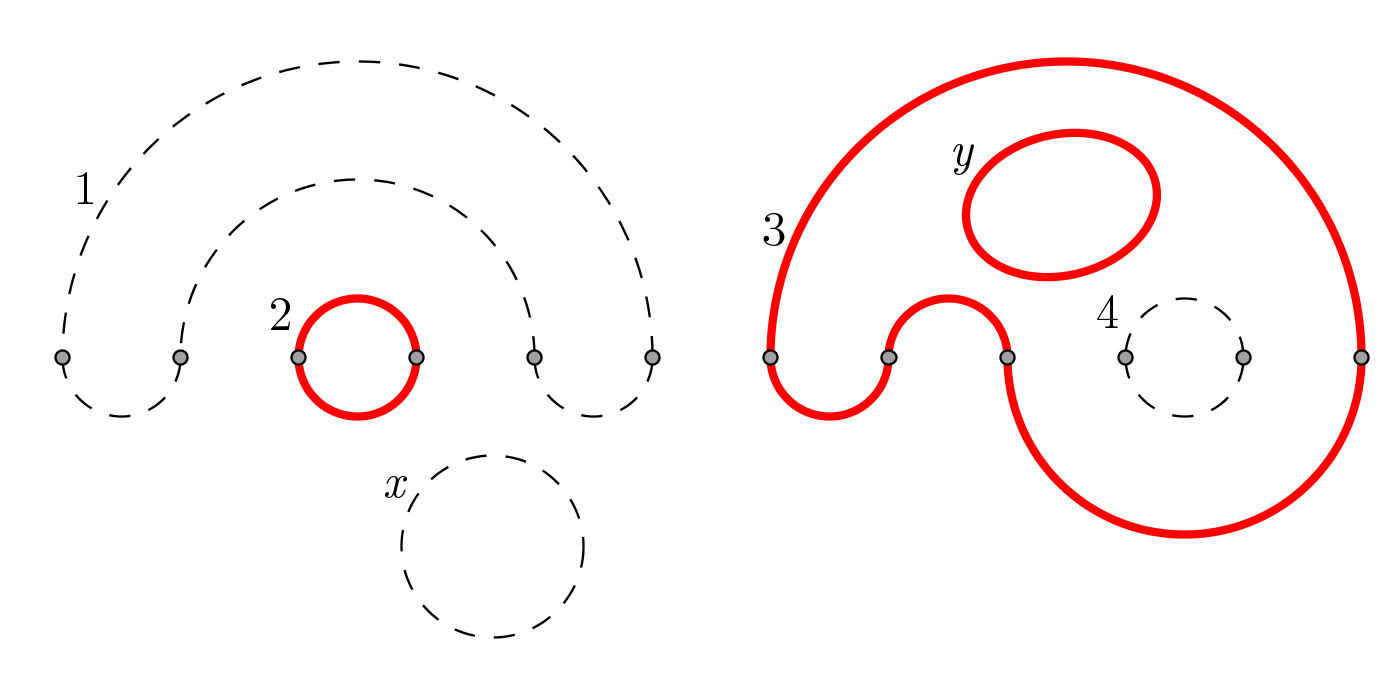
De plus, on dit que deux points sont reliés par un demi-cercle supérieur (resp. inférieur) d’un -diagramme s’il existe une composante de cercle qui passe par ces deux points telle qu’elle se restreint à un arc ne passant par aucun autre des points de base et que pour un voisinage suffisamment proche de et tous les points de cette restriction ont une ordonnée positive (resp. négative). On dit alors qu’un -diagramme est compatible au dessus d’un autre -diagramme si toute paire de points reliés par un demi-cercle supérieur de est reliée par un demi-cercle inférieur de (et vice-versa) et on demande en plus qu’il n’y ait pas de composante libre entourant des points de base ni dans ni dans .
Remarque 2.26.
On remarque que, par l’hypothèse de verticalité du diagramme autour des points de base, chacun de ceux-ci a un seul demi-cercle supérieur et un seul inférieur.
Proposition 2.27.
Il y a une isomorphisme de groupes abéliens entre le groupe impair et les combinaisons linéaires sur de classes d’équivalences de -diagrammes coloriés ne possédant pas de composante libre
Démonstration.
Soient avec ayant composantes , l’ordre étant induit par les points de base. On construit une fonction
Pour tout , associe à le -diagramme (il est évident par définition d’enchevêtrement que cela donne un -diagramme en translatant par ) avec les composantes associées à qui sont coloriées. On étend ensuite par linéarité pour en faire un morphisme injectif de vers . Ce morphisme est bien défini car on demande que les composantes du produit extérieur soient mis dans un certain ordre, fixant un signe. L’injectivité est obtenue par le fait que les -diagrammes sont pris à isotopie ambiante fixant les points de base près. On obtient la surjectivité en observant que
puisque par la remarque faite au dessus, chaque demi-cercle supérieur (resp. inférieur) relie points et puisque les demi-cercles ne peuvent pas se croiser et donc les demi-cercles supérieurs (resp. inférieurs) donnent une façon de relier points par demi-cercles vers le haut (ou bas), c’est-à-dire un élément de .
Exemple 2.28.
On sait que est composé des éléments
donnant les diagrammes
Dès lors, cela signifie que est engendré par
avec l’isomorphisme de la proposition donnant par exemple
Afin d’obtenir un anneau isomorphe à , on définit la résolution de ponts pour une règle de multiplication d’un -diagramme compatible au dessus d’un autre -diagramme comme la procédure suivante :
-
1.
On considère tels que et par la Proposition 2.27 et on prend l’ordre des points donné par pour le triplet .
-
2.
On place au dessous de à une certaine distance de sorte que le résultat soit une union disjointe de cercles dans le plan qu’on note et on pose .
-
3.
Si appartient à la même composante de cercle que dans , alors on ne fait rien. Sinon, on a un unique demi-cercle supérieur de , noté , qui relie à un certain et un unique demi-cercle inférieur de , noté , qui relie à . On définit comme où on relie à et à puis on supprime et . On obtient alors une union disjointe de cercles avec une ou deux composante(s) partiellement colorée(s) passant par et qu’on recolorie selon la règle suivante :
-
—
Si appartient à une composante différente de celle de dans le diagramme :
avec (resp. ) pour le nombre de composantes de cercles coloriées de supérieures à celle contenant (resp. ) et inférieures à celle contenant (resp. y).
-
—
S’ils appartiennent à la même composante de cercle dans :
avec si dans et sinon. On pose pour le nombre de composantes coloriées dans strictement inférieures à celle passant par et idem pour et . On prend pour le nombre de composante coloriées de inférieures ou égales à celle passant par ou strictement inférieures à celle passant par .
-
—
-
4.
On pose , si on arrête, sinon on revient à l’étape 3 pour chacun des éléments de la combinaison linéaire obtenue à l’étape 3.
On obtient au final une combinaison linéaire de -diagrammes coloriés et on note la résolution de ponts pour de au dessus de . On pose aussi que si n’est pas compatible au dessus de . On remarque que, dans le cas de , cela revient à spécifier et poser et on note la résolution de ponts pour .
Proposition 2.29.
L’isomorphisme de groupes de la Proposition 2.27 respecte la structure multiplicative de en prenant la résolution de ponts pour qu’on étend par linéarité comme multiplication pour les -diagrammes.
Démonstration.
L’idée de la preuve est de mettre un ordre sur les composantes de à chaque étape de la résolution et de montrer que les signes choisis correspondent aux produits extérieurs de la multiplication dans en associant les composantes coloriées aux produits extérieurs donné par l’ordre (comme dans la preuve de la Proposition 2.27). On définit cet ordre en parcourant les points à puis à de sorte qu’au diagramme soit associé le produit extérieur de celui de . On vérifie ensuite qu’à chaque étape de la résolution de ponts soit associé le produit extérieur de la fusion/scission correspondante :
-
—
Si les deux demi-cercles appartiennent à des composantes différentes, alors les résoudre revient à fusionner ces composantes, expliquant la couleur des diagrammes. Pour le signe ou , il vient du fait qu’en fusionnant la composante coloriée avec l’autre, l’ordre de cet élément dans le produit extérieur associé peut changer puisqu’il prend potentiellement la place de la composante non-coloriée. et calculent ces décalages.
-
—
S’ils appartiennent à la même composante, alors la résolution revient à séparer cette composante en deux et donc on a une scission, expliquant les couleurs. Le signe calcule l’orientation de la scission pour la règle de multiplications et les signes et calculent le décalage des éléments et du facteur qu’on positionne à la bonne place dans le produit extérieur selon l’ordre défini en début de preuve. Enfin, pour on a deux cas à regarder. Si , alors on a
et donc pour qui calcule le nombre de composantes inférieures ou égales à , contenant alors et . Par ailleurs on doit décaler pour le mettre à la place de , donc un décalage de , et on doit décaler pour le mettre à la bonne position dans (puisque est séparé de qui hérite du point de base minimal, on doit calculer le nouveau point de base de ). Au final, on a un décalage de autant de composantes que celles strictement inférieures à moins celle de , mais est calculé en prenant aussi ce qui annule la contribution de . Si par contre alors on a
et le calcul du décalage se fait de la même façon en inversant les rôles de et si ce n’est qu’on a pas le pour annuler la contribution de , d’où le signe devant l’expression.
Corollaire 2.30.
Les combinaisons linéaires de -diagrammes coloriés munies de la résolution de ponts sur comme multiplication forment un anneau gradué et cet anneau est isomorphe à .
De par ce corollaire, on confond dans la suite de ce travail les éléments de avec des diagrammes colorés.
Remarque 2.31.
Le calcul diagrammatique peut être aisément adapté pour , où on associe simplement les composantes colorées et les produits tensoriel sans se soucier de l’ordre ainsi qu’en oubliant les signes dans les résolutions de ponts et en prenant un plus dans la scission.
Exemple 2.32.
Exemple 2.33.
Exemple 2.34.
On calcule dans
9 Propriétés générales de
Dans cette section, on étudie quelques propriétés de . On observe notamment que est non-associatif pour tout et on montre que correspond avec quand on les considère modulo .
Proposition 2.35.
Pour tout , est un sous-anneau de .
Démonstration.
Tout élément de peut être étendu à un élément de en le décalant vers la droite de et en ajoutant des paires , comme illustré en Figure 12. Dès lors, pour , on retrouve toutes les composantes de dans et donc on obtient une inclusion canonique de groupes
Cela induit une injection de groupes gradués par
puisque . De plus cette injection respecte la structure de multiplication puisque le arcs qu’on ajoute pour former n’engendrent que des fusions de composantes non coloriées (les signes des résolutions de ponts ne sont calculées qu’à partir des composantes coloriées).
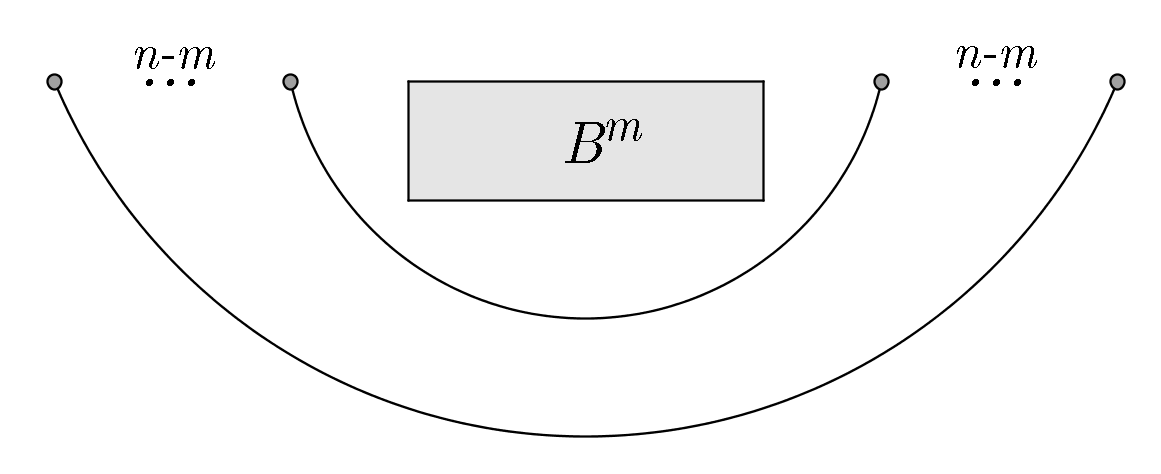
Remarque 2.36.
On choisit cette injection de dans car elle vient de l’injection canonique de l’algèbre de Temperley-Lieb (voir Définition 4.3) dans qui consiste à ajouter des brins verticaux à droite. En effet on peut voir les éléments de comme des combinaisons de qu’on courbe, déplaçant les point en bas pour les mettre à gauche. Pour la preuve de la proposition, on aurait aussi bien pu compléter un élément en ajoutant des paires de points mais cela donne une inclusion de dans qui n’est pas usuelle.
Proposition 2.37.
Soient et deux règles de multiplications ainsi que , alors et sont équivalents vu en tant que cobordismes sans chronologie.
Démonstration.
Si on oublie l’orientation et qu’on accepte l’associativité, la coassociativité et les relations de Frobenius, les deux cobordismes deviennent équivalents puisqu’ils contiennent tous deux le même nombre de scissions et fusions pour les même composantes.
Corollaire 2.38.
Soient et deux règles de multiplication, alors les multiplications
sont identiques à signe près, signe dépendant uniquement de et .
Démonstration.
On sait que et sont équivalents par la proposition précédente et donc par la Proposition 2.13 on obtient la propriété voulue.
9.1 Non-associativité de
On voit facilement que est associatif par l’Exemple 2.22. Par contre pour on perd l’associativité si on utilise la règle de multiplication comme le montre l’exemple suivant.
Exemple 2.39.
On considère les calculs diagrammatiques suivant dans :
et en réarrangeant les parenthèses on obtient
Cet exemple mène à un autre exemple qui montre que le produit de trois éléments peut parfois être nul et parfois non suivant l’ordre dans lequel on multiplie.
Exemple 2.40.
On considère les multiplications suivantes dans :
On commence par rassembler les termes à gauche pour avoir puis on multiplie par le terme de droite pour obtenir
Ensuite on rassemble les termes de droite pour avoir puis on multiplie par l’élément de gauche pour obtenir
On a donc trouvé un exemple de tel que et pour un certain non-nul.
Proposition 2.41.
Pour et quelconque, la multiplication dans n’est pas associative.
Démonstration.
On généralise l’Exemple 2.39 sur tout en remarquant que si
alors par le Corollaire 2.38 le signe de l’homomorphisme obtenu pour un est fixé et donc
et idem pour les signes opposés, en remarquant que les autres multiplications n’impliquent que des fusions et ne sont donc pas influencées par le choix de . On généralise ensuite pour tout par la Proposition 2.35.
Cela ne constitue qu’une des deux sources de non-associativité d’un produit de , et dans venant de la permutation du facteur avec les facteurs qui apparaissent par les scissions de la multiplication , comme illustré en Figure 13. Un second changement de signes peut être du au changement de chronologies dans le cobordisme . Pour , et on a
où est le produit de ajouté par les scissions de l’image par du cobordisme et est l’image de par ce cobordisme et de même pour les autres éléments. On a donc un premier changement de signes pour faire permuter avec et un second donné par le changement de chronologies
Ce second phénomène est illustré dans le prochain exemple.
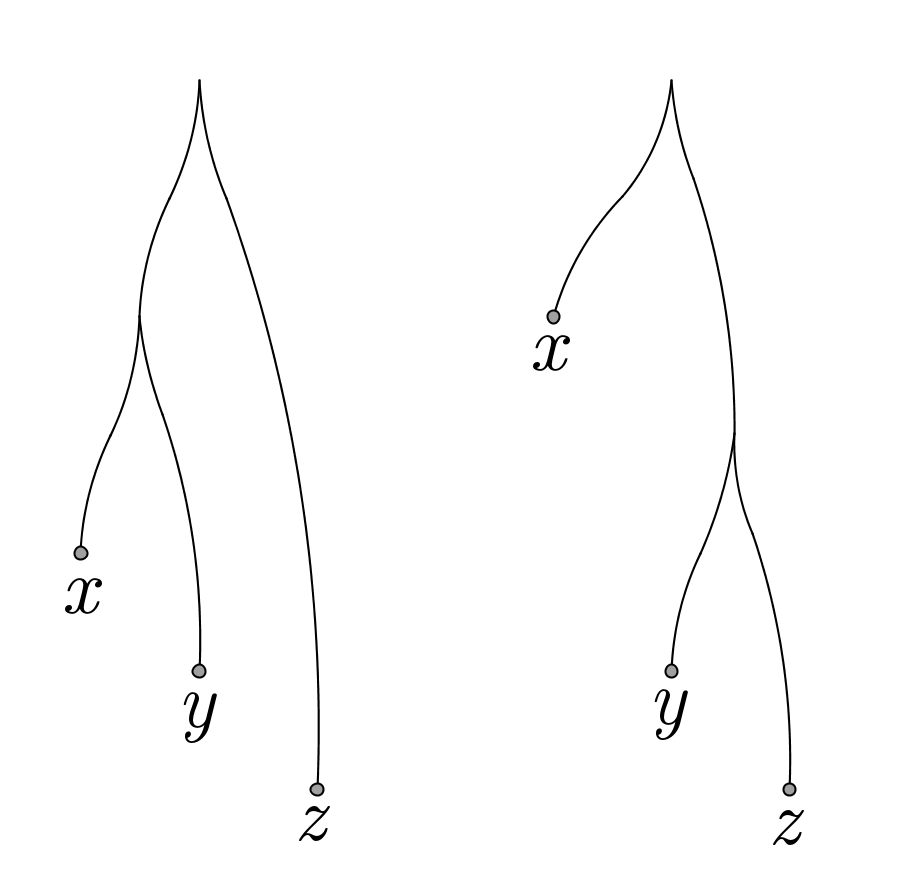
Exemple 2.42.
On considère les multiplications dans
et en réarrangeant les parenthèses
On a donc un autre exemple de non-associativité mais qui est du à l’ordre dans lequel on fait les scissions et fusions cette fois. Il est intéressant de noter que, comme le montre l’exemple suivant, en utilisant une autre règle de multiplication on peut ne pas retrouver la non-associativité de ces éléments. En fait, on retrouve le signe du à la permutation du facteur de gauche dans toutes les règles mais le signe du au changement de chronologie dépend du choix d’orientation des cobordismes et de leurs chronologies.
Exemple 2.43.
On définit la règle de multiplication comme celle où on donne l’ordre usuel de gauche à droite pour les points de base et on oriente les scissions si dans le diagramme de la procédure de construction de la composante passant par est plus petite dans l’ordre induit par les points de base que la composante passant par et inversement pour . Autrement dit si passe par un point de base plus petit que tous les points de base de alors on prend l’orientation .
On considère les multiplications suivante dans :
et en réarrangeant les parenthèses
9.2 Comparaison de avec
Les Exemples 1.17 et 2.22 montrent que puisque . Par contre, la non-associativité montre que pour , étant donné que est associatif. Par ailleurs, il est intéressant de noter que et sont équivalents en modulo , montrant que est associatif modulo .
Proposition 2.44.
Pour tout , on a l’équivalence modulo entre et
Démonstration.
L’idée de la preuve est très simple : le produit extérieur modulo correspond avec le produit tensoriels des modulo et le foncteur est équivalent à en modulo , donnant directement l’isomorphisme. Plus formellement pour une collection de cercles dans un certain on considère l’application
qu’on étend linéairement et en envoyant le produit extérieur vers le produit tensoriel. Cela est bien défini puisque
C’est clairement bijectif (on a même un inverse explicite qui consiste à envoyer le produit tensoriel vers le produit extérieur) et donc cela forme un isomorphisme de groupes gradués. Il reste à montrer qu’on respecte la multiplication pour avoir un isomorphisme d’anneaux gradués. Pour cela, il suffit de montrer que les fusions et scissions (orientées ou non) sont équivalentes modulo puisque l’ordre dans le produit extérieur n’a plus d’importance. C’est clair pour les fusions et pour les scissions on observe d’abord que l’orientation n’a plus d’importance en modulo 2 et ensuite que
ce qui est équivalent à la scission dans .
Chapitre 3 Centre impair de et cohomologie de la variété de Springer
Dans [HnCenter], M. Khovanov montre que le centre de l’anneau est isomorphe à l’anneau de cohomologie de la variété de Springer pour une partition (voir Annexes, Section A.5 pour une définition générale d’anneau de cohomologie). Dans ce chapitre, on montre que de façon équivalente le centre impair de , qui est le centre généralisé pour des éléments anticommutatifs, est isomorphe à la construction impaire, "odd" en anglais, de la cohomologie de la variété de Springer introduite par A. Lauda et H. Russell dans [OddSpringer]. Ce chapitre ayant pour objectif de montrer un résultat assez complexe, il est plus technique que les précédents.
10 Centre de et variété de Springer
Définition 3.1.
Soit un espace vectoriel complexe de dimension finie. Un drapeau est une suite strictement croissante de sous-espaces de :
Un drapeau est dit complet si pour tout on a
Définition 3.2.
Soient un espace vectoriel complexe de dimension et un endomorphisme linéaire nilpotent composé de deux bloques de Jordan nilpotents de taille . La variété de Springer est l’ensemble
un drapeau étant stabilisé si pour tout .
De façon générale, on peut définir une variété de Springer pour toute partition de en prenant des bloques de taille , mais dans ce travail on ne considère que le cas d’une partition de en qui est le cas relié à . Dans [HnCenter], M. Khovanov calcule une présentation de l’anneau de cohomologie de cette variété et montre ensuite qu’il est isomorphe au centre de . Il donne en plus une construction explicite pour cet isomorphisme.
Théorème 3.3.
(M. Khovanov [HnCenter, Théorème 1.1 et 1.2]) Le centre de , , est isomorphe en tant qu’anneau gradué à l’anneau de cohomologie de la variété de Springer . De plus, ils sont tous deux isomorphes au quotient de l’anneau polynomial , , par l’idéal engendré par
où pour et où la somme est prise sur tous les sous-ensembles de cardinalité de .
Explicitement, cet isomorphisme est donné par
où avec le séparé étant celui associé à la composante de cercle dans qui contient le ème point de base en partant de la gauche. Il montre de plus la propriété suivante qui sera utile par la suite.
Proposition 3.4.
(M. Khovanov [HnCenter, preuve du Théorème 3]) Un élément est dans le centre si et seulement si
avec et pour tout
Par ailleurs, on peut montrer que le rang de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer, vue comme un groupe abélien, est le même que la dimension de l’espace vectoriel obtenu en prenant le produit tensoriel par , ce qui revient à regarder les polynômes avec des coefficients modulo 2 dans la présentation.
Proposition 3.5.
On a l’égalité
En particulier, une base modulo 2 de est une base de .
Démonstration.
est un groupe abélien libre (de Concini et Procesi en construisent une base dans [ConciniProcesi]), donc on a une base et donc elle donne une base pour l’espace tensorisé. En effet toute relation dans l’espace tensorisé devient une relation dans le groupe quitte à multiplier par des coefficients .
11 Centre et centre impair de
On s’intéresse maintenant à étudier le centre de pour le comparer à celui de . On remarque que le centre n’a pas les propriétés voulues pour continuer l’analogie avec le cas de et on introduit une notion de centre impair qui correspond au centre étendu aux éléments anticommutatifs.
11.1 Centre de
Proposition 3.6.
Pour tout on a
avec , c’est-à-dire .
Démonstration.
On considère un élément central. On peut décomposer cet élément avec . Mais alors on a si , ce qui signifie que et on note .
Proposition 3.7.
Un élément est dans si et seulement si
avec et pour tout et on a
Démonstration.
Soit , on a
| et |
Puisque les morphismes de modules obtenus par pour ces deux multiplications sont respectivement les mêmes que ceux pour et et qu’ils ne sont composés que de fusions par la Proposition 2.21, on obtient
On en conclut que
quand on a les hypothèses de la suffisance en prenant .
Si commute avec tout élément, en particulier on doit avoir
Par ailleurs pour tout , on peut trouver des tels que et l’hypothèse donne la condition voulue.
Corollaire 3.8.
Un élément est dans le centre de si et seulement si pour tout
et pour tout et
Démonstration.
Puisque n’est composé que de fusions par la Proposition 2.21, un élément homogène est soit envoyé soit sur soit sur un élément homogène de la même longueur vu en tant que produit extérieur, c’est-à-dire que s’il commute dans alors il commute dans , ce qui permet de restreindre la seconde condition de la proposition précédente.
Remarque 3.9.
On peut décomposer en une somme d’éléments homogènes de degré . Si avec alors la seconde condition de la proposition est équivalente à puisque cela signifie que est pair. Dans le cas où alors la condition est toujours trivialement obtenue. En particulier on sait que et donc un élément du centre est une combinaison linéaire d’éléments de degrés égaux à 0 modulo 4 et de degrés .
Lemme 3.10.
Pour tout , et on a
Démonstration.
La preuve est directe une fois qu’on a remarqué que toutes les multiplications n’utilisent que des fusions par la Proposition 2.21 et que le produit extérieur est associatif.
Proposition 3.11.
La sous-anneau du centre de est associatif.
Quelle que soit la règle de multiplication qu’on choisit, le centre de est le même.
Proposition 3.12.
Pour et des règles de multiplications quelconques, on a l’isomorphisme d’anneaux gradués
Démonstration.
Exemple 3.13.
On calcule . est composé des éléments
qui donnent les collections de cercles
et on note le cercle extérieur de et l’intérieur. De même, on note le cercle de gauche de et le droit, ainsi que et les cercles de et .
On considère un élément central qui se décompose en avec
Cela se réécrit en calcul diagrammatique comme
On applique la Proposition 3.8 afin d’obtenir des conditions sur les et . Puisque l’anneau est gradué, on peut regarder les conditions de la proposition degré par degré.
-
1.
Pour : et , on a
et donc .
-
2.
Pour : et , on a
et donc . Par des calculs similaires, on obtient .
-
3.
Pour : et et la proposition ne livre aucune contrainte puisque
et de même pour les autres équations.
Dès lors on obtient que
Le centre de ne remplit pas les critères souhaités pour continuer la discussion en analogie avec le cas de . En effet, on remarque que sa dimension graduée est différente de celle du centre de (et de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer) :
On introduit alors dans la prochaine section le centre impair qui possède des propriétés plus intéressantes et comparables à celles du centre de .
11.2 Centre impair de
Dans le cadre des superalgèbres, c’est-à-dire des algèbres graduées sur (voir[superalgebra, Chapitre 3] pour plus de détails) on peut définir la notion de supercentre en fonction du supercommutateur
pour dans une superalgèbre donnant donc le supercentre
Cette définition est aussi parfois utilisée en topologie algébrique, notamment dans [Hatcher, Section 3.2], de sorte que l’anneau de cohomologie soit "supercommutatif", dans ce cas on l’appelle parfois tout simplement "commutatif", "skew-commutative", "anticommutative" ou encore "graded commutative".
On propose d’étendre cette définition à et de calculer son "supercentre", qu’on appelle centre impair, cela dans le but d’obtenir les éléments qui commutent "à antisymétrie" près. Pour ce faire, on définit le degré extérieur d’un élément homogène de comme étant
et on remarque aisément que est le nombre de facteurs du produit extérieur qui constitue , c’est-à-dire que
Définition 3.14.
On définit le centre impair de comme
Remarque 3.15.
Il faut faire attention que n’est pas une superalgèbre pour le degré extérieur. En effet, on peut avoir
Par exemple, on prend le produit suivant dans avec à gauche des degrés extérieurs valant et et valant à droite :
On ne peut pas non plus prendre simplement le degré divisé par pour obtenir le "degré impair" puisqu’on obtiendrait des degrés non-entiers pour des éléments dans possédant un nombre de composantes de parité différente de . Par contre, on peut montrer que est une superalgèbre pour le degré extérieur modulo 2 car alors on a la relation
Proposition 3.16.
Pour tout on a
avec c’est-à-dire .
Démonstration.
La preuve est similaire à celle de la Proposition 3.6 pour le centre.
Proposition 3.17.
Le centre impair est un sous-anneau associatif.
Démonstration.
L’associativité est directe par le Lemme 3.10 et la Proposition 3.16. Par ailleurs, il est clair que le centre impair est stable pour l’addition et donc on ne considère que la multiplication. Pour cela, on remarque d’abord que si alors
puisque la multiplication est juste donnée par le produit extérieur. De là on généralise facilement par la Proposition 3.16 que pour tout on a de même
Soient , on obtient pour tout
et par ce qu’on a montré juste au dessus , donc
ce qui livre la supercommutativité de .
Proposition 3.18.
Un élément est dans si et seulement si
| (3.1) |
pour tout .
Démonstration.
La preuve est similaire à celle de la Proposition 3.7, si ce n’est qu’on obtient l’anticommutativité par antisymétrie du produit extérieur. Il faut aussi remarquer que
pour les mêmes raisons que dans la preuve de la Proposition 3.8, c’est-à-dire puisque toutes les multiplications sont définies par des fusions qui ne changent pas la longueur d’un élément du produit extérieur.
Remarque 3.19.
En particulier, on a et, par la Remarque 3.9, les éléments de degré extérieur pair ou maximal du centre impair constituent le centre.
Par analogie avec la Proposition 3.12, on obtient la proposition suivante :
Proposition 3.20.
Soit et des règles de multiplication. Il y a un isomorphisme d’anneaux gradués
Démonstration.
Les cobordismes pour définir les multiplications de la Proposition 3.18 ne sont composés que de fusions et donc ont la même image par le foncteur .
Exemple 3.21.
On calcule le centre impair de . On rappelle que est donné par
qui livrent les diagrammes
On prend un élément avec
On applique la Proposition 3.18 pour trouver des contraintes sur les et et, puisque l’anneau est gradué, on peut regarder la supercommutativité degré par degré.
-
1.
Pour : et , on a
donc .
-
2.
Pour : on a
et
donc qui se réécrit comme
-
3.
Pour : la proposition ne livre aucune contrainte puisque
Dès lors on obtient que
avec comme prévu ainsi que
12 Construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer
Dans [OddSpringer], A. Lauda et H. Russell proposent une construction impaire de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer (et même pour toute partition) basée sur les polynômes impairs
où sont les polynômes ordonnés avec degré , formant donc un module gradué sur .
L’objectif de cette section est de définir et étudier quelques propriétés de cette construction qu’on note simplement "cohomologie impaire de " pour être concis.
Définition 3.22.
On définit la cohomologie impaire de la variété de Springer comme étant le module gradué sur
où est l’idéal à gauche engendré par l’ensemble
| (3.2) |
pour tout sous-ensemble ordonné de de cardinalité et
avec la position de dans .
Exemple 3.23.
est donné par les polynômes impairs à deux variables et quotientés par les relations
c’est-à-dire les polynômes avec une seule variable et donnant donc
Exemple 3.24.
est donné par les polynômes impairs à quatre variables et quotientés par les relations
qui peuvent se simplifier un peu en
On peut donc engendrer avec et car
et tous les polynômes de degrés supérieurs sont nuls. De plus ces éléments sont linéairement indépendants, ce qui est clair pour mais peut-être moins pour et . Néanmoins, la Proposition 3.28 permet de le justifier. On observe alors qu’en envoyant
on obtient un isomorphisme de groupes car en utilisant les notations de l’Exemple 3.21 on a
On montre ensuite par de simples calculs dans que les relations de sont dans le noyau de l’application, de sorte que l’isomorphisme de groupe soit un isomorphisme d’anneaux gradués bien défini par l’anticommutativité du produit extérieur et des polynômes impairs.
Remarque 3.25.
On note que tout polynôme de degré strictement plus grand que dans est nul puisqu’en prenant qui contient exactement les variables du polynôme et on obtient n’importe quel polynôme de tel degré.
En général, la cohomologie impaire de la variété de Springer pour une partition quelconque n’est pas un anneau et est donc juste un module sur . Mais puisque la hauteur de la partition est de deux, on a le lemme suivant qui permet de montrer que pour cette partition particulière la cohomologie impaire donne un anneau.
Lemme 3.26.
([OddSpringer, Lemme 3.6]) Pour tout , on a
Proposition 3.27.
possède une structure d’anneau induite par la structure d’anneau des polynômes impairs.
Démonstration.
Il suffit de calculer que l’idéal à droite engendré par est égal à l’idéal à gauche , c’est-à-dire que
Soient et . On considère
Si , alors commute avec tous les éléments de qui ne contiennent pas de , mais on peut obtenir un signe pour les autres. On élimine ces termes par le Lemme 3.26. Dans le cas impair, on a envie de prendre , mais cela ne marche pas en général puisque, à nouveau, les termes de contenant un posent problème car commutent sans changer de signe. Par le même raisonnement, on corrige cela en utilisant le lemme.
L’anneau de cohomologie et la cohomologie impaire de la variété de Springer sont semblables en tant que groupes, comme le montre la proposition suivante :
Proposition 3.28.
([OddSpringer, Théorème 3.8 et Corollaire 3.9]) et sont des groupes abéliens libres gradués de même rang et ce rang est donné par le coefficient binomial quantique (voir Section A.2 des Annexes)
En particulier on a donc
On note une certaine base monomiale de et la base correspondante de , la construction de ces bases étant expliquée dans [OddSpringer] et [ConciniProcesi]. Elles se correspondent dans le sens où les monômes qui constituent sont les même que ceux de . De plus, on a un isomorphisme d’espaces vectoriels gradués
qui fait se correspondre les projections de et de dans le produit tensoriel, notés et .
Proposition 3.29.
On a l’égalité
En particulier, une base modulo 2 de est une base de .
Démonstration.
On utilise les mêmes arguments que pour la Proposition 3.5.
13 Isomorphisme entre et
Cette section est dédiée à la preuve du résultat principal du chapitre qui consiste à construire un isomorphisme entre et .
Théorème 3.30.
Le centre impair de est isomorphe en tant qu’anneau gradué à la construction impaire de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer pour une partition
Par analogie à la construction explicite de l’isomorphisme du Théorème 3.3, on propose de définir un homomorphisme
similaire et adapté pour nos besoins qui induit le même homomorphisme en modulo 2. On construit dans un premier temps cet homomorphisme en le définissant sur les polynômes impairs et puis en montrant que les éléments de l’idéal par lequel on quotiente pour définir sont dans le noyau, de sorte à obtenir le morphisme induit . On montre dans un second temps que cet homomorphisme est injectif en montrant que si on a une relation dans l’image de la base de elle remonte à une relation dans la base. Enfin on montre qu’on a l’égalité des rangs de et de en regardant ces anneaux comme des groupes abéliens libres, donnant la surjectivité et concluant la preuve.
13.1 Définition de l’homomorphisme
On définit d’abord le morphisme d’anneaux gradués suivant :
avec la composante de cercle de qui touche le -ème point de base à partir de la gauche. On remarque que, par définition du produit dans , on a
et donc en général
| (3.3) |
Ceci montre que est un morphisme d’anneau et qu’il est bien défini puisqu’on retrouve l’antisymétrie des polynômes impairs dans le produit extérieur.
Lemme 3.31.
L’image de est dans le centre impair de
Démonstration.
On utilise la Proposition 3.18. Pour tout on a l’égalité
car pour effectuer les produits on fusionne ensemble les composantes de et qui passent par le -ème point de base. L’image de par étant la somme de ces composantes, on obtient l’égalité voulue. On étend ensuite à tout le domaine puisque le centre impair est un sous-anneau de et que est un homomorphisme d’anneaux.
On a donc un homomorphisme
et il nous reste à montrer que est dans son noyau pour tout et pour tout de sorte à induire un morphisme . On remarque que l’image de est nulle dans si et seulement si elle est nulle dans chacun des puisque son image est dans la somme directe de ceux-ci. Pour , on note la projection de sur de sorte que et on remarque aisément que cela forme un morphisme d’anneaux gradués pour les même raisons que pour . Afin de montrer le résultat voulu, on introduit les notations et lemmes suivants.
Lemme 3.32.
Pour tout , sous-ensemble ordonné de de cardinalité et , on a
Démonstration.
Puisqu’il y a composantes dans , le produit extérieur est engendré par éléments et donc tout produit de plus de éléments est nul. Or étant une somme de polynômes à plus de termes, ils sont envoyés par sur des produits extérieurs de plus de éléments par (3.3).
Pour la suite du raisonnement, on se fixe un arbitraire afin de ne pas devoir le mettre comme hypothèse dans chacun des lemmes. Dans le but d’alléger l’écriture, on note aussi vu comme ensemble ordonné. On peut alors voir un sous-ensemble (ordonné) de comme un sous-ensemble des points d’extrémités des arcs de .
Définition 3.33.
Pour , on appelle arcs de les paires de points de qui sont identifiées aux extrémités d’un même arc de et on appelle ces points les points non-libres (de ). On appelle tous les autres points des points libres (donc les points de dont l’autre extrémité de l’arc de n’est pas dans ), comme illustré en Figure 14.

Lemme 3.34.
Soient . Si , alors possède au moins arcs et points non-libres ainsi qu’au plus points libres.
Démonstration.
On doit choisir points parmi répartis en paires pour les arcs, donc on a au moins collisions (c’est-à-dire paires de points appartenant à un même arc). Chaque arc ayant deux extrémités et puisqu’on a au minimum arcs, on a au moins points non-libres. Le nombre de points libres est obtenu en prenant la différence du nombre total de points de et du nombre de points non-libres, donc on obtient bien un maximum de points libres.
Pour et un sous-ensemble ordonné on pose
Cette notation donne, en prenant la somme sur tous les sous-ensemble ordonnés de ,
| (3.4) |
Lemme 3.35.
Soient . Si contient un arc de , alors
Démonstration.
On observe que si sont reliés par un arc dans , alors
puisque . On généralise ensuite et on obtient le résultat par anticommutativité.
Lemme 3.36.
Pour tout , avec et , il existe un point non-libre de contenu dans .
Démonstration.
C’est un simple argument de comptage : par le Lemme 3.34 il y au maximum points libres dans et par hypothèse contient au minimum points.
Définition 3.37.
On suppose fixé. Pour un arc de ayant une extrémité ou dans , on considère la somme des nombres de
-
—
points libres de situés entre et non-contenus dans ,
-
—
points non-libres de situés entre et et contenus dans .
On appelle parité de l’arc la parité de cette somme.
On peut calculer la parité d’un arc de pour en fonction de ses sous-arcs maximaux ayant une extrémité dans , c’est-à-dire les sous-arcs contenus dans aucun autre sous-arc ayant une extrémité dans .
Lemme 3.38.
Soient . Si ne contient aucun arc de , alors la parité d’un arc de ayant une extrémité dans est donnée par la somme des parités inverses des sous-arcs maximaux ayant une extrémité dans et de la parité du nombre de points libres de non-contenus dans qui ne sont pas dans ces sous-arcs.
Démonstration.
Tous les points contenus dans les sous-arcs sont dans l’arc et, ne pouvant contenir deux extrémités d’un même arc, chaque sous-arc considéré ajoute un point non-libre contenu dans , inversant la parité.
Lemme 3.39.
Soient . Soient aussi un arc de avec (resp. ) dans et obtenu en retirant (resp. ) de et ajoutant (resp. ). Si est pair alors on obtient
Avant de montrer ce résultat un peu technique, on propose un exemple afin de clarifier le raisonnement.
Exemple 3.40.
On prend comme dans la Figure 15 ainsi que , et . On a donc les points libres de et les points non-libres donnant les arcs de et .
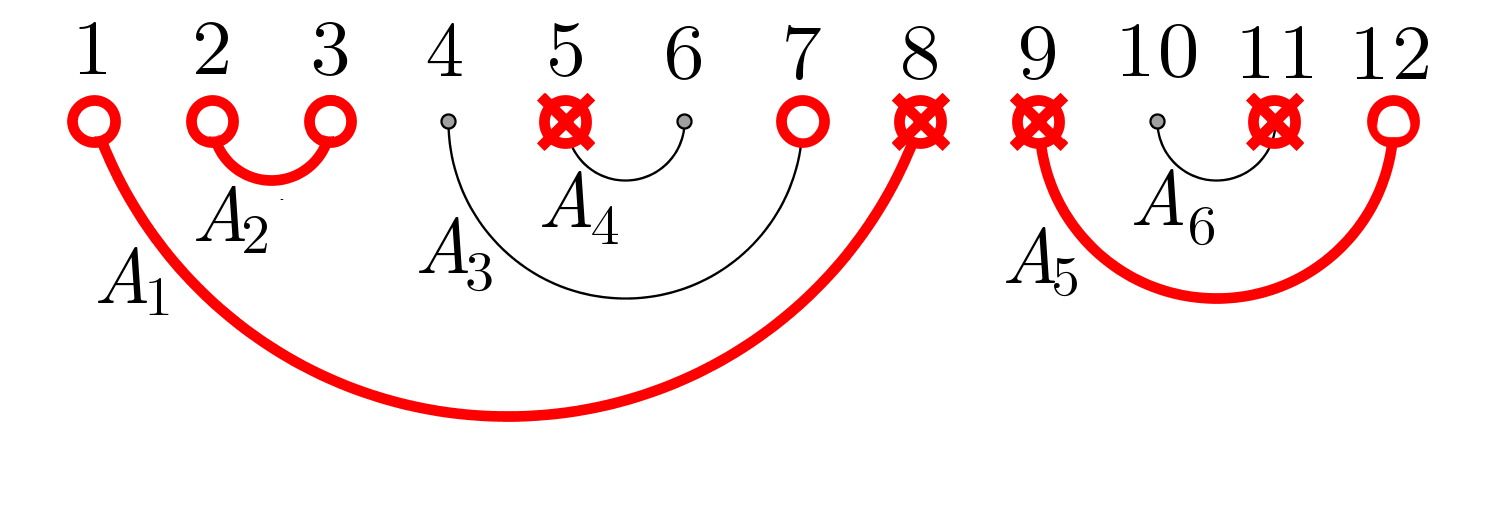
On obtient le terme de , les signes étant dus à la position des points dans , qui a comme image dans
où est la -ème composante de cercle de pour l’ordre induit par les points de base, comme illustré en Figure 15 (on prend des majuscules dans cet exemple pour ne pas confondre avec les qui définissent , dans le cas de la figure on a par exemple ). Puisque contient et comme points non-libres, on regarde la parité des arcs :
-
—
: impair car il contient juste 7 comme point libre de non-contenu dans et aucun non-libre contenu dans ,
-
—
: pair car il ne contient aucun des points recherchés.
On vérifie qu’en effet l’élément avec qui est donné par où on échange avec , c’est-à-dire l’élément , donne l’image
Par contre si on échange avec on obtient comme image qui est la même que celle de mais qui s’annule avec l’élément où on échange avec et avec . Au final, la somme de toutes les possibilités d’échanges des points non-libres de est donc nulle.
Démonstration.
(du Lemme 3.39) On montre le résultat par récurrence sur la taille de et de . En effet, on suppose que contient un arc avec aucun autre point de compris entre ses extrémités et qui possède donc trivialement un nombre pair de points recherchés. On a alors un changement de signes induit par la position dans ( et sont côte à côte dans , donc est de signe opposé à ), tandis que et sont à la même position dans l’expression de l’image, ne changeant pas de signe. Au total, on a donc un changement de signe comme voulu. On a maintenant cinq cas à considérer :
-
1.
On ajoute un point libre compris entre et à et .
-
2.
On ajoute un point libre compris entre et seulement à .
-
3.
On ajoute un arc compris entre et dans et une de ses deux extrémités dans .
-
4.
On ajoute un arc compris entre et dans avec aucune de ses extrémités dans .
-
5.
On ajoute un arc compris entre et dans et dans .
Le premier cas n’induit pas de changement de signe puisque est décalé d’une position vers la droite par rapport à , impliquant un premier changement de signe, et que l’élément ajouté étant dans il apparait aussi dans le produit. Commuter avec cet élément implique donc un second changement de signe donnant une égalité au final. Par contre, le deuxième cas induit un changement de signe puisqu’on conserve le changement par la position dans mais qu’on ne retrouve plus l’élément avec lequel on doit commuter dans et donc dans le produit. Le troisième cas induit aussi un changement puisqu’on ajoute éléments dans , ne modifiant donc pas le signe, mais qu’on ajoute un seul élément dans impliquant une commutation dans le produit. Le quatrième cas ne change pas non plus le signe par des arguments semblables. Enfin, pour le cinquième cas, alors contient un arc de et la solution devient triviale par le Lemme 3.35. Au final, le signe n’est donc influencé que par les deuxième et troisième cas qui sont les points considérés pour définir la parité d’un arc.
Lemme 3.41.
Soient avec et . Si ne contient aucun arc de , alors il existe un arc de ayant une extrémité dans et de parité paire.
Démonstration.
Tout d’abord, par le Lemme 3.36 il existe un arc de ayant une extrémité dans . On suppose par l’absurde qu’il n’existe pas d’arc rencontrant et ayant une parité pair et donc que tout arc de ayant une extrémité dans est impair. Si on pose le nombre de points non-libres de contenus dans , on observe qu’il y a au moins points libres dans . Par le Lemme 3.38, la parité d’un arc ne dépend pas de ses sous-arcs (ils sont tous impairs induisant une parité paire) et il faut donc pour chaque arc au moins un point libre non-contenu qui ne se trouve dans aucun des sous-arcs pour obtenir une parité impaire. De là on déduit qu’il y a au moins autant de points libres non-contenus dans que d’arcs de ayant une extrémité dans . On a donc points libres de qui ne sont pas contenus dans , laissant un maximum de points libres restants par le Lemme 3.34. Or doit en contenir au moins , ce qui est absurde.
Maintenant qu’on a tous les outils nécessaires, on peut démontrer le résultat voulu donné par la proposition suivante :
Proposition 3.42.
Pour tout , et ainsi que pour tout de cardinalité , on a
Démonstration.
Tout d’abord, par le Lemme 3.32, on peut supposer que . L’idée de la preuve est de montrer que tous les termes qui composent l’image par (3.4) et qui ne sont pas annulés par le Lemme 3.35 s’annulent deux à deux en utilisant le Lemme 3.39. On peut donc supposer que ne contient pas d’arc de . Par le Lemme 3.41, il existe un arc de pair pour et donc on peut appliquer le Lemme 3.39 pour l’annuler avec . Cela permet d’annuler tous les autre termes puisque, étant donné un avec un arc pair , pour tout autre obtenu à partir de en échangeant un point non-libre (différent de et ) avec l’autre extrémité de l’arc, on peut appliquer le Lemme 3.39 dessus aussi pour l’annuler avec obtenu en échangeant et et que tout ces ensembles donnent des différents.
Corollaire 3.43.
Il existe un morphisme d’anneaux gradués induit par
13.2 Injectivité de l’homomorphisme
Lemme 3.44.
Le morphisme d’anneaux
induit par sur le produit tensoriel avec est un isomorphisme.
Démonstration.
On a un isomorphisme d’anneaux
en envoyant le produit tensoriel d’éléments de vers le produit extérieur, comme dans la preuve de la Proposition 2.44. Le centre de et le centre impair de étant caractérisés par la même relation (3.1) une fois prise en modulo , on obtient un isomorphismes d’anneaux gradués
On considère ensuite le diagramme commutatif de morphismes d’anneaux suivant
avec l’isomorphisme de droite venant du Théorème 3.3 et celui du haut de la Proposition 3.28. Le diagramme commute car est équivalent modulo 2 à l’isomorphisme de droite. On en conclut que est un isomorphisme.
Proposition 3.45.
Le morphisme du Corollaire 3.43 est injectif.
Démonstration.
On note la base de de la Proposition 3.28. On suppose par l’absurde que ne soit pas injectif, c’est-à-dire qu’il existe une combinaison linéaire non-nulle d’éléments de , , envoyée sur par
L’idée de la preuve est d’utiliser l’isomorphisme du lemme précédent et la conservation de la base sous le produit produit tensoriel avec pour obtenir une relation dans les éléments d’une base de , c’est-à-dire une combinaisons linéaire non-nulle d’éléments de cette base donnant , ce qui est absurde par définition. On obtient cela en passant par le produit tensoriel avec , comme illustré par les diagrammes suivants
où le diagramme de gauche commute et le diagramme de droite représente le chemin de raisonnement parcouru.
On considère l’image de la combinaison linéaire en modulo 2, c’est-à-dire sa projection dans le produit tensoriel avec , donnant
puisque est projeté sur et que le diagramme de gauche commute. Par le lemme précédent est un isomorphisme, impliquant que
On obtient donc une relation dans qui est une base par la Proposition 3.29.
13.3 Égalité des rangs de et
Dans la preuve du Théorème 3.3, M. Khovanov construit une variété à partir de sphères. Il montre que son anneau de cohomologie est isomorphe au centre de et qu’il possède une présentation équivalente à celle de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer. On propose de construire une variété similaire, notée , à partir de cercles (donnant donc des algèbres extérieures comme anneau de cohomologie) et de montrer qu’il existe un épimorphisme d’anneaux non-gradués de l’anneau de cohomologie de cette variété vers le centre impair de . Ensuite on calcule le rang de cet anneau de cohomologie et on remarque qu’il est égal au rang de l’anneau de cohomologie impaire de , donnant l’égalité avec le rang du centre impaire et concluant la preuve.
Définition 3.46.
Pour tout , on définit tel que
si et seulement si tout reliés par un arc dans implique .
On définit alors
On remarque que puisque possède arcs et donc on égalise paires de disjointes sur disponibles. De même, est l’ensemble des tels que si est relié dans ou dans alors de sorte que si deux points appartiennent à la même composante de on a . Géométriquement, est donc un hypertore , avec le nombre de composantes de cercles, de sorte que est une collection d’hypertores identifié ensemble deux par deux sur des sous-hypertores de dimensions inférieures donnés par les diagonales.
Exemple 3.47.
Dans on considère
On obtient , noté par abus de notation . On obtient aussi et par conséquent . Visuellement, si on représente et comme des tores sous forme de rectangles où on identifie les côtés opposés, on obtient la surface représentée sur la Figure 16, c’est-à-dire que est l’union de deux tores dont on identifie ensemble les diagonales.
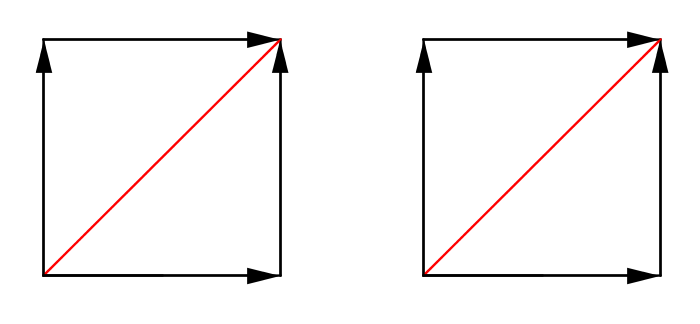
Exemple 3.48.
Dans on considère les éléments
On obtient alors par exemple les diagrammes
On calcule que et impliquant que . Visuellement, on a pour représenté par la boite où on identifie deux à deux les cotés opposés la Figure 17 avec l’intersection en rouge.
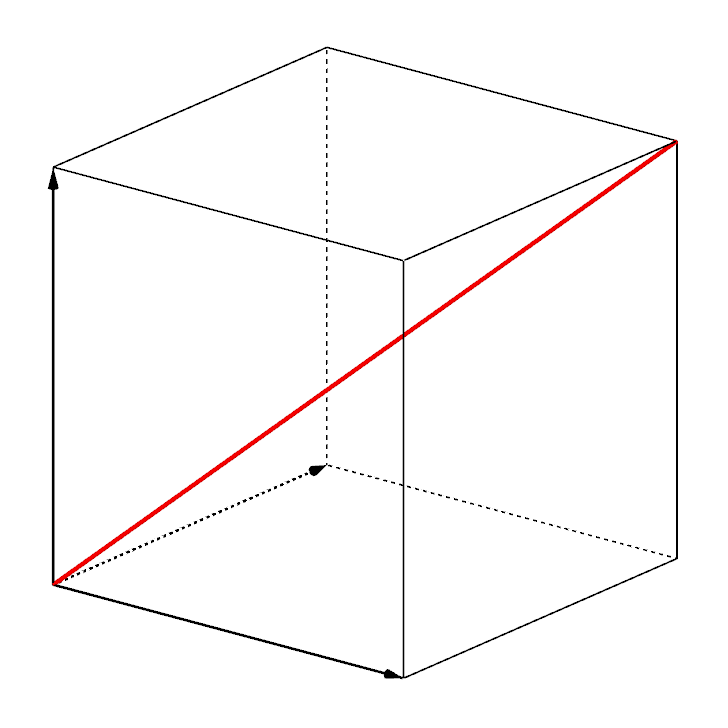
De même, on calcule et donc . On obtient alors l’hypertore représenté en Figure 18 avec l’intersection en rouge.
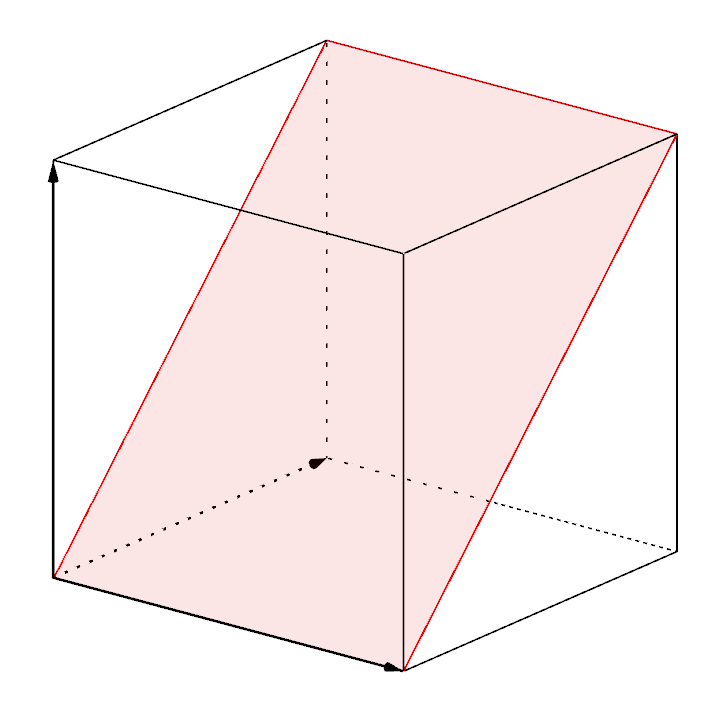
En faisant pareil pour , on calcule finalement que est donné par la Figure 19 où les éléments colorés sont identifiés ensemble deux à deux.
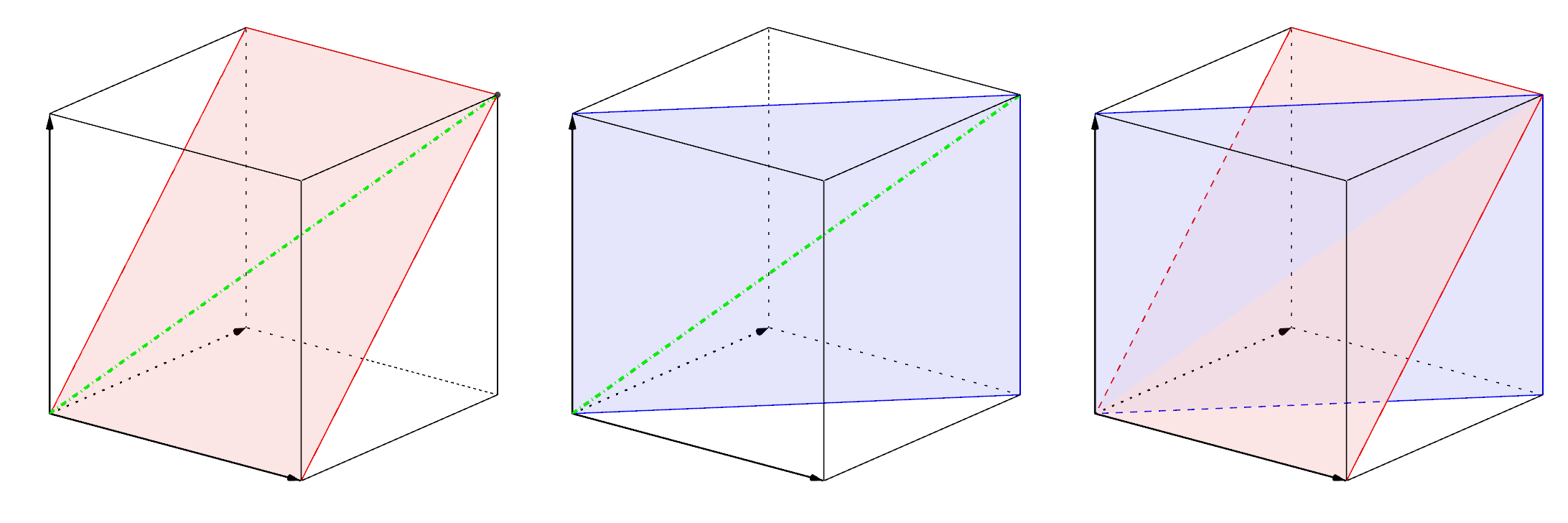
Lemme 3.49.
On a un isomorphisme d’anneaux (non-gradués)
et un isomorphisme de groupes (non-gradués)
De plus, en munissant d’une structure d’anneau induite par l’isomorphisme de groupe et en définissant
où les sont induit par inclusion de dans et , on obtient le diagramme commutatif de morphismes d’anneaux suivant :
Démonstration.
On sait par l’Exemple A.5.10 des Annexes que
avec chaque composante de générant un élément de base du produit extérieur par la formule de Kunneth (voir [Hatcher, Théorème 3.15]) et donc on a
De même on a des isomorphismes de groupes
On calcule que envoie un produit extérieur vers un autre en renommant les éléments suivant les composantes de égalisées dans puisque c’est le morphisme induit par l’inclusion
où on envoie chaque coordonnée de vers les coordonnées de égalisées pour former . En effet, chaque composante de engendrant un élément de base de , deux éléments de base sont égalisés si les composantes associées sont égalisées. Par ailleurs, on sait que agit exactement de la même façon puisqu’on égalise les composantes de cercles fusionnées.
Définition 3.50.
Soient des ensembles finis et ainsi que des anneaux pour tout et pour tout et des morphismes pour certaines paires . On note
On définit l’égalisateur de comme le sous-anneau de qui consiste en les tels que
dès que et sont définis.
Par la Proposition 3.16, on remarque que, si on pose , avec donné par l’ensemble des et par l’ensemble des paires tels que est défini si ou , on obtient l’égalité . Dès lors, en posant de la même manière , on obtient le diagramme commutatif de morphismes d’anneaux suivant :
De plus, on a un morphisme induit par l’inclusion pour tout . On considère alors la composition de ce morphisme avec la projection de sur le sous-anneau et on obtient le diagramme commutatif suivant :
| (3.9) |
Jusque là, la preuve est équivalente à celle de M. Khovanov en remplaçant les sphères par des cercles, sauf que maintenant on veut montrer que est, non pas un isomorphisme, mais un épimorphisme.
Définition 3.51.
On dit qu’il y a une flèche pour s’il existe un quadruplet tels que est relié à et à dans et est relié à et à dans , ainsi que si tous les autres arcs sont les mêmes dans et . Visuellement, on a
Exemple 3.52.
Pour , on obtient toutes les flèches suivantes :
Définition 3.53.
On définit un ordre partiel sur en disant que s’il existe une suite . On se fixe un ordre total arbitraire à partir de cet ordre partiel.
On définit aussi une notion de distance donnée par la distance sur le graphe non orienté induit par les flèches, c’est-à-dire que pour minimal tel qu’on a une suite avec soit soit pour tout .
Proposition 3.54.
Le diagramme contient exactement composantes de cercles
Démonstration.
Tout d’abord on note que si ou alors il est clair que contient composantes puisque les 4 arcs de la définition de flèche entre et appartiennent à la même composante de .
On doit avoir
car pour toute suite avec ou on a le cobordisme
et à chaque étape
on change le nombre de composantes de donc dans le pire des cas on fusionne composantes.
On considère les arcs de qui appartiennent à une même composante de et on construit une suite de vers avec tous ces arcs fusionnés, ce qui prend étapes. On peut faire ainsi pour chaque composante et on obtient alors une suite de à constitué de étapes et donc .
On pose et . On remarque que si est le prochain élément après dans l’ordre total sur alors . Cela est utile par la suite pour faire des preuves par induction.
M. Khovanov utilise les trois lemmes suivants ([HnCenter, Lemmes 3.2-3.4]) pour sa preuve mais qu’il laisse non démontrés. La preuve du premier étant fort technique et trouvable dans les annexes de [preuveLemme, preuve de la Proposition 3.15], on n’en donne que l’idée principale tandis qu’on démontre les deux autres pour le cas utilisant des tores.
Lemme 3.55.
Pour tout il existe tel que et .
Démonstration.
(idée) Tout d’abord, il faut observer que si on n’a pas de séquence minimale avec , alors on a une séquence . Toute la technicité de la preuve est contenue dans ce résultat qu’on accepte.
La preuve se fait par récurrence sur . Si , alors soit , soit et on prend ou . On suppose maintenant que le lemme est vrai pour des distances inférieures. Si on un chemin minimal tel que alors on prend le donné par le lemme appliqué à et et on remarque qu’il est correspond au recherché pour et . Sinon, par le résultat technique au dessus, on peut prendre .
Lemme 3.56.
Pour tout tels que on a
Démonstration.
On remarque que le corbordisme
envoie composantes de cercle vers composantes. Or, puisque , on doit éliminer et donc fusionner au moins composantes. Puisqu’on a ponts, on a exactement fusions et donc deux points reliés par un arc de sont dans la même composante de ce qui est équivalent à l’assertion du lemme.
Lemme 3.57.
Pour tout , on a
Démonstration.
Le lemme suivant est adapté de [HnCenter, Lemme 3.5] avec comme différence que la décomposition utilise des cellules de toutes dimensions au lieu de cellules de dimensions paires. On renvoie à la Section A.6 des Annexes pour une définition d’une décomposition cellulaire.
Lemme 3.58.
Il existe une décomposition cellulaire de qui se restreint en une décomposition cellulaire de .
Démonstration.
On note l’ensemble des arcs de de sorte qu’on ait un homéomorphisme . On définit le graphe non-orienté obtenu en prenant comme sommets l’ensemble et en posant que deux arcs et sont reliés s’il existe tel que est obtenu à partir de en effaçant et et en reconnectant les 4 points extrémités de ces arcs d’une façon différente. Une façon similaire de voir que deux arcs sont reliés est si l’un est contenu dans l’autre et qu’il n’y a pas d’arc intermédiaire. est alors une union disjointe d’arbres. Un exemple de graphe pour un élément de est donné en Figure 20.
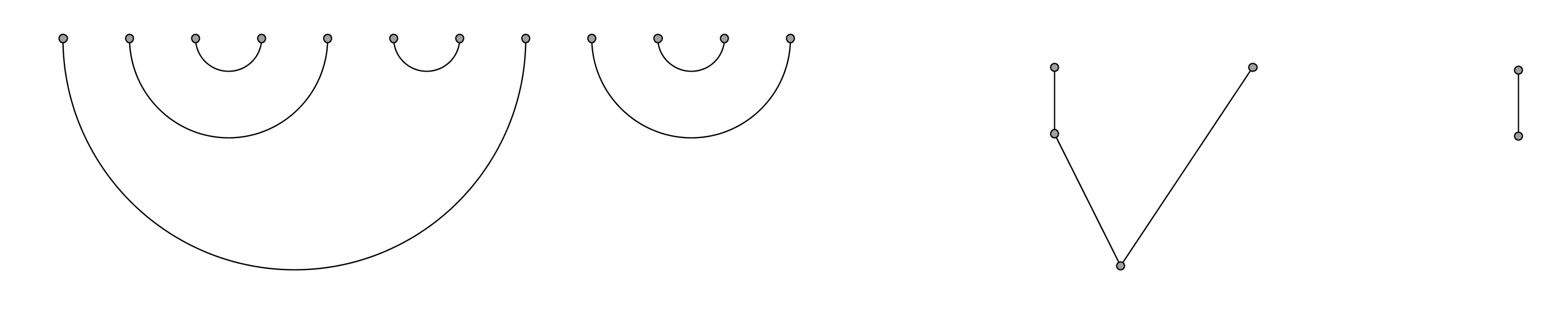
On pose l’ensemble des arêtes de . Dans chaque arbre de , on choisit un sommet qu’on marque et on note l’ensemble des sommets marqués (qui contient donc autant d’éléments que d’arbres dans ). On remarque alors que puisqu’on a autant d’arêtes que le nombre d’arcs moins le nombre d’arbres (chaque arbre contenant autant d’arêtes que d’arcs moins un). On se fixe un point et pour tout on pose le sous-ensemble de constitué des points tels que
| si | |||||
| si | |||||
| si | |||||
| si |
avec qui est donc l’arête qui relie l’arc à l’arc . Il est évident qu’on a , l’union étant disjointe puisqu’on a des égalités ou inégalités suivant si l’élément est présent ou non dans . De là on a où l’homéomorphisme est donné par : la composante d’arc marqué est envoyé sur la composante de cet arc et on parcourt le graphe en partant de ces points marqué, envoyant les composantes de chaque arête vers la composante de l’arc extrémité auquel on a pas encore attribué de composante, de sorte que si alors les composantes engendrées par les extrémités de l’arc sont égalisées dans l’image de . De plus est homéomorphe à puisque chaque élément dans diminue le nombre de degrés de libertés par un, un élément de égalisant deux composantes et un élément de fixant une composante sur .
Cela donne donc une décomposition cellulaire de dont les cellules sont des hypertores de dimension et le bord de est donné par . Cette décomposition se restreint à une décomposition cellulaire de . En effet, on observe que pour , on a
avec qui contient au moins l’arête donnée par le changement d’arcs de vers . On a cela car égalise les composantes de données par les arcs et et est donc donné par un sous-hypertore de codimension dans pris sur la diagonale qui égalise les deux même composantes. Or toute cellule pour contenant a ses composantes et égalisées.
Exemple 3.59.
On considère la décomposition de pour
en notant le grand arc de et l’autre. On obtient alors un graphe avec et comme sommets reliés ensemble puisque . On choisit comme sommet marqué et donc on a , on obtient alors le tore représentés en Figure 21 où la flèche horizontale est la composante associée à et la verticale à de sorte que l’homéomorphisme envoie la composante associée à vers celle associée à dans et celle de vers celle de dans . On obtient alors une décomposition comme dans la Figure 21 où le point bleu est donné par , le cercle vert troué d’un point par , le cercle rouge troué d’un point par et enfin le tore auquel on retire deux cercles donné par . On remarque de plus qu’on a et donc est donné dans par la diagonale qui est donc bien un sous-complexe.

Par contre, se décompose comme représenté en Figure 22 et on remarque que n’est pas un sous-complexe puisque c’est aussi la diagonale.

La première différence avec le travail de M. Khovanov est que dans sa décomposition cellulaire, puisqu’il utilise des sphères à la place de cercles, il obtient des cellules de dimensions paires. Dès lors, il obtient trivialement que l’anneau de cohomologie de est composé d’éléments de degrés pairs uniquement qui lui permettent de montrer facilement que le morphisme induit par l’inclusion est surjectif (les opérateurs de bords étant trivialement nuls) et par la suite que est injectif. On montre maintenant le lemme suivant adapté de [HnCenter, Lemme 3.6].
Lemme 3.60.
Le morphisme
induit par l’inclusion est injectif.
Démonstration.
Il suffit de vérifier que
est injectif puisque c’est une composition par une projection. Par la preuve du Lemme 3.58, on sait que la décomposition cellulaire de se restreint à une décomposition cellulaire de pour tout . Mais par le Lemme 3.57 on a et donc c’est injectif.
En effet, en général pour des CW-complexes , on a que l’application induite par l’injection est la projection
avec qui sont les cellules de non-présentes dans . Mais donc ici, si l’application n’était pas injective, ça signifierait qu’on pourrait trouver au moins une cellule de présente dans aucun des ce qui est absurde.
On remarque que et donc, par la proposition suivante, on a une suite de Mayer-Vietoris :
| (3.10) |
En effet, par la Proposition A.5.7 des Annexes, les groupes de cohomologie d’un espace et d’une déformation rétracte de celui-ci sont isomorphes et donc la suite de Mayer-Vietoris pour les voisinages de la proposition suivante donne la suite voulue.
Proposition 3.61.
Pour tout il existe un voisinage ouvert de dans tel que est une déformation rétracte de ce voisinage, on l’appelle alors voisinage rétracte de . De même on a des voisinages rétractes et pour respectivement et tels que
Démonstration.
Pour tout , on sait que est l’union de deux hypertores de dimension identifiés sur un sous-hypertore donné par un hyperplan diagonal de dimension . On construit alors comme un épaississement ouvert de cet hyperplan de largeur dans et , comme illustré en Figure 23, donnant
Il est clair que cela donne un ouvert dans et que est une déformation rétracte de en envoyant les sur . On construit alors
qui est un ouvert de et un voisinage rétracte de pour la même raison. On définit
et on observe que ce sont des voisinages rétractes de et ayant la propriété voulue par définition.
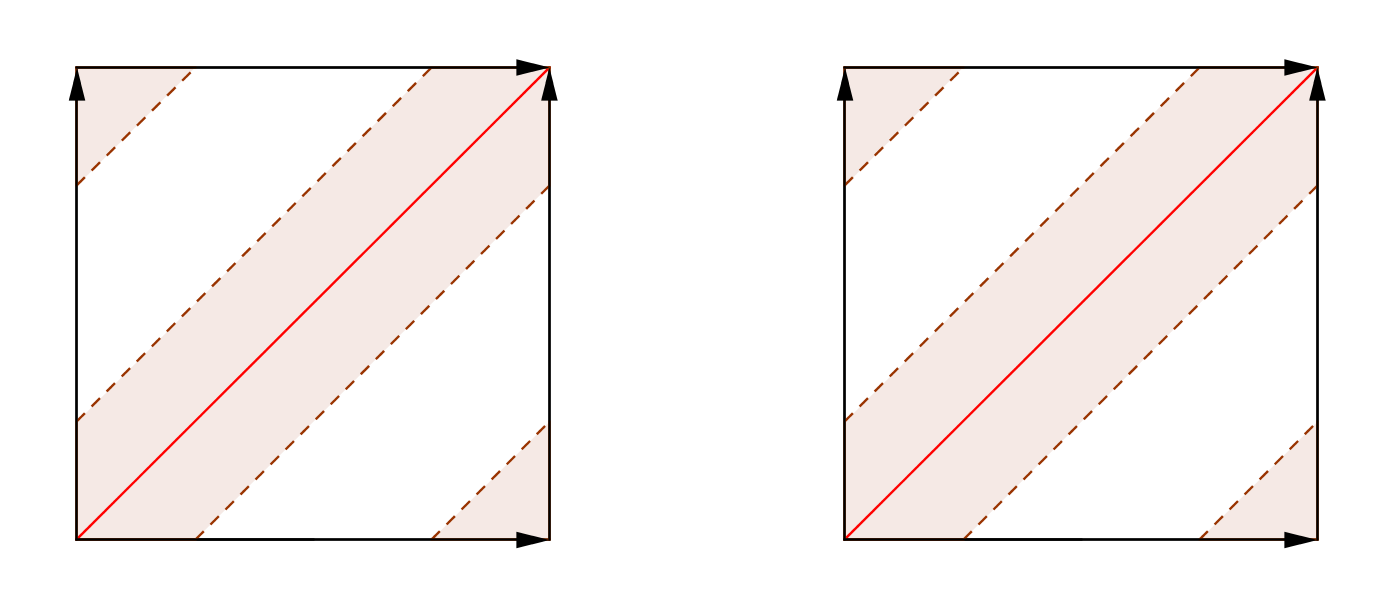
M. Khovanov obtient par surjectivité de une version un peu plus forte de la proposition suivante dans [HnCenter, Proposition 3.8] où il a en plus un "" à gauche de la suite exacte.
Proposition 3.62.
La suite suivante est exacte
où est le morphisme induit par les inclusions et on définit
avec
induit par l’inclusion .
Démonstration.
La preuve se fait par induction sur par rapport à l’ordre total sur . Pour minimal, on obtient la suite
qui est bien évidemment exacte. On suppose maintenant que est le prochain élément après pour l’ordre total et que la proposition soit vrai pour . Par le Lemme 3.60, puisque le morphisme est injectif et donc que la composition préserve le noyau, on peut remplacer par dans la suite exacte de Mayer-Vietoris (3.10) en conservant l’exactitude partout sauf pour les flèches , donnant une suite exacte
| (3.11) |
De plus, par hypothèse d’induction, la suite
| (3.12) |
est exacte. Puisque , on obtient par (3.12) et (3.11) le diagramme
qui donne donc la suite exacte voulue
Plus précisément, on suppose que soit dans l’image de et on a
mais et donc par exactitude de (3.12)
De plus si et si , donc on a
par le fait que la suite de Mayer-Vietoris fait apparaitre un signe similaire à et par l’exactitude de (3.11).
Proposition 3.63.
Il existe un épimorphisme d’anneaux (non-gradués)
Démonstration.
Dans le but de calculer le rang de on montre le lemme suivant, cité par M. Khovanov dans sa preuve de [HnCenter, Lemme 4.1] mais laissé non-démontré.
Lemme 3.64.
Pour tout , on note le nombre d’arcs inférieurs de , c’est-à-dire le nombre d’arcs qui ne sont pas contenus dans un autre arc. On obtient alors
Démonstration.
On montre l’identité équivalente
avec le ème nombre de Catalan. On a à gauche pour
On affirme que l’élément de gauche respecte la relation de récurrence de Segner
qui est une des façon de définir les nombres de Catalan, voir [catalan, Chapitre 5]. Pour prouver cela, on suppose par induction qu’elle la respecte pour tout et donc que et .
Tout d’abord on observe qu’on peut construire à partir des pour par une construction comme en Figure 24 : on peut écrire comme l’union où les éléments de sont donnés par un arc avec dans cet arc un élément de et à droite un élément de .

On obtient alors qu’un élément de possède autant d’arcs inférieurs que l’élément de droite de plus un. Dès lors, si on somme sur toutes les possibilités d’éléments à droite, on obtient par hypothèse d’induction et on multiplie par pour le nombre de possibilités d’éléments de dans l’arc , livrant l’équation
Cela se traduit en termes de , en utilisant l’hypothèse d’induction que , par
On a donc
On montre que pour tout on a en sommant le -ème terme de la somme et le -ème
et si est impair alors pour , on a et donc
ce qui nous donne
et cela conclut la preuve.
Proposition 3.65.
Vu en tant que groupe abélien, on a
De plus, est un groupe abélien libre.
Démonstration.
Par le Lemme 3.58, on a une décomposition cellulaire de qui se restreint à une décomposition de . Dès lors, on peut obtenir une partition cellulaire de à partir de cette décomposition, en commençant par prendre la décomposition de pour l’élément minimal de puis en ajoutant les cellules de pour tout en suivant l’ordre total défini sur . Il est important de noter que cela forme une partition cellulaire et non pas une décomposition puisque la fermeture d’une cellule n’est pas en général une union de cellules, comme le montre l’Exemple 3.59. Mais cela suffit pour la preuve car on affirme que le rang de est donné par le nombre de cellules de la partition. Puisque le rang des groupes d’homologie et de cohomologie sont égaux, on montre que la somme des rangs des groupes d’homologie est donnée par le nombre de cellules. En effet, on a la suite de Mayer-Vietoris, donnée par la Proposition 3.61,
et les sont nuls car l’application est injective. Intuitivement, cela vient du fait que l’intersection est une union d’hypertores de codimension un donné par des diagonales dont les intersections sont des hypertores de dimension inférieure et donc un cycle non nul dans un de ces hypertores reste non nul dans l’hypertore de dimension . Plus formellement, on sait par l’Exemple A.6.4 des Annexes que est donné par le groupe abélien libre à éléments et on a une décomposition cellulaire de en le même nombre de cellules de dimension (les cellules de dimension étant celles avec et donc on doit piocher éléments dans disponibles, ce qui égal à en piocher dans ). Cela signifie que chacune des cellules de la décomposition engendre un unique générateur du groupe d’homologie de . Puisque est un sous-complexe, son homologie est engendrée par ses cellules. Dès lors, on ne peut pas engendrer de nouvelle relation par l’inclusion puisqu’on sait qu’elles sont linéairement indépendantes dans . Ceci donne l’information supplémentaire que est un groupe abélien libre de rang égal au nombre de cellules du sous-complexe. De là on obtient
qui se traduit en termes de rang par
et donc on obtient par récurrence que le rang de est égal au nombre de cellules de dimension puisque est le nombre de cellules qu’on ajoute.
Pour , on pose le nombre d’arcs inférieurs de , c’est-à-dire le nombre d’arcs qui ne sont pas contenu dans un autre arc. On remarque que est aussi le nombre de composantes connexes du graphe de la preuve du Lemme 3.58. En effet, chaque composante possède au moins un arc inférieur sinon le graphe serait infini et on ne peut pas avoir plusieurs arcs inférieurs dans une même composante par le fait que deux arcs sont reliés si l’un contient l’autre sans arc intermédiaire. La décomposition de possède cellules puisque les cellules qu’il reste à attacher sont celles qui ne possèdent aucune des arêtes données par les flèches , donc il ne reste que les cellules définies par les ne possédant que des arcs marqués, donc une par composante connexe du graphe. Dès lors, on a possibilités suivant si on prend où non l’arc marqué dans . De là on obtient que la partition cellulaire de possède cellules puisque l’élément minimal est composé de arcs inférieurs et que la décomposition de possède cellules. Par le Lemme 3.64 cette somme est égale à .
Démonstration.
Remarque 3.66.
On peut remarquer qu’on a en plus montré que le rang de est le même que et donc est en fait un isomorphisme (non-gradué). En composant avec l’isomorphisme vers la présentation de la cohomologie impaire de , on obtient une présentation de en changeant le degré des générateurs des polynôme impairs en . On pouvait aussi l’observer directement en voyant que les opérateurs de bord de la suite de Mayer-Vietoris (3.10) sont nuls, ajoutant un à gauche dans la suite exacte de la Proposition 3.62 et donnant l’injectivité de . Sans doute est-il possible de montrer directement que admet une présentation semblable à l’anneau de cohomologie impaire de en adaptant la preuve de la Proposition 3.42 et/ou en utilisant un raisonnement similaire à M. Khovanov dans la preuve de [HnCenter, Théorème 1.4], donnant un isomorphisme non-gradué entre les deux, et il suffirait alors de montrer que la composition de avec cet isomorphisme donne un morphisme gradué, livrant une preuve alternative.
Par ailleurs, une preuve similaire serait certainement possible en construisant à partir d’hypersphère (ou toute autre dimension impaire plus grande que ), permettant d’utiliser des arguments similaires à ceux de M. Khovanov pour montrer que les opérateurs de bords sont nuls (puisqu’on a des groupe de cohomologie triviaux pour les entiers qui ne sont pas multiple de cette dimension). De plus, cela donne une présentation de ces anneaux de cohomologie toujours en modifiant le degré des générateurs des polynôme impairs en fonction de la dimension choisie pour .
Chapitre 4 Pour aller plus loin
Ce chapitre propose une série d’idées pour aller plus loin dans l’étude et la compréhension de l’anneau impair des arcs des Khovanov, notamment en proposant un substitut de module qui pourrait permettre d’imiter une bonne partie des résultats connus sur et pourrait mener à un nouvel invariant d’enchevêtrements. On montre aussi qu’il existe une façon de tourner en un anneau associatif et on étudie les règles de multiplications qui donnent des anneaux isomorphes.
14 Rendre associatif
On peut se demander s’il existe des coefficients tels que la multiplication
soit associative pour tout . La réponse est affirmative mais demande des résultats qui dépassent le cadre de ce travail. On en propose quand-même l’idée en renvoyant le lecteur vers des références pour les démonstrations et détails des résultats utilisés.
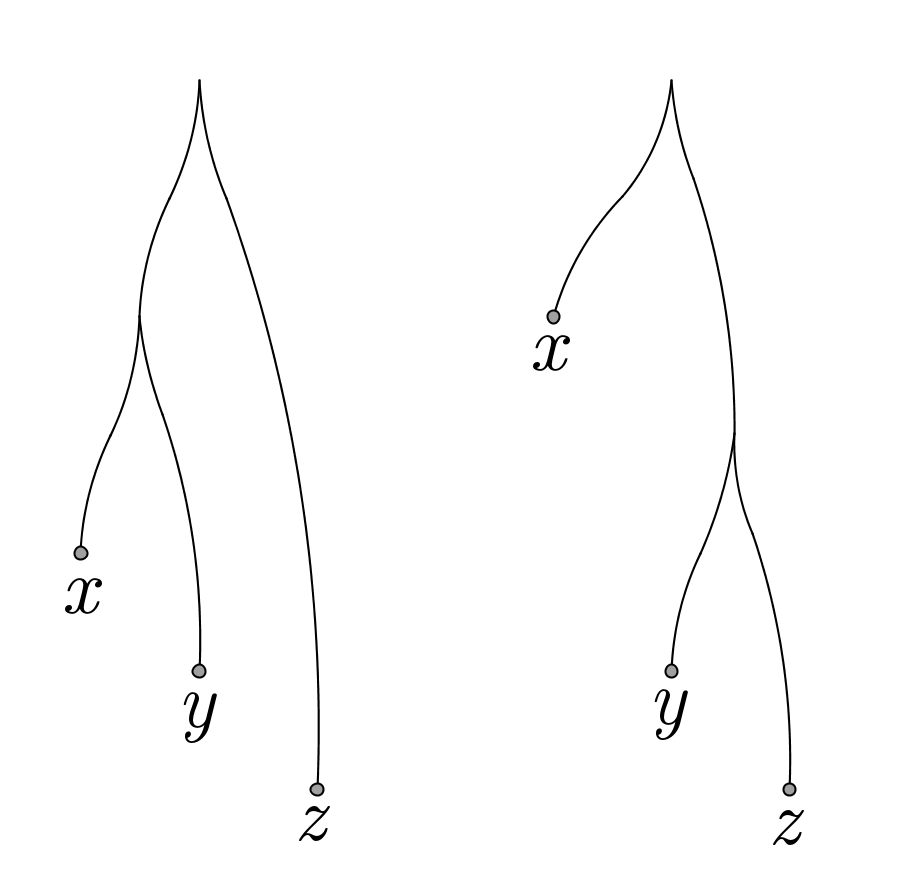
Tout d’abord il faut observer plus attentivement d’où vient la non-associativité. En effet, elle est due à deux phénomènes différents : d’une part les changements de chronologie dans les cobordismes, dépendant juste des diagrammes, comme dans l’Exemple 2.42, et d’autre part l’anticommutativité avec l’élément de gauche du double produit et des scissions de la multiplication de droite, dépendant du degré et des diagrammes, représenté en Figure 25 et illustré dans l’Exemple 2.39. Étant donné la nature du second, on observe le résultat suivant qui permet de calculer le nombre de scissions d’un cobordisme et donc le nombre de scissions avec lesquelles l’élément de gauche doit permuter.
Proposition 4.1.
La multiplication
est composée de scissions.
Démonstration.
Il suffit d’observer qu’on a autant de scissions que moins le nombre de fusions. Le cobordisme
doit envoyer composantes sur c’est-à-dire qu’il faut en fusionner au moins . Pour toute fusion supplémentaire, on doit avoir une scission correspondante afin d’équilibrer le nombre de composantes, ce qui donne
avec , pour et le nombre de fusions et scissions supplémentaires, la somme devant faire car on a ponts. Ceci donne
d’où on obtient la formule de la proposition.
Cela montre bien que peut importe le choix de , on a toujours autant de scissions dans le produit. On considère maintenant le groupoïde (voir Section A.7 des Annexes pour une définition de groupoïde) dont les objets sont les éléments de et les flèches les diagrammes qu’on peut composer . Chaque flèche possède un inverse puisque . Par ailleurs, on peut définir une graduation sur les éléments de (vu en tant que groupe abélien gradué) donnée par les flèches de et la décomposition en somme directe
Cela forme une graduation pour car la multiplication de deux éléments de a comme degré la composition des degrés. On note le degré pour cette graduation et on l’appelle degré diagrammatique. On note celui de la graduation usuelle par et le double degré dans le groupoïde est noté . Pour et , on note le nombre de scissions donné par la Proposition 4.1 et on note . On considère l’associateur
avec tel que
Puisque la non-associativité est due à deux phénomènes on peut séparer cet associateur en deux éléments
où calcule le signe du au changement de chronologie en fonction des diagrammes et calcule le signe de la permutation de avec la multiplication en fonction des diagrammes et du degré de .
L’idée de la preuve est d’observer que le groupoïde a une forme de -simplexe puisque pour toute paire d’objets on a une unique flèche de l’un vers l’autre et une unique flèche dans l’autre sens, avec ou plus (puisque et ). Dès lors, par l’Exemple A.7.6 des Annexe, sa cohomologie de degré dans est triviale (on renvoie vers la Section A.7 pour une définition de cohomologie de groupoïdes). Par ailleurs, puisque est un associateur, le diagramme suivant, où , commute :
| (4.7) |
Cela se traduit en termes de et en prenant les éléments et par
pour toute suite
dans , ce qui signifie que est un cocycle. Puisque la cohomologie de degré de est triviale, est un cobord et donc il existe tel que , c’est-à-dire
De même, on obtient que est un cocycle dans le groupoïde . On calcule que la réalisation géométrique de est
et donc on peut les décomposer en cellules. Par la formule de Künneth ([Hatcher, Théorème 3.15]) on obtient alors
Dès lors est un cobord et on a un tel que . On pose
et on obtient
avec
On en conclut que
et cela donne l’associativité pour cette nouvelle multiplication. Hélas est très difficilement calculable et donc la version associative de n’est pas intéressante pour ce qu’on en fait. De plus, il faudrait encore prouver que l’anneau qu’on obtient n’est pas isomorphe à .
15 Classes d’isomorphismes de
On peut étudier les collections de règles de multiplications qui donnent des isomorphes. En fait, on peut montrer que tous les qui ont des règles de multiplications avec les même associateurs sont isomorphes. Cela se montre par des arguments similaires à ce qu’on a fait pour trouver une multiplication associative.
On se fixe et deux règles de multiplications et afin d’éviter toute confusion on note la multiplication dans et dans . Puisque les cobordismes sont équivalents si on les regarde sans chronologie ni orientation, on sait qu’on a
avec pour tout . On peut alors définir l’application
définie par si et et sinon. Cela signifie que si alors . On souhaite avoir
pour un certain de sorte que
soit un isomorphisme d’anneaux gradués. Puisque a une cohomologie de degré triviale, tout cocycle est un cobord et donc on voudrait avoir que soit un cocycle. On observe alors que
et on peut prendre et pour avoir
avec le produit, s’il n’est pas spécifié, dans . Cela signifie que si
la fraction étant un abus de notation pour le signe induit par la non-associativité, donc si et ont le même associateur, alors est un cocycle. On note donc
l’associateur tel que pour on a
c’est-à-dire que c’est la fonction qui calcule le signe du au changement de chronologies, comme dans la section précédente. On ajoute l’hypothèse que et on en conclut que est un cobord. Cela signifie qu’il existe tel que . On a
et donc
avec comme prévu
donnant l’égalité . On en conclut le théorème suivant :
Théorème 4.2.
Pour toutes règles de multiplication et telles que et ont le même associateur, donc si , on a un isomorphisme d’anneaux gradués
Démonstration.
On utilise le fait que l’associateur est décomposé en deux éléments : un dépendant du degré du facteur de gauche et du nombre de scissions de la multiplication de droite, donc indépendant de , et l’autre dépendant du changement de chronologie et noté . Cela signifie que si et seulement si . Il suffit ensuite d’appliquer le raisonnement fait au-dessus pour conclure.
On peut alors noter la classe d’équivalence de ces anneaux, avec l’associateur. Comme le montrent les Exemples 2.42 et 2.43 on n’a pas toujours l’hypothèse d’égalité des associateurs. La question qu’on se pose maintenant est de savoir si cette condition est suffisante ou s’il existe d’autres isomorphismes pour entre ces anneaux ? En tout cas, cela donne une borne supérieure sur le nombre d’anneaux pour chaque puisque l’associateur est définir par un choix d’autant de ou que de triplets de diagrammes , et , c’est-à-dire quadruplets d’éléments de . On a donc au maximum
différents , où est le -ème nombre de Catalan.
16 Modules sur
Puisque n’est pas associatif, il ne peut pas former un module sur lui-même et donc il n’y a pas vraiment d’intérêt de parler de modules sur au sens usuel du terme. On se demande alors s’il existe un moyen de définir un substitut de module. Une réponse possible est de voir comme un quasi-anneau et d’étudier ses quasi-modules et quasi-bimodules, un quasi-anneau étant un anneau gradué non-associatif mais avec un associateur (devant donc faire commuter le diagramme (4.7)) prenant comme arguments les degrés des éléments. Dès lors, un quasi-module est un groupe abélien gradué sur le même ensemble que le quasi-anneau et avec une action devant respecter l’associateur aussi, c’est-à-dire que pour tout et on a
On peut alors définir le produit tensoriel de deux bimodules et comme
Comme expliqué dans [Khovanov], les bimodules sur forment une catégorification de l’algèbre de Templerley-Lieb qui est définie comme suit :
Définition 4.3.
L’algèbre de Temperley-Lieb, notée , est l’algèbre sur avec générateurs et les relations
On peut montrer que cette algèbre est isomorphe à l’algèbre diagrammatique sur engendrée par
![[Uncaptioned image]](/html/1510.06650/assets/Images_arxiv/TL_Ui.png) |
où on regarde donc les éléments à isotopie près et un cercle disjoint revient à multiplier par . Plus précisément, cette catégorification consiste à associer à un diagramme le bimodule sur donné par
| où |
avec l’action à gauche
donnée par le cobordisme où on construit les même ponts que pour la multiplication dans et idem pour l’action à droite. De plus, la catégorification du coefficient est donnée par le groupe abélien (le rang gradué de est ). On veut alors définir de la même façon des quasi-bimodules sur , en utilisant la règle de multiplication pour choisir l’ordre de construction des ponts et leurs orientations donnés par (on pourrait aussi étendre la règle à un choix dépendant de l’élément ). Pour que ceci forme une catégorification, il faut que la composition de deux bimodules donne le bimodule donné par la concaténation des diagrammes associés, c’est-à-dire que pour tout on ait
Si on montre cela, on peut alors définir des complexes de quasi-bimodules et espérer obtenir un invariant d’enchevêtrement, comme M. Khovanov le fait avec les bimodules sur (voir [Khovanov] pour plus de détails). La question suivante serait alors de savoir si et livrent des invariants différents (ce qui est fort probablement le cas puisque l’homologie de Khovanov et sa version impaire sont différents) et même de savoir si pour des règles de multiplications différentes on peut obtenir des invariants différents.
17 Généralisation de et
K. Putyra a défini dans [Covering] une famille de foncteurs avec des paramètres tels que, une fois spécialisés, on obtient de ou de . Pour cela on pose
| et |
avec et et les applications qui servent de permutation, fusion, scission, naissance de cercle et mort de cercle :
On note l’anneau obtenu par une construction similaire à où on remplace les produit extérieurs par des produits tensoriels de et on associe aux cobordismes élémentaires les applications associées. On remarque qu’en spécialisant les paramètres on obtient et en les spécialisant à on obtient . On pourrait alors définir un centre pour donné par
où et . Il serait intéressant de vérifier si, en spécialisant les paramètres, on obtient que ce centre donne et . Par ailleurs, cela mène à la question de savoir s’il existe une généralisation de l’anneau de cohomologie de la variété de Springer et qui serait isomorphe au centre de pour une partition .
18 Action de sur le centre impair
On dit qu’un groupe agit faiblement sur une catégorie s’il existe des foncteurs pour tout tels que et . Comme expliqué dans [Khovanov, Section 6.5] et dans [HnCenter, Section 5], le groupe des tresses à brins agit faiblement sur la catégorie triangulée des complexes bornés de bimodules sur en tensorisant par le complexe de bimodule obtenu par résolutions de la tresse vue comme enchevêtrement. Cette action faible descend à une action du groupe symétrique sur le centre de par permutation des dans la présentation du Théorème 3.3.
Par ailleurs, dans [OddSpringer, Corollaire 3.4], A. Lauda et H. Russell montrent que l’algèbre de Hecke agit à gauche sur la construction impaire de la cohomologie de la variété de Springer et donc sur le centre impair de . On se demande alors si l’action du groupe des tresses sur la catégorie des quasi-bimodules sur descend à l’action de sur le centre impair.
19 Algèbres de Stroppel-Ehrig
C. Stroppel et M. Ehrig ont développé une famille d’algèbres diagrammatiques de type D dans [Stroppel] qui généralisent les anneaux des arcs de Khovanov qui sont de type A (puisque reliés à ). On peut alors se demander quels liens pourraient exister entre la version impaire des anneaux des arcs et les algèbres de Stroppel-Ehrig ?
Annexes
Annexe A.1 Notations
Afin d’éviter toute confusion possible, on donne une liste des notations utilisées dans ce travail, sauf celles qui sont explicitement définies dedans.
Ensembles
On note les ensembles des naturels , des entiers , des réels et des complexes . Par ailleurs, pour un ensemble, on note le groupe abélien libre engendré par les éléments de .
Rangs de groupes
Pour un groupe on note son rang (c’est-à-dire le nombre minimal d’éléments nécessaires pour générer le groupe) et pour un groupe abélien on note son rang (c’est-à-dire la taille du plus grand sous-groupe abélien libre).
Coefficients binomiaux
On note pour deux naturels et le coefficient binomial
Caractéristique d’Euler
On note pour un espace topologique sa caractéristique d’Euler-Poincaré.
Espaces vectoriels
Soit un espace vectoriel sur un corps . On note ou sa dimension.
Fonctions
On note l’application induite par l’inclusion de l’ensemble dans l’ensemble . On note s’il existe un isomorphisme respectant la structure algébrique de et de entre les deux. On note si et possèdent une structure de groupe abélien et qu’ils sont isomorphes en tant que groupes abéliens.
Produit tensoriel
On note le produit tensoriel sur de deux modules et sur un anneau . On note si le choix de est clair du contexte. On note aussi .
Annexe A.2 Nombres quantiques et groupe quantique
Tout ce qui est présenté dans cette section se trouve en détails dans [quantumj] à quelques changements de notation près (on prend par exemple un tel qu’il soit la racine de utilisé dans la référence).
L’algèbre de Lie admet une enveloppe avec générateurs tels que , et (le ici est dans la référence).
L’enveloppe admet une unique représentation irréductible de dimension , à isomorphisme près, qu’on note . Pour la dimension , on note simplement . Cette représentation est donnée par l’espace vectoriel des polynômes homogènes de degré en les variables avec agissant sur le vecteur de poids , par
avec la convention .
Par ailleurs, on peut définir une version quantique des entiers, c’est-à-dire qu’on déforme un nombre par un paramètre complexe . Plus formellement, on a la définition suivante :
Définition A.2.1.
Pour , on définit le -ème nombre quantique (pour ) comme
et on pose ainsi que .
De là on peut définir la factorielle quantique et par extension le coefficient binomial quantique
On observe que
et donc la somme des coefficients de est . De là on obtient que la somme des coefficients de est et on peut montrer que la somme des coefficients du coefficient binomial quantique donne le coefficient binomial usuel.
Tout comme on a une version quantique des entiers, on peut définir une version quantique de comme une déformation de cette algèbre par un paramètre complexe . Intuitivement, cela signifie qu’au lieu de prendre , on prend la déformation quantique de par un paramètre , c’est-à-dire , et on pose (cela peut se formaliser en termes de séries de puissances en prenant ). On obtient alors la définition suivante :
Définition A.2.2.
Le groupe quantique est l’algèbre sur engendrée par les éléments et tels que
On peut alors définir une version quantique de , qu’on note aussi , qui est donnée par l’espace vectoriel de dimension ayant comme base
et avec l’action définie par les mêmes relations que celles de en remplaçant les coefficients entiers par leurs analogues quantiques. On obtient donc
Annexe A.3 Groupes, anneaux et modules gradués
A.3.1 Groupes gradués
Un groupe abélien gradué (sur ) est un groupe abélien avec neutre qui se décompose en somme directe
On définit alors l’application degré pour tout comme
et on appelle de tels les éléments homogènes de . On définit le rang gradué comme le polynôme de Laurent obtenu en prenant
A.3.2 Anneaux gradués
Un anneau gradué est un anneau qui, vu comme groupe abélien, est gradué
et tel que pour tout et dans on a
Autrement dit pour des éléments homogènes , on a .
Exemple A.3.1.
L’anneau des polynômes en une variable est gradué par
A.3.3 Modules gradués
Un module gradué est un module sur un anneau gradué qui, vu comme groupe abélien, est gradué
et tel que pour tout et dans on a
On dit qu’un homomorphisme entre deux modules gradués est de degré si pour tout homogène on a homogène et
On note alors le degré du morphisme.
Définition A.3.2.
On définit la notion de décalage par d’un module gradué , noté , comme
| , | où |
Autrement dit, on a vu en tant que modules non-gradués et pour tout homogène on obtient
c’est-à-dire qu’on décale les degrés des éléments de par .
Par ailleurs, on peut définir une graduation sur le produit tensoriel de deux modules gradués et sur un anneau , ce qui forme un module en posant pour et
Remarque A.3.3.
Ici on ne considère que des graduations sur mais on peut définir une graduations sur n’importe quel groupe en demandant que le degré du produit soit donné par la composition des degrés. On peut même étendre cette définition sur des groupoïdes (voir Section A.7) en imposant que la multiplication soit non-nulle si et seulement si les degrés sont composables dans le groupoïde.
Annexe A.4 Algèbres extérieures de modules
En général, la notion d’algèbre extérieure est définie sur un espace vectoriel. On définit ici une généralisation de cette notion pour un module.
Définition A.4.1.
Soit un module sur un anneau commutatif unitaire . On définit l’algèbre extérieure sur le module comme
avec le produit tensoriel pris sur et
qui est l’idéal bilatère engendré par les éléments de l’ensemble.
On définit la multiplication sur l’algèbre extérieure
par
On remarque que cette définition de multiplication donne alors pour et
On remarque aussi que pour on a
puisque
Définition A.4.2.
Pour un élément on définit l’application de contraction par le dual de comme
et qui vaut pour tout , , avec et ,
et
Si le module est gradué, on a une graduation induite sur cette algèbre en donnant à un produit extérieur la somme des degrés
Sinon, on a une graduation naturelle sur cette algèbre en donnant un degré aux éléments de et un degré pour les éléments de , c’est-à-dire la graduation induite en donnant à tout élément de un degré .
Exemple A.4.3.
On considère le groupe abélien libre engendré par l’ensemble vu comme module sur . On a alors
avec et .
Annexe A.5 Anneau de cohomologie
En premier lieu, on fait quelques rappels sur les théories d’homologie et de cohomologie singulières d’un espace topologique, tous les détails se trouvant dans [Hatcher] et ensuite on définit l’anneau de cohomologie à proprement parlé.
A.5.1 Homologie et cohomologie singulières
Définition A.5.1.
Un -simplexe singulier dans un espace topologique est une application continue
avec le -ème simplexe topologique
où on ordonne si pour les sommets du simplexe.
On pose le groupe abélien libre engendré par les -simplexes singuliers et on appelle ses éléments des -chaines.
On définit l’opérateur de bord
où signifie qu’on prend le -simplexe engendré par tous les sauf .
On peut montrer que pour tout de sorte que et on définit les groupes d’homologie singulière de comme
On peut montrer que ces groupes sont isomorphes pour deux espaces topologiques homotopes.
Proposition A.5.2.
Soit une fonction continue entre des espaces topologiques et , alors il y a un morphisme de groupes induit
qui est l’application induite par le composition d’un -simplexe singulier et
Définition A.5.3.
Pour un espace topologique , on définit le groupe des -cochaines comme le dual du groupe des -chaines
c’est-à-dire qu’une -cochaine associe à chaque -simplexe singulier un entier.
On définit l’opérateur de cobord comme étant le dual de , donc
pour toute -cochaine et tout -simplexe singulier .
La définition se généralise en prenant le dual sur un groupe abélien quelconque au lieu de , mais on n’en a pas besoin dans ce travail. Comme , on obtient que et on définit les groupes de cohomologie singulière de comme
On appelle les éléments de des cocycles et les éléments de des cobords.
Proposition A.5.4.
Soit une fonction continue entre des espaces topologiques et , alors il y a un morphisme de groupes induit
qui est l’application induite par le composition de et d’une -cochaine
Proposition A.5.5.
Pour tout on a
Démonstration.
Cela se prouve en utilisant le théorème des coefficients universels et on renvoie vers [Hatcher, Section 3.1] pour plus de détails sur celui-ci, notamment pour la construction de . Ce théorème donne une suite exacte scindée
et donc
Puisque est un groupe abélien de type fini on a
Par ailleurs
puisque si on décompose avec sa partie sans torsion et sa partie avec torsion on obtient
et, ne contenant pas de sous-groupe libre non-trivial, son rang est nul. On en conclut le résultat voulu.
Définition A.5.6.
Un sous-espace d’un espace topologique est une déformation rétracte de celui-ci s’il existe une application continue
telle que pour l’inclusion.
Proposition A.5.7.
Si est une déformation rétracte de alors
| et |
A.5.2 Anneau de cohomologie
Tout comme pour la sous-section précédente, tous les détails et toutes les preuves des propositions se trouvent dans [Hatcher]. Tout d’abord, il faut introduire un produit sur les groupes de cohomologie d’un espace topologique
Ce produit est induit par un produit de cochaines donné par, pour et de dimensions respectives et , la cochaine de dimension telle que
pour tout simplexe singulier .
Lemme A.5.8.
Pour toutes cochaines et de dimensions respectives et on a
Le produit de deux cocycles est alors un cocycle (les deux cobords étant nuls et le produit par une cochaine nulle donnant une cochaine nulle) et le produit d’un cocycle et d’un cobord est un cobord puisque pour on a
et de même pour on a
Cela montre que le produit sur les cochaines induit un produit sur les groupes de cohomologie. Ce produit est la base pour définir l’anneau de cohomologie de .
Définition A.5.9.
Pour un espace topologique on définit l’anneau de cohomologie comme le groupe abélien gradué
muni de la multiplication
On montre aisément que cela forme bien un anneau associatif unitaire.
Exemple A.5.10.
On peut montrer ([Hatcher, Exemple 3.16]) que l’anneau de cohomologie du tore de dimension est donné par le produit extérieur sur éléments
avec les éléments générateurs du groupe libre ayant un degré .
Exemple A.5.11.
L’anneau de cohomologie de l’espace projectif complexe de dimension est donné par les polynômes
avec .
Annexe A.6 CW-complexe
On fait quelques rappels sur les -complexes, en commençant par leur définition et en expliquant l’homologie cellulaire ensuite. Toute comme pour la section précédente, tous les détails se trouvent dans [Hatcher].
A.6.1 Définition
Un -complexe est une construction inductive définie comme suit :
-
1.
On commence par un ensemble discret de points qu’on appelle des cellules de dimension et notées pour .
-
2.
On construit à partir de en attachant des cellules de dimension par des applications continues
c’est-à-dire que est l’espace quotient de l’union disjointe de et d’une collection de disques de dimension , , sous l’identification pour tout .
-
3.
On peut soit arrêter ce processus pour un fini, donnant pour un certain , soit prendre l’union de tous les munie de la topologie faible, c’est-à-dire qu’un ensemble est ouvert si son intersection avec tout est ouverte dans .
On appelle décomposition cellulaire d’un espace un -complexe tel que .
Exemple A.6.1.
On construit une décomposition cellulaire du tore .
-
1.
On commence par fixer un point donnant .
-
2.
On attache deux cellules de dimension 1 dont les bords sont attachés à , donnant (qui est donc un bouquet de deux cercles).
-
3.
On attache une cellule de dimension 2 dont le bord est attaché par
Si on considère comme un pavé où on identifie les côtés opposés deux à deux, en envoyant vers le point bleu, vers le segment vert et vers le segment rouge et vers le pavé entier, on a visuellement que la décomposition cellulaire donne la Figure A.6.1.

A.6.2 Homologie cellulaire
Tout comme on définit l’homologie singulière à partir des simplexes singuliers, il est possible de définir une homologie cellulaire à partir des cellules d’un -complexe. Formellement, on la définit à partir des groupes d’homologie singulière relatifs , mais ici on la définit directement à partir de chaines de cellules et d’un opérateur de bord défini sur celles-ci.
Définition A.6.2.
On définit pour un complexe le groupe des chaines cellulaires de dimension , , comme le groupe abélien libre engendré par les cellules de dimension de .
On définit l’opérateur de bord comme
où est le degré de l’application
où la seconde application est celle qui identifie en un point.
On peut montrer que et donc on peut définir des groupes d’homologie cellulaire
On peut montrer que ces groupes sont isomorphes à ceux de l’homologie singulière :
Théorème A.6.3.
([Hatcher, Théorème 2.35, p. 139]) Soit un -complexe. Alors pour tout on a
Cela donne des informations intéressantes sur l’homologie singulière d’un espace topologique , notamment le fait que le rang du -ème groupe d’homologie est borné par le nombre de cellules de dimension de toute décomposition cellulaire de .
Exemple A.6.4.
Il est connu que le tore peut être vu comme une hyperboite de dimension où on identifie deux à deux les faces opposées. On considère une décomposition cellulaire donnée par un point de base qui est un sommet de l’hyperboite pour . Ensuite on attache cellules de dimension , une pour chaque arête de l’hyperboite (à cause des identifications des faces, il y a des arêtes identifiées ensemble et donc on a différentes). Ensuite, chaque cellule de dimension est donnée par un choix de arêtes parmi les (par exemple arêtes donnent une face de dimension avec comme bord la première arête suivi de la seconde, moins la première et moins la seconde). On a donc une décomposition en cellules de dimension . On remarque que l’opérateur de bord est nul (le bord est donné par des paires d’hyperfaces qui s’annulent deux à deux) et donc on obtient que le groupe d’homologie est le groupe abélien libre engendré par les cellules de dimension , donc de rang .
Annexe A.7 Groupoïdes et cohomologie de catégories
Le but de cette section est de donner les idées derrière la notion de groupoïde et cohomologie de catégories. On renvoie vers [simphomtheory], [introtohom] et [may] pour plus de détails, on se limite ici à une approche un peu simple qui donne les définitions et propriétés nécessaires pour ce qu’on en fait dans ce travail. Un groupoïde est une sorte de groupe où l’opération de composition n’est définie que partiellement, c’est-à-dire qu’on ne peut composer que certains éléments du groupoïde. Tout comme un groupe peut s’exprimer comme une catégorie avec un seul élément (les flèches étant les éléments du groupe qu’on compose sur un unique objet abstrait), on a la définition suivante pour un groupoïde :
Définition A.7.1.
Un groupoïde est une petite catégorie dans laquelle chaque flèche est un isomorphisme (donc possède un inverse).
Il existe aussi une définition algébrique où on définit le groupoïde comme un ensemble munit d’une opération d’inverse et d’une composition partielle mais on n’en a pas besoin. Afin de définir une notion de cohomologie sur les groupoïdes, il nous faut définir une notion de simplexe, ce qu’on appelle le nerf d’une catégorie. L’idée est simple : si on a deux morphismes composable et alors on a un morphisme , formant donc un triangle
ce qui est semblable à un simplexe.
Définition A.7.2.
Le nerf d’une petite catégorie est donné par l’ensemble des où on définit comme l’ensemble des objets de et comme l’ensemble des compositions de morphismes
munis des opérateurs de faces (donc qui prennent chacune une face du simplexe)
envoyant pour
sur
en composant les morphismes et et on définit pour comme la composition où on retire l’élément . On définit aussi les opérateurs de dégénérescence où on ajoute l’identité sur .
On peut alors maintenant définir une théorie de cohomologie simpliciale pour une catégorie (et donc pour un groupoïde) sur un groupe abélien . On définit d’abord les complexes de cochaines comme
avec l’opérateur de cobord donné pour un certain par
On peut alors facilement calculer que et on définit le -ème groupe de cohomologie simpliciale par
Afin de calculer les groupes de cohomologie d’une catégorie, il existe un outil utile donné par la réalisation géométrique et le théorème qui suit. Tout cela existe de façon générale pour des ensembles simpliciaux, mais on en a pas besoin pour cette discussion et on renvoie vers [may, Chapitre 3] pour de plus amples détails.
Définition A.7.3.
La réalisation géométrique du nerf d’une catégorie est défini par
où est donné par l’union disjointe d’autant de simplexes que d’éléments dans et est défini par
avec la -ème face du -simplexe et le -simplexe écrasé sur sa -ème face.
Autrement dit, on identifie chaque simplexe du nerf à un simplexe topologique avec les faces attachées comme il faut.
Théorème A.7.4.
([may, Proposition 16.2, p. 63]) Pour une catégorie petite et un groupe abélien il y a un isomorphisme
Cela signifie donc que pour calculer la cohomologie simpliciale d’une catégorie, il suffit de connaitre la cohomologie simpliciale (ou singulière) de la réalisation géométrique de son nerf.
Exemple A.7.5.
On considère la catégorie possédant un seul objet et dont les flèches sont indexées par les entiers avec la composition donnée par la somme
pour tout . Puisque est un groupe, on appelle sa réalisation géométrique son espace de classification, noté . On peut montrer que puisque
signifiant qu’on a un -cycle qui génère tous les -cycles. On obtient alors que pour tout groupe abélien
Exemple A.7.6.
On considère un groupoïde possédant objets et tel que pour toute paire d’objets il existe une unique flèche (qui est donc l’inverse de l’unique flèche ). Autrement dit, a une forme de -simplexe, ce qui donne la réalisation géométrique
et pour tout groupe abélien on obtient
Références
- @article{TQFT}
- author=Abrams, Lowell, title=Two-dimensional topological quantum field theories and Frobenius algebras., journal=J. Knot Theory Ramifications date=1996, pages=569-587, volume=5 @article{khstrongerJ}
- author=Bar-Natan, Dror, title=On Khovanov’s categorification of the Jones polynomial, journal=Algebr. & Geom. Topol., volume=2, pages=337-370, date=2002, eprinttype = arxiv, eprint = math.QA/0201043v3 @article{bloom}
- author=Bloom, Jonathan M., title=Odd Khovanov homology is mutation invariant, journal=Math. Res. Lett. volume=17, number=1, pages=1-10, date=2010, eprinttype = arxiv, eprint = math.QA/0903.3746 @book{quantumj}
- author=Carter, J. Scott, author=Flath, Daniel E., author=Saito, Masahico, title=The Classical and Quantum -symbols, publisher=Princeton University Press, serie=Mathematical Notes, volume =43, year=1995 @article{categorification}
- author=Crane, Louis, author=Frenkel, Igor B., title=Four-dimensional topological quantum field theory, Hopf categories, and the canonical bases, journal=J. Math. Phys., volume=35, number=10, pages=5136-5154, date=1994 @article{clockcate}
- author=Crane, Louis, title=Clock and category: is quantum gravity algebraic? , journal=J. Math. Phys., volume=36, number=11, date=1995, pages=6180-6193 @article{ConciniProcesi}
- author=de Concini, C., author=Procesi, C., title=Symmetric functions, conjugacy classes and the flag variety, journal=Invent. Math., volume=64, number=2, date=1981, pages=203-219 @article{Stroppel}
- author=Ehrig, Michael, author=Stroppel, Catharina title=Diagrams for perverse sheaves on isotropic Grassmannians and the supergroup , eprinttype = arxiv, eprint = arXiv:1306.4043v1 @book{simphomtheory}
- author=Goerss, Paul G., author=Jardine, John F., title=Simplicial Homotopy Theory, publisher=Modern Birkhäuser Classics, date=2009, Reprint of 1999 HatcherAllenAlgebraic topologyCambridge University Press2002@book{Hatcher, author = {Hatcher, Allen}, title = { Algebraic Topology}, publisher = {Cambridge University Press}, date = {2002}} @article{Jones}
- author=Jones, V. F. R., title=A polynomial invariant for knots via Von Neumann algebras, journal=Bull. Amer. Math. Soc., volume=12, number=1, date=1985, pages=103-111 @incollection{quantumsl}
- author=Kirillov, A. N., author=Reshetikhin, N. Yu., title=Representations of the algebra , -orthogonal polynomials and invariants of links, pages=285-339, booktitle=Infinite-dimensional Lie algebras and groups, editor=Kak, V. G. publisher=World Sci. Publ., year=1989, @article{KhovanovHomology}
- author=Khovanov, Mikhail, title=A categorification of the Jones polynomial, journal=Duke Math J., volume=101, number=3, date=2000, pages=359-426, eprinttype = arxiv, eprint = math.QA/9908171 KhovanovMikhailA functor-valued invariant of tanglesAlgebr. Geom. Topol.22002665–741@article{Khovanov, author = {Khovanov, Mikhail}, title = {A functor-valued invariant of tangles}, journal = {Algebr. Geom. Topol.}, volume = {2}, date = {2002}, pages = {665-741}} KhovanovMikhailCrossingless matchings and the cohomology of (n, n) springer varietiesCommun. Contemp. Math.642004561–577@article{HnCenter, author = {Khovanov, Mikhail}, title = {Crossingless matchings and the cohomology of (n, n) Springer varieties}, journal = {Commun. Contemp. Math.}, volume = {6}, number = {4}, date = {2004}, pages = {561-577}} @book{Cobordismes}
- author=Kock, J., title= Frobenius algebras and 2D topological quantum field theories, publisher=Cambridge University Press, date=2003, volume= No. 59 of LMSST @book{catalan}
- author=Koshy, title=Catalan numbers with applications, publisher=Oxford University Press, date=2009, @article{unknot}
- author=Kronheimer, P. B., author=Mrowka, T. S., title=Khovanov homology is an unknot-detector, journal=Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., volume=113, pages=97-208, date=2011, eprinttype = arxiv, eprint = math.QA/1005.4346 @article{spider2}
- author=Kuperberg, Greg, title=Spiders for rank 2 Lie algebras, journal=Comm. Math. Phys., volume=180, number = 1, pages=109-151, date=1996, eprinttype = arxiv, eprint = math.QA/9903003 LaudaAaron D.RussellHeather M.Oddification of the cohomology of type a springer varietiesInt. Math. Res. Not.1720144822–4854@article{OddSpringer, author = {Lauda, Aaron D.}, author = {Russell, Heather M.}, title = {Oddification of the Cohomology of Type A Springer Varieties}, journal = {Int. Math. Res. Not.}, volume = {17}, date = {2014}, pages = {4822-4854}} @book{may}
- author=May, Peter J., title=Simplicial Objects in Algebraic Topology, publisher=The University of Chicago Press, date=1967 OzsvathPeterRasmussenJacobSzaboZoltanOdd khovanov homologyAlg. Geom. Topol.13201331465–1488@article{OddKhovanov, author = {Ozsvath, Peter}, author = { Rasmussen, Jacob}, author = {Szabo, Zoltan}, title = {Odd Khovanov homology}, journal = {Alg. Geom. Topol.}, volume = {13}, date = {2013}, number = {3}, pages = {1465-1488}} PutyraKrzysztofCobordisms with chronologies and a generalisation of the khovanov complex2008Jagiellonian University@thesis{Putyra, author = {Putyra, Krzysztof}, title = {Cobordisms with chronologies and a generalisation of the Khovanov complex}, year = {2008}, school = {Jagiellonian University}} PutyraKrzysztofA 2-category of chronological cobordisms and odd khovanov homology2014Banach Center Publ.103291–355arxivmath.QA/1310.1895v2@article{Covering, author = {Putyra, Krzysztof}, title = {A 2-category of chronological cobordisms and odd Khovanov homology}, date = {2014}, journal = {Banach Center Publ.}, volume = {103}, pages = {291-355}, eprinttype = {arxiv}, eprint = {math.QA/1310.1895v2}} @article{preuveLemme}
- author=Russell, Heather M., title=A topological construction for all two-row Springer varieties, journal=Pacific J. Math., volume=253, number=1, date=2011, pages=221-255 @article{shumakovich}
- author=Shumakovitch, Alexander, title=Patterns in odd Khovanov homology, journal=J. Knot Theory Ramifications, volume=20, number=1, pages=203-222, date=2011, eprinttype = arxiv, eprint = arXiv:1101.5607 VaradarajanVeeravalli S.Supersymmetry for mathematicians: an introductionAmerican Mathematical Society Courant Lecture Notes in Mathematics 112004@book{superalgebra, author = {Varadarajan, Veeravalli S.}, title = { Supersymmetry for Mathematicians: An Introduction}, publisher = {American Mathematical Society}, series = { Courant Lecture Notes in Mathematics }, volume = {11}, date = {2004}} @book{introtohom}
- author=Weibel, Charles A., title=An introduction to homological algebra, publisher=Cambridge University Press, serie=Cambridge Studies in Advanced Mathematics, volume=38, date=1994 @article{wehrli}
- author=Wehrli, Stephan, title=Khovanov Homology and Conway Mutation, date=2003, eprinttype = arxiv, eprint = arXiv:0301312v1