![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x1.png)
Cette thèse a été financée par l’Ecole Normale Supérieure (2008-2009), puis une bourse AMN du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2009-2011). Lors de mes travaux, j’ai bénéficié du soutien financier de l’ANR GranMa (ANR-08-BLAN-0311-01), du CEA Saclay via l’IPhT, et de la fondation CFM pour la recherche.
Résumé
La géométrie complexe est un outil puissant pour étudier les systèmes intégrables classiques, la physique statistique sur réseau aléatoire, les problèmes de matrices aléatoires, la théorie topologique des cordes, … Tous ces problèmes ont en commun la présence de relations, appelées équations de boucle ou contraintes de Virasoro. Dans le cas le plus simple, leur solution complète a été trouvée récemment [EO07a], et se formule naturellement en termes de géométrie différentielle sur une surface de Riemann : la "courbe spectrale", qui dépend du problème. Cette thèse est une contribution au développement de ces techniques et de leurs applications.
Pour commencer, nous abordons les questions de développement asymptotique à tous les ordres lorsque , des intégrales dimensionnelles venant de la théorie des matrices aléatoires de taille , ou plus généralement des gaz de Coulomb. Nous expliquons comment établir, dans les modèles de matrice et dans un régime à une coupure, le développement asymptotique à tous les ordres en puissances de . Nous appliquons ces résultats à l’étude des grandes déviations du maximum des valeurs propres dans les modèles , et en déduisons de façon heuristique des informations sur l’asymptotique à tous les ordres de la loi de Tracy-Widom , pour tout . Ensuite, nous examinons le lien entre intégrabilité et équations de boucle. En corolaire, nous pouvons démontrer l’heuristique précédente concernant l’asymptotique de la loi de Tracy-Widom pour les matrices hermitiennes.
Nous terminons avec la résolution de problèmes combinatoires en toute topologie. En théorie topologique des cordes, une conjecture de Bouchard, Klemm, Mariño et Pasquetti [BKMP09] affirme que des séries génératrices bien choisies d’invariants de Gromov-Witten dans les espaces de Calabi-Yau toriques, sont solution d’équations de boucle. Nous l’avons démontré dans le cas le plus simple, où ces invariants coïncident avec les nombres de Hurwitz simples. Nous expliquons les progrès récents vers la conjecture générale, en relation avec nos travaux. En physique statistique sur réseau aléatoire, nous avons résolu le modèle trivalent sur réseau aléatoire introduit par Kostov, et expliquons la démarche à suivre pour résoudre des modèles plus généraux.
Tous ces travaux soulignent l’importance de certaines "intégrales de matrices généralisées" pour les applications futures. Nous indiquons quelques éléments appelant à une théorie générale, encore basée sur des "équations de boucles", pour les calculer.
Abstract
Complex analysis is a powerful tool to study classical integrable systems, statistical physics on the random lattice, random matrix theory, topological string theory, … All these topics share certain relations, called "loop equations" or "Virasoro constraints". In the simplest case, the complete solution of those equations was found recently [EO07a] : it can be expressed in the framework of differential geometry over a certain Riemann surface which depends on the problem : the "spectral curve". This thesis is a contribution to the development of these techniques, and to their applications.
First, we consider all order large asymptotics in some -dimensional integrals coming from random matrix theory, or more generally from "log gases" problems. We shall explain how to use loop equations to establish those asymptotics in matrix models within a one cut regime. This can be applied in the study of large fluctuations of the maximum eigenvalue in matrix models, and lead us to heuristic predictions about the asymptotics of Tracy-Widom law to all order, and for all . Second, we study the interplay between integrability and loop equations. As a corollary, we are able to prove the previous prediction about the asymptotics to all order of Tracy-Widom law for hermitian matrices.
We move on with the solution of some combinatorial problems in all topologies. In topological string theory, a conjecture from Bouchard, Klemm, Mariño and Pasquetti [BKMP09] states that certain generating series of Gromov-Witten invariants in toric Calabi-Yau threefolds, are solutions of loop equations. We have proved this conjecture in the simplest case, where those invariants coincide with the "simple Hurwitz numbers". We also explain recent progress towards the general conjecture, in relation with our work. In statistical physics on the random lattice, we have solved the trivalent model introduced by Kostov, and we explain the method to solve more general statistical models.
Throughout the thesis, the computation of some "generalized matrices integrals" appears to be increasingly important for future applications, and this appeals for a general theory of loop equations.
Merci …
Je voudrais remercier les nombreuses personnes qui m’ont poussé de quelque manière sur le plan scientifique. Pour commencer, l’ensemble des professeurs qui m’ont formé à l’École Normale Supérieure. Ensuite, Kay Wiese et Pierre le Doussal m’ont permis, en prolongement d’un stage expérimental de DEA, de participer à l’école d’été de Beg Rohu, où j’ai appris grâce aux cours de Patrik Ferrari et Satya Majumdar des rudiments de matrices aléatoires. Introduction très utile lorsque j’ai commencé ma thèse, deux mois plus tard.
Bertrand Eynard a été un directeur de thèse remarquable, par son enthousiasme à transmettre ses connaissances, son application à présenter ses idées de manière accessible, sa patience devant mes tentatives aléatoires. Grâce à sa culture mathématique et ses suggestions, j’ai compris quelques ficelles qui tiennent ensemble des problèmes très différents. Il a aussi été d’un grand soutien pendant la saison moins excitante de la chasse aux post-docs. Enfin, il a réuni toutes les conditions pour que j’assiste à des conférences, et que je commence à discuter avec d’autres scientifiques de nos sujets de recherches.
Je suis très reconnaissant à Boris Dubrovin et Tamara Grava de m’avoir accueilli à la SISSA pendant un mois. Ils se sont rendus très disponibles et j’ai beaucoup appris avec eux sur les systèmes intégrables. Si ce processus est loin d’être terminé, quelques discussions de base ont été très utiles lorsque j’ai commencé à travailler sur l’équation de Painlevé II. J’espère revenir un jour avec plus d’éléments pour répondre aux questions que nous avons laissé en suspens.
Je remercie Gabriel Lopes Cardoso à Lisbonne, Albrecht Klemm (dont j’ai suivi le cours de théorie topologique des cordes à l’IST) et Hartmut Monien à Bonn, Jan de Gier à Melbourne, pour leurs invitations et les discussions stimulantes qui y sont liées, ainsi que l’ensemble de mes collaborateurs. Enfin, je remercie Philippe Biane et Marcos Mariño d’avoir accepté de rapporter ce manuscrit. Je leur suis redevable, ainsi qu’à Pavel Bleher, d’y avoir apporté quelques corrections.
À l’IPhT, j’ai fréquemment dérangé pour de petites questions Michel Bauer, François David, Philippe di Francesco, Jérémie Bouttier, Emmanuel Guitter, Ivan Kostov, Stéphane Nonnenmacher, que je remercie pour leur accueil et leur réponses. Grâce aux remarques pointilleuses de Michel Bergère, j’ai souvent corrigé ma façon de présenter un problème pour atteindre plus de rigueur. Les échanges avec les autres (post)doctorants, notamment Olivier Marchal, Nicolas Orantin, Jean-Émile Bourgine, Jérôme Dubail, Nicolas Curien, ont été enrichissants, ainsi que les discussions avec Grégory Schehr, Satya Majumdar et Céline Nadal au LPTMS. Je souhaite aux futurs étudiants à l’IPhT de bénéficier encore des excellentes conditions de recherche qui y sont offertes aujourd’hui, et des interactions enrichissantes avec le plus grand nombre de chercheurs.
Les personnages de l’ombre ne sont pas oublié(e)s.
Avant-propos
Je voudrais pour excuser le volume de ce manuscrit, souligner son objectif pédagogique (qui sera ou non atteint suivant l’appréciation du lecteur). Plusieurs thèmes de la physique théorique sont abordés : géométrie complexe et algébrique, théorie des cordes, intégrabilité, physique statistique, combinatoire, … Chacun requiert un formalisme dont j’ai choisi de présenter quelques éléments, pour permettre une lecture sans consultation trop fréquente de la bibliographie. Après une introduction au domaine buissonnant des matrices aléatoires (chapitre I), le chapitre II présente les fils conducteurs de cette thèse : le formalisme de la récurrence topologique et les équations de boucles. Les autres chapitres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Les chapitres III et IV sont plutôt reliés à des questions d’intégrales convergentes de matrices (domaine des probabilités), tandis que les chapitres V et VI utilisent plutôt des intégrales formelles de matrices (domaine de la combinatoire). Un petit formulaire de modèles de matrices (§ I.13 et I.14) rassemble noms et notations.
Je présente ceux de mes travaux qui ont aboutis (les résultats sont synthétisés au § I.12), en essayant de les situer dans un contexte scientifique plus vaste. La plupart ont fait l’objet d’une publication sur l’arXiv. La construction d’un système intégrable dispersif à partir d’une courbe spectrale évoquée au § IV.4.2 fait exception : elle est basée sur un article en préparation avec Bertrand Eynard, mais nous butons encore sur une preuve technique. J’ai choisi d’en parler pour mieux situer le lien entre nos méthodes et les systèmes intégrables.
Dans le cours du texte se trouvent quelques résultats secondaires, qui ne sont pas encore apparus à ma connaissance dans la littérature :
-
La dérivation heuristique du développement asymptotique dans un régime à plusieurs coupures pour le modèle . C’est une généralisation évidente du cas hermitien () qui a été traité par [Eyn09].
-
Dans les modèles de boucles, le calcul des observables avec un nombre fini de changements de conditions de bords (Annexe B). C’est un résultat relativement simple, qui n’est pas encore assez etoffé pour être publié.
Dès que possible, j’ai cherché à simplifier les raisonnements de base qui se trouvent dans les articles ; j’espère que le manuscrit leur sera complémentaire. C’est le cas notamment au Chapitre V, où je donne une preuve plus élégante du lemme "une coupure" dans une large classe de modèles de boucles, inspirée par une discussion avec Jérémie Bouttier et Emmanuel Guitter.
| Chapitre I | Introduction |
|---|---|
| page I.1 | Les débuts |
| I.2 | Statistique des valeurs propres et polynômes orthogonaux |
| I.3 | Universalité locale |
| I.4 | Lois de matrices aléatoires dans la nature |
| I.5 | Surfaces discrètes |
| I.6 | Surfaces discrètes à la limite continue … |
| I.7 | …et intégrabilité |
| I.8 | Physique statistique |
| I.9 | Géométrie de l’espace des surfaces de Riemann … |
| I.10 | …et théorie des cordes |
| I.11 | Équations de boucles et géométrie |
| I.12 | Résultats obtenus |
| I.13 | Description des modèles de matrices étudiés |
| I.14 | Description des observables |
| Chapitre II | La récurrence topologique |
|---|---|
| II.1 | Les équations de Schwinger-Dyson |
| II.2 | Formalisme de la récurrence topologique |
| II.3 | Applications |
| II.4 | Généralisations |
| Chapitre III | Intégrales convergentes de matrices |
|---|---|
| III.1 | Asymptotique à |
| III.2 | Asymptotique en puissances de |
| III.3 | Asymptotique dans un régime à plusieurs coupures |
| III.4 | Statistique de |
| Chapitre IV | Systèmes intégrables et équations de boucles |
|---|---|
| IV.1 | Qu’est-ce qu’un système intégrable ? |
| IV.2 | Déformations isomonodromiques |
| IV.3 | Équations de boucles et conséquences |
| IV.4 | Construction d’un système intégrable à partir d’une courbe spectrale |
| IV.5 | Conclusion |
| Chapitre V | Intégrales formelles de matrices et combinatoire |
|---|---|
| V.1 | Intégrales formelles de matrices |
| V.2 | Les modèles de boucles |
| V.3 | Le modèle trivalent |
| Chapitre VI | Cordes topologiques et conjecture BKMP |
|---|---|
| VI.1 | Notions de théorie des cordes |
| VI.2 | Récurrence topologique et théorie topologique des cordes |
| VI.3 | Résultats récents |
| VI.4 | Perspectives |
| Chapitre VII | Conclusion |
|---|---|
| VII |
| Annexes | |
|---|---|
| A | Géométrie complexe sur les surfaces de Riemann compactes |
| B | Observables à bords non uniformes dans les modèles de boucles |
| C | Index |
| D | Liste d’articles et bibliographie |
Chapitre I Introduction
Au centre de cette thèse se trouvent des structures mathématiques dont l’étude a été motivée, ou encouragée, par la théorie des matrices aléatoires. Depuis les années 1950, plusieurs problèmes ont été reliés de manière inattendue, tant en physique qu’en mathématiques, à des questions de matrices aléatoires. Cette introduction résume la progression historique des idées, avec des raccourcis et des omissions qui reflètent mon point de vue. En particulier, je vais mettre de côté :
-
l’analyse statistique (intéressant pour certaines applications en biologie, sciences humaines, finance, …). Les premières matrices aléatoires ont été introduites à cet effet par Wishart [Wis28] en 1928.
-
l’emploi de modèles de matrices pour certains régimes de la chromodynamique quantique (cf. la revue d’Akemann [Ake07]).
La partie "physique" de cette introduction a été inspirée par la lecture de Mehta [Meh04] et de la revue de Guhr et al. [GMGW98].
I.1 Les débuts
L’histoire commence en physique nucléaire. Pour comprendre le déroulement de certaines réactions nucléaires, il faut pouvoir décrire comment un neutron projectile interagit avec un atome cible. Lorsque l’énergie cinétique du projectile est assez grande ( eV) et le noyau complexe, le neutron va typiquement interagir avec un grand nombre de nucléons à l’intérieur du noyau. Pour certains (les énergies de résonance), un état quasi lié avec le noyau pourra se former avec une grande durée de vie (par rapport à la durée de collision). Ce composé se désintégrera ensuite, avec plusieurs possibilités : fission du noyau, éjection d’un nucléon (radioactivité), … Les énergies de résonance et la durée de vie des états quasi liés sont des caractéristiques importantes. La complexité des interactions à l’intérieur du noyau rend la prédiction de ces paramètres difficile. Il y a de toute façon un grand nombre de résonances (leur espacement moyen est de quelques eV au début du spectre, et décroît exponentiellement avec l’énergie). Mais, dans une réaction nucléaire, la distribution en énergie des neutrons libres peut être large, donc ce sont les propriétés statistiques des et qui importent. Cette image était bien établie dans les années 1930.
Justement, devant la complexité des interactions, une tentative est de les considérer "typiques" dans un vaste ensemble de modèles d’interactions, donc d’utiliser les outils de la physique statistique. Wigner franchit ce pas en 1951 [Wig51], et propose comme modèle des propriétés statistiques des , celles des valeurs propres d’une grande matrice aléatoire avec entrées indépendantes. Le type de matrice (symétrique, hermitienne, …) à considérer, en l’absence d’autres informations, dépend seulement des symétries discrètes respectées par les interactions (invariance par renversement du temps, symétrie particule-trou, parité, …). Les matrices , où les entrées sont des variables aléatoires indépendantes, sont appelées matrices de Wigner. Les valeurs propres d’une matrice de Wigner sont des variables aléatoires corrélées, qui ont tendance à se repousser. Plus précisément, Wigner conjecture que la distribution des espacements est bien reproduite par la distribution des espacements , modulo un changement d’échelle tenant compte de la densité locale des . Il calcule cette distribution pour une matrice aléatoire symétrique de taille , dont les entrées ont une distribution gaussienne :
| (I-1) |
et cette distribution est proche numériquement de celle obtenue dans une matrice de taille infinie .
Vers 1960, cette estimée de Wigner a été comparée avec succès aux données de la physique nucléaire [PR60] (cf. Fig I.3). Naturellement, une matrice avec des entrées gaussiennes indépendantes ne modélise pas sérieusement le hamiltonien d’interaction d’un système quantique à corps () gouvernant la dynamique à l’intérieur du noyau. De plus, la présence de règles de sélection suggère que la matrice représentant a, dans une base adaptée, beaucoup de zéros. En ce sens, il n’est pas facile d’envisager un modèle de matrice aléatoire réaliste. Cependant, les simulations numériques ont rapidement montré que dépendait peu des détails de la distribution des . Les physiciens espéraient donc que la statistique des valeurs propres de grandes matrices aléatoires présenterait des caractéristiques assez universelles, qui se manifesteraient dans les spectres des systèmes complexes.
I.2 Statistique des valeurs propres et polynômes orthogonaux
Dans la perspective d’une comparaison plus complète aux données spectroscopiques, un premier enjeu a été de calculer analytiquement la statistique des valeurs propres, dans divers modèles de matrices (pas nécessairement de Wigner).
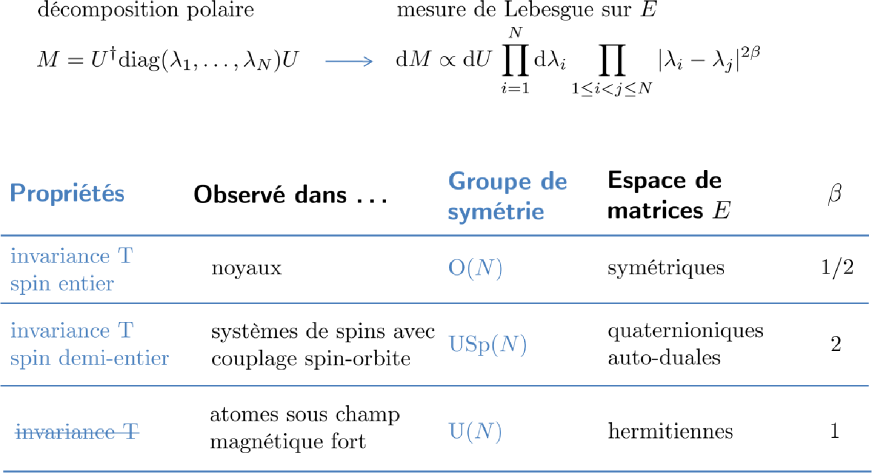
Les modèles de matrices hermitiennes sont les plus simples à analyser. La mesure de probabilité invariante sous le groupe unitaire la plus générale s’écrit :
où assure la normalisation . Quand on ne s’intéresse qu’à la statistique des valeurs propres de , on peut utiliser la décomposition polaire pour faire le changement de variable où . Le résultat est donné en Fig. I.1, le jacobien du changement de variable est un déterminant de Vandermonde à la puissance . La question est alors de déterminer les corrélations de densité entre valeurs propres :
en particulier dans la limite . Une autre quantité intéressante est la fonction de partition :
Lorsque la mesure de probabilité est de la forme111 est la taille des matrices, et sa présence dans l’exposant est un choix de normalisation. , ou après intégration sur la partie angulaire :
| (I-2) |
Mehta et Gaudin [Meh60, MG60] ont découvert que les pouvaient se calculer en introduisant une famille de polynômes orthogonaux :
| (I-3) |
En normalisant , ils écrivent le déterminant de Vandermonde :
Après une algèbre élémentaire sur les déterminants, et en utilisant l’orthogonalité (Éqn. I-3), ils trouvent :
| (I-4) |
avec le noyau de Christoffel-Darboux :
Pour la fonction de partition, ils retrouvent une formule classique reliant déterminants de Hankel et normes des polynômes orthogonaux :
| (I-5) | |||||
Beaucoup d’autres données statistiques, comme la distribution de la plus grande valeur propre (cf. III.4.2), de la plus grande valeur propre, d’espacements entre valeurs propres consécutives,… s’extraient à partir du noyau . Une stratégie analogue peut être appliquée dans les modèles de matrices invariants sous () ou (), toujours pour une mesure du type .
Il y a donc un lien profond entre matrices aléatoires et théorie des polynômes orthogonaux, à double sens. D’une part, à la suite de Gaudin et Metha, nombre de résultats exacts ( fini) et asymptotiques () ont été établis sur la statistique des valeurs propres dans les modèles de matrices hermitiennes, notamment ceux associés aux polynômes orthogonaux classiques (Hermite, Laguerre, Jacobi, …). D’autre part, déterminer les propriétés des polynômes orthogonaux (équivalent asymptotique, distribution asymptotique des zéros, …) est équivalent au calcul d’intégrales de matrices dans la limite des grandes tailles. Ce renversement de point de vue a été très fructueux pour les mathématiques.
I.3 Universalité locale
Dans ce paragraphe, la limite grand sera sous-entendue. Pour des assez réguliers et croissants à l’infini, les suivant Éqn. I-2 se situent avec probabilité dans une certaine réunion de segments . La densité de valeurs propres sur dépend des détails de . Un voisinage borné d’un point dans le milieu du spectre, contient une fraction macroscopique des valeurs propres. Donc, la distance typique entre deux valeurs propres autour de est d’ordre . À cette échelle, on peut montrer que les corrélations de densité () sont universelles222On sous-entend que la convergence a lieu pour une topologie faible, i.e. au sens des distributions.. Modulo renormalisation par la densité locale de valeurs propres , elles sont données par des formules déterminantales (Éqn. I-4) avec un noyau en sinus :
où :
On parle d’universalité locale au milieu du spectre (Fig. I.2).
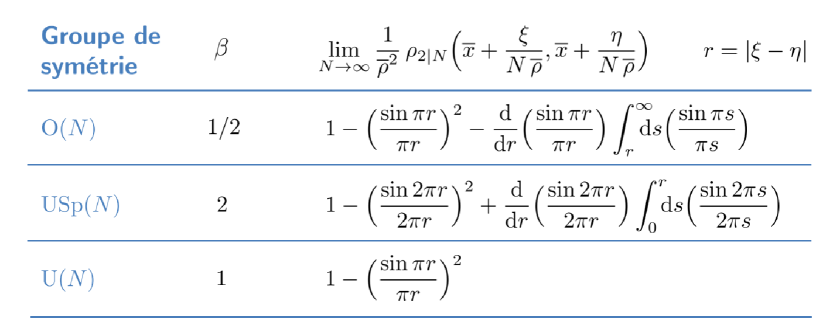
En probabilités, l’émergence du théorème central limite pour les sommes de variables aléatoires indépendantes est bien comprise, ainsi que ses hypothèses minimales. En théorie des matrices aléatoires, ce programme n’est pas encore complété. Des simulations numériques ont confirmé le vaste domaine de validité des propriétés d’universalité (cf. partie I.8), bien au-delà des modèles solubles comme celui de l’Éqn. I-2. Depuis 10 ans, des progrès importants ont été faits, auxquels sont associés les noms de K. Johansson, A. Soshnikov,… puis L. Erdös, J. Ramírez, B. Schlein, H.-T. Yau, et T. Tao et V. Vu. Tao et Vu ont notamment démontré [TV09] l’universalité locale au milieu du spectre pour les matrices de Wigner hermitiennes, sous une hypothèse sur les trois premiers moments des entrées.
I.4 Lois de matrices aléatoires dans la nature
Ces résultats cautionnent la comparaison entre données expérimentales et numériques d’une part, et statistique des valeurs propres de matrices aléatoires. Des caractéristiques de la statistique EGO ou EGU (suivant les symétries du problème) ont été observées dans des systèmes très divers. Nous avons évoqué les spectres nucléaires des noyaux lourds , où la statistique EGO a été mise en évidence. Citons encore le spectre de l’atome hydrogène placé dans un champ magnétique fort (où l’on trouve sous certaines conditions une statistique EGO), ou bien les niveaux d’énergie d’une cavité conductrice, où les électrons évoluent en régime balistique (où l’on peut trouver une statistique EGO, EGU, ou d’autres classes de symétrie). Dans ces systèmes physiques, l’universalité locale des corrélations est souvent bien vérifiée, jusqu’à un certain espacement (notation de la Fig. I.2) entre niveaux d’énergies. Au-delà de la phénoménologie, on ne comprend pas toujours pourquoi les lois de matrices aléatoires apparaissent dans toutes ces situations. Depuis 1960, il y a eu un important travail de documentation de l’apparition de ces lois en physique, qui a inspiré des conjectures, à leur tour appelant de nouveaux tests et la découverte de nouveaux phénomènes. Des connections inattendues ont été établies avec les systèmes dynamiques et la théorie des nombres.
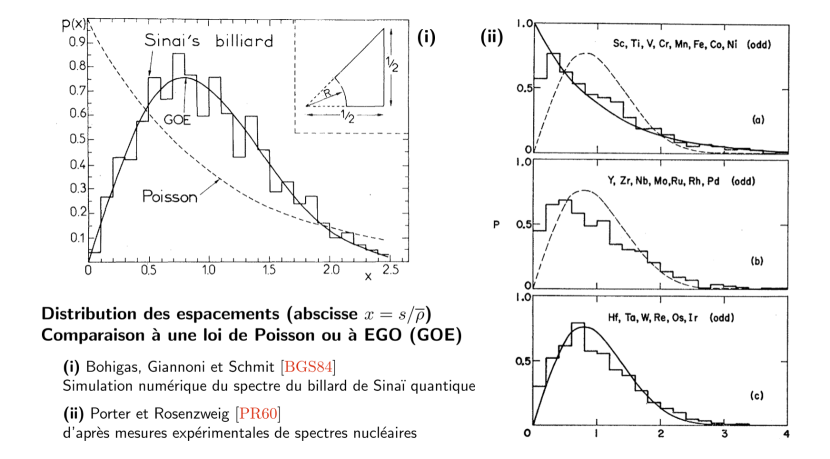
Le comportement des électrons balistiques dans une cavité est la version quantique d’un problème de trajectoires dans un billard. Il faut trouver les valeurs propres et vecteurs propres d’un hamiltonien dans un domaine de (dans les exemples suivants, ). Certains systèmes sont intégrables (par exemple, si est un disque ou un rectangle), d’autres sont chaotiques (c’est le cas générique). Dans le cas intégrable, la géométrie des est assez régulière et la répartition des est assez bien comprise. Dans le cas chaotique, les simulations numériques indiquent que la statistique des est compatible avec EGO et l’estimée de Wigner Éqn. I-1. Citons notamment les simulations de [MK79] lorsque est un stade, et de [BGS84] lorsque est un billard de Sinaï, (Fig. I.3). Bohigas, Giannoni et Schmit ont conjecturé un phénomène général :
Conjecture I.1.
Si le problème classique est un système "assez chaotique333Bohigas et al. prennent ”K-système” comme hypothèse.", la statistique locale des est génériquement444Merci à S. Nonnenmacher pour cette précision. La condition de généricité ne figure pas dans [BGS84], mais on sait maintenant qu’elle est nécessaire. celle de EGO ou EGU (suivant le respect ou non de l’invariance par renversement du temps).
Cette conjecture (ainsi qu’une formulation précise des hypothèses nécessaires) reste une question ouverte. Toutefois, il existe aussi une zoologie de systèmes dynamiques présentant un comportement intermédiaire entre intégrabilité et chaos, où l’on observe (le plus souvent empiriquement) une répulsion des mais pas de loi connue venant des matrices aléatoires.
En théorie des nombres, la position des zéros de la fonction de Riemann (le prolongement analytique à de défini pour ) a des conséquences importantes sur l’arithmétique dans , et en particulier la distribution des nombres premiers. L’hypothèse de Riemann (datant de 1859, notée HR) affirme qu’hormis les entiers négatifs pairs, les zéros sont de la forme . On sait d’après Hardy [Har14] qu’il existe une infinité de zéros de ce type, et il est bien connu que implique , ce qui permet de conserver seulement les et de les lister par ordre croissant. Plusieurs théorèmes existent sur leur distribution. Montgomery a formulé [Mon73] la conjecture suivante, qu’il a démontré ensuite pour une classe restreinte de fonctions test en supposant HR :
Conjecture I.2.
On note . Pour une classe assez large de fonctions test :
où l’on reconnait la fonction de corrélation entre deux valeurs propres de EGU.
Cette conjecture est supportée par les calculs numériques d’Odlyzko [Odl87] (cf. Fig. I.4). Elle en a inspiré beaucoup d’autres [KS99, KS00] concernant et d’autres fonctions , confirmées par les simulations numériques existantes. Il semble donc, sans compréhension sous-jacente, que l’on puisse importer pour la théorie des nombres certains calculs de la théorie des matrices aléatoires.
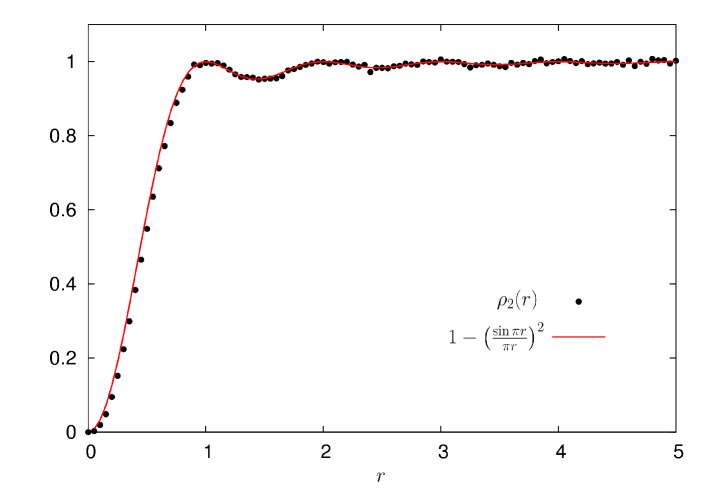
I.5 Surfaces discrètes
Une deuxième vague d’intérêt pour les matrices aléatoires est née en théorie des champs. Dans ce contexte, on a une grandeur (qui peut ou non avoir un sens physique), à laquelle on associe un poids , et les observables physiques à calculer sont les moyennes statistiques :
| (I-6) |
L’espace des configurations possibles est de "très grande dimension finie" (pour ne pas dire infini en théorie des champs) et on note la mesure d’intégration. On sait bien calculer ces sommes lorsque est quadratique, c’est le théorème de Wick. En général, on peut essayer de se ramener au cas quadratique en étudiant un modèle plus simple que l’Éqn. I-6. On se place au voisinage d’un minimum de , que l’on décompose en partie quadratique + le reste : . On définit , la valeur moyenne pour le poids . Puis, on définit le modèle statistique "perturbatif" en développant en série de Taylor par rapport au ’reste’ et en échangeant cette série avec .
| (I-7) | |||||
| (I-8) |
et sont définies comme des séries formelles dans les . L’application du théorème de Wick et d’une combinatoire élémentaire permet d’organiser Éqns. I-7-I-8 comme séries génératrices de graphes. À chaque ordre en , il n’y a qu’un nombre fini de graphes à considérer, et ils sont comptés avec un certain poids , modulo ré-étiquetage des sommets et des arêtes. Si l’on écrit , alors est la même somme restreinte aux graphes connexes, et est une somme sur des graphes avec sommets marqués.
En chromodynamique quantique (CQD), est une matrice de fonctions définies sur l’espace-temps (quand , c’est la théorie des interactions fortes), et est une action contenant des termes de degré , et . t’Hooft observe en 1974 [t’H74] que le poids d’un graphe est proportionnel à , où est la caractéristique d’Euler de . Généralement en théorie des champs et en CQD, faire la somme sur les graphes est difficile, et le nombre de graphes croît exponentiellement avec l’ordre où l’on se place.
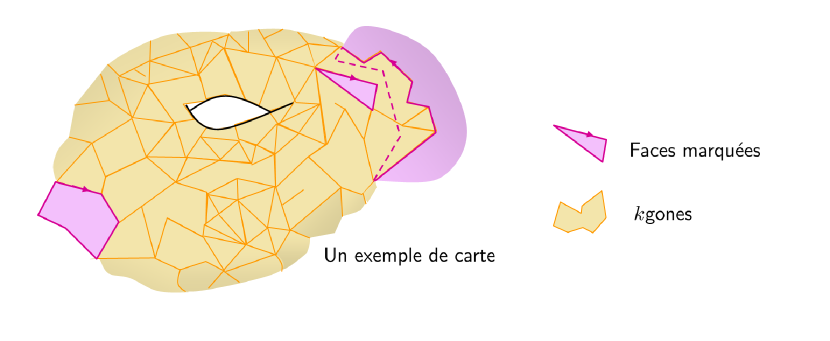
Mais inversement, on peut obtenir des résultats combinatoires sur les graphes à partir d’une théorie perturbative des champs. Cette idée a été exploitée astucieusement en 1978 par Brézin, Itzykson, Parisi et Zuber [BIPZ78], avec le modèle très simple où est une matrice hermitienne de taille , et :
| (I-9) |
i.e. un modèle à une matrice aléatoire. Les graphes à considérer sont alors en bijection avec des surfaces discrètes (cf. Fig. I.5), que l’on appelle également cartes. Quand est constituée de faces gonales, elle est comptée avec le poids . Dans la limite ne survivent que les graphes planaires (les surfaces "sans trous"), et on peut calculer leur nombre, par exemple à fixé. Le résultat de cette énumération avait été établi par Tutte dans les années 60 [Tut62, Tut63] par des méthodes combinatoires, et il est ainsi retrouvé par des techniques de matrices aléatoires (sans faire de combinatoire). J’exposerai cette méthode au chapitre V, et son application à la combinatoire de surfaces discrètes décorées.
De nombreux résultats nouveaux pour la combinatoire ont été obtenus à la suite de [BIPZ78], en particulier sur les surfaces discrètes de genre plus grand ("avec des anses"). Plus récemment, grâce à des bijections inventées par Schaeffer pour les cartes planaires, et généralisées aux genres par Bouttier et Guitter, certains de ces résultats ont été retrouvés par la combinatoire. Je précise toutefois (cf. chapitre V) que les modèles de matrices ne donnent pas pour les cartes aléatoires toutes les informations (notamment, métriques et microscopiques) qui intéresseraient les probabilistes et les combinatoristes.
En relation avec la théorie des champs, l’activité de recherche autour des matrices aléatoires a été renouvelée. Des liens profonds ont été établis avec les systèmes intégrables classiques, domaine florissant depuis les découvertes de l’école russe (Dubrovin, Its, Krichever, Matveev, Novikov, …) au milieu des années 1970 [Mat08]. Ces connections ont suscité l’intérêt de nombreux mathématiciens pour les matrices aléatoires depuis le tournant des années 1990, conduisant à la preuve (et parfois à la correction) de résultats connus des physiciens théoriciens, et à de nouvelles mathématiques. Les chapitres III et IV s’inscrivent dans cette direction. Dans les deux paragraphes qui suivent, je retrace le mouvement des années 1980, où des problèmes de comptage de surfaces, de solutions d’équations différentielles "intégrables", de gravité quantique à deux dimensions ont été simultanément étudiés.
I.6 Surfaces discrètes à la limite continue …
Reprenons le modèle statistique de surfaces discrètes généré par Éqn. I-9. Si l’on appelle , la série génératrice des cartes connexes de genre , on a une égalité entre séries formelles555À fixé, la somme dans le membre de droite est finie. :
| (I-10) |
Le nombre asymptotique de cartes, lorsque , est encodé dans les singularités de . En effet666Il existe un résultat incluant les singularités/asymptotiques logarithmiques. Dans l’Éqn. I-11, est vrai à condition que la série s’étende en une fonction analytique sur un domaine , privé d’un secteur d’angle autour de [FS09]. Dans la discussion qui suit, je vais mettre de côté des subtilités importantes liées à la structure des singularités de . :
| (I-11) |
On peut étudier cette asymptotique dans plusieurs régimes, où l’on privilégie certaines espèces de polygones par rapport à d’autres : on ajuste simultanément vers une singularité . On parle de point critique lorsque , et de point multicritique quand . Si mesure une distance au point critique, il est possible de montrer :
| (I-12) |
avec un exposant777Par convention, . fixé par le régime asymptotique choisi. ne dépend plus des paramètres non ajustés. En ce sens, les sont universels.
Si l’on fixe fini, on peut remarquer que chaque terme dans l’Éqn. I-10 contribue en . Pour approcher un point multicritique, il faut aussi garder certaines variables finies (). On devine :
Proposition I.1.
(Heuristique). Il existe une double limite d’échelle :
| (I-13) |
On attend aussi que la fonction se recolle bien avec l’Éqn I-10 et l’Éqn. I-12 lorsqu’on est assez loin de la singularité :
Proposition I.2.
(Heuristique). est une série asymptotique888Valable seulement dans un certain secteur angulaire autour de . de lorsque .
Dans le modèle de matrice associé à l’Éqn. I-9, l’approche d’un point critique correspond à un changement de comportement de la densité de valeurs propres. Génériquement, près d’un bord du spectre. Lorsque tandis que les autres sont génériques, non critiques, il existe un bord où l’on a plutôt . En fait, avec des modèles de matrices plus compliqués, comptant des cartes "décorées" (comme le modèle étudié au chapitre V), on peut atteindre n’importe quel comportement (). Typiquement, on trouve un nombre fini de valeurs propres autour de si l’on regarde dans un voisinage de diamètre . À cette échelle, les corrélations de valeurs propres deviennent universelles (ne dépendent pas des paramètres non ajustés). Le cas a reçu beaucoup d’attention. Les corrélations de valeurs propres et les dans ce cas peuvent être extraits d’un noyau intégrable universel, . Il est justifié de parler de classe d’universalité, que l’on appelle classe (cf. § IV.1.2).
Les cartes avec un grand nombre de polygones, d’un point de vue macroscopique, sont des approximations de surface continues. La théorie des champs où l’on somme sur toutes les surfaces possibles (que l’on interprète comme des espaces-temps fluctuants) capture la notion de "gravité quantique à deux dimensions" (GQ2d). Les physiciens ont donc proposé (Prop. I.1) comme une définition de la fonction de partition de GQ2d. Cette définition est non perturbative, car en général la série asymptotique dans Prop. I.2 ne suffit pas pour connaitre . J’insiste sur le fait que n’est pas une intégrale de matrice, mais une limite d’intégrale de matrice. Pour des valeurs génériques (assez petites) des , lorsque , on tombe dans la classe d’universalité , et l’on parle de "gravité pure". On peut aussi l’atteindre avec des triangulations : et autres (assez petits) génériques. En cas d’ajustements simultanés, plusieurs types de polygones sont en compétition, et l’on peut atteindre les classes d’universalité .
I.7 …et intégrabilité
Les polynômes orthogonaux du modèle à une matrice satisfont une récurrence (d’ordre ) et une équation différentielle (d’ordre ) :
| (I-14) | |||
| (I-19) |
où est une matrice de polynômes en , de degrés lorsque pour tout . Si l’on étudie la dépendance des dans les paramètres , on trouve aussi des équations différentielles d’ordre :
| (I-20) |
où est une matrice de polynômes en , de degrés . Les sont donc solutions de systèmes compatibles d’équations différentielles (et/ou de récurrences). Cette propriété définit999Il y a plusieurs définitions de l’intégrabilité, dont l’équivalence n’est pas toujours établie. Nous adopterons celle-ci, attribuée à Krichever. un système intégrable. En l’occurence, le système (S : Éqns. I-14-I-19-I-20), est équivalent à un système intégrable appelé "chaine de Toda". Les équations de compatibilité de (S), avec les conditions initiales, déterminent les et , donc la fonction de partition (Éqn. I-5).
Dans la limite continue , les équations discrètes deviennent des équations différentielles dans le paramètre . Dans cette limite, on peut chercher des solutions autosimilaires de (S), c’est-à-dire des solutions régulières dans la limite ne dépendant que de variables d’échelle comme , et défini par :
On obtient [GM90] alors des équations différentielles non linéaires transcendantes remarquables (on les note (P)), qui appartiennent à la hiérarchie de Painlevé. Des travaux comme [FIK92] justifient mathématiquement que les limites des et tendent vers des fonctions régulières et déterminées par une certaine solution de (P). Ils démontrent ainsi l’existence de la double limite d’échelle (Prop. I.1), et caractérisent comme solution de (P). Par exemple, pour le point critique associé à la gravité pure, il existe une variable d’échelle, notée , de sorte que soit solution101010Il y a des subtilités importantes sur les ”conditions initiales” à ajouter pour spécifier de manière unique la solution intéressante pour la physique. de l’équation de Painlevé I :
Toute une technologie a été développée par Bleher, Its, Deift, Venakides, Zhou et leurs successeurs, pour étudier rigoureusement la double limite d’échelle. Ces méthodes exploitent la structure intégrable du modèle de départ. Sans entrer dans les détails, on peut dire que le modèle à une matrice hermitienne et les polynômes orthogonaux sont aujourd’hui bien compris [DKM+97, DKM+99b, DKM+99a, BM09b, Ber07]. En revanche, l’étude des autres classes de symétrie (), ou des chaines de matrices hermitiennes (reliées aux polynômes biorthogonaux), est encore largement ouverte.
I.8 Physique statistique
En physique statistique hors équilibre, on rencontre assez fréquemment des processus déterminantaux, i.e. dont la loi jointe à variables est du type Éqn. I-4 :
pour un certain noyau . Leur intérêt vient d’un résultat combinatoire de Karlin-McGregor [KM59] : dans un modèle de chemins aléatoires avec poids locaux, si l’on note la probabilité d’un chemin de à , est la probabilité d’observer chemins reliant à sans s’intersecter. Des processus déterminantaux interviennent donc dans les modèles de marches aléatoires sans intersection (MAsI), dans les modèles d’exclusion à dimension, et tous leurs avatars.
Dans les MAsI (cf. Fig. I.6), on peut faire correspondre la position à la ème valeur propre d’une matrice , et écrire un modèle de matrices hermitiennes encodant la dynamique des . Lorsque , en invoquant l’universalité locale, les corrélations locales entre les marcheurs "du milieu" sont décrites par le noyau sinus. Autour de marcheurs extrêmes, on doit trouver la classe d’universalité , valable génériquement au bord du spectre d’une matrice aléatoire, et décrite par le noyau d’Airy. On peut inventer des modèles où l’enveloppe des positions des marcheurs a une forme plus compliquée. Chaque type de géométrie locale pour correspond à une classe d’universalité, qui décrit au voisinage de ce point les corrélations des valeurs propres/des positions des marcheurs.
D’un point de vue fondamental, de nombreux modèles de partition aléatoire (empilement de carrés) ou de partition plane aléatoire (empilement de cubes, cf. Fig. I.6) peuvent se représenter comme des intégrales multidimensionnelles qui sont des modèles de matrices hermitiennes. On verra une application de cette technique avec le calcul des nombres de Hurwitz au chapitre VI. Ces problèmes de partitions sont duaux à des modèles de permutations aléatoires, de pavages aléatoires, de dimères, de particules en interactions, d’où l’ubiquité des lois de matrices aléatoires hermitiennes en physique statistique. Quelques exemples de classes d’universalité sont donnés en Fig. I.7.
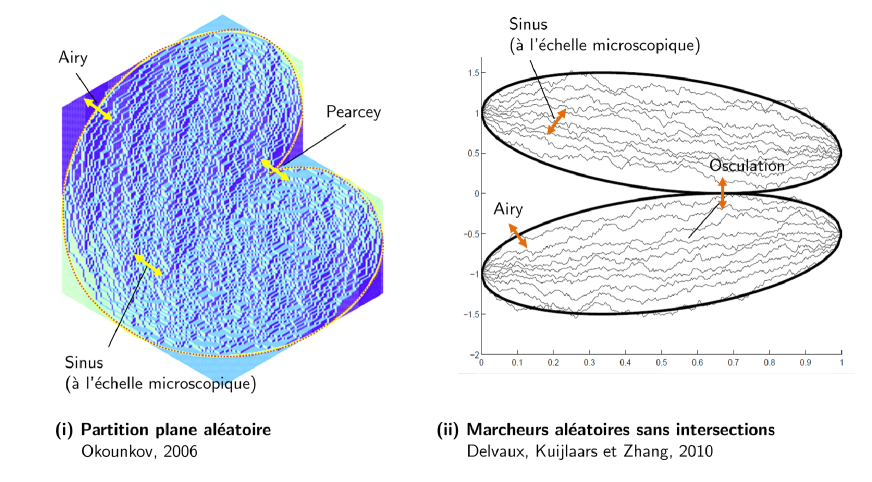
L’étude rigoureuse et la classification de ces classes d’universalité (souvent anticipée par les physiciens) a beaucoup progressé ces vingt dernières années, et a servi la physique statistique. Dans un modèle donné, cela revient à prouver l’existence d’une double limite d’échelle. Lorsque a une représentation assez explicite, des méthodes élémentaires suffisent. En général, la méthode developpée par Bleher-Its et Deift-Zhou a longtemps été le seul angle d’attaque. Parmi les derniers résultats obtenus par cette méthode, mentionnons la détermination d’une classe d’universalité associée à une singularité de type "osculation" [AFvM10, DKZ10]. Le chapitre IV peut être interprété comme une autre approche rigoureuse de l’idée (géométrie locale) (classe d’universalité associée à un système intégrable), basée sur la "récurrence topologique" introduite au chapitre II. Cela est illustré en particulier à la page IV.3.4.
Enfin, il y a d’autres modèles comme les processus d’exclusion (TASEP, ASEP), des modèles de croissance d’interfaces [SS10] ou de cristaux, … où l’on observe des lois de matrices aléatoires (diverses, pas nécessairement hermitiennes) mais le lien est plus fragile. On y trouve aussi des déformations de processus déterminantaux, des transitions entre lois de matrices aléatoires et d’autres classes d’universalité, … dont les structures mathématiques restent à élucider.
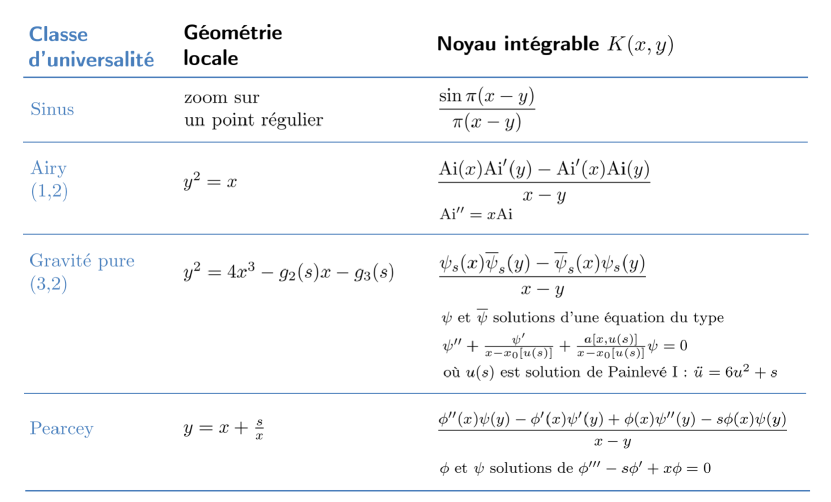
I.9 Géométrie de l’espace des surfaces de Riemann …
Enfin, je vais parler des développements des techniques évoquées en partie I.5, pour la combinatoire des surfaces de Riemann.
Une surface de Riemann est une surface (un objet de dimension ) lisse, orientable et connexe. À déformation continue près, les surfaces de Riemann compactes sont classifiées par leur genre , i.e. leur nombre d’anses (Fig. I.8).
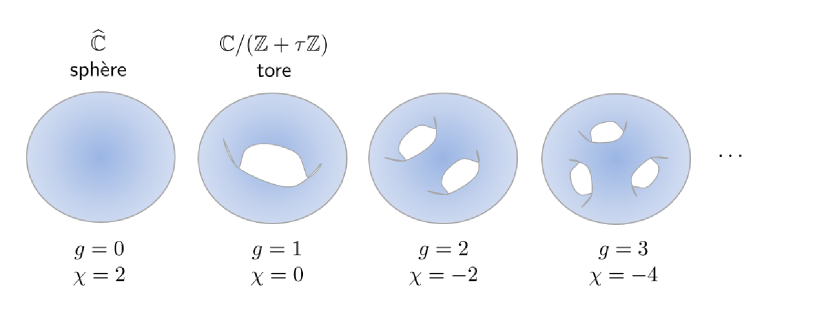
Mais on peut aussi faire de la géométrie complexe sur , auquel cas on s’intéresse à à bijection holomorphe près. On utilise parfois le mot conforme comme synonyme d’holomorphe. L’ensemble des classes d’équivalence conforme de surfaces de Riemann de genre , avec points marqués, est noté . Plusieurs bijections ont été inventées pour décrire l’espace , et je présente en Fig. I.9 la décomposition utilisant la théorie de Strebel pour en donner une image intuitive :
est donc un espace stratifié. Les strates sont localement modelées sur un espace quotienté par un groupe discret (on parle d’orbivariété), et ont pour dimension maximale :
La limite d’une famille de surfaces de Riemann lisses n’est pas forcément un objet lisse. Par exemple, on peut pincer une surface en plusieurs points. Donc n’est pas compact, mais on peut lui ajouter des surfaces pincées pour obtenir un espace compact (c’est la compactification de Deligne-Mumford). On peut alors donner un sens111111Les difficultés techniques sont cachées dans la construction des contre lesquels on veut intégrer. à et ainsi "compter des surfaces continues". Des facteurs de symétrie sont naturellement inclus car est une orbivariété.
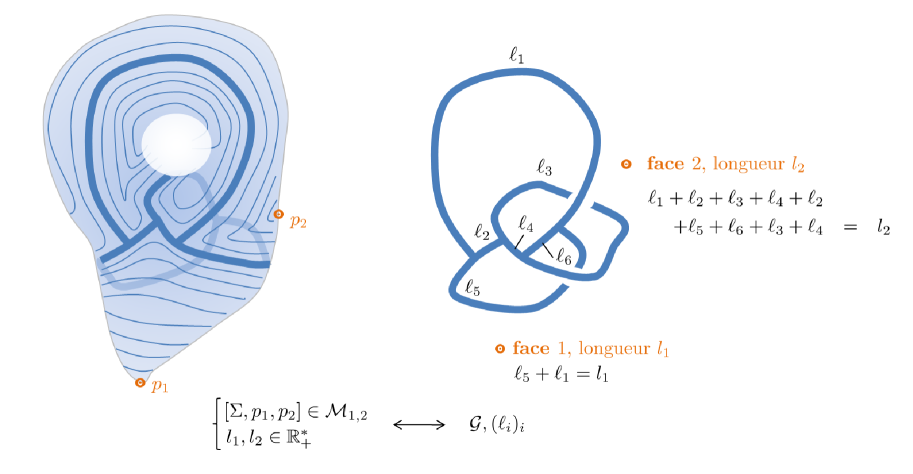
Ces décompositions peuvent être utilisées en principe pour ramener un problème de "comptage de surfaces continues" à un problème de combinatoire de graphes. Associée à des calculs de matrices aléatoires, cette stratégie a produit des théorèmes nouveaux en géométrie algébrique. En 1986, dans un article fondateur, Harer et Zagier [HZ86] ont calculé entre autres la caractéristique d’Euler de en étudiant les moments dans l’intégrale à une matrice hermitienne avec un poids gaussien (cf. partie I.5) :
Quelques années plus tard, partant des mêmes idées, Kontsevich a prouvé un résultat remarquable, conjecturé par Witten, conduisant à un calcul effectif de la théorie de l’intersection dans . Je dois expliquer quelques notions avant de l’énoncer.
Un enjeu en géométrie algébrique est de comprendre la géométrie d’un espace comme , i.e. comment s’intersectent des sous-espaces de . Pour , c’est très simple : on a des courbes et des points , avec les règles , et génériquement , . Il y a aussi des formules intégrales pour le nombre d’intersections de deux courbes et . Pour qui est une orbivariété stratifiée, la théorie de l’intersection est plus compliquée. Il faut d’abord définir les objets naturels (les "classes") à intersecter. Dans cette thèse (chapitre VI), nous rencontrerons les classes et les classes construites par Mumford [Mum83]. Informellement, une classe se comporte comme l’élément d’aire de la surface de engendrée en déplaçant le point sur . En particulier, les nombres d’intersections :
| (I-21) |
peuvent être définis mathématiquement et sont non nuls lorsque . Quant aux classes , elles se comportent plutôt comme des éléments de volume -dimensionnels. Par construction, intervient lorsque l’on veut déjà intégrer sur un point dans l’Éqn. I-21 :
Kontsevich [Kon92] a démontré en construisant un modèle de matrice adéquat :
Theorème I.1.
La série formelle :
est le logarithme d’une fonction tau121212La notion de fonction tau pour un système intégrable sera introduite au chapitre IV. Disons seulement qu’une fonction tau satisfait certaines équations différentielles non linéaires. de la hiérarchie intégrable KdV, pour les temps . En particulier, satisfait l’équation de Korteweg-de Vries :
On utilise la notation .
Comme les classes encodent des familles de surfaces avec des points marqués fluctuants, on a appelé la fonction de partition de la gravité topologique à deux dimensions. En fait, les de la gravité quantique (Éqn. I-13) sont des spécialisations de à pour .
I.10 …et théorie des cordes
Plus généralement, l’étude des familles de surfaces (modulo reparamétrage conforme) plongées dans un espace cible , s’est considérablement développée depuis les années 90, avec des travaux de Kontsevich et bien d’autres. Il s’agit là encore de comprendre la théorie de l’intersection, de résoudre des problèmes d’énumération de configurations géométriques dans un "espace ". On souhaite aussi définir des invariants, calculables de façon algorithmique à partir de la définition de , peut-être applicables pour mieux distinguer (voire classifier) des objets . Comprendre permet de mieux comprendre la géométrie de l’espace .
En fait, explorer l’ensemble des surfaces plongées dans , les compter avec certains poids (au sens de Éqn. I-6), est exactement ce que l’on entend par une théorie des cordes dans . On parle de théorie des cordes topologiques lorsque les observables ne dépendent que de données topologiques de : le genre , le nombre de bords/points marqués , leurs nombres d’enroulements sur certains sous-espaces de , … Ces observables, lorsqu’elles sont proprement définies, sont des séries génératrices d’invariants géométriques de . On a vu un exemple au Théorème I.1 avec , la série génératrice des nombres d’intersections dans .
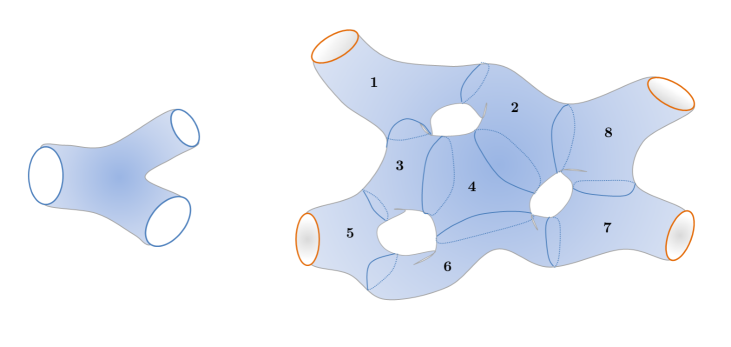
Cette présentation informelle cache des aspects mathématiques non triviaux pour définir proprement et des classes sur lesquelles on peut intégrer. Lorsque est une variété complexe lisse et compacte, Li et Tian [LT98] ont ainsi construit131313 n’est pas un ensemble, mais plutôt une pile, en utilisant le langage des catégories. et une bonne classe de comptage : les nombres ont un sens, et sont des invariants géométriques de . Ce sont les invariants de Gromov-Witten, dont nous reparlerons au chapitre VI. Ils comptent le nombre de façons inéquivalentes de plonger dans . Ces travaux ont été progressivement généralisés à des moins sympathiques.
Cette construction ne donne pas de règle pour obtenir ces invariants de Gromov-Witten. Depuis leur invention, des progrès importants ont été réalisés pour les calculer effectivement dans des espaces particuliers, grâce aux échanges féconds entre théoriciens des cordes et mathématiciens. Notamment, lorsque l’espace possède assez de symétries, l’intégrale sur peut être exactement localisée, et devient une somme discrète sur certaines configurations géométriques (appelées instantons). Derrière ces problèmes de "géométrie énumérative", on retrouve des systèmes intégrables, des calculs d’intégrales sur , des sommes sur des partitions ou des partitions planes … et in fine, les structures mathématiques qui apparaissent dans les modèles de matrices, si ce n’est directement les modèles de matrices.
I.11 Équations de boucles et géométrie
Au cours de cette thèse, nous allons voir que ces structures mathématiques gravitent toutes autour des équations de boucles, ou de la hiérarchie des équations de boucles, introduites au § II.2.7. Les observables des modèles de matrices, les séries génératrices de cartes, les séries génératrices de nombres d’intersections sont (ou peuvent être extraites) des solutions de ces équations. Mon directeur de thèse Bertrand Eynard a déterminé en 2004 [Eyn04] la solution générale de la hiérarchie d’équations de boucles, en étendant et reformulant la méthode des moments initiée par Ambjørn et Makeenko en 1990 [AM90]. Ces solutions dérivent d’un formalisme uniquement basé sur de la géométrie complexe, que l’on appelle récurrence topologique et qu’il a développé avec son étudiant à l’époque, Nicolas Orantin. Dans sa version la plus simple, la récurrence topologique prend une courbe plane comme donnée, et définit des nombres , et des formes différentielles (). Vu les précédents mathématiques des matrices aléatoires, il était naturel d’espérer que ces objets aient de nombreuses propriétés, et c’est le cas. En particulier, Eynard et Orantin ont démontré que les sont des invariants symplectiques de . En suivant une présentation axiomatique, je réexpliquerai la récurrence topologique au chapitre II, en signalant les propriétés connues utiles à cette thèse, et les propriétés conjecturées. Pendant ma thèse, j’ai répondu à (ou progressé vers) certaines de ces conjectures, notamment en relation avec l’intégrabilité et la géométrie énumérative.
Les travaux sur la récurrence topologique (2004-2011), et notamment les thèses de Nicolas Orantin [Ora07], d’Olivier Marchal [Mar10], et la présente contribution, laissent penser que les équations de boucles forment la structure mathématique universelle qui sous-tend toutes les questions évoquées dans cette introduction. Cette structure est essentiellement géométrique, tant par sa formulation (géométrie complexe sur les surfaces de Riemann) que ses propriétés (invariance symplectique) et applications (en géométrie algébrique, en intégrabilité). Quant à son interprétation : s’il est clair que et pour n’importe quel s’expriment toujours à partir des nombres d’intersections dans , la relation précise n’est bien connue que dans certains cas (§ II.3.2).
I.12 Résultats obtenus
Mes travaux ont été réalisés en collaboration étroite avec mon directeur de thèse, et s’orientent suivant deux axes. En premier lieu, le développement de la théorie associée à la récurrence topologique (en abrégé, RT) et aux équations de boucles, et ses généralisations. En second lieu, le développement de nouvelles applications de cette théorie. Voici les principaux résultats que j’ai obtenus pendant la thèse. Je mentionnerai leur contexte le moment venu.
L’énumération des cartes décorées par des boucles autoévitantes (le modèle dans toutes les topologies (chapitre V, article [BEMS10]). En corolaire, la preuve des exposants KPZ pour les grandes cartes dans ce modèle. La réponse est donnée par la récurrence topologique appliquée à une courbe non algébrique.
La preuve de la conjecture de Bouchard et Mariño : les nombres de Hurwitz sont donnés par la récurrence topologique appliqués à la courbe de Lambert . Ce travail a été réalisé en collaboration avec Motohico Mulase (UC Davis) et Brad Safnuk (Central Michigan University). C’est le premier cas démontré de la conjecture BKMP, qui affirme que les invariants de Gromov-Witten d’une variété torique de Calabi-Yau , sont donnés par la récurrence topologique appliquée à une courbe , appelée courbe miroir et facilement calculable à partir de (chapitre VI).
Pour la loi de Tracy-Widom avec quelconque, la détermination heuristique de l’asymptotique à tous les ordres : elle est donnée par la récurrence topologique version appliquée à (chapitre III). Ce travail s’inscrit dans une collaboration (article [BEMN10]) avec Céline Nadal et son directeur de thèse Satya Majumdar (LPTMS Orsay).
La démonstration du développement en dans les modèles sur l’axe réel, dans un régime à une coupure hors d’un point critique (chapitre III). C’est un travail en collaboration avec Alice Guionnet (ENS Lyon), qui sera bientôt publié (article [BG11])
Pour , la démonstration de l’heuristique ci-dessus, à savoir que la resommation des est asymptotique à la solution de Painlevé II qui permet d’exprimer d’après les travaux originaux de Tracy et Widom [TW94] (chapitre III, article [BE10a]).
L’association d’équations de boucles à tout système intégrable classique. L’article [BE10b] et sa version courte [BE10a] sont en fait une application de ces travaux aux systèmes associés à l’équation de Painlevé II. Le cas des systèmes a été fait pour l’essentiel par Bergère et Eynard [BE09]. J’ai trouvé une solution technique qui permet d’affaiblir leurs hypothèses, et de généraliser aux systèmes . Elle est expliquée au chapitre IV, et devrait figurer dans un prochain article, avec une application à la double limite d’échelle dans les modèles minimaux .
Des résultats partiels sur la réciproque, i.e. la construction d’un système intégrable à partir d’équations de boucles. Ils seront expliqués au chapitre IV mais ne sont pas encore publiés.
I.13 Description des modèles de matrices étudiés
On utilise la notation pour le déterminant de Vandermonde.
Le modèle à une matrice hermitienne
L’ensemble des matrices hermitiennes est un espace vectoriel de dimensionR , que l’on munit de la mesure canonique .
| (I-22) |
est une constante de normalisation. Grâce à la décomposition polaire :
on peut changer de variable et intégrer sur . Le jacobien de ce changement de variable est :
| (I-23) |
Remarquons que les intégrales sur les éléments de matrice ne se factorisent dans Éqn I-22 que si est un polynôme de degré . Autrement dit, les matrices distribuée avec le poids de l’Éqn. I-22 sont des matrices de Wigner ssi est un polynôme de degré .
Remarque : volume de
Une méthode classique pour calculer le volume de (pour la mesure induite par la mesure canonique sur ) est justement de spécialiser avec le potentiel quadratique . Dans ce cas, Éqn I-22 est un produit d’intégrales gaussiennes :
tandis que l’intégrale sur les peut être calculée avec la méthode de Gaudin et Mehta évoquée à la partie I.2 (Éqn. I-5). Les polynômes orthogonaux en jeu sont les polynômes de Hermite , de norme . D’où :
Le modèle à une matrice normale
Une matrice carrée de taille est normale ssi elle est diagonalisable dans une base orthonormée. On veut étendre la définition Éqn. I-23 en plaçant les valeurs propres sur des chemins (fermés ou ouverts) dans . On définit donc des fractions de remplissage () telles que , et on appelle l’ensemble des matrices normales ayant valeurs propres sur . On se donne aussi un potentiel .
| (I-24) |
Par rapport à l’Éqn. I-23, on a fixé le préfacteur. Avec cette notation, est l’ensemble des matrices hermitiennes. Par la suite, on note génériquement , un produit cartésien de contours du plan complexe, et on appelle la réunion de ces contours. Cette généralisation du modèle hermitien intervient naturellement quand on doit considérer l’asymptotique des intégrales de matrices dans le régime à plusieurs coupures.
Les modèles à une matrice
C’est la généralisation de l’intégrale Éqn. I-24 sur les valeurs propres, en prenant un déterminant de Vandermonde à une puissance :
| (I-25) |
Quand , c’est l’intégrale Éqn. I-24 sur un espace de matrices normales. Les cas et sont atteints par des intégrales du type Éqn. I-22, mais plutôt sur un espace de matrices diagonalisées par des transformations orthogonales (), ou symplectiques unitaires ( (cf. aussi Fig. I.1). Il n’y a pas d’intégrales sur un ensemble de matrices connu qui reproduisent, après passage aux valeurs propres, l’intégrale Éqn. I-25 en toute généralité. Le seul résultat en ce sens, dû à Dumitriu et Edelman [DE02] et généralisé récemment, est un modèle de matrices tridiagonales qui reproduit Éqn. I-25 pour les potentiels polynomiaux pairs. Il y a bien des manières de déformer le modèle à une matrice, dont les exemples donnés au chapitre V. Historiquement, les modèles ont retenu l’attention à cause de leur lien avec le hamiltonien de Calogero-Sutherland et les polynômes de Jack, et plus généralement leur relation supposée aux théories conformes décrivant des effets Hall quantiques fractionnaires : la mesure d’intégration dans l’Éqn. I-25 est la fonction d’onde à corps proposée par R. Laughlin [Lau83] pour rendre compte de particules à statistique fractionnaire (à un opérateur de vertex près).
Remarque : convergence des intégrales
Dans les chapitres IV et III, on s’intéressera à des intégrales de matrices convergentes, en particulier dans la limite où est grand. est une première condition, et d’autres conditions portent sur et . Par exemple, si un des va à l’infini, doit croître assez rapidement à l’infini le long de . Une condition suffisante est l’existence de , tel que . Comme on s’intéressera au comportement de grand de l’Éqn. I-24, il est suffisant de supposer :
On rencontrera dans les chapitres V et VI des intégrales de matrices formelles, dont on donnera une définition précise. Elle est analogue à la définition des théories des champs "perturbatives" donnée dans l’introduction (partie I.5), et les conditions sur sont de nature différentes.
Remarque : les intégrales de Selberg
Pour des potentiels très particuliers, il existe des formules closes dues à Selberg141414Elles sont rassemblées par exemple au Chapitre 17 de [Meh04], et leurs implications ont fait l’objet d’une revue [FW08]. [Sel44] pour la fonction de partition des modèles . Notamment :
Pour l’ensemble de Laguerre version , i.e. :
Pour l’ensemble gaussien version , i.e. :
| (I-27) |
Le modèle à une matrice avec champ extérieur
Dans ce modèle, on souhaite appliquer un potentiel différent à chaque . Ici, on ne s’intéressera qu’à une manière minimale de le faire : on se donne une matrice diagonale (le champ extérieur), et on définit
C’est une version "formelle" de ce modèle que l’on utilisera pour calculer les nombres de Hurwitz au chapitre VI.
L’intégrale d’Harish-Chandra
Déterminant de Cauchy
Le déterminant de Cauchy de et est défini par :
Un calcul élémentaire à partir de l’intégrale de Harish-Chandra permet de le représenter par une intégrale de matrice :
La chaine de matrices
C’est un modèle à plusieurs matrices de même taille , couplées en chaine avec une interaction linéaire.
Grâce à la formule d’Harish-Chandra, on peut diagonaliser les matrices , et intégrer sur les variables angulaires .
![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x12.png)
Lorsque (les valeurs propres ne vivent que sur un contour), et lorsque les sont des polynômes, et les fonctions de corrélations de ce modèle peuvent être étudiés en introduisant deux bases de polynômes duales pour le produit scalaire :
| (I-31) |
La limite des grandes chaines () peut être vue, en normalisant correctement les couplages, comme un modèle à une matrice dépendant d’un temps continu, avec une dynamique dictée par un terme cinétique quadratique .
Les chaines de matrices n’interviendront pas directement dans cette thèse. Je les définis car ce sont actuellement les modèles les plus généraux151515On peut aussi ajouter comme dans Éqn. I.13 un champ extérieur à une des extrémités. à plusieurs matrices où l’on sait obtenir des équations de boucles fermées, et les résoudre. Par ailleurs, on voit que pour des modèles avec couplages entre matrices plus compliqués, l’astuce d’Harish-Chandra ne permet pas d’intégrer sur les variables angulaires pour ne garder que les valeurs propres. Du point de vue probabiliste, on peut penser que la chaine de matrices est un modèle particulier. Cependant, ils sont singularisés du point de vue de l’intégrabilité, et interviennent souvent en physique statistique ou en théorie des cordes (problèmes de partitions planes aléatoires). On peut aussi garder à l’esprit, pour des travaux futurs, qu’étudier l’asymptotique des chaines de matrices, revient à étudier l’asymptotique des polynômes biorthogonaux.
Les modèles de matrices généralisés
Nous appellerons intégrales de matrices généralisées, les modèles du type :
| (I-32) |
et leurs extensions à plusieurs matrices. L’interaction entre deux "valeurs propres" et n’est plus décrite par un déterminant de Vandermonde, mais une fonction à deux points arbitraire. Ici, on a séparé artificiellement un facteur qui s’annule à points coïncidants, d’un facteur régulier . Le modèle à une matrice , et le modèle trivalent en sont deux exemples. Comme les modèles de matrices, cette généralisation a de nombreuses applications en physique théorique, dont quelques-unes sont évoquées dans cette thèse.
I.14 Description des observables
Résolvantes et corrélateurs
Dans cette thèse, nous nous intéresserons le plus souvent aux valeurs moyennes d’observables d’un modèle à une matrice, qui sont symétriques par changement de base (i.e. par permutation des valeurs propres) : elles s’écrivent . Pour cette raison, on les appelle parfois observables bosoniques. Les résolvantes engendrent une base de ces observables bosoniques (). L’expérience montre que c’est la plus commode du point de vue de la géométrie complexe. On définit alors les corrélateurs non connexes :
| (I-33) |
et les corrélateurs connexes :
La notation rappelle que est défini à partir des cumulants. Les corrélateurs connexes ou pas étant symétriques dans les , on utilisera la notation pour désigner . La relation entre et est à l’origine du vocabulaire non connexe/connexe :
Par exemple, pour et :
Par la suite, corrélateur signifiera en l’absence de précision "corrélateur connexe". Les observables bosoniques pour une matrice peuvent être engendrées en perturbant le potentiel dans les intégrales de matrices. Si l’on explicite cette dépendance dans le potentiel :
La dérivée le long de la déformation est appelée opérateur d’insertion, ou parfois opérateur de vertex infinitésimal.
Ratios de polynômes caractéristiques
Du point de vue des systèmes intégrables, ce sont les observables fermioniques qui ont été introduites à l’origine, notamment les valeurs moyennes de ratios des polynômes caractéristiques :
Les sont engendrés par l’insertion d’opérateurs de vertex finis. Par conséquent, on peut aisément écrire une formule exponentielle exprimant les en fonction de ou , et un opérateur de dérivation à points coïncidant pour faire l’opération inverse. Par exemple :
Chapitre II La récurrence topologique
Je commence par une discussion élémentaire sur les équations de Schwinger-Dyson, afin de montrer les équations de boucles satisfaites par les modèles de matrices, et de justifier leur étude dans un cadre plus général. Puis, je présente l’axiomatique de la récurrence topologique (RT), développée par Eynard et Orantin : à partir d’une courbe spectrale (notion qui sera définie), RT exhibe la solution générale d’une hiérarchie d’équations de boucles. Je rappelle ses propriétés utiles pour la suite de la thèse, en particulier son application aux chaines de matrices hermitiennes. Je discute aussi des extensions (connues ou encore à explorer) de RT. Le contenu de ce chapitre n’étant pas nouveau, je donnerai peu de démonstrations détaillées, et renvoie à [EO08a] pour une revue plus complète datant de 2008 et des références. Le lecteur qui n’est pas familier avec la géométrie complexe sur les surfaces de Riemann pourra consulter l’Annexe A en préliminaire.
II.1 Les équations de Schwinger-Dyson
II.1.1 Principes
Reprenons les notations de la partie I.5. Imaginons une théorie des champs (ou une loi de probabilité), avec une fonction de partition . Imaginons aussi et construits de sorte que les théorèmes habituels sur l’invariance de l’intégration par changement de variable s’appliquent, et que l’on dispose d’une famille différentiable de changements de variable , qui envoie sur :
Ce qui donne, pour des changements de variables infinitésimaux, une équation à trois termes :
| (II-1) |
Le premier vient de la variation du domaine d’intégration, on a noté . Le second est le jacobien infinitésimal du changement de variable :
Le troisième est la variation du poids d’intégration :
L’Éqn. II-1 donne une relation entre valeurs moyennes de certaines observables. On appelle équation de Schwinger-Dyson, toute relation découlant du principe d’invariance par changement de variable (ou d’une intégration par partie, ce qui est équivalent). On peut écrire une équation de Schwinger-Dyson pour toutes les familles de changements de variable possibles dans (elles sont paramétrées par l’espace tangent de , si tant est que cela ait un sens). On peut appliquer le même principe pour les intégrales donnant les valeurs moyennes . Après diverses manipulations, on peut espérer obtenir des équations fermées pour certaines observables , et peut-être ainsi calculer . De plus, si , on peut remonter à modulo un facteur constant en intégrant (comme en probabilités, lorsque l’on connait bien les moments d’une loi, on peut remonter à la loi).
II.1.2 Exemples
Nous allons illustrer la dérivation des équations de Schwinger-Dyson. Pour bien montrer que la méthode est élémentaire, nous allons d’abord le faire sur une intégrale unidimensionnelle. Nous passerons ensuite aux équations de Schwinger-Dyson du modèle à une matrice pour la fonction de partition et toutes les observables . Enfin, je présenterai l’équation de Schwinger-Dyson pour le modèle à une matrice hermitienne en champ externe. Ces deux cas nous seront utiles par la suite.
Exemple trivial
On se propose de calculer les moments pour la mesure de probabilité sur (), en suivant la stratégie que l’on vient d’évoquer. Pour des questions de convergence, on restreint d’abord à : . Toute fonction qui est définit une famille différentiable de changements de variable , pourvu que soit assez petit. L’équation de Schwinger-Dyson s’écrit :
Pour à croissance modérée à l’infini, le terme de bord disparait quand , et l’on trouve :
En prenant pour , on trouve par récurrence :
Enfin, . Il existe donc une constante telle que :
doit être calculé par d’autres moyens.
Modèle à une matrice
Le modèle à une matrice est défini en Éqn. I-25 :
| (II-2) |
Etudions les équations de Schwinger-Dyson générées par les changements de variable de la forme :
Si l’on choisit de sorte qu’il n’y ait pas de termes de bord, on obtient :
| (II-3) |
Cette équation est linéaire en , donc on peut en principe choisir une base quelconque de , comme la base des polynômes , puis en faire des combinaisons linéaires pour tenter de fermer les équations. On ne reproduira pas ces tâtonnements, et on choisit qui donne efficacement la réponse. L’Éqn. II-3 s’écrit :
ou en termes de corrélateurs (cf. partie I.14) :
| (II-4) |
avec :
On peut aussi écrire des équations de Schwinger-Dyson à partir de l’intégrale qui représente le corrélateur à points. En fait, elles se déduisent de l’Éqn. II-4 par des perturbations infinitésimales du potentiel (cf. Éqn. LABEL:eq:Wnconnexe) . Il en résulte :
| (II-5) | |||||
où l’on a introduit :
Ces équations sont quadratiques, à cause du terme d’interaction entre deux valeurs propres (le déterminant de Vandermonde) dans l’Éqn. II-2.
Modèle à une matrice hermitienne en champ extérieur
Le modèle est défini en Éqn. I.13 :
Écrivons l’équation de Schwinger-Dyson pour , en utilisant le changement de variable :
| (II-6) |
Il est utile d’introduire :
En particulier, notons que est régulier lorsque , et a des pôles simples lorsque . Nous pouvons mettre en forme l’Éqn. II-6 :
Cette équation est valable pour tout , en particulier, on peut faire disparaitre en spécialisant :
| (II-7) |
II.2 Formalisme de la récurrence topologique
Je vais maintenant introduire la récurrence topologique, qui exhibe l’unique solution des équations de Schwinger-Dyson des modèles de matrices hermitiennes (Éqns. II-4 et II-5 avec ) prescrite par certaines conditions analytiques. L’extension au cas sera mentionnée au § II.4.1.
II.2.1 Notion de courbe spectrale
Pour nous, une courbe spectrale sera la donnée :
-
d’une surface de Riemann .
-
d’un couple de fonctions méromorphes sur . On suppose que est un ensemble fini pour tout .
-
On note , les zéros de , on suppose qu’ils sont en nombre fini, et on demande que soit régulier aux .
-
d’un noyau de Bergman , i.e. d’un objet qui est une forme différentielle en et en , symétrique en , et qui est méromorphe avec pour seule singularité un pôle double avec coefficient en , sans résidu, i.e. dans n’importe quelle coordonnée locale :
Les deux premiers points sont équivalents à la donnée d’un atlas , ou encore d’une courbe plane d’équation . On peut éventuellement se restreindre à une courbe plane (pour enlever un ensemble de singularités par exemple), où rajouter des points à (pour la rendre compacte par exemple). Il n’est pas nécessaire que soit une fonction algébrique.
Les sont les points de ramification de , et les valeurs sont les points de branchement. On dit qu’une courbe spectrale est simple si les sont des zéros simples de et les sont deux à deux distincts. Dans ce cas, il existe une involution locale , définie sans ambigüité au voisinage de chaque par et .
Outre l’équivalence géométrique (liberté de paramétrage, de choix de coordonnées locales,…), nous utiliserons deux notions d’équivalence de courbes planes, qui se transmettent aux courbes spectrales.
est faiblement équivalente à si elles peuvent être représentées avec la même surface de Riemann , et qu’il existe une constante , une fonction méromorphe au voisinage des points de branchement de , telles que :
est symplectiquement équivalente à si elles se déduisent l’une de l’autre par composition de transformations d’équivalence faible, d’échanges , et de . Informellement, ce sont les transformations qui préservent , d’où le nom "symplectique".
II.2.2 Exemples
Une courbe spectrale algébrique de genre , avec deux points de ramification :
L’involution locale est en fait globale : . Cette courbe spectrale intervient dans le dénombrement des cartes construites avec des gones ().
La courbe spectrale d’Airy, avec un seul point de ramification :
| (II-8) |
L’involution locale est en fait globale : .
La courbe plane la plus générale qui est de genre et possède un seul point de ramification s’écrit :
| (II-9) |
L’involution locale est en fait globale : . Par des transformations d’équivalence faible, on peut toujours se ramener à . Si , et si l’on adjoint à le choix du noyau de Bergman :
| (II-10) |
on obtient une courbe spectrale symplectiquement équivalente à celle du modèle de Kontsevich (cf. § II.3.2 ou le Théorème I.1 de l’introduction)
Une courbe spectrale non algébrique, de genre , avec un point de ramification en :
Ici, fournit111Attention, les transformations d’équivalence faible et symplectiques ne touchent pas au noyau de Bergman. Ainsi, cette courbe spectrale est symplectiquement équivalente à la courbe munie de . une coordonnée globale, et où est la fonction de Lambert. Cette courbe spectrale intervient dans le calcul des nombres de Hurwitz. Ce n’est pas un cas particulier de la courbe spectrale de Kontsevich. Certes, on peut mettre la courbe plane sous la forme Éqn. II-9, avec des coefficients explicitement calculables, mais le noyau de Bergman est différent de donné à l’Éqn. II-10.
Une courbe spectrale algébrique elliptique, avec un point de ramification :
où et est la fonction de Weierstraß. Cette courbe spectrale est basée sur la courbe plane d’équation . Depuis les travaux de Seiberg et Witten [SW94], elle intervient pour les calculs semiclassiques dans les théories de Yang-Mills supersymétriques .
Les courbes spectrales hyperelliptiques. L’équation :
définit une surface de Riemann compacte , qui est génériquement de genre . Les involutions locales se recollent en fait en une involution globale : . Cette propriété caractérise les courbes hyperelliptiques. Avec un noyau de Bergman approprié, c’est la courbe spectrale la plus générale que l’on rencontre dans le modèle à une matrice hermitienne avec potentiel polynomial.
II.2.3 Axiomatique
À partir d’une courbe spectrale simple, on définit des nombres pour , et des objets . Pour initialisation :
Ensuite, on introduit un noyau de récurrence , qui est une forme différentielle en , et l’inverse d’une forme différentielle en définie au voisinage de chaque .
| (II-11) |
La formule des résidus définit par récurrence sur :
| (II-12) |
signifie que l’on exclut de la somme les termes où apparait. Enfin, on définit pour des nombres , par l’équation de dilatation :
| (II-13) |
Comme un noyau de Bergman n’a pas de résidus, on peut montrer à partir de la formule des résidus que , sauf pour . Par conséquent, la définition de ne dépend pas de la primitive de choisie.
II.2.4 Représentation diagrammatique
En débobinant la récurrence, il est possible d’écrire comme une somme sur une certaine classe de graphes fléchés trivalents , de genre , et avec une arête externe pour chaque variable . est calculé par un emboitement de résidus. Le poids de est obtenu en multipliant les poids des arêtes internes , les poids des sommets trivalents (où sont les variables associées aux arêtes incidentes), et en prenant les résidus dans l’ordre des flèches. À cause du fléchage, ces poids sont non locaux. Cette diagrammatique est développée dans [EO08a].
Il est aussi possible de représenter comme une fonction génératrice de surfaces orientables de genre , à bords, avec une variable vivant sur chaque bord (Fig. II.1). Ici, j’indique seulement une façon graphique de d’écrire/lire la formule des résidus, sans prétention bijective. C’est plutôt un choix de vocabulaire, qui a une contrepartie combinatoire précise développée dans [EO09] mais que je n’aborderai pas.
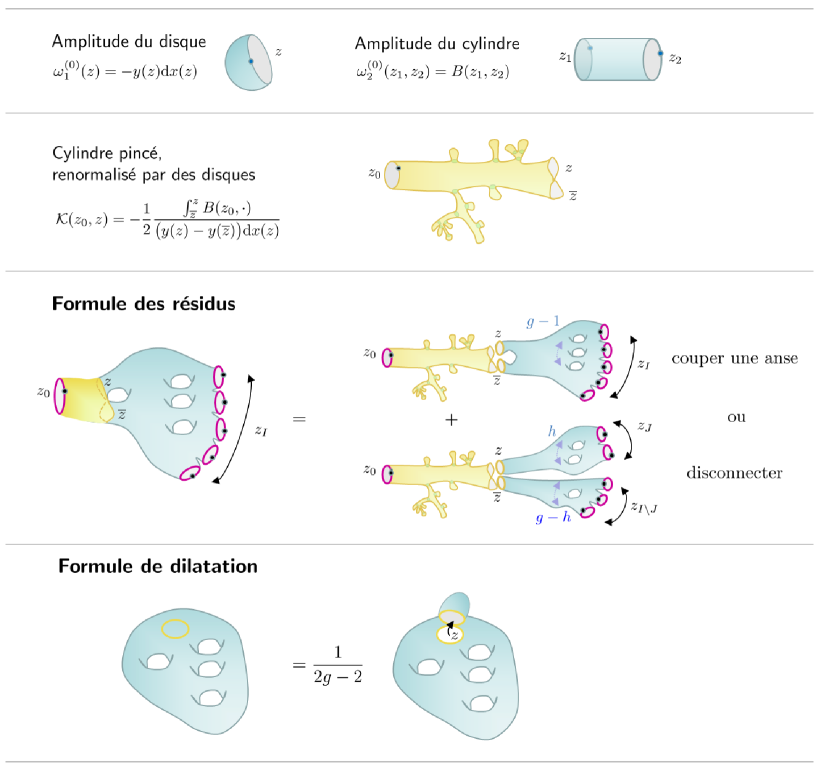
II.2.5 Définition des termes instables
En géométrie algébrique, on montre que le groupe d’automorphismes holomorphes d’une surface de Riemann de genre avec points marqués est discret ssi . Dans ce cas, on dit que est stable, sinon elle est instable. Les objets stables sont aussi ceux qui peuvent être munis d’une métrique hyperbolique à courbure constante strictement négative et rendant les bords géodésiques. Ces deux faits sont liés et rendent les objets stables plus faciles à étudier que les objets instables. Par exemple, l’espace des modules n’est bien défini que pour , et la décomposition de Strebel (partie I.9) existe aussi à cette condition. Toutefois, les topologies instables sont peu nombreuses : les sphères , les disques , les cylindres , et le tore . On peut donc les traiter au cas par cas. C’est un phénomène analogue qui rend la définition d’un et , ayant de bonnes propriétés, plus compliquée que celle des ou stables. "Bonnes propriétés" signifie que les dérivées de et par rapport à un maximum de paramètres doivent être décrites par la géométrie spéciale (§ II.2.9). Par conséquent, et ne sont jamais définis qu’à une constante près. Dans une famille donnée de courbes spectrales, il peut exister des choix naturels de cette constante.
Ici, on va se contenter de donner des définitions pour une famille de courbes spectrales simples algébriques. Elles ont l’avantage d’être basées sur une surface de Riemann compacte, sur laquelle la géométrie complexe est bien connue (cf. Annexe A).
Définition de
Lorsque est une surface de Riemann compacte, de genre , l’ensemble des noyaux de Bergman sur est un espace affine de dimensionC (cf. Annexe A) :
| (II-14) |
est entièrement déterminé par le choix d’une base symplectique de . Si est une courbe spectrale simple, on peut définir sans ambigüité (je ne le justifie pas ici) une famille222Cette famille est parfois appelée ”espace de Hurwitz” dans la littérature touchant aux systèmes intégrables et aux variétés de Frobenius. de courbes spectrales simples paramétrée par et les positions des points de branchement . La structure conforme de change avec et . Cependant, on peut s’intéresser aux variations infinitésimales d’une fonction ou d’une forme différentielle , lorsqu’une coordonnée locale est fixée et varie. Le résultat est noté ou , et vit encore333Une petite illustration : . sur la surface de Riemann .
Les noyaux de Bergman dans cette famille satisfont la formule variationnelle de Rauch [Rau59] :
| (II-15) |
Elle assure l’existence d’une fonction telle que [EKK04] :
| (II-16) |
On utilise la notation :
Comme multiplié par n’importe quelle fonction rationnelle de , vit toujours sur la même surface de Riemann, ne dépend pas des . Par exemple, pour la famille des courbes hyperelliptiques , après le choix d’une base symplectique sur une courbe origine dans cette famille :
est le déterminant de Vandermonde des , et la matrice des périodes canonique pour les courbes hyperelliptiques. Le choix d’un préfacteur s’impose naturellement.
On définit à une constante près :
| (II-17) |
Les points de branchement avec ne contribuent pas au second terme.
Définition de
Notons , les pôles de , et la coordonnée locale au voisinage de fixée par la fonction (Annexe A). Décomposons :
Avec un choix de point base , on introduit le potentiel chimique :
On choisit également une base symplectique de cycles sur . Alors, on définit , qui est aussi appelé le prépotentiel :
| (II-18) |
Cette expression ne dépend pas du choix de point base car .
Remarque
Il n’est pas facile d’étendre cette définition de a des courbes spectrales non algébriques. Il faut s’assurer que l’on peut déformer en paramétrant par la position des points de branchement, tout en préservant la formule variationnelle de Rauch (Éqn. II-15). Dans le cas algébrique, est relié au déterminant régularisé du laplacien sur muni de la métrique , et on pourrait aussi essayer de généraliser cette relation à des cas non algébriques.
Le prépotentiel a une interprétation géométrique simple, liée à l’aire régularisée de munie de la métrique . Cette régularisation est transparente : il est moins difficile de généraliser la définition de à des courbes spectrales non algébriques, au cas par cas. On peut considérer que est défini pour toute courbe spectrale (pas nécessairement simple). En fait, l’Éqn. II-18 ne fait pas intervenir le noyau de Bergman , autrement dit, on peut parler du prépotentiel d’une courbe plane quelconque.
II.2.6 Propriétés élémentaires
On pose , la coordonnée locale444Si , il faut plutôt utiliser . au voisinage de telle que . On introduit , l’entier positif tel que , et on distingue les points de ramification durs (quand ) et mous (quand ).
Analyticité Les stables sont des formes différentielles méromorphes dans chacun des , dont les pôles sont nécessairement situés aux , et n’ont pas de résidus.
Symétrie Bien que la formule des résidus privilégie une variable, tous les sont invariants par permutation des . Cela peut être explicitement prouvé en utilisant la représentation diagrammatique.
Degré des pôles Les stables ont un pôle de degré maximal lorsque . En particulier, si est un point de ramification dur, tous les sont réguliers en . Ces propriétés se prouvent par récurrence.
Localité On considère et donnés. Les stables ne dépendent que du développement de Taylor à l’ordre de lorsque . En revanche, les objets instables , et dépendent des propriétés globales de la courbe spectrale.
Normalisation Pour la courbe spectrale d’Airy (Éqn. II-8) :
Invariance faible Tous les (sauf ) sont invariants lors de transformations d’équivalence faible de la courbe spectrale. La preuve est très facile.
Invariance symplectique Tous les sont invariants lors de transformations symplectiques de la courbe spectrale. En revanche, les ne sont pas invariants, ils changent par un signe ou/et par l’ajout d’une forme exacte, i.e. d’une quantité . La preuve [EO07b] demande des outils conceptuels que nous n’aborderons pas ici555Le point difficile est l’invariance par échange . On peut le vérifier à la main pour et . La preuve générale consiste à définir des quantités mixtes où et jouent des rôles symétriques, qui satisfont des équations de boucles. Il faut enfin montrer que l’on trouve le même résultat en calculant , à partir de ou de par une équation de dilatation..
Homogénéité Tous les et les sont homogènes en de degré . I.e., lorsque pour :
| (II-19) |
Équation de dilatation se déduit de par :
Cette équation pour définit les pour .
II.2.7 Hiérarchie d’équations de boucles
On indexe par , les différents feuillets de , i.e. pour tout , . La récurrence topologique est équivalente au système suivant d’équations de boucles :
Hiérarchie d’équations de boucles linéaires.
où est une fonction de est holomorphe au voisinage de .
Hiérarchie d’équations de boucles quadratiques.
| (II-21) |
où est une fonction de qui est holomorphe au voisinage .
En pratique, lorsque , seuls les feuillets qui se ramifient en donnent lieu à des termes singuliers dans ces équations. Ainsi, si la courbe spectrale est simple, seuls les termes impliquant et sont singuliers quand . On appelle parfois le cas de l’Éqn. LABEL:eq:VVVV1 l’équation de boucle maitresse, car si l’on part d’un feuillet donné, elle prescrit la structure de dans les autres feuillets, et donc la structure de la courbe plane . On peut également remarquer que la composante de l’Éqn. LABEL:eq:VVVV1 :
| (II-22) |
est équivalente à dire que est un noyau de Bergman.
II.2.8 Limite singulière de courbes spectrales
Soit une famille lisse de courbes spectrales simples . Il y a trois façons pour de devenir singulière lorsque , qui peuvent être combinées simultanément.
Pincement Deux points de branchement et se rapprochent jusqu’à fusionner à .
Saut de avec lorsque , donc .
Collision avec une singularité essentielle a une singularité essentielle qui s’approche d’un .
Si est singulière à la limite , même dans l’hypothèse où on peut appliquer la récurrence topologique à , les propriétés analytiques des stables sont différentes de celles des stables pour . Par exemple, si augmente brusquement, le degré des pôles à dans augmente aussi brusquement. C’est un signe de divergence des stables lorsque .
Imaginons que, par un zoom à une certaine échelle autour des incriminés, l’on voit une courbe spectrale simple . Plus précisément, on suppose qu’il existe une bijection locale telle que :
avec un facteur d’échelle quand . Par récurrence, on peut alors prouver pour les objets stables :
Ces formules sont aussi valables avec quelques précautions pour les objets instables :
Chaque formule est valide tant que l’équivalent n’est pas nul, ce qui pourrait ponctuellement arriver avec certains .
Dans ce résultat, il est remarquable que la contribution dominante à à l’approche d’une singularité, ne dépende plus des détails de la famille , mais seulement du type de singularité, encodé par à équivalence(s) près. C’est une propriété d’universalité, dont on rencontrera un exemple au § III.4.4.
II.2.9 Géométrie spéciale
Déformations méromorphes
Soit une courbe spectrale simple. On peut chercher à changer le couple (ce qui en général change la position des points de branchement donc la classe conforme de ). On veut donc calculer la variation de le long de transformations infinitésimales avec , où et sont des fonctions analytiques sur . Comme les stables ne dépendent que de la courbe spectrale locale autour des , il est suffisant de supposer et méromorphes au voisinage des . Si l’on veut calculer les variations d’objets instables, on supposera que et sont méromorphes sur tout .
À cause de la liberté de reparamétrage, la variation des ne dépend que de la forme différentielle . Par dualité forme-cycle, on peut la représenter :
Alors, on peut montrer par récurrence pour tout :
| (II-23) |
Cette famille de propriétés est appelée géométrie spéciale. Pour les objets instables, il faut parfois régulariser le membre de droite pour que cette formule ait un sens et soit valide, mais il existe une manière canonique de le faire, prescrite par l’atlas de coordonnées locales fixées en tout point de par la fonction .
Exemples
Ajouter un pôle simple Comme (au moins pour une forme méromorphe sur une surface compacte), une manière minimale est d’ajouter deux pôles simples et avec résidus et . Cela revient à faire varier .
Ajouter un pôle multiple sans résidu Si l’on choisit un point et la coordonnée locale dictée par au voisinage de , on peut ajouter une forme méromorphe qui a un unique pôle, de degré en , tel que lorsque . Cela revient à changer .
En particulier, on note la déformation par ajout d’un pôle double en : . La relation de géométrie spéciale s’écrit :
Pour cette raison, on appelle l’opérateur d’insertion. Il permet d’exprimer n’importe quelle déformation . En effet, par construction :
Ajouter une forme holomorphe Lorsque est une surface de Riemann compacte de genre , le choix d’une base symplectique de cycles définit une base de formes holomorphes . Déformer en ajoutant revient à faire varier la fraction de remplissage .
Notamment, la matrice des périodes de vérifie :
En fait, le prépotentiel a été défini (Éqn. II-18) afin que ses dérivées secondes soient données par la relation de géométrie spéciale, i.e. par des périodes de .
Déformations du noyau de Bergman
On peut aussi s’intéresser aux variations des le long d’une famille de courbes spectrales où le noyau de Bergman change également, via une déformation dans l’Éqn. II-14. C’est le cas par exemple lorsque l’on change de base symplectique de cycles. Sans donner plus de détails, disons lorsque est compacte, que les formules de géométrie spéciale (Éqn. II-23) sont encore valables si l’on remplace par :
où la variation de la matrice des périodes se calcule par :
et la formule de Rauch
En supposant , on peut calculer et l’écrire sous la forme :
| (II-24) |
Par ailleurs, lors d’une déformation de sorte que soit régulier aux , la position des points de branchement varie de . D’après la formule variationnelle de Rauch (Éqn. II-15), on peut écrire :
On voit donc que la formule de Rauch est équivalente à la relation de géométrie spéciale .
II.3 Applications
Dans cette partie, je rappelle le lien entre récurrence topologique et modèles de matrices, et avec les nombres d’intersections dans . Plusieurs applications seront discutées plus loin dans la thèse : à l’étude des classes d’universalité (chapitre III), aux systèmes intégrables classiques (chapitre IV), à la combinatoire des cartes (chapitre V), à la théorie topologique des cordes (chapitre VI). J’ai choisi de les reporter, afin de les présenter en relation avec mes travaux.
II.3.1 Modèles de matrices
Développement topologique
Dans la chaine de matrices hermitiennes définie en Éqn. LABEL:sec:chain, supposons qu’il existe un paramètre de sorte que l’énergie libre et les corrélateurs666Lorsqu’il y a plusieurs matrices, il faut aussi supposer que tous les corrélateurs mixtes, i.e. impliquant plusieurs , ont un développement en puissances de . (le indique qu’ils sont définis à partir de la matrice de la chaine) aient un "développement topologique" :
| (II-25) |
Peu importe sa nature, asymptotique (lorsque est une intégrale de matrices convergente) ou formel (lorsque est une intégrale de matrices définie perturbativement). On demande surtout que commence en , ce qui contraint dans un exemple concret le choix d’un bon paramètre . Souvent où est la taille des matrices, est un bon paramètre, car les grandes matrices aléatoires ont une propriété de factorisation :
| (II-26) |
qui est le signe d’une forte corrélation entre valeurs propres de .
Ce développement peut être inséré dans les équations de Schwinger-Dyson, qui sont satisfaites ordre par ordre en . On trouve alors que les objets :
satisfont les hiérarchies d’équations de boucles linéaires et quadratiques (§ II.2.7). En gardant les notations de l’Éqn. LABEL:eq:VVVV1, est le potentiel pour la matrice figurant dans l’Éqn. LABEL:sec:chain. La preuve est facile pour le modèle à une matrice, à partir des équations de Schwinger-Dyson Éqn. II-5. En revanche, mettre les équations de Schwinger-Dyson de la chaine de matrice sous la forme Éqn. LABEL:eq:VVVV1-II-21 demande un tour de force, déjà nécessaire dans la chaine à deux matrices. Cela a été fait dans [CEO06]. Par conséquent, et si l’on peut trouver une courbe spectrale telle que :
Calcul de la courbe spectrale
Par construction, le corrélateur est une fonction holomorphe dans , discontinue sur . Ce est le support des valeurs propres de dans la limite , et est a priori inconnu. En premier lieu, il faut déterminer de manière consistante :
-
Le support , qui est en général une réunion d’arcs.
-
Une surface de Riemann sur laquelle admet un prolongement analytique. Le plongement de dans est appelé feuillet physique pour la matrice .
-
Pour chaque fraction de remplissage fixée pour la matrice , des cycles sur lesquels :
-
défini sur et qui est la solution de l’équation de boucle maitresse :
(II-27) La notion de feuillet et la définition précise de est prescrite par le modèle de matrice considéré. Cependant, l’équation à résoudre pour prend toujours la forme Éqn. II-27.
En d’autres termes, est la solution d’un problème de type Riemann-Hilbert scalaire, qu’il est parfois difficile de résoudre. Si certaines fractions de remplissage sont libres dans le modèle de matrice, il faut les déterminer de sorte que soit un extremum pour le prépotentiel (par stricte convexité de , c’est nécessairement un minimum). Les conditions de minimisation sont :
Cette propriété est la définition des courbes de Boutroux. Grâce à une bonne compréhension des courbes de Boutroux hyperelliptiques, il est prouvé que l’ensemble de ce problème pour le modèle à une matrice admet une solution, qui est unique [Ber07]. L’existence de courbes de Boutroux dans le cas général (ou déjà dans le cas algébrique non hyperelliptique) est une question difficile. Empiriquement l’ensemble de ce problème a une solution unique, mais on n’en connait pas de preuve.
Noyau de Bergman
Une fois la géométrie complexe trouvée (surface , feuillets, cycles ,…), il faut déterminer . On se contente de dire que le noyau de Bergman approprié dans les modèles de matrices satisfait :
| (II-28) |
Les -cycles sont les cycles non contractibles tels que entourent les arcs du support dans le feuillet physique. Lorsque est compact, l’Éqn. II-28 prescrit de manière unique.
Exemples
Le modèle à une matrice hermitienne Écrivons l’équation de Schwinger-Dyson au rang (Éqn. II-4 avec ) à l’ordre dominant en :
| (II-29) |
C’est une équation du second degré, dont on peut écrire la solution. Comme est régulière sur , on apprend que a une discontinuité sur de type ’racine carrée’, et reste finie sur . On peut donc la prolonger analytiquement sur une surface de Riemann hyperelliptique . a deux feuillets, un pour chaque détermination de la racine carrée. On a également a priori, grâce aux fractions de remplissage, des informations sur les intégrales de cycles (dans le plan ) de . Calculons maintenant la discontinuité de Éqn. II-29 de part et d’autre de :
| (II-30) |
L’équation est maintenant linéaire. Comme peut être étendue en une forme différentielle analytique sur , l’Éqn. II-30 est une relation entre fonctions analytiques valable sur un continuum de points , donc sur tout entier. On retrouve l’équation de boucle maitresse. . Par ailleurs, en perturbant le potentiel à partir de l’Éqn. II-30, on trouve :
| (II-31) |
En traduisant à nouveau cette relation en égalité de formes différentielles analytiques sur , on déduit que la combinaison :
| (II-32) |
est bien un noyau de Bergman sur (cf. Éqn. II-22).
Le modèle à une matrice avec champ extérieur Dans l’équation de Schwinger-Dyson II-7, est une corrélation connexe à deux points et donc négligeable à l’ordre dominant. On obtient alors une équation sur :
| (II-33) |
En pratique, les propriétés analytiques de permettent de deviner et d’exhiber un paramétrage de la courbe d’équation II-33. Lorsque ce problème peut avoir plusieurs solutions, il faut sélectionner la bonne en minimisant le prépotentiel.
II.3.2 Nombres d’intersection dans
Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de [Eyn07]. Il ne faut pas faire confiance aux facteurs et aux signes dans cet article, mais les calculs ont été détaillés et corrigés dans [Eyn11]. Je vais utiliser les notions de théorie de l’intersection dans introduites à la partie I.9. Kontsevich [Kon92] a montré pour la série génératrice des nombres d’intersections :
avec les temps qui sont en correspondance avec une matrice diagonale de taille assez grande par , et la constante de normalisation :
est le genre fixé par la dimension . Nous allons écrire et afin de le mettre en valeur :
Ici, il est commode de fixer , ce qui permet de supprimer les termes redondants contenant , donc de restreindre la somme à des entiers strictement positifs. Cette convention revient à choisir une normalisation pour la matrice des temps : .
et classes
L’intégrale de matrice de Kontsevich peut se réécrire comme une intégrale formelle à une matrice dans un champ externe :
Nous sommes dans le champ d’application du paragraphe précédent, avec qui joue le rôle777Ce passage peut être rendu rigoureux (les manipulations d’intégrales formelles seront justifiées au chapitre V). Nous invoquons ici le cas du modèle à une matrice en champ externe pour justifier l’application de la récurrence topologique, car nous l’avons déjà rencontré. On pourrait tout aussi bien résoudre les équations de Schwinger-Dyson du modèle de l’Éqn. II.3.2 et arriver aux mêmes conclusions. de .
La courbe spectrale satisfait l’équation maitresse :
| (II-36) |
À la limite , l’intégrale de Kontsevich est un modèle de matrice gaussien, dont la courbe spectrale est de genre . Comme les sont des variables formelles, la courbe spectrale en est une perturbation, en particulier doit aussi être de genre . Autrement dit, admet un paramétrage rationnel. Ceci détermine une unique solution de l’Éqn. II-36. Il suffit d’étudier le comportement aux pôles pour vérifier que :
est la solution désirée. Nous donnons aussi le résultat pour le noyau de Bergman :
Par comparaison avec l’Éqn. LABEL:eq:konkon, pour :
| (II-37) |
Par invariance symplectique, ce sont aussi les de la courbe spectrale :
Par une nouvelle transformation symplectique, on peut se débarasser des pour . Cela est évident car le membre de droite de Éqn II-37 ne dépend pas de , et on le retrouve a posteriori grâce à la propriété d’invariance symplectique des . On pourrait absorber le facteur en faisant une dilatation de . D’après l’Éqn. II-19, cela signifie que l’Éqn. II-37 dépend de uniquement via un préfacteur et les variables renormalisées .
Réécriture avec les classes
Les intégrales de classes sur peuvent être réduites à des intégrales sur en introduisant les classes . Cela permet de réécrire l’Éqn. II-37 de façon compacte. Le résultat est :
| (II-38) |
Il faut comprendre comme une série génératrice de classes (qui sont des formes -dimensionnelles), et est nulle par convention lorsque l’on intègre une forme de dimension totale différente de . Les sont les paramètres modifiés :
Ils sont reliés à la transformée de Laplace de sur la courbe spectrale :
| (II-39) |
, classes et
Les sont engendrés par les variations des lorsque l’on fait des variations infinitésimales de la courbe spectrale. La variation réalise l’opérateur d’insertion . Ici, est une matrice diagonale888Pour préserver la condition , il faut supposer ., on note (resp. ) les valeurs propres de (de , et les sont les pôles de , i.e. . En effet, un calcul simple montre :
Les doivent donc s’exprimer également en termes d’intégrales de classes . Nous allons seulement donner le résultat :
| (II-40) |
où l’on a introduit les formes différentielles :
Cette formule est valable pour les topologies stables, i.e. . Elle est aussi valable pour , où il n’y a plus d’insertions de classes et l’on retrouve Éqn. II-38. Elle donne une interprétation des et en termes de nombres d’intersections999Cela permet aussi de calculer de façon récursive les nombres d’intersections en utilisant la formule des résidus. Historiquement, c’est Mirzakhani [Mir07] qui a trouvé la première formule récursive pour calculer des intersections de classes et de que l’on appelle forme volume de Weil-Petersson. Une autre preuve a été proposée par [MS08, LX09a], et l’équivalence avec la récurrence topologique a été démontrée dans [EO07c]. Ces résultats ont été étendus pour inclure les autres classes dans [LX09b], et du point de vue de la récurrence topologique dans [Eyn07]. dans pour toutes les courbes spectrales qui n’ont qu’un seul point de branchement mou , et dont le noyau de Bergman est :
Résumons de manière informelle. est un habillage gravitationnel, qui dépend des temps, et est défini via une transformée de Laplace dans la courbe plane . est l’élément de surface associée à la famille de surfaces de Riemann de où le point marqué fluctue. calcule une fonction de corrélation à points parmi les surfaces de Riemann de genre pondérées par . En utilisant un vocabulaire de physique, ce sont les fonctions de corrélation de la gravité quantique (§ I.9).
II.4 Généralisations
II.4.1 Déformations de la récurrence topologique
Le paramètre
Nous avons écrit les équations de Schwinger-Dyson du modèle à une matrice au § II.1.2. Lorsque , elles sont de nature algébrique, et sont équivalentes après développement topologique à la hiérarchie d’équations de boucles que résoud la récurrence topologique (§ II.2.7). Lorsque , elles font apparaitre une dérivée, par exemple :
| (II-41) | |||||
On veut étudier ces équations en présence d’un petit paramètre tel que . À l’ordre dominant :
| (II-42) |
avec . Je vais écarter le cas singulier où le terme quadratique est négligeable devant les deux autres, et distingue deux régimes intéressants :
Le terme dérivée est négligeable à l’ordre dominant, vérifie la même équation que pour (Éqn. II-29). Les équations de Schwinger-Dyson, ordre par ordre en puissances de , forment encore un système récursif d’équations algébriques. Elles peuvent être résolues en termes de géométrie complexe sur la courbe spectrale du modèle hermitien (). Par exemple, ce régime s’applique dès que et reste fini et loin de , ce qui recouvre beaucoup de cas intéressants pour la théorie des matrices aléatoires.
fini Tous les termes de l’Éqn. II-42 sont du même ordre, c’est une équation différentielle de type Ricatti. En posant , elle est équivalente à une équation de Schrödinger :
| (II-43) |
avec une fonction inconnue à déterminer par consistance avec les propriétés analytiques que l’on requiert pour . Les autres équations de Schwinger-Dyson, ordre par ordre en puissances de , sont des équations différentielles linéaires du premier ordre pour , avec des inconnues à déterminer encore par consistance. Dans ce régime, il est nécessaire (mais pas suffisant) que ou . Par exemple, il serait pertinent du point de vue probabiliste, pour étudier la transition entre un régime de fortes corrélations () et de décorrélation () pour variables aléatoires .
Résoudre les équations de Schwinger-Dyson à fini requiert une nouvelle technologie, principalement développée par Bertrand Eynard et Olivier Marchal [EM09, Mar10], rejoints par Leonid Chekhov [CEM09, CEM10]. Ils sont parvenus à mettre la solution sous la forme d’une récurrence topologique, où toutes les notions de géométrie complexe (noyau de Bergman, résidus, formule de Cauchy, cycles non contractibles, identité bilinéaire de Riemann, …) sont remplacées par des notions de la théorie des équations différentielles. En quelque sorte, ils ont établi l’analogue de la géométrie complexe classique d’une courbe plane , pour un -module , où et sont des objets non commutatifs : . Disons que ce programme est complété au moins dans le "cas hyperelliptique" . Il est conjecturé que les sont des invariants symplectiques, i.e. sont préservés par toute transformation telle que . L’extension à des plus généraux (atteints par exemple dans la déformation de la chaine à deux matrices) permettrait d’étudier cette conjecture. Cette théorie est prometteuse, je l’ai peu abordée pendant ma thèse, mais j’ai l’intention d’y participer dans le futur.
Dans cette thèse, nous rencontrerons seulement . L’extension de la récursion topologique est assez facile car on reste dans le domaine de la géométrie complexe. Elle a été développée par Chekhov et Eynard depuis 2006 [CE06, Che10]. Les nombres et des formes différentielles sur peuvent être définis axiomatiquement en termes de géométrie complexe sur . Ils satisfont outre la hiérarchie d’équations de boucles (), toutes leurs descendantes (). Au niveau apparait la dérivée de l’objet de niveau (cf. Éqn. LABEL:eq:M2 un peu plus loin). En particulier, pour tout . Les objets vérifient la géométrie spéciale, sont homogènes de degré , et se comportent bien par rapport aux limites singulières de courbes spectrales101010L’indice ’sing’ rappelle que les objets instables ont une partie non divergente. Les nouveaux objets instables sont , , .
L’invariance symplectique des pour est conjecturée mais n’a pas encore été prouvée.
Application au modèle à une matrice ()
Revenons au modèle (fini loin de ) à une matrice, avec un potentiel indépendant de et . Ici, je voudrais justifier la dépendance en et en du développement à , moyennant quelques hypothèses qu’il faut juger sur des exemples pratiques (cf. chapitre III). Supposons qu’il existe un développement :
| (II-44) |
En particulier, on demande que l’ordre dominant de soit , et par convention si . L’équation de Schwinger-Dyson II-41 s’écrit ordre par ordre en :
et plus généralement l’Éqn. II-5 :
Ces équations sont récursives linéaires : on peut déterminer (niveau ) en résolvant une équation linéaire, où interviennent seulement des termes de niveau inférieur . Lorsque , on remarque que la première correction générée à partir des termes , n’est pas , mais . Autrement dit, la substitution du développement Éqn. II-44 dans les équations de Schwinger-Dyson produit naturellement un développement en lorsque . En revanche, pour , tous les ordres apparaissent. . L’ordre dominant de vérifie l’équation (Éqn. II-42) :
donc ne dépend pas de . Avec cette initialisation, une analyse rapide montre que la dépendance en est polynomiale en et , et plus précisément :
avec indépendant de . Par intégration de , on trouve aussi :
avec indépendant de .
En particulier, on peut définir une courbe spectrale qui est essentiellement celle du modèle hermitien :
est une courbe spectrale hyperelliptique, indépendante de . La version de la récurrence topologique appliquée à est précisément définie afin de donner la solution de la hiérarchie d’équations de Schwinger-Dyson (Éqn. LABEL:eq:M1 et LABEL:eq:M2), avec la correspondance :
et :
II.4.2 Qu’est-ce qu’une courbe spectrale ?
J’ai fixé une notion de courbe spectrale au § II.2.1, afin de présenter une théorie générale. Mais, d’un point de vue empirique, on peut définir des objets et dès que la formule des résidus (Éqn. II-12) et la formule de dilatation (Éqn. II-13) font sens. Notamment, on a vu que les objets stables () ne font intervenir que les propriétés locales de autour des points de ramification. Certaines propriétés de la récurrence topologique (comme une hiérarchie d’équations de boucles, le comportement à l’approche d’une limite singulière) seront automatiquement satisfaites, d’autres (comme la géométrie spéciale) demanderont quelques vérifications.
Si est donnée, on peut chercher à appliquer la récurrence topologique avec une fonction possédant des monodromies autour des . Il suffit de passer à un recouvrement universel de , trouver un noyau de Bergman dans et écrire une formule des résidus aux . Notamment, le cas où est compact alors que est non compact est intéressant.
Un exemple est donné par le modèle de matrice , où les corrélateurs à l’ordre dominant et sont connus depuis longtemps, et sont des fonctions analytiques avec monodromies, définies sur une surface elliptique. Pour des valeurs , est non compacte ( et ont une singularité essentielle au point ). On peut chercher à appliquer la récurrence topologique à ces données, mais à ce stade, ce n’est qu’une définition axiomatique. J’ai montré [BE11] que les construits de cette manière donnent bien le développement topologique des corrélateurs du modèle de matrice , si l’on définit correctement l’involution locale sur et si l’on choisit le bon noyau de Bergman . La situation est similaire dans plusieurs autres modèles de matrices intervenant en combinatoire/physique statistique sur réseau aléatoire : dans le modèle de Potts [BE99], le modèle à six vertex [Kos00], certains modèles ABAB [ZJ03], … on connait l’ordre dominant, qui définit une courbe spectrale possédant des monodromies. On conjecture que le développement topologique de tous ces modèles est donné par une récurrence topologique appropriée. Cela signifierait que les équations de Schwinger-Dyson dans ces modèles de matrices peuvent se mettre sous la forme d’équations de boucles (Éqn. LABEL:eq:VVVV1 et II-21) avec une notion de feuillet appropriée. Je reviendrai sur ce point au chapitre V.
Enfin, j’ai mentionné au § II.4.1 l’extension de la récurrence topologique à une géométrie algébrique non commutative. Plus généralement, on voit que la surface de Riemann munie de la fonction sert uniquement à donner une réalisation géométrique à l’équation de boucle linéaire (Éqn. LABEL:eq:VVVV1), où la notion de feuillet correspond aux différents relèvements de . On peut chercher à étudier l’Éqn. LABEL:eq:VVVV1 :
-
dans un cadre géométrique plus général. Par exemple, on peut dire que dans la déformation des équations de boucles, on a pour un certain feuillet . Cela conduit à étudier les courbes spectrales non pas comme une surface de Riemann avec structure additionnelle, mais plutôt comme un module , où est un certain opérateur linéaire. Par exemple (cf. Éqn. II-43). Pour le modèle , on rencontrera à la partie V.3 :
où est une fonction elliptique. Plus généralement, on pourrait s’intéresser à :
C’est ce que les auteurs de la déformation de la récurrence topologique ont initié.
-
dans un cadre algébrique. On appelle l’opérateur de passage de passage du feuillet au feuillet , et on se donne une structure abstraite de groupe pour les . On cherche alors à trouver les solutions de la hiérarchie d’équations de boucles. Cela nous amènerait vers les théories de Galois classiques et différentielles.
Les deux aspects sont très liés. Ce programme est largement ouvert. Il est motivé par les progrès récents fait sur la déformation de la récurrence topologique et le modèle , et les nombreuses similarités entre phénomènes mathématiques observés dans les modèles de matrices, et les théories conformes, les théories de jauge, les problèmes à corps, … En fait, le lien entre tous ces problèmes se trouve peut-être dans les équations de boucles (dont les solutions représentables par des intégrales de matrices ne sont qu’un cas particulier). Leur formulation Éqn. LABEL:eq:VVVV1 et l’Éqn. II-21 est assez universelle. Il est bien connu (e.g. [dB91]) que ces équations encodent une partie de l’algèbre de Virasoro111111Dans les travaux d’Ivan Kostov, les modèles de matrices apparaissent comme fonction de partition de la théorie conforme d’un boson chiral vivant sur la courbe spectrale [Kos99]. Les termes du développement topologique apparaissent comme des corrections quantiques, et peuvent être calculés par des techniques diagrammatiques. Kostov et Orantin ont montré récemment [KO10] que ces diagrammes sont une resommation de ceux de la récurrence topologique. Ces aspects ne seront pas abordés dans cette thèse. ou plus généralement des contraintes issues d’une algèbre [BS93]. Par conséquent, de nouveaux résultats concernant la résolution des équations de boucles auraient des conséquences en théorie conforme ou pour les systèmes intégrables.
Chapitre III Intégrales convergentes de matrices
Cette partie traite de l’asymptotique à dans les modèles à une matrice, voire les modèles de matrices généralisés. Tout d’abord dans le régime "une coupure", où le développement asymptotique ne contient que des puissances de . Après un rappel des théorèmes sur l’ordre dominant, j’explique comment les équations de boucles permettent de démontrer l’existence de l’asymptotique à tous les ordres (article [BG11]). Leur expression est alors donnée par la récurrence topologique. Dans le régime "plusieurs coupures", je présente une dérivation heuristique de l’asymptotique, due à Eynard, qui justifie l’apparition de termes à tous les ordres . La dernière partie est dévolue à l’étude de la statistique de la valeur propre maximale dans les modèles , comme application des techniques de récurrence topologique. Dans une double limite d’échelle, cela permet d’obtenir des informations précises sur la queue gauche des lois de Tracy-Widom , et de comprendre leur universalité (article [BEMN10]).
III.1 Asymptotique à
Une intégrale convergente de matrice est simplement une loi de probabilité sur un ensemble de matrices, ou bien la donnée de la loi jointe sur leurs valeurs propres . Nous serons aussi intéressés par les mesures de probabilité provenant de modèles de matrices généralisés (Éqn. I-32). Pour nous, la question principale sera de déterminer la statistique des , dans la limite , et de calculer l’énergie libre .
Pour le modèle à une matrice hermitienne, pour la chaine de matrices, pour les modèles , il existe des méthodes de polynômes orthogonaux, qui reviennent à réaliser ces modèles comme des systèmes intégrables classiques. Une technologie puissante, appelée approche de Riemann-Hilbert, a été développée pour étudier leur asymptotique lorsque , et l’on pourra consulter comme bonne introduction la série de cours de Deift [Dei98]. Dans cette thèse, nous nous intéressons au cas où cette méthode ne peut pas être appliquée. Cela concerne la plupart des modèles de matrices généralisés (Éqn. I-32), et notamment le modèle (Éqn. I-25).
Dans ce chapitre, nous présentons une approche basée sur les équations de Schwinger-Dyson (cf. partie II.1). Ces équations sont exactes pour fini, et contraignent la structure du développement asymptotique lorsque . Elles permettent aussi de contrôler les erreurs successives lorsque l’on tronque le développement. Pastur et ses collaborateurs sont les précurseurs de cette méthode.
III.1.1 Cadre
Notre propos sera illustré en détail pour le modèle sur l’axe réel, avec bords . Il est défini par la mesure de probabilité sur :
| (III-1) |
Le développement asymptotique lorsque de ce modèle est l’objet de l’article [BG11] écrit avec Alice Guionnet. Le but n’est pas ici d’énoncer des hypothèses minimales ou de présenter les preuves complètes qui apparaissent dans [BG11] et ses références. Nous voulons plutôt délimiter la démarche générale. Nous indiquerons au § III.2.1 et III.2.5 ce qui se généralise sans difficulté, et ce qui exigerait des travaux futurs. Pour fixer les idées, nous supposerons que :
est indépendant de (régime du § II.4.1).
est une fonction à valeurs réelles, qui admet un développement asymptotique
| (III-2) |
où chaque se prolonge en une fonction holomorphe (éventuellement nulle) sur un voisinage de .
Si est infini, il faut supposer pour assurer la convergence :
Cette dernière hypothèse dit aussi que croît assez vite à l’infini, pour que les valeurs propres vivent dans une région finie, à des configurations de poids exponentiellement petit près quand est grand :
Lemme III.1.
Il existe un segment fini , inclus dans , et une constante tels que :
Si l’on ne s’intéresse pas à ces termes exponentiellement petits, on peut donc supposer dès le départ et finis. L’avantage est que les corrélateurs définis en Éqn. I-33 :
sont automatiquement des fonctions holomorphes pour . Cela va nous permettre d’utiliser les outils de l’analyse complexe, et de déplacer des contours d’intégration dans .
Quelle notion de convergence ?
Plus précisément, appartient à l’espace des fonctions à variables, holomorphes sur au moins, et qui ont une limite à l’infini (ici, lorsque ). Si l’on veut parler de développement asymptotique, il faut préciser pour quelle notion de convergence. Choisissons une courbe de Jordan qui entoure , et notons la composante connexe de contenant , et celle qui contient (Fig. III.1). Définissons pour :
| (III-3) |
Grâce au principe des zéros isolés, est une norme. Puisque n’a pas de singularité lorsque vit dans , le sup est atteint pour en appliquant fois le principe du maximum. L’espace est complet. La notion de convergence dans cet espace revient à contrôler uniformément la convergence de tous les coefficients de la série de Laurent de au voisinage de ; autrement dit, en termes de , à contrôler la convergence de tous les moments impliquant valeurs propres distinctes.
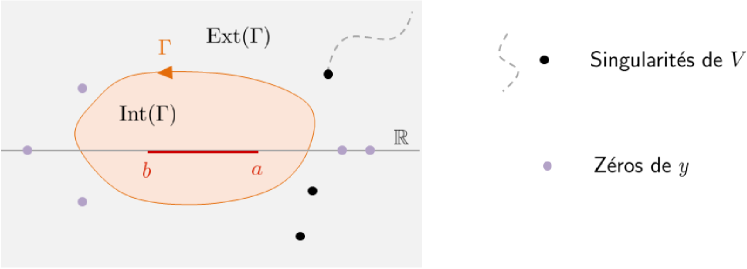
Remarquons que, pour tout , il existe une constante telle que :
| (III-4) |
où . Comme d’habitude avec les fonctions analytiques, contrôler uniformément suffit à contrôler sa dérivée uniformément.
Équations de Schwinger-Dyson
Les équations de Schwinger-Dyson pour ont été essentiellement écrites à l’Éqn. II-3, où il faut choisir des changements de variable qui préservent le domaine d’intégration . Ils sont tous générés par . Après quelques calculs, on trouve l’équation au rang :
Et en perturbant le potentiel, les équations au rang :
est un contour entourant mais laissant à l’extérieur. En le déplaçant pour inclure le pôle à , la deuxième ligne s’écrit :
où est holomorphe au voisinage de . Les équations écrites sous cette forme se rapprochent des Éqns. II-4 et II-5 qui sont valables en l’absence de bords : le seul effet des bords est d’autoriser a priori un pôle simple en dans la quantité .
III.1.2 Mesure empirique des valeurs propres
La mesure empirique est définie comme la mesure de comptage des valeurs propres :
Il existe depuis longtemps des théorèmes assez généraux qui garantissent que converge vers une mesure de probabilité pour la topologie faible, i.e. pour toute fonction test assez régulière :
Par exemple, pour [Joh98]
Theorème III.1.
existe, et est l’unique mesure de probabilité sur qui minimise :
| (III-7) |
On note le support de . Si ou , précisons que est compact.
Avec nos hypothèses de régularité sur , est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, i.e. c’est une densité .
L’existence d’un qui minimise vient de considérations générales de théorie de la mesure. Le point essentiel est l’unicité. La fonctionnelle Éqn. III-7 est en fait strictement convexe, donc ne peut avoir qu’un seul minimum. La propriété de convexité :
ne voit pas le terme linéaire et se résume à :
| (III-8) |
où est la différence de deux mesures de probabilité quelconques sur . L’indice est là pour rappeler que est une mesure signée telle que . Avec cette notation, et la représentation :
| (III-9) |
un petit calcul suivant [Dei98, p142-143] montre que :
est la transformée de Fourier de la mesure . L’intégrand est régulier en , car implique lorsque . Par conséquent, , avec égalité ssi , ssi . Ceci établit la stricte convexité de .
Caractérisation de
Les équations de minimisation sont :
| (III-10) | |||||
où est une constante. En dérivant l’égalité par rapport à :
| (III-11) |
v.p. désigne la partie principale de l’intégrale, i.e. l’expression . L’utilisation de la transformée de Stieltjes :
clarifie la nature géométrique du problème :
| (III-12) |
Cette équation est bien sûr compatible avec l’équation de Schwinger-Dyson au rang (Éqn. LABEL:eq:cvf), à l’ordre dominant lorsque . En effet, l’Éqn. III-12 assure que n’a pas de discontinuité sur . Cette quantité a donc des singularités uniquement à celles de , éventuellement en où peut se comporter comme , ce qui la détermine de manière unique. La solution vérifie :
En comparant avec l’Éqn. LABEL:eq:cvf, on apprend au passage que .
L’Éqn. III-12 est indépendante de (c’est la même équation que pour le modèle hermitien) et de la présence des bords. En fait, les bords influent sur les propriétés analytiques a priori de . Si l’on note un des bords, on sait d’après l’Éqn. LABEL:eq:cvf à l’ordre dominant, que . En revanche, en l’absence de bord, reste fini partout sur l’axe réel. Trouver revient à déterminer la solution de l’Éqn. III-12 qui satisfait ces propriétés analytiques, et (si l’on a le choix) qui minimise .
Les techniques d’analyse complexe sont efficaces pour résoudre l’Éqn. III-12, elles sont réexpliquées en détail dans [BEMN10]. Elles ont aussi l’avantage de se généraliser à des équations linéaires plus compliquées, comme celle du modèle (§ V.3). Dans des cas plus restreints (dont l’Éqn. III-11 fait partie), on peut trouver indépendamment dans la littérature la solution de l’équation intégrale : c’est une formule intégrale due à Plemelj et redérivée par Tricomi [Tri57] pour III-11, et une formule intégrale due à B¸ckner [Büc66] pour l’équation du modèle dans le cas particulier .
Rappelons que la courbe plane associée au modèle de matrice est relié à par :
et est une surface de Riemann sur laquelle se prolonge analytiquement. En particulier, est aussi le prolongement analytique de la quantité , initialement définie sur .
III.1.3 L’opérateur linéaire
L’existence de indique que avec , sous-entendu pour la norme . On peut aussi en déduire que . Que se passe-t-il aux ordres suivants ?
Écrivons également . satisfait l’Éqn. LABEL:eq:cvf à l’ordre dominant (Éqn. III.1.2), et le reste de l’équation s’écrit :
| (III-14) |
et sont des endomorphismes de .
| (III-15) |
L’opérateur surtout joue un rôle important, car il faudrait l’inverser pour déterminer à l’ordre sous-dominant. Il intervient de même dans toutes les équations de Schwinger-Dyson de rang (Éqn. LABEL:eq:ooo), que l’on peut écrire :
| (III-16) |
où les sont spectateurs et les opérateurs agissent sur la variable . On aurait besoin à nouveau de l’inverse de , pour déterminer à l’ordre dominant. Deux cas se présentent.
Régime à une coupure Si est un segment , est bien inversible. Ici, nous allons simplifier notre discussion en supposant que les bords et sont durs, i.e. et . En présence de bords mous, la méthode que nous allons décrire demande d’établir a priori un "principe de dépendance faible dans les bords mous", i.e. que les observables du modèle défini sur coïncident à un , avec celles du modèle défini sur tout intervalle qui est un petit élargissement de . Ceci sera fait dans l’article en cours d’écriture avec Alice Guionnet, où nous démontrons le résultat final (Propositions III.2 et III.3) avec des hypothèses légèrement plus faibles, et quelque soit la nature des bords. Ainsi, en supposant que les bords et sont durs, un argument classique conduit à la formule de Tricomi [Tri57] pour l’inverse de :
| (III-17) |
Dans ce cas, est une courbe de genre .
Régime à plusieurs coupures Si est une réunion de segments , n’est pas inversible, son noyau est de dimensionC . En effet, les éléments du noyau sont les , où est une forme holomorphe sur la surface de Riemann d’équation :
On peut en choisir une base duale aux contours111Le contour n’est pas indépendant des autres, puisque est contractible sur . qui entourent :
Le mieux que l’on puisse dire est :
Néanmoins, peut être inversé si l’on se fixe a priori les intégrales de cycles .
Dans un régime à une coupure, on peut espérer que et aient un développement en puissances de , en résolvant récursivement les équations de Schwinger-Dyson. C’est ce que nous allons faire. Ce n’est jamais vrai dans un régime à plusieurs coupures, car des oscillations rapides avec apparaissent dans la partie de qui est annihilée par . Leur origine sera expliquée en partie III.3.
Pour assez petit, il est facile de déterminer qualitativement le régime dans lequel on se trouve (Fig. III.2). À , les valeurs propres se concentrent au voisinage des minima absolus de . Lorsque augmente, est constitué de segments croissants autour des minima globaux, puis d’autres segments au voisinage de minima locaux peuvent apparaitre. Lorsque augmente encore, les valeurs propres s’étalent de plus en plus et certains segments peuvent fusionner. Si est strictement convexe sur (donc admet un unique minimum), nous serons toujours dans un régime à une coupure. En effet, la fonction
est maintenant strictement concave sur . Comme elle est nulle sur et continue strictement négative sur (Éqn. III-10), doit être connexe.
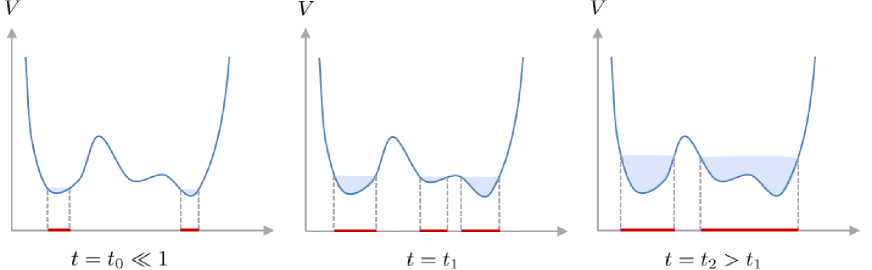
III.2 Asymptotique en puissances de
III.2.1 Ce qui est important
Continuité de
Notre approche est basée sur l’hypothèse fondamentale :
Hypothèse III.1.
a un inverse, qui est un opérateur linéaire continu.
Cette hypothèse est vérifiée dès que est donné par une formule de type Tricomi :
| (III-18) |
où est une fonction holomorphe dans , où est un voisinage ouvert de privé du segment lui-même, et entoure mais pas . En effet, plaçons sur un contour qui définit la norme (Éqn. III-3), et déplaçons vers un contour (Fig. III.3).
On peut maintenant borner le membre de droite :
donc est un opérateur linéaire continu dans l’espace . Sa norme est contrôlée par la distance entre les singularités de qui sont à l’extérieur de , et le segment lui-même. Par exemple, pour le modèle dans le régime à une coupure :
et la norme de est controlée par la distance entre et les zéros de .
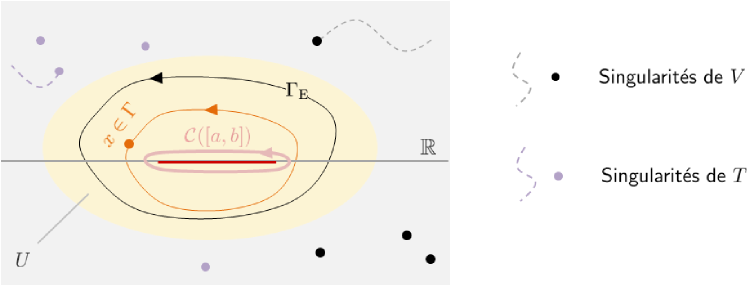
Ordre de grandeur de
En second lieu, nous allons nous baser sur un contrôle a priori des , que nous énonçons d’abord sous une forme contraignante :
Hypothèse III.2.
.
Hyp. III.1 garantit que l’on peut appliquer à l’Éqn. III-14 ou l’Éqn. III-16, en contrôlant la norme à une constante multiplicative près. Si l’on sait que pour certaines constantes (), les équations de Schwinger-Dyson (Éqn. III-16) impliquent :
L’analyse de cette relation montre que des bornes a priori grossières sur , sont suffisantes pour conclure que est un . Par exemple :
Lemme III.2.
Si il existe et tel que pour tout , , alors l’hypothèse III.2 est vérifiée.
Pour le modèle , en supposant que est une fonction à valeurs réelles, lipschitzienne sur , mais sans hypothèses sur , Boutet de Monvel, Pastur et Shcherbina [dMPS95] ont établi des bornes dont on peut déduire [BG11, Lemme 4.6]. Si l’on dispose de l’hypothèse III.1, le Lemme III.2 s’applique et justifie dans ce cas l’hypothèse III.2.
Voyons les premières conséquences de l’hypothèse III.2, en commençant avec l’Éqn. III-14. Dans le membre de gauche, est le terme dominant quoiqu’il arrive ; dans le membre de droite, il y a des termes d’ordre donc est négligeable devant eux222On a seulement besoin de à ce stade.. Par conséquent333On utilise la continuité de , ainsi que la continuité des opérateurs et de qui est évidente d’après la remarque faite à l’Éqn. III-4., a une limite quand :
Les mêmes arguments s’appliquent à l’Éqn. III-16, qui contient a priori des termes qui sont , tandis que est d’un ordre de grandeur inférieur. L’équation qui détermine l’ordre dominant de ne fait plus intervenir que l’ordre dominant des (). Par conséquent, une récurrence montre que admet une limite pour tout , et :
| (III-20) |
Remarquons que les équations de Schwinger-Dyson, même pour , contiennent des dérivées de . À une étape de la récurrence, si les corrélateurs sont controlés pour une norme , le contrôle à l’étape sera valable pour une norme , où est légèrement plus grand444Je remercie Pavel Bleher pour une correction sur ce point., i.e. . il faut élargir légèrement le contour. Ceci peut être pris en compte en introduisant une famille de contours emboités, ce qui est expliqué dans [BG11]. Le prix à payer pour cela est que les concernant ne peuvent être uniformes par rapport à .
III.2.2 Théorème central limite et conséquences
L’existence de et la propriété est suffisante pour établir un théorème central limite pour les valeurs propres . Pour le modèle , c’est un résultat déjà connu de Johansson [Joh98], essentiellement par la même méthode.
Proposition III.1.
Soit de sorte que l’hypothèse III.1 soit vérifiée ainsi que . Soit une fonction qui se prolonge analytiquement sur un voisinage de . Posons :
La loi de la variable aléatoire , induite par , converge vers la loi normale lorsque .
Cela vient d’un petit calcul avec le potentiel modifié . Nous allons noter le corrélateur à un point pour le potentiel sur . Les hypothèses assurent la validité de l’Éqn. LABEL:eq:Wbh, et l’on a :
Le premier terme est d’après la définition de la transformée de Stieltjes. En utilisant explicitement l’Éqn. LABEL:eq:Wbh, + un terme linéaire en , et l’on trouve :
| (III-21) |
Notons que est linéaire et est quadratique en . L’Éqn. III-21 indique que la transformée de Fourier de la loi de coïncide converge vers celle de la loi normale, d’où la convergence en loi énoncée à la Prop. III.1.
III.2.3 Développement asymptotique complet
Il est temps de systématiser la stratégie initiée à la fin du § III.2.1. Prenons comme hypothèse de récurrence au niveau l’assertion HR :
où est connu pour , et le reste est un a priori inconnu. Nous utiliserons également la notation pour :
Pour relier ces notations aux précédentes, .
HR est vérifiée d’après § III.2.1. Soit et supposons HR. Les équations de Schwinger-Dyson III-14 et III-16 tronquées à un près donnent des relations entre déjà connues. De nouvelles informations se trouvent dans le .
Pour :
Pour :
Dans ces expressions, nous avons isolé , qui est une expression indépendante de où interviennent uniquement les pour , donc qui n’a de discontinuité que sur :
Le reste est un (d’après HR) que nous n’allons pas expliciter, mais qui est dans . En conséquence, en utilisant la continuité de , a une limite :
| (III-22) |
qui appartient à , et le reste est un dans . Ce qui prouve HR. Là encore, il faut élargir le contour définissant la norme à chaque étape de la récurrence afin de bien contrôler les dérivées intervenant dans . Finalement, est un bien un , mais qui n’est pas uniforme par rapport à et à
Ainsi, par récurrence :
Proposition III.2.
En principe, l’énergie libre se déduit de à une constante près, en intégrant sur les paramètres du modèle.
Proposition III.3.
Ces développements asymptotiques sont uniformes tant que les paramètres du modèle prennent des valeurs à distance bornée loin de de celles où explose ou l’hypothèse III.2 est prise en défaut.
III.2.4 Lien avec la version de la récurrence topologique
Supposons d’abord que est indépendant de et . Nous savons maintenant que et admettent un développement asymptotique en lorsque :
| (III-23) |
pour une constante indépendante de . Nous pouvons donc appliquer le formalisme de la récurrence topologique555C’est simplement une mise en forme des coefficients , et calculés pédestrement avec l’opérateur à l’Éqn. III-22. présenté au § II.4.1. La courbe spectrale s’écrit666 donc est indépendante de contre les apparences. :
et les autres coefficients du développement valent :
Imaginons à présent que l’on s’intéresse à un potentiel , qui admet un développement asymptotique quelconque. Une astuce est d’introduire des nouveaux paramètres et , qui n’ont rien à avoir avec , le nombre de valeurs propres, et , l’exposant de répulsion entre valeurs propres. Si l’on suppose que le modèle avec potentiel satisfait les hypothèses III.1 et III.2 pour toutes valeurs de (finie ou infinie) et , il admet pour une courbe spectrale le développement LABEL:eq:asynfu, qui est uniforme par rapport à . On peut également calculer le développement asymptotique lorsque de et . Grâce à l’uniformité, il suffit de substituer , et de regrouper les termes de même ordre en dans et : le modèle avec potentiel admet lui aussi un développement asymptotique quand . Naturellement, si le développement de contient des termes qui ne sont pas des puissances de , il en sera de même du développement de et . Il se calcule nonobstant en regroupant les termes donnés par la version de la récurrence topologique.
III.2.5 Modèles de matrices généralisés
Ces résultats peuvent être étendus à des modèles de matrices généralisés :
Le théorème d’unicité de et les bornes a priori de [dMPS95] sont toujours valides pourvu que la fonctionnelle soit strictement convexe :
| (III-25) |
Les hypothèses III.1 et III.2 seront alors valides dans un régime à une coupure. La condition de convexité s’écrit toujours :
pour toute mesure signée telle que . Si l’on décompose , on peut utiliser à nouveau l’astuce Éqn. III-9 et calculer :
Le modèle trivalent (et sa déformation ) est un bon exemple pour voir cette condition à l’œuvre :
| (III-26) |
Pour , ce modèle est étudié du point de vue des intégrales formelles de matrices en partie V.3, en particulier dans le régime . Ici, considérons l’intégrale convergente associée à Éqn. III-26. On trouve :
où sont les parties réelles et imaginaires de . Si , on peut conclure que est strictement convexe. De plus, lorsque le potentiel conduit à un régime à une coupure, l’opérateur a été construit dans [Eyn95, EK95] et prend la forme Éqn. III-18.
Proposition III.4.
III.3 Asymptotique dans un régime à plusieurs coupures
Dans cette partie, nous allons suivre la méthode proposée par [Eyn09] pour obtenir de façon heuristique l’asymptotique des intégrales de matrices convergentes, dans un régime à plusieurs coupures. La formule finale (Éqn. III.3.2) sera utile au Chapitre IV. Au passage, nous verrons quels problèmes importants il faudrait résoudre pour démontrer cette asymptotique.
III.3.1 Une bonne base de contours
Nous nous intéresserons ici à une mesure à valeurs complexes :
où est une fonction entière de et . Par exemple, est admissible ssi est un entier. Nous supposerons également, par souci de simplicité, que est un polynôme de degré à coefficients complexes, indépendants de . Au lieu de placer les par défaut sur l’axe réel, nous allons les placer sur des cycles du plan complexe. désigne alors une mesure curviligne quelconque sur . Puisque est une fonction entière des , est inchangé si l’on déforme continument les . Les seuls contours qui donnent une contribution non nulle sont ceux qui passent par l’infini. Et, afin que l’intégrale soit convergente, ils doivent le faire dans la région où lorsque . Par conséquent, il existe contours indépendants sur lesquels on peut placer les valeurs propres (Fig. III.4). Définissons une fonction de partition en plaçant valeurs propres sur :
Les sont les fractions de remplissage. Comme , il n’y a que fractions de remplissage indépendantes.
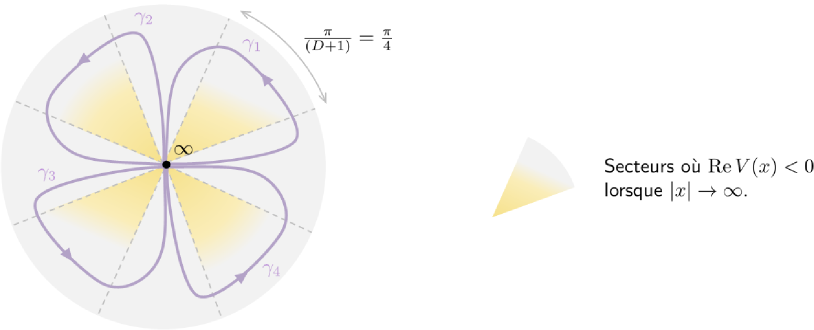
Puisque croît assez vite à l’infini le long des , les équations de Schwinger-Dyson associées à ne contiennent pas de termes de bord. De plus, elles sont indépendantes des . L’exemple du modèle à une matrice hermitienne permet de bien comprendre cette liberté. L’équation de Schwinger-Dyson au rang fait intervenir la quantité a priori inconnue :
Il est clair que est un polynôme de degré , dont le coefficient dominant vaut si l’on a noté celui de . contient donc coefficients inconnus, i.e. autant que de fractions de remplissage indépendantes. Ce décompte est rassurant, mais ne prouve pas que les coefficients de sont en bijection avec les fractions de remplissage (la situation est en général plus compliquée).
Nous allons supposer :
Hypothèse III.3.
Il existe une base d’homologie de contours , de sorte que, à fractions de remplissage fixées , admette un développement en puissances de :
À l’heure actuelle, cette hypothèse n’a reçu de preuve complète que dans le modèle à une matrice hermitienne avec potentiel polynômial. Même dans ce modèle, la preuve est indirecte. En effet, les techniques de minoration/majoration utilisées pour la partie III.2 sont valables pour des mesures de probabilité, et il n’est pas facile de les étendre au cas où est une mesure complexe. Démontrer le Lemme III.1, qui assure que les valeurs propres vivent dans une région bornée de à des configurations de poids exponentiellement petit près, demanderait déjà de nouvelles astuces. Qualitativement, on s’attend à ce que l’hypothèse III.3 soit vraie, avec pour une base de chemins de plus grande pente pour . Dans ce cas, une valeur propre sur ne voit alors qu’un potentiel avec un seul minimum global , donc les valeurs propres vivant sur devraient se condenser sur une partie connexe de autour de . Si c’est le cas, on a alors une égalité, valable ordre par ordre en :
Connaissant ces intégrales de cycles, on pourrait inverser l’opérateur qui intervient dans les équations de Schwinger-Dyson, et démontrer l’existence d’un développement en . Les coefficients seront automatiquement calculés par la récurrence topologique appliquée à la courbe spectrale du modèle. C’est une courbe spectrale de genre maximal 888On rappelle que les fractions de remplissage sont en correspondance avec les formes holomorphes sur la courbe spectrale : son genre est le nombre de fractions de remplissage indépendantes et non nulles.. Elle est caractérisée, en sus des équations de boucles linéaires, par les intégrales de cycles (cf. § II.3.1) :
| (III-27) |
III.3.2 Somme sur les fractions de remplissage
Cherchons à calculer l’asymptotique de :
où est un contour sans bords du plan complexe, en acceptant l’hypothèse III.3. se décompose sur un sous-ensemble des chemins de la base où , dans le sens où :
| (III-28) |
On peut d’ailleurs donner un sens au membre de gauche pour , que l’on va représenter . Éqn. III-28 est une somme toutes les configurations possibles de fractions de remplissage. Chaque terme admet un développement asymptotique , et possède une phase, car il a fallu introduire des chemins passant par le plan complexe, même si est au départ sur l’axe réel. L’interférence de tous ces termes donne naissance à des oscillations rapides avec , et l’asymptotique de la somme ne peut être en général de la forme .
On s’attend à ce que les configurations voisines d’un maximum global de dominent la somme. Ceci suggère, heuristiquement, que relever la contrainte dans la somme n’a qu’un effet exponentiellement petit. On peut même à ce prix étendre la somme à , et l’on conjecture , avec :
| (III-29) |
La fonction de partition modifiée est plus facile à manier. Nous allons la mettre en forme pour arriver au résultat final Éqn. III.3.2.
Maxima et condition de Boutroux
Comme nous avons utilisé plusieurs notations suivant le contexte, rappelons que l’ordre dominant de , le prépotentiel de , et la valeur de la fonctionnelle Éqn. III-7 pour la mesure d’équilibre à fractions de remplissage fixée, désignent le même objet.
Les cycles qui forment avec les cycles une base symplectique de sont duaux aux variations des fractions de remplissage (§ II.2.9) :
où est la matrice des périodes de .
Si est réel et est un minimum local de , vérifie999L’existence d’un minimum local dans le domaine , est assurée par . Il y a des subtilités car certains pourraient être nuls, et nous admettrons que la restriction initiale à un uple de fractions de remplissages non nulles, avec , permet d’en tenir compte. Il y a aussi des difficultés importantes pour identifier les cycles lorsque n’est pas une réunion d’arcs (mais plutôt une réunion d’arbres). Pour cette raison, le problème de Boutroux n’est pas résolu en général. Seul le cas des courbes spectrales hyperelliptiques est bien compris [Ber07]. :
Cela signifie que est nul pour tout cycle . Le problème de Boutroux consiste à trouver de tels sous la contrainte Éqn. III-27.
Mise en forme
On choisit un quelconque, pas nécessairement un minimum pour , ce qui sera commenté plus tard. Nous allons développer en série de Taylor au voisinage de , en mettant de côté les contributions divergentes quand (à fixé) dans chaque terme exponentiel. Quelques notations préliminaires :
On note , et .
Si et sont deux uples, désigne leur produit scalaire.
On note la différentielle d’ordre de par rapport au uple , évaluée en . Autrement dit, pour tout uple :
désigne la suite de longueur .
Si la seconde ligne n’existait pas, nous aurions une somme qui ressemble à une fonction thêta de genre :
| (III-30) |
avec et prenant les valeurs :
Cette série converge car est définie positive. Remarquons qu’il suffit de dériver fois Éqn. III-30 par rapport à afin de calculer la même somme avec une insertion de . Finalement :
Le premier facteur est simplement le développement asymptotique lorsque de . Le second produit toute une série de dérivées de fonctions thêta, avec des préfacteurs (), et dont la variable dépend linéairement de . Écrivons explicitement le début de cette série, en notant :
Commentaire
La définition standard de la fonction thêta de Riemann est :
C’est une fonction périodique suivant et quasi périodique suivant :
La fonction lui est reliée par :
et en conséquence est quasi périodique dans les directions et .
III.3.3 Conclusion
Les méthodes basées sur les équations de Schwinger-Dyson permettent d’établir le développement asymptotique d’une grande classe de modèles à une matrice dans un régime à une coupure. Des ajouts seraient nécessaires pour démontrer avec ces outils l’asymptotique dans un régime à plusieurs coupures. Cela passe par une généralisation de la partie III.2 au cas où la mesure est complexe. Une extension aux modèles à plusieurs matrices est aussi souhaitable. Néanmoins, le résultat attendu (Éqn. III.3.2) est bien compris, il s’exprime uniquement en termes d’objets définis par la récurrence topologique du Chapitre II appliquée à la courbe spectrale du modèle de matrice.
Ces méthodes sont bien sûr applicables aux modèles de matrices intégrables, comme les modèles . On peut espérer que ces outils pourront suppléer l’approche de Riemann-Hilbert, là où elle n’a pas encore été appliquée en raison de difficultés techniques. Un enjeu important serait :
Problème III.1.
Établir le développement asymptotique Éqn. III.3.2 pour la chaine de matrice Éqn. LABEL:sec:chain avec potentiels polynômiaux (voire plus généraux).
Cela reviendrait à établir le développement asymptotique des polynômes biorthogonaux. Les courbes de Boutroux jouent un rôle important pour cet asymptotique. Une autre interprétation de assure que est le lieu d’accumulation des zéros des polynômes (bi)orthogonaux lorsque , et que est leur densité [Dei98]. Le problème inverse est tout aussi intéressant, et intimement relié au problème de Boutroux :
Problème III.2.
Construire des familles de polynômes (bi)orthogonaux à coefficients complexes, dont les zéros s’accumulent d’une façon prescrite sur une réunion d’arcs ou d’arbres dans le plan complexe.
III.4 Statistique de
La théorie des matrices aléatoires s’intéresse à toutes les questions imaginables sur la statistique des . Après le choix d’une bonne échelle, quelle est la loi de la -ème valeur propre (par ordre décroissant), de l’espacement entre deux valeurs propres, … dans la limite ? Et, est-ce que ces lois sont robustes lorsque les paramètres du modèle changent, se rangent-elles dans des classes d’universalité ? Dans l’article [BEMN10] écrit avec Bertrand Eynard, Satya Majumdar et Céline Nadal, nous avons illustré l’intérêt des méthodes basées sur la récurrence topologique, en étudiant la distribution du maximum des valeurs propres dans un modèle à une matrice (Éqn. III-1) :
Nous supposerons que est un potentiel polynômial indépendant de et , et qui conduit pour la mesure à un régime à une coupure. On note son degré. Par convention .
Les résultats essentiels de [BEMN10] seront exposés aux § III.4.3 et III.4.4. Cet article prend l’existence de l’asymptotique en puissances de dans les modèles comme une hypothèse, car il est antérieur à [BG11] où cette asymptotique est établie.
III.4.1 Description qualitative
Dans la situation à une coupure que nous étudions, les valeurs propres se condensent dans la limite grand, sur un segment pour la mesure . En particulier, vaut en moyenne. Un argument classique, valable pour tout , permet d’évaluer l’échelle de ses fluctuations autour de . La densité limite de valeurs propres sur ne dépend pas de , elle est de la forme :
où est un polynôme de degré . Si est générique, se comporte en près de . Le nombre de valeurs propres supérieures à est en moyenne . On s’attend à , d’où l’estimation .
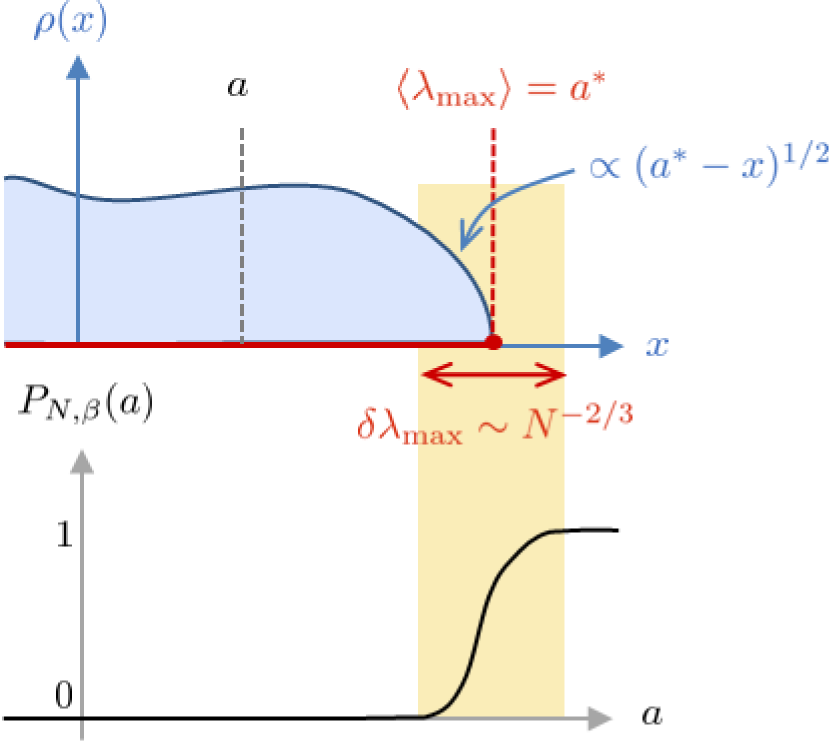
Si l’on choisit , les évènements "" sont rares. En fait, la mesure conditionnée reste dans un régime à une coupure tant que , et les résultats de la partie III.2 sont applicables101010Ici, le bord est dur, tandis que le bord est mou. La justification des résultats de la partie III.2 dans ce cas se trouve dans [BG11]. Par conséquent, la probabilité de "" est de l’ordre de lorsque est grand. Plus précisément, en notant la courbe spectrale du modèle conditionné :
Les premiers termes de cette série sont :
| (III-33) | |||||
On identifie la fonction de grande déviation , et les autres en calculent les corrections de taille finie.
Si l’on zoome autour de à l’échelle , on s’attend à voir la transition entre lorsque , et lorsque (Fig. III.5). Il devrait exister une limite :
| (III-34) |
On s’attend également à ce que cette limite soit universelle pour la classe des potentiels (ne conduisant pas nécessairement à un régime une coupure) tel que au voisinage du maximum du spectre. Autrement dit, si et sont de tels potentiels :
| (III-35) |
pour une constante non universelle .
III.4.2 Lois de Tracy-Widom
Ce paragraphe résume ce qui est connu sur les distributions , et qui nous intéresse au premier chef pour situer les résultats de [BEMN10].
Le modèle pour ces valeurs est un modèle de matrice associé à un des groupes de symétrie classique (Fig. I.1), soluble par les techniques de polynômes orthogonaux (partie I.2). Les fonctions de corrélation de densité entre valeurs propres s’écrivent :
Un calcul utilisant cette représentation déterminantale montre alors que la probabilité de soit inférieure à est un déterminant de Fredholm :
Pour le potentiel (et par convention), les noyaux pertinents sont reliés au noyau d’Airy (Fig. I.7). En étudiant leur limite, Tracy et Widom [TW94, TW96] ont établi l’existence de la limite Éqn. III-34 pour tout . Nous noterons les fonctions de Tracy-Widom :
| (III-36) |
Ces auteurs ont surtout établi des équations différentielles pour les déterminants de Fredholm sur , qui leur ont permis notamment de représenter en fonction de la solution d’une équation de Painlevé II.
| (III-37) |
et est l’unique solution de telle que lorsque . Son existence et unicité ont été prouvée par Hastings et McLeod [HM80], et elle se comporte aussi comme
| (III-38) |
Cette équation de Painlevé II apparait comme la condition de compatibilité dans un système intégrable , nous y reviendrons au § IV.2.3.
L’universalité des lois de Tracy-Widom a été démontrée par Deift et Gioev [DG07]. Grâce aux asymptotiques des polynômes orthogonaux établis par les méthodes de Riemann-Hilbert [DKM+99a], ces auteurs contrôlent la convergence du noyau vers le noyau d’Airy, de manière suffisamment précise pour établir l’universalité au bord du spectre.
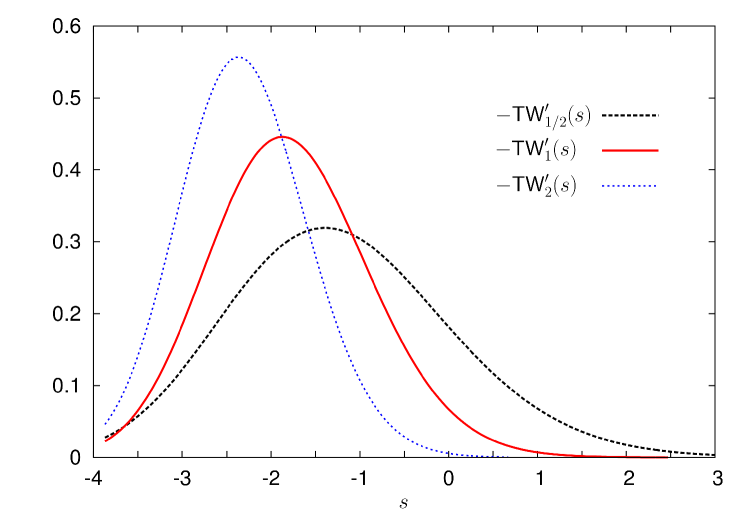
Le développement de la queue gauche des lois de Tracy-Widom, i.e. lorsque , se déduit récursivement de l’Éqn. III-37 et de l’équation de Painlevé II, sauf le préfacteur constant qui est difficile à obtenir.
La valeur de la constante pour a été conjecturée par Tracy et Widom [TW94] d’après une coïncidence numérique, et établie par Deift, Its et Krasovsky [DIK08]. En étudiant plus généralement les intégrales de , Baik, Buckingham et DiFranco [BBd08] ont retrouvé et déterminé la valeur de et :
est le prolongement analytique de la fonction zêta de Riemann . Toutes ces preuves utilisent les techniques de Riemann-Hilbert.
Ce genre de constante a pour origine l’asymptotique de la fonction de Barnes [Vor87] :
qui intervient dans les intégrales de Selberg (Éqn. LABEL:eq:SelL et I-27). En fait, c’est la version de la fonction de Barnes qui apparaissait :
| (III-39) |
Mais, pour , ou grâce à la formule de duplication pour , s’exprime en termes de .
quelconque
Les informations pour quelconque sont plus rares, et datent principalement des cinq dernières années. Éqn. III-34 a été démontrée pour un potentiel par Rider, Ramírez et Virág [RRV06]. Leur point de départ est la représentation du modèle comme un modèle à une matrice tridiagonale aléatoire de taille : ils démontrent que, dans la limite , les premières plus grandes valeurs propres convergent en loi, après une mise à l’échelle, vers celles d’un opérateur de Schrödinger perturbé par le processus brownien et agissant sur :
L’équation de Schrödinger stochastique est équivalente à une équation de Ricatti stochastique vérifiée par :
La probabilité que soit plus petite que s’interprète alors, dans la limite grand, comme la probabilité que le processus , avec la condition initiale , ne rejoigne pas en temps fini. Cela définit une "loi de Tracy-Widom ", notée111111Par la suite, nous noterons génériquement , et cela sous-entendra qu’il faut remplacer lorsque pour coller à la définition standard (Éqn. III-36). . Par ailleurs, Rider [Rid10] a annoncé une preuve de l’Éqn. III-34 pour tous les potentiels polynômiaux pairs, ainsi qu’un résultat d’universalité.
Bloemendal et Virág [BV10] ont dérivé de cette interprétation stochastique une équation différentielle maitresse pour calculer . Leur résultat dit que , où est l’unique solution bornée de
| (III-40) |
Pour , ces auteurs ont vérifié que les représentations Éqn. III-37 sont bien solutions de ce problème, mais le cas leur a résisté. Cette caractérisation donne un point de vue nouveau sur les lois de Tracy-Widom, dont il faudrait explorer les liens (s’il y en a) avec les systèmes intégrables.
En travaillant sur l’interprétation stochastique, [RRV06] ont pu établir le premier terme de la queue gauche :
Sans connaitre ces travaux, à la même époque, Dean et Majumdar [DM06] ont obtenu ce résultat heuristiquement, en calculant la fonction de grande déviation pour , et en insérant dans cette expression. désigne ici la densité limite des valeurs propres dans le modèle conditionné . Notre article [BEMN10] est en fait une extension de cette démarche à tous les ordres en , puisque la récurrence topologique donne tous les coefficients et leurs propriétés.
Toujours avec l’interprétation stochastique, signalons enfin que [DV11] ont établi les deux premiers termes de la queue droite :
III.4.3 Grandes déviations
Courbe spectrale
Si , est un bord dur pour le modèle conditionné . La densité limite de valeurs propres dans ce modèle est supportée par un segment . D’après les équations de Schwinger-Dyson, dans ce modèle diverge en lorsque , et reste finie partout ailleurs sur :
| (III-41) |
Qualitativement, une fraction macroscopique de valeurs propres voudraient se condenser aussi dans la région qui leur est interdite, donc marquent leur préférence en s’accumulant à gauche de . La manière la plus efficace de résoudre l’Éqn. III-12 passe par le paramétrage de Joukovski (Fig. III.7), qui ouvre la coupure . Grâce à lui, on peut calculer la courbe spectrale , et résoudre récursivement et "à la main" les premières équations de Schwinger-Dyson : les sont des fractions rationnelles des , et cette résolution requiert seulement des calculs de décompositions en éléments simples. Cela est expliqué en détail dans [BEMN10], mais ce n’est qu’une application de la version de la récurrence topologique développée dans [CE06], à une courbe spectrale de genre .
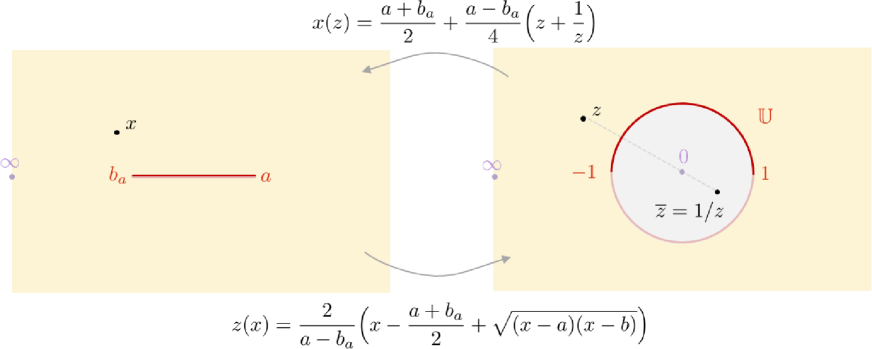
Si l’on décompose sur les polynômes de Tchebychev :
Il est commode d’écrire la fonction définissant la courbe spectrale sous une forme équivalente :
| (III-42) |
Cela met en évidence les zéros de dans le feuillet physique. C’est leur distance à qui contrôle la norme de l’opérateur (§ III.2.1). L’extrémité est déterminée par la condition lorsque , qui s’écrit :
Le noyau de Bergman est (cf. II.3.1).
Quelques résultats explicites
Comme est de genre , les calculs peuvent être menés à terme avec des fonctions élémentaires. Voici les expressions des termes de qui subsistent dans la limite (Éqn. III-33).
La fonction de grande déviation , avec le prépotentiel défini à l’Éqn. II-18. Plus explicitement :
| (III-43) |
Cette expression est un avatar du théorème de la limite forte de Szegö [Sze52].
La première correction, , est au signe près l’entropie de la distribution .
a été défini à l’Éqn. II-17. Puisque est de genre , il n’y a pas d’intégrales de cycles dans la fonction tau de Bergman :
| (III-45) |
est reliée à certains déterminants d’opérateurs sur la courbe spectrale [WZ06], comme .
| (III-46) | |||||
Les expressions ci-dessus sont des formules closes pour les termes instables de la récurrence topologique (les plus difficiles à calculer). Pour tous les autres , il y a un algorithme uniforme via la formule d’intégration :
| (III-47) |
Pour les obtenir de façon explicite, il suffit de résoudre mécaniquement les équations de Schwinger-Dyson pour , qui forment une récurrence sur [CE06]. Le résultat de l’Éqn. III-47 sera une fonction rationnelle symétrique des .
III.4.4 Connection avec les lois de Tracy-Widom
Universalité
La famille de courbes est singulière dans la limite , car devient brusquement un point de branchement mou lorsqu’il atteint . Cette situation advient lorsque l’un des zéros de dans le feuillet physique tend vers (appelons-le ). Génériquement, on trouve pour une constante positive , tandis que les autres tendent vers . D’après § II.2.8, il faut calculer la résolution de la famille de courbes spectrales au voisinage de . L’effet de se fait sentir à l’échelle où est d’ordre , si l’on pose . L’Éqn. III-42 devient :
| (III-48) |
La courbe spectrale est universelle :
| (III-49) |
et décrit la résolution de à une constante de proportionnalité (indépendante de ) non universelle près :
| (III-50) |
Par conséquent, si l’on note les invariants symplectiques de :
Puisque les sont universels, leur valeur pour se déduit aisément des formules closes III-43-III-46 en choisissant le cas simple d’un potentiel gaussien :
Et tous les autres se calculent avec la (version de la) récurrence topologique appliquée à [CE06]. Voici les premiers:
Les constantes et sont a priori non universelles121212A posteriori, on vérifie que . Il est probable que pour des constantes universelles et , mais je n’ai pas fait le calcul., il faut les calculer à partir de III-45-III-46.
Double limite d’échelle
Comme attendu, chaque terme du développement LABEL:eq:devv devient d’ordre lorsque la variable d’échelle est d’ordre , et les précédents contribuent pour lorsque . En général, la somme de tous ces termes d’ordre n’est pas convergente. Il faut plutôt lui donner, heuristiquement, la signification de développement asymptotique lorsque . Ainsi, nous avons une prédiction pour la queue gauche de à tous les ordres (formules LABEL:eq:TWde et III-53 ci-dessous). De plus, cette prédiction vérifie la propriété d’universalité (Éqn. III-35) : les coefficients du développement sont les invariants symplectiques de la courbe spectrale universelle , qui décrit lorsque approche le bord du spectre (Éqn. III-48). La constante de normalisation est explicitement calculable (Éqn. III-50).
Pour avoir les normalisations correctes, il faut calculer les constantes qui apparaissent avec le potentiel gaussien qui définit .
| (III-51) | |||
Par conséquent :
avec la constante :
En analogie avec [BBd08], cette constante se compose de trois morceaux :
Morceau exact est le facteur de normalisation entre l’intégrale sur les valeurs propres avec bords durs , et la définition des invariants symplectiques de la courbe spectrale (Éqn. III-23). Il ne dépend pas de , et : on peut le déterminer lorsque l’on a des formules closes, d’une part pour l’intégrale sur les valeurs propres, d’autre part pour tous les . Le choix et fait l’affaire. D’une part, se ramène lorsque à une intégrale de Selberg pour l’ensemble de Laguerre (Éqn. LABEL:eq:SelL). D’autre part tous les pour sont des dans cette limite, et se déduisent des formules III-43-III-46 pour .
Morceau d’Airy La deuxième ligne est essentiellement le facteur de normalisation entre l’intégrale sur les valeurs propres sans bords durs , et la définition des invariants symplectiques. Il se calcule à partir de l’Éqn. III-51 et de , qui est une intégrale de Selberg avec poids gaussien (Éqn. I-27).
Choix de la variable d’échelle Le développement asymptotique de contient un logarithme , donc son terme constant est sensible à la normalisation choisie pour la variable d’échelle . La troisième ligne est liée à ce phénomène.
Le calcul montre que la limite existe bien, ce qui est rassurant pour la consistance de ce paragraphe.
| (III-53) |
Le morceau d’Airy et le morceau exact font intervenir (via les intégrales de Selberg) la déformation de la fonction de Barnes (Éqn. III-39), et plus précisément sa partie finie :
Les formules LABEL:eq:TWde et III-53 sont en accord avec tous les résultats connus évoqués au § III.4.2. Il faut souligner que la dérivation de ce paragraphe est heuristique, elle suppose que l’on peut prolonger les résultats obtenus rigoureusement à fixé, jusqu’à . En fait, il suffirait pour le justifier de démontrer l’existence d’un développement en pour lorsque . C’est un problème à explorer à la lumière du début de ce chapitre.
Commentaires
Cette méthode ne donne malheureusement pas de caractérisation de la loi de Tracy-Widom , ni ne permet de vérifier à la main si satisfait une équation différentielle comme Éqn. III-40. Pour le cas intégrable néanmoins, il existe une relation précise entre récurrence topologique et systèmes intégrables131313On ne dispose pas actuellement d’une théorie analogue pour les cas ou , dont on sait pourtant qu’ils sont intégrables., qui sera présentée au Chapitre IV. Cela a été exploité dans l’article [BE10b] pour démontrer que :
est bien le développement asymptotique de représenté en termes de la solution d’Hastings-McLeod de Painlevé II (Éqn. III-37).
À cause de la structure particulière en du développement LABEL:eq:TWde, on peut remarquer une dualité au niveau des développements asymptotiques :
où désigne le choix du signe opposé pour la racine carrée. Une relation de ce type existe par exemple entre deux solutions indépendantes d’une équation de Schrödinger. Cela suggère que et correctement normalisés sont solutions d’une même équation différentielle d’ordre deux. À l’heure de l’écriture, cette dualité n’est pas évidente à partir de la caractérisation III-40.
La queue droite de à tous les ordres pourrait être étudiée par les mêmes méthodes. Il faudrait plutôt employer le modèle de matrice pour la densité de probabilité de :
avec le potentiel dépendant de et de :
Qualitativement, lorsque , ce modèle sera dans un régime à une coupure, avec un support tel que . Les résultats de la partie III.2 s’appliqueront, avec la procédure évoquée au § III.2.4 pour traiter la dépendance en du potentiel.
D’autres statistiques de valeurs propres (et leur régime d’échelle pour grand) seraient calculables dans les modèles quelconque par les mêmes méthodes, parallèlement à [For10, Chapitre 9] qui expose les méthodes basées sur les déterminants de Fredholm pour . De notre point de vue, il suffirait d’étudier un modèle de matrice approprié avec bords (et sa double limite d’échelle), de préférence dans un régime une coupure car les calculs sont plus tractables. Deux exemples parmi d’autres :
La loi jointe des plus grandes valeurs propres .
Qualitativement, ce modèle devrait avoir une coupure dans le régime où .
La probabilité qu’un segment fixé ne contienne aucune valeur propre :
Lorsque , i.e. au milieu du spectre, c’est un modèle de matrice à deux coupures.
Cela conduirait de façon systématique à des résultats nouveaux pour , mais un peu frustrants à l’heure actuelle en l’absence de méthode pour caractériser ces lois. Inversement, pour , les lois sont connues et l’on établirait leurs relations avec la récurrence topologique appliquée à certaines courbes spectrales.
Chapitre IV Systèmes intégrables et équations de boucles
Nous commençons par fixer les définitions et les objets associés à un système intégrable classique : problème linéaire, noyau intégrable, fonction tau, équations de Hirota, courbe spectrale, … Nous définissons aussi des "corrélateurs" à la suite de Bergère et Eynard, et proposons une méthode plus efficace pour montrer qu’ils satisfont des équations de boucles. Lorsque la courbe spectrale est de genre , le Théorème IV.2 établit le lien entre asymptotique BKW (à tous les ordres) d’un système intégrable, et récurrence topologique. Réciproquement, nous rappelons et reformulons la construction algébro-géométrique de Krichever, qui associe un système intégrable à une courbe spectrale fixée. On peut chercher à construire un système intégrable dispersif, qui est une déformation du précédent où la courbe spectrale évolue lentement au cours du temps. Guidé par le résultat heuristique pour l’asymptotique des modèles de matrices, nous exhibons des formules pour la fonction d’onde, la fonction tau, … à tous les ordres dans le paramètre lent. Leur validité repose sur une conjecture équivalente à l’équation de Hirota, qui reste en suspens à l’heure de l’écriture.
IV.1 Qu’est-ce-qu’un système intégrable ?
IV.1.1 Introduction informelle
Il existe plusieurs définitions, pas toujours équivalentes, des systèmes intégrables. Dans cette thèse, il sera question de systèmes intégrables classiques définis par la donnée d’une famille compatible de systèmes différentiels linéaires. Cela doit être compris au sens large. Voici une revue des notions associées à un système intégrable, pour situer le vocabulaire que nous allons employer. Nous utiliserons souvent le livre [BBT02] comme référence.
Chaque système différentiel définit un flot, et l’on appelle temps le paramètre d’évolution correspondant. En général, une des variables d’évolution joue un rôle particulier, on la note , et la famille des autres temps est notée . L’ensemble de ces systèmes différentiels est appelé problème linéaire : il se traduit typiquement en équations différentielles linéaires de type Schrödinger (et leur généralisation d’ordre ) à une dimension, dont les coefficients dépendent de tous les paramètres d’évolution. Une solution de ce problème est génériquement notée , et appelée fonction de Baker-Akhiezer. Les conditions de compatibilité du problème linéaire donnent par élimination des équations aux dérivées partielles, non linéaires, vérifiées par les coefficients . Elles forment une hiérarchie intégrable, caractérisée par l’existence d’une quantité conservée par flot .
La compatibilité des systèmes différentiels implique l’existence d’une fonction tau , telle que soit le ratio de deux fonctions tau. C’est la formule de Sato :
Une caractéristique importante des systèmes intégrables est que, une fois la fonction tau construite, l’évolution de est linéaire dans tous les temps : c’est la manifestation de la commutativité des flots . L’étude des propriétés analytiques dans la variable de permettent d’établir une identité bilinéaire pour les solutions du problème linéaire. Cela implique pour la fonction une équation fonctionnelle bilinéaire, appelée équation de Hirota. Celle-ci est équivalente à la hiérarchie intégrable. L’équation de Hirota peut être écrite de plusieurs façons, mais c’est essentiellement la même équation dans tous les systèmes intégrables. Sa solution générale peut toujours s’écrire comme un déterminant infini (qui se réduit parfois à un déterminant fini).
À partir des fonctions de Baker-Akhiezer, on peut construire un noyau intégrable qui a des propriétés remarquables. L’équation de Hirota équivaut notamment à une propriété d’autoréplication pour le noyau intégrable.
À partir de la fonction tau, on peut définir111Cette définition a été proposée par Bergère et Eynard [BE09]. Toute mention d’une référence antérieure serait bienvenue. des corrélateurs non connexes à points qui encodent les dérivées de la fonction par rapport aux temps. La formule de Sato se traduit par une formule exponentielle, exprimant le noyau intégrable en fonction de tous les corrélateurs. Réciproquement, l’autoréplication de entraine des formules déterminantales, exprimant le corrélateur à points comme des déterminants du noyau intégrable :
IV.1.2 Exemples brefs
La hiérarchie KP
La hiérarchie KP est un exemple fondamental de système intégrable. Les hiérarchies de Painlevé, les modèles minimaux que nous rencontrerons plus tard, sont en fait des réductions ou des troncations de KP (voir la définition un peu plus loin). Il n’est pas question de la présenter ici (cf. [BBT02]), mais plutôt d’illustrer à partir de l’équation de Hirota pour KP :
| (IV-1) |
comment apparait la hiérarchie d’équations différentielles non linéaires. Ici, les temps sont indexés par . La première étape est de développer en série de Taylor :
Le premier ordre de l’Éqn. IV-1 qui contient une information est :
où :
En dérivant deux fois par rapport à , on trouve que satisfait :
À des coefficients numériques près que l’on peut absorber dans la définition des , c’est l’équation originale de Kadomtsev et Petviashvili [KP70]. Elle décrit la propagation selon d’une perturbation dans un milieu faiblement dispersif à deux dimensions . Elle peut être dérivée par des arguments physiques en supposant l’échelle de variation de dans la direction assez grande pour que le caractère dispersif ne s’y manifeste pas. Dans la limite d’un problème unidimensionnel (), cet argument conduit à l’équation de Korteweg-de Vries [KdV95] :
qui a été utilisée historiquement pour modéliser les mascarets.
Tronquer la hiérarchie revient à imposer lorsque pour un certain . Réduire la hiérarchie signifie rechercher des solutions qui ne dépendent que de certaines variables d’échelle construites à partir des temps.
Les modèles minimaux
Il existe des troncations, réductions de la hiérarchie KP, qui se ramènent au problème suivant : trouver deux opérateurs différentiels et , de degrés et premiers entre eux, tels que
| (IV-2) |
Cela définit les modèles minimaux , et est appelée équation de corde. La solution générale pour s’écrit [dFGZJ94] :
| (IV-3) |
L’équation de corde détermine alors les coefficients et à des constantes d’intégration près. On définit le temps tel que . La relation précise avec la fonction de la hiérarchie KP est alors .
Ces modèles minimaux interviennent dans la chaine à deux matrices hermitiennes (§ I.13). et sont les opérateurs représentés par les matrices infinies :
dans les bases et des polynômes biorthogonaux pour le produit scalaire défini à l’Éqn. I-31. Lorsque et sont de degrés respectifs et , et sont des matrices à bande finie de largeur et . Dans une double limite d’échelle, et deviennent au moins heuristiquement des opérateurs différentiels de degré et , et l’on est amené à étudier l’Éqn. IV-2.
En particulier, les modèles décrivent le point multicritique pour le modèle à une matrice hermitienne (polynômes orthogonaux cette fois). , i.e. le modèle , décrit le point critique correspondant à la gravité pure (§ I.6). En écrivant l’équation de corde pour et , on trouve en effet l’équation de Painlevé I :
| (IV-4) |
Naturellement, le modèle est inclus dans pour croissant, il suffit de geler certains des temps de l’Éqn. IV-3. L’équation de Painlevé I est donc contenue dans la hiérarchie d’équations du modèle minimal , que l’on appelle hiérarchie de Painlevé I.
IV.2 Déformations isomonodromiques
IV.2.1 Systèmes de Lax et problèmes de Riemann-Hilbert
Dans la suite de ce chapitre, notre point de départ sera un autre type de systèmes intégrables, que l’on appellera ici systèmes de Lax. Il est temps de passer de la présentation du § IV.1.1 à des formules concrètes. Initialement, on se pose le problème linéaire :
où est maintenant une matrice donnée de taille , et une matrice inversible. La littérature se place souvent dans le cas , où les coefficients de sont des fonctions rationnelles de , c’est aussi l’hypothèse que nous allons prendre. Il me semble que la plupart des énoncés de ce paragraphe sont généralisables (avec quelques subtilités) lorsque vit sur une surface de Riemann , et les coefficients de sont des formes méromorphes : cela pourrait faire l’objet d’un article dans le futur.
Flots et problème linéaire
Près des pôles de , toute solution a une singularité essentielle. Localement en , on peut la décomposer en une partie régulière , et une partie singulière :
En général, une solution possède des monodromies : si l’on prolonge analytiquement le long d’un cycle qui fait le tour de , ne revient pas à sa valeur initiale après un tour complet. De manière équivalente, est la solution d’un problème de Riemann-Hilbert : cela signifie qu’elle admet des discontinuités prescrites de part et d’autre de certains contours , où sont des matrices (Fig. IV.1). Ici, est une forme rationnelle en , donc sans monodromie, par conséquent les ne dépendent pas de .
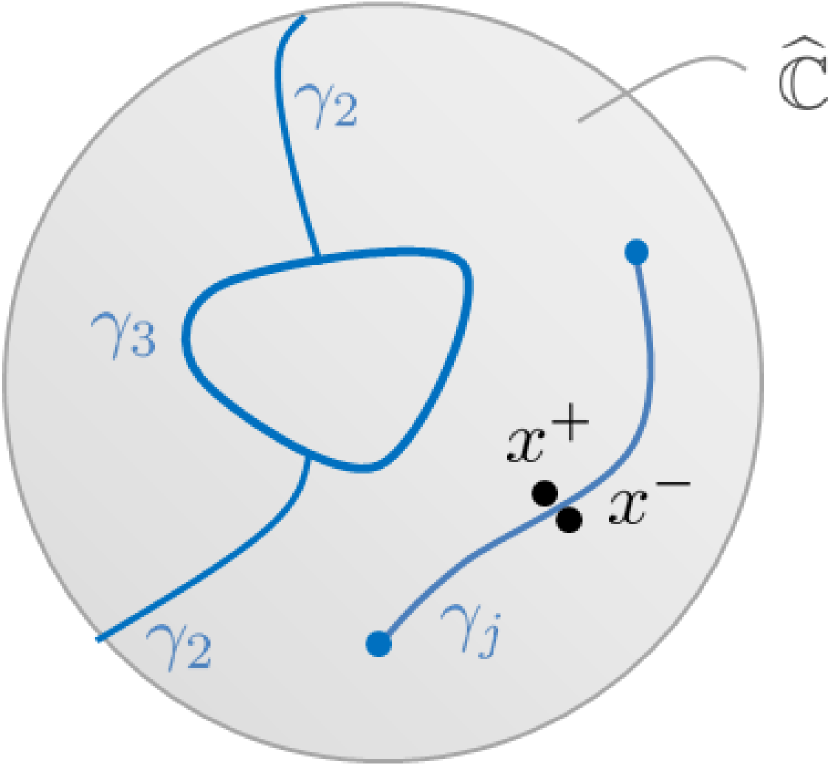
D’après une construction classique [BBT02, Chapitre 8], il existe une infinité de flots qui commutent (), avec lesquels évolue en tout en gardant les mêmes monodromies . D’où leur nom : déformations isomonodromiques. Ces flots perturbent le comportement de au voisinage de la singularité essentielle :
| (IV-5) |
est la matrice qui ne contient que des zéros, à l’exception d’un en position . désigne une coordonnée locale sur centrée en . Puisque l’on travaille sur , on peut prendre si , et .
Les temps sont spéciaux, car seules les transformations discrètes préservent les monodromies : elles sont appelées transformations de Schlesinger. Les flots pour sont eux définis de manière consistante par :
car ils vérifient les conditions de compatibilité :
désigne la partie divergente en de la décomposition en éléments simples de . Ainsi, et restent rationnelles. Par un argument déjà employé, cela assure que les monodromies ne dépendent ni de , ni de . Les temps diagonaux engendrent donc des transformations isomonodromiques continues pour , qui forment un sous-groupe commutatif maximal de déformations isomonodromiques. En fait, toutes les matrices élémentaires génèrent des déformations isomonodromiques, et l’on pourrait très bien choisir un autre sous-groupe commutatif de flots pour travailler.
Pour collecter tous les flots continus associés à un pôle et une direction , on définit l’opérateur d’insertion :
| (IV-6) |
Le problème linéaire se réécrit alors :
| (IV-7) |
Fonction tau et noyau
À toute famille de solutions , Jimbo, Miwa et Ueno ont montré222Le cas où n’est pas une matrice diagonale est un ajout de Bertola et Marchal [BM09a]. dans leur article fondateur [JMU81] que l’on peut associer une fonction vérifiant :
| (IV-8) |
Réciproquement, la solution du problème linéaire se déduit de par une formule de Sato (Éqn. IV-10, [SS83]). Cette fonction tau est un objet important pour les systèmes intégrables. Par exemple, s’annule en ssi le problème de Riemann-Hilbert que devrait vérifier avec les conditions Éqn. IV-5 n’a pas de solution. C’est un théorème dû à Malgrange [Mal83] lorsque est un pôle simple de , et à Palmer [Pal99] en toute généralité.
Le noyau intégrable, parfois appelé noyau de Christoffel-Darboux, est la matrice définie par :
Le fait que soit solution du problème linéaire Éqn. IV-7 se traduit par une propriété333Elle est équivalente à l’équation de Ricatti de [BBT02, Section 8.7]. d’autoréplication :
| (IV-9) |
La formule de Sato exprime en fonction de [BBT02] :
| (IV-10) |
désigne la famille de temps :
Le décalage dans l’argument de la fonction dans Eqn IV-10 comporte à la fois une évolution des temps diagonaux, et des transformations de Schlesinger. L’autoréplication pour (Éqn. IV-9) est alors équivalente à l’équation de Hirota pour .
Remarque
Dans la suite, nous commencerons souvent avec deux systèmes différentiels compatibles :
| (IV-11) |
dont l’équation de compatibilité est une équation différentielle par rapport à , non linéaire. Avec la construction évoquée ci-dessus, on peut toujours définir une infinité de flots qui sont compatibles avec l’Éqn. IV-11 et perturbent le comportement de au voisinage d’une singularité essentielle ( lui même s’identifiera peut-être avec une combinaison de ces flots). Cela garantit l’existence d’un opérateur d’insertion (Éqn. IV-6), qui sera cruciale pour la suite. On peut ensuite oublier l’existence des si on le souhaite et se concentrer sur le système initial Éqn. IV-11.
IV.2.2 Exemples
Hiérarchie de Painlevé I
Il existe un système de Lax de taille dont les équations de compatibilité sont équivalentes à celles du modèle minimal , i.e. à la hiérarchie de Painlevé I. Il est construit comme suit, avec un temps pour commencer :
| (IV-12) |
avec :
est le polynôme différentiel de Gelfand-Dikii, défini récursivement à des constantes d’intégration près par :
Les premiers termes sont :
L’équation de compatibilité s’écrit alors :
| (IV-13) |
Pour , , on retrouve bien l’équation de Painlevé I (Éqn. IV-4), et le problème linéaire associé se spécialise à :
est en quelque sorte le flot . On peut bien sûr construire tous les autres flots () en suivant le § IV.2.1.
IV.2.3 Équation de Painlevé II
Un exemple important en relation avec les lois de Tracy-Widom est la hiérarchie de Painlevé II. L’équation de Painlevé II :
| (IV-14) |
en est le premier représentant. C’est l’équation de compatibilité des deux systèmes définis par les matrices de Lax [AKNS74] :
| (IV-15) |
Le problème de Riemann-Hilbert associé est présenté en détail dans l’article original [FN80], et dans le livre [FIKN06] qui est une revue de la méthode générale. Il est important de garder à l’esprit l’équivalence entre systèmes isomonodromiques et problèmes de Riemann-Hilbert pour les applications potentielles de la partie IV.3, mais nous n’en aurons pas besoin ici. Signalons surtout :
Theorème IV.1.
Lorsque est la solution de Hastings-McLeod de Painlevé II, la fonction de ce système coïncide avec le déterminant du noyau d’Airy, qui est aussi la loi de Tracy-Widom pour (§ III.4.2) :
Ceci est la manifestation d’un phénomène général, étudié dans [BD02] : grosso modo, le déterminant de Fredholm d’un noyau intégrable est une fonction tau.
La hiérarchie complète de Painlevé II et le système de Lax correspondant sont décrits par exemple444Afin que la comparaison avec le système IV-15 soit plus facile, les matrices données par [BE03] ont été conjuguées par . par Bleher et Eynard [BE03] :
| (IV-20) | |||||
| (IV-23) |
avec :
et sont définis par une relation de récurrence à la Gelfand-Dikii :
L’équation de compatibilité s’écrit alors :
| (IV-24) |
On retrouve le système IV-15 lorsque et .
IV.3 Équations de boucles et conséquences
IV.3.1 Notion de courbe spectrale semiclassique
Lorsque que l’on veut étudier l’asymptotique d’une solution d’un problème linéaire, il est commode de redéfinir les différents paramètres de (, les temps , d’autres paramètres libres …), en introduisant un paramètre redondant , pour avoir un problème linéaire équivalent :
| (IV-25) |
Maintenant, chaque dérivée vient avec un préfacteur , et , et dépendent de . On garde cependant les définitions :
Cette mise à l’échelle est pertinente lorsque le régime asymptotique que l’on veut étudier correspond à , et lorsque et ont une limite et lorsque .
La courbe spectrale semiclassique associée555Cette définition sera complétée plus tard par un noyau de Bergman. à IV-25 est par définition la courbe algébrique :
Elle est toujours définie à partir de la limite du système différentiel par rapport à . C’est une courbe de degré en , il y a donc valeurs sur correspondant à une valeur de donnée. La raison de cette définition est que l’asymptotique de lorsque est de la forme :
| (IV-26) |
Cette équation est simplement l’ordre dominant d’une approximation BKW, donnant la relation de dispersion semiclassique où . Elle joue un rôle important lorsque l’on souhaite déterminer les coefficients d’un développement asymptotique complet de . On peut d’ores et déjà remarquer que le même raisonnement appliqué à conduit à :
avec déterminé par :
L’existence de systèmes différentiels compatibles, donc la possibilité de faire des calculs avec chacun des systèmes, pose des contraintes fortes sur les singularités en des coefficients du développement asymptotique de .
IV.3.2 Corrélateurs et équations de boucles
Motivés par les propriétés observées dans la chaine à deux matrices (un cas particulier de systèmes intégrables), Bergère et Eynard [BE09] ont proposé de définir des corrélateurs à points pour tout système de Lax, par des formules déterminantales :
Les corrélateurs non connexes sont simplement les déterminants :
signifie que l’on remplace chaque occurence de (qui n’a pas de sens à cause de la singularité de à points coïncidants) par , et chaque occurence de (qui elle aurait un sens) par .
Après un petit calcul :
et une simple comparaison avec la formule de Jimbo, Miwa, Ueno pour la fonction (Éqn. IV-8) montre que :
Autrement dit, les variations de le long des flots sont encodées dans le développement de Taylor666C’est en fait un développement en série de Laurent, dont la partie négative est trivialement connue. Ce phénomène de décalage pour et se manifestait déjà dans les modèles de matrices. de lorsque approche le pôle . La propriété d’autoréplication du noyau permet ensuite d’étendre ce résultat aux autres corrélateurs :
| (IV-27) |
au sens d’une égalité des développement de Taylor777Pour , voir la note précédente. lorsque . Ces formules peuvent aussi servir de définition des corrélateurs.
Ces objets sont particulièrement intéressants car ils vérifient des équations de boucles (comparer avec le § II.2.7).
Équation de boucle linéaire
| (IV-28) |
Équation de boucle quadratique
| (IV-29) |
Le point remarquable dans ces équations est que le membre de droite est une fonction rationnelle de dont la position des pôles est connue, alors que le membre de gauche vient d’une fonction multivaluée en . Puisque l’on a l’Éqn. IV-27, les applications successives de l’opérateur d’insertion génèrent l’ensemble des équations de boucles pour les .
IV.3.3 Lien avec la récurrence topologique
Supposons que les ait un développement asymptotique lorsque du type "développement topologique" :
| (IV-30) |
Si l’on insère ce développement dans les relations que l’on vient d’obtenir, on trouve que satisfait la hiérarchie d’équations de boucles du § II.2.7. La récurrence topologique en donne l’unique solution qui n’a de singularités qu’aux points de branchement de . D’où le théorème suivant :
Theorème IV.2.
Supposons :
et ont un développement asymptotique en puissances de :
défini par l’Éqn. IV-26 admet une limite quand .
Cela assure que admet un développement asymptotique :
Ajoutons d’autres hypothèses :
Pour tout , il existe une fonction méromorphe sur , définie par dans le feuillet , dont les singularités éventuelles se situent aux points de branchement de la courbe spectrale semiclassique ou aux pôles de ou de .
admet un développement asymptotique de la forme .
Alors, et admettent un développement topologique :
Les coefficients sont donnés par la récurrence topologique appliquée à la courbe spectrale semiclassique avec noyau de Bergman défini lorsque est dans le feuillet et dans le feuillet par :
Remarques
Les travaux de [BE09] n’utilisaient qu’un opérateur d’insertion formel. Pour ces auteurs, il était alors nécessaire d’établir les équations de boucles pour chaque , conduisant à une preuve assez technique et valable uniquement pour les systèmes . De plus, ils devaient supposer l’existence d’un développement asymptotique pour tous les afin d’avoir le résultat du Théorème IV.2. Je me suis rendu compte ensuite, grâce à [BBT02], qu’il existe toujours un opérateur d’insertion réalisé par des vrais flots (Éqn. IV-6). Cela permet d’étendre les résultats de [BE09] aux systèmes en toute généralité, comme nous venons de le présenter.
Dans un exemple pratique, il faut surtout vérifier que n’a des singularités qu’aux points de branchement de (i.e. les zéros de sur ), et que a un développement en puissances impaires de . Il suffit pour cela d’étudier le développement asymptotique de , qui est une famille de solutions indépendantes d’une équation différentielle d’ordre (autant dans la variable que dans les variables ), dont les coefficients sont des fonctions rationnelles en . Cette démarche a été détaillée pour les systèmes dans mon article [BE10b] avec application au système de Lax associé à l’équation de Painlevé II, et sera détaillée dans un prochain article pour les systèmes avec application aux modèles minimaux .
Il peut arriver que n’ait pas de limite lorsque . En effet, de manière générique lorsque est une courbe de genre , on s’attend à la présence de fonctions thêta variant rapidement avec , à l’ordre dominant et à tous les ordres du développement asymptotique (cf. § IV.4.2). En principe, le Théorème IV.2 devrait se généraliser : il suffit d’identifier le comportement dominant de lorsque , et de sommer comme au § III.3.2 sur les fractions de remplissage de de sorte à reproduire ce comportement dominant. Il y aura toutefois un travail d’analyse non négligeable pour justifier un tel résultat. Ce problème rejoint celui de l’étude de l’asymptotique dans les chaines de matrices.
IV.3.4 Applications
Hiérarchie de Painlevé I
Bergère et Eynard ont appliqué cette méthode à la hiérarchie de Painlevé I dans leur article [BE09]. La courbe spectrale semiclassique est :
À la famille de solutions888Nous laissons de côté la question de l’existence et unicité d’une telle solution. du système défini par les Éqns. IV-12 et IV-13 qui se comportent comme :
est associée une fonction . Ils vérifient les conditions , , , et montrent que a un développement a priori en . En supposant que ce développement commence à l’ordre , ils concluent que a un développement asymptotique :
Remarquons que est un cas particulier de la courbe spectrale de Kontsevich, donc les pour ont une expression en fonction des nombres d’intersections dans (cf. II.3.2).
Hiérarchie de Painlevé II
Récemment, Cafasso et Marchal [CM10] ont fait de même pour la hiérarchie de Painlevé II. Sa courbe spectrale semiclassique est :
À la famille de solutions du système défini par les Éqns. IV-23 et IV-24 qui se comporte comme :
est associée une fonction . Toujours en supposant que commence en , ils concluent :
L’argument que j’ai proposé conduit à l’Éqn. IV-27 et complète ces travaux.
Application à la loi de Tracy-Widom
Dans l’article [BE10a], j’ai montré que toutes les conditions étaient réunies pour appliquer le Théorème IV.2 au système de Lax dont l’équation de Painlevé II est l’équation de compatibilité (Éqn. IV-15), et dont on recherche la solution telle que :
lorsque dans le secteur angulaire .
La première étape consiste à introduire à la main un paramètre . Si l’on souhaite que chaque dérivée soit d’ordre tandis que tous les autres termes restent d’ordre , on est conduit à poser :
Ce qui nous amène à un système de Lax mis en forme comme en Éqn. IV-25, avec :
et l’équation de compatibilité :
| (IV-31) |
Cette mise en forme est pertinente si le membre de gauche tend vraiment vers lorsque . Quand , c’est le cas lorsque est la solution d’Hastings-McLeod (Éqn. III-38), pourvu que : . De l’Éqn. IV-31, on déduit que admet un développement asymptotique :
avec des coefficients que l’on peut calculer récursivement. Donc et admettent un développement en , et correspond au régime .
La courbe spectrale semiclassique de ce système de Lax est :
| (IV-32) |
C’est une courbe hyperelliptique : il y a deux feuillets, et l’on passe de l’un à l’autre en choisissant l’autre détermination de la racine. Elle est de genre , puisqu’elle admet un paramétrage rationnel :
Les deux points de branchement correspondent à . Il y a un unique noyau de Bergman qui est une forme méromorphe sur :
On note la courbe spectrale .
Les points , et sont vérifiés en étudiant l’équation de type Schrödinger satisfaite par . Il apparait que , ordre par ordre en , ne peut développer de singularités en qu’aux zéros communs de et de défini par :
Par conséquent, il n’y a pas de singularité en , seules les singularités aux points de branchement se manifestent, i.e. est vérifié. Enfin, il existe une symétrie :
valable pour tout fini qui assure que est bien impair en , d’où .
D’après le Théorème IV.2, admet le développement asymptotique lorsque
Par dilatation et transformations symplectiques, se ramène à la courbe spectrale trouvée au § III.4.4 (Fig. IV.2) :
En utilisant les propriétés des invariants symplectiques, on obtient
où doit être remplacé par . D’après le Thm. IV.1, cela signifie que les invariants symplectiques de sont les coefficients du développement asymptotique de la queue gauche de la loi de Tracy-Widom des matrices hermitiennes. Nous avons donc prouvé rigoureusement l’Éqn. LABEL:eq:TWde dans le cas .
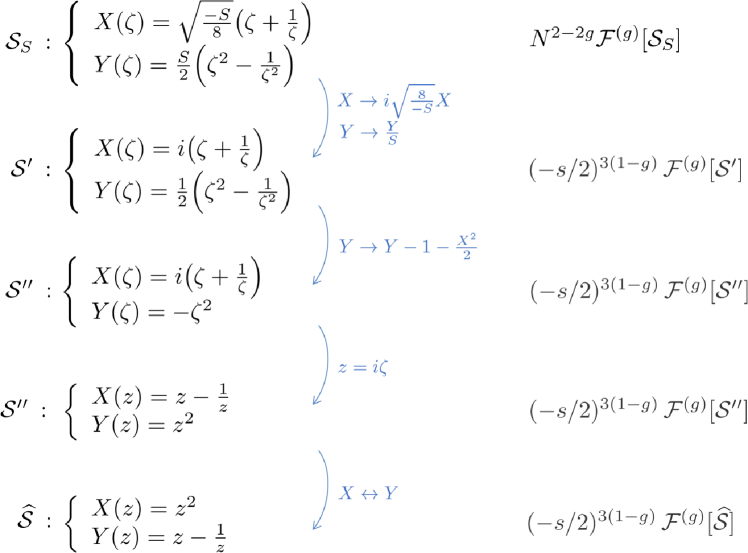
Cette méthode ne peut être utilisée pour établir LABEL:eq:TWde pour d’autres valeurs de , même ou , car il n’existe pas de structure "intégrable" connue conduisant à la déformation des équations de boucles. Autrement dit, partant d’un système de Lax ou d’une déformation de ce système, on ne sait pas définir un objet intéressant qui dépende de et satisfasse la déformation (Éqn. II-41) de l’équation de boucle quadratique (Éqn. IV-29).
IV.4 Construction d’un système intégrable à partir d’une courbe spectrale
Dans un article célèbre [Kri77], Krichever a montré comment la géométrie d’une surface de Riemann compacte donne lieu à des solutions de la hiérarchie KP. Cette classe de solutions, dites algébro-géométriques, est très particulière : peut être défini comme fonction analytique univaluée d’une variable vivant sur . Outre les pôles, les seules singularités qui apparaissent sont des points de branchement, d’ordre borné. Cela signifie que le groupe engendré par les matrices de monodromie de est fini. Nous allons rappeler la construction algébro-géométrique au § IV.4.1, en la reformulant d’une manière un peu différente de la littérature sur les systèmes intégrables.
En général, le groupe de monodromie d’une solution du problème linéaire d’un système intégrable est infini. Pour construire des solutions plus générales, on peut chercher à perturber une solution algébro-géométrique avec un petit paramètre , en autorisant l’ordre des singularités de type "point de branchement" à croître avec l’ordre en . C’est typiquement ce qui arriverait si l’on avait une solution qui était définie sur une surface de Riemann qui évolue lentement (à une échelle de temps ). Lorsque c’est le cas, on dira que le paramètre de dispersion, et que est la solution du problème linéaire d’un système intégrable dispersif autour de . Tous les systèmes intégrables rencontrés jusqu’à présent étaient des exemples de systèmes intégrables dispersifs autour de leur courbe spectrale semiclassique qui était de genre . L’enjeu du § IV.4.2 est la construction d’un système intégrable dispersif autour de n’importe quelle courbe de genre . Plusieurs tentatives existent dans cette direction, notamment par Krichever [Kri94], et plus récemment Takasaki et Takebe [TT09]. L’intérêt de notre approche est de proposer des formules explicites pour organiser le développement asymptotique lorsque .
Cette partie esquisse le contenu d’un article en préparation avec Bertrand Eynard. J’indiquerai seulement l’idée des démonstrations, et soulignerai comme conjectures les points que nous n’avons pas encore démontrés. Dans les premières parties de ce chapitre, nous partions d’un système intégrable, et lui associions des notions comme celle de fonction tau, noyau intégrable, … Ici, nous allons adopter une démarche inverse : nous allons d’abord définir certains objets géométriques, puis nous allons rechercher le système intégrable (s’il y en a un) dont ils apportent la solution. Pour cela, nous ferons souvent appel aux outils de géométrie complexe présentés dans l’Annexe A. Pour éviter les confusions, nous allons maintenant désigner la fonction tau par , et réserver la lettre pour la matrice des périodes d’une surface de Riemann.
IV.4.1 Construction algébro-géométrique
Soit une surface de Riemann de genre , une fonction méromorphe sur , une base symplectique de cycles sur , et un point base. Ces données additionnelles définissent une base de l’espace des formes méromorphes sur . Les temps de la hiérarchie seront les cooordonnées :
Les fractions de remplissage ne joueront qu’un rôle spectateur, elles sont fixées une fois pour toutes. À toute forme méromorphe , on associe une forme d’intégrale nulle sur les -cycles, et le vecteur de ses intégrales sur les -cycles :
où est la matrice des périodes de . On définit une courbe spectrale en posant , où est le noyau de Bergman sur d’intégrale nulle sur les -cycles.
Fonction tau
Commençons par définir une fonction bilinéaire des temps :
Nous annonçons alors que :
| (IV-33) |
est une fonction tau, ce qui est justifié par les propositions suivantes.
Proposition IV.1.
vérifie une version globale de l’équation de Hirota :
Cette équation est exactement la réécriture pour de l’identité de Fay pour la fonction thêta (Éqn. A.2), avec . Il suffit pour cela de remarquer que la transformation agit comme :
est la forme primaire :
On peut définir un opérateur d’insertion , qui est la dérivée le long de la déformation . Cette déformation peut aussi être obtenue en ajoutant deux pôles simples, en et , et en laissant tendre vers :
dans toute coordonnée locale au voisinage de . Lorsque est dans une région où (la coordonnée locale autour d’un pôle de ) est encore une coordonnée locale, on a également la représentation :
Par conséquent, si on laisse et coalescer vers un point :
Proposition IV.2.
vérifie une version infinitésimale de l’équation de Hirota :
Noyau intégrable spinoriel
Nous allons introduire un noyau intégrable spinoriel , qui est du point de vue géométrique un objet plus fondamental999C’est sur ce point que la présentation diffère, à notre connaissance, de la littérature. que le noyau intégrable. Il est défini à partir d’une formule de Sato :
La dépendance de en est sous-entendue pour simplifier les notations. C’est bien la formule de Sato, puisque si l’on choisit un pôle de et dans une région où est une coordonnée locale, la transformation se représente par :
est l’unique objet avec les propriétés analytiques suivantes :
est un spineur en et en . Autrement dit, lors d’un changement de coordonnée locale , il se transforme comme .
est défini globalement sur , i.e. n’a pas de monodromie lorsque (ou ) parcourt un -cycle ou un -cycle.
admet un pôle simple avec coefficient à points coïncidants, i.e. dans toute coordonnée locale :
a une singularité essentielle aux pôles de , de sorte que lorsque ou approchent .
est une forme différentielle méromorphe en la variable , qui a un pôle simple avec résidu lorsque , et avec résidu lorsque . En utilisant le fait que c’est aussi un spineur en et , inchangé lorsque (ou ) parcourt un -cycle ou un -cycle, on peut identifier :
Proposition IV.3.
Relation de passage dans :
Par ailleurs, un calcul direct de aboutit exactement au membre de droite dans la Prop. IV.3. D’où :
Proposition IV.4.
a une propriété d’autoréplication :
| (IV-34) |
En fait, ces calculs reviennent à démontrer la version infinitésimale de l’identité de Fay : la Proposition IV.2 est simplement la réécriture de la Proposition IV.4 en termes de . Cette Proposition IV.4 est le résultat clé pour construire un système intégrable. Pour calculer l’action de sur , il suffit d’intégrer l’Éqn. IV-34 contre le cycle généralisé .
Noyau intégrable
Notons , le degré de la fonction sur . Le noyau intégrable est la matrice obtenue en évaluant aux différents points tels que :
| (IV-35) |
Tous les énoncés du paragraphe précédent ont une contrepartie pour le noyau intégrable. Ainsi, le produit matriciel est une fonction rationnelle de (car on a sommé sur toutes les préimages de ), que l’on peut identifier en étudiant son comportement aux pôles et . Ou, de manière équivalente, on peut sommer dans la Proposition IV.3 sur toutes les préimages de . Quelque soit la manière, le résultat est :
Proposition IV.5.
Relation de passage dans :
Corolaire IV.1.
est une matrice inversible, et :
De même, a une propriété d’autoréplication qui se déduit de la Proposition IV.4.
Lien avec les fonctions de Baker-Akhiezer
Dans la littérature sur les systèmes intégrables, on rencontre plus fréquemment les fonctions de Baker-Akhiezer, qui sont les uniques fonctions analytiques d’une seule variable , avec les mêmes singularités essentielles, et pôles de position fixée. Ce type de fonction a été introduit pour la première fois par Akhiezer [Akh61] lorsque est de genre . En genre quelconque, elles s’écrivent :
où est un vecteur des constantes de Riemann. On peut les obtenir en spécialisant le noyau spinoriel intégrable :
| (IV-36) |
En effet, si est donné et est une caractéristique impaire non singulière, a exactement zéros lorsque parcourt , dont le point lui-même. D’après le théorème d’inversion de Jacobi (Thm. A.1), il existe toujours tels que :
| (IV-37) |
Et d’après la description des zéros de la fonction thêta, les doivent être précisément les zéros de : quitte à permuter, on peut supposer . La substitution de la relation IV-37 dans la définition de conduit à l’Éqn. IV-36.
Reconstruction du problème linéaire
Définissons des matrices , qui dépendent des temps via la forme :
Leurs entrées sont des fonctions rationnelles de , car le produit matriciel réalise une somme sur les différentes préimages de . est donc solution de systèmes différentiels compatibles à coefficients rationnels :
| (IV-38) | |||||
Un point important est que la position et le degré maximal des pôles ne dépendent pas du temps. Plus précisément :
Si , a un pôle en de degré , et a un pôle de degré (le degré du pôle dans ).
Si , en notant le maximum des degrés des pôles de . a un pôle en de degré , et a un pôle de degré .
Pour toute fonction méromorphe sur , indépendante des temps, on définit :
| (IV-39) |
C’est encore une matrice à coefficients rationnels, qui vérifie :
Il est manifeste, d’après l’Éqn. IV-39, que les valeurs propres de sont indépendantes du temps : on parle d’évolution isospectrale. Il y a exactement quantités conservées indépendantes, qui correspondent aux fractions de remplissages .
Il y a une façon de spécialiser , ou bien , dans , afin de définir une solution (ou bien ) du problème linéaire, à partir de laquelle on peut reconstruire le noyau intégrable . Nous ne l’évoquerons pas ici. Le système intégrable que l’on vient de décrire est bien un cas particulier de système isomonodromique, puisque les monodromies de sont fixées par les données de et , qui sont indépendantes du temps. Comme nous l’avons dit, dans ce cas, le groupe engendré par les monodromies est fini.
Corrélateurs
On définit les corrélateurs et les corrélateurs non connexes comme les formes différentielles101010Pour et , cette définition diffère de celle du § IV.3.2 par un décalage. :
Par exemple, le corrélateur à un point vaut :
Proposition IV.6.
Les corrélateurs vérifient des formules déterminantales. Pour les corrélateurs connexes :
et pour les corrélateurs non connexes :
où désigne le déterminant où l’on remplace chaque occurence de (qui n’a pas de sens) par .
La formule pour est le résultat d’un petit calcul. Puis, on obtient les formules déterminantales pour les autres corrélateurs grâce à l’autoréplication de (Éqn. IV-34).
IV.4.2 Déformation dispersive
Soit une courbe spectrale de genre , une base symplectique de cycles, et . Pour cette construction, nous allons utiliser le formalisme de la récurrence topologique (Chapitre II), et en particulier les propriétés de géométrie speciale (§ II.2.9). Les fractions de remplissage auront un rôle spécial. On note , la courbe spectrale à fractions de remplissage fixées. En ajoutant une forme holomorphe à , on peut atteindre n’importe quel vecteur de fractions de remplissage, sans toucher à la structure conforme de . Les temps seront les coefficients des déformations méromorphes de à une vitesse :
Contrairement à ce qui se passe dans la construction algébro-géométrique, la structure conforme de change avec les flots. Cela se traduit par la variation de la matrice des périodes :
et la variation de l’application d’Abel :
Toutes ces déformations peuvent s’obtenir à partir de celle consistant à ajouter d’un pôle double . Au niveau infinitésimal, le flot correspondant est l’opérateur d’insertion . Par exemple :
et l’expression pour figure à l’Éqn. II-24.
Fonction tau
Pour tout , la récurrence topologique associe à une fonction de partition :
qui est solution des équations de boucles (§ II.2.7) :
| (IV-40) |
où désigne une fonction régulière aux points de branchement. Ce sont des équations linéaires sur . Toute combinaison linéaire de solutions est encore une solution. En particulier :
| (IV-41) |
est aussi solution des équations de boucles, et c’est notre candidat pour une fonction tau111111Elle ne dépend pas des fractions de remplissage initiales de , mais seulement de et modulo ..
On peut se demander si la somme converge. La formule III.3.2 donne un sens précis à cette définition, en tant que série asymptotique lorsque :
| (IV-42) | |||
où l’on a introduit :
et l’on rappelle que est une notation pour le tenseur des dérivées de par rapport aux fractions de remplissage, évalué en . Aux premiers ordres, avec la notation que l’on a déjà rencontrée :
Pour abréger les formules, les références à , , seront dorénavant sous-entendues. À l’ordre dominant (en surbrillance), on retrouve121212À un facteur constant près, et quitte à spécialiser à une caractéristique impaire . la valeur de la fonction tau algébro-géométrique (Éqn. IV-33), avec .
Cette définition est inspirée des systèmes intégrables venant des modèles de matrices hermitiennes : leur fonction de partition coïncide avec la fonction tau. L’Éqn IV-42 est l’asymptotique à grand de la fonction de partition dérivée heuristiquement dans [Eyn09] et réexpliquée à la Section III.3. Par ailleurs, l’Éqn. IV-41 réalise l’analogue d’une moyenne de Whitham [BBT02]. Je pense que le système intégrable que nous cherchons à construire coïncide avec la hiérarchie de Whitham décrite par Krichever [Kri94]. Si cela se vérifiait, nos formules apporteraient des solutions explicites, à tous les ordres, pour la hiérarchie de Whitham.
Noyau intégrable spinoriel
Comme précédemment, la formule de Sato tient lieu de définition pour le noyau spinoriel intégrable. On note , la courbe spectrale où l’on a remplacé par , et :
| (IV-44) |
L’indice se référant à la courbe spectrale sera sous-entendu lorsqu’il n’y a pas d’ambigüité. Le membre de droite se calcule à partir de l’Éqn. IV-42 en utilisant les propriétés de géométrie spéciale (§ II.2.9). Si l’on introduit , les deux premiers ordres s’écrivent :
Cet objet a les propriétés suivantes :
est un spineur défini globalement sur .
a un pôle simple avec coefficient à points coïncidants, i.e. dans toute coordonnée locale :
a une singularité essentielle aux pôles de , de sorte que lorsque ou approchent un pôle de .
Les autres singularités de sont a priori des pôles aux points de branchement, ordre par ordre en .
Conjecture IV.1.
a une propriété d’autoréplication :
Les deux membres sont clairement des formes différentielles de , qui ont les mêmes pôles en et . Ils ne peuvent différer que par une forme méromorphe ayant des pôles aux points de branchement, et notre conjecture dit que celle-ci est nulle. Cela peut être reformulé de façon plus technique. À partir de la représentation :
on peut déplacer les contours et écrire :
Il faudrait donc démontrer que cette somme de résidus aux points de branchement est nulle, ordre par ordre dans le dévéloppement asymptotique lorsque .
Cette conjecture a été vérifiée jusqu’à l’ordre par un calcul direct. Malgré plusieurs tentatives, à l’heure de l’écriture, nous n’avons pas de méthode générale pour la prouver. On sait au moins que toutes ses conséquences sont vraies pour toutes les courbes spectrales qui venant des modèles de matrices intégrables, notamment du modèle à une matrice hermitienne (qui atteignent toutes les courbes hyperelliptiques) et de la chaine à deux matrices hermitiennes. Cependant, cela ne permet pas d’atteindre toutes les courbes spectrales algébriques.
Équations de Hirota et identité de Fay
En termes de la fonction , la Conjecture IV.1 s’écrit :
Conjecture IV.2.
vérifie une version infinitésimale de l’équation de Hirota :
Enfin, nous proposons aussi une conjecture globale qui implique la précédente (mais que l’on pense en fait équivalente) :
Conjecture IV.3.
vérifie une version globale de l’équation de Hirota globale :
Corrélateurs
On définit à nouveau des corrélateurs et des corrélateurs non connexes par :
On peut calculer les premiers ordres en partant de l’Éqn. IV.4.2.
Puis, en appliquant une nouvelle fois l’opérateur d’insertion :
Les contractions des tenseurs sont sous-entendues dans ces expressions, ainsi qu’un facteur par dérivation de fonction thêta.
Par construction, les corrélateurs ont deux propriétés importantes. D’une part, ils vérifient des équations de boucles (cf. Éqn. IV-40). D’autre part, en utilisant un développement de Taylor pour réécrire la formule de Sato (Éqn. IV-44), il existe une formule exponentielle qui reconstruit à partir des :
où , , et pour . Enfin, un petit calcul montre :
Si la conjecture IV.4 est vraie, on déduit automatiquement que :
et satisfont des formules déterminantales (cf. Proposition IV.6).
Le noyau intégrable défini comme à l’Éqn. IV-35 satisfait une relation de passage dans (cf. Proposition IV.5).
est solution d’un problème linéaire à coefficients rationnels (cf. Éqn. IV-38), où les matrices n’ont de pôles qu’à ceux de (en particulier, n’ont pas de pôles aux points de branchement).
Cela justifierait que notre construction décrit bien un système intégrable dispersif, dont est la courbe spectrale semiclassique.
IV.5 Conclusion
Une réponse à la question suivante pourrait constituer une approche indirecte de la Conjecture IV.4 :
Problème IV.1.
Peut-on réaliser toute courbe plane algébrique comme la courbe spectrale semiclassique d’un système différentiel :
où et sont des matrices :
-
qui admettent une limite et lorsque ;
-
qui admettent un développement asymptotique lorsque ;
-
qui sont ordre par ordre des fonctions rationnelles en , dont les pôles sont ceux de (i.e. les projections en des pôles de ) ?
Dans la partie IV.3, nous avons expliqué comment associer des équations de boucles à un système intégrable. Dans la partie IV.4, nous avons cherché réciproquement à associer un système intégrable aux équations de boucles pour une courbe spectrale algébrique. Si nos conjectures se vérifiaient, cela signifierait schématiquement :
Intégrabilité classique Équations de boucles
Il serait très intéressant d’étudier les conséquences d’une telle équivalence pour la théorie des variétés de Frobenius [Dub96], qui sous-tend certaines hiérarchies intégrables. Dans cette théorie, la construction des objets associés au système intégrable, à tout ordre dans le paramètre dispersif, est un problème réputé difficile. Une première étape serait de comparer les premiers ordres de la fonction tau prédit par l’Éqn. IV-41, à des résultats connus du côté variété de Frobenius. Il y a en tout cas un dictionnaire à établir avec les méthodes de récurrence topologique.
Chapitre V Intégrales formelles de matrices et combinatoire
Les problèmes de physique statistique sur réseau aléatoire, i.e. de combinatoire de cartes (décorées ou non), peuvent être représentés à l’aide d’intégrales formelles de matrices de taille . Chaque carte est comptée modulo ses automorphismes, avec un poids , où est la caractéristique d’Euler pour une carte de genre à bords. J’illustre cette méthode pour un modèle de boucles sur réseau aléatoire, dont le modèle trivalent est un cas particulier. Le calcul des observables avec un nombre fini de changements de conditions de bord, se ramène au calcul des observables avec conditions de bord uniformes. Ces dernières sont solution d’équations de Schwinger-Dyson dans le modèle de matrices, qui sont équivalentes à des relations combinatoires (i.e. démontrables par une approche bijective). J’explique ensuite brièvement, dans le cas du modèle trivalent, la résolution de ces équations par une récurrence topologique, et quelques conséquences pour l’asymptotique des grandes cartes. Ces résultats sont détaillés dans l’article [BE11].
V.1 Intégrales formelles de matrices
Dans ce chapitre, je vais parler de l’énumération de cartes, sans définir mathématiquement ce qu’est une "carte". Je renvoie par exemple à [Cha09, Eyn11], ou à des ouvrages plus anciens et spécialisés [Ber58]. Je choisis plutôt de partir d’un modèle formel de matrices assez général, et de montrer selon la méthode introduite par [BIPZ78], quels objets combinatoires il compte. Ceux-ci correspondent bien à la notion de carte topologique qui a été retenue en mathématiques. Cette partie est un peu technique mais ne contient pas de résultat profond : j’essaie de justifier pas à pas les hypothèses simplificatrices qui permettront d’étudier efficacement des problèmes de combinatoire grâce aux équations de Schwinger-Dyson. J’explique notamment les précautions à prendre pour qu’un modèle formel de matrices ait un développement topologique.
V.1.1 Définitions
Nous avons déjà rencontré la notion d’intégrales formelles de matrices en introduction, ce n’est qu’un exemple de théorie des champs perturbative (partie I.5). Soit une famille de matrices hermitiennes de taille . On se donne une mesure d’intégration :
| (V-1) |
où est une somme finie de monômes de degré dans les entrées . Après plusieurs étapes qui seront explicitées, il est possible de définir comme séries formelles en ,
la fonction de partition :
l’énergie libre .
pour toute observable polynômiale dans les entrées , la valeur moyenne :
pour toute famille d’observables polynômiales, les cumulants :
Comme la mesure est gaussienne, on dispose du théorème de Wick pour calculer ses moments. Si l’on note les valeurs moyennes pour :
et la valeur des appariements est donnée par l’inverse de la matrice de covariance :
Les moments d’ordre sont donc proportionnels à , tandis que les moments d’ordre impair sont nuls. Définissons :
Comme est une somme finie de monômes de degré , est une somme finie de termes de degré minimal . Cela assure que le coefficient de dans est nul si , vaut si , et est une somme finie lorsque . Donc, et sont bien des séries formelles111sous-entendu en puissances positives de de . On en déduit que pour toute observable polynômiale :
est aussi une série formelle en . Enfin, les cumulants sont des fonctions polynômiales des moments, donc sont aussi des séries formelles en .
V.1.2 Le développement topologique
Les définitions précédentes sont valables dès que fait de la famille des un vecteur gaussien centré. Nous allons être plus spécifiques en ne considérant que les mesures et les observables qui sont invariantes sous l’action globale du groupe sur , car ce sont ces modèles qui ont une bonne interprétation combinatoire en termes de cartes. La dérivation de cette combinatoire se décompose en plusieurs étapes.
Hypothèses techniques
Nous allons supposer que dans ne contient pas de termes . Alors, il est toujours possible de se ramener par des combinaisons linéaires de à :
Les appariements valent :
| (V-2) |
Ceci sert uniquement à simplifier notre discussion.
Nous allons aussi faire une hypothèse sur importante pour la suite. Définissons un mot cyclique dans l’alphabet comme une suite finie , modulo une succession de permutations cycliques et de commutations . On note , le nombre d’éléments de la classe d’équivalence de , et :
Les termes que nous autorisons dans sont indexés par un ensemble avec répétitions de mots cycliques à plus de trois lettres sur l’alphabet . Nous allons écrire :
| (V-3) |
En répétant un argument précédent, on remarque que l’introduction de cette dépendance en dans préserve le caractère de série formelle en de la fonction de partition et des valeurs moyennes d’observables.
Les observables invariantes dans ce modèle sont les fonctions des traces de produits arbitraires de . Par la suite, nous utiliserons le mot observable pour désigner aussi bien que sa valeur moyenne.
Diagrammatique
Il est commode de représenter un élément de matrice hermitienne par un couple segment entrant (indice )/segment sortant (indice ), avec une "couleur" . On peut alors lire un appariement (Éqn. V-2) par une mise bout-à-bout de segments de même orientation et de même couleur, les flèches entrantes pointant vers la zone d’interaction entre les deux matrices. Avec cette règle, chaque ligne garde son indice matriciel .
![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x23.png)
Dans un premier temps, on souhaite calculer :
| (V-4) |
Naturellement, se représente en disposant cycliquement autour d’un sommet les couples de segments entrants/sortants (les fléches entrantes pointent vers le sommet) associés à , , … La trace impose , donc on va relier un segment entrant (indice ) au segment sortant immédiatement précédent (indice ). Les indices vivant sur chaque ligne sont libres. On remarque que la ligne associée à entre avec une couleur et ressort avec une couleur qui peut être différente.
![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x24.png)
Le théorème de Wick dit que Éqn. V-4 est la somme sur toutes les "configurations" où les lignes sont deux à deux appariées. Les "configurations" sont donc décrites par des graphes épais , où les sommets sont les , les arêtes sont les appariements et portent des couleurs . Les lignes (bords des arêtes) doivent former des cycles fermés sur lesquels circule un indice . Ils sont naturellement orientés par le sens des flèches. Le dual d’un graphe épais définit ce que l’on appellera une carte. Intuitivement, c’est un recollement de faces polygonales le long de leur côtés, ou encore une surface discrète orientable (l’orientation vient du sens des flèches le long des cycles de ). Nous allons adopter le vocabulaire des cartes par la suite : en l’absence de précision, "sommets", "arêtes" et "faces" feront référence à .
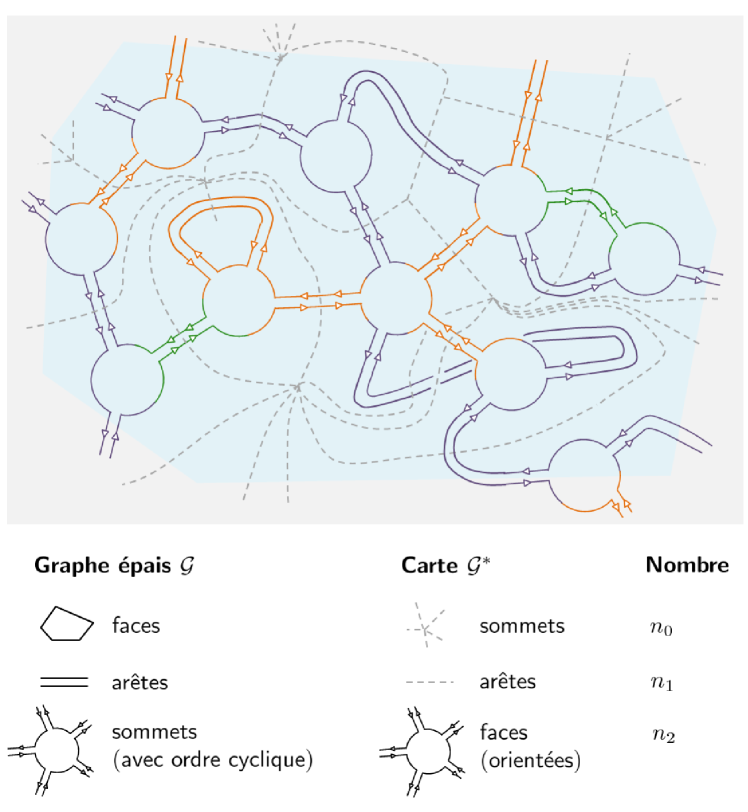
Dans un second temps, on souhaite calculer :
| (V-5) | |||||
où les sont des paramètres formels proches de . C’est encore une somme sur des cartes . Pour les décrire, il faut maintenant distinguer les faces (internes) issues du développement de , des faces marquées apparaissant en surbrillance. Dans l’expression précédente, les faces marquées sont associées aux mots cycliques concaténés fois, elles ont un périmètre . On les représente avec une arête marquée et une orientation, i.e. on choisit (arbitrairement) un représentant du mot . Les faces marquées sont naturellement numérotées (par un indice ), ce qui n’est pas le cas des faces internes. Pour décrire une "configuration" intervenant dans le calcul de Éqn. V-5, il est nécessaire de numéroter temporairement les polygones internes , et de numéroter leurs côtés, disons dans un ordre cyclique (i.e. de fixer un représentant de chaque ). est alors déterminé par la liste des paires de côtés que l’on veut identifier. Ceci fait, on obtient, après l’oubli de tous les numéros temporaires, un graphe épais ou une carte .
Notons le sous-groupe du groupe des renumérotations des sommets et de leurs demi-arêtes, laissant (avec tous ses marquages permanents) invariant. est le nombre d’automorphismes du graphe , aussi appelé facteur de symétrie.
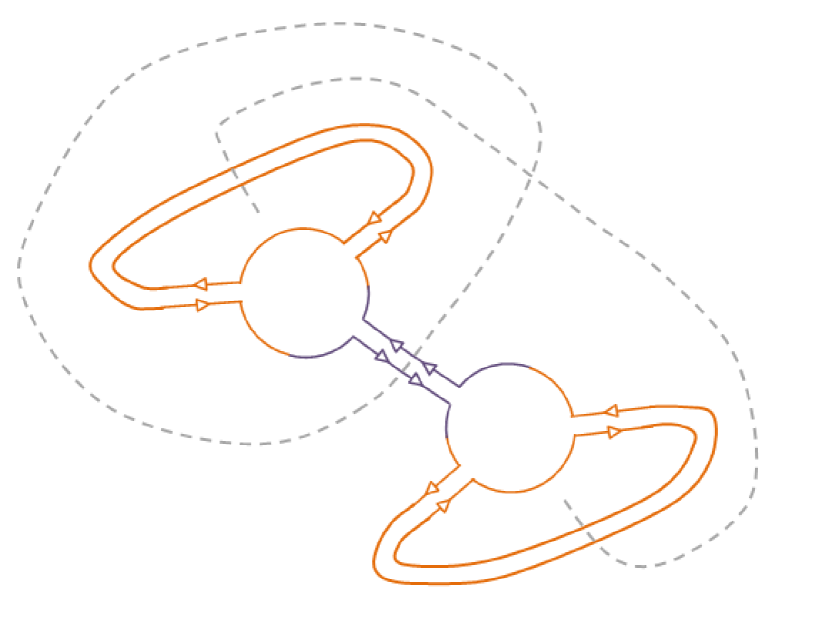
Maintenant, calculé comme une somme sur les configurations fait apparaitre fois le même graphe . On peut donc la réécrire comme une série génératrice de toutes les cartes qui contiennent au moins les faces marquées :
La normalisation au dénominateur de chaque terme de (Éqn. V-3) a été choisie précisément pour reconstituer un facteur dans . D’où :
| (V-6) |
En particulier, lorsque :
| (V-7) |
Nous allons calculer ce poids, qui se décompose naturellement en , où contiendra toute l’information sur la topologie de , et sera indépendant de .
et regroupements par topologie
Soit un graphe épais et la carte associée. On note le nombre de faces polygonales de (sommets internes de ), le nombre d’arêtes de (le nombre d’appariements dans ) et le nombre de sommets de (le nombre de lignes formant des cycles dans ). La dépendance en et du poids est très simple. Chaque ligne fermée dans porte un indice matriciel sur lequel on somme, donc contribue à un facteur . Et, par construction, chaque appariement vient avec un facteur (Éqn. V-2), et chaque sommet de avec un facteur (Éqn. V-3). D’où :
est la caractéristique d’Euler de ou de . Si l’on note, pour chaque composante connexe de , son genre et son nombre de faces marquées, elle vaut . caractérise entièrement la topologie de la carte. Pour la terminologie, une carte connexe de genre est dite planaire, et une carte connexe avec une face marquée est dite enracinée222Noter qu’une carte enracinée n’a pas d’automorphismes : .. Par définition :
A priori dans un modèle donné, les sommets de ont une valence arbitraire (la longueur des cycles dans est arbitraire). Il n’est donc pas évident que l’ensemble des cartes à caractéristique d’Euler et nombre de sommets fixés, soit un ensemble fini. Notons la valence d’une face polygonale associée à , et le nombre de telles faces dans . Le nombre d’arêtes s’écrit :
D’où :
| (V-8) |
avec l’inégalité venant de l’hypothèse technique faite sur les termes de . On trouve que les cartes de sont obtenues par le recollement d’au plus faces polygonales, dont le nombre de côtés est borné puisque contient un nombre fini de termes. Donc, est fini.
Pour toute observable qui s’écrit :
cela permet de définir en regroupant les topologies :
en tant que série formelle en . De plus, on a une égalité entre séries formelles :
i.e. à un ordre donné , il n’y a qu’un nombre fini de qui contribuent dans le membre de droite, et l’égalité est valable.
Poids et modèles à poids multiplicatifs
Intéressons-nous maintenant à la dépendance du poids dans les paramètres du modèle. dépend du nombre de sommets internes de type , et du nombre d’arêtes de couleur qui sont présents dans . Il y a aussi par construction un préfacteur couplé au périmètre des faces marquées.
porte sur toutes les familles finies constituée d’ensembles avec répétitions de mots cycliques de longueur , et de multiplicités , telles que pour tout mot . Cette somme est simplement le préfacteur de dans le développement de . C’est en général une fonction compliquée des , qui n’est pas multiplicative. Par conséquent, si a pour composantes connexes , en général :
| (V-9) |
On parle d’un modèle à poids multiplicatifs lorsqu’il y a égalité dans l’Éqn. V-9 pour quelconque. Cela arrive seulement lorsque ne contient pas de produits de traces :
| (V-10) |
Dans ce cas :
Par la suite, je vais limiter la discussion aux modèles à poids multiplicatifs. Des modèles à poids non multiplicatifs, comme le modèle formel à une matrice :
avec polynôme et polynôme de bas degré, ont été étudiés dans la littérature. Ils décrivent des cartes branchées en arbre. La limite des grandes cartes planaires est alors décrite par la classe d’universalité des polymères branchés, ou des classes de polymères branchés en compétition avec les modèles minimaux de la gravité quantique. À ma connaissance, les topologies ont été peu étudiées pour ces modèles.
Fonctions connexes
La fonction de partition est une somme sur les cartes sans face marquée. Dans un modèle à poids multiplicatifs, un argument élémentaire montre que l’énergie libre est la somme sur toutes les cartes connexes sans faces marquées. En regroupant les topologies, on peut définir comme la somme sur toutes les cartes connexes de genre et sans face marquée, et l’on a :
Toujours dans un modèle à poids multiplicatifs, est la somme sur les cartes à faces marquées, de type , de sorte que toute composante connexe contienne au moins une face marquée. En regroupant les topologies :
On peut aussi définir le cumulant , qui calcule la même somme restreinte aux cartes connexes. Là encore, on peut regrouper les topologies :
Pour les cartes connexes, nous utilisons une notation avec le genre en exposant (g), plutôt que [[χ=2-2g-n]].
Conclusion
Pour résumer, nous avons justifié, pour les modèles formels à poids multiplicatifs, que l’énergie libre et les cumulants (et les moments) ont un développement topologique, dont les termes s’interprètent comme des séries génératrices de cartes de genre fixé. On a aussi introduit des paramètres formels couplés multiplicativement aux périmètres des faces marquées.
Remarquons que les équations de Schwinger-Dyson (partie II.1) seront valables aussi bien pour les modèles formels que convergents. Et, dans les modèles formels, on a automatiquement l’existence d’un développement topologique de type Éqn. II-25, avec . La nature de ce développement est un peu particulière : chaque série génératrice est une série formelle en , et à un ordre donné , il y a un nombre fini de termes qui ont la même puissance de , et que l’on peut regrouper. Finalement, on pourra insérer ce développement dans les équations de Schwinger-Dyson, et chercher à résoudre la hiérarchie ainsi obtenue afin de calculer les séries génératrices de cartes.
V.1.3 Propriétés analytiques des séries génératrices
Les séries génératrices de cartes sont définies initialement comme des séries formelles (en , en ), mais elles ont des rayons de convergence non nuls car le nombre de cartes croît au plus géométriquement avec le nombre de faces. Ceci peut être justifié en deux temps.
Les cartes considérées par Tutte et ses successeurs sont engendrées par un modèle formel à une matrice :
| (V-11) |
Tutte a établi [Tut63] que le nombre de quadrangulations planaires, enracinées, à faces est :
où Cat est le nombre de Catalan. Comme il existe une bijection entre cartes et quadrangulations bipartites (Fig. V.3) et que toute quadrangulation planaire est bipartite, c’est aussi le nombre de cartes planaires enracinées à arêtes. Il faut ajouter que nos hypothèses techniques (toutes les faces internes ont un périmètre , tandis que les faces externes ont un périmètre quelconque) impliquent que les cartes planaires enracinées générées dans l’Éqn. V-11 ne forment qu’un sous-ensemble des cartes planaires enracinées de [Tut63]. De ce résultat, on peut également déduire une croissance géométrique du nombre de cartes enracinées de genre à arêtes, soit en se référant aux travaux ultérieurs de Bender et Canfield [BC90], soit en étudiant directement le développement topologique des équations de Schwinger-Dyson du modèle formel à une matrice. Enfin, ce résultat est préservé si l’on ajoute des faces marquées.
Les modèles multiplicatifs plus généraux engendrent des cartes où les arêtes portent une couleur . On peut encore associer à toute carte à arêtes, une quadrangulation bipartite à faces, et en décorant convenablement, il est possible de remonter de façon unique à (Fig. V.3). De plus, cette association préserve la caractéristique d’Euler. Donc, le nombre de telles cartes à genre fixé sera un .
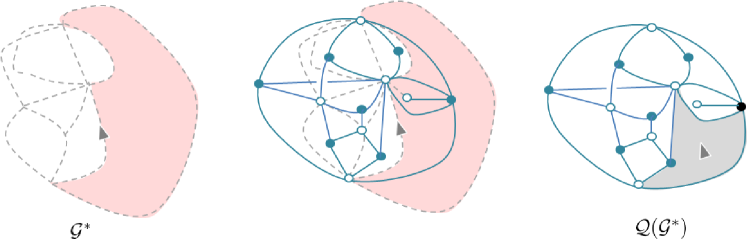
Enfin, si le nombre de sommets et la caractéristique d’Euler de sont fixés, le nombre d’arêtes est borné par (Éqn. V-8). Donc croît au plus géométriquement avec . Par conséquent,
a un rayon de convergence non nul, c’est une fonction analytique pour , et pour . Cela permet par la suite d’utiliser les outils puissants de l’analyse complexe. Toute relation entre séries génératrices sera valable dans tout le domaine d’analyticité pour, et donnera même des informations sur le domaine maximal d’analyticité. L’étude des singularités en donnera naturellement accès à l’énumération des grandes cartes.
V.1.4 Limitations inhérentes aux modèles de matrices
Comme l’on ne peut associer de paramètres libres qu’aux faces marquées, les observables des modèles formels de matrices ne peuvent pas donner directement accès à des informations locales sur la carte aléatoire, ni à des informations métriques. Cependant, il existe des relations combinatoires (dont le vaste champ n’est qu’en partie exploré) entre des quantités locales intéressantes, et les observables couplées au périmètre des faces marquées. Récemment, Jérémie Bouttier et Emmanuel Guitter [BG10] ont découvert que la statistique de la distance géodésique dans les cartes planaires (sans décoration, i.e. engendrées par Éqn. V-11) était encodée dans le développement en fraction continue de . À l’avenir, il serait intéressant d’exploiter de telles méthodes pour les cartes décorées, par exemple pour prédire l’exposant échelle de la distance géodésique entre deux points d’une grande carte. Celui-ci est inconnu déjà pour le modèle de boucles le plus simple (le modèle trivalent, partie V.3).
V.2 Les modèles de boucles
V.2.1 Pourquoi les modèles de boucles ?
Les modèles de boucles consistent à compter des configurations de chemins autoévitants vivant sur les faces d’un réseau à deux dimensions (fixe ou aléatoire). Ces chemins peuvent relier deux extrémités (que l’on appellera mèches) appartenant aux bords, ou bien former des boucles. Dans les modèles , il y a types de boucles, et chaque boucle de type est comptée avec un poids . On peut donner une orientation aux boucles si on le souhaite : en écrivant dans le modèle précédent, la contribution d’une boucle qui a tourné fois à droite et fois à gauche sera le préfacteur de .
Pour des valeurs génériques des , le poids des configurations est non local. Cela signifie que le poids donné globalement à une boucle de type , a priori étendue sur , ne peut être redistribué uniquement sur les sommets, arêtes et faces de . La physique statistique dans les modèles non locaux contient certainement de nouveaux effets par rapport à celle des modèles locaux.
Sur un réseau fixe
Les modèles de boucles ont d’abord été étudiés sur un réseau fixe et régulier, essentiellement sur le réseau carré ou le nid d’abeille. Le modèle a une longue histoire en physique statistique et en combinatoire. Lorsque toutes les faces du réseau sont occupées par des boucles, il est dual au modèle de Potts à couleurs, et les boucles sont les frontières des amas de spins de même couleur. Lorsque les boucles sont interprétées comme lignes de niveaux et , c’est un modèle de hauteurs aléatoires appelé RSOS (Restricted Solid on Solid). En prenant des dérivées par rapport à , évaluées à , le modèle capture la physique des polymères, i.e. des marches aléatoires autoévitantes. Le modèle est aussi est relié à des modèles de vertex intégrables quantiques, i.e. solubles par ansatz de Bethe, comme le modèle à six vertex (si les boucles occupent toutes les faces d’un réseau carré) ou le modèle à dix-neuf vertex (sans cette contrainte, sur le réseau carré, Fig. V.4). Le modèle est relié à l’énumération des matrices à signes alternés introduites par Mills et Robbins, … La conjecture de Razumov-Stroganov, démontrée en 2010 par Luigi Cantini et Andrea Sportiello [CS10], est une belle illustration de cette ubiquité (Fig. V.5) : dans un modèle sur réseau carré, où tout carré est occupé par un chemin, la probabilité d’observer un appariement donné de mèches est proportionnelle aux composantes du vecteur propre de l’état fondamental d’une chaine de spins de type XXZ. En général, les observables avec changements de conditions de bord sont organisées en une représentation de l’algèbre de Temperley-Lieb (Fig. V.6) ou de ses variantes, avec .
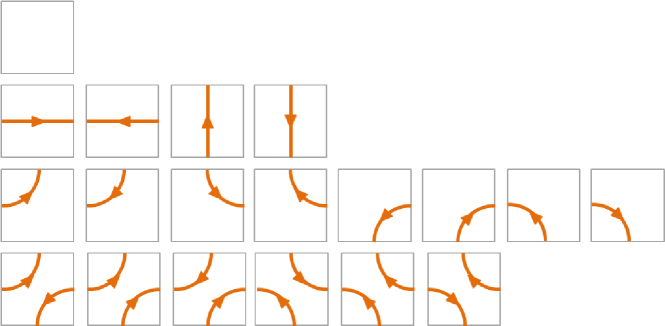
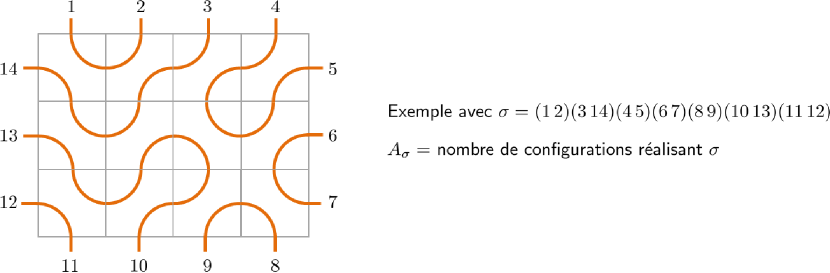
À la limite continue, le modèle sur réseau régulier carré, devrait être décrit par une théorie conforme [dFMS99] de charge centrale :
C’est une conjecture pour les mathématiciens333C’est un sujet de recherche très actif, avec des résultats récents notamment pour (le modèle d’Ising). On pourra consulter la revue de S. Smirnov [Smi06] pour un état des progrès datant de 2006 ainsi que des références, ainsi que la description plus technique [Smi10]., et un fait plausible largement utilisé par les physiciens pour faire des prédictions, qui n’a jamais été pris en défaut par les résultats exacts ou les simulations numériques (pour les exposants, les règles de fusion d’opérateurs, …). Inversement, la limite continue des modèles de boucles est particulièrement intéressante pour étudier, au moins heuristiquement, une vaste classe de théories conformes et leurs conditions de bord [JS08, Dub10]. Cela inclut la série des modèles minimaux unitaires (lorsque ) et la série des modèles minimaux (lorsque ), mais ces théories conformes sont par ailleurs très bien connues. En revanche, le cas permet en principe d’atteindre les théories conformes logarithmiques, dont la compréhension est un enjeu actuel. On observe par exemple de fortes similarités entre, la théorie des représentations de et ses variantes qui conduit à la définition de modèles ou , et celle de l’algèbre de Virasoro (à l’œuvre dans la théorie conforme).
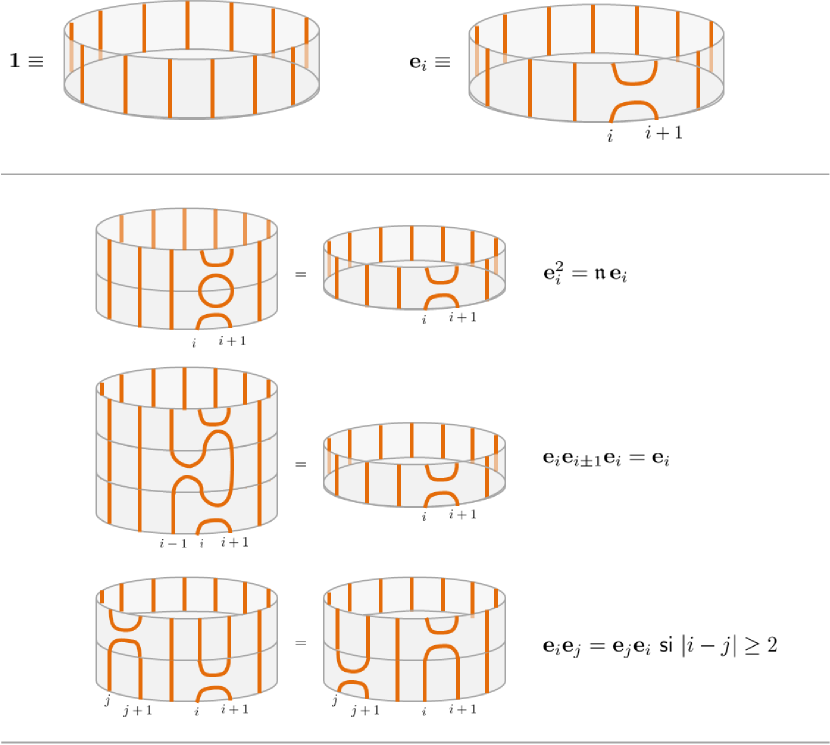
Sur une carte aléatoire
Pour les physiciens, les cartes aléatoires (sans boucles) sont bien décrites à la limite continue par la théorie de Liouville, qui est la seule théorie des champs connue qui capture la notion de "gravité quantique à deux dimensions". Naturellement, les cartes aléatoires dotées de configurations de boucles devraient être décrites à la limite continue par la théorie de Liouville couplée à une théorie conforme. Dans ce cadre, il existe une correspondance appelée habillage gravitationnel entre les observables d’une théorie conforme de charge centrale , et les observables de la même théorie conforme couplée à la théorie de Liouville. Knizhnik, Polyakov et A.B. Zamolodchikov [KPZ88] prédisent une relation entre dimension conforme d’un opérateur (donnant un exposant critique sur réseau fixe) et dimension conforme de l’opérateur habillé (donnant un exposant critique pour les cartes aléatoires) :
Les intégrales formelles de matrices donnent une technique d’étude systématique des modèles de boucles sur cartes aléatoires. Le plus simple techniquement est le modèle trivalent, introduit en 1989 par Ivan Kostov [Kos89]. C’est principalement sa limite continue qui a été étudiée par Kostov et bien d’autres : les points critiques ont été étudiés dans [KS92], l’étude des conditions de bords parallèlement aux travaux de Jacobsen et Saleur sur le réseau fixe [JS08] a été faite dans [Kos07], le diagramme de phase et les flots de renormalisation pour les conditions de bords ont été étudiés dans la thèse de Jean-Émile Bourgine [Bou10], … Le va-et-vient entre limite continue du modèle de matrice , et théorie de Liouville couplée à une théorie conforme, ont contribué à une meilleure compréhension de chaque côté.
Dans l’optique de cette thèse, les modèles de boucles sur cartes aléatoires sont également intéressants avant la limite continue. Pour la combinatoire, mais surtout pour leurs relations conjecturées avec des algèbres de type Temperley-Lieb et des questions d’intégrabilité quantique. À terme, on aimerait transposer aux modèles sur carte aléatoire, l’arsenal de structures mathématiques existant sur le réseau fixe de taille finie. Plus modestement ici, l’objectif est de calculer le maximum d’observables dans les modèles de boucles sur carte aléatoire sans prendre de limite continue. Dans les paragraphes suivants, je vais montrer pour le modèle de boucles général, quelles sont les équations à résoudre et où se trouve actuellement la frontière des connaissances. Cette présentation est inspirée de travaux en cours, qui ne sont pas encore publiés. Le modèle trivalent fera l’objet de la partie V.3.
V.2.2 Définitions
Le modèle formel de matrices qui engendre des cartes aléatoires portant des boucles autoévitantes est :
| (V-12) | |||||
sont des matrices hermitiennes. La matrice a un rôle particulier. Nous encodons son potentiel et le terme de couplage en posant :
| (V-13) | |||||
| (V-14) |
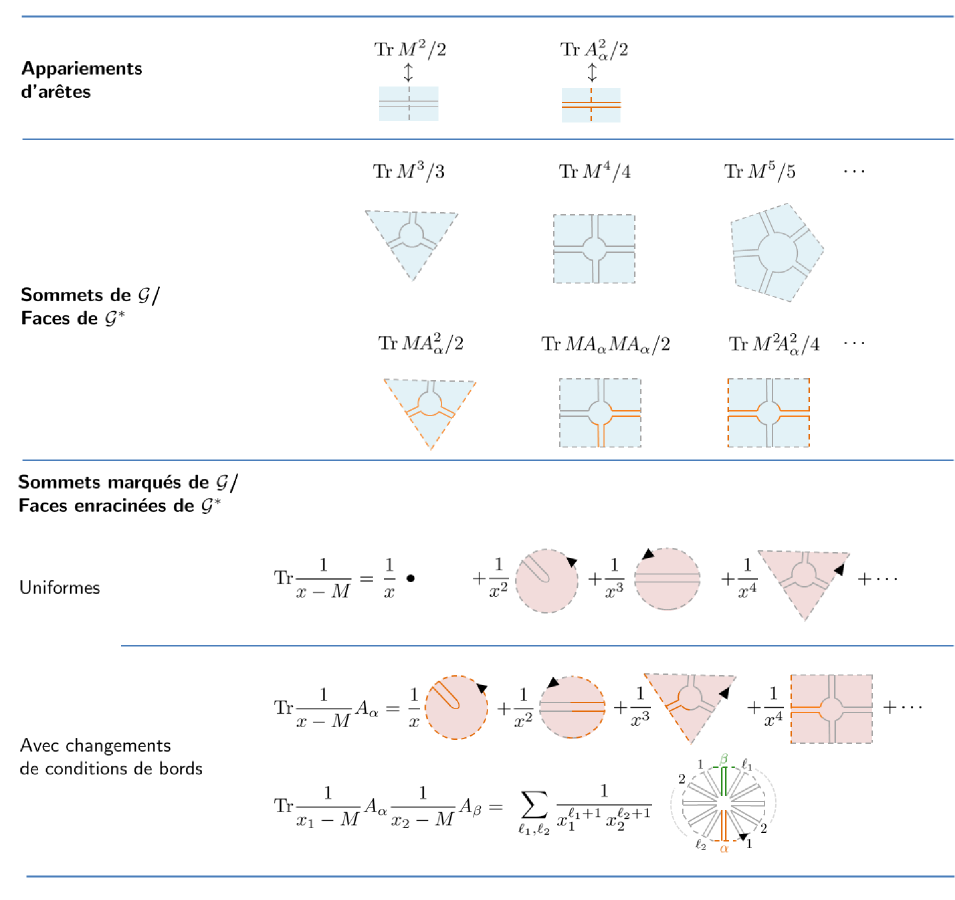
Attardons-nous sur les briques élémentaires des cartes dans ce modèle (Fig. V.7). Les engendrent des gones "standard" avec poids . Les engendrent des gones avec deux côtés spéciaux : on peut les représenter comme des gones () traversés par un chemin de couleur entre deux côtés séparés par exactement côtés standard. Lors du recollement des polygones, ces chemins sont mis bout-à-bout, et doivent se fermer ou avoir leur extrémités sur des côtés de couleur appartenant à une face marquée. Par construction, un chemin garde toujours sa couleur (pas de terme croisé ), et ne peut ni s’intersecter ni intersecter un autre chemin (pas de termes de degré en dans ). Si est la longueur totale des chemins de couleur , le nombre de polygônes de type , le nombre de gones standard, le poids est :
On appellera bords, les faces marquées d’une carte. On appelle observables (à conditions de bord) uniformes les séries génératrices . Elles génèrent des cartes où sont dessinés des chemins qui ne peuvent que former des boucles. Les corrélateurs de la matrice fournissent une base des observables uniformes :
énumère les cartes de genre , avec faces marquées, et si l’on note est le périmètre de la face , elles sont comptées avec le poids :
| (V-15) |
En revanche, sur les cartes générées par des observables à bords non uniformes, les chemins de couleur ont la possibilité de former des boucles, ou de relier deux arêtes de couleur appartenant à un bord. On dira que ces arêtes de couleur sur le bord portent une mèche de couleur . Les mèches sont reliées par un chemin tracé sur la carte, qui définit donc un appariement. On cherchera en Annexe B à calculer les observables où les mèches sont en nombre fini, sont appariées suivant un motif fixé, et où les cartes sont pondérées selon l’Éqn. V-15, où est couplé à la distance entre deux mèches le long d’un même bord.
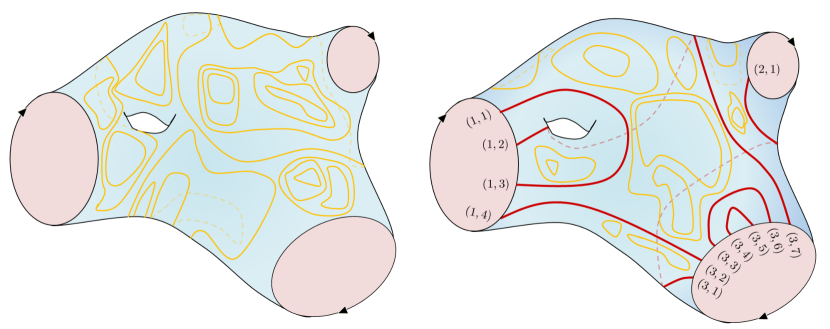
Le modèle Éqn. V-12 est également intéressant lorsque certains jouent le même rôle. Imaginons que soit partitionné en ensembles , tels que soit symétrique par échanges des pour à l’intérieur de . On peut donc définir des cartes qui ne différencient plus les boucles de couleur . Les observables sont des séries génératrices de ces cartes, comptées avec un poids Éqn. V-15 multiplié par , où est le nombre de boucles de type , et . Le problème d’énumération de cartes avec des boucles de type et un poids par boucle de type , a un sens toute valeur complexe finie du paramètre . Il est communément appelé modèle . Lorsque les sont des entiers positifs, il se représente par une intégrale formelle sur matrices. Sinon, les observables de ce modèle coïncident avec le prolongement analytique des observables du modèle de matrices. En particulier, toute équation valable dans le modèle de matrices et analytique en sera automatiquement valable pour le problème combinatoire où a une valeur complexe quelconque.
D’après § V.1.3, pour fixé tel que , toutes ces observables sont des fonctions holomorphes de chaque variable au moins dans , où est assez grand, et nous pouvons prendre lorsque .
V.2.3 Intégration sur les matrices
Il est facile d’intégrer sur les matrices car leur poids est gaussien. C’est très simple pour les observables uniformes , le résultat s’écrit , où est la valeur moyenne par rapport à la mesure induite :
ou sont les opérateurs de multiplication à gauche ou à droite par , qui agissent sur l’espace des matrices hermitiennes. est donné par l’Éqn. V-14 où le produit usuel est remplacé par le produit tensoriel , et le terme constant par .
Cette expression est plus lisible si l’on diagonalise dès le départ, et si l’on intègre sur :
| (V-16) | |||||
Il est légitime de se demander si ces manipulations sont autorisées étant donné le caractère formel du modèle. Il me semble que oui. J’ai choisi de définir le modèle avec une variable formelle vivant près de et des vraies variables et pour des raisons pédagogiques. Mais par homogénéité, on peut reproduire les étapes du § V.1.2 si l’on déclare comme des variables formelles vivant près de , et comme une vraie variable. Dans ce cadre, l’Éqn. V-16 est valide, et les observables ont en fait un rayon de convergence non nul par rapport à chacun des paramètres formels. Il n’y a pas d’ambigüité venant d’éventuels zéros de , car les puissances négatives de sont bien définies en tant que séries formelles de . De plus, dans les modèles ou il y a qui jouent le même rôle, le prolongement analytique à complexe est atteint en étudiant la mesure :
| (V-17) | |||||
Rappelons que est analytique dans . Cela implique, pour tous les calculs à partir , que tout se passe comme si les valeurs propres vivaient seulement sur le segment . Nous verrons avec le Thm. V.1 que les équations de Schwinger-Dyson impliquent que est en fait holomorphe lorsque , avec un segment indépendant de et . Autrement dit, tout se passe comme si les valeurs propres vivaient uniquement sur . Les extrémités et dépendent de et de tous les paramètres du modèle444Pour les paramètres qui étaient formels, on demande que leur valeur reste dans le domaine d’analyticité.. Lorsque est proche de , est un petit segment autour de . En augmentant ou en faisant varier les paramètres du modèle, on peut agrandir progressivement . Manifestement, il se passe quelque chose de spécial lorsque atteint ou pour la première fois. Heuristiquement, on s’attend à ce qu’un tel point donne lieu à une singularité caractéristique des modèles de boucles, i.e. qui n’est pas décrite par la gravité pure. Ce point critique devrait être associé à une limite de grandes cartes avec des boucles macroscopiques. Bien sûr, on peut également ajuster les coefficients de pour décrire un point multicritique qui est une compétition entre le précédent et la gravité pure.
Les observables à bords non uniformes contiennent des , donc le théorème de Wick entre en jeu lorsque l’on veut intégrer sur les matrices . Finalement, ces observables s’écrivent toujours , i.e. peuvent se déduire de la seule connaissance des observables uniformes. Ce calcul demande l’introduction de nouvelles notations, il sera présenté dans le cas d’un nombre fini de mèches en Annexe B. À toute famille de mèches disposées le long de bords, et à tout appariement abstrait entre ces mèches, on peut ainsi associer la série génératrice des cartes de genre où est tracé un système de liens autoévitants réalisant .
V.2.4 Équations de Schwinger-Dyson
Dérivation des équations
Les modèles formels de matrices peuvent être étudiés à nouveau grâce aux équations de Schwinger-Dyson. Pour les modèles de boucles, on peut se concentrer sur les observables uniformes, et étudier directement la mesure Éqn. V-17 obtenue après intégration des . L’invariance de sous le changement de variable infinitésimal se traduit par :
La deuxième ligne est propre aux modèles de boucles, on pourra comparer à l’équation de Schwinger-Dyson (Éqn. II-4) du modèle à une matrice défini en Éqn. I-22. En échangeant les indices muets et , les deux termes sont égaux. On peut écrire cette équation en termes des corrélateurs :
est un contour entourant les singularités des et mais pas le point . Pour le moment, nous ignorons la position de ces singularités, nous savons seulement qu’elles se réduisent à lorsque . Nous supposerons dans un premier temps assez petit, afin que le rayon de convergence grossier que l’on a établi pour tous les , soit tel que
pour un . Le choix de contour convient en plaçant (Fig. V.9).
est symétrique555Le calcul des observables invariantes , avec la mesure donnée par l’Éqn. V-17, ne dépend que de la fonction . Si la fonction n’est pas symétrique, on peut toujours la remplacer par ., et dans les modèles de boucles, c’est un produit de polynômes symétriques à deux variables (cf. Éqn. V-14), éventuellement élevés à des puissances666 est réel strictement positif, donc pour assez petit, reste dans lorsque parcourt : il n’y a pas d’ambigüité à élever a une puissance non entière. . Il est commode de les factoriser :
Si n’est pas un polynôme, il peut admettre une infinité de zéros, et il faut autoriser la présence d’une fonction sans zéros en préfacteur. Lorsque est un polynôme, est une constante. Par conséquent :
En déplaçant le contour vers , on collecte les résidus aux pôles simples à :
| (V-18) | |||||
avec :
| (V-19) | |||||
Ce que l’on réécrit
| (V-20) | |||||
est une fonction de qui est régulière aux singularités des :
où est un corrélateur non connexe (Éqn. I-33).
Les équations de Schwinger-Dyson pour s’en déduisent, en laissant agir l’opérateur d’insertion (partie I.14). On donne seulement le résultat :
| (V-21) |
où est une fonction régulière lorsque s’approche des singularités de , qui s’écrit explicitement :
Le lemme "une coupure"
L’Éqn. V-18 est une équation quadratique pour la série génératrice des cartes planaires enracinées :
On reconnait lorsque l’équation quadratique de Tutte pour les cartes sans boucles [Tut68]. Nous recherchons la solution qui se comporte en quand :
Comme et sont réguliers dans , la seule singularité de dans ce disque est une discontinuité sur le lieu de . À , et possède un zéro double en . Par analyticité, pour assez petit, , donc ce zéro double se scinde en deux zéros simples et , qui ont un développement en série formelle de , et tels que . Ils sont nécessairement réels, puisque les corrélateurs sont holomorphes sur , privé de l’axe réel où vivent a priori les valeurs propres .
Pour tous les autres , les équations de Schwinger-Dyson (Éqn. V-21) sont linéaires en . intervient aussi, mais on sait déjà que cette quantité est holomorphe pour , et on peut la traiter comme une inconnue qui ne contribuera pas aux singularités de . Finalement, ne développe pas d’autres singularités que celles initialement présentes dans :
Theorème V.1.
(Lemme "une coupure"). Pour assez petit, il existe et , qui sont des séries formelles en , telles que , de sorte que soit holomorphe pour , et ait une discontinuité pour de part et d’autre de . De plus :
C’est la propriété analytique clé, qui distingue la solution combinatoire qui nous intéresse parmi l’ensemble des solutions des équations de Schwinger-Dyson.
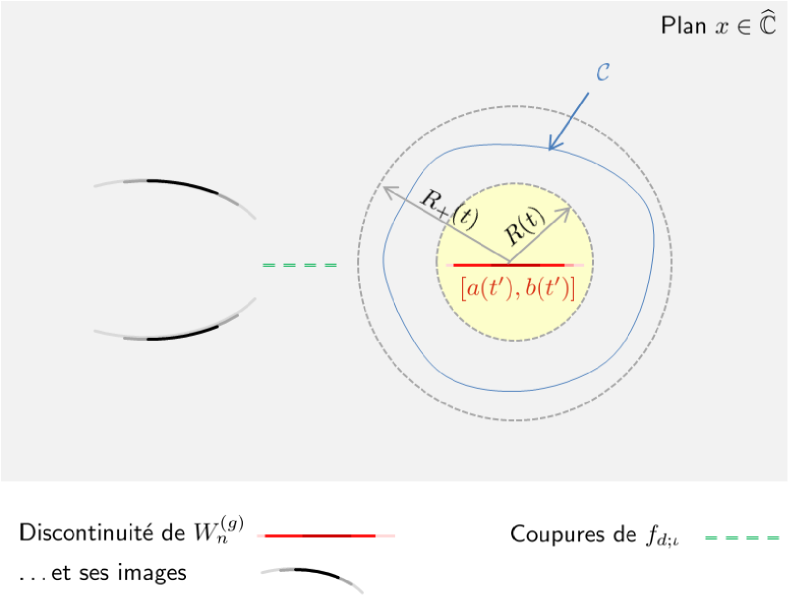
Réapparition des équations de boucles
En calculant la discontinuité des équations de Schwinger-Dyson sur , on arrive par récurrence à montrer, pour tout , , et :
| (V-22) | |||||
Les objets naturels sont les formes différentielles :
qui absorbent les facteurs dans l’Éqn. V-22 :
On obtient une équation linéaire à coefficients constants, qui ressemble beaucoup à la hiérarchie d’équations de boucles linéaires (Éqn. LABEL:eq:VVVV1). De même, les équations de Schwinger-Dyson sous la forme Éqn. V-20 et V-21, écrites pour , ressemblent fortement à la hiérarchie d’équations de boucles quadratiques (Éqn. II-21). Ceci fait écho à la généralisation de la notion d’équation de boucles777Historiquement, les équations de boucles ont reçu ce nom par référence au bord des surfaces discrètes que génère , qui est une boucle de longueur . Cela est étranger aux boucles aléatoires autoévitantes qui sont dessinées sur les surfaces discrètes générées par les modèles de boucles. évoquée au § II.4.2.
Ces progrès ont été faits peu avant l’écriture, et le projet n’est pas encore achevé. La difficulté est de déterminer et satisfaisant l’équation linéaire V-22 pour des les plus généraux, i.e. de déterminer la courbe spectrale. Cela passe par la résolution de l’équation linéaire homogène :
| (V-23) |
pour une fonction dont on connait les propriétés analytiques sur . Pour la combinatoire, est un segment de l’axe réel, mais on peut chercher d’autres types de solutions de l’Éqn. V-23, où est une collection d’arcs du plan complexe. Dans un premier temps, on supposera que la vraie coupure ne rencontre ni ses coupures images , ni les discontinuités de que l’on peut appeler coupures fantômes. Un point critique sera probablement atteint lorsque les coupures (au sens large) commencent à se rencontrer, autrement dit lorsque la courbe spectrale devient singulière.
Si cette étape est franchie, avec une notion sous-jacente de géométrie complexe et de feuillets, je pense qu’il sera aisé de montrer que tous les autres sont donnés par une formule des résidus, avec un formalisme de récurrence topologique (Chapitre II), et toutes les propriétés qui y sont associées.
V.3 Le modèle trivalent
V.3.1 Présentation
Ce programme a été complété dans mon article [BE11] pour le modèle trivalent introduit par Kostov [Kos89] :
| (V-24) |
ou bien, après intégration des :
Il engendre des cartes constituées de gones (), où les chemins vivent seulement sur des triangles, et chaque boucle est comptée avec un poids (Fig. V.10). Le modèle combinatoire est parfaitement défini pour toute valeur de . Il est bon garder à l’esprit les modèles populaires en physique statistique qui lui sont reliés :
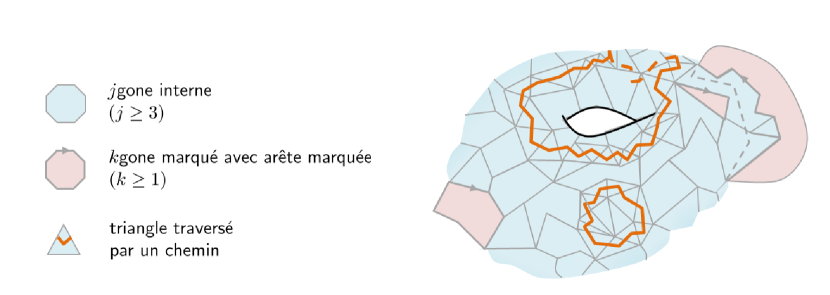
Du point de vue des équations de boucles, le modèle trivalent est techniquement le plus simple : est une fonction affine, donc n’a qu’un seul zéro , qui est fonction affine de . L’équation linéaire :
| (V-25) |
a été résolue pour quelconque888La solution est connue depuis longtemps dans le cas , où est une fraction irréductible. Elle s’exprime uniquement en termes de racines carrées et de racines . On pourra par exemple consulter [EZJ92]. dans la thèse de Bertrand Eynard [Eyn95], et lors de ses travaux avec Charlotte Kristjansen [EK95, EK96] Cela leur a permis de trouver , , et en principe les séries génératrices pour les autres topologies grâce à la méthode des moments initialement développée par Ambjørn et al. [ACM92].
Mes travaux ont consisté à reformuler cette solution dans le cadre de la géométrie complexe, puis à démontrer que tous les sont bien donnés par une récurrence topologique. Par rapport à la méthode des moments, l’avantage de la récurrence topologique est d’élucider complètement le caractère géométrique du problème. Elle donne aussi un algorithme de calcul plus facile à mettre en œuvre.
Pour simplifier, je vais supposer . On peut naturellement étudier les cas en prenant des limites . Nous n’aborderons pas le cas , où la nature des solutions de l’Éqn. V-25 est un peu modifiée [EK96].
Interprétation combinatoire des équations de Schwinger-Dyson
Les équations de Schwinger-Dyson traduisent des relations entre séries génératrices de cartes. En général, elles sont équivalentes à des bijections que l’on peut construire en ôtant une arête marquée dans une carte. Cependant, en manipulant les équations de Schwinger-Dyson, on peut arriver à des équations dont la signification bijective n’est pas très claire. C’est le cas de l’Éqn. V-18, obtenue après avoir déplacé des contours dans le plan complexe. Le modèle est à la fois assez simple et élaboré pour illustrer comment on peut parvenir, par une approche bijective, à :
| (V-26) | |||||
qui est le développement topologique de l’Éqn. V-20, où l’on identifie :
La méthode consiste toujours à établir une relation de récurrence entre séries génératrices de cartes, en décrivant les cartes obtenues en ôtant l’arête marquée d’une face marquée.
Pour le modèle , ce procédé est appliqué dans un premier temps aux cartes enracinées de genre à la Fig. V.11. Il fait apparaitre des cartes avec deux mèches adjacentes, dont la série génératrice est :
Le résultat est :
| (V-27) | |||||
Il faut trouver une autre relation pour éliminer . Le même procédé est appliqué à cette fin aux cartes enracinées de genre , dont la face marquée possède deux mèches, à la Fig. V.12. Leur série génératrice dépendant de deux variables, et , couplées aux distances séparant les deux mèches le long de la face marquée :
Le résultat est :
| (V-28) |
En spécialisant dans l’Éqn. V-28, on obtient en termes d’observables uniformes uniquement. On en déduit l’Éqn. V-26 en additionnant l’Éqn. V-27 pour les valeurs et . Ces changements de variables sont autorisés car ils préservent le caractère de série formelle en et en des observables et .
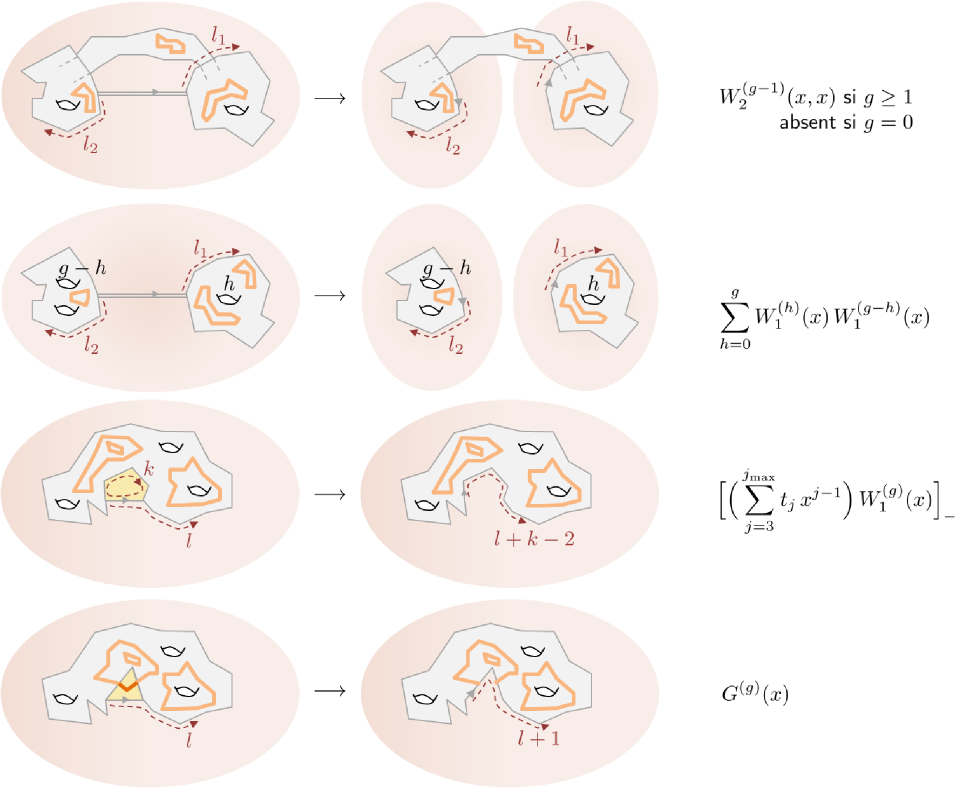
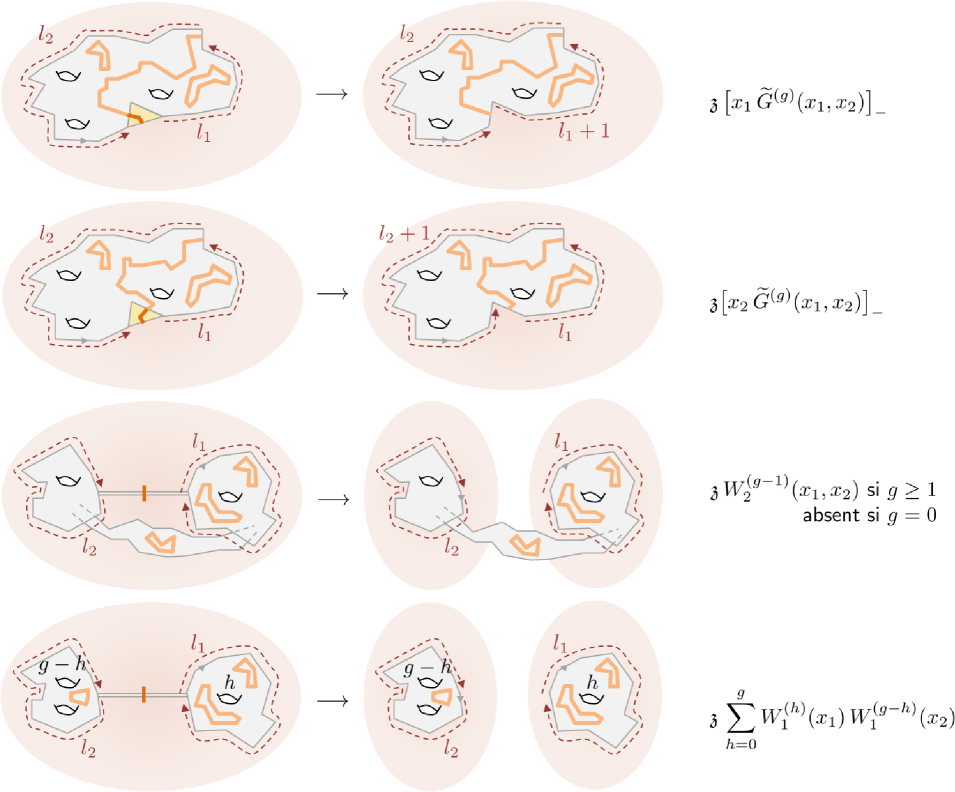
Comme l’interprétation combinatoire de l’opérateur d’insertion est limpide (on considère des cartes ayant une face marquée supplémentaire, de périmètre couplé à la variable ), cela donne une preuve combinatoire complète des équations de Schwinger-Dyson du modèle .
V.3.2 Séries génératrices des topologies instables
Résolution de l’équation linéaire
et satisfont, pour :
| (V-29) | |||||
Ces équations sont linéaires. Comme le second membre est une fonction régulière sur , elles ont une solution particulière facile :
| (V-31) | |||||
| (V-32) |
Les quantités sont solutions de l’équation homogène V-25. Rappelons l’idée de la résolution de l’Éqn. V-25. Si l’on cherche à exprimer la solution générale de l’Éqn. V-25 sans autre information, on sera naturellement conduit à considérer des fonctions qui ont une discontinuité sur et sur son image . Il est judicieux d’introduire un paramétrage qui "ouvre" ces deux coupures :
| (V-33) |
où est l’intégrale elliptique complète évaluée en . n’est pas une fonction univaluée. La détermination principale envoie sur le domaine , et la fonction réciproque peut être étendue analytiquement pour (Fig. V.13) en une fonction qui satisfait :
est un nombre complexe de partie imaginaire strictement positive, c’est ici le module de la surface de Riemann :
Le domaine est appelé feuillet physique. L’opération miroir devient dans le feuillet physique avec le nouveau paramétrage.
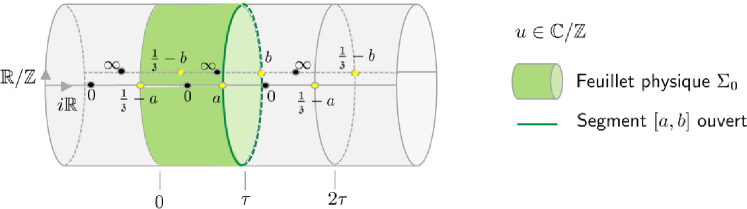
Les solutions de l’Éqn. V-25 qui sont des fonctions analytiques sur s’écrivent alors , avec une fonction qui se prolonge analytiquement sur et vérifie :
| (V-36) | |||
| (V-37) |
Ces équations nous disent que n’est pas univaluée sur la surface de Riemann , car elle admet une monodromie non triviale autour de . La contrainte d’imparité peut être imposée a posteriori. Si l’on se concentre sur l’Éqn. V-36, l’ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension sur le corps des fonctions elliptiques, i.e. périodiques de période et et méromorphes sur . Toute solution s’écrit comme combinaison linéaire (à coefficients "fonctions elliptiques") de fonctions prenant des phases à chaque translation par
avec . Tout d’abord, il existe de telles fonctions. Il suffit d’en construire une, dans , et cela peut être fait avec un ratio de fonctions thêta ou une série infinie999Comme la série ne converge pas absolument, il faut préciser que est une notation pour . :
Celle-ci est dans et a des pôles simples lorsque , tels que :
La théorie de ces fonctions pseudoelliptiques (les fonctions de ) est analogue à celle des fonctions elliptiques esquissée en Annexe A. Il n’y a pas de fonction pseudoelliptique holomorphe, autre que la fonction constante101010Cela n’est vrai que pour , i.e. pour . Autrement dit, quand est une phase. est un exemple de fonction entière, périodique et prenant un facteur constant de module après translation , puisque .. Une fonction pseudoelliptique est caractérisée par son comportement aux pôles, ou par la position de ses pôles et de ses zéros. On peut identifier l’analogue des fonctions de Weierstraß (pôle double sans résidu), (pôle simple), (singularité logarithmique), et des fonctions de Jacobi. Ce sont les briques qui permettent de représenter de diverses manières toute fonction pseudoelliptique, par exemple avec des formules de Cauchy.
Pour les fonctions solutions de l’Éqn. V-36-V-37, le noyau de Cauchy approprié est :
et la représentation d’une fonction méromorphe s’écrit :
| (V-39) |
C’est une somme de résidus aux pôles de dans le feuillet physique. Lorsque , , et pour tous les autres pôles, . Cette formule est correcte stricto sensu lorsque n’a pas de résidus à . Pour déterminer , il suffit donc de déterminer son comportement aux pôles dans le feuillet physique.
La méthode d’Eynard et Kristjansen donne des résultats "plus explicites" dans la variable . Deux remarques permettent de faire le lien avec leurs expressions. Tout d’abord, si est une fonction pseudoelliptique, alors est une fonction elliptique. Ensuite, il est possible de montrer que est une fonction elliptique de période et ssi s’écrit :
| (V-40) |
où et des fractions rationnelles paires, et . Cela permet toujours d’exprimer comme une intégrale elliptique. Dans [EK95, EK96], Eynard et Kristjansen exhibent dans un premier temps une base de . Puis, ils décomposent , la solution recherchée de l’équation linéaire, sur cette base, avec des coefficients qui sont des fonctions elliptiques écrites selon l’Éqn. V-40. Enfin, ils déterminent les fractions rationnelles paires inconnues à partir des propriétés de au voisinage de ses singularités.
Les disques :
est la solution de l’Éqn. V-25 caractérisée par les propriétés analytiques :
Autrement dit, si l’on note le prolongement analytique de à , il n’a de singularité dans le feuillet physique qu’en .
On peut appliquer directement la formule Éqn. V-39. Il est commode de paramétrer le potentiel, en fonction de son comportement au voisinage de :
En utilisant les propriétés de , le résultat est :
| (V-41) |
On remonte facilement à . La position des bords et est déterminée par la consistance de l’Éqn. V-41 avec :
i.e. par deux conditions d’annulation au bord de la discontinuité. doit être l’unique solution de ce système telle que et lorsque .
La méthode suivie par Eynard et Kristjansen donne une expression différente de l’Éqn. V-41, mais équivalente et que nous écrivons :
| (V-42) |
est un noyau construit à partir d’un choix de fonctions de base dans , dont l’expression est donnée dans [BE11]. Cette formule intégrale généralise celle de Tricomi [Tri57] :
Les cylindres :
On note , le prolongement analytique de à . C’est une fonction méromorphe, qui a des pôles doubles sans résidus lorsque et :
n’admet aucune autre singularité. On peut donc la construire par combinaison linéaire (à coefficients constants) de fonctions de Weierstraß pseudoelliptiques :
On remonte facilement à . Là encore, Eynard et Kristjansen trouvent une expression différente, avec des fonctions qui dépendent séparément de et . Elle est bien sûr équivalente : satisfait, comme la fonction de Weierstraß usuelle, des formules d’addition des arguments, reliant , et . L’avantage de l’Éqn. LABEL:eq:wsp est de bien montrer que ne dépend que des distances et , une fois mesurées dans la bonne coordonnée . Cela généralise un phénomène bien connu dans le modèle à une matrice.
Dans les deux cas, on observe que est une fonction universelle : toute la dépendance dans les paramètres du modèle se résume à la position des extrémités des coupures (i.e de , et du paramètre ). Cela était aussi attendu.
Les sphères :
Les séries génératrices de cartes sans bord se déduisent par intégration des séries génératrices des cartes à bords. Dans le cas de , cela se manifeste par la relation d’homogénéité :
et la relation de géométrie spéciale :
On donne seulement le résultat de l’intégration :
où . L’Éqn. V.3.2 est la généralisation pour le modèle du prépotentiel défini à l’Éqn II-18. On peut pousser plus loin ces formules pour calculer (en utilisant l’Éqn. V-41) ou (en utilisant l’Éqn. LABEL:eq:wsp). Quelques unes sont données dans [BE11]. Ces résultats sont nouveaux par rapport à [EK95, EK96].
Les tores :
Du point de vue des modèles de matrices, est la fonction la plus difficile à calculer. Nous avons montré qu’une formule similaire à l’Éqn. II-17 existe, avec une fonction définie à partir de par une déformation de l’Éqn. II-16. Cela n’est pas très explicite.
Dans les modèles de boucles sur réseau fixe, la fonction de partition sur le tore111111Il va de soi que le tore intervenant dans le paramétrage n’a rien à avoir avec la topologie des cartes de ce paragraphe. est une quantité importante, qui se calcule exactement en termes de caractères de Temperley-Lieb (avant la limite continue) ou de Virasoro (à la limite continue). Tout progrès pour le calcul du serait intéressant en vue d’une comparaison avec les résultats sur réseau fixe. On pourrait à l’avenir exploiter un argument heuristique basé sur une intégrale de chemins, qui relie notre à un déterminant de Fredholm.
V.3.3 Séries génératrices des topologies stables
Résultat principal
Il est naturel, dans le modèle formel de matrices, de considérer les fonctions , qui sont les formes différentielles lues avec la coordonnée , avec un décalage pour et (Éqn. V-31 et V-32). Elles s’étendent analytiquement en fonctions méromorphes pour . Une conséquence immédiate du lemme "une coupure" et des équations de Schwinger-Dyson, est que les pour n’ont de pôles dans le feuillet physique que lorsque ou .
Définissons une courbe spectrale pour le modèle .
est un cylindre. est une coordonnée globale sur .
est une fonction méromorphe sur . Parmi les points de branchement de , on sélectionne seulement ceux qui se trouvent dans le feuillet physique : . On définit une involution (qui est ici globale) par .
définit une fonction méromorphe sur . Lorsque , la relation entre et est non algébrique.
On définit un pseudo noyau de Bergman :
a bien un pôle double avec coefficient à points coïncidants et pas de pôle et (c’est la raison de ce décalage). Mais ce n’est pas stricto sensu un noyau de Bergman, car il admet des pôles supplémentaires, lorsque atteint les autres points , (cf. Fig. V.14).
Theorème V.2.
Pour , les séries génératrices des cartes de genre à bords sont données par la récurrence topologique appliquée à la courbe spectrale .
Autrement dit, on a la formule des résidus (§ II.2.3) :
est relié à par la relation V.3.3. Le noyau de récurrence est :
signifie que l’on exclut de la somme tous les termes ou apparait.
Les autres propriétés de la récurrence topologique sont aussi valides, ce sont essentiellement des conséquences de cette formule, et je ne les redérive pas ici. Je mentionne seulement l’équation de dilatation qui permet de calculer les séries génératrices des cartes sans bord :
Theorème V.3.
Pour :
Ainsi, la solution du modèle de matrice ne se distingue pas de celle du modèle à une matrice, une fois la courbe spectrale identifiée. Même la relation II-32 entre le corrélateur et le noyau de Bergman est encore valide :
Preuve
Nous allons utiliser les équations de Schwinger-Dyson et la formule de Cauchy (Éqn. V-39), pour arriver exactement à la formule des résidus. Le rôle de l’involution est essentiel121212Toutes les fonctions que l’on considère sont périodiques en , donc le dans n’est pas important.. Il est facile d’être égaré lorsque l’on fait ce calcul la première fois, à cause des décalages de et . C’est pourquoi je choisis de détailler cette preuve.
On pose :
et l’on va définir , et dans tous les autres cas. Les équations de Schwinger-Dyson V-21, pour , s’écrivent toujours :
| (V-46) |
avec une fonction régulière lorsque ou . Les cas et doivent être traités séparément, à cause du décalage :
Lorsque :
| (V-47) | |||||
Lorsque , l’Éqn V-47 ne peut pas être correcte car a un pôle lorsque . En fait :
avec la définition de adoptée à l’Éqn. V.3.3.
Lorsque , il y a des termes supplémentaires dans l’Éqn. V-47, qui sont des produits de deux ou . Comme il sont réguliers lorsque , on peut les inclure dans , et l’Éqn. V-47 est encore valide.
Nous pouvons maintenant utiliser la formule de Cauchy (Éqn. LABEL:eq:Chachy) :
et y insérer l’équation de Schwinger-Dyson sous la forme Éqn. V-46.
Puisque , s’annule lorsque . Par conséquent :
est régulier lorsque , et le terme impliquant ne contribue pas au résidu :
Puisque , on peut symétriser :
On peut décomposer :
avec :
Même si l’on n’a pas explicité le terme produit provenant du décalage lorsque , est régulier lorsque . Par conséquent, on trouve la formule des résidus, pour :
En comparant l’expression de (Éqn. LABEL:eq:wsp) et celle du noyau de Cauchy (Éqn. LABEL:eq:Chachy), et en rappelant que , on peut établir :
On peut ajouter à toute fonction impaire de sous l’involution sans changer l’intégrale, en particulier on remplacer par (Éqn. V.3.3). D’où la formule :
V.3.4 Limite des grandes cartes
Les points critiques propres au modèle sont ceux où rencontre la coupure image , i.e. lorsque ou . La limite de a été extensivement étudiée par Kostov et Staudacher [KS92], en étudiant l’équation linéaire directement à ou . On peut retrouver leurs résultats en prenant la limite dans divers régimes de l’Éqn. V-42 ou V-41, sachant que correspond à .
Si l’on fixe tel que , il y a autant de phases possibles que de déterminations de tel que . La résolution de la courbe spectrale est :
avec une courbe plane limite non algébrique :
telle que lorsque . Par ailleurs :
et pour la limite du pseudo noyau de Bergman :
Cela définit une courbe spectrale limite avec un point de branchement à .
Ces points critiques sont atteints à certaines valeurs , et l’approche se fait à une vitesse :
L’exposant de susceptibilité s’en déduit :
Comme ces exposants sont connus, nous n’allons pas nous attarder sur ces résultats.
Comme la récurrence topologique passe bien à la limite singulière de courbes spectrales, nous avons aussi démontré, pour les séries génératrices de cartes :
avec les subtilités habituelles (décalages, parties non singulières) pour les topologies instables (). Ces exposants et leur dépendance dans la topologie est attendue du côté de la théorie conforme de charge centrale :
couplée à la théorie de Liouville : c’est la relation d’échelle KPZ (pour le paramètre d’échelle ) [KPZ88]. Elle apparait comme une conséquence de la relation de Gauss-Bonnet pour une feuille d’univers de caractéristique d’Euler : . Récemment, pour les cartes sans boucles, Guillaume Chapuy [Cha09, Chapitre 2] a trouvé une interprétation combinatoire de cette dépendance en : la relation d’échelle garde trace de la probabilité de trouver trisections dans une carte, qui la rendent de genre . Son argument se généralise probablement aux cartes du modèle , et aux autres modèles de boucles.
Chapitre VI Cordes topologiques et conjecture BKMP
Les invariants de Gromov-Witten d’une variété de Calabi-Yau torique peuvent être calculés efficacement de plusieurs manières : par des techniques de localisation (relations avec la théorie de l’intersection de ), par des sommes sur des partitions (relations avec des problèmes combinatoires et de théorie des représentations du groupe symétrique), par des hiérarchies d’équations différentielles intégrables. En 2007, Bouchard, Klemm, Mariño et Pasquetti ont conjecturé une nouvelle méthode, basée sur la récurrence topologique appliquée à la courbe miroir de . L’application la plus simple de cette conjecture donne une façon de calculer les nombres de Hurwitz simples grâce à la récurrence topologique appliquée à la courbe de Lambert , et cela a été établi dans [BEMS10]. Des progrès, auxquels je n’ai pas contribué, ont été faits depuis en direction de la conjecture BKMP générale, mais il y a encore beaucoup à comprendre. L’objectif de cette partie est d’expliquer, à un niveau élémentaire, l’intérêt des méthodes du Chapitre II pour la théorie des cordes topologiques.
VI.1 Notions de théorie des cordes
Commençons par une introduction simplifiée à la théorie des cordes dont nous aurons besoin.
VI.1.1 Pourquoi les espaces de Calabi-Yau ?
Une théorie des cordes est une théorie des champs où les configurations sont des plongements de surfaces de Riemann (les feuilles d’univers) dans un espace cible . Nous n’allons pas aborder de telles définitions par la théorie des champs. Disons seulement que, en général, l’on s’intéresse aux théories dites sans anomalie, où la valeur des observables ne dépend pas du choix de paramétrage de et utilisé pour les calculer. Cela impose des conditions purement géométriques sur . La théorie des supercordes, avec un espace riemannien et de dimensionR et qui admet un spineur constant, fournit une classe de théories sans anomalie. Les physiciens se sont tout de suite demandés : si l’on écrit , où est une variété de dimension qui joue le rôle d’espace-temps (par exemple ), quelle est la théorie effective sur ? Pour cela, il faut que soit une variété de dimensionR , sur laquelle il existe un spineur constant. Les configurations qui extrémisent l’action des supercordes sur sont celles où la métrique de satisfait les équations d’Einstein :
| (VI-1) |
En l’absence de matière, le tenseur énergie-impulsion est nul. Si l’on recherche les solutions où est un produit direct , et sont nécessairement solution de l’Éqn. VI-1 en dimensionR et respectivement.
Une restriction supplémentaire consiste à ne s’intéresser qu’à des variétés de Kähler . Ce sont les variétés complexes dont la métrique est induite par un élément , autrement dit
lu dans un système de coordonnées locales holomorphes . Les variétés de Calabi-Yau (CY en abrégé) sont précisément définies comme les variétés de Kähler qui admettent un spineur constant. Elles ont plusieurs autres définitions équivalentes :
Définition originale Il existe une forme volume sur qui ne s’annule jamais.
Conjecture de Calabi, démontrée par Yau Il existe une métrique sur de courbure de Ricci nulle : . En particulier, la courbure scalaire est nulle.
Les CY de dimensionC fournissent donc un cadre naturel pour étudier la théorie des supercordes sans anomalie dans un espace du type .
VI.1.2 Théories des cordes de type A et B
La théorie des supercordes sans anomalie associée à existe en deux versions, type IIA et IIB, qui diffèrent par la réalisation de la supersymétrie. L’intensité globale des interactions entre cordes est fixée par un paramètre , couplé à la topologie des feuilles d’univers. En théorie topologique des cordes, seules les observables qui ne dépendent que de la topologie vont nous intéresser. On dit que ces observables appartiennent au secteur topologique, ouvert ou fermé selon la présence ou non de bords dans les feuilles d’univers. Dans le secteur fermé, les quantités à calculer sont :
-
l’énergie libre de genre , .
-
l’énergie libre .
-
la fonction de partition .
Comme en thermodynamique, les observables du secteur ouvert sont reliées aux variations de ces quantités par rapport à certains paramètres dont dépend la géométrie de . Pour les théories des cordes, l’évaluation de ces observables est une première étape et dicte les couplages entre les autres secteurs. Pour les mathématiques, ces observables sont intéressantes si on les voit comme des séries génératrices en , car elles contiennent des informations sur la géométrie de .
Dans le modèle B
C’est la structure de variété complexe de qui compte. Il est muni d’une forme de Kähler , qui définit une forme volume holomorphe . Les observables du secteur fermé encodent les intégrales de sur des cycles de . L’énergie libre de genre est bien définie par :
où est une base de telle que :
L’énergie libre de genre est définie à partir de la torsion de Ray-Singer , qui est un invariant de variété symplectique :
est le laplacien agissant sur les formes holomorphes, et le déterminant est régularisé selon une procédure classique en théorie spectrale [Vor87]. Les pour , ou les observables du secteur ouvert, n’avaient pas de définition rigoureuse et assez générale jusqu’aux propositions de Bouchard, Klemm, Mariño et Pasquetti [BKMP09] (cf. § VI.2.2). Toutefois, si elles existent, on souhaite qu’elles vérifient des équations d’anomalie holomorphe, dérivées [BCOV94] via la théorie des champs qui représente le modèle B. Ces équations dictent la dépendance en des , mais en général ne les déterminent pas complètement.
Dans le modèle A
C’est la structure de variété symplectique de qui compte. Les observables énumèrent les surfaces de Riemann de genre à bords, plongées dans avec un degré donné et s’enroulant sur certaines surfaces (Fig. VI.1). Les autorisés sont prescrits par la structure symplectique sur . Ces nombres sont des invariants géométriques de . Il existe deux approches pour les définir, suivant le point de vue adopté sur .
DT est défini implicitement par une équation dans . Il existe une mesure de comptage naturelle sur l’ensemble de telles équations. Les invariants de Donaldson-Thomas sont définis par son intégrale sur . On les rassemble dans une fonction de partition , qui est par construction une série en puissance de , où vit naturellement près de .
GW est défini par un paramétrage dans . L’ensemble de ces paramétrages coïncide avec l’espace introduit dans les parties I.9 et I.10. Il existe une bonne mesure de comptage, notée , sur cet espace, et les nombres
sont appelés invariants de Gromov-Witten. On les rassemble dans une série génératrice en puissances de , qui vit naturellement près de . En particulier dans le secteur fermé :
et l’on note la fonction de partition. Un comptage de dimension montre que beaucoup de ces invariants sont nuls lorsque est de dimension. Cela concentre l’intérêt, dans un premier temps, sur les espaces de basse dimensionC et .
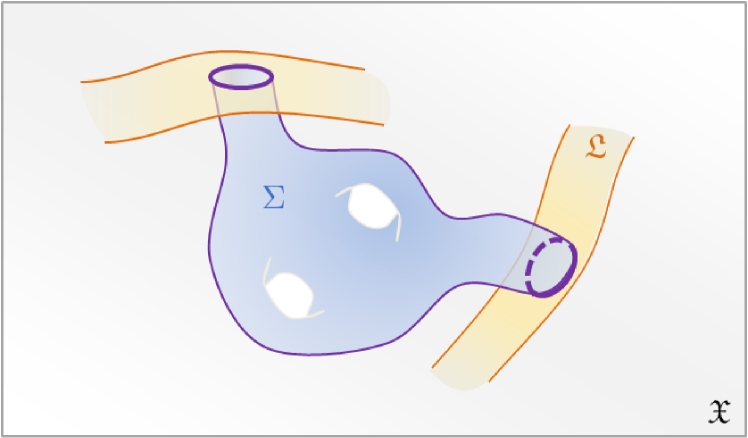
Il a été démontré [MOOP08] que et sont égaux modulo une identification adéquate des paramètres des séries génératrices. Cela signifie qu’il existe une fonction de partition pour le modèle , de sorte que le développement asymptotique à de engendre les invariants DT, et le développement à de les invariants GW. Nous allons surtout parler de l’aspect Gromov-Witten.
Nous supposerons dorénavant que est un CY de dimensionC (CY3 en abrégé). Pour la famille des CY3 qui admettent une symétrie torique , des techniques de calcul assez générales ont été développées à la fois pour les modèles A et B. Ce n’est pas étranger au fait que la classification des CY3 toriques est très simple, et s’étend aussi au cas des orbivariétés. Le paragraphe § VI.1.4 résume cette classification et introduit plusieurs notions utiles à la partie VI.2. En revanche, le programme de classification des CY3 n’est pas encore achevé. Il existe des travaux sur la théorie topologique des cordes dans d’autres familles connues de (qui ont ou pas la propriété de Calabi-Yau), mais cela sort du cadre de cette thèse.
VI.1.3 Symétrie miroir
Il existe une symétrie miroir disant que le modèle de type sur un espace est dual au modèle de type sur un espace miroir . C’est une conjecture profonde en mathématiques, et dont la formulation précise demande un investissement en géométrie algébrique bien au-delà des objectifs de cette thèse. On pourra consulter le programme original de Kontsevich [Kon94], et nous n’allons pas faire état des progrès récents pour y répondre. Le livre [CK99] décrit le phénomène avec de nombreux exemples.
La symétrie miroir a été justifiée par les physiciens Hori et Vafa [HV00], disons pour le moins, lorsque est un CY3. Son miroir est également un CY3 que l’on sait construire explicitement. Ici, nous adopterons un point de vue purement calculatoire : sous hypothèses, nous disposerons de définitions algorithmiques pour certaines observables des modèles A et B, et nous verrons quelles propriétés elles impliquent. La symétrie miroir prédit une correspondance précise entre observables, souvent vérifiable numériquement, et permet de transposer (en conjecture) des idées développées pour le modèle A vers le modèle B et inversement. La conjecture BKMP en est une manifestation (§ VI.2.2).
VI.1.4 Description des CY toriques
Cette présentation sera minimale, et s’inspire de celles employées dans les articles d’Aganagic, Klemm, Mariño, …[LLLZ09, Mar05b, BKMP09]. Son but est surtout de permettre au lecteur d’identifier les objets que l’on manipule, en s’appuyant dès que possible sur des dessins et une intuition. La plupart des justifications seront laissées de côté. Un amateur qui aimerait avoir plus de prises sur les géométries toriques pourra consulter l’article pédagogique [Clo09].
Les CY3 toriques …
À l’exception de quelques cas particuliers, tous les CY3 toriques peuvent être construits comme des quotients111ou des recollements de ces quotients. En fait, les espaces que l’on considère ici ne sont pas des variétés lisses. On travaille plutôt avec des schémas, i.e. des atlas d’anneaux constitués des polynômes dans les coordonnées locales, qui satisfont des conditions de recollement. Le point de vue des schémas a l’avantage de décrire sans heurts les points où n’est pas lisse, par exemple au voisinage desquels est une orbivariété. Les ”CY3 toriques” que l’on considère en pratique sont parfois appelés CY3 toriques formels dans la littérature. :
| (VI-2) |
avec les identifications pour tout . Les sont appelés paramètres de Kähler, ils forment un système de coordonnées réelles sur . Les vecteurs sont appelés charges. L’espace est bien de Calabi-Yau ssi :
| (VI-3) |
n’est pas nécessairement une variété lisse, mais la description Éqn. VI-2 est assez explicite pour que l’on comprenne ses singularités.
Si l’on choisit initialement un système de coordonnées locales valable sur un ouvert , on peut réaliser comme un fibré en tores sur . (Fig. VI.2, à gauche). Par exemple, en introduisant et par :
| (VI-4) | |||
et en définissant l’action de par :
La condition VI-3 implique que l’action des charges laissent la coordonnée invariante, ce qui permet de projeter à dans tout système de coordonnées sans perdre d’information.
Si l’on souhaite décrire les fibres à constants dans une autre région avec un autre système de coordonnées , il faut utiliser l’Éqn. VI-2 pour exprimer et en fonction des . On peut parcourir ainsi tout un atlas de . Même si les choix de et de la fibration Éqn. VI-4 sont arbitraires, la géométrie de est entièrement caractérisée par le lieu où la fibre est singulière. C’est en général un graphe trivalent dont les arêtes ont une pente fractionnaire (Fig. VI.2, à droite). Réciproquement, la donnée d’un tel graphe permet de reconstruire un CY3 par le recollement approprié de systèmes de coordonnées associés à chaque vertex de .
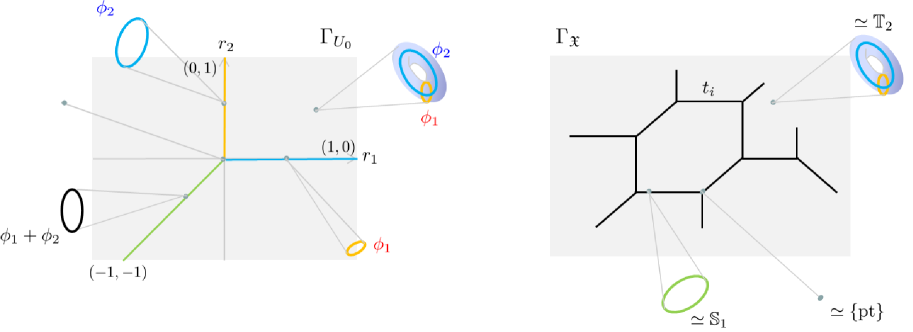
est appelé le diagramme torique de . La géométrie de est encodée de façon transparente dans le dual : les sommets correspondent à des points de , les arêtes à des courbes invariantes sous l’action torique, et les faces donnent des relations entre les classes d’homologie de courbes invariantes toriques (elles sont prescrites par les charges ). Pour chacune de ces courbes, on peut définir un paramètre de Kähler complexe , et ces relations indiquent que tous les ne sont pas indépendants.
…et leurs miroirs
A tout CY3 torique est associé un espace miroir , qui est aussi un CY3 torique :
| (VI-5) |
coïncident avec les paramètres de Kähler de . Modulo un choix de coordonnées fonctions des , on munit de la forme volume holomorphe .
Il est commode d’utiliser des coordonnées vivant dans : , , . On peut voir comme un fibré en hyperboles, où les fibres ont pour équation . Le lieu où ces fibres deviennent singulières est appelé courbe miroir et noté (Fig. VI.3). Son équation se déduit de :
à partir des relations définissant (Éqn. VI-5). Elle est toujours de la forme :
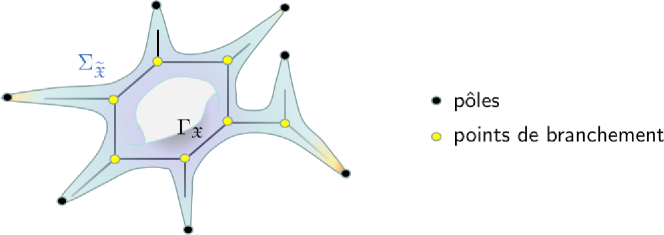
L’application miroir
Il existe une application miroir, qui donne la correspondance entre les paramètres de Kähler de (modèle A) et les périodes de , de sorte que la symétrie miroir soit valide dans le secteur fermé :
En fait, grâce aux symétries toriques, les périodes sur les cycles de dimensionR de se réduisent aux périodes de sur des cycles de la courbe miroir :
Avant de parler de symétrie miroir dans le secteur ouvert, il faut préciser dans le modèle A sur quelles surfaces s’enroulent les bords de la feuille d’univers . Génériquement, ces bords sont appelés branes. Les qui se proposent naturellement comme support des branes sont des surfaces lagrangiennes, i.e.222Contrairement au secteur fermé qui apparemment n’utilise que la structure de variété complexe de , le secteur ouvert du modèle A fait intervenir la structure de Kähler sur . , qui vivent sur les arêtes de . Leur position est fixée par un entier , dont le nom anglais framing n’a pas de traduction en français. Intuitivement, il spécifie le plongement de dans la fibre (Fig. VI.4). Les observables ouvertes de genre , à bords du modèle A sont alors les séries génératrices :
où est le nombre d’enroulements de la brane autour de .
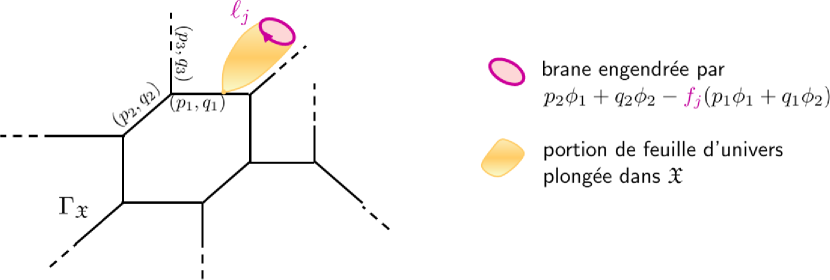
Il y a aussi un secteur ouvert dans le modèle B : intuitivement, ajouter des branes revient à ajouter des singularités dans la structure complexe de . Cela se traduit naturellement par l’ajout de pôles dans . On comprend alors que la position de la brane est déterminée par un point associé au choix d’une coordonnée locale . A priori, les observables ouvertes dépendent du choix du paramétrage de . Il existe une application miroir "ouverte" qui, à partir d’une configuration de brane donnée dans le modèle A, prescrit le bon choix qui est fonction des , de sorte que la symétrie miroir soit valide. On peut changer la configuration de brane étudiée grâce à des transformations appropriées. En particulier, les changements de framing sont implémentés par pour , tandis que les autres transformations de permettent de déplacer une brane d’une arête de vers une autre. On peut reconnaitre dans ce un sous-groupe des transformations symplectiques de introduites au § II.2.1.
S’il faut être conscient de l’existence de ces applications miroirs, leur construction ne sera pas discutée ici. Il suffit de se référer à la littérature lorsque l’on souhaite travailler sur des exemples précis.
VI.1.5 Exemples
. Le diagramme torique est constitué par un seul vertex, et la courbe miroir a pour équation :
Après changement de référentiel , l’équation de la courbe miroir devient :
C’est une courbe de genre , sur laquelle définit une coordonnée globale, et qui a un unique point de branchement , à la position . Lorsque l’on grossit le voisinage de dans la limite selon :
on obtient la courbe de Lambert :
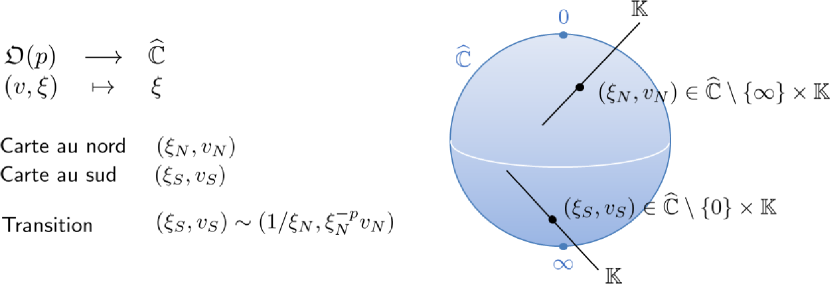
Si est une surface de Riemann, on trouve des CY3 parmi les fibrés vectoriels de rangC au-dessus de . De même, si est une variété complexe de dimensionC , on trouve des CY3 parmi les fibrés vectoriels de rangC au-dessus de . De tels espaces sont appelés géométries locales.
Les CY3 basés sur sont tous du type . La figure VI.5 explique cette notation. Lorsque , ces espaces ne peuvent être réalisés333Je remercie Marcos Mariño pour cette précision.. par un quotient du type Eqn. VI-2. Il existe tout de même une notion de courbe miroir, que l’on peut déterminer à partir du vertex topologique [no], mais que nous n’allons pas expliciter. Son expression est par exemple donnée dans [Eyn08].
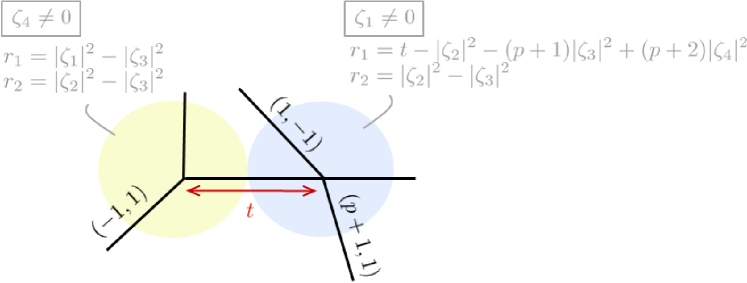
On appelle résolution du cône la famille d’espaces de l’exemple précédent.
"extrapole de manière lisse" la singularité conique , d’où son nom. La courbe miroir, dans un paramétrage adapté à une brane sur une arête externe de , a pour équation :
Le seul fibré de rangC qui permet de définir un espace de Calabi-Yau basé sur l’espace projectif , est du type . Il est réalisé par :
recouvert par les trois cartes (). L’action de est engendrée par la charge . est appelé espace local. Son diagramme torique est représenté à la figure VI.7. Une équation pour la courbe miroir est :
avec et . On admet que ce paramétrage est adapté pour décrire une brane positionnée sur une arête externe de .
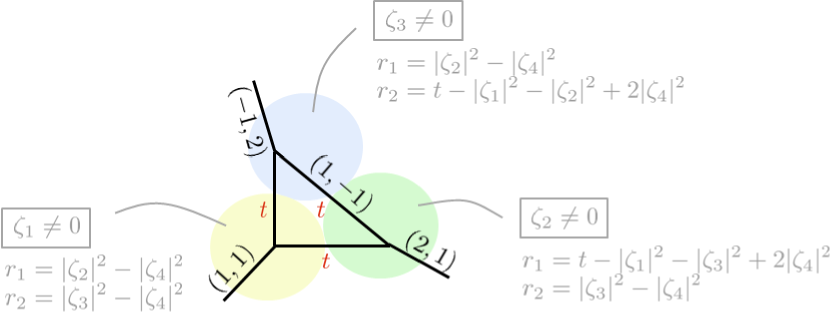
VI.2 Récurrence topologique et théorie topologique des cordes
Nous allons présenter quelques aspects du calcul des invariants de Gromov-Witten dans les CY3 toriques, où l’introduction récente de techniques de récurrence topologique a permis quelques progrès.
VI.2.1 Localisation et vertex topologique
Dans un CY3 torique, la symétrie permet de localiser les intégrales sur , i.e. de les exprimer comme une somme discrète, avec certains poids, d’intégrales sur . Les termes de cette somme sont appelés instantons : chaque configuration invariante sous l’action de donne lieu à un instanton. D’où l’importance du diagramme torique : de telles surfaces de Riemann doivent s’appuyer sur les arêtes de , et sont engendrées par la fibre . Si ce n’était pas le cas, on disposerait au moins d’une action non triviale de , dont au moins un sous-groupe ferait tourner dans . En général, les instantons sont indexés par une suite de partitions vivant sur les arêtes de . Ainsi, la dépendance dans la géométrie de ne se trouve plus dans l’espace d’intégration, mais dans les poids statistiques d’un modèle de partitions aléatoires.
Le résultat est la formule de Mariño-Vafa exprimant la fonction de partition du modèle A comme une somme sur des instantons. Leur poids font intervenir :
une amplitude dépendant de deux partitions , donnée par les nombres de Hurwitz doubles dont nous reparlerons au § VI.2.4 :
| (VI-6) |
Ici, est le nombre de boites des partitions, désigne une partition de boites, qui définit également une représentation unitaire irréductible du groupe symétrique . est le Casimir quadratique associé à (Éqn. VI-11), et est le caractère de cette représentation évalué sur la classe de conjugaison de associée à .
une amplitude dépendant de trois partitions donnée par les intégrales de Hodge triples :
est la longueur totale des partitions. est appelée classe de Hodge. Les classes sont définies [Mum83] pour , et se comportent comme des éléments de volume -dimensionnels dans (et ). Elles peuvent s’exprimer en fonction des classes et . Dans la formule ci-dessus, est un entier de framing.
Il est important de souligner que les poids des instantons ne dépendent que la géométrie locale de : on peut découper suivant chaque arête de , étudier séparément la contribution de dans chaque carte associée à un sommet de , et les recoller en sommant sur tous les découpages possibles (Fig. VI.8). La contribution d’un sommet avec la configuration de brane la plus générale est appelée vertex topologique, et noté . Plusieurs formules équivalentes permettent de calculer le vertex topologique en tant que série en puissances de . Ce sont toujours des sommes sur des partitions, que [LLLZ09] expriment à partir de . [ORV03] donne une jolie interprétation de , par un modèle statistique de grandes partitions planes s’appuyant sur .
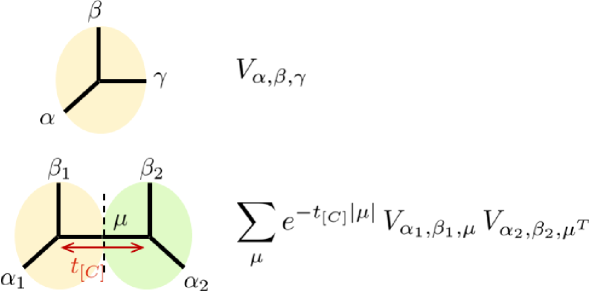
Historiquement, le vertex topologique et l’algorithme de recollement ont été découverts en physique [AKMV05]. En fait, il existe une dualité bien documentée [Wit95] entre certains invariants de nœuds de Chern-Simons pour le groupe sur un espace de dimensionR , et le secteur ouvert du modèle A sur où les branes s’enroulent sur une variété lagrangienne. Cette dualité vaut à tout ordre dans l’asymptotique , et a mené à la conjecture de la formule de Mariño-Vafa [MV01], démontrée dans [LLZ04]. Les auteurs de [AKMV05] ont décrit précisément comment transposer les idées correctes dans la théorie de Chern-Simons, pour reproduire toutes les caractéristiques attendues du secteur ouvert du modèle A dans un CY3 torique quelconque. Grâce à la localisation, ces prédictions ont été prouvées pour l’essentiel dans [LLLZ09]. Le lecteur pourra consulter [Liu06] pour plus d’informations sur les intégrales de Hodge et leur lien avec les invariants de Gromov-Witten.
VI.2.2 La conjecture BKMP
La théorie du vertex topologique calcule en puissances de , i.e. du côté Donaldson-Thomas. On aimerait également avoir une méthode directe pour calculer les invariants de Gromov-Witten, i.e. , le coefficient de dans . C’est l’objet de la conjecture de Bouchard, Klemm, Mariño et Pasquetti [BKMP09].
Conjecture VI.1.
Soit est un CY3 torique. On définit une courbe spectrale à partir de la courbe miroir et de l’application miroir ouverte. Alors, les séries génératrices d’invariants de Gromov-Witten de sont données par la récurrence topologique du Chapitre II appliquée à . Les invariants symplectiques encodent le secteur fermé :
Les primitives :
encodent le secteur ouvert lorsqu’elles sont développées en série de Taylor en , où est une coordonnée locale sur prescrite par l’application miroir.
Les formules de résidus (Éqn. II-12) et de dilatation (Éqn. II-13) donnent un algorithme efficace pour calculer ces quantités, qui héritent automatiquement de toutes les propriétés de la récurrence topologique. Celles-ci ressemblent fortement aux caractéristiques que l’on attend des observables des modèles A et B.
Dans le secteur ouvert, les dépendent du choix du paramétrage , à des transformations d’équivalence faible près. Dans le secteur fermé, est inchangé sous des transformations symplectiques de . Cela est consistant avec l’idée que l’on peut changer les configurations de branes par des transformations symplectiques de . En particulier, les pour dépendent du choix d’un framing, mais pas les .
Les et ont les propriétés de géométrie spéciale. C’est ce que l’on attend des observables du modèle B.
Le choix d’un noyau de Bergman invariant modulaire rend les et invariants modulaires, mais leur donne une dépendance non holomorphe en les périodes sur . Cette dépendance est toutefois régie par des équations d’anomalie holomorphe [EMO07]. Pour un autre choix de noyau de Bergman, dépendant de manière holomorphe des périodes, et dépend de manière holomorphe des périodes, et ont des transformations modulaires que l’on sait expliciter. C’est aussi le phénomène à l’œuvre dans le modèle B.
La conjecture BKMP a été motivée par ces analogies. Elle est bien testée numériquement par comparaison avec la méthode du vertex topologique. En fait, [BKMP09] proposent et comme définition des secteurs ouvert et fermé du modèle B dans .
VI.2.3 La conjecture de Bouchard et Mariño
Dans le cas le plus simple avec framing , les observables du modèle A encodent les intégrales de Hodge simple.
| (VI-7) |
Définissons la série génératrice
| (VI-8) |
où les sont les monômes symétriques :
et est une suite de variables proches de . Bouchard et Mariño [BM07] ont dérivé une application de la conjecture VI.1 qui permet de les calculer. La courbe miroir de dans la limite a pour équation . est une coordonnée globale sur cette courbe, et on choisit le noyau de Bergman :
pour définir la courbe spectrale .
Conjecture VI.2.
(Bouchard et Mariño)
où est l’unique point de tel que , et lorsque .
Les intégrales de Hodge simple ont aussi une interprétation combinatoire : ce sont des nombres de Hurwitz simples, que nous allons définir maintenant. Cette formule donne un algorithme efficace pour les calculer, genre par genre. Elle présente un intérêt indépendamment du contexte de la théorie des cordes où elle est apparue.
VI.2.4 Les nombres de Hurwitz
Par définition, les nombres de Hurwitz comptent le nombre de recouvrements de la sphère de Riemann par une surface de Riemann (éventuellement non connexe), à équivalence topologique près (Fig. VI.9).
| (VI-9) |
Le degré de est le nombre de préimages (comptées avec multiplicités) d’un point , et il ne dépend pas de . Tous les ont exactement préimages distinctes, sauf un nombre fini d’entre eux . est une partition de boites, qui prescrit les degrés de ramification des préimages de . Autrement dit, au voisinage d’une préimage de :
où l’on a implicitement utilisé des coordonnées locales dans et . On note le nombre de recouvrements par une surface connexe de genre . est en fait contraint par le profil des ramifications, d’après la formule de Riemann-Hurwitz :
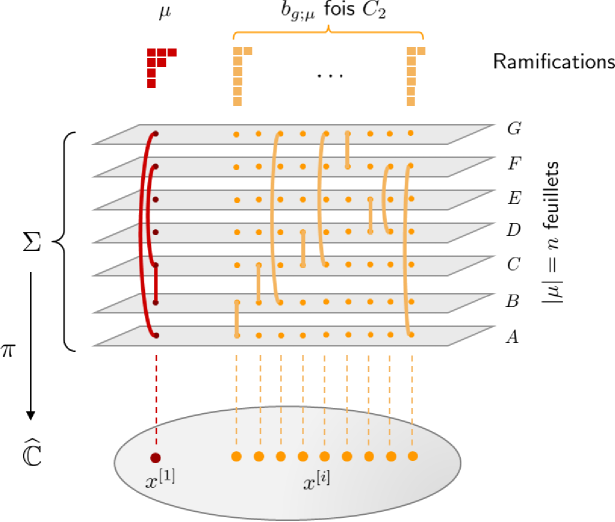
Enumérer ces recouvrements revient à compter dans les décompositions de sorte que la classe de conjugaison de soit , pondérées par leur facteur de symétrie. C’est un problème résolu il y a longtemps444Lorsqu’il n’y a que des points de branchement simples, Hurwitz a relié l’énumération des recouvrements aux décompositions dans le groupe symétrique [Hur91], et a ensuite établi la formule VI-9 [Hur02]. en termes des caractères du groupe symétrique :
| (VI-10) |
qui est une somme sur les partitions à boites.
On parle de nombres de Hurwitz simples lorsque tous les points de branchement sont simples555Rappelons que est point de branchement simple si a exactement un zéro , qui est simple., sauf un point de branchement arbitraire. À genre fixé, cela impose exactement :
points de branchement simple. La classe de conjugaison qui les décrit est celle d’une transposition, on la note . coïncide avec le Casimir quadratique de la représentation indexée par :
| (VI-11) |
La formule ELSV [ELSV01] relie les nombres de Hurwitz simples définis par la formule VI-10 aux intégrales de Hodge simple666La formule découverte par ELSV est un cas particulier de la formule de Mariño-Vafa. de l’Éqn. VI-7 :
| (VI-12) |
On parle de nombres de Hurwitz doubles lorsque tous les points de branchement sont simples, sauf deux points de branchement et arbitraires. Cette fois-ci, il y a exactement :
points de branchement simple. Cela donne une inteprétation combinatoire à la quantité définie en Éqn. VI-6 :
VI.3 Résultats récents
Venons-en concrètement aux stratégies qui permettent d’aller dans le sens de la conjecture VI.1.
VI.3.1 Utilisation des modèles de matrices
Une première approche est d’essayer de représenter la fonction de partition , qui s’écrit comme sommes sur des partitions777Collision entre le nom consacré ”fonction de partition” en physique statistique, et le nom ”partition” pour les suites . ou des partitions planes, par une chaine de matrices hermitiennes avec champ extérieur (ou tout modèle plus simple). Nous savons alors que la récurrence topologique s’applique, notamment , pourvu qu’un tel développement existe et que l’on ait identifié la courbe spectrale .
La représentation par un modèle de matrices est la partie astucieuse, mais facile car purement algébrique.
On se restreint à des partitions de longueur fixée, en excluant les partitions de longueur , et en complétant celles de longueur par zéros.
Les partitions sont en bijection avec des suites strictement décroissantes d’entiers , et l’on peut symétriser :
![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x48.png)
Les poids sur les partitions qui interviennent en théorie topologique des cordes dérivent de notions de la théorie des représentations de . Ils dépendent analytiquement des , et s’annulent lorsque deux sont égaux. La somme sur des entiers peut donc se représenter comme une intégrale de contour contre une fonction ayant des pôles simples avec résidu en ces points :
Souvent, contient des déterminants de Vandermonde . et sont des exemples rencontrés fréquemment. Cela suggère d’associer, à chaque partition, une matrice hermitienne .
Enfin, quitte à introduire des matrices aléatoires auxiliaires, ou des matrices fixées qui jouent le rôle de champ externe, on cherche à reconnaitre comme l’intégrale d’une mesure dérivant d’une chaine de matrices. La formule d’Harish-Chandra (Éqn. I-28) et la représentation du déterminant de Cauchy par une intégrale de matrice (Éqn. LABEL:eq:Cauint) sont très utiles pour cette étape.
Dès lors, la procédure du § II.3.1 s’applique : il reste à prouver que et les corrélateurs ont un développement du type II-25 dans le petit paramètre , et à déterminer la courbe spectrale qui est solution de l’équation de boucle maitresse (Éqn. II-27). C’est la partie technique, dont la difficulté varie suivant les problèmes. Souvent, en pratique, à des transformations d’équivalence faible près, cette courbe spectrale ne dépend plus de au-delà d’un assez grand. C’est une manifestation du phénomène du cercle arctique évoqué à la partie I.8. Empiriquement, s’il est assez facile de deviner une courbe spectrale solution, il est parfois difficile de prouver que c’est l’unique solution.
VI.3.2 Preuve de la conjecture de Bouchard et Mariño
Ces idées ont été appliquées dans mon article [BEMS10] pour démontrer la conjecture VI.2. Pour à la limite de framing infini, la fonction de partition s’écrit :
| (VI-13) |
C’est une série génératrice dépendant d’une suite infinie de variables vivant près de , qui permettent d’encoder les degrés des branchements. On peut toujours réaliser comme sommes de puissances de variables , i.e. . En suivant la procédure précédente, la série définie par l’Éqn. VI-13 restreinte à , se représente comme une intégrale formelle à une matrice hermitienne, de taille , dans un champ externe :
| (VI-14) |
Le potentiel vaut :
Par construction (cf. Éqn. VI-13), a un développement topologique en , et on peut aussi justifier que cela est aussi vrai des corrélateurs. Puisque dépend de , la courbe spectrale dépend ici de (on la note ) et doit satisfaire l’équation de boucle maitresse (Éqn. II-7). Comme nous avons affaire à une intégrale formelle, lorsque doit être une perturbation de la courbe spectrale d’un modèle gaussien, qui est de genre . Cet argument intuitif est justifié dans [BEMS10], d’où l’on déduit que admet un paramétrage () par une variable . Cette information adjointe à l’équation de boucle maitresse détermine une unique courbe spectrale , que l’on sait exhiber. Par conséquent :
La dernière étape de la preuve consiste à remarquer :
Les propriétés de géométrie spéciale (cf. § II.2.9) de la récurrence topologique permettent de calculer cette dérivée en fonction de . On trouve que le cycle dual de lit simplement une forme différentielle dans la coordonnée . Cette relation passe bien à la limite :
Enfin, est exactement la courbe spectrale de Lambert prédite par Bouchard et Mariño.
VI.3.3 Vers la conjecture BKMP
Pour un CY3 torique quelconque , le dual peut être construit à partir d’un réseau rectangulaire de taille assez grande après une succession de renversements de faces, et l’envoi de certains paramètres de Kähler vers l’infini (ce qui efface la partie du diagramme à "distance infinie"). Les invariants de Gromov-Witten ne changent pas lors des renversements, pourvu que l’on suive la trace des paramètres de Kähler à chaque étape. Il suffit donc de les étudier pour les CY3 toriques associés à . Eynard, Kashani-Poor et Marchal [EKPM10a] ont trouvé que donné par le vertex topologique comme une somme sur une famille de partitions, se représente comme une chaine de matrices hermitiennes, avec un champ externe à chaque extrémité (Fig. VI.10). Ils ont ensuite montré [EKPM10b] que la courbe miroir était une solution de l’équation de boucle maitresse (Éqn. II-27).
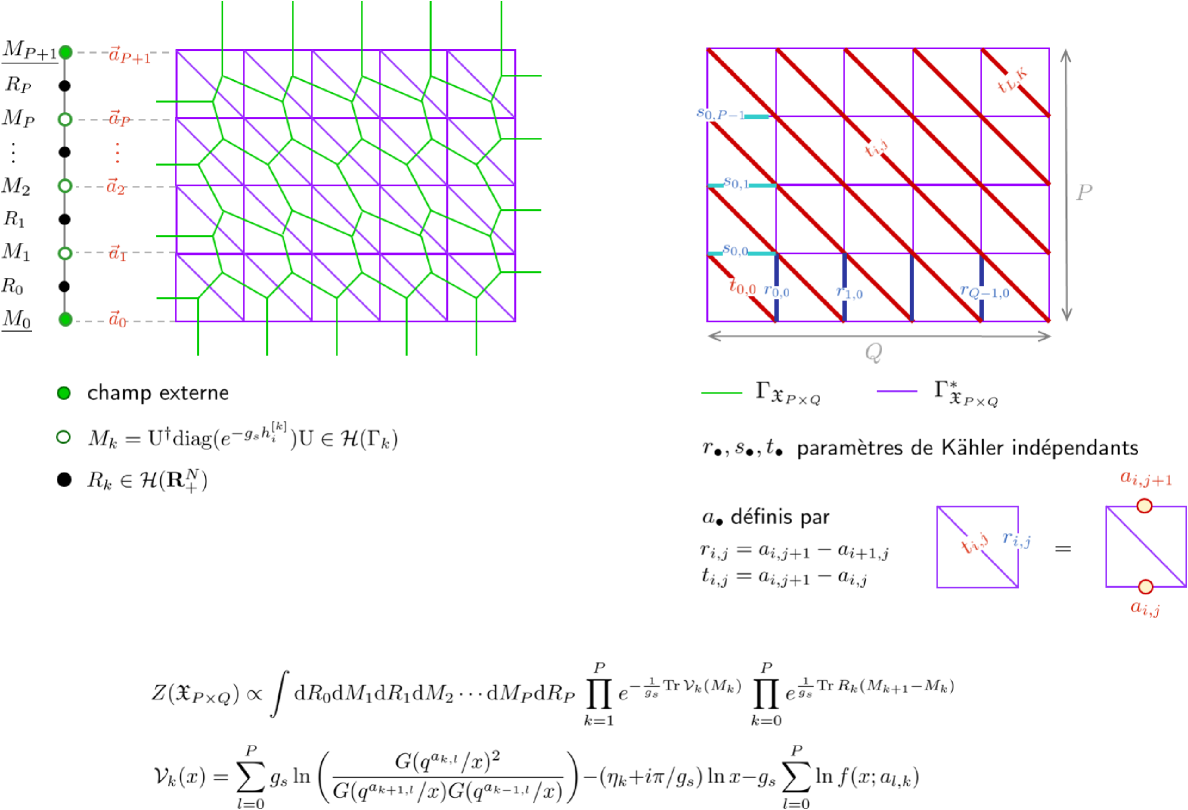
Il faudrait compléter deux points pour en déduire une preuve de la conjecture VI.1.
Le vertex topologique construit comme une série en puissances de , lorsque (cf. § VI.2.1). Grâce à la correspondance GW/DT établie par [MOOP08] (cf. § VI.1.2), on sait que a bien un développement en puissance de lorsque . Il faudrait montrer que c’est aussi le cas des corrélateurs et des corrélateurs mixtes. Ce sont des travaux en cours, auxquels je participe. Nous favorisons pour l’instant des techniques de polynômes orthogonaux pour étudier le modèle de matrices de la Fig. VI.10. À l’heure de l’écriture, la façon dont encode des observables ouvertes du modèle A n’est pas encore très claire.
Il faudrait démontrer que la courbe miroir est l’unique courbe spectrale solution de l’équation de boucle maitresse qui minimise le prépotentiel (cf. § II.3.1). Cette étape parait assez difficile.
VI.3.4 Autres méthodes
Relations combinatoires et équations de boucles
Les nombres de Hurwitz simples (§ VI.2.4) vérifient des relations combinatoires récursives, appelées équations cut-and-join, redécouvertes et étudiées par Goulden, Jackson [GJ97] et Vakil [Vak97]. Elles sont illustrées à la Fig. VI.11. Leur structure est très similaire à celles des équations de boucles (Chapitre II) ou des relations combinatoires récursives que vérifient les cartes (Chapitre V) : il y a deux types de termes, selon l’effet d’un coup de ciseau dans une surface qui recouvre . Eynard, Mulase et Safnuk ont montré dans [EMS09] que les équations cut-and-join sont en fait équivalentes aux équations de boucles pour la courbe spectrale de Lambert. Ceci donne une seconde preuve de la conjecture de Bouchard et Mariño, sans recourir à la représentation par un modèle de matrices. Il existe également des équations cut-and-join pour les intégrales de Hodge triple, dépendant d’un framing . Généralisant [EMS09], Zhou a montré dans [Zho09a, Zho09b] qu’elles sont équivalentes aux équations de boucles pour la courbe spectrale miroir de , dont l’équation est (cf. § VI.1.5). Il a ainsi obtenu une preuve de la conjecture BKMP lorsque . Le recollement de plusieurs cartes pour atteindre la conjecture BKMP générale devrait être possible en suivant ces techniques. C’est un travail entrepris notamment par Nicolas Orantin.
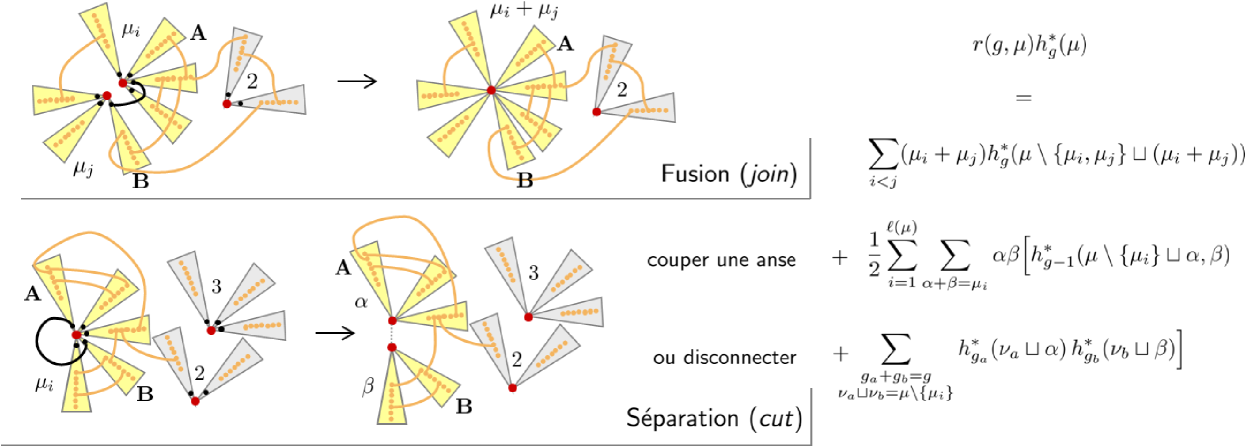
Nombres d’intersections dans
Nous avons vu au § II.3.2 que les pour les courbes spectrales admettant un point de branchement mou , et où le noyau de Bergman est :
| (VI-15) |
sont des séries génératrices de nombres d’intersections. Dès que :
| (VI-16) |
est une série génératrice de classes définie par les Éqns. II-38 et II-39.
Il devrait exister une relation similaire lorsque l’on choisit un autre noyau de Bergman. De plus, il devrait être possible de faire des "recollements" pour arriver à des courbes spectrales à plusieurs points de branchement. Actuellement, ce recollement est bien connu au niveau de la fonction de partition [Ora08], et il faudrait comprendre ce qu’il advient au niveau des fonctions de corrélations et de l’Éqn. VI-16. Ce sont des travaux en cours.
Par exemple, la courbe spectrale calculant les nombres de Hurwitz est :
Le noyau de Bergman est différent de , donc l’Éqn. VI-16 ne s’applique pas. Cependant, on sait de façon indirecte, par la formule ELSV (Éqn. VI-12) :
et selon Mumford est une série génératrice de classes et . Une formule généralisant l’Éqn. VI-16 pour un noyau de Bergman quelconque permettrait de mieux comprendre l’apparition des intégrales de Hodge du point de vue de la récurrence topologique. Dans le cas de la courbe de Lambert, on en déduirait sans doute une nouvelle preuve de la formule ELSV.
Hiérarchies intégrables
Les observables de théorie topologique des cordes sont solutions de systèmes d’équations différentielles intégrables. Une autre voie à explorer pour démontrer la conjecture BKMP serait de les relier aux systèmes intégrables venant des équations de boucles, dont on a évoqué la construction au chapitre IV. Les travaux récents d’Andrea Brini [Bri11], où sont décrits précisément ces hiérarchies intégrables et l’opérateur d’insertion dans le secteur ouvert, seraient un bon point de départ.
VI.4 Perspectives
La plupart des aspects des théories topologiques des cordes peuvent être unifiés du point de vue de la récurrence topologique. Il n’est donc pas étonnant d’y rencontrer, outre les propriétés que l’on vient d’évoquer, des systèmes intégrables, des nombres d’intersections dans , des modèles de matrices, des sommes sur les partitions ou des partitions planes, … Les équations de boucles/contraintes de Virasoro, dont la récurrence topologique fournit les solutions, sont un dénominateur commun à tous ces problèmes. Pour rendre ce point de vue complet, il faudrait mieux comprendre la relation générale entre récurrence topologique et l’intersection de classes tautologiques dans (i.e. les intégrales mêlant classes , , et ). La fin de ce chapitre évoque des questions récentes, auxquels ces outils seront sans doute utiles dans le futur, autant du point de vue technique que de la compréhension des phénomènes mathématiques en jeu.
Modèles de matrices généralisés
Actuellement, on ne sait appliquer la récurrence topologique en général qu’aux intégrales de matrices du type :
Notamment, cela suppose que la quantité en exposant ne contienne pas de produits de traces, et que les valeurs de propres de subissent toutes le même potentiel . Autrement dit, , outre les quantités absorbées dans les mesures , ne doit pas de facteurs , , … ni de . Dans le modèle de [EKPM10a], ces deux types de facteurs sont présents au début du calcul. Toutefois, ils disparaissent à la fin grâce aux relations entre paramètres de Kähler imposées par la condition de Calabi-Yau. Si l’on peut toujours imaginer d’autres géométries définies à partir de avec des paramètres de Kähler tous indépendants, les géométries de Calabi-Yau se distinguent par leur simplicité du point de vue du modèle de matrices.
| (VI-17) |
peut être considéré comme un modèle de matrice généralisé. Ce type d’intégrales et sa généralisation "à plusieurs matrices" se manifeste dans plusieurs problèmes intéressants. Nous les avons déjà rencontrées dans les modèles de boucles sur des surfaces aléatoires au Chapitre V (Éqn. V-16). On les retrouve souvent dans le contexte de la physique des hautes énergies. Voici quelques exemples :
La théorie de Chern-Simons sur les espaces de Seifert , qui est duale au modèle A sur . Ici, sont des entiers deux à deux premiers, et est un entier premier avec . La fonction de partition s’écrit [Mar05a] :
Dans le cas particulier des espaces lenticulaires , la courbe spectrale de ce modèle est connue [HY03].
La fonction de partition introduite par Nekrasov pour les théories de jauge superconformes [Nek04]. Dans le cadre des dualités entre théories de cordes et théories de jauge à , voire dimensionsR, cette fonction de Nekrasov réalise une déformation à deux paramètres de la somme sur les instantons du modèle A. En notant , Sułkowski [Suł10] la réécrit :
Pour décrire rapidement cette formule888Nous avons évité d’inclure des champs de Chern-Simons, qui conduisent à un poids qui dépendent explicitement de , ce qui complique encore l’analyse. : est un poids associé à des champs de matière dans la représentation fondamentale de , est associé à multiplets de masses vivant dans la représentation (anti)fondamentale de . Selon la dimensionR de la théorie de jauge :
Cela conduit à un modèle de matrice généralisé où les facteurs du déterminant de Vandermonde sont remplacés par une fonction plus compliquée , singulière lorsque . [Suł10] en a déterminé la courbe spectrale seulement dans la limite , où se réduit à un déterminant de Vandermonde.
La conjecture d’Alday-Gaiotto-Tachikawa [AGT10] énonce une relation entre ces théories de jauge et la théorie conforme de Liouville de charge centrale :
Elle est à l’origine d’une activité de recherche intense ces deux dernières années. Mentionnons seulement deux points. Du côté CFT, Bonelli et al. [BMTY10] ont proposé un modèle de matrice généralisé calculant les corrélateurs de la théorie de Liouville sur une surface de Riemann de genre à points marqués. Il fait intervenir, à la place du déterminant de Vandermonde, la forme primaire , i.e. une fonction thêta de genre qui s’annule à points coïncidants (Éqn. A.9). Dans le cas par exemple, , avec des points marqués :
Le nombre de valeurs propres et l’exposant sont liés aux paramètres de la théorie de Liouville :
et est la masse partielle placée au point . Les auteurs de [BMTY10] ont trouvé la courbe spectrale de ce modèle. Du côté théorie de jauge, ont été identifiés depuis longtemps [NS09] des systèmes intégrables où la projection ne vit pas sur mais sur une surface de Riemann de genre : on troque une matrice de Lax rationnelle en , pour une fonction méromorphe sur . Ce sont des exemples de systèmes de Hitchin. Il serait intéressant de développer l’analogue de la théorie du chapitre IV pour ces systèmes intégrables : est-elle ou non fondamentalement différente ?
Lorsque les méthodes ébauchées au § V.2.4 pour étudier les modèles de matrices généralisés via leurs équations de boucles auront été approfondies, j’espère qu’elles seront applicables à ces problèmes. L’enjeu est bien sûr de calculer toutes les corrections en , à partir de la courbe spectrale . On s’attend à ce que la réponse soit donnée par une récurrence topologique, et bénéficie de toutes ses propriétés.
Chapitre VII Conclusion
Toutes les conséquences des méthodes basées sur les équations de boucles, et leur solution via la récurrence topologique, n’ont pas été exploitées. Quand elles s’appliquent, ces techniques offrent un algorithme de calcul efficace et permettent d’établir des propriétés structurelles des quantités que l’on calcule. Les cartes aléatoires (avec ou sans boucles), les nombres de Hurwitz simples, le développement asymptotique des intégrales de matrices, et plus généralement des fonctions tau des systèmes intégrables, … rentrent dans ce cadre. Un grand chantier reste ouvert pour établir les relations conjecturées actuellement, avec les invariants de Gromov-Witten et la théorie topologique des cordes, les nombres de Hurwitz doubles, la fonction de partition de Nekrasov, les systèmes de Hitchin, les théories conformes couplées à la théorie de Liouville, … D’autres relations avec l’intégrabilité quantique ou la théorie des nœuds sont plus incertaines. La liste des applications potentielles n’est sans doute pas close.
J’ai l’intention de me concentrer sur trois problèmes principaux dans les mois qui viennent.
La résolution des équations de boucles des modèles de matrices généralisés. J’ai quelques idées pour une méthode générale de résolution, la partie difficile étant de résoudre l’équation maitresse. Cela aurait de nombreuses applications en théorie des nœuds (modèles de matrices venant des théories de Chern-Simons), en théorie topologique des cordes, en théorie de Liouville couplée à la CFT, … En physique statistique, cela conduirait probablement à de nouveaux types de points critiques, lorsque les coupures images ou/et les coupures fantômes se rejoignent de différentes manières. Ces points critiques sont pertinents par exemple dans les modèles de boucles sur réseau aléatoire.
Le développement asymptotique des modèles de matrices (généralisés), en particulier une justification rigoureuse de la série thêta (Éqn. III.3.2) à partir des méthodes d’équations de boucles. Une première étape pourrait consister à étudier les modèles intégrables, comme le modèle à deux matrices, ou les systèmes de Lax de taille .
La statistique des chemins dans le modèle . J’ai commencé à travailler avec Bertrand Eynard sur le processus aléatoire constitué par un chemin de longueur dans une carte aléatoire du modèle , par des méthodes purement combinatoires. Le seul préliminaire est le calcul des observables uniformes qui est complet d’après mon article [BE11]. Nous avons des résultats exacts sur le réseau aléatoire de taille finie. Cependant, prendre la limite continue est techniquement difficile. Nous espérons retrouver des caractéristiques d’un processus aléatoire invariant conforme (puisque l’on a moyenné en quelque sorte sur tous les réseaux possibles), i.e. d’un SLE. J’ai choisi de ne pas le présenter car ce travail n’est pas abouti. L’objectif est, à plus long terme, une compréhension fine des cartes aléatoires (décorées ou non) et des processus aléatoires qui vivent dessus, afin de justifier rigoureusement leur description en physique par des théories conformes.
Annexe A Géométrie complexe sur les surfaces de Riemann compactes
Quelques faits élémentaires sur les surfaces de Riemann, utilisés dans le cours du texte, sont rappelés sans démonstration dans cette annexe. Parmi les références remarquables, signalons : [FK07] pour l’aspect "géométrie différentielle" ; le livre de fonctions spéciales [GW89] pour l’aspect "fonctions elliptiques" ; le cours de Marco Bertola [Ber06], qui est agréable à lire et est un bon compromis entre détails mathématiques et aspects pratiques utilisés dans cette thèse.
A.1 Géométrie
Topologie
Les surfaces orientables à anses sont obtenues topologiquement par identification de côtés dans un -gone (Fig. A.1). Son groupe d’homologie est est isomorphe à : elle possède une base de cycles non contractibles. Ils peuvent être arrangés de sorte que :
| (A.1) |
Une base de cycles qui vérifie ces relations est dite symplectique. Les changements de base symplectique sont paramétrés par le groupe des matrices à coefficients entiers qui préservent l’Éqn. A.1, i.e. .
est un domaine fondamental de , i.e. un ouvert simplement connexe maximal.
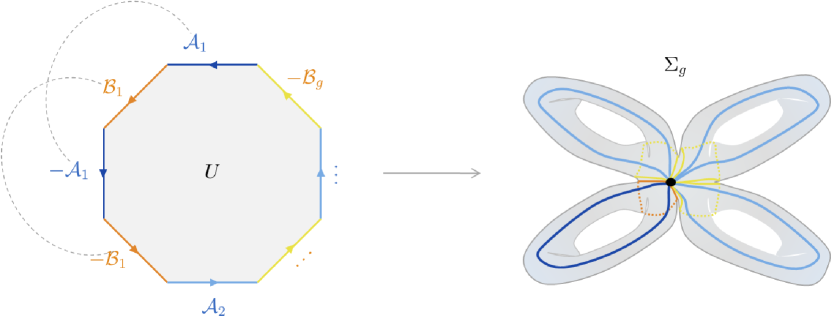
Formes différentielles
Si est une forme différentielle méromorphe non nulle sur , notons ses zéros et ses pôles comptés avec multiplicités. vérifie les deux relations fondamentales :
Si et sont deux formes différentielles, et n’a pas de résidus, elles vérifient l’identité bilinéaire de Riemann :
Il est possible d’en déduire que l’espace des formes holomorphes sur est engendré par les , donc est de dimensionC . Celles-ci forment une base duale à :
| (A.2) |
Les intégrales sur les -cycles définissent la matrice des périodes :
| (A.3) |
Une propriété fondamentale est que est une matrice symétrique, et est définie positive. Ceci est une conséquence de la compacité et l’orientabilité de .
Soit un point arbitraire. Les primitives des sont des fonctions holomorphes sur le domaine fondamental, mais ne sont pas univaluées sur au vu de l’Éqn. A.2 et A.3. On peut cependant définir l’application d’Abel :
est la jacobienne de . Lorsque , est un isomorphisme de surfaces de Riemann. Si , est un plongement mais ne peut plus être surjective pour des raisons de dimension. Toutefois, on a la propriété importante :
Theorème A.1.
Théorème d’inversion de Jacobi.
A.2 Fonction thêta
Définition générale
Dans cette annexe, nous choisissons d’appeler module, toute matrice à entrées complexes, symétrique et de partie imaginaire définie positive. Pour tout module de taille , la fonction thêta de Riemann est définie par :
C’est une fonction entière sur , périodique dans la direction , et qui prend une phase linéaire dans la direction :
| (A.4) |
Elle vérifie une équation de diffusion :
peut donc être vue comme un noyau de la chaleur sur l’espace avec certaines conditions de périodicité. En genre , s’annule uniquement à modulo . En genre , la situation est plus compliquée et sera décrite dans le paragraphe suivant. Il y a toujours des zéros évidents aux vecteurs demi-entiers tel que , que l’on appelle caractéristiques impaires.
Il est justifié à la partie I.9 que la dimensionC maximale d’une famille de surfaces de Riemann de genre , est . Or, un module de taille contient paramètres libres. Lorsque , , donc il existe toujours des modules qui ne sont pas des matrices de périodes d’une surface de Riemann.
Fonctions thêta issues d’une surface de Riemann
Lorsque est bien une matrice de périodes pour une surface de Riemann , la fonction possède d’autres propriétés. On omet d’écrire la dépendance en dans ce qui suit.
Zéros de Il existe un vecteur des constantes de Riemann , tel que, ssi il existe points tels que . Ce vecteur dépend du choix du point .
Identité de Fay La fonction thêta vérifie une propriété d’addition des arguments, appelée identité de Fay [Fay70]. Cette addition se fait naturellement dans la jacobienne : si , notons . Soit et une caractéristique impaire. Il y a plusieurs façons d’écrire l’identité de Fay, voici la forme qui nous sera utile :
où est la forme primaire définie un peu plus loin, à l’Éqn. A.9. Cette identité a de nombreuses conséquences, et est intimement liée à l’existence de systèmes intégrables basés sur (Chapitre IV). Elle est équivalente à l’équation de Hirota que vérifie la fonction tau de la famille des solutions algébro-géométriques (§ IV.4.1). Elle se généralise facilement :
Des limites à points coïncidants de l’Éqn. A.2 conduisent à des équations différentielles non linéaires venant d’une hiérarchie intégrable.
Fonctions analytiques sur
Une caractéristique impaire est dite non singulière si la fonction n’est pas identiquement nulle pour . Il existe des caractéristiques impaires non singulières, et l’on en choisit une. Soit une fonction méromorphe sur , qui admet des zéros en et des pôles en (comptés avec multiplicités). Il existe une constante telle que :
| (A.7) |
Les relations A.1 assurent que le membre de droite restent inchangé lorsque . On dit que les ratios de l’Éqn. A.7 sont bien équilibrés.
On appelle fonctions pseudoméromorphes des fonctions qui ne sont pas univaluées sur , mais prennent des phases lorsque l’on translate ou . Les ratios mal équilibrés de fonctions permettent de construire ce type de fonctions.
A.3 Formes méromorphes
On se fixe une caractéristique impaire non singulière .
Noyau de Bergman
Il existe un unique objet , qui est une forme différentielle en et , tel que :
La seule singularité de est un pôle double sans résidu à points coïncidants. I.e. dans toute coordonnée locale :
.
De plus, cet objet est symétrique en et : c’est un noyau de Bergman pour . Son intégrale sur les -cycles redonne les formes holomorphes :
Il se construit explicitement :
| (A.8) |
qui est indépendant du choix de .
Forme primaire
Lorsque est une caractéristique impaire non singulière, est une forme holomorphe qui a exactement zéros, qui sont doubles.
| (A.9) |
est un objet méromorphe sur le domaine fondamental de , qui se comporte comme l’inverse d’un spineur en et , et admet un zéro simple à points coïncidants. n’est pas défini de façon univalente sur , il prend une phase lorsque comme la fonction thêta. En fait, ne dépend pas de , et on l’appelle forme primaire. Elle vérifie , et :
| (A.10) | |||
Noyau de Cauchy
À cause de l’Éqn. A.1, une forme différentielle méromorphe ne peut admettre un unique pôle simple. On peut néanmoins construire une forme différentielle méromorphe sur , qui admet un pôle simple avec résidu en , et un pôle simple avec résidu en :
Comme corolaire de l’identité bilinéaire de Riemann, on trouve une formule de Cauchy pour représenter par des intégrales de contours n’importe quelle forme différentielle méromophe sur , dont on note les pôles :
Pôles multiples
Soit , et une coordonnée locale telle que . Si est une forme différentielle méromorphe avec un pôle de degré en , les coefficients dans le développement de Laurent :
dépendent du choix de .
Inversement, on peut chercher à construire des formes différentielles méromorphes telles que . Elles sont définies à l’ajout d’une forme holomorphe près. Si l’on impose à d’avoir des intégrales nulles sur les -cycles, il y a une unique solution, qui s’écrit :
Base de formes méromorphes
Soit une fonction méromorphe sur . Elle définit de façon canonique des coordonnées locales au voisinage de tout point , telles que :
-
Si a un pôle de degré en , on pose .
-
Si est régulière en , et d’ordre (i.e. a un zéro d’ordre en ), on pose .
Par conséquent, elle définit une base de formes méromorphes sur , et toute forme méromorphe sur se décompose de manière unique :
| (A.11) |
Les temps et les formes différentielles de la base sont toujours de la forme
où et sont des cycles généralisés, i.e. la donnée d’un contour dans et d’une fonction définie sur ce contour (Fig. A.2). Cette décomposition ne dépend pas du point car la somme des résidus de est nulle : .
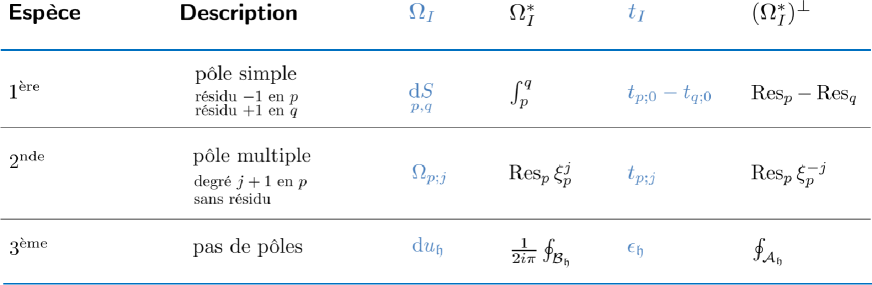
L’ensemble des fonctions méromorphes non nulles est un corps. La représentation d’une fonction méromorphe comme ratio de fonctions thêta (Éqn. A.7) souligne la structure de groupe, tandis que la représentation utilisant les primitives des (primitive de Éqn. A.11 appliquée à ) met en évidence la structure d’anneau. Cette dernière est pratique pour l’intégration ou la dérivation. En résumé, pour identifier une fonction ou une forme méromorphe, il suffit d’identifier ses pôles et zéros, ou son comportement aux pôles, et de reproduire cette structure grâce à des fonctions bien connues.
A.4 Transformations modulaires
Rassemblons les cycles dans des vecteurs colonnes, et les formes holomorphes dans des vecteurs lignes. On note , la transposée de . Les changements de base symplectique de cycles, aussi appelés transformations modulaires, s’écrivent :
Notons que l’inverse de s’écrit .
Cette transformation se répercute sur tous les objets introduits jusqu’à présent.
Les formes holomorphes .
La matrice des périodes .
Le noyau de Bergman , avec la matrice symétrique :
La fonction thêta devient [Mum84] :
est une phase dépendant seulement de , et les arguments et sont reliés par :
A.5 Surfaces de Riemann elliptiques
Les courbes spectrales de genre se rencontrent dans le modèle à une matrice dans un régime à deux coupures (partie III.3), ou comme outil intermédiaire pour le modèle trivalent (partie V.3). Lorsque , est en bijection conforme avec via l’application d’Abel. et est la base symplectique de cycles correspondante. Il n’y a qu’une seule caractéristique impaire, , et elle est non singulière.
Cette bijection rend la géométrie sur plus maniable. Les fonctions méromorphes sur sont les fonctions méromorphes sur qui sont et périodiques. Ces fonctions bipériodiques sont aussi appelées fonctions elliptiques, car la fonction qui intervient pour calculer l’abscisse curviligne sur une ellipse possède ce type de propriété. Une fonction elliptique sans pôles est bornée sur , donc constante : est la seule forme holomorphe à une constante multiplicative près, comme l’on s’y attend. Il y a plusieurs jeux de fonctions elliptiques spéciales, à partir desquelles toute fonction elliptique peut s’exprimer. Celui impliquant les fonctions de Jacobi , et ne sera pas présenté ici.
Les fonctions pseudoelliptiques du chapitre V sont des fonctions périodiques dans la direction , et qui prennent une phase dans la direction :
Fonction thêta
La fonction de Jacobi est une variante de la fonction thêta de Riemann. Pour :
est une fonction impaire de , en particulier elle s’annule en . Ses propriétés par translation sont :
On dispose également de la représentation en produit triple de Jacobi :
| (A.13) |
Les transformations modulaires agissent sur par homographies à coefficients entiers :
La règle de transformation de est assez simple, notamment pour :
| (A.14) |
Dans la limite , se réduit à une ou deux exponentielles qui dominent la série A.5. La limite s’en déduit grâce à la transformation modulaire A.14.
Si est une fonction méromorphe dont on connait les pôles et les zéros, on peut l’exprimer comme un ratio bien équilibré de fonctions . Les ratios mal équilibrés permettent de représenter les fonctions pseudoelliptiques du Chapitre V. Par exemple,
admet des zéros aux , des pôles aux , et :
Fonctions de Weierstraß
La fonction de Weierstraß est définie par :
C’est une fonction elliptique, paire, et qui possède un pôle double lorsque . Elle coïncide à une constante près avec le noyau de Bergman , d’intégrale nulle sur le cycle :
En comparant avec l’Éqn. A.8, on obtient une autre représentation de la fonction de Weierstraß :
| (A.15) |
On peut établir l’équation différentielle :
| (A.16) |
Les deux membres sont des fonctions elliptiques, il suffit de comparer leur comportement au voisinage de l’unique pôle pour démontrer l’Éqn. A.16. On identifie au passage les constantes :
admet exactement trois zéros modulo , qui sont situés aux points . Pour illustration, on peut aisément exprimer et comme ratio équilibré de fonctions thêta :
La base de formes méromorphes s’exprime en fonction de la base alternative :
constituée de et de ses dérivées.
La fonction de Weierstraß est définie par :
C’est une fonction telle que , elle possède un pôle simple avec résidu en . Elle est reliée naturellement au noyau de Cauchy :
Les intégrales de cycles de impliquent que n’est pas une fonction univaluée sur :
La fonction de Weierstraß est définie par :
Elle vérifie . L’Éqn. A.15 permet de la relier à la fonction thêta :
Ceci conduit à l’expression de comme produit triple de Jacobi (Éqn. A.13).
Annexe B Observables à bords non uniformes dans les modèles de boucles
Dans le cadre du modèle de boucles défini par la mesure :
nous allons calculer les observables admettant bords avec un nombre fini de mèches dans une configuration arbitraire. Lorsque le bord n’a pas de mèche, son périmètre est couplé à une seule variable . Lorsqu’il possède mèches, on les indexe en suivant l’ordre cyclique par , et l’on note leur couleur. La longueur de l’intervalle entre et est couplée à une variable . On note l’ensemble des bords, et l’ensemble des bords sans mèches.
L’observable en question est :
On peut aussi définir une observable connexe, et regrouper les topologies :
B.1 Observables non connexes
L’intégration sur les matrices est possible car, à matrice fixée, elles sont gaussiennes, avec pour matrice de covariance :
Par application du théorème de Wick :
La somme porte sur les appariements de mèches préservant la couleur . Pour fixer les idées, on dira que avec est un lien, et que est un système de liens. compte les cartes sur lesquelles sont tracés des chemins autoévitants qui réalisent le système de liens .
La mèche a des indices matriciels que l’on indique en écrivant . Lors de l’appariement entre et :
Les appariements successifs des matrices font apparaitre des cycles qui sont parcourus par un même indice matriciel :
Si l’on introduit , l’opération successeur , ces cycles sont les cycles disjoints de la permutation111 fait aussi l’affaire. . Il est commode d’ajouter de nouveaux cycles pour chaque variable vivant sur un bord sans mèche. À chaque variable de bord (entre deux mèches et , ou sur un bord sans mèche), on peut donc associer le cycle auquel appartient. Il faut ensuite sommer sur les indices indépendants, et intégrer sur les valeurs propres , avec la mesure induite (Éqn. V-16) :
| (B.2) |
Pour chaque lien de couleur , les mèches et appartiennent à des cycles notés et (qui sont peut-être identiques), et il existe dans un facteur de couplage entre et via le noyau (cf. Éqn. B.1). Ainsi :
avec la valeur moyenne pour la mesure de l’Éqn. B.2, et l’ensemble des variables de bord.
Ce résultat peut être réécrit en fonction du corrélateur non connexe , où est le nombre total de cycles. On rappelle que cette observable est holomorphe pour et admet une discontinuité sur le segment (Thm. V.1).
désigne l’ensemble des liens de , est l’ensemble des cycles de augmenté de l’ensemble des bords sans mèches. Cette formule a une interprétation graphique (Fig. B.1) : si l’on découpe le long des liens une carte où est réalisé le système de liens , on obtient une surface discrète avec bords’. Les variables vivent sur ces bords’. Ils sont constitués dans un ordre cyclique de l’arête portant , du lien , de l’arête portant , du lien , … Chaque lien est commun à deux bords (éventuellement identiques) indexés par , et contribue par un facteur à l’intégrand.
Nous avons donc réduit le calcul de à celui des observables uniformes.
B.2 Observables connexes …
De la même façon :
et énumère les cartes connexes de genre sur lesquelles le système de liens est réalisé. Si est fixé, les bords initiaux se regroupent en amas : on peut passer d’un bord à un bord en suivant uniquement les liens de , mais pas à un bord si .
…à un amas
Parfois, assure la connexion entre tous les bords, i.e. (cela suppose que tous les bords portent des mèches). Dans ce cas, la contrainte de connectivité n’en est pas une : . En identifiant la plus grande puissance de dans la formule B.1, on en déduit le genre minimal d’une carte sur laquelle peut être tracé :
| (B.4) |
C’est aussi le genre minimal d’une variété de dimension sur laquelle peut être tracé, puisque l’on peut toujours se ramener pour ce problème à des discrétisations (par exemple, des triangulations) de . Les systèmes de liens pour lesquels sont dits planaires, ce sont eux qui forment une base des algèbres de type Temperley-Lieb (Fig. V.6). Ils sont caractérisés par :
En genre minimal, se factorise en , ce qui simplfie un peu l’expression :
…à plusieurs amas
Lorsque , le calcul de est très similaire à celui de . La seule différence est qu’il faut maintenant imposer la connectivité entre les amas. Les cycles se regroupent aussi naturellement en amas, notés , avec la règle ssi un bord est représenté dans le cycle . Par conséquent :
avec le corrélateur -connexe, qui est par définition le cumulant des observables d’amas :
Il est remarquable que soit une fonction symétrique des variables qui vivent sur un même cycle .
Notons le système de liens restreint aux mèches de l’amas . Il peut être tracé sur une surface de genre minimal . Par convention, si est constitué d’un seul bord qui n’a pas de mèche. L’inspection des puissances de maximales apparaissant dans l’Eqn B.2 montre alors que :
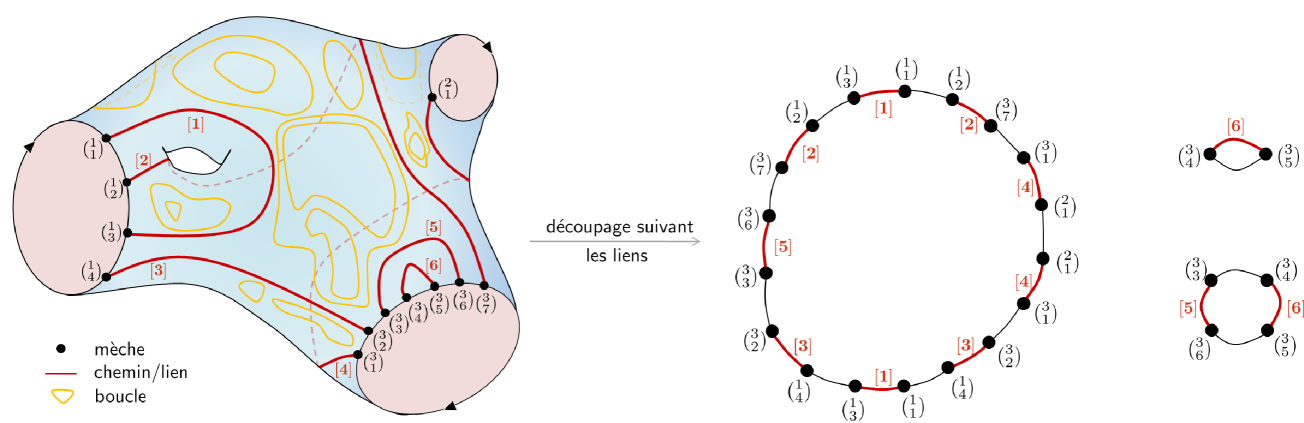
B.3 Exemples
Les expressions B.1 et B.2 peuvent être transformées en déplaçant les contours vers les pôles de l’intégrand, et éventuellement en utilisant les équations de Schwinger-Dyson (§ V.2.4). Illustrons-le sur quelques exemples simples : dans le modèle trivalent, i.e. indépendamment de , pour des observables à un seul bord, i.e. , et en genre minimal.
Un seul lien
![[Uncaptioned image]](/html/1110.1493/assets/x54.png)
Un seul bord’ Lorsque , apparie mèches de sorte que (cela impose à d’être pair). ne dépend pas d’un tel , car les variables jouent des rôles complètement symétriques :
Deux liens Pour , et l’on se trouve dans le cas précédent. Les deux autres possibilités et sont des systèmes de liens planaires, et admettent bords’. et se déduisent l’un de l’autre par permutation circulaire des variables (Fig. B.2).
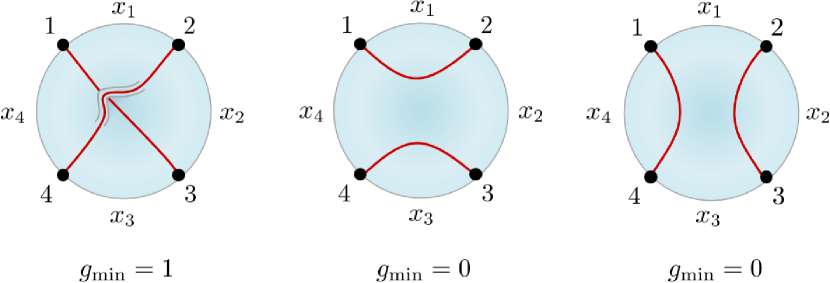
Les équations de Schwinger-Dyson permettent d’exprimer et en termes de quantités qui sont (éventuellement) discontinues sur seulement. Le résultat final s’écrit :
| (B.13) | |||||
B.4 Questions
Si l’on constate que l’on peut calculer explicitement les observables au cas par cas, la structure générale reste à établir. Par exemple, il existe une action naturelle des générateurs de l’algèbre de Temperley-Lieb à mèches sur le cylindre (Fig. V.6), sur le bord : elle transforme , par composition, en un système de liens . On aimerait décrire cette transformation au niveau de la représentation intégrale B.2. On remarque par ailleurs, en calculant les intégrales de contours dans le modèle trivalent, que est toujours la somme d’une observable "irréductible" qui dépend pleinement de tous les , et de termes de complexité inférieure. Sans donner une définition générale, on aimerait identifier comme parties irréductibles dans les exemples précédents :
tel que nous l’avons défini semble ne pas être la bonne base d’observable. Il faudrait donc trouver la bonne définition qui remplacerait l’Éqn. LABEL:eq:defss et sélectionnerait la partie irréductible de . Cela faciliterait l’identification de la structure algébrique des .
Il serait instructif de comparer avec les résultats connus pour la chaine à deux matrices hermitiennes. En effet, le modèle :
est dual au modèle trivalent sur triangulations aléatoires, en posant et . Dans les chaines à deux matrices hermitiennes, toutes les observables invariantes impliquant et ont été calculées par Eynard et Orantin [EO08b]. Ils ont trouvé notamment [EO05] que les observables planaires avec un bord non uniforme :
se décomposent sur les systèmes de liens planaires :
sont des fractions rationnelles des et , dont la construction ainsi que la structure algébrique est connue. Elles appartiennent au commutant d’une certaine famille de matrices de transfert de taille , dépendant de deux paramètres spectraux et :
est une série génératrice de cartes ayant la topologie d’un disque et dont les faces portent un modèle d’Ising222Autrement dit, une face générée par des matrices (resp. ) porte un (resp. ).. En revanche, la décomposition sur les systèmes de liens planaires est purement algébrique, l’interprétation combinatoire des termes pris isolément n’est pas connue. Dans le modèle , la situation est inversée : on connait l’interprétation combinatoire de , mais pas la structure algébrique du résultat. Cela appelle de nouveaux travaux pour éclairer les relations entre observables non uniformes dans le modèle , celles de la chaine à deux matrices, leur interprétation combinatoire, les propriétés d’intégrabilité quantique en relation avec les matrices de transfert , et l’algèbre de Temperley-Lieb. Le va-et-vient entre les deux modèles et l’implémentation de leur dualité au niveau des observables sera probablement source d’inspirations.
Par ailleurs, l’universalité de la formule B.2 est remarquable : elle est valable dans tous les modèles de boucles, seul le noyau dépend des détails du modèle. On peut se demander à quel point la structure algébrique que l’on aimerait trouver dépend du noyau , et si il n’y a pas déjà de nombreuses propriétés liées à Temperley-Lieb cachées dans les fractions rationnelles de l’intégrand dans l’Éqn. B.2.
Annexe C Index
Algèbre
de Brauer V.6
Algébro-géométrique IV.4.1
Amas B.2
Anomalie holomorphe VI.1.2
Appariements V.1.1, V.1.2, B.1
Application miroir VI.1.4, VI.2.2
Base
d’homologie de contours III.3
symplectique de cycle II.2.5, II.2.9
Bord dur, bord mou III.1.3, III.4.3
Casimir quadratique VI-6, VI-11
Corrélateurs I.14, IV.3.2, IV.4.1, IV.4.2, V.7, VI.10
Coupures III.1.3, III.3, III-41, V.1, V.3.2
Coupures images, coupures fantômes V-23, V.3.4
Courbe
hyperelliptique II.2.2, II.2.5, II-29, IV-32
miroir VI.1.4, VI.1.5, VI.2.2, VI.10
Courbe spectrale
de Kontsevich II-9, II.3.2, IV.3.4
de Painlevé I IV.3.4
Décomposition
polaire I.2
de Strebel I.8
Densité de valeurs propres I.3, I.2, III.1.2, III.4.1, III.4.2, III.4.3
Déterminant
de Vandermonde I.2, I.13, VI.3.1
Développement
asymptotique complet III.2.3, III.3,
topologique 6, II.4.1, III.2.4, IV-30
Diagramme torique VI.2, VI.2.1, VI.10
Dispersif (système intégrable) IV.4
Double limite d’échelle I.1, III.4.4
Énergie libre II.3.1, III.1, III.3, V.1.1, ‣ VI.1.2
Ensemble
de Laguerre LABEL:eq:SelL, III.4.4
Équation
de boucle maitresse LABEL:eq:VVVV1, II-27
de Hirota IV-1, IV-9, IV.1, IV.3,
de Korteweg-de Vries 12, IV.1.2
de Kadomtsev-Petviashvili IV.1.2
Équations
de boucles II.2.7, IV.3.2, V.2.4, VI.3.4
cut-and-join VI.3.4
de Schwinger-Dyson II.1, III.1.1, V.2.4,
Espace des modules des surfaces
de Riemann I.9, II.3.2, VI.1.2
Espaces
de Calabi-Yau VI.1.1, VI-2, VI.4
Exposants critiques I.6, V.2.1, V.3.4
Feuillet physique ‣ II.3.1, III.7, V.3.2
Flots IV.1.1, IV.2.1, IV.4.1, IV.4.2
Fonction
de Barnes I.13, III.4.2, III-53
de Hastings-McLeod III-38, III.4.4,
de partition I.2, III.3.1, IV.4.2, IV.4.2,
de partition de Nekrasov VI.4
Fonction
tau de Bergman III-45
thêta III-30, IV-33, V.3.2, VI.4, A.2
Fonctions
de Baker-Akhiezer IV.4.1
quasi périodiques III.3.2
Formes différentielles holomorphes II.2.9, A.1
Formes différentielles méromorphes II.2.9, IV.4.1, A.1, A.3
Formule
exponentielle IV.4.2
de dilatation II-13
de Karlin-McGregor I.8
KPZ V.2.1
de Mariño-Vafa VI.2.1
de Riemann-Hurwitz VI.2.4
variationnelle de Rauch II-15, II.2.9
Formules déterminantales 2, IV.3.2, IV.6, IV.4.2
Fractions de remplissage ‣ II.3.1, III.3.1, IV.4.1, IV.4.2
Géométrie spéciale II.2.9, IV-44, VI.1
Grandes déviations III.5, III.4.3
Hiérarchie
de Whitham IV.4.2
Identité
bilinéaire de Riemann A.1
Intégrales
convergentes I.13
de Hodge VI.2.1, VI.2.3, VI.3.4
de Selberg I.13, III.4.2, III.4.4
Interprétation combinatoire II.1, V.3.1, VI.3.4
Invariants
de Donaldson-Thomas VI.1.2, VI.2.2
de Gromov-Witten 13, VI.1.2, VI.2.2
Invariants symplectiques II.2.6, VI.2.2
Involution locale II.2.1, V.3.3
Isomonodromique IV.2, IV-15, IV.4.1
Isospectral IV.4.1
Lemme "une coupure" V.2.4
Limite
des grandes cartes V.3.4
singulière de courbes spectrales
Lois de Tracy-Widom III.4.2, III.4.4, IV.1, IV.3.4
Marches aléatoires I.8
Matrice des périodes II.2.5, II.2.9, IV.4.2, A.3, A.2
Matrices
de transfert B.4
de Wigner I.1
Mesure empirique III.1.2
Modèle
I-32, II.4.2, III-26, V.2.1, V.3
à poids multiplicatifs V.1.2
Modèles minimaux I.8, IV.1.2, 3
Modèles de matrice
à une matrice hermitienne I.2,
à une matrice version I-25, II-2,
II-44, III.1.1, III.4.2, III.4.4
à une matrice avec champ
extérieur I.13, II.1.2, II-33, 7
généralisé I-32, II.4.2, III.2.5, V-12, VI.4
chaine de matrices LABEL:sec:chain, II.3.1, III.1,
Nombres
de Hurwitz simples VI.2.4
de Hurwitz doubles VI-6
d’intersections I-21, II.3.2, IV.3.4, VI.3.4
Noyau
de Bergman ‣ II.2.1, II.2.9, IV.2
pseudo noyau de Bergman V.3.3
spinoriel intégrable IV.4.1, IV-44
intégrable I.2, IV.2.1, IV-35, IV.4.2
Observables
Opérateur d’insertion LABEL:eq:Wnconnexe, II.2.9, IV-6, IV.3.3, IV.4.1
Osculation I.6
Paramétrage de Joukovski III-41
Paramètres de Kähler VI-2, VI.1.4, VI.4
Partitions I.8, VI.2.1, VI.2.4, VI.3.1, VI.4
Point
de branchement II.2.1, 2, VI.9
de ramification II.2.1, VI.2.4
Points critiques I-11, IV.1.2, V.2.1, V.2.3
Polynômes
de Gelfand-Dikii IV.2.2, IV.2.3
(bi)orthogonaux I.2, I.7, III.1,
Potentiel chimique II.2.5
Prépotentiel II.2.5, III.1.2, III-43, V.3.2
Problème
linéaire IV.2.1, IV-7, IV.4.1, IV.4.2
de Riemann-Hilbert scalaire II.2.7,
de Riemann-Hilbert matriciel III.1,
Quadrangulations V-11
Rayon de convergence V.1.3, V.2.3, V.2.4
Relation
de dispersion IV-26
d’échelle KPZ V.3.4
Résolution d’une courbe spectrale II.2.8, III-48, V.3.4, VI.1.5
Secteur fermé/ouvert VI.1.2
Symétrie
classes de symétrie I.2
Système
de Hitchin VI.4
de Lax IV.2.1
Transformations
d’équivalence faible II.2.1
de Schlesinger IV.1
symplectiques II.2.6, IV.3.4, VI.4, VI.1
Topologie
des surfaces de Riemann A.1
stable/instable II.2.5
regroupement par topologie V.1.2
Théorème
central limite III.2.2
d’inversion de Jacobi IV-36, A.1
de la limite forte de Szegö III-43
de Wick I-6, V.1.1, V.1.2, V.2.3, B.1
Théorie
des champs perturbative I.5, V.1.1
conforme II.4.2, V.5, V.3.4, VI.4
des cordes de type A VI.1.2
des cordes de type B VI.1.2
des cordes topologiques VI.1.2
de Galois ‣ II.4.2
de Liouville V.2.1, V.3.4, VI.4
Universalité locale I.3
Variété
de Frobenius IV.1
Annexe D Liste d’articles
Publiés dans une revue à comité de lecture
[BEMS10] A matrix model for simple Hurwitz numbers, and topological recursion
G. Borot, B. Eynard, M. Mulase, B. Safnuk
Journal of Geometry and Physics, Volume 61, Issue 2
Février 2011, pages 522-540, math-ph/0906.1206
Erratum p526.
De plus, la formule correcte pour le Casimir quadratique est
[BE11] Enumeration of maps with self avoiding loops and the model on random lattices of all topologies
G. Borot, B. Eynard
Journal of Statistical Mechanics, Theory and Experiment
math-ph/0910.5896
Soumis dans une revue à comité de lecture
[BEMN10] Large deviations of the maximal eigenvalue of random matrices
G. Borot, B. Eynard, C. Nadal, S. Majumdar
Journal of Statistical Physics
math-ph/1009.1945
[BE10b] Tracy-Widom GUE law and symplectic invariants
G. Borot, B. Eynard
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, P01010
nlin.SI/1011.1418
Prépublication
[BG11] Asymptotic expansion of matrix models in the one-cut regime
G. Borot, A. Guionnet
math.PR/1107.1167
Références
- [ACM92] J. Ambjørn, L.O. Chekhov, and Yu. Makeenko, Higher genus correlators from the hermitian one-matrix model, Phys. Lett. B 282 (1992), 341–348, hep-th/9203009.
- [AFvM10] M. Adler, P.L. Ferrari, and P. van Moerbeke, Non-intersecting random walks in the neighborhood of a symmetric tacnode, math-ph/1007.1163.
- [AGT10] L.F. Alday, D. Gaiotto, and Y. Tachikawa, Liouville correlation functions from four-dimensional gauge theories, Lett. Math. Phys. 91 (2010), 167–197, hep-th/0906.3219.
- [Ake07] G. Akemann, Matrix models and QCD with chemical potential, Int. J. Mod. Phys. A 22 (2007), 1077–1122, hep-th/0701175.
- [Akh61] N.I. Akhiezer, Continuous analogues of the polynomials orthogonal on the system of intervals, Dokl. Akad. Nauk SSSR 141 (1961), 263–266.
- [AKMV05] M. Aganagic, A. Klemm, M. Mariño, and C. Vafa, The topological vertex, Commun. Math. Phys. 254 (2005), 425–478, hep-th/0305132.
- [AKNS74] M. Ablowitz, D. Kaup, A.C. Newell, and H. Segur, The inverse scattering transform-fourier analysis for nonlinear problems, Stud. Appl. Math. 53 (1974), no. 4, 249–315.
- [AM90] J. Ambjørn and Yu. Makeenko, Properties of loop equations for the hermitian matrix model and for two-dimensional gravity, Mod. Phys. Lett. A 5 (1990), 1753–1763.
- [BBd08] J. Baik, R. Buckingham, and J. diFranco, Asymptotics of Tracy-Widom distributions and the total integral of a Painlevé II function, Commun. Math. Phys. 280 (2008), no. 2, 463–497, math.FA/0704.3636.
- [BBT02] O. Babelon, D. Bernard, and M. Talon, Introduction to classical integrable systems, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- [BC90] E.A. Bender and R. Canfield, The number of rooted maps on an orientable surface, J. Comb. Theo. B 53 (1990), no. 2, 293–299.
- [BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa, Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes, Commun. Math. Phys. 165 (1994), 311–428, hep-th/9309140.
- [BD02] A. Borodin and P. Deift, Fredholm determinants, Jimbo-Miwa-Ueno tau-functions, and representation theory, Comm. Pure Appl. Math. 55 (2002), no. 9, 1160–1230, math-ph/0111007.
- [BE99] G. Bonnet and B. Eynard, The Potts-q random matrix model: loop equations, critical exponents, and rational case, Phys. Lett. B 463 (1999), 273–279, hep-th/9906130 .
- [BE03] P. Bleher and B. Eynard, Double scaling limit in random matrix models and a nonlinear hierarchy of differential equations, J. Phys. A 36 (2003), 3085–3106, hep-th/0209087.
- [BE09] M. Bergère and B. Eynard, Determinantal formulae and loop equations, math-ph/0901.3273.
- [BE10a] G. Borot and B. Eynard, The asymptotic expansion of Tracy-Widom GUE law and symplectic invariants, nlin.SI/1012.2752.
- [BE10b] , Tracy-Widom GUE law and symplectic invariants, nlin.SI/1011.1418.
- [BE11] , Enumeration of maps with self avoiding loops and the model on random lattices of all topologies, J. Stat. Mech. (2011), no. P01010, math-ph/0910.5896.
- [Bej05] A.Iu. Bejan, Largest eigenvalues and sample covariance matrices. Tracy-Widom and Painlevé II: computational aspects and realization in S-plus with applications, 2005, http://www.cl.cam.ac.uk/~aib29/TWinSplus.pdf.
- [BEMN10] G. Borot, B. Eynard, S.N. Majumdar, and C. Nadal, Large deviations of the maximal eigenvalue of random matrices, math-ph/1009.1945.
- [BEMS10] G. Borot, B. Eynard, M. Mulase, and B. Safnuk, A matrix model for simple Hurwitz numbers, and topological recursion, J. Geom. Phys. 61 (2010), no. 26, 522–540, math-ph/0906.1206.
- [Ber58] C. Berge, Théorie des graphes et ses applications, Dunod, Paris, 1958.
- [Ber06] M. Bertola, Riemann surfaces and theta functions, Course at Concordia University, http://www.mathstat.concordia.ca/faculty/bertola/.
- [Ber07] , Boutroux curves with external field: equilibrium measures without a minimization problem, nlin.SI/0705.3062.
- [BG10] J. Bouttier and E. Guitter, Planar maps and continued fractions, math.CO/1007.0419.
- [BG11] G. Borot and A. Guionnet, Asymptotic expansion of matrix models in the one-cut regime, en préparation.
- [BGS84] O. Bohigas, M.J. Giannoni, and C. Schmit, Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws, Phys. Rev. Lett. 52 (1984), 1–4.
- [BIPZ78] É. Brézin, C. Itzykson, G. Parisi, and J.-B. Zuber, Planar diagrams, Commun. Math. Phys. 59 (1978), 35–51, http://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103901558.
- [BKMP09] V. Bouchard, A. Klemm, M. Mariño, and S. Pasquetti, Remodeling the B-model, Commun. Math. Phys. 287 (2009), 117–178, hep-th/0709.1453.
- [BL01] D. Bernard and A. LeClair, A classification of non-hermitian random matrices, Statistical field theories (A. Cappelli and G. Mussardo, eds.), Nato Science Series II, vol. 73, École d’été des Houches, Juin 2001, cond-mat/0110649v1.
- [BM07] V. Bouchard and M. Mariño, Hurwitz numbers, matrix models and enumerative geometry, From Hodge Theory to Integrability and tQFT: tt*-geometry (R. Donagi and K. Wendland, eds.), Proc. Symp. Pure Math., AMS, 2007, math.AG/0709.1458.
- [BM09a] M. Bertola and O. Marchal, The partition function of the two-matrix model as an isomonodromic tau-function, J. Math. Phys. 50 (2009), math-ph/0809.3367.
- [BM09b] M. Bertola and M.Y. Mo, Commuting difference operators, spinor bundles and the asymptotics of orthogonal polynomials with respect to varying complex weights, Adv. Math. 220 (2009), no. 1, 154–218, math-ph/0605043.
- [BMTY10] G. Bonelli, K. Maruyoshi, A. Tanzini, and F. Yagi, Generalized matrix models and AGT correspondance at all genera, hep-th/1011.5417.
- [Bou10] J.-E. Bourgine, Modèles de matrices et problèmes de bord dans la gravité de Liouville, Thèse de doctorat, Université d’Orsay-Paris Sud (2010), http://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00541162/.
- [Bri11] A. Brini, Open topological strings and integrable hierarchies: Remodeling the A-model, hep-th/1102.0281.
- [BS93] P. Bouwknegt and K. Schoutens, -symmetry in conformal field theory, Phys.Rept. 223 (1993), 183–276, hep-th/9210010.
- [Büc66] H.F. Bückner, On a class of singular integral equation, J. Math. Anal. App. 14 (1966), 392–426.
- [BV10] A. Bloemendal and B. Virág, Limits of spiked random matrices I, math.PR/1011.1877.
- [CE06] L.O. Chekhov and B. Eynard, Matrix eigenvalue model: Feynman graph technique for all genera, JHEP (2006), no. 0612:026, math-ph/0604014.
- [CEM09] L.O. Chekhov, B. Eynard, and O. Marchal, Topological expansion of the Bethe ansatz, and quantum algebraic geometry, math-ph/0911.1664.
- [CEM10] , Topological expansion of beta-ensemble model and quantum algebraic geometry in the sectorwise approach, math-ph/1009.6007.
- [CEO06] L.O. Chekhov, B. Eynard, and N. Orantin, Free energy topological expansion for the 2-matrix model, JHEP (2006), no. 0612:053, math-ph/0603003.
- [Cha09] G. Chapuy, Combinatoire bijective des cartes de genre supérieur, Thèse de doctorat, École Polytechnique (2009), http://tel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005289/.
- [Che10] L. Chekhov, Logarithmic potential beta-ensembles and Feynman graphs, math-ph/1009.5940.
- [CK99] D.A. Cox and S. Katz, Mirror symmetry and algebraic geometry, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 68, American Mathematical Society, Providence, RI, 1999.
- [Clo09] C. Closset, Toric geometry and local Calabi-Yau varieties: an introduction to toric geometry (for physicists), hep-th/0901.3695.
- [CM10] M. Cafasso and O. Marchal, Double scaling limits of random matrices and minimal models: the merging of two cuts in a degenerate case, math-ph/1002.3347.
- [CS09] S. Caracciolo and A. Sportiello, Spanning forests on random planar lattices, J. Stat. Phys. 135 (2009), 1063–1104, hep-th/0903.4432.
- [CS10] L. Cantini and A. Sportiello, Proof of the Razumov-Stroganov conjecture, math.CO/1003.3376.
- [dB91] J. de Boer, Multi-matrix models and the KP hierarchy, Nucl. Phys B 366 (1991), 602–628.
- [DE02] I. Dumitriu and A. Edelman, Matrix models for beta ensembles, J. Math. Phys. 43 (2002), no. 11, 5830–5847, math-ph/0206043.
- [Dei98] P. Deift, Orthogonal polynomials and random matrices : a Riemann-Hilbert approach, AMS, New York, 1998, Courant Institute of Mathematical Sciences.
- [dFGZJ94] P. di Francesco, P. Ginsparg, and J. Zinn-Justin, gravity and random matrices, Phys. Rep. 254 (1994), no. 1, hep-th/9306153v2.
- [dFMS99] P. di Francesco, P. Mathieu, and D. Sénéchal, Conformal field theory, corrected ed., ch. The model, pp. 229–231, Springer, Berlin, 1999.
- [DG07] P. Deift and D. Gioev, Universality at the edge of the spectrum for unitary, orthogonal and symplectic ensembles of random matrices, Comm. Pure Appl. Math. 60 (2007), no. 6, 867–910, math-ph/0507023.
- [DIK08] P. Deift, A. Its, and I. Krasovsky, Asymptotics of the Airy-kernel determinant, Commun. Math. Phys. 278 (2008), no. 3, 643–678, math.FA/0609451.
- [DK88] B. Duplantier and I.K. Kostov, Conformal spectra of polymers on a random surface, Phys. Lett. Rev. 61 (1988), no. 13.
- [DKM+97] P. Deift, T. Kriecherbauer, K.T.-R. McLaughlin, S. Venakides, and X. Zhou, Asymptotics for polynomials orthogonal with respect to varying exponential weights, Int. Math. Res. Notices 16 (1997), 759–782.
- [DKM+99a] , Strong asymptotics of orthogonal polynomials with respect to exponential weights via Riemann-Hilbert techniques, Comm. Pure Appl. Math. 52 (1999), no. 12, 1491–1552.
- [DKM+99b] , Uniform asymptotics for polynomials orthogonal with respect to varying exponential weights and applications to universality questions in random matrix theory, Comm. Pure Appl. Math. 52 (1999), no. 11, 1335–1425.
- [DKZ10] S. Delvaux, A. Kuijlaars, and L. Zhang, Critical behavior of non-intersecting Brownian motions at a tacnode, math.PR/1009.2457.
- [DM06] D.S. Dean and S.N. Majumdar, Large deviations of extreme eigenvalues of random matrices, Phys. Rev. Lett. 97 (2006), 160–201, cond-mat/0609651.
- [dMPS95] A. Boutet de Monvel, L. Pastur, and M. Shcherbina, On the statistical mechanics approach in the random matrix theory. Integrated density of states, J. Stat. Phys. 79 (1995), no. 3-4.
- [Dub96] B. Dubrovin, Geometry of topological field theories, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1620, pp. 120–348, Springer, Berlin, 1996, hep-th/9407018.
- [Dub10] J. Dubail, Conditions aux bords dans des théories conformes non unitaires, Thèse de doctorat, Université d’Orsay-Paris Sud (2010), http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/56/24/PDF/pres.pdf.
- [DV11] L. Dumaz and B. Virág, The right tail exponent of the Tracy-Widom-beta distribution, math.PR/1102.4818.
- [Dys62] F. Dyson, Statistical theory of the energy levels of complex systems, J. Math. Phys. 3 (1962), 140.
- [EK95] B. Eynard and C. Kristjansen, Exact solution of the model on a random lattice, Nucl. Phys. B 455 (1995), 577–618, hep-th/9506193 .
- [EK96] , More on the exact solution of the model on a random lattice and an investigation of the case , Nucl. Phys. B 466 (1996), 463–487, hep-th/9512052 .
- [EKK04] B. Eynard, A. Kokotov, and D. Korotkin, Genus one contribution to free energy in hermitian two-matrix model, Nucl. Phys. B 694 (2004), 443–472, hep-th/0403072.
- [EKPM10a] B. Eynard, A.-K. Kashani-Poor, and O. Marchal, A matrix model for the topological string I: deriving the matrix model, hep-th/1003.1737.
- [EKPM10b] , A matrix model for the topological string II: the spectral curve and mirror geometry, hep-th/1007.2194.
- [ELSV01] T. Ekedahl, S. Lando, M. Shapiro, and A. Vainshtein, Hurwitz numbers and intersections on moduli spaces of curves, Invent. Math. 146 (2001), 297–327, math.AG/0004096.
- [EM09] B. Eynard and O. Marchal, Topological expansion of the Bethe ansatz, and non-commutative algebraic geometry, JHEP (2009), no. 0903:094, math-ph/0809.3367.
- [EMO07] B. Eynard, M. Mariño, and N. Orantin, Holomorphic anomaly and matrix models, JHEP (2007), no. 0706:058, hep-th/0702110.
- [EMS09] B. Eynard, M. Mulase, and B. Safnuk, The Laplace transform of the cut-and-join equation and the Bouchard-Mariño conjecture on Hurwitz numbers, math.AG/0907.5224.
- [EO05] B. Eynard and N. Orantin, Mixed correlation functions in the -matrix model, and the Bethe ansatz, JHEP (2005), no. 0508:028, hep-th/0504029.
- [EO07a] , Invariants of algebraic curves and topological expansion, math-ph/0702045.
- [EO07b] , Topological expansion of mixed correlations in the hermitian matrix model and symmetry of the invariants, math-ph/0705.0958.
- [EO07c] , Weil-Petersson volume of moduli spaces, Mirzakhani’s recursion and matrix models, math-ph/0705.3600.
- [EO08a] , Algebraic methods in random matrices and enumerative geometry, math-ph/0811.3531.
- [EO08b] , Topological expansion and boundary conditions, JHEP (2008), no. 0806:037, hep-th/0710.0223.
- [EO09] , Geometrical interpretation of the topological recursion, and integrable string theories, math-ph/0911.5096.
- [Eyn95] B. Eynard, Gravitation quantique bidimensionnelle et matrices aléatoires, Thèse de doctorat, Université Paris VI (1995).
- [Eyn04] , All genus correlation functions for the hermitian -matrix model, JHEP (2004), no. 0411:031, hep-th/0407261.
- [Eyn07] , Recursion between Mumford volumes of moduli spaces, a paraître dans Ann. IHP (2011), math.AG/0706.4403.
- [Eyn08] , All orders asymptotic expansion of large partitions, J. Stat. Mech (2008), no. P07023, math-ph/0804.0381.
- [Eyn09] , Large expansion of convergent matrix integrals, holomorphic anomalies, and background independence, JHEP (2009), no. 0903:003, math-ph/0802.1788.
- [Eyn11] , Counting surfaces, 2011, en préparation, http://eynard.bertrand.voila.net/TOCbook.htm.
- [EZJ92] B. Eynard and J. Zinn-Justin, The model on a random surface: critical points and large order behavior, Nucl. Phys. B 386 (1992), 558–591, hep-th/9204082 .
- [Fay70] J. Fay, Theta functions on Riemann surfaces, Lecture Notes in Mathematics, vol. 352, Springer, Berlin, 1970.
- [FIK92] A.S. Fokas, A. Its, and A. Kitaev, The isomonodromy approach to matrix models in quantum gravity, Commun. Math. Phys. 147 (1992), 395–430.
- [FIKN06] A. Fokas, A. Its, A. Kapaev, and V. Novokshenov, Painlevé transcendents: the Riemann-hilbert approach, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 128, American Mathematical Society, 2006.
- [FK07] H. Farkas and I. Kra, Riemann surfaces, second ed., Graduate Texts in Mathematics, Springer, Berlin, 2007.
- [FN80] H. Flaschka and A.C. Newell, Monodromy- and spectrum-preserving deformations, I, Commun. Math. Phys. 76 (1980), no. 1, 65–116, http://projecteuclid.org/euclid.cmp/1103908189.
- [For10] P.J. Forrester, Log-gases and random matrices, Princeton University Press, 2010.
- [FS09] P. Flajolet and R. Sedgewick, Analytic combinatorics, Cambridge University Press, 2009, http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/books.html.
- [FW08] P.J. Forrester and S.O. Warnaar, The importance of the Selberg integral, Bull. Amer. Math. Soc. 45 (2008), 489–534, math.CA/0710.3981.
- [GJ97] I.P. Goulden and D.M. Jackson, Transitive factorisations into transpositions and holomorphic mappings on the sphere, Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997), 51–60, math.CO/9903094.
- [GM90] D. Gross and A. Migdal, A nonperturbative treatment of two-dimensional gravity, Nucl. Phys. B 340 (1990), 333–365.
- [GMGW98] T. Guhr, A. Müller-Groeling, and H. A. Weidemüller, Random matrix theories in quantum physics: common concepts, Phys. Rep. 299 (1998), 189–425, cond-mat/9707301v1.
- [GW89] D.R. Guo and Z.X. Wang, Special functions, World Scientific, Singapore, 1989.
- [Har14] G.H. Hardy, Sur les zéros de la fonction de Riemann, C.R. Acad. Sci. Paris 158 (1914), 1012–1014, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3111d.image.f1014.langEN.
- [HC57] Harish-Chandra, Differential operators on a semi-simple Lie algebra, J. Amer. Math. 79 (1957), 87–120.
- [HM80] S.P. Hastings and J.B. McLeod, A boundary value problem associated with the second Painlevé transcendent and the Korteweg-de Vries equation, Archive for Rational Mechanics and Analysis 73 (1980), no. 1, 31–51, http://adsabs.harvard.edu/abs/1980ArRMA..73…31H.
- [Hur91] A. Hurwitz, Über Riemann’sche Flächen mit gegebenen Verzweigungspunkten, Math. Ann. 39 (1891), 1–60.
- [Hur02] , Über die Anzahl der Riemannschen Flächen mit gegebenen Verzweigungspunkten, Math. Ann. 55 (1902), 53–66.
- [HV00] K. Hori and C. Vafa, Mirror geometry, hep-th/0002222.
- [HY03] N. Halmagyi and V. Yasnov, The spectral curve of the lens space matrix model, hep-th/0311117.
- [HZ86] J. Harer and D. Zagier, The Euler characteristics of the moduli space of curves, Invent. Math. 85 (1986), 457–485.
- [IZ80] C. Itzykson and J.-B. Zuber, The planar approximation II, J. Math. Phys. 21 (1980), 411–421.
- [JMU81] M. Jimbo, T. Miwa, and K. Ueno, Monodromy preserving deformation of linear ordinary differential equations with rational coefficients: I. General theory and -function, Physica D 2 (1981), no. 2, 306–352.
- [Joh98] K. Johansson, On fluctuations of eigenvalues of random hermitian matrices, Duke Math. J. (1998).
- [JS08] J.L. Jacobsen and H. Saleur, Conformal boundary loop models, Nucl. Phys. B 88 (2008), 137–166, math-ph/0611078.
- [Kaz86] V. Kazakov, Ising model on a dynamical planar random lattice: exact solution, Phys. Lett. A 119 (1986), 140–144.
- [KdV95] D. Korteweg and G. de Vries, On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal, and on a new type of long stationary waves, Philosophical Magazine 39 (1895), 422–443.
- [KM59] S. Karlin and J. McGregor, Coincidence probabilities, Pacific J. Math. 9 (1959), no. 4, 1141–1164.
- [KO10] I.K. Kostov and N. Orantin, CFT and topological recursion, math-ph/1006.2028.
- [Kon92] M. Kontsevich, Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function, Commun. Math. Phys. 147 (1992), 1–23, http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.cmp/1104250524.
- [Kon94] , Homological algebra of mirror symmetry, alg-geom/9411018v1.
- [Kos89] I.K. Kostov, vector model on a planar random lattice: spectrum of anomalous dimensions, Mod. Phys. Lett. A 4 (1989), 217.
- [Kos99] , Conformal field theory techniques in random matrix models, hep-th/9907060.
- [Kos00] , Exact solution of the six-vertex model on a random lattice, Nucl.Phys. B 575 (2000), 513–534, hep-th/9911023.
- [Kos07] , Boundary loop models and quantum gravity, J. Stat. Mech. (2007), no. P08023, hep-th/0703221.
- [KP70] B. Kadomtsev and V. Petviashvili, On the stability of solitary waves in weakly dispersive media, Soviet Phys. Dokl. 15 (1970), 539–541, https://ceprofs.civil.tamu.edu/jkaihatu/teaching/ocen675/KP1970.pdf.
- [KPZ88] V.G. Knizhnik, A.M. Polyakov, and A.B. Zamolodchikov, Fractal structure of quantum gravity, Mod. Phys. Lett. A 3 (1988), 819–826.
- [Kri77] I. Krichever, Methods of algebraic geometry in the theory of non linear equations, Russ. Math. Surv. 32 (1977), 185–213.
- [Kri94] I. Krichever, The Tau function of the universal Whitham hierarchy, matrix models and topological field theories, Comm. Pure Appl. Math. 47 (1994), no. 4, 437–475, hep-th/9205110.
- [KS92] I.K. Kostov and M. Staudacher, Multicritical phases of the model on a random lattice, Nucl. Phys. B 384 (1992), 459–483, hep-th/9203030.
- [KS99] N. Katz and P. Sarnak, Zeroes of zeta functions and symmetry, Bull. Amer. Math. Soc. 36 (1999), 1–26, http://www.ams.org/journals/bull/1999-36-01/S0273-0979-99-00766-1/home.html.
- [KS00] J. Keating and N. Snaith, Random matrix theory and , Commun. Math. Phys. 214 (2000), 57–89.
- [Lau83] R.B. Laughlin, Anomalous quantum hall effect : an incompressible quantum fluid with fractionally charged excitations, Phys. Rev. Lett. 50 (1983), no. 18.
- [Liu06] M.C.-C. Liu, Formulae of one-partition and two-partition Hodge integrals, Geom. Topol. Monogr. 8 (2006), 105–128.
- [LLLZ09] J. Li, M.C.-C. Liu, K. Liu, and J. Zhou, A mathematical theory of the topological vertex, Geom. Topol. 13 (2009), 527–621, math.AG/0408426.
- [LLZ04] M.C.-C. Liu, K. Liu, and J. Zhou, A proof of a conjecture of Mariño-Vafa on Hodge integrals, J. Diff. Geom. 65 (2004), 289–340, math.AG/0306434.
- [LT98] J. Li and G. Tian, Virtual moduli cycles and Gromov-Witten invariants of general symplectic manifolds, J. Am. Math. Soc. 11 (1998), no. 1, 119–174, math.AG/9608032.
- [LX09a] K. Liu and H. Xu, Mirzakharni’s recursion formula is equivalent to the Witten-Kontsevich theorem, Astérisque 328 (2009), 223–235, math.AG/0705.2086.
- [LX09b] K. Liu and H. Xu, Recursion formulae of higher Weil-Petersson volumes, IMRN (2009), no. 5, 835–859, math.AG/0708.0565v2.
- [Mal83] B. Malgrange, Sur les déformations isomonodromiques. i. singularités régulières, Progr. Math., vol. 37, pp. 401–426, Birkhäuser, Boston, 1983.
- [Mar05a] M. Mariño, Chern-Simons theory, matrix integrals, and perturbative three-manifold invariants, Commun. Math. Phys. 253 (2005), 25–49, hep-th/0207096.
- [Mar05b] , Lectures on the topological vertex, Enumerative invariants in algebraic geometry and string theory (K. Behrend and M. Manetti, eds.), Lecture Notes in Mathematics, vol. 1947, Cetraro, Italie, Juin 2005.
- [Mar10] O. Marchal, Aspects géométriques et intégrables des modèles de matrices aléatoires, Thèse de doctorat, Université de Montréal et Université Paris VII, math-ph/1012.4513.
- [Mat08] V.B. Matveev, years of finite-gap integration theory, Phil. Trans. R. Soc. A 366 (2008), 837–875, http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/366/1867/837.abstract.
- [Meh60] M.L. Mehta, On the statistical properties of the level-spacings in nuclear spectra, Nucl. Phys. 18 (1960), 395–419.
- [Meh04] , Random matrices, 3 ed., Pure and Applied Mathematics, vol. 142, Elsevier/Academic, Amsterdam, 2004.
- [MG60] M.L Mehta and M. Gaudin, On the density of eigenvalues of a random matrix, Nucl. Phys. 18 (1960), 420–427.
- [Mir07] M. Mirzakhani, Simple geodesics and Weil-Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces, Invent. math. 167 (2007), 179–222, http://www.springerlink.com/content/432768xh15v3ru75/.
- [MK79] S.W. McDonald and A.N. Kaufman, Spectrum and eigenfunctions for a hamiltonian with stochastic trajectories, Phys. Rev. Lett. 42 (1979), 1189–1191.
- [Mon73] H.L. Montgomery, The pair correlation of zeroes of the zeta function, Analytic number theory (Amer. Math. Soc., ed.), Proc. Sympos. Pure Math., 1973, http://www-personal.umich.edu/~hlm/paircor1.pdf.
- [MOOP08] D. Maulik, A. Oblomkov, A. Okounkov, and R. Pandharipande, Gromov-Witten/Donaldson-Thomas correspondence for toric -folds, math.AG/0809.3976.
- [MS08] M. Mulase and B. Safnuk, A simple proof of Mirzakhani’s recursion formula of Weil-Petersson volumes, Ind. J. Math. 50 (2008), 189–228, math.QA/0601194.
- [Mum83] D. Mumford, Towards an enumerative geometry of the moduli space of curves, pp. 271–328, Birkhäuser, 1983.
- [Mum84] , Tata lectures on Theta, Modern Birkhäuser Classics, Birkhäuser, Boston, 1984, Volume I (no. 28), II (no. 43), III (no. 97).
- [MV01] M. Mariño and C. Vafa, Framed knots at large , Orbifolds in mathematics and physics (Providence, RI) (J. Morava A. Adem and Y. Ruan, eds.), Contemp. Math., vol. 310, Madison, WI, Amer. Math. Soc., 2001, hep-th/0108064, pp. 185–204.
- [Nek04] N. Nekrasov, Seiberg-Witten prepotential from instanton counting, Adv. Theor. Math. Phys. 7 (2004), 831–864, hep-th/0206161.
- [no] M. Mari no, Open string amplitudes and large order behavior in topological string theory, JHEP.
- [NS09] N. Nekrasov and S. Shatashvili, Quantization of integrable systems and four dimensional gauge theories, XVIth Int. Cong. Math. Phys., World Scientific Publishing, Août 2009, hep-th/0908.4052, pp. 265–289.
- [Odl87] A. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, Math. Comp. 48 (1987), 273–308, http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/arch/zeta.zero.spacing.pdf.
- [Oko06] A. Okounkov, Random partitions and instanton counting, math-ph/0601062.
- [Ora07] N. Orantin, Du développement topologique des modèles de matrices à la théorie des cordes topologiques : combinatoire de surfaces par la géométrie algébrique, Thèse de doctorat, Université Paris VI (2007), http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00173162/en/.
- [Ora08] , Symplectic invariants, Virasoro constraints and Givental decomposition, math-ph/0808.0635.
- [ORV03] A. Okounkov, N. Reshetikhin, and C. Vafa, Quantum Calabi-Yau and classical crystals, hep-th/0309208.
- [Pal99] J. Palmer, Zeros of the Jimbo, Miwa, Ueno tau function, J. Math. Phys. 40 (1999), 6638–6681, solv-int/9810004.
- [PR60] C.E. Porter and N. Rosenzweig, "Repulsion of energy levels" in complex atomic spectra, Phys. Rev. 120 (1960), 1698–1714.
- [Rau59] H.E. Rauch, Weierstrass points, branch points, and moduli of Riemann surfaces, Comm. Pure Appl. Math. 12 (1959), 543–560.
- [Rid10] B. Rider, Exposé au MSRI Semester on Random Matrix Theory, Septembre 2010. Basé sur des travaux communs avec M. Krishnapur et B. Virág.
- [RRV06] J.A. Ramìrez, B. Rider, and B. Virág, Beta ensembles, stochastic Airy process, and a diffusion, math.FA/0609451.
- [Sel44] A. Selberg, Bemerkninger om et multiplet integral, Norsk. Mat. Tid. 26 (1944), 71–78.
- [Smi06] S. Smirnov, Towards conformal invariance of lattice models, Proc. Int. Congr. Math. 2 (2006), 1421–1451, math-ph/0708.0032.
- [Smi10] , Discrete complex analysis and probability, Proc. Int. Congr. Math. (2010), math-ph/1009.6077.
- [SS83] M. Sato and Y. Sato, Soliton equations as dynamical systems on infinite-dimensional grassmann manifold, Nonlinear partial differential equations in applied science, Stud. Math., vol. 81, Tokyo, North Holland, 1983, http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ kyodo/kokyuroku/contents/pdf/0439-5.pdf, pp. 259–271.
- [SS10] H. Spohn and T. Sasamoto, The one-dimensional KPZ equation: an exact solution and its universality, Phys. Rev. Lett. 104 (2010), cond-mat.stat-mech/1009.1883.
- [Str84] K. Strebel, Quadratic differentials, vol. 3, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, no. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1984.
- [Suł10] P. Sułkowski, Matrix models for -ensembles from Nekrasov partition functions, JHEP (2010), no. 1004:063, hep-th/0912.5476.
- [SW94] N. Seiberg and E. Witten, Monopole condensation, and confinement in supersymmetric Yang-Mills theory, Nucl. Phys. B 426 (1994), 19–52, hep-th/9407087.
- [Sze52] G. Szegö, On certain hermitian forms associated with the Fourier series of a positive function, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 228–238, tome supplémentaire.
- [t’H74] G. t’Hooft, A planar diagram theory for strong interactions, Nucl. Phys. B 72 (1974), 461–473, http://www.phys.uu.nl/~thooft/gthpub.html.
- [Tri57] F.G. Tricomi, Integral equations, Interscience, London, 1957, New edition, Dover Publications, 1985.
- [TT09] K. Takasaki and T. Takebe, hbar-expansion of KP hierarchy: Recursive construction of solutions, math-ph/0912.4867.
- [Tut62] W.T. Tutte, A census of planar triangulations, Can. J. Math. 14 (1962), 21.
- [Tut63] , A census of planar maps, Can. J. Math. 15 (1963), 249.
- [Tut68] , On the enumeration of planar maps, Bull. Amer. Math. Soc. 74 (1968), no. 1, 64–74.
- [TV09] T. Tao and V. Vu, Random matrices: universality of local eigenvalue statistics, to appear in Acta Math. (2009), math.PR/0906.0510.
- [TW94] C. Tracy and H. Widom, Level spacing distributions and the Airy kernel, Commun. Math. Phys. 159 (1994), 151–174, hep-th/9211141.
- [TW96] , On orthogonal and symplectic matrix ensembles, Commun. Math. Phys. 177 (1996), 727–754, solv-int/9509007.
- [Vak97] R. Vakil, Enumerative geometry of curves via degeneration methods, Ph.D. Thesis, Harvard University (1997).
- [Vor87] A. Voros, Spectral functions, special functions, and the Selberg zeta function, Commun. Math. Phys. 110 (1987), 439–465.
- [Wig51] E.P. Wigner, On the statistical distribution of the widths and spacings of nuclear resonance levels, Proc. Cambridge Phil. Soc. 47 (1951), no. 4, 790–798.
- [Wis28] J. Wishart, The generalised product moment distribution in samples from a normal multivariate population, Biometrika 20A (1928), no. 1/2, 32–52.
- [Wit95] E. Witten, Chern-Simons gauge theory as a string theory, Prog.Math. 133 (1995), 637–678, hep-th/9207094.
- [WZ06] P. Wiegmann and A. Zabrodin, Large expansion for the Dyson gas, J. Phys. A 39 (2006), 8933–8964, hep-th/0601009.
- [Zho09a] J. Zhou, Local mirror symmetry for one-legged topological vertex, math.AG/0910.4320.
- [Zho09b] , Local mirror symmetry for the topological vertex, math.AG/0911.2343.
- [ZJ03] P. Zinn-Justin, The asymmetric ABAB matrix model, Europhys. Lett. 64 (2003), 737–742, hep-th/0308132.