Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie
Sylvain Crovisier
Décembre 2009
Perturbation de la dynamique de difféomorphismes en topologie
Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la dynamique de difféomorphismes de variétés compactes. Pour l’étude des propriétés génériques ou pour la construction d’exemples, il est souvent utile de savoir perturber un système. Ceci soulève généralement des problèmes délicats : une modification locale de la dynamique peut engendrer un changement brutal du comportement des orbites. En topologie , nous proposons diverses techniques permettant de perturber tout en contrôlant la dynamique : mise en transversalité, connexion d’orbites, perturbation de la dynamique tangente, réalisation d’extensions topologiques,… Nous en tirons diverses applications à la description de la dynamique des difféomorphismes -génériques.
Perturbation of the dynamics of diffeomorphisms in the -topology
This memoir deals with the dynamics of diffeomorphisms of compact manifolds. For the study of generic properties or for the construction of examples, it is often useful to be able to perturb a system. This generally leads to delicate problems: a local modification of the dynamic may cause a radical change in the behavior of the orbits. For the topology, we propose various techniques which allow to perturb while controlling the dynamic: setting in transversal position, connection of orbits, perturbation of the tangent dynamics,… We derive various applications to the description of -generic diffeomorphisms.
Introduction
Le dynamicien étudie les systèmes qui évoluent au cours du temps. De nombreux exemples sont fournis par la mécanique classique à travers une équation différentielle. Poincaré a montré dans son mémoire [131] sur la stabilité du système solaire que l’on peut décrire le comportement asymptotique des trajectoires sans passer par leur calcul explicite (souvent vain). Nous nous intéressons dans ce texte aux systèmes à temps discret obtenus en itérant un difféomorphisme. Ils sont naturellement reliés aux systèmes à temps continu si l’on considère une section de Poincaré ou le temps du flot associé. Les systèmes provenant de la physique possèdent bien souvent des symétries supplémentaires : nous n’abordons pas ici le cas spécifique des difféomorphismes conservatifs, i.e. qui préservent une forme volume ou symplectique (voir [47] pour un panorama des difféomorphismes de surface conservatifs).
La classe des difféomorphismes hyperboliques est l’une des premières étudiées et des mieux décrites. Dans ce mémoire111Je suis très reconnaissant à Jérôme Buzzi, Rafael Potrie et Charles Pugh pour l’attention qu’ils ont portée sur ce texte et leurs nombreuses remarques., nous discuterons essentiellement des difféomorphismes non hyperboliques génériques. (Nous renvoyons à [34] pour une vue d’ensemble des dynamiques faiblement hyperboliques.)
0.1 Dynamiques génériques
Plaçons-nous sur une variété différentiable compacte . L’étude de la dynamique d’un difféomorphisme arbitraire de peut sembler parfois hors de portée : on peut imaginer la coexistence et l’accumulation d’une grande variété de comportements différents, empêchant l’espoir de décomposer et de structurer la dynamique. Il se pourrait cependant que de tels difféomorphismes, pathologiques, puissent toujours être approchés par d’autres, plus simples à analyser : il devient plus raisonnable d’espérer décrire la dynamique d’une partie dense des systèmes. Ce point de vue soulève une difficulté, que nous discuterons plus amplement par la suite : nous devons préciser l’espace des difféomorphismes considérés, ainsi que le choix d’une topologie sur cet espace.
Nous travaillerons en général avec des espace de difféomorphismes métrisables complets et nous pourrons alors utiliser la généricité de Baire. Une propriété sera dite générique si elle est satisfaite par un ensemble de difféomorphismes contenant une intersection dénombrable d’ouverts denses (un ensemble Gδ dense). La réalisation simultanée de deux propriétés génériques est encore générique. La généricité de Baire est donc un outil commode pour décrire des ensembles denses de difféomorphismes.
0.1.a Choix d’un espace de difféomorphismes.
Les propriétés génériques que l’on peut obtenir dépendent beaucoup de la régularité des difféomorphismes que l’on étudie. Notons l’espace des difféomorphismes de classe de . Nous allons discuter l’existence de points périodiques de difféomorphismes génériques pour différents espaces.
- –
-
–
Dans , l’existence de points périodiques est plus difficile à obtenir : c’est l’objet du lemme de fermeture de Pugh. L’ensemble des points ayant une même période est fini.
-
–
Dans , , l’existence de points périodique n’est en général pas connue.
-
–
Herman a montré [75, 74] que sur certains tores symplectiques, pour des ensembles ouverts de fonctions hamiltoniennes il existe des ouverts de surfaces d’énergies régulières sur lesquelles il n’y a pas d’orbites périodiques. Les dynamiques hamiltoniennes génériques sur ces surfaces d’énergies n’ont donc pas d’orbite périodique.
Nous travaillerons par la suite en régularité . Il y a pour cela plusieurs raisons. L’existence d’une structure différentiable donne une rigidité minimale, permettant par exemple la continuation des points périodiques, l’étude des exposants de la dynamique, l’obtention de sous-variétés invariantes. Comme nous l’avons vu, la perturbation de difféomorphismes en topologie est assez souple pour créer des points périodiques. La topologie possède également une propriété importante : si est un difféomorphisme de à support compact, tous les conjugués par des homothéties de rapport petit sont à la même distance à l’identité. Cette remarque est à la base des principales techniques de perturbation dans . En revanche, la régularité n’est pas suffisante pour certains résultats requérant un contrôle de distorsion.
0.1.b Dynamiques hyperboliques.
Très rapidement, les dynamiciens ont cherché quelles étaient les dynamiques structurellement stables, i.e. dont le comportement topologique ne change pas après perturbation du système. Anosov et Smale ont introduit une classe de difféomorphismes ayant cette propriété : ce sont les difféomorphismes hyperboliques. Un difféomorphisme est hyperbolique si, au-dessus de tout ensemble invariant suffisamment récurrent, on peut décomposer l’espace tangent de en deux fibrés linéaires invariants, le premier (le fibré stable) étant uniformément contracté, le second (le fibré instable) uniformément dilaté. Paradoxalement, la stabilité de ces systèmes face aux perturbations ne les empêche pas d’avoir une dynamique parfois “chaotiques”. La dynamique de ces systèmes est très bien comprise, notamment du point de vue symbolique (existence de partitions de Markov, de codages) et du point de vue de la théorie ergodique (existence de mesures physiques).
L’équivalence entre la stabilité et l’hyperbolicité a fait l’objet de nombreux travaux et a finalement été obtenue par Mañé. Ces recherches ont fait émerger de nombreux outils intéressants pour l’étude des dynamiques différentiables. Il est apparu cependant que l’ouvert des dynamiques hyperboliques n’est en général pas dense dans l’espace des difféomorphismes. Des objectifs naturels guident alors l’étude des dynamiques génériques :
-
–
la compréhension des défauts d’hyperbolicité,
-
–
la généralisations de propriétés satisfaites par les systèmes hyperboliques à des classes plus larges de dynamiques,
-
–
la recherche de nouveaux phénomènes dynamiques.
Parmi les dynamiques non hyperboliques, deux obstructions apparaissent fréquemment : les tangences homoclines et les cycles hétérodimensionnels (voir la figure 1).
-
–
Une orbite périodique hyperbolique possède une tangence homocline si ses variétés stable et instable possèdent un point d’intersection non transverse. Certains vecteurs sont alors uniformément contractés par itérations passées et futures et devraient appartenir simultanément aux fibrés stable et instable.
-
–
Deux orbites périodiques hyperboliques forment un cycle hétérodimensionnel si elles sont liées par des orbites hétéroclines et si leurs dimensions stables diffèrent. Il n’existe donc pas de fibré stable de dimension constante au-dessus du cycle.
Pour les difféomorphismes de surface de régularité , , Newhouse a montré que l’ensemble des difféomorphismes ayant une tangence homocline est dense dans un ouvert (non vide) de l’espace des difféomorphismes. En dimension plus grande (et en toute régularité , ), Abraham et Smale ont construit un ouvert dans lequel les dynamiques présentant un cycle hétérodimensionnel sont denses. Le cas des difféomorphismes de classe des surfaces n’est pas connu.
Conjecture (Smale).
Pour toute surface compacte , l’ensemble des difféomorphismes hyperboliques est dense dans .
Palis a conjecturé que ces bifurcations sont les seules obstructions à l’hyperbolicité.
Conjecture (Palis).
Dans , , tout difféomorphisme peut être approché par une dynamique hyperbolique ou par une dynamique possédant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
0.1.c Les dynamiques génériques représentent-elles tous les systèmes ?
La généricité donne un sens à la notion de partie négligeable de l’ensemble des difféomorphismes : nous cherchons à décrire la plupart des dynamiques. Ce point de vue est cependant très relatif, puisqu’il se peut que l’espace des difféomorphismes étudiés soit négligeable pour une autre notion de généricité.
Il est ainsi envisageable que l’on puisse trouver deux parties disjointes, chacune dense dans un ouvert de l’espace des difféomorphismes et représentant des dynamiques très différentes. Par exemple, lorsque , on peut alors introduire :
-
–
l’ensemble des homéomorphismes ayant un ensemble non dénombrable de points périodiques (nous avons vu que c’est une partie générique de ),
- –
Les difféomorphismes structurellement stables ont au plus un nombre dénombrable de points périodiques et ces deux parties denses de sont donc disjointes.
Remarquons que, dans certains cas, en travaillant avec des propriétés génériques, on peut obtenir des conclusions satisfaites par un ouvert dense de difféomorphismes, et non pas seulement par un Gδ. (Voir par exemple la conjecture faible de Palis, plus bas.)
0.2 Décomposition de la dynamique
La dynamiques d’un difféomorphisme hyperbolique est portée par un nombre fini d’ensembles compacts invariants disjoints et transitifs (i.e. possédant une orbite positive dense), appelés pièces basiques. Plus précisément, dans ce cadre chaque pièce basique contient une orbite périodique et coïncide avec l’adhérence de l’ensemble des intersections transverses entre les variétés stables et instables de . Un tel ensemble associé à une orbite périodique hyperbolique peut être défini pour un difféomorphisme arbitraire et est appelé classe homocline de .
Conley a montré que cette décomposition se généralise aux difféomorphismes quelconques, si l’on autorise un nombre infini de pièces et si l’on remplace la transitivité par la transitivité par chaînes. Cette propriété est une notion plus faible de récurrence qui met en jeux les pseudo-orbites, i.e. les suites de pour lesquelles et sont proches pour tout mais ne coïncident pas nécessairement. Les pièces obtenues sont alors appelée classes de récurrence par chaînes.
La décomposition de Conley est intéressante si l’on parvient à faire le lien entre les pseudo-orbites et les vraies orbites de la dynamique. Il faut pour cela être capable de refermer les sauts d’une pseudo-orbite par perturbation. Ce problème a été traité progressivement par l’obtention de lemmes de perturbation dans des situations de plus en plus générales.
-
–
Pugh a démontré un lemme de fermeture qui permet de créer un point périodique près d’un point non-errant. Il s’agit en quelque sorte de fermer une pseudo-orbite périodique ayant un saut unique.
-
–
Hayashi a obtenu un lemme de connexion : lorsque l’orbite positive d’un point et l’orbite négative d’un point ont un point d’accumulation commun, et sont contenus dans la même orbite après perturbation. Là encore, il n’y a qu’un seul saut à refermer.
-
–
Finalement, avec C. Bonatti nous avons abordé le cas général et établi un lemme de connexion pour les pseudo-orbites.
Le lemme de connexion pour les pseudo-orbites permet de montrer que la décomposition en classes de récurrence par chaînes est bien adaptée à l’étude des difféomorphismes génériques : par exemple, les classes de récurrence par chaînes contenant une orbite périodique sont des ensembles transitifs. Plus précisément, nous avons obtenu le résultat suivant.
Théorème.
Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes pour lesquels la classe de récurrence par chaînes de toute orbite périodique coïncide avec sa classe homocline .
Toutefois le lemme de connexion pour les pseudo-orbites ne permet pas de contrôler complètement le support de l’orbite obtenue. J’ai établi pour cela un autre lemme de perturbation. En voici une conséquence.
Théorème.
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , chaque classe de récurrence par chaînes est limite de Hausdorff d’une suite d’orbites périodiques.
Ces techniques de perturbation restent valables pour les difféomorphismes conservatifs. Elles entraînent un résultat de “diffusion des orbites” (obtenu avec C. Bonatti et M.-C. Arnaud).
Théorème.
Considérons une variété compacte connexe munie d’une forme volume ou symplectique . Tout difféomorphisme appartenant à une partie générique de l’espace des difféomorphismes de préservant est transitif.
Ce dernier théorème souligne à nouveau l’importance de la régularité choisie. En effet, le théorème des tores invariants de Herman (voir [73, chapitre IV], [101, section II.4.c] et [190]) montre par des techniques de théorie KAM qu’il existe un ouvert de difféomorphismes de , , qui possèdent un tore de codimension . Ce tore sépare la variété en deux composante et empêche la transitivité. Le théorème précédent n’est donc pas vrai en régularité supérieure.
Nous pouvons également remarquer certaines particularités du sujet. D’une part, l’essentiel des résultats s’appuient sur des techniques de perturbation. D’autre part, les différents lemmes de perturbation ont parfois des énoncés qui peuvent sembler très similaires, bien que la difficulté des démonstrations puisse être bien différente.
Notre connaissance des dynamiques -générique devient suffisamment précise pour pouvoir obtenir des conclusions qui n’étaient jusqu’alors connues que dans le cadre des dynamiques hyperboliques. Par exemple, on s’attend à ce que le centralisateur d’un difféomorphisme, i.e. l’ensemble des difféomorphismes qui commutent avec lui, soit en général petit. C’est ce que nous avons vérifié avec C. Bonatti et A. Wilkinson.
Théorème.
L’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial (i.e. réduit aux itérés , ) contient un Gδ dense de .
Caractérisation des dynamiques non hyperboliques
En dimension et en toute régularité, la conjecture de Palis est une conséquence du théorème de Peixoto : tout difféomorphisme du cercle peut être approché par un difféomorphisme ayant un nombre fini de points périodiques, tous hyperboliques (les autres orbites sont errantes et connectent une source à un puits). En dimension , Pujals et Sambarino ont démontré la conjecture en régularité . En dimension supérieure, seuls des résultats partiels existent (et seulement en topologie ). Nous allons les présenter ci-dessous.
0.3.a Les dynamiques conservatives
En topologie et dans le cadre conservatif, la conjecture de Palis est vérifiée, nous obtenons même un résultat plus fort.
En dimension , il existe une obstruction robuste à l’hyperbolicité venant de la structure symplectique : l’existence d’un point périodique elliptique, i.e. ayant des valeurs propres non réelles de module . Newhouse a montré [106] que cette obstruction suffit a caractériser les difféomorphismes robustement non hyperboliques
Lorsque , les points périodiques sont génériquement hyperboliques [154]. Les travaux, classiques, autour de la stabilité structurelle, impliquent qu’une dynamique dont on ne peut pas faire bifurquer les points périodiques est hyperbolique. Si l’on parvient au contraire à faire bifurquer des points périodiques, on obtient par perturbation des points périodiques ayant des dimensions stables différentes; le lemme de connexion pour les pseudo-orbites crée alors un cycle hétérodimensionnel (dans le cadre conservatif et lorsque est connexe, il n’y a qu’un seule classe de récurrence par chaînes) associé à des points périodiques dont la dimension stable diffère de .
Un résultat de Bonatti et Díaz permet de renforcer les cycles hétérodimensionnels : après perturbation, on obtient un difféomorphisme et une paire d’ensemble hyperboliques transitifs dont la dimension stable diffère, tels que pour tout difféomorphisme proche de , les continuations sont liées par des orbites hétéroclines. Un tel cycle associé à et est une obstruction robuste à l’hyperbolicité et est appelé cycle hétérodimensionnel robuste. Si l’on choisit des orbites périodiques et , il existe un ensemble dense de difféomorphismes au voisinage de pour lesquels et forment un cycle hétérodimensionnel.
L’énoncé obtenu porte sur un ouvert dense de l’espace des difféomorphismes conservatifs.
Théorème.
Tout difféomorphisme conservatif peut être approché dans par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel robuste.
0.3.b La conjecture faible de Palis.
On connaît depuis Poincaré [131, 132] et Birkhoff [20] l’importance du rôle joué par les intersections homoclines transverses, i.e. par les points d’intersection transverses entre les variétés stables et instables d’une orbite périodique. Cette propriété - très simple - est à l’origine d’une dynamique complexe.
Smale a construit [168] un modèle géométrique, son célèbre fer à cheval, qui décrit la dynamique près d’une telle orbite. On trouve des ensembles hyperboliques dont une puissance est conjuguée au décalage sur l’ensemble de Cantor . Il y a alors une infinité d’orbite périodiques et l’entropie topologique de la dynamique est strictement positive. Remarquons également que l’existence d’une intersection homocline transverse est une propriété ouverte.
À l’opposé, Smale a introduit des dynamiques très simples : les difféomorphismes Morse-Smale. Ce sont des difféomorphismes hyperboliques pour lesquels chaque pièce basique est réduite à une orbite périodique. Les autres orbites s’accumulent dans le passé et dans le futur sur deux orbites périodiques distinctes. En particulier, ces dynamiques sont stables (elles forment donc un ouvert) et leur entropie topologique est nulle.
Palis a conjecturé (en toute classe de différentiabilité , ) que ces deux comportements forment une partie dense de l’espace des difféomorphismes. Cette seconde conjecture de Palis est impliquée par la première et est donc vérifiée en dimension d’après les résultats de Pujals et Sambarino. Elle a ensuite été démontrée en dimension par Bonatti, Gan et Wen. J’ai obtenu une démonstration dans le cas général.
Théorème.
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme Morse-Smale ou par un difféomorphisme ayant une intersection homocline transverse.
Bien que la preuve fasse appel aux techniques de généricité, la conclusion décrit à nouveau une partie ouverte et dense de l’espace des difféomorphismes. Sur cet ouvert, il y a donc une dichotomie parfaite entre les dynamiques “simples” et “compliquées”.
La démonstration se ramène à l’étude d’ensembles dont le défaut d’hyperbolicité est concentré sur un fibré linéaire invariant de dimension . Aucun vecteur de ce fibré n’est contracté ni dilaté par les itérés de l’application tangente. Les techniques habituelles de dynamiques différentiables reliées à l’existence d’exposants de Lyapunov non nuls ne s’appliquent donc pas et nous les avons remplacées par l’étude d’objets de nature plus topologique : les modèles centraux.
Dans le cas conservatif, on s’attendrait à ce que pour un ouvert dense de difféomorphismes, il existe une orbite périodique hyperbolique ayant une intersection homocline transverse. En topologie , c’est une conséquence du théorème établi avec Arnaud et Bonatti énoncé ci-dessus. En régularité plus grande, des résultats partiels existent sur les surfaces : Zehnder a montré [191] que tout point elliptique est approché par un point périodique hyperbolique ayant une intersection homocline transverse. Plus généralement, les difféomorphismes ayant une intersection homocline transverse sont denses dans presque toute classe d’homotopie de difféomorphisme conservatif , , voir [155, 128, 110, 111].
0.3.c Hyperbolicité partielle.
Une approche possible pour montrer la conjecture de Palis consiste à étudier les difféomorphismes génériques qui ne sont pas approchés par des tangence homoclines ou par des cycles hétérodimensionnels. Il s’agit alors de montrer que chaque classe de récurrence par chaînes est un ensemble hyperbolique.
Nous avons obtenu un résultat dans cette direction : chaque classe de récurrence par chaînes vérifie une propriété d’hyperbolicité partielle. Plus précisément, il existe une décomposition du fibré tangent unitaire. et sont uniformément contractés et dilatés. La partie centrale est moins contractée ou dilatée que les fibrés extrêmes . De plus, sa dimension est au plus égale à (lorsqu’elle est de dimension , elle se décompose à nouveau en deux fibrés de dimension ). Un tel difféomorphisme est appelé dans ce cadre difféomorphisme partiellement hyperbolique.
J’ai démontré que les difféomorphismes loin des bifurcations homoclines peuvent être approchés par des difféomorphismes partiellement hyperboliques. Wen avait obtenu précédemment une version locale de ce résultat en s’appuyant sur le lemme de sélection de Liao.
Théorème.
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme partiellement hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
Pour achever la démonstration de la conjecture de Palis, il faudrait montrer que pour ces difféomorphismes partiellement hyperboliques, les fibrés centraux de dimension sont uniformément contractés ou dilatés. C’est ce qu’ont réussi Pujals et Sambarino dans le cas des difféomorphismes de surface. Dans le cas de fibrés centraux extrêmes (i.e. lorsque ou est dégénéré) leur argument se généralise (le cas où est de dimension a été traité par Pujals et Sambarino ; j’ai traité le cas avec E. Pujals).
Addendum.
Les difféomorphismes partiellement hyperboliques du théorème précédent peuvent être choisis pour satisfaire la propriété additionnelle suivante : pour chaque classe de récurrence par chaînes qui n’est pas un puits ou une source, les fibrés extrêmes sont non dégénérés.
0.3.d Hyperbolicité essentielle.
Il peut être plus facile d’étudier l’hyperbolicité des parties attractives de la dynamique. En dimension , Pujals a établi sous certaines hypothèses que tout difféomorphisme ayant un attracteur non hyperbolique peut être approché par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
Un difféomorphisme est essentiellement hyperbolique si et possèdent un nombre fini d’attracteurs hyperboliques dont l’union des bassins est dense dans . De façon équivalente, en restriction à un ouvert dense de on ne distingue pas la dynamique de de celle d’un difféomorphisme hyperbolique.
Le résultat suivant a été obtenu en collaboration avec E. Pujals.
Théorème.
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme essentiellement hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
0.3 Structure de l’espace des dynamiques
La décomposition de la dynamique générique a permis la formulation de nombreuses questions, présentées dans ce texte (voir aussi l’exposé de Bonatti [21]). Une des directions de recherches actuelles consiste à structurer l’espace des difféomorphismes et à classifier les divers types de comportements de la dynamique. Une telle approche avait déjà été proposée par Smale [172, 160].
0.4.a Phénomènes et mécanismes.
Les énoncés présentés dans les paragraphes précédents ont un objectif commun que l’on peut formuler de la façon suivante.
Problème (Pujals).
Structurer l’espace des difféomorphismes en phénomènes et mécanismes.
Plus précisément, ces énoncés fournissent deux ouverts disjoints , d’union dense dans l’espace des difféomorphismes et caractérisant deux types de dynamiques très différents.
-
–
est l’ouvert associé à un phénomène : pour tout difféomorphisme appartenant à une partie (Gδ parfois ouverte) dense de , il existe une description globale de la dynamique (dynamique Morse-Smale, hyperbolicité, hyperbolicité partielle, hyperbolicité essentielle,…)
-
–
est l’ouvert associé à un mécanisme : pour tout difféomorphisme appartenant à une partie dense de , il existe une configuration semi-locale de la dynamique (une bifurcation) qui est à la fois très simple (par exemple elle se lit sur les orbites périodiques, elle peut être détectée numériquement), qui engendre des changements importants sur les dynamiques voisines (par exemple l’apparition d’un grand nombre d’orbites périodiques) et qui est une obstruction au phénomène associé à .
0.4.b Complexité des dynamiques génériques.
Les résultats récents sur la dynamique générique permettent d’imaginer une façon de structurer l’espace des difféomorphismes. Deux conjectures, impliquant toutes deux celle de Palis, résument l’essentiel des scénarios envisagés pas les auteurs du sujet (voir [21] pour un exposé détaillé de différentes conjectures).
La première constate que les seuls mécanismes connus engendrant une infinité de classes distinctes sont liées à l’existence de tangences homoclines (c’est le cas du phénomène de Newhouse pour lequel il existe une infinité de puits et de sources).
Conjecture de finitude (Bonatti).
Les difféomorphismes loin des tangences homoclines dans n’ont qu’un nombre fini de classes de récurrence par chaînes.
La seconde implique également la conjecture de Smale et est propre à la régularité . Pour cette topologie, les méthodes pour obtenir un ensemble localement dense de difféomorphismes présentant une tangence homocline font toutes intervenir des cycles hétérodimensionnels.
Conjecture d’hyperbolicité (Bonatti-Díaz).
Tout difféomorphisme de peut être approché par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel robuste.
Bonatti propose de décomposer l’espace des difféomorphismes selon les critères suivants :
-
–
existence de tangences homoclines (dynamique critique),
-
–
existence de cycle hétérodimensionnel (dynamique hétérodimensionnelle),
-
–
nombre fini ou infini de classes de récurrence par chaînes (dynamique modérée ou sauvage).
Par ailleurs, Bonatti et Díaz ont montré l’existence de dynamiques sauvages ayant une propriété remarquable : en renormalisant la dynamique contenue dans des disques périodiques, on obtient une famille de difféomorphismes dense dans l’espace des difféomorphismes du disque préservant l’orientation. Une telle dynamique est qualifiée d’universelle.
Si les deux conjectures précédentes sont vérifiées, l’espace des difféomorphismes est alors structuré en régions de complexité croissante : dynamique hyperbolique, modérée non critique, modérée critique, sauvage, dynamique universelle (voir la figure 2). Des exemples de dynamique pour chaque région seront donnés en sections 1.6, 5.10, 7.9 et 8.6.
Notations
-
est l’espace (compact) des parties compactes d’un espace métrique compact , muni de la distance de Hausdorff :
(Lorsque est vide et non vide, on pose .)
-
désignera en général une variété différentiable compacte sans bord munie d’une métrique riemannienne.
-
est l’intérieur d’une partie .
-
, pour , est l’espace des difféomorphismes de classe de , muni de la topologie . (C’est un espace métrique complet, donc un espace de Baire.)
-
représentent l’ensemble des points périodiques, l’ensemble non-errant et l’ensemble récurrent par chaînes du difféomorphisme de .
-
sont les ensembles stable et stable par chaînes du point .
-
et sont des relations dynamiques introduites au chapitre 1.
-
Les mesures d’un espace compact métrique seront toujours des mesures boréliennes. Leur ensemble est muni de la topologie faible (rendant continues les évaluations sur les fonctions continues ).
-
et désignent l’ensemble des difféomorphismes d’une variété ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
Chapter 1 Décomposition de la dynamique
Ce chapitre introduit les notations et les définitions que nous utiliserons dans la suite du texte. Nous nous plaçons sur une variété différentiable compacte sans bord de dimension .
Nous présentons tout d’abord des notions de récurrence qui permettent d’analyser les systèmes dynamiques topologiques : la récurrence au sens des pseudo-orbites donne lieu au “théorème fondamental de la dynamique” de Conley. Nous travaillons ensuite avec des difféomorphismes et nous rappelons la notion d’ensemble hyperbolique. Nous renvoyons à [42, 162, 107, 189, 68] pour des exposés détaillés des propriétés des dynamiques hyperboliques (stabilité, pistage,…) Nous définissons finalement ce qui sera pour nous un difféomorphisme hyperbolique.
1.1 Récurrence : transitivité faible, transitivité par chaînes
Soit un difféomorphisme d’une variété différentiable compacte sans bord munie d’une métrique riemannienne111Jusqu’en section 1.4, il suffirait de considérer un homéomorphisme d’un espace métrique compact..
Ensembles faiblement transitifs.
Un compact invariant est transitif si pour tous ouverts rencontrant , il existe ayant un itéré positif , , dans .
Plus généralement, est faiblement transitif si, pour tous ouverts rencontrant et tout voisinage de , la propriété suivante est satisfaite.
- ()
-
Il existe un segment d’orbite tel que et .
Si est un ensemble fermé, nous noterons si pour tous voisinages de , de et de , la propriété a lieu. Nous écrirons pour . Ces relations sont fermées mais ne sont en général pas transitives.
L’ensemble non-errant, , est l’ensemble des points de dont tout voisinage intersecte l’un de ses itérés , , c’est-à-dire l’ensemble des points satisfaisant . C’est un fermé invariant qui contient les ensembles faiblement transitifs. En particulier, il contient tous les points périodiques de . Remarquons que la dynamique induite par sur peut avoir des points errants.
Ensembles transitifs par chaînes.
Nous introduisons une notion de récurrence plus grossière mais qui n’a pas les défauts de la précédente.
Soit . Les -pseudo-orbites de sont les suites de telles que la distance est strictement inférieure à pour tout tel que appartiennent à .
Un ensemble est transitif par chaînes si pour tous et tout la propriété suivante a lieu.
- ()
-
Il existe une -pseudo-orbite telle que , et .
Si est un ensemble fermé, nous noterons si la propriété () a lieu. Nous écrirons pour . Ces relations sont fermées et transitives. De plus implique . Par conséquent les ensembles faiblement transitifs sont aussi transitifs par chaînes.
On peut étendre la relation aux ensembles transitifs par chaînes : on a s’il existe et tels que .
Un point est récurrent par chaînes si, pour tout , il appartient à une -pseudo-orbite périodique, c’est à dire si . L’ensemble récurrent par chaînes est l’ensemble des points récurrents par chaînes. C’est un donc fermé invariant, contenant l’ensemble non-errant. En restriction à , la dynamique de ne possède que des points récurrents par chaînes.
Les classes de récurrence par chaînes sont les classes d’équivalence de la relation symétrisée “ et ”. Elles sont fermées et elles coïncident avec les ensembles transitifs par chaînes maximaux. L’ensemble récurrent par chaînes est naturellement partitionné par les classes de récurrence par chaînes, par conséquent l’ensemble récurrent par chaînes coïncide avec l’union des ensembles transitifs par chaînes.
1.2 Théorème “fondamental” de la dynamique, filtrations
Théorème 1.1 (Conley).
Soit un homéomorphisme d’un espace compact métrique . Il existe une fonction continue ayant les propriétés suivantes :
-
–
décroît le long des orbites de et décroît strictement le long des orbites de contenues dans ;
-
–
l’image de par est totalement discontinue ;
-
–
prend des valeurs distinctes sur des classes de récurrence par chaînes distinctes.
Un ouvert de est attractif si est contenu dans . Une fonction de Lyapunov222Nous renvoyons à [18] pour une discussion plus détaillée des décomposition de la dynamique par fonctions de Lyapunov. donnée par le théorème de Conley permet de montrer de nouvelles propriétés.
-
–
Pour tout point , il existe un ouvert attractif tel que appartient à : l’ensemble récurrent par chaînes est donc la notion de récurrence raisonnable la plus faible.
-
–
Pour tout ensemble fini de classes de récurrence par chaînes, il existe une suite emboîtée d’ouverts attractifs , tels que contienne un élément de et un seul pour chaque entier .
Une suite emboîtée d’ouverts attractifs est appelée filtration de .
1.3 Ensemble stable par chaînes, quasi-attracteurs
L’ensemble stable d’un point est l’ensemble
Par analogie, on introduit l’ensemble stable par chaînes d’un point ou d’une classe de récurrence par chaînes de : c’est l’ensemble des points tels que pour tout il existe des -pseudo-orbite et telles que , et . On le note . (Le “p” signifie “au sens des pseudo-orbites”). On définit symétriquement l’ensemble instable et l’ensemble instable par chaînes .
Les classes de récurrence par chaînes sont partiellement ordonnées par la relation . Un quasi-attracteur (on parle aussi parfois d’“attracteur faible”) est une classe de récurrence par chaînes qui est minimale pour l’ordre , ou de façon équivalente qui coïncide avec son ensemble instable par chaînes. Il existe toujours au moins un quasi-attracteur (ce qui n’est pas le cas des attracteurs).
Si est une classe de récurrence par chaînes, pour tout , l’ensemble des points que l’on peut atteindre depuis par -pseudo-orbites est un voisinage attractif de . Ceci montre la proposition suivante.
Proposition 1.2.
Une classe de récurrence par chaînes est un quasi-attracteur si et seulement si elle possède une base de voisinages ouverts attractifs.
Ces notions sont proches de la stabilité au sens de Lyapunov. On dit qu’un ensemble invariant est stable au sens de Lyapunov s’il admet une base de voisinages positivement invariants, i.e. satisfaisant . Un quasi-attracteur est une classe de récurrence par chaînes stable au sens de Lyapunov, mais la réciproque est fausse en général.
1.4 Hyperbolicité
Un ensemble invariant par est hyperbolique s’il existe une décomposition du fibré tangent au-dessus de en deux sous-fibrés linéaires invariants par l’application tangente et un entier tels que pour tout on a333 Nous pouvons bien sûr remplacer par n’importe quelle constante strictement supérieure à , mais nous avons fait ce choix par cohérence avec la définition de l’exposant de Lyapunov (section 5.5).
| (1.4.1) |
La dimension du fibré stable est appelée indice de .444Certains auteurs appellent au contraire indice la dimension du fibré instable.
Plus généralement, un ensemble compact invariant est dit hyperbolique (à indice variable) s’il admet une partition en ensembles hyperboliques.
L’ensemble stable (resp. instable ) d’un point appartenant à un ensemble hyperbolique est une sous-variété injectivement immergée de , tangente à (resp. ).
Une orbite périodique hyperbolique est un puits (resp. une source ) si son ensemble stable (resp. instable) contient un voisinage de l’orbite. Dans les autre cas, on dit que l’orbite périodique hyperbolique est une selle.
1.5 Classes homoclines
Deux orbites périodiques hyperboliques sont dites homocliniquement reliées555On devrait dire transversalement homocliniquement reliées. si la variété stable de coupe transversalement la variété instable de pour et . En particulier, leur indices coïncident.
La classe homocline d’une orbite périodique hyperbolique est l’adhérence de l’ensemble des points d’intersection transverse entre les variétés stables et instables de . En utilisant le lemme d’inclinaison (le “-lemma”, voir [107, proposition 2.5]) et le théorème homocline de Smale (voir [107, théorème 2.3]), Newhouse a montré [104] que c’est aussi l’adhérence de l’ensemble des orbites périodiques hyperboliques homocliniquement reliées à . La classe homocline est dite triviale lorsqu’elle est réduite à .
Remarquons que les classes homoclines de deux orbites périodiques hyperboliques distinctes peuvent s’intersecter sans coïncider. Chaque classe homocline est un ensemble compact invariant transitif. Plus précisément, il existe toujours au moins une mesure de probabilité invariante ergodique dont le support coïncide avec (voir [4, théorème 3.1]).
1.6 Difféomorphismes hyperboliques
Un difféomorphisme satisfait l’axiome A si l’ensemble non-errant est hyperbolique et coincide avec l’adhérence des points périodiques de . D’après, le théorème de décomposition spectrale de Smale, il existe une décomposition disjointe
en ensembles hyperboliques compacts transitifs localement maximaux666 est localement maximal s’il possède un voisinage tel que ., appelés ensembles basiques de . Chaque ensemble est une classe homocline et réciproquement toute classe homocline de est un ensemble basique.
Un difféomorphisme qui satisfait l’axiome possède un cycle s’il existe une suite d’ensembles basiques tels que et se rencontrent hors de lorsque , et lorsque . Lorsque n’a pas de cycle, et les ensembles basiques sont aussi les classes de récurrence par chaînes de .
Réciproquement, on montre facilement à l’aide du lemme de pistage qu’un difféomorphisme dont l’ensemble récurrent par chaînes est hyperbolique vérifie l’axiome A et n’a pas de cycle. Ceci justifie la définition suivante.777Cette définition n’est pas standard. On lit en général “difféomorphisme axiome A sans cycle”.
Définition 1.3.
Un difféomorphisme est hyperbolique si est hyperbolique, ou de façon équivalente s’il satisfait l’axiome A et n’a pas de cycle.
Puisque l’ensemble récurrent par chaînes varie semi-continûment supérieurement avec , les difféomorphismes hyperboliques forment une partie ouverte de .
Exemples 1.4.
-
1.
Un difféomorphisme hyperbolique pour lequel coïncide avec est un difféomorphisme d’Anosov. C’est le cas du difféomorphisme du tore induit par l’action de l’automorphisme linéaire .
-
2.
Le temps du flot associé au champ de gradient d’une fonction de Morse est un difféomorphisme hyperbolique : les ensembles basiques sont les points critiques de . Lorsque toutes les valeurs critiques de sont simples, est une fonction de Lyapunov au sens du théorème 1.1 de Conley. La figure 1.1 montre une filtration associée.
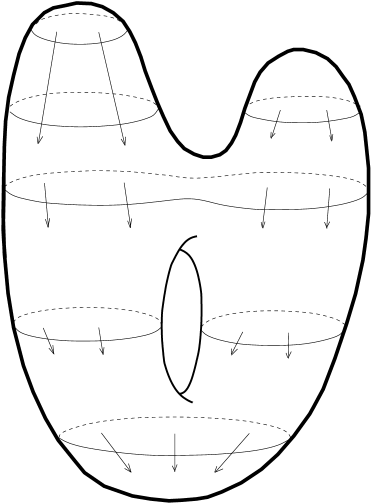
Smale a donné [165] une généralisation de l’exemple précédent.
Définition 1.5.
Un difféomorphisme est Morse-Smale si est fini, hyperbolique et si pour tous points , l’intersection est transverse : pour tout point dans l’intersection, .
L’ensemble des difféomorphismes Morse-Smale est ouvert [121].
Chapter 2 Techniques de perturbations, généricité
Afin d’obtenir des propriétés satisfaites par des ensembles denses de difféomorphismes, il est naturel de s’intéresser aux propriétés des difféomorphismes génériques. La difficulté pour montrer qu’une propriété est générique reste bien souvent la densité : elle requiert de savoir perturber dans .
Nous introduisons dans ce chapitre une technique de perturbation d’orbites en topologie , due à Pugh. Elle permet d’obtenir par un argument combinatoire (que nous pensons plus simple que l’argument initial de Pugh [135, 142]) le lemme de fermeture de Pugh (le “closing lemma”). Elle permet également d’obtenir les autres résultats de connexion d’orbites, en particulier le lemme de connexion d’Hayashi (le “connecting lemma”) présenté en fin de chapitre.
Le lemme de fermeture est particulièrement important puisqu’il assure l’existence d’orbites périodiques pour les difféomorphismes -génériques : un grand nombre de propriétés dynamiques s’énoncent ou se démontrent en s’appuyant sur les orbites périodiques.
2.1 Notions de généricité, de robustesse
Un ensemble de difféomorphismes est -générique, pour , s’il contient un Gδ dense de . Une propriété est -générique si elle est satisfaite par un ensemble -générique.
Puisque est un espace de Baire, une intersection dénombrable de parties -génériques est encore -générique.
Un difféomorphisme vérifie une propriété de façon robuste si cette propriété est satisfaite par tous les difféomorphismes proches de .
2.2 Mise en transversalité : difféomorphismes de Kupka-Smale
L’une des premières propriétés de généricité a été montrée par Kupka et Smale [82, 167]. En appliquant le théorème de transversalité de Thom (disponible en régularité , ), on peut perturber tout difféomorphisme pour supprimer les points fixes non hyperboliques. Plus généralement, on obtient le théorème suivant (voir [118]).
Théorème 2.1 (Kupka-Smale).
Chaque espace , contient un Gδ dense formé de difféomorphismes vérifiant les deux propriétés suivantes.
-
–
Toutes les orbites périodiques de sont hyperboliques.
-
–
Pour tous points périodiques de , les variétés stables et instables sont transverses, i.e. pour tout .
Un difféomorphisme vérifiant ces deux propriétés est appelé difféomorphisme Kupka-Smale. En particulier pour tout , l’ensemble de ses points périodiques de période inférieure à est fini.
2.3 Perturbation ponctuelle de la différentielle : le lemme de Franks
Voici un résultat élémentaire, souvent utilisé pour modifier la différentielle d’un difféomorphisme le long d’une orbite périodique, sans changer l’orbite.
Théorème 2.2 (Lemme de Franks [56]).
Pour tout voisinage de , il existe avec la propriété suivante.
Pour tout point et toute application linéaire telle que , il existe un difféomorphisme tel que :
-
–
et coïncident en et hors d’un voisinage arbitrairement petit de ;
-
–
.
Ce résultat permet de rendre hyperbolique une orbite périodique par petite perturbation . Avec le même argument, on peut aussi “linéariser” un difféomorphisme au voisinage d’un point, c’est-à-dire fixer une métrique riemannienne et demander que coïncide au voisinage de avec l’application . Ce résultat est bien sûr propre à la topologie .
2.4 Modification élémentaire d’une orbite
On souhaite fréquemment modifier une orbite d’un difféomorphisme . Dans les cas les plus simples, on considère deux points proches , et l’on cherche un difféomorphisme proche de pour lequel l’image de n’est plus mais . On contrôle la taille du support à l’aide du lemme élémentaire suivant (voir [13]).
Lemme 2.3 (Perturbation élémentaire).
Pour tout voisinage d’un difféomorphisme , il existe et vérifiant la propriété suivante : pour tous points , contenus dans une boule de raynon , il existe envoyant sur et coincidant avec hors de la boule .
Pourquoi travailler en topologie ?
Une telle perturbation s’obtiendrait très facilement en topologie avec un support localisé autour d’un chemin quelconque joignant à . Les régularités supérieures font apparaître des contraintes sur la taille du support de perturbation.
En topologie , si l’on cherche une perturbation de l’identité vérifiant et , pour tout point on obtient :
Le support de la perturbation contient donc une boule de rayon . Le lemme 2.3 nous montre en revanche que la taille du support ne dégénère pas aux petites échelles : l’uniformité de par rapport au couple sera essentielle pour les utilisations futures.
En topologie supérieure, on perd cette uniformité. Ceci explique pourquoi les démonstrations des énoncés perturbatifs que nous présentons dans les sections suivantes sont spécifiques à la topologie , ainsi que les difficultés que l’on a à perturber en régularité , .
Quelle est la difficulté à travailler en topologie ?
La constante dans le lemme 2.3 explose lorsque le voisinage décroît. Ceci constitue la principale difficulté des perturbations en topologie . Si l’on suppose par exemple que est un itéré futur de , on peut espérer utiliser le lemme 2.3 pour fermer l’orbite de . Cette idée simple ne fonctionne pas en général puisque le support risque de contenir un itéré futur de antérieur à et la perturbation risque de briser la connexion entre et . On voit ainsi l’intérêt de travailler avec des perturbation de support aussi petit que possible.
2.5 Modification progressive d’une orbite : le lemme de Pugh
Pugh a élaboré une technique de perturbation en topologie qui permet de supposer la constante du lemme 2.3 petite, quelle que soit la taille des perturbations. L’idée est de répartir la perturbation dans le temps : le difféomorphisme peut être perturbé successivement dans des domaines disjoints. Puisque l’on travaille désormais avec de grands itérés de la dynamique, le domaine supportant la perturbation subit une déformation et ce sont maintenant des ellipsoïdes qui jouent le rôle des boules apparaissant au lemme 2.3. Il sera plus commode par la suite de travailler avec des parallélépipèdes. On introduit donc la définition suivante.
Définition 2.4.
Si est une carte de , nous appelons cube de tout ensemble tel que soit l’image d’un cube par une translation de ; la quantité est le rayon du cube. Si le cube homothétique à de rayon et de même centre est encore contenu dans , nous noterons sa pré-image par .
Voici l’énoncé fondamental permettant les modifications d’orbites en topologie .
Théorème 2.5 (Lemme de perturbation, Pugh).
Pour tout voisinage de et tous , il existe un entier et, en tout point , une carte avec la propriété suivante.
Pour tout cube de , disjoint de ses -premiers itérés, et tous points , il existe vérifiant :
-
–
;
-
–
coïncide avec hors de l’union des avec ;
-
–
pour tout , le point appartient à ;
-
–
et coïncident sur pour hors d’une boule centrée en et de rayon inférieur à fois la distance entre et le complémentaire de .
Remarque 2.6.
La perturbation de est obtenue en composant des perturbations élémentaires (au sens du lemme 2.3) centrée aux différents points , .
C’est essentiellement cet énoncé que l’on retrouve dans les différents travaux traitant du “lemme de fermeture” de Pugh (voir [135, 137, 85, 90, 142]). La version que nous donnons ici est légèrement plus uniforme (en particulier ne dépend pas du point ) et correspond à [22, théorème A.2] (voir aussi [180]). Pour la démonstration, il suffit de travailler avec la suite d’applications linéaires , . En effet, le support de la carte est choisi très petit de sorte que les premiers itérés de sur sont proches d’une suite d’applications linéaires. La preuve initiale de Pugh a été simplifiée par Mai [91] (voir aussi [13]). Nous renvoyons à [184] pour une démonstration digeste de ce théorème.
2.6 Fermeture d’orbites : le “closing lemma”
Nous pouvons déduire du théorème 2.5 le célèbre “closing lemma” de Pugh.
Théorème 2.7 (Lemme de fermeture, Pugh).
Pour tout voisinage de et tout , il existe pour lequel est un point périodique.
À notre connaissance, il n’y a pas dans la littérature de démonstration directe du théorème de Pugh à l’aide du lemme de perturbation (par exemple, la démonstration de [142] requiert de modifier la géométrie des cubes de perturbation). Nous en proposons une, de nature combinatoire.
Proof.
Fixons tel que , , où est la dimension de la variété. La constante ne jouera pas de rôle et sera prise égale à . Considérons un entier et une carte au voisinage de , donnés par le théorème 2.5 appliqué à un voisinage de plus petit que . Nous pouvons supposer que n’est pas périodique et donc que est disjoint de ses premiers itérés.
Puisque est non-errant, il existe deux points proches de tels que soit un itéré futur de . Nous considérons deux cubes et de tels que contienne et . Soit l’ensemble (fini) des itérés intermédiaires entre et contenus dans . Nous construisons
-
–
des paires de points de tels que est un itéré futur de ,
-
–
des cubes de tels que le cube contienne et ,
de sorte que soit contenu dans et de rayon moitié.
La construction se fait par récurrence (voir la figure 2.1). Puisque est fini, elle s’arrête en temps fini.
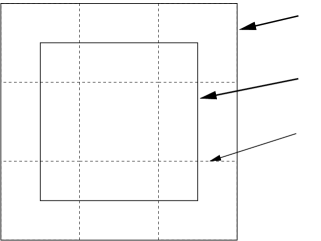
Nous allons voir que l’arrêt correspond à l’existence de points et d’un cube de tels que :
-
1.
pour un entier ;
-
2.
appartiennent à ;
-
3.
les itérés intermédiaires , n’appartiennent pas à .
Le théorème 2.5 permet alors de trouver un difféomorphisme tel que est périodique. Puisque est arbitrairement proche de , il existe conjugué à tel que est périodique.
Il reste à expliquer comment construire à partir de . Le triplet vérifie les propriétés 1 et 2. S’il ne vérifie pas 3, il existe un itéré intermédiaire entre et qui appartient à . Le triplet vérifie alors les propriétés 1 et 2. On peut répéter la construction tant que l’on ne parvient pas à satisfaire aux trois propriétés. On obtient ainsi une suite de triplets pour . Puisque , les points appartiennent tous à . Le cube est réunion de cubes de rayon moitié du rayon de . Puisque , il existe donc deux points et qui sont contenus dans un même de ces cubes, noté . Nous notons et ces points et posons . ∎
2.7 Exemple de démonstration de généricité : le théorème de densité de Pugh
Nous montrons à présent comment déduire un résultat de généricité (ici le théorème de densité de Pugh [136]) d’un énoncé perturbatif.
Corollaire 2.8 (Pugh).
Il existe un Gδ dense de tel que l’ensemble des points périodiques de tout difféomorphisme est dense dans l’ensemble non-errant .
La démonstration utilise la propriété classique suivante des espaces de Baire (voir [83]).
Proposition 2.9.
Soit un espace de Baire, un espace compact métrique et une application semi-continue inférieurement ou semi-continue supérieurement, à valeur dans l’espace des sous-ensembles compacts de , muni de la topologie de Hausdorff. Alors, l’ensemble des points de continuité de contient un Gδ dense de .
En d’autres termes,
-
–
si pour tout ouvert de , l’ensemble est ouvert, alors pour tout dans un Gδ dense de et pour tout voisinage de , l’ensemble est un voisinage de ;
-
–
si pour tout ouvert de , l’ensemble est ouvert, alors pour tout dans un Gδ dense de et pour tout voisinage de , l’ensemble est un voisinage de .
Démonstration du corollaire 2.8.
Soit un Gδ dense de difféomorphismes dont les points périodiques sont tous hyperboliques (donné par le théorème 2.1 de Kupka-Smale). C’est un espace de Baire. Soit l’application qui associe à tout difféomorphisme l’adhérence de ses points périodiques. Chaque point périodique possède une continuation hyperbolique et par conséquent est semi-continue inférieurement. D’après la proposition 2.9 et le théorème de Baire, l’ensemble de ses points de continuité contient un Gδ dense de .
Pour nous devons montrer que et coïncident. Nous avons bien sûr l’inclusion . Considérons un point et un voisinage ouvert de . Le lemme de fermeture donne l’existence d’un difféomorphisme proche de tel que est périodique. Par perturbation (donnée par le lemme de Franks, théorème 2.2), on peut supposer que est hyperbolique ; l’orbite de peut donc être suivie par perturbation, il existe donc proche de et de ayant un point périodique arbitrairement proche de . Puisque , on en déduit que appartient à . Le voisinage étant arbitraire, ceci permet de conclure . Par conséquent . ∎
2.8 Connexions d’orbites : le “connecting lemma”
Considérons deux points périodiques hyperboliques et supposons que la variété instable de et la variété stable de aient un point d’accumulation commun . Peut-on par perturbation créer une orbite hétérocline entre et ? Cette question se pose naturellement lorsque l’on cherche à caractériser les difféomorphismes structurellement ou -stables (voir [72]) et a été contournée dans ce cadre par Mañé [97]. Lorsque n’est pas périodique, la réponse a finalement été apportée par Hayashi [70] trente ans après la démonstration du lemme de fermeture.
Théorème 2.10 (Lemme de connexion, Hayashi).
Soit un voisinage de et trois points tels que :
-
–
les ensembles d’accumulation des orbites future de et passée de contiennent ;
-
–
le point n’est pas périodique.
Il existe alors tel que est un itéré futur de .
Ce résultat est également démontré dans [14, 185]. Il y a eu de nombreuses conséquences, voir par exemple [28, 14, 71, 44, 99, 15, 59] et la section 3.3. L’hypothèse que n’est pas périodique sert dans la démonstration à placer en un cube perturbatif (fourni par le théorème 2.5) disjoint d’un grand nombre d’itérés.
Pourquoi est-il plus difficile de connecter que de fermer ?
Les lemmes de fermeture et de connexion semblent proches. Si l’on reprend la démonstration du lemme de fermeture, on place en une carte fournie par le théorème 2.5 et dont le support est disjoint de premiers itérés. On considère un itéré futur de et un itéré passé de , proches de . Comme pour le lemme de fermeture, nous ne pouvons pas directement perturber et construire un difféomorphisme tel que , puisqu’une telle perturbation risque de briser les segments d’orbites entre et et entre et : nous ne serions pas certains que soit sur l’orbite positive de .
Fixons un voisinage de disjoint de ses premiers itérés. L’idée naturelle serait de trouver comme dans l’argument combinatoire de la section 2.6, deux itérés intermédiaires entre et et entre et , et un cube de la carte les contenant, tels que le cube ne contiennent pas d’autre itéré de ou de . Pour cela, nous devons considérer l’ensemble de tous les itérés intermédiaires de et proches de . Une difficulté nouvelle apparaît alors : nous devons sélectionner une paire de points de , mais à la différence du lemme de fermeture, cette paire doit contenir à la fois un itéré de et un itéré de . Les points de ne sont plus tous interchangeables et l’argument précédent ne fonctionne pas.
La stratégie d’Hayashi.
L’argument d’Hayashi consiste à sélectionner plusieurs paires qu’il faudra connecter simultanément : on simplifie l’ensemble des retours en effaçant certains points. Si une même orbite possède deux itérés (par exemple deux itérés et de ) qui seraient trop proches relativement à leur distance à la second orbite, nous pouvons dans ce cas considérer que ces deux points sont les mêmes, oublier les itérés intermédiaires entre ces deux points et espérer qu’une petite perturbation permettra de les connecter. En répétant cet argument, on sélectionne un grand nombre de paires de retour et nous devons appliquer, pour chacune d’elles, une perturbation donnée par le théorème 2.5. Une difficulté est de garantir que toutes ces perturbations ont des supports disjoints.
Plus précisément, notons et les itérés de et de proches de , i.e. appartenant à l’ensemble , et classés par ordre chronologique. On extrait ensuite une sous-suite de la forme de sorte qu’il existe pour chaque un difféomorphisme qui satisfait . Le support de est contenu dans un petit cube proche de et dans les premiers itérés de .
Supposons que :
-
1.
, ,
-
2.
pour tout , le point est le premier retour de l’orbite de dans un voisinage de .
-
3.
les supports des différentes perturbations sont deux à deux disjoints.
En composant l’ensemble des perturbations de , on obtient alors un difféomorphisme envoyant sur par itérations positives. Après perturbation, le segment d’orbite entre et est plus court que la pseudo-orbite initiale , voir la figure 2.2.
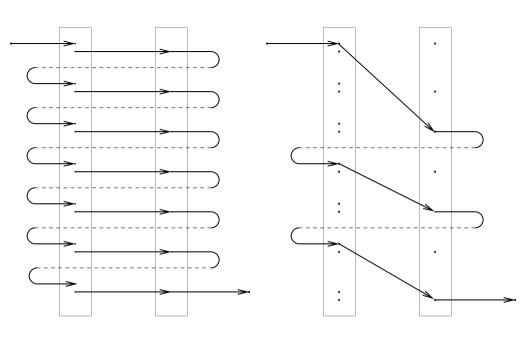
Le plus difficile est de choisir la sous-suite . Elle s’obtient après deux sélections.
Première sélection : les cubes quadrillés
Nous pavons tout d’abord un voisinage de par des cubes de la carte , comme illustré en figure 2.3. Le voisinage lui-même est un cube et le cube central du pavage contient . Nous pouvons supposer que les itérés et de et de sont contenus dans . Nous notons l’ensemble des retours furturs de et passés de dans . Le pavage permet de déterminer s’il y a accumulation de points de dans une région du cube .
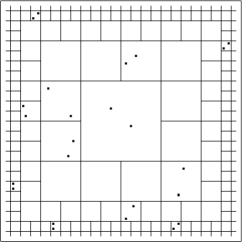
Nous extrayons une première sous-suite de satisfaisant les propriétés 1 et 2 ci-dessus, de sorte que
-
–
pour tout , les points et appartiennent à une même tuile du pavage de ,
-
–
chaque tuile du pavage contient au plus une paire .
Nous avons utilisé ici de façon essentielle que les points et appartiennent à une même tuile du pavage. La suite extraite est représentée en figure 2.3.
En appliquant le théorème 2.5, on définit alors une suite de perturbations telles que . Elle ne permet pas de conclure la démonstration : si appartiennent à une tuile du pavage, le support de la perturbation est contenu dans le cube et dans ses premiers itérés. S’il existe deux perturbations associées à deux tuiles adjacentes, les supports des perturbations correspondantes risquent de s’intersecter et nous ne pouvons pas composer les perturbations.
Seconde sélection : les raccourcis.
Supposons que le support de deux perturbations et définies ci-dessus se chevauchent (remarquons que les supports peuvent être disjoints dans et se chevaucher dans des itérés pour certains ). Cela implique que les points (dans la tuile ) et les points (dans la tuile ) ont des images proches pour un itéré . Nous fixons un tel entier et nous supposerons .
Afin de résoudre le conflit, nous remplaçons les deux perturbations qui envoient respectivement sur et sur , par une seule perturbation envoyant sur (figure 2.4) : il suffit pour cela de conserver la perturbation sur les itérés pour , de conserver la perturbation sur les itérés pour , et d’utiliser sur une perturbation élémentaire qui envoie sur . À l’issue de cette construction, on efface les paires de points intermédiaires avec de la suite , pour obtenir une nouvelle pseudo-orbite qui joint à . En d’autres termes, nous avons réalisé un raccourci au sein de la pseudo-orbite obtenue après la première sélection.
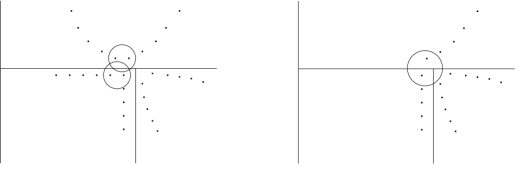
Les supports des perturbations et sont contenus dans des boules de rayon fois plus petites que les distances et respectivement. En ayant choisi et suffisamment petits, on en déduit que les tuiles et sont adjacentes et que le support de la nouvelle perturbation reste petit par rapport aux tailles des tuiles et de leur premiers itérés.
Nous poursuivons ces modifications tant que subsiste des conflits entre perturbations. Remarquons qu’à chaque fois qu’un conflit est levé, nous obtenons une nouvelle perturbation de support légèrement plus large que le support des perturbations précédentes. Par conséquent le support de la nouvelle perturbation peut à son tour rencontrer le support d’une troisième perturbation . On peut se demander si le nombre de conflits successifs que l’on rencontre peut être arbitrairement grand, de sorte que le support de la perturbation finale devienne bien plus important que la taille de la tuile initiale .
Ce n’est pas le cas : nous contrôlons a priori la taille des perturbations si bien que les conflits qui apparaissent sont toujours associés à des tuiles adjacentes à la tuile initiale . Puisque a géométrie du pavage est uniforme, le nombre de tuiles adjacentes à est borné (par ) et partant de la perturbation initiale , il y aura au plus conflits à résoudre. Si l’on choisi la constante suffisamment petite, le support perturbation que l’on obtient après conflits reste petit par rapport à la taille de la tuile , justifiant ainsi le contrôle a priori des perturbations (voir la figure 2.5).
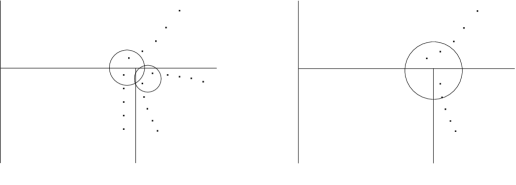
Après traitement des différents conflits, nous obtenons une nouvelle pseudo-orbite, une nouvelle suite et une collection de perturbations dont les supports sont deux-à-deux disjoints et telle que pour tout on ait .
2.9 Espaces de perturbation
Les perturbations réalisées dans la preuve du lemme de Pugh et des différents lemmes de perturbations qui en découlent sont une succession de perturbations élémentaires données par le lemme 2.3 et de supports disjoints : nous appelons support d’un difféomorphisme l’ensemble des points tels que ; le support d’une perturbation de est le support du difféomorphisme .
Cette remarque permet de travailler en restant dans des sous-espaces de , pourvu que les deux propriétés suivantes soit vérifiées.
-
–
Le lemme 2.3 de perturbation élémentaire s’applique au sein de .
-
–
Tout difféomorphisme possède une base de voisinages flexibles, i.e. satisfaisant pour tous difféomorphismes à supports disjoints
En particulier, le lemme de Pugh reste vrai si l’on travaille avec des difféomorphismes conservatifs (i.e. vérifiant une forme volume ou symplectique), ou même avec des difféomorphismes de classe , , pourvu que la topologie considérée soit la topologie .
2.10 Problèmes
Il existe très peu de résultats perturbatifs en classe , .
Question 2.11.
Existe-t-il un lemme de fermeture en régularité supérieure ?
Des difficultés ont été mises en évidence [138, 65, 75, 74, 76]. Des cas particuliers ont été traités [139], ainsi que le cas des flots sur les surfaces [126, 66, 67].
On peut se demander quels résultats persistent pour la dynamique des endomorphismes, i.e. des applications différentiables non injectives. Wen a étendu le lemme de fermeture à ce cadre [179], mais il n’existe pas de lemme de connexion.
Question 2.12.
Existe-t-il un lemme de connexion pour les endomorphismes ?
Pour les difféomorphismes, le lemme de connexion reste valide lorsque est périodique, si son orbite est hyperbolique, ou plus généralement s’il n’y a pas de résonance non triviale entre ses valeurs propres (voir la remarque 3.2 plus bas). Il serait intéressant pour les applications de ne plus avoir d’hypothèse sur le point .
Question 2.13.
Le lemme de connexion reste-t-il vérifié lorsque le point est périodique ?
Hayashi a montré [71] un “make or break lemma” : si l’orbite future de et l’orbite passée de ont un point d’accumulation commun , on peut alors perturber la dynamique en topologie pour disjoindre ces ensembles d’accumulation, ou bien pour que soit un itéré de .
Chapter 3 Connexions de pseudo-orbites
Nous présentons le lemme de connexion pour les pseudo-orbites démontré dans [22, 16]). La démonstration nécessite de construire une section de la dynamique : on énonce pour cela un théorème d’existence de “tours topologiques”, qui peut être utile pour d’autres applications (voir par exemple le chapitre 11).
3.1 Énoncé du lemme de connexion pour les pseudo-orbites
Rappelons que si est un ensemble compact et deux points, nous notons lorsque pour tout il existe une -pseudo-orbite avec et contenue dans .
Théorème 3.1 (Lemme de connexion pour les pseudo-orbites, Bonatti-Crovisier ).
Soit un voisinage d’un difféomorphisme dont les points périodiques sont hyperboliques. Pour tous points satisfaisant , il existe une perturbation de et tels que .
Remarques 3.2.
-
1.
Si l’on considère un ensemble compact tel que , alors pour tout voisinage on peut demander que la perturbation soit à support dans .
-
2.
Dans [16], nous avons affaibli l’hypothèse sur le difféomorphisme. Il suffit de supposer que pour toute orbite périodique, il n’y a pas de résonance non triviale au sein des valeurs propres de module .
Plus précisément, pour toute orbite périodique, il n’y a pas de valeur propre qui soit racine de l’unité, les valeurs propres de module sont simples, et il n’y a pas de relation de la forme
où les sont des entiers strictement positifs et les sont des valeurs propres de module toutes distinctes.
3.2 Idée de la preuve
On ne peut clairement pas espérer connecter deux points liés par des pseudo-orbites en effectuant simplement une perturbation locale : nous allons devoir perturber indépendemment dans plusieurs régions en utilisant les cubes quadrillés fournis par la démonstration du lemme de connexion d’Hayashi. En s’assurant que les supports des différentes perturbations sont disjoints, la section 2.9 garantit que la perturbation finale reste petite.
a) Les domaines de perturbations
Considérons une carte . Un domaine quadrillé selon les coordonnées de est la donnée d’un ouvert et d’une famille de cubes de (appelés tuiles du domaine) tels que
-
1.
les intérieurs des tuiles sont deux à deux disjoints ;
-
2.
l’union des tuiles de est égale à ;
-
3.
la géométrie du quadrillage est bornée, i.e.
-
–
le nombre de tuiles est uniformément borné (par ) au voisinage de chaque point,
-
–
pour toute paire de tuiles adjacentes, le rapport de leur rayon est uniformément borné (par ).
-
–
Par une construction standard, tout ouvert peut être quadrillé selon les cordonnées de (voir la figure 3.1).

Une pseudo-orbite est à sauts dans les tuiles du domaine quadrillé si pour tout les points coïncident ou appartiennent à une même tuile de .
Finalement, si l’on fixe un voisinage de , un domaine quadrillé et un entier , on dit que est un domaine de perturbation pour si :
-
1.
est disjoint de ses premiers itérés par ;
-
2.
pour toute pseudo-orbite avec et à sauts dans les tuiles , il existe une perturbation de à support dans et un entier tel que .
Le lemme de perturbation de Pugh (théorème 2.5) et le lemme de connexion d’Hayashi (théorème 2.10) assurent l’existence de domaines de perturbation.
Théorème 3.3 (Existence de domaines de perturbation).
Pour tout voisinage de , il existe un entier et, en tout point , il existe une carte tels que pour tout domaine quadrillé selon les coordonnées de qui est disjoint de ses premiers itérés, est un domaine de perturbation de .
Le fait que l’entier ne dépende pas du point sera crucial dans la suite de la démonstration du théorème 3.1.
b) Les tours topologiques
Afin de traiter des pseudo-orbites arbitraires, nous devons être en mesure de construire une collection de domaines de perturbation deux à deux disjoints qui couvrent l’espace des orbites de la dynamique. Le résultat suivant permet de construire une telle section de la dynamique.
Théorème 3.4 (Tours topologiques, Bonatti-Crovisier).
Il existe (ne dépendant que de la dimension de la variété ) tel que pour tout et tout difféomorphisme n’ayant pas de point périodique non hyperbolique de période inférieure à , il existe un ouvert et un ensemble compact ayant les propriétés suivantes :
-
–
tout point qui n’est pas périodique de période inférieure à possède un itéré dans ;
-
–
les ouverts sont deux à deux disjoints
On peut choisir pour que le diamètre de ses composantes connexes soit arbitrairement petit.
La démonstration utilise le lemme de transversalité de Thom et se ramène à un problème combinatoire (exprimé en termes de coloriage).
c) Lorsqu’il n’y a pas d’orbite périodique de basse période
Le lemme de perturbation de Pugh donne un entier et permet de couvrir la variété par une famille finie de cartes . Nous supposerons pour simplifier que n’a pas de point périodique de période inférieure à . Fixons deux points tels que .
Considérons un ouvert disjoint de itérés et un ensemble compact donnés par le théorème 3.4. Quitte à remplacer par ou par , les points n’appartiennent pas à . Puisque les composantes de sont de diamètre petit, nous pouvons supposer que chacune d’entre elles est contenue dans l’une des cartes . Finalement, nous quadrillons chaque composante de selon une des cartes et nous construisons ainsi :
-
–
une famille de domaines de perturbations tels que sont disjoints pour tous et tous ,
-
–
une famille finie de tuiles contenue dans l’union des tuiles des domaines , ,
tels que toute orbite rencontre l’une des tuiles de .
En travaillant plus, on obtient par un argument de compacité :
-
–
pour chaque tuile , un ensemble compact ,
-
–
un entier et une constante tels que toute -pseudo-orbite de longueur rencontre l’un des ensembles .
Considérons une -pseudo-orbite . Si n’est pas déjà un itéré positif de , en prenant suffisamment petit, nous pouvons supposer que la pseudo-orbite est de longueur supérieure à . Nous pouvons différer les sauts de la pseudo-orbite (sur des intervalles de temps inférieurs à ) et supposer qu’il n’ont lieu qu’aux points appartenant aux ensembles compacts . Si a été choisi petit, ceci assure la propriété suivante.
Lemme 3.5.
Il existe une pseudo-orbite entre et à sauts dans les tuiles des domaines quadrillés .
Il ne reste plus qu’à perturber successivement dans chaque domaine de perturbation pour supprimer finalement l’ensemble des sauts de la pseudo-orbite et obtenir une segment d’orbite (en général plus court) qui joint à .
d) Lorsqu’il y a des points périodiques
En présence de points périodiques de basse période, la tour topologique ne couvre plus l’ensemble des orbites. De plus, lorsqu’une orbite s’approche d’une orbite périodique, le temps de retour dans la tour peut devenir arbitrairement long.
Dans ce cas, on utilise à nouveau que les points périodiques sont hyperboliques. Il existe une version du théorème 3.4 autorisant l’existence de points p{eriodiques hyperboliques de petite période: il s’applique aux points qui n’appartiennent pas aux variétés invariantes des points périodiques de petite période. On rajoute de nouveaux domaines de perturbations qui couvrent des domaines fondamentaux des ensembles stables et instables des orbites périodiques de basse période. Le lemme 3.5 est encore vérifié, ce qui permet de conclure comme dans le cas précédent.
3.3 Conséquences immédiates
Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes pour lesquel les propriétés suivantes sont vérifiées.
a) Lieu de récurrence.
Les ensembles , et coïncident.
Il n’y a donc qu’une seule notion de récurrence. Rappelons que le lemme de fermeture de Pugh permettait déjà de conclure .
b) Ordre dynamique.
Pour tout ensemble compact , les relations et coïncident.
En particulier, les ensembles faiblement transitifs et les ensembles transitifs par chaînes coïncident ; les classes de récurrence par chaînes sont les ensembles faiblement transitifs maximaux. On en déduit aussi que la relation est transitive (ce qui avait été montré précédemment par Arnaud [14], Gan et Wen [59]).
c) Quasi-attracteurs.
L’ensemble des points dont l’ensemble -limite (i.e. l’ensemble des valeurs d’adhérence de son orbite future) est un quasi-attracteur contient un Gδ dense de .
Les quasi-attracteurs sont exactement les classes de récurrence par chaînes stables au sens de Lyapunov.
Une classe homocline est un quasi-attracteur si et seulement elle contient la variété instable de .
Ceci répond à une conjecture de Hurley [79] dans le cas et améliore des résultats antérieurs de Arnaud [14], Morales et Pacifico [99].
Comme conséquence, une classe de récurrence par chaînes d’intérieur non vide est un quasi-attracteur à la fois pour et .
d) Classes homoclines et classes apériodiques.
Les classes de récurrence par chaînes contenant une orbite périodique sont des classes homoclines.
Si sont deux orbites périodiques telles que et si l’indice de est inférieur ou égal à celui de , alors et ont un point d’intersection transverse :
Les classes de récurrence par chaînes sans orbite périodique sont appelées classes apériodiques.
On obtient facilement d’autres propriétés.
-
–
Toute composante connexe de est entièrement contenue dans une classe homocline.
-
–
Deux classes homoclines sont toujours disjointes ou confondues.
-
–
Si deux orbites périodiques et ont même indice et sont contenus dans une même classe de récurrence par chaînes, elles sont homocliniquement reliés.
-
–
Si et ont des indices différents et sont contenues dans une même classe de récurrence par chaînes, il existe une perturbation de telle que les continuations hyperboliques de et forment un “cycle hétérodimensionnel” : la variété instable de l’une rencontre la variété stable de l’autre (voir la section 8.2).
e) Classes isolées.
Toute classe de récurrence par chaînes isolée dans est une classe homocline . Pour tout difféomorphisme proche de , la classe de récurrence par chaînes contenant la continuation de est encore isolée.
Si n’a qu’un nombre fini de classes de récurrence par chaînes, tout difféomorphisme proche de a le même nombre de classes que .
3.4 Exemples
Les exemples connus de dynamiques -génériques non hyperboliques ont lieu en dimension supérieure ou égale à . Nous en citons quelques uns.
a) Dynamiques robustement transitives.
Il existe des dynamiques non hyperboliques ayant une unique classe de récurrence par chaînes (voir la section 5.10).
Théorème 3.6 (Shub [159]).
Il existe un ouvert non vide de difféomorphismes transitifs et non hyperboliques.
Cet exemple est obtenu en modifiant un difféomorphisme d’Anosov. D’autres exemples similaires sur d’autres variété ont été donnés ensuite, voir [92, 40] et [34, chapitre 7]. Une autre méthode de construction, due à Bonatti-Díaz [27] consiste à perturber l’application “temps ” d’un flot d’Anosov ou à perturber le produit d’un difféomorphisme d’Anosov et de l’application identité d’une variété compacte.
b) Cycles hétérodimensionnels.
L’obstruction à l’hyperbolicité dans l’exemple précédent provient de l’existence (dans une même classe de récurrence par chaînes) de points périodiques d’indices différents. De tels exemples existent également pour des dynamiques qui ne sont pas transitives (voir la section 7.9).
Théorème 3.7 (Abraham-Smale [9], Simon [164], Bonatti-Díaz [28]).
Pour toute variété compacte de dimension , il existe un ouvert non vide de difféomorphismes non transitifs et deux familles continues de points périodiques hyperboliques , d’indices différents, ayant la même classe homocline pour tout .
c) Phénomène de Newhouse.
Newhouse a construit [103, 105] des exemples de difféomorphismes de surface -génériques ayant un comportement pathologique, aujourd’hui appelé phénomène de Newhouse : pour toute surface, il existe un ouvert non vide de l’espace des difféomorphismes de classe et un Gδ dense de tel que tout difféomorphisme possède une infinité de puits ou de sources. Bonatti et Díaz ont ensuite utilisé les mélangeurs pour obtenir le même résultat en topologie sur les variétés de dimension supérieure ou égale à (voir aussi la section 7.9).
Théorème 3.8 (Bonatti-Díaz [28]).
Pour toute variété compacte de dimension , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes ayant une infinité de puits et de sources.
d) Classes apériodiques.
Bonatti et Díaz ont également montré que les classes apériodiques peuvent apparaître parmi les difféomorphismes -génériques (voir aussi la section 8.6). Leur construction montre aussi que l’on peut trouver des classes de récurrence par chaînes (des classe homoclines ainsi que des classes apériodiques) qui sont accumulées en topologie de Hausdorff par des classes de récurrence par chaînes non triviales (ce ne sont pas des orbites périodiques isolées) ; pour ces dynamiques l’ensemble des classes de récurrence par chaînes est non dénombrable.
Théorème 3.9 (Bonatti-Díaz [29]).
Pour toute variété de dimension supérieure ou égale à , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes ayant un nombre non dénombrable de classes apériodiques.
e) Absence d’attracteurs.
Il est possible de garantir que tous les quasi-attracteurs sont accumulés par des sources : dans ce cas, il n’y a pas de classe de récurrence par chaînes qui est un attracteur.
Théorème 3.10 (Bonatti-Li-Yang [38]).
Pour toute variété de dimension supérieure ou égale à , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes n’ayant pas d’attracteur : il n’y a pas d’ouvert non vide attractif dont l’intersection des itérés est une classe de récurrence par chaînes.
3.5 Problèmes
Voici quelques questions formulées pour les dynamiques -génériques : nous demandons s’il existe un Gδ dense de sur lequel on peut donner une réponse affirmative à chacune d’entre elle.
a) Structure des classes apériodiques.
Rappelons que les classes homoclines sont toujours transitives.
Question 3.11.
Les classes apériodiques sont-elle toujours transitives ?
Les classes apériodiques décrites par [29] sont (voir la section 8.6) :
-
–
minimales et uniquement ergodiques (ce sont des odomètres),
-
–
Lyapunov stables pour et (ou “dynamiquement isolées”), i.e. il existe des voisinages ouverts arbitrairement petits de la classe apériodique vérifiant et .
On peut se demander si c’est toujours le cas.
b) Cardinalité de l’ensemble des classes de récurrence par chaînes.
Question 3.12.
Le nombre de classes de récurrence par chaînes est-il toujours fini ou infini non dénombrable ?
Les difféomorphismes présentant le phénomène de Newhouse sont souvent des exemples de dynamiques pour lesquels la cardinalité de l’ensemble des classes de récurrence par chaînes n’est pas connue : peut-il exister un difféomorphisme qui présente le phénomène de Newhouse et qui n’aurait qu’un nombre dénombrable de classes de récurrence par chaînes ?
c) Robustesse des classes isolées.
Une classe de récurrence par chaîne isolée dans est une classe homocline . Pour tout difféomorphisme proche de , la classe de récurrence par chaînes contenant la continuation hyperbolique de est encore isolée et pour tout difféomorphisme proche appartenant à un Gδ dense de , cette classe coïncide avec la classe homocline (voir [2]). Cette propriété deviendrait robuste si l’on parvenait à remplacer l’ensemble par un ensemble ouvert.
Question 3.13.
Pour toute classe homocline de isolée dans , existe-t-il un voisinage de tel que est encore isolée pour tout difféomorphisme ?
Ceci montrerait que les classe homoclines isolées sont des ensembles “robustement transitifs” au sens de [32].
d) Classes d’intérieur non vide.
Question 3.14.
Si est connexe, une classe de récurrence par chaînes d’intérieur non vide coïncide-t-elle avec ?
Nous avons montré [5] que c’est le cas en dimension deux. C’est aussi le cas lorsque la classe est isolée (voir Abdenur-Bonatti-Díaz [7]). En dimension supérieure des résultats partiels existent (voir [7], ou les travaux de Potrie et Sambarino [134, 133]), lorsque la classe est partiellement hyperbolique ou admet certaines décomposition dominées (voir le chapitre 5).
Une classe de récurrence par chaînes d’intérieur non vide est une classe homocline qui est stable au sens de Lyapunov pour et . Les classes apériodiques étudiées dans [29] sont stables au sens de Lyapunov pour et . Nous pouvons donc étendre la question précédente aux classe homoclines stables au sens de Lyapunov pour et (voir [133]).
e) Attracteurs.
Les exemples [38] de dynamiques sans attracteurs possèdent des attracteurs essentiels : ce sont des classes de récurrence par chaînes ayant un voisinage tel que l’orbite positive de tout point contenu dans un Gδ dense de s’accumule dans . De plus, l’union des bassins des attracteurs essentiels est dense dans la variété.
Question 3.15.
Existe-t-il toujours un attracteur essentiel ?
L’union des bassins des attracteurs essentiels contient-il un Gδ dense de ? un ensemble de mesure de Lebesgue totale ?
On peut aussi étudier les attracteurs essentiels. Remarquons que les classes apériodiques construites dans [29] sont des quasi-attracteurs dont le bassin est trivial.
Question 3.16.
Une classe homocline qui est un quasi-attracteur est-elle un attracteur essentiel ? (ou attire-t-elle un Gδ dense d’un ouvert non vide de ?)
Un attracteur essentiel est-il toujours une classe homocline ?
Chapter 4 Connexions globales
Le lemme de fermeture permet de construire des points périodiques dans tout ouvert qui rencontre l’ensemble non-errant, mais il ne donne pas de contrôle sur le support des orbites périodiques crées. Dans ce chapitre, nous répondons à la question suivante.
Étant donnés des ouverts , peut-on perturber la dynamique et obtenir une orbite périodique qui rencontre tous ces domaines ?
En s’appuyant sur le lemme de perturbation de Pugh, nous démontrons le lemme de fermeture ergodique de Mañé : lorsqu’il existe une mesure ergodique chargeant chaque ouvert, on peut créer une orbite périodique qui passe au moins une fraction de temps proche de dans pour tout .
Nous présentons également une propriété de pistage faible et donnons de nouvelles démonstrations de certains résultats issus de [48] : lorsqu’il existe un ensemble transitif par chaînes qui intersecte tous les , on peut obtenir une orbite qui visite chacun de ces ouverts (mais nous ne contrôlons pas la statistique des visites).
4.1 Approximation des mesures ergodiques par orbites périodiques : l’ “ergodic closing lemma”
Théorème 4.1 (Lemme de fermeture ergodique, Mañé).
Soit un voisinage de et une mesure de probabilité -invariante. Alors -presque tout point a la propriété suivante. Pour tout , il existe et tels que soit -périodique pour et tels que pour tout , on ait
En fixant le point et en faisant tendre vers , les orbites périodiques s’équidistribuent comme l’orbite de sous : lorsque est ergodique, elle convergent donc faiblement vers . Ce résultat est amélioré dans [4, Proposition 6.1] par un contrôle des exposants des mesures périodiques (voir la section 5.5).
Addendum 4.2 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
On peut demander dans la conclusion du théorème 4.1 que le exposant de Lyapunov de pour soit -proche du exposant de Lyapunov de pour .
On en déduit un résultat de généricité (voir [4, théorème 3.8]).
Corollaire 4.3.
Il existe un Gδ dense tel que toute mesure de probabilité ergodique pour un difféomorphisme est approchée faiblement par une suite de mesures invariantes portées par des orbites périodiques de . De plus, les orbites convergent vers le support de en topologie de Hausdorff et le vecteur de Lyapunov de converge vers le vecteur de Lyapunov de la mesure .
Nous donnons ci-après une démonstration du lemme de fermeture ergodique à partir du théorème 2.5 de Pugh. Pour montrer l’addendum 4.2, nous choisissons un point qui est régulier pour , i.e. dont l’espace tangent admet une décomposition satisfaisant le théorème d’Oseledets (voir la section 5.5). Dans une carte autour de , la différentielle peut s’écrire sous la forme , où est une isométrie de que l’on peut choisir dans un voisinage de l’identité. On prendra de sorte que pour tous , l’image de l’espace est dans un cône uniforme autour de . Pour une période suffisamment grande, ceci garantit que les exposants de Lyapunov de pour et sont proches.
Démonstration du lemme de fermeture ergodique (théorème 4.1).
Il suffit de fixer et de montrer que -presque tout point satisfait la conclusion du théorème 4.1 pour cette constante .
Nous pouvons supposer que n’est pas supportée par une orbite périodique : -presque tout point appartient au support de et n’est pas périodique. Fixons tel que et pour que et posons . Le théorème 2.5 pour nous donne un entier et une carte au voisinage de , telle que coïncide avec le cube standard et telle que les premiers itérés de par soient disjoints et de diamètre inférieur à . On note . Soit l’image par des points qui vérifient la conclusion du théorème. On doit montrer que .
Comme avant, les cubes de que nous considérons sont des images du cube standard par une homothétie-translation. Un bon cube est un cube de vérifiant et . Dans ce cas, il existe un ensemble ayant mesure plus grande que formé de points dont le premier retour dans est contenu dans . On peut alors appliquer le lemme de perturbation de Pugh (théorème 2.5) au cube de la carte pour obtenir un difféomorphisme tel que et coïncident le long de l’orbite et . En particulier .
Supposons par l’absurde que l’ensemble soit de mesure non nulle. On fixe grand et on considère le pavage de par des cubes d’intérieurs deux à deux disjoints et de taille . Par régularité de la mesure , on peut trouver une collection de cubes du pavage qui approxime :
-
–
d’une part pour tout ;
-
–
d’autre part l’union des cubes et l’union des cubes pour vérifient :
(4.1.1)
Remarquons que l’on peut “séparer” les cubes de la famille : il existe une partition de en familles de cubes tels que pour tous cubes appartenant à une même famille, les cubes sont d’intérieurs disjoint. Pour l’une de ces familles, l’union des cubes est de mesure supérieure à , donc quitte à remplacer par cette famille, (4.1.1) est toujours satisfaite et de plus,
| Pour tous , les cubes sont d’intérieurs disjoints. | (4.1.2) |
Nous utilisons maintenant le résultat suivant.
Affirmation.
Pour tout cube , il existe un cube tel que :
-
i)
(et en particulier ) ;
-
ii)
est un bon cube (et donc ) ;
-
iii)
.
Proof.
La preuve se fait par l’absurde : on construit par récurrence une suite de cubes satisfaisant et , pour tout . En particulier est contenu dans et la mesure des cubes est supérieure à et croît exponentiellement avec . C’est une contradiction.
On construit à partir de de la façon suivante : on divise en cubes de même rayon et d’intérieurs deux à deux disjoints. L’un d’eux, noté , est de mesure supérieure à . Les cubes , , vérifient donc (iii). Puisque , on a . Les cubes , , vérifient donc également (i). Par hypothèse, (ii) n’est donc pas satisfaite et on obtient pour tout ,
En posant , ceci implique
Ceci conclut la construction de la suite . ∎
Si l’on applique l’affirmation à chaque cube , on obtient donc un cube contenu dans l’intérieur de . D’après (4.1.2) et (i), les cubes sont deux à deux disjoints. En particulier, leur union vérifie d’après (ii) et (iii) :
Ceci contredit (4.1.1). La mesure de est donc pleine dans . Ceci achève la démonstration du lemme de fermeture ergodique. ∎
4.2 Approximation des ensembles transitifs par chaînes par orbites périodiques
Il est naturel de se demander si l’on peut approcher un ensemble transitif par chaînes par une orbite périodique, ou plus simplement par un segment d’orbite.
Une difficulté : les raccourcissements d’orbites.
Si la dynamique est générique, on peut supposer que est faiblement transitif. À l’aide du lemme de connexion, on peut assez facilement construire un segment d’orbite qui visite trois points quelconques : puisque est faiblement transitif, il suffit de connecter en un segment d’orbite joignant à avec un segment d’orbite joignant à . Une difficulté apparaît lorsque l’on cherche à connecter plus de points : si l’on connecte avec un segment d’orbite joignant à un quatrième point , nous n’obtenons en général pas une orbite qui visite les quatre points . En effet, si l’on applique le lemme de connexion, on obtient un segment d’orbite qui est souvent plus court que la concaténation des segments et (voir la section 2.8).
Nous avons montré dans [48] que de telles connexions globales peuvent être réalisées en prenant plus de précautions. Comme pour les lemmes de connexion précédents, nous avons besoin d’une hypothèse technique, un peu plus faible cette fois, sur les orbites périodiques du difféomorphisme.
-
(I) Pour tout entier , les points périodiques de période sont isolés dans .
Nous disons qu’un ensemble fermé invariant est une orbite faible si la relation est un ordre total sur , i.e. est transitive et pour tous points distincts on a ou (on peut avoir les deux relations à la fois et il peut exister des points tels que n’ait pas lieu). Par exemple l’adhérence, d’une orbite est toujours une orbite faible.
Théorème 4.4 (Lemme de connexion globale, Crovisier).
Soit un voisinage d’un difféomorphisme vérifiant (I). Pour tout , les propriétés suivantes sont satisfaites.
-
–
Pour tout ensemble faiblement transitif , il existe et une orbite périodique de qui est à distance de Hausdorff de inférieure à .
-
–
Pour toute orbite faible , il existe et une orbite de dont l’adhérence est à distance de Hausdorff de inférieure à .
On en déduit un lemme de pistage faible satisfait par les difféomorphismes -génériques.
Corollaire 4.5 (Pistage faible).
Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes vérifiant la propriété suivante.
Pour tout il existe tel que toute -pseudo-orbite est -proche d’un segment d’orbite fini pour la distance de Hausdorff.
Si de plus est périodique (i.e. ), on peut choisir périodique.
En particulier, on obtient l’approximation des ensembles transitifs par chaînes par orbites périodiques.
Corollaire 4.6.
Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes vérifiant les propriétés suivantes.
-
–
Un ensemble compact est transitif par chaînes si et seulement s’il est limite de Hausdorff d’une suite d’orbites périodiques.
-
–
Les classes apériodiques sont limites de Hausdorff de classes homoclines.
Arnaud avait montré dans un travail antérieur [15] que pour un difféomorphisme -générique, les ensembles -limites sont limite de Hausdorff d’orbites périodiques.
Le corollaire 4.5 donne aussi des informations sur la dynamique entre les classes de récurrence par chaînes : pour tout difféomorphisme -générique, si l’on considère une suite de classes de récurrence par chaînes , vérifiant pour tout , et des voisinages , il existe une orbite qui visite successivement chaque ouvert .
4.3 Démonstration du pistage faible
La démonstration du théorème 4.4 est assez délicate puisqu’elle requiert de perturber la dynamique en plusieurs endroits. Nous allons démontrer un résultat plus faible qui impliquera le corollaire 4.5.
Théorème 4.7 (Pistage faible, Crovisier).
Il existe un Gδ dense tel que, pour tout , pour tout ensemble fermé (non nécessairement invariant), pour tous points vérifiant , et pour tout , il existe un segment d’orbite contenu dans le -voisinage de qui rencontre chaque boule centrée en , , de rayon .
Si de plus on a , alors peut être choisi périodique.
Pour la suite, on introduira pour tout l’ensemble des parties compactes de (non nécessairement invariantes) qui sont limites de Hausdorff d’une suite de segments d’orbite finis ainsi que l’ensemble des parties compactes de (non nécessairement invariantes) qui sont limites de Hausdorff pour tout d’une suite de segments de -pseudo-orbites finis. Finalement désigne l’ensemble des parties compactes (invariantes) de qui sont limites d’une suite d’orbites périodiques et celles qui sont transitives par chaînes.
Démonstration du corollaire 4.5 à partir du théorème 4.7.
Considérons appartenant à l’ensemble résiduel donné par le théorème 4.7. Lorsque est fixé, il existe tel que tout segment de -pseudo-orbite est -proche d’un élément de . D’après le théorème 4.7, il existe un segment d’orbite fini de qui est -proche de pour la distance de Hausdorff. Ceci démontre la première partie du corollaire 4.5.
Le même argument montre que pour assez petit, toute -pseudo-orbite périodique est -proche d’un élément de . D’après le théorème 4.7, il existe une orbite périodique de qui est -proche de pour la distance de Hausdorff. ∎
Démonstration du théorème 4.7: le cas non récurrent..
L’application est semi-continue inférieurement sur . Il existe donc un Gδ dense de difféomorphismes qui sont des points de continuité de cette application, qui sont Kupka-Smale, et qui satisfont à la seconde propriété de la section 3.3 ( pour tout ensemble compact ). Nous considérons à présent un élément . Nous montrons la première partie du théorème par récurrence sur . Le cas est évident. Remarquons aussi que nous pouvons toujours supposer que les points appartiennent à des orbites distinctes (quitte à supprimer certains points) et supposer qu’ils ne sont pas périodiques (qui à les remplacer par des points proches, puisque est un difféomorphisme dont tous les points périodiques sont hyperboliques).
Considérons points de . Nous devons montrer qu’ils sont contenus dans un élément inclus dans . Puisque est un point de continuité de l’application , il suffit de trouver pour tout et tout voisinage de un difféomorphisme ayant un segment d’orbite fini contenu dans le -voisinage de et rencontrant chaque boule , . Le lemme de perturbation de Pugh (théorème 2.5) appliqué à , et nous donne un entier et des paires de cubes centrés en chaque point , , dont les premiers itérés sont disjoints deux à deux et de diamètre inférieur à . On choisit enfin tel que chaque boule est contenue dans .
En appliquant l’hypothèse de récurrence, on obtient un segment d’orbite qui intersecte chaque cube et qui est contenue dans le -voisinage de . Soit alors le plus petit segment d’orbite contenu dans qui contienne et rencontre chaque cube , ; nous notons le point final de . Remarquons que par minimalité de , les points pour ne rencontrent pas le cube contenant . Il existe donc un itéré , , qui appartient à .
Puisque pour , il existe un segment d’orbite contenu dans le -voisinage de tel que appartient à et à la boule . On applique alors le lemme de connexion : il existe tel que est un itéré positif de . Les difféomorphismes et coïncident hors de et de ses premiers itérés. Le segment d’orbite n’a pas été modifié. On en déduit que est un itéré positif de et que l’ensemble des itérés compris entre et rencontre chaque boule pour . Par ailleurs, le nouveau segment d’orbite est inclus dans l’union de , et des premiers itérés de . Par conséquent, il est contenu dans le -voisinage de . ∎
Démonstration du théorème 4.7: le cas récurrent..
Nous montrons à présent la seconde partie du théorème: nous supposons pour tout et . Quitte à considérer un Gδ dense plus petit, nous pouvons supposer que (dont tous les points périodiques sont hyperboliques) est un point de continuité de l’application . Il suffit donc de construire proche de possédant une orbite périodique contenue dans le -voisinage de qui intersecte chaque boule . Nous introduisons comme précédemment les cubes . Nous supposerons de plus que chaque est un cube quadrillé dont est une tuile centrale (comme pour la section 2.8).
D’après la première partie du théorème, il existe un segment d’orbite qui rencontre chaque cube et qui est contenu dans le -voisinage de . Nous considérons un segment d’orbite qui rencontre chaque cube et qui est minimal (pour l’inclusion) pour cette propriété. Nous notons et ses points initial et final : ils sont chacun contenus dans un cube et . Nous montrons que, quitte à remplacer par un autre segment minimal, nous pouvons supposer que
-
a)
a un itéré négatif , , dans ,
-
b)
a un itéré positif , dans .
Supposons par exemple que a) n’est pas satisfait. Puisque rencontre et puisque est minimal, il existe tel que appartient à et possède un itéré positif , , dans . Il existe alors tel que le segment soit un nouveau segment minimal. Par construction la propriété b) est satisfaite par . Si a) n’est toujours pas satisfaite, on répète cette construction. À chaque étape, augmente et puisque est fini, ce procédé doit s’arrêter : on obtient alors à la fois a) et b).
Introduisons à présent un segment d’orbite contenu dans le -voisinage de et rencontrant les cubes et . La réunion de et de contient une pseudo-orbite à sauts dans les tuiles de et et contenant . Par construction évite les cubes et et rencontre les autres cubes . Nous pouvons donc, comme en section a), perturber et construire un difféomorphisme possédant une orbite périodique qui contient et donc rencontre chaque cube . Cette orbite est contenue dans le -voisinage de . ∎
4.4 Application : étude de la stabilité molle
Un des buts des systèmes dynamiques consiste à décrire comment les invariants dynamiques varient lorsque l’on perturbe le système. Ceci conduit à la notion de stabilité. Puisque la stabilité structurelle et l’-stabilité (voir section 7.7) ne sont pas dense dans , d’autres formes de stabilité ont été proposées. En suivant une idée de Zeeman, Takens a introduit [175] une stabilité affaiblie. La stabilité structurelle a lieu lorsque l’espace des orbites est rigide ; la stabilité molle exprime que l’espace des orbites du système change peu lorsque l’on perturbe la dynamique.
Par exemple, si désigne l’espace des ensembles compacts de muni de la topologie de Hausdorff, Takens montre le théorème suivant [175].
Théorème 4.8 (Takens).
L’ensemble des points de continuité de chaque application , et définies sur et à valeurs dans contient un Gδ dense.
Pour , c’est une simple conséquence de la proposition 2.9. Pour , c’est une conséquence du théorème 2.1 de Kupka-Smale et pour , c’est une conséquence du lemme de fermeture de Pugh (théorème 2.7). 111Remarquons que puisque génériquement dans , on a , il n’y a pas de -explosion, répondant ainsi au problème 19 de [119].
Pour décrire comment se décompose en orbites, on travaille dans l’espace des familles fermées d’ensembles compacts de et on introduit pour tout difféomorphisme ,
-
: l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont limite de Hausdorff d’adhérences d’orbite de .
Un difféomorphisme est mollement stable (“tolerance stable”) si c’est un point de continuité de l’application définie sur .
Conjecture de stabilité molle (Zeeman).
L’ensemble des difféomorphismes mollement stables contient un Gδ dense de .
À notre connaissance, cette conjecture reste ouverte, mais nous pouvons traiter des questions analogues. La structure de l’espace des orbites est décrite par les éléments suivants de :
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de ,
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont limites de Hausdorff d’orbites périodiques,
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont faiblement transitives,
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont transitives par chaînes,
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont limites de Hausdorff de segments d’orbites finis,
- :
-
l’ensemble des parties compactes invariantes de qui sont limites de -pseudo-orbites pour tout (parfois appelées orbites étendues de ).
Les propriétés de stabilité correspondantes sont vérifiées.
Proposition 4.9.
L’ensemble des points de continuité des ensembles , , , , et contient un Gδ dense de .
Takens avait traité [175, 176] le cas des ensembles , et . La proposition s’obtient par des arguments de semi-continuité. Pour , on utilise le lemme de fermeture et pour , on utilise le corollaire 4.6.
Concernant la conjecture initiale de Zeeman, Takens a donné [176] le critère suivant.
Théorème 4.10 (Takens).
Si l’ensemble des difféomorphismes tels que contient un Gδ dense de , alors la conjecture de stabilité molle est vraie.
Du théorème 4.4, on déduit que pour un Gδ dense de . La conjecture de Zeeman est donc reliée au problème suivant.
Question 4.11.
A-t-on pour dans un Gδ dense de ?
Le théorème 4.4 montre aussi que .
4.5 Problèmes
D’autres problèmes de connexion d’orbites restent ouverts et peuvent être intéressants pour des applications.
a) Fermeture asymptotique.
Question 4.12 (Fermeture asymptotique).
Considérons un voisinage de et un point de .
-
–
Existe-t-il pour lequel appartient à la variété stable d’une orbite périodique hyperbolique ?
-
–
Peut-on demander de plus que les adhérences des orbites positives de sous et sous restent proches en topologie de Hausdorff ? Que et l’ensemble des valeurs d’adhérences de l’orbite positive de sous soient proches pour la distance de Hausdorff ?
b) Orbites avec visites rares.
Question 4.13.
Supposons que vérifie une condition -générique et considérons un ensemble compact et transitif par chaînes contenu dans une classe de récurrence par chaînes . Fixons un point , un voisinage de et .
Existe-t-il une orbite périodique ayant un point proche de et passant une proportion de temps supérieure à dans ?
Chapter 5 Hyperbolicité non uniforme
Certaines propriétés connues pour les systèmes hyperboliques s’étendent à des classes plus générales de dynamiques. C’est l’objet par exemple de la théorie de Pesin [127] qui décrit la dynamique associée à une mesure ergodique dont aucun exposant de Lyapunov ne s’annule, pour des difféomorphismes de classe (les arguments ne se généralisent pas à la topologie , voir [140]). Nous présentons dans ce chapitre de tels résultats, non perturbatifs et valables en classe .
5.1 Décomposition dominée
Domination.
Considérons un ensemble invariant dont le fibré unitaire tangent est la somme directe de deux sous-fibrés linéaires invariants par l’application tangente : . C’est une décomposition dominée s’il existe un entier tel que pour tout et tous , unitaires on a
On dira aussi que la décomposition est -dominée lorsque l’on souhaitera préciser l’entier . La décomposition est non triviale si les dimensions de et ne sont pas nulles. On étend cette définition et on considérera aussi des décompositions dominées ayant plus de deux facteurs.
Propriétés.
Voici quelques propriétés des décompositions dominées (voir [34, appendice B]).
-
–
Tout ensemble invariant possède une décomposition dominée la plus fine : pour toute autre décomposition dominée , il existe tel que et .
-
–
Les décompositions dominées s’étendent à l’adhérence de . Elles passent à la limite : si est une suite de difféomorphismes convergeant vers , si est une suite d’ensembles compacts -invariants qui converge en topologie de Hausdorff vers , si chaque ensemble porte une décomposition -dominée telle que la dimension de ne dépende pas de , alors les fibrés et convergent vers des fibrés au-dessus de qui induisent une décomposition -dominée .
-
–
Si l’ensemble compact possède une décomposition dominée pour , tout ensemble contenu dans un voisinage de et invariant par un difféomorphisme proche de possède également une décomposition dominée en sous-fibrés de la même dimension.
Hyperbolicité partielle.
Un ensemble est dit partiellement hyperbolique s’il admet une décomposition dominée et un entier tels que et soient respectivement -uniformément contractés et -uniformément dilatés (i.e. on a (1.4.1)) et ne soient pas tous deux triviaux.
Les notions d’hyperbolicité, hyperbolicité partielle, décompositions dominées ne dépendent pas de la métrique riemannienne. Gourmelon a montré [62] que l’on peut toujours trouver une métrique pour que dans ces définitions l’hyperbolicité ou la domination se voient dès la première itération, i.e. en tout point on a :
5.2 Familles de plaques
On peut associer à tout ensemble ayant une décomposition dominée une famille de sous-variétés qui généralise les variétés invariantes locales des ensembles hyperboliques.
Définition 5.1.
Soit un ensemble invariant avec une décomposition dominée
.
Une famille de plaques tangente à est une application continue satisfaisant :
-
–
pour tout , l’application induite est un plongement pour lequel et dont l’image est tangente en à ;
-
–
est une famille continue de plongements .
La famille de plaques est localement invariante s’il existe tel que pour tout , l’image de la boule par est contenue dans la plaque .
D’après [78, théorème 5.5], il existe toujours des familles de plaques localement invariantes.
Théorème 5.2 (Hirsch-Pugh-Shub).
Pour tout ensemble compact invariant dont l’espace tangent possède une décomposition dominée , il existe une famille de plaques localement invariante tangente à .
Remarque 5.3.
-
a)
En général, les plaques ne sont pas définies dynamiquement. Par conséquent, deux plaques peuvent avoir des points d’intersection isolés et la famille de plaques n’est pas unique a priori.
-
b)
On peut énoncer une version uniforme de ce résultat : il existe des voisinages de et de et une collection de familles de plaques tangentes aux continuations du fibré et définies au-dessus des ensembles invariants maximaux de tels que
-
–
est une famille continue de plongements ,
-
–
les familles de plaques sont uniformément localement invariantes : il existe tel que pour tous et , l’image de la boule par est contenue dans la plaque .
-
–
-
c)
Lorsqu’il y a une décomposition dominée en trois fibrés, on peut obtenir une famille de plaques localement invariante tangente à en intersectant des familles de plaques localement invariantes tangentes à et à respectivement.
-
d)
Les plaques seront généralement de petit diamètre.
5.3 Points hyperboliques
Considérons un entier et un ensemble compact invariant muni d’une décomposition dominée .
Définition 5.4.
Un point est -hyperbolique le long de si pour tout on a:
L’existence de points hyperboliques fait souvent appel au lemme de Pliss [129]. Dans le cas d’orbites périodiques, on obtient le résultat suivant.
Proposition 5.5 (Conséquence du lemme de Pliss).
Pour ensemble invariant ayant une décomposition dominée , il existe avec la propriété suivante. Pour tout suffisamment grand et pour toute orbite périodique hyperbolique de satisfaisant
| (5.3.1) |
l’ensemble des points -hyperboliques de a une proportion supérieure à .
Remarque 5.6.
Lorsque la condition 5.3.1 est également satisfaite pour les itérations de le long de , on obtient des points simultanément hyperboliques le long des espaces et .
En effet, on choisit un entier premier. On applique la proposition au fibré et on considère un point qui est -hyperbolique le long du fibré . On applique ensuite la proposition au fibré : il existe un point qui est -hyperbolique le long de pour . Puisque est premier, on peut le mettre sous la forme . On choisit minimal avec cette propriété. Le fait que les points ,…, ne soient pas -hyperboliques le long de implique pour tout ,
La domination entre et entraîne alors (si est suffisamment grand),
pour tout . Puisque est -hyperbolique pour , ceci est encore vrai pour tout . Par conséquent, est simultanément -hyperbolique le long de et .
5.4 Variétés invariantes
Par un argument classique (voir par exemple [4, section 8]), tout point qui est -hyperbolique le long de possède une variété stable tangente à .
Proposition 5.7.
Considérons un ensemble compact invariant dont l’espace tangent possède une décomposition dominée , une famille de plaques localement invariante tangente à et un entier . Il existe tels que pour tout point qui est -hyperbolique le long de , l’ensemble
a les propriétés suivantes :
-
–
est une sous-variété injectivement immergée tangente à et ne dépend pas de ;
-
–
la boule est contenue dans et son image par est contenue dans pour tout .
L’ensemble est appelé variété stable forte de associée à et noté lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le fibré . On définit de façon symétrique la variété instable forte (encore notée ). Dans le cas de la décomposition d’un ensemble hyperbolique, la variété coïncide avec l’ensemble stable .
Remarque 5.8.
On peut énoncer une version uniforme de ce résultat.
Le résultat suivant découle des propositions 5.5 et 5.7 et peut servir à borner le nombre de classes homoclines d’un difféomorphisme. Il a été démontré initialement par Pliss [129] dans le cas d’une décomposition dominée triviale () pour majorer le nombre de puits d’un difféomorphisme.
Corollaire 5.9.
Pour tout ensemble invariant ayant une décomposition dominée et tout entier , il existe ayant la propriété suivante.
Dans toute famille d’orbites périodiques de vérifiant pour tout ,
| (5.4.1) |
il existe au moins deux orbites homocliniquement reliées.
5.5 Mesures hyperboliques
Si est une mesure de probabilité invariante sur , le théorème d’Oseledets (voir [68, théorème S.2.9]) associe à -presque tout point une unique décomposition invariante et des réels tels que pour tout la quantité
converge vers lorsque tend vers .
On appelle l’exposant de Lyapunov de selon l’espace et on lui affecte la multiplicité . La suite ordonnée des exposants de Lyapunov de , comptés avec multiplicité, est le vecteur de Lyapunov de . Lorsque est ergodique, le vecteur de Lyapunov ne dépendent pas du point .
Considérons une mesure ergodique dont le support ait une décomposition dominée . Alors l’exposant de Lyapunov maximal de en restriction au fibré est égal (voir [84]) à la limite
La proposition suivante issue de [4] permet de construire des variétés invariante en tout point régulier d’une mesure ergodique. Il permet de retrouver une partie de la théorie de Pesin lorsque la régularité du difféomorphisme est seulement mais en présence d’une décomposition dominée.
Proposition 5.10 (théorème 3.11 de [4]).
Considérons une mesure ergodique dont le support ait une décomposition dominée . Lorsque l’exposant de Lyapunov maximal de en restriction au fibré est strictement négatif, -presque tout point est hyperbolique le long de et possède donc une variété stable forte tangente à .
Lorsque est ergodique et que les exposants de Lyapunov sont tous non nuls en -presque tout point, nous disons que est hyperbolique.
5.6 Pistage généralisé
Définition 5.11.
Fixons et un ensemble invariant muni d’une décomposition dominée . Un segment d’orbite de longueur contenu dans est -hyperbolique pour la décomposition dominée si pour tout on a:
Liao a démontré [89, 90] le lemme de pistage suivant qui généralise le lemme de pistage classique de la théorie hyperbolique (voir aussi [58]).
Théorème 5.12 (Pistage généralisé, Liao).
Soit un ensemble invariant muni d’une décomposition dominée . Fixons et .
Il existe alors tel que pour toute famille de segments d’orbites , , contenus dans , qui sont -hyperboliques et satisfont
il existe une orbite périodique de période telle que
Avec la proposition 5.10, ceci permet d’approximer les mesures ergodiques par des orbites périodiques.
Corollaire 5.13.
Soit une mesure ergodique dont le support possède une décomposition dominée non triviale telle que les exposants de Lyapunov de soient strictement négatifs le long de et strictement positifs le long de .
Il existe alors une suite d’orbites périodiques hyperboliques qui converge vers en topologie de Hausdorff et dont les mesures induites convergent vers .
De plus, il existe un entier tel que (5.4.1) ait lieu pour tout assez grand. En particulier, toutes les orbites , sauf un nombre fini, sont homocliniquement liées et est contenu dans leur classe homocline.
5.7 Lemmes de sélection
Liao [87, 90] (voir aussi [183]) et Mañé [98] ont donné d’autres cadres où le lemme de pistage généralisé s’applique : la difficulté est de sélectionner des segments d’orbites hyperboliques.
Théorème 5.14 (Lemme de sélection de Liao).
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une décomposition -dominée non triviale et , tels que les deux conditions suivantes soient satisfaites.
-
–
Tout sous-ensemble compact invariant de contient un point vérifiant pour tout :
-
–
Il existe un point tel que pour tout on ait :
Pour tous proches de , il existe alors dans tout voisinage de une orbite périodique contenant un point satisfaisant pour tout :
En particulier, on peut trouver une suite de points périodiques homocliniquement reliés entre eux et qui converge vers un point de .
Le lemme de sélection de Mañé suppose que l’un des fibrés de la décomposition est uniforme.
Théorème 5.15 (Lemme de sélection de Mañé).
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une décomposition -dominée non triviale et tels que
-
–
le fibré est uniformément dilaté,
-
–
la dynamique restreinte à n’a pas d’ouvert errant,
et tels que les deux conditions suivantes soient satisfaites.
-
–
Il existe un ensemble dense de points vérifiant :
-
–
Il existe un point tel que pour tout on ait :
Alors, la conclusion du théorème 5.14 a lieu.
Dans le cas où est une classe homocline , on peut choisir un ensemble dense de points périodiques homocliniquement liés à . Les points périodiques obtenus par le théorème 5.15 peuvent être choisis “homocliniquement reliés” à un point de . On obtient alors le résultat suivant, démontré dans [36].
Corollaire 5.16 (Bonatti-Gan-Yang).
Considérons une classe homocline munie d’une décomposition dominée telle que soit uniformément dilaté et . Si n’est pas uniformément contracté, il existe alors une suite d’orbites périodiques hyperboliques homocliniquement liées à et pour tout , l’une de ces orbites n’a pas de point -hyperbolique le long de .
5.8 Fibrés non uniformes
Voici une application du lemme de sélection de Liao, issue de [50], qui permet d’analyser l’existence de fibrés non uniformes.
Théorème 5.17.
Supposons que pour tout et tout difféomorphisme -proche de l’ensemble des points périodiques d’indice ait une décomposition dominée telle que .
Considérons un ensemble compact invariant ayant une décomposition dominée . Si le fibré n’est pas uniformément contracté, l’un des cas suivant se produit.
-
1.
intersecte une classe homocline associée à un point périodique d’indice strictement plus petit que .
-
2.
intersecte des classes homoclines associées à des points périodiques ayant un indice égal à et ayant un exposant de Lyapunov le long de arbitrairement proche de .
-
3.
contient un ensemble compact invariant muni d’une structure partiellement hyperbolique telle que est de dimension et . De plus, pour toute mesure ergodique supportée par , l’exposant de Lyapunov le long de est égal à .
Ce théorème fait naturellement apparaître des ensembles hyperboliques ayant une structure partiellement hyperbolique avec un fibré central de dimension . Puisque les exposants de Lyapunov de toute mesure invariante supportée sur cet ensemble sont nuls le long du fibré central, les techniques présentées dans ce chapitre ne permettent pas de décrire plus précisément la dynamique. Nous introduirons au chapitre 9 les modèles centraux qui permettent d’analyser la dynamique dans la direction centrale d’un point de vue topologique.
Proof.
Puisque n’est pas uniformément contracté, il existe une mesure ergodique supportée par dont l’exposant de Lyapunov maximal le long de est positif ou nul.
D’après le lemme de fermeture ergodique (théorème 4.1) et son addendum, il existe une suite de difféomorphismes , et une suite d’orbites périodiques associées qui converge vers le support de en topologie de Hausdorff et dont les exposants de Lyapunov convergent vers ceux de . D’après l’hypothèse sur la domination des orbites périodiques, les orbites ont au plus un exposant proche de . Par conséquent a au plus un exposant de Lyapunov proche de .
Si est hyperbolique, l’indice des orbites est égal à la dimension des espaces stables de . Par passage à la limite, il existe donc une décomposition dominée , avec . D’après le corollaire 5.13, intersecte une classe homocline d’indice . Ceci donne le premier cas du théorème.
Si n’est pas hyperbolique, on construit de la même façon une décomposition dominée , telle que les exposants de sont strictement négatifs le long de , strictement positifs le long de et nuls le long de . On a .
On peut choisir pour que la dimension de soit minimale et on note . On en déduit que pour toute mesure supportée par , l’exposant le long du fibré central de est négatif ou nul.
On peut aussi avoir choisi minimal pour l’inclusion et ces propriétés. Ainsi, pour tout sous-ensemble compact invariant propre , l’exposant de toute mesure le long du fibré central est strictement négatif. Il est même inférieur à une constante car dans le cas contraire la mesure serait hyperbolique (il y a au plus un exposant proche de ). Comme précédemment, intersecterait une classe homocline ayant des orbites périodiques d’indice dont l’exposant le long de est -proches de . On serait alors dans le cas 1) (si ) ou dans le cas 2) (si ) du théorème.
Si contient une mesure d’exposant central strictement négatif, on peut appliquer le lemme de sélection de Liao et intersecte une classe homocline ayant des orbites périodiques d’indice dont l’exposant le long de est arbitrairement proche de . On est alors à nouveau dans le cas 1) ou 2).
Si toutes les mesures supportées par ont un exposant central nul, on est dans le cas 3) du théorème. ∎
5.9 Classes hyperboliques par chaînes
Considérons un ensemble invariant , une décomposition dominée et une famille de plaques tangente à . On définit les notions suivantes.
-
–
est piégée si pour tout on a
-
–
est finement piégée si pour une base de voisinages de la section de , il existe :
-
1.
une famille de difféomorphismes de qui est continue en topologie et supportée dans ;
-
2.
une constante telle que pour tous on a et :
Bien sûr, si est finement piégée, il existe une famille de plaques tangentes à (et de diamètres arbitrairement petits) qui est piégée. Par ailleurs, toute autre famille de plaques tangente à et localement invariante est également finement piégée : il existe tel que pour tout la boule est envoyée par dans . Ceci justifie la définition :
-
1.
-
–
est finement piégée s’il existe une famille de plaques tangente à et finement piégée.
Nous avons proposé [51] une nouvelle définition d’hyperbolicité affaiblie.
Définition 5.18.
Une classe homocline est hyperbolique par chaînes si
-
–
elle possède une décomposition dominée en deux fibrés ;
-
–
il existe une famille de plaques tangente à piégée par et une famille de plaques tangente à et piégée par ;
-
–
il existe un point périodique hyperbolique homocliniquement relié à l’orbite de dont l’ensemble stable contient et il existe un point périodique hyperbolique homocliniquement relié à l’orbite de dont l’ensemble instable contient .
Les familles de plaques et jouent alors le rôle des variétés stables et instables locales des ensembles hyperboliques : elles sont respectivement contenues dans les ensembles stables et instables par chaînes de la classe . Ceci justifie la terminologie “hyperbolicité par chaînes”. En particulier, une propriété de produit local est satisfaite (voir [51]).
Lemme 5.19.
Considérons une classe homocline hyperbolique par chaînes.
-
1.
il existe un sous-ensemble dense d’orbite périodiques homocliniquement reliées à telles que pour tout on a et ;
-
2.
pour tout on a et ;
-
3.
tout point d’intersection transverse entre deux plaques et , , est contenu dans .
L’hyperbolicité par chaînes est robuste aux perturbations (voir [51]).
Théorème 5.20 (Crovisier-Pujals).
Considérons une classe homocline hyperbolique par chaînes telle que :
-
–
coïncide avec sa classe de récurrence par chaînes,
-
–
les familles de plaques et sont finement piégées respectivement par et .
Alors pour tout difféomorphisme proche de la classe homocline de associée à la continuation hyperbolique de est encore hyperbolique par chaînes.
Nous donnons des exemples de classes hyperboliques par chaînes robustement non hyperbolique en section suivante.
5.10 Difféomorphismes dérivés d’Anosov robustement non hyperboliques
Smale a construit [170] un difféomorphisme hyperbolique ayant un attracteur non trivial en modifiant un difféomorphisme d’Anosov linéaire du tore . Il est obtenu en déformant le difféomorphisme initial près d’un point fixe : la perturbation est petite en topologie mais grande en topologie .
Cette idée de déformer au voisinage d’un point fixe a été reprise par Mañé [92], puis par Bonatti-Viana [40] pour construire un difféomorphisme robustement transitif et non hyperbolique. (Avec cet argument, on peut aussi construire des exemples d’attracteurs robustes non hyperboliques (voir [45]).) Nous expliquons ici comment construire de telles dynamiques dans le cas le plus simple. Voir aussi [34, section 7.1].
On considère un difféomorphisme d’Anosov linéaire du tore avec valeurs propres réelles , et un point fixe . L’application peut donc être écrite localement
Introduisons un difféomorphisme qui fixe , coïncide avec hors d’un petit voisinage de et de la forme
Il préserve donc le feuilletage stable de . On demande également que
-
–
, de sorte que préserve une domination entre l’espace centre-stable (tangent aux feuilles de ) et un fibré instable,
-
–
contracte strictement les aires le long des feuilles de .
Le difféomorphisme initial possède ces propriétés mais nous allons voir que d’autres difféomorphismes peuvent être intéressants.
Fixons alors et définissons un difféomorphisme qui coïncide avec hors d’un voisinage de et prend la forme suivante au voisinage de
Pour grand, diffère de dans une boule centrée en de rayon arbitrairement petit. Pour grand, le fibré instable de est arbitrairement proche de celui de et sa dilatation est arbitrairement proche de .
Les difféomorphismes -proches de possèdent encore un feuilletage centre-stable. Ceci découle de [78, théorèmes 7.1 et 7.2] puisque le feuilletage centre-stable de est lisse et normalement hyperbolique.
Les difféomorphismes proches de n’ont qu’une seule classe de récurrence par chaînes.
Proposition 5.21.
Si l’on choisit assez grands, tout difféomorphisme -proche de est transitif. Plus précisément, est une classe homocline.
Proof.
L’argument est le même que dans [40, section 6.2]. ∎
Proposition 5.22.
Si sont assez grands, est une classe hyperbolique par chaînes pour tout difféomorphisem -proche de .
Proof.
Considérons un point périodique de et une famille de plaques centre-stable piégée pour (i.e. une famille continue de variétés stables locales). Puisque préserve le feuilletage stable de et est arbitrairement proche de en topologie , les plaques sont piégées par . Pour suffisamment grands, l’orbite de coïncide pour et pour et de plus pour . Pour les difféomorphismes proches de en topologie , il existe un feuilletage centre-stable proche de . Par conséquent il existe encore une famille de plaques centre-stable qui est proche de la famille pour la topologie . Cette famille est donc également piégée pour et la plaque de la continuation de est contenue dans la variété stable de .
Puisque le fibré est uniformément dilaté par , il existe une famille de plaques tangente à piégée par et satisfaisant . Ceci est également vérifié par tout difféomorphisme proche de en topologie .
Avec la proposition 5.21, ceci montre que est une classe hyperbolique par chaînes. ∎
Pour obtenir une dynamique robustement non hyperbolique, il suffit de choisir avec des points fixes hyperboliques d’indices 1 et 2. Voir la figure 5.1. Puisque appartiennent à une même classe homocline robustement, tout difféomorphisme proche de peut être approché par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel.
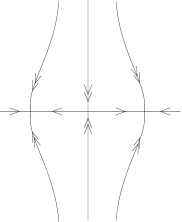
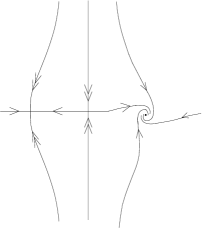
On peut construire avec une structure partiellement hyperbolique avec trois fibrés de dimension . Aucun difféomorphisme au voisinage de ne peut alors avoir de tangence homocline (voir la section 7.5).
On peut aussi choisir avec des valeurs propres stables complexes. Dans ce cas, pour aucun difféomorphisme proche de , la classe homocline (contenant ) n’a pas de décomposition dominée de la forme avec . On en déduit (voir le théorème 7.15 plus loin) que tout difféomorphisme proche de est accumulé par des difféomorphismes pour lesquels a une tangence homocline.
Ceci fournit des exemples de dynamiques modérées hétérodimensionnelle et critique mentionnées en introduction.
Corollaire 5.23.
Il existe sur des dynamiques génériques modérées hétérodimensionnelles critiques et non critiques.
Chapter 6 Réduction de la dimension ambiante
On peut toujours représenter les dynamiques -génériques de dimension au sein des dynamiques génériques de dimension supérieure : il suffit de les réaliser sur des sous-variétés invariantes normalement hyperboliques (voir la construction en section 7.9). Ceci permet d’obtenir très simplement de nouvelles classes d’exemples : du phénomène de Newhouse, on déduit l’existence (en dimension ) de classes de récurrence par chaînes accumulées par des selles isolées (des orbites périodiques hyperboliques qui ne sont ni des sources ni des puits et dont la classe homocline est triviale). Dans ce chapitre nous étudions le problème réciproque : étant donné un ensemble invariant , peut-on détecter l’existence d’une sous-variété invariante qui le contient ? Nous présentons le critère issu de [23].
6.1 Variété normalement hyperbolique
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une décomposition dominée telle que est uniformément dilaté. Supposons qu’il existe une sous-variété contenant , tangente à (et de dimension ), qui soit localement invariante : il existe un voisinage de dans tel que (voir la figure 6.1).
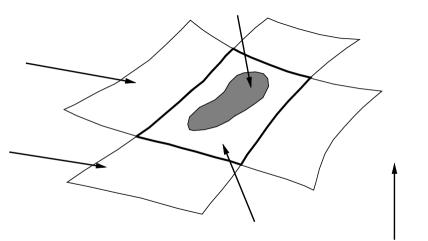
Il est facile de voir que tout point dont l’orbite est contenue dans un petit voisinage de appartient à . Un argument classique de transformée de graphe (voir [78, 23]) entraîne que cette propriété est encore vérifiée pour les difféomorphismes proches.
Théorème 6.1.
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une décomposition dominée telle que est uniformément dilaté, et une sous-variété contenant , tangente à , qui est localement invariante au voisinage de .
Il existe alors un voisinage de dans qui est une sous-variété à bord localement invariante par , un voisinage de dans et un voisinage de dans tels que pour tout il existe sous-variété à bord -proche de vérifiant : l’ensemble maximal invariant de dans est contenu dans et .
6.2 Existence de sous-variété localement invariante
Reprenons le cadre de la section précédente. Tout point possède une variété instable forte tangente à . Il est alors facile de voir que pour tout , la variété n’intersecte qu’au point . En effet, si recoupe en , en considérant les images de pour un itéré avec large, on obtient deux points arbitrairement proches et joints par une courbe tangente à un champ de cône instable, transverse à la direction .
Cette propriété admet une réciproque (voir [23]).
Théorème 6.2 (Bonatti-Crovisier).
Considérons un ensemble compact invariant ayant une décomposition dominée
telle que est uniformément dilaté.
Il existe alors une sous-variété à bord de dimension qui :
-
–
contient dans son intérieur,
-
–
est tangente à aux points de ,
-
–
est localement invariante au voisinage de ,
si (et seulement si) la propriété suivante est vérifiée.
-
(I)
Pour tout , la variété instable ne rencontre qu’au point .
6.3 Idée de la preuve du théorème 6.2
Nous utilisons le théorème d’extension de Whitney en classe (voir par exemple [8, Appendice A]).
Théorème 6.3 (Whitney).
Considérons une partie fermée et une application continue. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
-
1.
s’étend en une fonction de classe ,
-
2.
il existe une application continue définie sur et à valeurs dans l’espace d’applications linéraires , telle que l’application définie par :
vérifie : pour tout , la quantité tend vers lorsque les points de tendent vers .
En travaillant dans des cartes, l’ensemble du théorème 6.2 peut être localement décrit comme le graphe d’une application , où : les axes et sont respectivement tangents à des champs de cônes autour des directions et . En effet, si l’on fixe une section locale de la lamination par variétés instables fortes, on peut projeter localement sur par holonomie. L’hypothèse (I) du théorème 6.2 se traduit par l’injectivité de cette application.
Le fibré définit une application . Si la condition (2) n’est pas satisfaite, on peut trouver des paires de points proches telles que soit uniformément transverse à un champ de cônes autour de la direction . Par conséquent, la dynamique dilate le vecteur par itérations positives : il existe tel que la distance soit proche de ; par ailleurs, le vecteur (vu dans une carte) est proche du champ . En prenant une suite de points telle que tende vers , l’entier tend vers . Le long d’une suite extraite, converge vers un point et vers un point , contredisant l’hypothèse (I). La condition (2) du théorème de Whitney est donc satisfaite.
À l’aide d’une partition de l’unité, on obtient une variété différentiable à bord de dimension qui contient dans son intérieur et qui est tangente à aux points de . Un argument de transformée de graphe, permet de modifier pour obtenir une variété localement invariante au voisinage de .
6.4 Application : existence de feuilletages stables
Nous pouvons retrouver très simplement l’existence d’un feuilletage stable au voisinage de tout ensemble hyperbolique pour les difféomorphismes de surface de classe (voir [122, appendice A] pour une démonstration classique).
Théorème 6.4.
Considérons un difféomorphisme de classe d’une surface et un ensemble hyperbolique . Il existe alors un feuilletage de classe , défini au voisinage de et localement invariant par , qui est tangent au fibré stable de .
Proof.
Puisque est de classe , il induit un difféomorphisme de classe sur le fibré unitaire tangent . Le fibré stable au-dessus de défini un ensemble compact invariant qui relève .
En tout point , notons le sous-espace de tangent aux fibres de . Ceci définit un fibré continu invariant au-dessus de . On vérifie facilement qu’il existe tel que pour tout , on ait pour tout ,
Transversalement aux fibres, la norme de est bornée par . Ceci montre que possède une décomposition dominée en trois fibrés telle que et se projettent par respectivement sur et .
En chaque point , on peut considérer la variété instable forte , tangente à : par construction c’est l’ensemble . Par conséquent, elle coupe en uniquement. Nous pouvons donc appliquer le théorème 6.2 et considérer une sous-variété contenant , tangente à et localement invariante. La projection induite par est un difféomorphisme local, injectif sur , donc injectif au voisinage de . On peut donc interpréter comme un champ de droites au voisinage de qui est localement invariant par et qui étend le champ défini au-dessus . Le feuilletage s’obtient alors en intégrant ce champ de droites. ∎
6.5 Problèmes
a) Classes pelliculaires.
Nous avons vu en introduction qu’il existe des classes de récurrence par chaînes accumulées par des orbites périodiques qui ne sont ni des puits ni des sources : pour les exemples construits, la dynamique est supportée par une sous-variété normalement hyperbolique. On peut se demander s’il existe des exemples plus intéressants.
Question 6.5.
Existe-t-il un ouvert non vide et un Gδ dense formé de difféomorphismes ayant une classe homocline avec la propriété suivante? La classe n’est pas contenue dans une sous-variété normalement hyperbolique et est accumulée par des orbites périodiques selles dont l’indice n’appartient pas à l’ensemble des indices des points périodiques de .
L. Díaz appelle classe pelliculaire une classe homocline ayant de telles propriétés.
b) Connexions fortes.
Lorsque la condition (I) n’est pas vérifiée, il peut être utile de chercher un point périodique tel que rencontre . Ceci peut permettre de créer des connexions fortes (voir la section 8.2 pour la définition). Nous sommes alors intéressés par des énoncés de la forme : satisfait (I) ou bien possède une connexion forte.
Chapter 7 Bifurcations de points périodiques
Nous avons rassemblé dans ce chapitre divers résultats perturbatifs sur les suites périodiques d’applications linéaires. Grâce au lemme de Franks (théorème 2.2), on obtient des résultats perturbatifs sur les orbites périodiques des difféomorphismes. Comme conséquence, nous déduisons que les difféomorphismes -génériques dont l’ensemble récurrent par chaînes n’admet pas de décomposition dominé possède une infinité de puits ou de sources (phénomène de Newhouse). Nous démontrons aussi le théorème d’-stabilité en utilisant le lemme de connexion pour les pseudo-orbites. Finalement, nous présentons le théorème de Pujals-Sambarino-Wen-Gourmelon qui fait le lien entre les tangences homoclines et l’absence de décomposition dominée.
7.1 Cocycles linéaires périodiques
Définition.
Un cocycle linéaire périodique est la donnée d’une suite d’espaces euclidiens de dimension , d’une suite d’isomorphismes linéaires et d’un entier , tels que et pour tout . On appelle sa période. Les valeurs propres de sont les valeurs propres de l’endomorphisme . Ses exposants sont les quantités où parcourt l’ensemble des valeurs propres.
On dit que est borné par si pour tout on a
On dit que les cocycles et sont -proches si pour tout on a
Sous-fibrés.
Si est une suite de sous-espaces de dimension , également -périodique, qui est invariante par , on obtient par restriction un cocycle de . Si est borné par , le cocycle l’est également. Réciproquement si est un cocycle de borné par , c’est la restriction d’un cocycle de borné par . Si et sont -proches, leurs extensions et seront également -proches.
Hyperbolicité.
On dit que est uniformément contracté à la période, s’il existe tel que pour tout on ait :
| (7.1.1) |
C’est une propriété plus forte que la contraction à la période (toutes les valeurs propres du produit sont de module strictement plus petit que ) mais plus faible que la contraction uniforme (il existe tel que pour tout on a ).
On dit que admet une décomposition dominée , s’il existe deux suites -périodiques et de sous-espaces supplémentaires qui sont -invariantes et s’il existe tel que, pour tout et tous , unitaires, on ait :
| (7.1.2) |
La décomposition est non triviale si les dimensions de et de ne sont pas nulles.
7.2 Contraction uniforme à la période
Théorème 7.1 (Pliss).
Pour tous , , il existe et tels que pour tout cocycle périodique linéaire de dimension , borné par et de période l’un des cas suivants se produit :
-
–
est -uniformément contracté à la période ;
-
–
il existe une -perturbation de qui possède un exposant positif.
7.3 Valeurs propres réelles simples
Il est possible par pertubation de rendre les valeurs propres d’un cocycle linéaire périodique réelles. Ceci a été démontré dans [22] pour la dimension et généralisé en dimension supérieure dans [37].
Proposition 7.2 (lemme 6.6 de [22] et théorème 2.1 de [37]).
Pour tous , , il existe tel que tout cocycle périodique linéaire de dimension , borné par et de période possède une -perturbation telle que :
-
–
les valeurs propres de sont toutes réelles et simples ;
-
–
pour , les exposants de et de (comptés avec multiplicité) sont -proches.
7.4 Domination
Mañé a démontré [93] qu’en l’absence de décomposition dominée, on peut faire bifurquer les orbites périodiques de type selle d’un difféomorphisme de surface pour les transformer en puits ou source. Ceci a été généralisé en dimension par Díaz, Pujals et Ures [53] puis en dimension quelconque par Bonatti, Pujals et Díaz dans le cadre des dynamiques robustement transitives [32] : supposons que les difféomorphismes proches de soient tous transitifs, alors possède une décomposition dominée pour . Plus récemment, Bonatti, Gourmelon et Vivier ont donné [37] une preuve différente de ce résultat qui autorise à travailler avec des orbites périodiques n’appartenant pas à un même ensemble transitif.
Théorème 7.3 (Bonatti-Gourmelon-Vivier).
Pour tous , , il existe tel que pour tout cocycle périodique linéaire de dimension , borné par et de période l’un des cas suivants se produit :
-
–
possède une décomposition -dominée non triviale ;
-
–
il existe une -perturbation de dont toutes les valeurs propres sont réelles et de même module.
Corollaire 7.4 (Mañé).
Pour tous , , il existe tel que pour tout cocycle périodique linéaire de dimension , borné par et de période l’un des cas suivants se produit :
-
–
il existe une décomposition -dominée telle que et sont -uniformément contractés à la période par et respectivement ;
-
–
il existe une -perturbation de ayant une valeur propre de module .
Proof.
Considérons des entiers supérieur aux entiers donnés par les théorèmes 7.1 et 7.3 et considérons un cocycle pour lequel le deuxième cas du corollaire ne se produit pas.
Considérons une décomposition -dominée (éventuellement triviale) telle que tous les exposants selon soient strictement négatifs et tous les exposants selon soient strictement positifs. Il existe une telle décomposition qui maximise les dimensions de et de . Nous pouvons appliquer le théorème 7.3 à la restriction de au fibré . Puisqu’il n’existe pas de décomposition -dominée de , on peut perturber le cocycle pour rendre tous ses exposants selon de mêmes signes. Puisque nous ne sommes pas dans le second cas du corollaire, les exposants selon doivent déjà être de mêmes signes pour , ce qui contredit la maximalité de ou de . Nous avons donc montré qu’il existe une décomposition -dominée telle que tous les exposants de selon sont strictement négatifs et tous ceux selon sont strictement positifs.
En appliquant à présent le théorème 7.1 à chacun des fibrés et , on obtient que et sont -uniformément contractés à la période par et respectivement. ∎
7.5 Tangences homoclines
D’autres bifurcations associées aux orbites périodiques hyperboliques font intervenir les variétés invariantes. C’est la cas des tangences homoclines, particulièrement importantes puisqu’elles engendrent des modifications importantes de la dynamique (voir [122, 34]).
Définition 7.5.
Une orbite périodique hyperbolique a une tangence homocline s’il existe un point d’intersection non transverse entre les variétés stables et instables de .
En dimension deux, Pujals et Sambarino ont montré [148] que si l’on ne peut pas approcher par des difféomorphismes présentant des tangences homoclines, l’ensemble des points périodiques de type selle de possède une décomposition dominée. Ceci a été généralisé par Wen [181] en dimension quelconque. Gourmelon [63] a amélioré ces énoncés en donnant une version quantitative qui autorise à considérer chaque orbite périodique séparément.
Théorème 7.6 (Pujals-Sambarino, Wen, Gourmelon).
Pour tout voisinage de , il existe et un voisinage de tels que pour et toute orbite périodique hyperbolique de de période , l’un des deux cas suivants se produit :
-
–
la décomposition en espaces stables et instables est -dominée,
-
–
il existe une perturbation qui coïncide avec sur et sur un voisinage arbitrairement petit de telle que a une orbite de tangence homocline contenue dans un petit voisinage de .
Avec le théorème 7.1 et la proposition 7.2, on en déduit (par une démonstration similaire à celle du corollaire 7.4, voir [182, lemmes 3.3 et 3.4]),
Corollaire 7.7 (Wen).
Supposons que n’est pas limite dans de difféomorphismes ayant une tangence homocline.
Il existe alors un voisinage de et tels que pour tout et toute orbite périodique de , la décomposition en espaces caractéristiques dont les exposants de Lyapunov appartiennent respectivement à , , vérifie :
-
–
est de dimension ou ,
-
–
la décomposition est -dominée,
-
–
si la période de est supérieure à , alors et sont -uniformément contractés à la période par et respectivement.
L’existence d’une tangence homocline est un phénomène de codimension et d’après le théorème 2.1 de Kupka-Smale l’ensemble des difféomorphismes ayant une tangence homocline forme une partie maigre. On peut toutefois généraliser la définition précédente et définir une propriété qui apparaît sur des ouverts de difféomorphismes.
Définition 7.8.
Une orbite périodique hyperbolique possède une tangence homocline robuste si elle appartient à un ensemble hyperbolique transitif tel que pour tout difféomorphisme proche de la continuation hyperbolique de pour possède deux points tels que et aient une intersection non transverse.
Toute variété de dimension supérieure ou égale à possède des difféomorphismes ayant des tangences homocline robustes (voir [107, section 8], [17] et la section 7.9). En dimension , Newhouse a montré [105] qu’en topologie , il existe des tangences homoclines robustes. Moreira a montré [100] que ce n’est pas le cas en topologie .
Théorème 7.9 (Moreira).
Lorsque , il n’existe pas de tangence homocline robuste dans .
7.6 Application (1) : phénomène de Newhouse en l’absence de décomposition dominée
D’après le théorème 3.8, le phénomène de Newhouse existe en topologie sur toute variété de dimension supérieure ou égale à . Parallèlement à ces exemples, Mañé a montré [93] que tout difféomorphisme de surface -générique est hyperbolique ou bien possède une infinité de puits ou de sources. Díaz, Pujals, Ures en dimension (voir [53]), puis Bonatti, Díaz, Pujals en dimension quelconque [32] ont obtenu un résultat similaire.
Théorème 7.10 (Bonatti-Díaz-Pujals-Ures).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense , toute classe homocline possède une décomposition dominée non triviale ou est contenue dans l’adhérence des puits ou des sources.
En particulier, toute classe de récurrence par chaînes ayant de l’intérieur ou isolée dans possède une décomposition dominée non triviale.
En appliquant le corollaire 4.6 et le théorème 7.3, nous obtenon une version du résultat précédent pour les ensembles transitifs par chaînes.
Théorème 7.11 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Il existe un Gδ dense tel que tout ensemble transitif par chaînes d’un difféomorphisme possède une décomposition dominée non triviale ou bien est limite pour la distance de Hausdorff d’une suite de puits ou de sources.
On en déduit un énoncé sur la dynamique globale.
Corollaire 7.12 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Pour tout difféomorphisme -générique,
-
–
ou bien il existe une décomposition de en un nombre fini d’ensembles compacts invariants
tels que est l’union d’un nombre fini de puits et de sources et possède une décomposition dominée non triviale,
-
–
ou bien possède une infinité de puits ou de sources.
Au voisinage d’une classe homocline isolée, le phénomène de Newhouse n’a pas lieu et on peut obtenir dans ce cadre un résultat plus fort.
Théorème 7.13 (Bonatti-Diaz-Pujals).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un dense , toute classe homocline qui est isolée dans est hyperbolique en volume.
Plus précisément, est une source, ou un puits, ou possède une décomposition dominée telle que
-
–
et sont non dégénérés,
-
–
il existe tel que contracte uniformément le volume le long de et dilate uniformément le volume le long de .
Proof.
Si n’est pas un puits ou une source, il existe une décomposition dominée non triviale . Nous pouvons supposer que est minimale et il s’agit de montrer qu’il existe tel que contracte uniformément le volume le long de .
La structure riemannienne sur permet de définir le jacobien le long de en chaque point de comme le module du déterminant de . On obtient une fonction multiplicative sur , i.e. pour tout . Si l’on suppose par l’absurde que le volume le long de n’est uniformément contracté par pour aucun entier , il existe une mesure de probabilité invariante supportée par telle que . Le lemme de fermeture ergodique (théorème 4.1) implique qu’il existe une suite d’orbite périodiques s’accumulant sur une partie de telles que pour tout , la moyenne de long de soit supérieure à pour tout suffisamment grand. Puisque satisfait une condition de généricité, on en déduit que tout voisinage de contient une orbite périodique telle que la moyenne de le long de soit strictement positive.
Nous utilisons à présent le fait que est isolée pour conclure que est contenue dans . La généricité de implique alors que . La définition des classes homoclines implique que est limite de Hausdorff d’orbites périodiques sur lesquelles la moyenne de est strictement positive. Puisque est minimale, en appliquant le théorème 7.3, on peut faire bifurquer l’une de ces orbites périodiques pour que tous les exposants de Lyapunov le long de soient strictement positifs : on obtient alors une source dans un voisinage de arbitraire. Par un argument de généricité, nous en déduisons que est limite de Hausdorff de sources, contredisant le fait que cette classe soit isolée et ne soit pas elle-même une source. ∎
Remarque 7.14.
Le point clé de la démonstration consiste à montrer que s’il existe une suite d’orbite périodiques s’accumulant sur une partie de et dont la moyenne de long de soit positive, on peut se ramener à .
Nous avons utilisé la fait que est isolé pour voir que les orbites sont contenues dans puis nous nous sommes servi de la notion de points périodiques homocliniquement reliés pour conclure . Ce second argument sera pleinement exploité au chapitre 8.
7.7 Application (2) : caractérisation de la stabilité
Un problème, formulé par Palis et Smale [121] et qui a occupé les dynamiciens pendant les années 1970-1980, est la caractérisation des dynamiques structurellement stables. Abraham et Smale ont montré [9, 169] que ces dynamiques ne sont pas dense dans lorsque .
Définition.
Nous disons qu’un difféomorphisme est structurellement stable (pour la topologie ) si tout difféomorphisme appartenant à un voisinage de dans est conjugué à par un homéomorphisme de . Plus généralement, est -stable (pour la topologie ) si pour tout difféomorphisme appartenant à un voisinage de , les systèmes et sont conjugués par un homéomorphisme .
Conditions suffisantes.
Une fois que l’on sait que les difféomorphismes axiome A sans cycles sont les difféomorphismes hyperboliques (voir la section 1.6), son résultat est une conséquence du lemme de pistage pour les dynamiques hyperboliques.
Conditions nécessaires.
Palis et Robinson ont montré [112, 153] que pour un difféomorphisme axiome A, les conditions “sans cycle” ou “transversalité forte” sont nécessaires pour avoir l’-stabilité ou la stabilité structurelle respectivement. Palis et Mañé ont montré plus tard que l’axiome A lui-même est nécessaire [98, 113].
On obtient alors le théorème suivant.
Théorème d’-stabilité.
Pour tout difféomorphisme il y a équivalence entre les propriétés :
-
–
est -stable (pour la topologie ),
-
–
est hyperbolique (définition 1.3),
-
–
possède la propriété (*) suivante :
- (*)
-
Toute orbite périodique de tout proche de est hyperbolique.
Démonstration de l’-stabilité.
Nous avons déjà expliqué pourquoi les difféomorphismes hyperboliques sont -stables. Supposons à présent que est -stable. D’après le théorème de Kupka-Smale, il existe des perturbations arbitrairement petites de dont les nombre d’orbites périodiques de chaque période est fini. La stabilité implique que a aussi cette propriété. Supposons que ait un point périodique non hyperbolique : avec le lemme de Franks, il est possible de perturber pour que ait une valeur propre racine de l’unité et que la dynamique au voisinage de l’orbite de soit topologiquement conjuguée à la partie linéaire de le long de l’orbite de : on obtient ainsi une infinité de points périodiques de même période au voisinage de pour une petite perturbation de , ce qui contredit la stabilité. Puisque l’-stabilité est une propriété ouverte, nous avons montré que l’-stabilité entraîne la propriété (*).
Supposons finalement que satisfait (*). Remarquons que cette propriété permet de suivre continûment toute orbite périodique le long d’un chemin de difféomorphismes proches de . D’après le corollaire 7.4, il existe un entier tel que pour tout et tout difféomorphisme proche de , l’ensemble des points périodiques d’indice possède une décomposition -dominée et leurs directions stables et instables sont -uniformément contractées à la période par et respectivement. Le corollaire 5.9 montre que n’a qu’un nombre fini de classes homoclines distinctes. Nous en déduisons :
Affirmation.
n’a qu’un nombre fini de classe de récurrence par chaînes.
Proof.
Si ce n’était pas le cas, on peut considérer une suite arbitrairement longue d’ouverts filtrants (i.e. ) telle que contient une classe de récurrence par chaînes. Par une perturbation arbitrairement petite donnée par le lemme de fermeture, on peut créer dans une orbite périodique. Puisque (*) est satisfaite cette orbite peut être associée à une orbite périodique de et puisque la suite est filtrante, appartient à . On peut donc trouver orbites périodiques pour qui ne sont pas homocliniquement reliées, contredisant la borne sur le nombre de classes homoclines de . ∎
Nous montrons par l’absurde que est hyperbolique. Si ce n’est pas le cas, il existe une classe de récurrence par chaînes qui n’est pas hyperbolique. Nous avons vu qu’elle est isolée dans . Puisque a la propriété (*), toute orbite périodique contenue dans un voisinage de pour un difféomorphisme proche de peut être associée à une orbite périodique de . D’après le lemme de fermeture, contient donc des orbites périodiques. Soit l’indice maximal des points périodiques contenus dans .
Affirmation.
n’est pas hyperbolique.
Proof.
En effet si est un ensemble hyperbolique , il se décompose en un nombre fini de classes homoclines hyperboliques disjointes. Soit l’une d’entre elles. Puisque est strictement contenu dans la classe de récurrence par chaînes , on peut trouver et . Le lemme de connexion pour les pseudo-orbites permet par une perturbation de créer une orbite homocline transverse en pour l’ensemble hyperbolique et un difféomorphisme proche . Le difféomorphisme possède donc un ensemble hyperbolique qui est la continuation hyperbolique de , ainsi que des points périodiques d’indice proches de : nous avons créé par perturbation de nouvelles orbites périodiques, contredisant (*). ∎
L’ensemble est union d’un nombre fini de classes homoclines associées à des points périodiques d’indice . L’une d’entre elles, notée , n’est pas hyperbolique. D’après ce qui précède, elle possède une décomposition dominée telle que est égale à la dimension stable de .
Affirmation.
Le fibré est uniformément dilaté.
Proof.
Si l’on suppose par l’absurde que ce n’est pas le cas, il existe une mesure ergodique supportée par qui vérifie . En appliquant le lemme de fermeture ergodique, on obtient une orbite périodique proche de pour un difféomorphisme proche de pour laquelle le fibré n’est pas -uniformément contracté à la période par . Si est d’indice , ceci contredit la propriété (*). Sinon est d’indice supérieur à , contredisant le choix d’un indice maximal . ∎
Pour conclure, nous appliquons le lemme de sélection de Mañé (théorème 5.15) à l’ensemble et à la décomposition . Nous en déduisons que possède une orbite périodique qui n’est pas -uniformément contractée à la période le long de . C’est une contradiction. ∎
7.8 Contrôle des variétés invariantes
Les techniques de Gourmelon permettent de faire bifurquer une orbite périodique comme dans les sections précédentes, tout en contrôlant certaines orbites homoclines (voir [64]). En particulier, ceci permet [63] de créer des tangences à l’intérieur d’une classe homocline.
Théorème 7.15 (Gourmelon).
Toute classe homocline de a l’une de ces propriétés :
-
–
il existe une perturbation de telle que possède une tangence homocline,
-
–
il existe une décomposition dominée telle que .
Potrie a appliqué [133] les techniques de ce chapitre à l’étude des classes homoclines qui sont stable au sens de Lyapunov à la fois pour et : puisqu’une telle classe reste un quasi-attracteur pour tout difféomorphisme générique proche, il n’est pas possible de faire bifurquer l’une de ses orbites périodiques en un puits tout en préservant l’intersection .
Théorème 7.16 (Potrie).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout , toute classe homocline qui est stable au sens de Lyapunov à la fois pour et possède une décomposition dominée non triviale.
Les bifurcations d’orbites périodiques avec contrôle de la classe homocline seront plus largement étudiée au chapitre 8.
7.9 Exemples d’Abraham-Smale
Nous reprenons la méthode de construction de Abraham-Smale pour obtenir les résultats déjà mentionnés de [9, 164, 28, 17] et [107, section 8]. L’idée est de considérer des ensembles hyperboliques transitifs d’une variété de dimension trois dont le fibré stable est un fibré en droites, mais dont la variété stable est de dimension deux (elle est feuilletée par les variétés stables des points de l’ensemble hyperbolique qui sont des sous-variétés de dimension un).
Théorème 7.17 (Newhouse [107], Asaoka [17]).
Toute variété de dimension , possède un ouvert non vide de difféomorphismes ayant une orbite périodique qui présente une tangence homocline robuste. De plus, la classe homocline n’a pas de décomposition dominée non triviale.
D’après le théorème 7.11, pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , la classe homocline est donc limite d’une infinité de puits ou de sources. (Phénomène de Newhouse identifié par Bonatti-Díaz.) Ceci fournit un exemple de dynamique sauvage, mentionné en introduction.
Proof.
La construction utilise l’exemple dû à Plykin [130] (voir aussi [157, section 8.9 ]) en dimension deux d’un difféomorphisme ayant un ensemble hyperbolique transitif d’indice qui est un attracteur. Sa variété stable locale est un voisinage de feuilleté par les variétés locales , . Voir la figure 7.1.
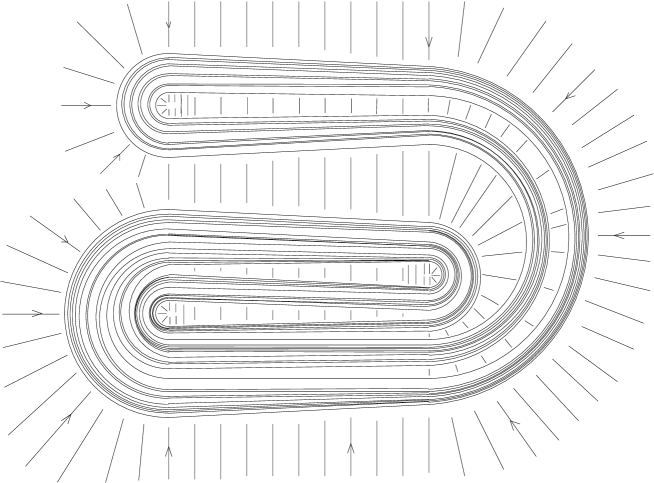
On peut alors plonger dans et considérer des difféomorphismes coincidant avec l’application sur . Pour suffisamment grand, la décomposition aux points correspondant aux coordonnées est dominée. On en déduit (voir par exemple le théorème 6.1) que pour tout difféomorphisme proche de , la continuation hyperbolique de est contenue dans une sous-variété invariante qui est -proche de .
Pour tout proche de , la surface est encore contenue dans l’ensemble stable de et possède un feuilletage en variétés stables , . Fixons une orbite périodique . Sa continuation appartient à une variété instable de dimension possédant un feuilletage par variétés instables fortes de dimension . Voir la figure 7.2.
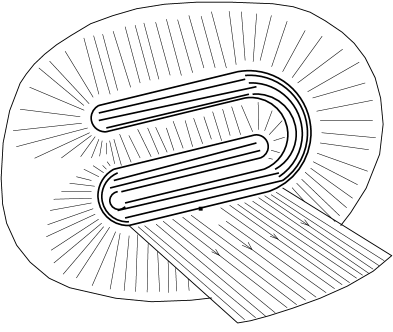
On peut alors modifier hors d’un voisinage de pour que et aient un point d’intersection transverse hors de tel que la feuille soit tangente à et de sorte que ces propriétés restent satisfaites pour tout difféomorphisme proche de et un point proche de . Par conséquent, l’ensemble hyperbolique possède une tangence homocline robuste. Voir la figure 7.3.
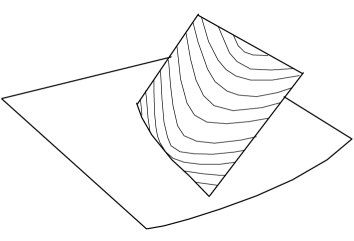
On peut demander qu’au voisinage de , il existe une feuille de qui soit transverse à . Pour tout proche de , il existe donc un point d’intersection non transverse entre une feuille de et qui soit accumulé par des points d’intersections transverses. Ceci implique que appartient à la classe homocline associée à .
De la même manière, on peut construire indépendemment un point d’intersection transverse hors de entre et tel que la feuille soit tangente à et de sorte que ces propriétés restent satisfaites pour tout difféomorphisme proche de et un point proche de .
La classe homocline ne possède pas de décomposition dominée non triviale. En effet, si elle possédait par exemple une décomposition avec , il est facile de voir que l’espace coïnciderait avec l’espace tangent à la feuille en et l’espace avec l’espace tangent à . Par construction ces espaces ne sont pas transverse et on obtiendrait une contradiction. ∎
Addenda.
Cette construction offre beaucoup de souplesse. On peut plonger indépendemment les dynamiques et et ainsi construire un difféomorphisme de qui possède deux ensembles hyperboliques , l’un d’indice et l’autre d’indice , tels que :
-
–
et sont chacun contenu dans une surface invariante par et respectivement, ayant un point d’intersection transverse.
-
–
possèdent chacun une orbite périodique telles que les variétés invariantes (de dimension deux) et aient un point d’intersection transverse.
On obtient donc la propriété suivante qui permet d’obtenir le théorème 3.7.
Il existe un ouvert non vide de difféomorphismes ayant des ensembles hyperboliques d’indice et respectivement qui présentent un cycle robuste : et sont non vides.
En dimension plus grande, la même construction permet de lier robustement des ensembles hyperboliques de tout indice compris entre et et d’empêcher l’existence de décomposition dominée non triviale.
7.10 Problèmes
a) Autres perturbations d’orbites périodiques.
D’autres types de perturbations de cocycles pourraient se révéler intéressants et donner lieu à des résultats perturbatifs dans le même esprit que ceux qui ont été présentés dans ce chapitre. Par exemple, on peut poser les questions suivantes.
-
–
Sous quelles conditions peut-on perturber une orbite périodique pour obtenir valeur propres de module ?
-
–
Quels sont les indices que l’on peut atteindre par bifurcation ?
-
–
Sous quelles conditions peut-on créer des valeurs propres complexes ?
Nous renvoyons aussi à [64] pour d’autres types de contraintes sur les perturbations de cocycles.
b) Hyperbolicité en volume des classes isolées.
Question 7.18.
Supposons que vérifie une condition -générique, considérons une mesure ergodique pour et un point appartenant à la classe de récurrence par chaînes du support de .
Existe-t-il une suite de points périodiques convergeant vers telles que la suite des mesures périodiques associées converge faiblement vers ?
On obtiendrait alors une version plus forte des théorèmes 7.10 et 7.13 et une réponse affirmative à la question suivante.
Question 7.19.
Supposons que vérifie une condition -générique.
Est-ce que toute classe homocline (ou plus généralement tout ensemble transitif par chaînes) vérifie la dichotomie suivante ?
-
–
est hyperbolique en volume ;
-
–
(ou une partie de ) est limite de Hausdorff d’une infinité de puits ou de sources.
c) Stabilité structurelle en régularité supérieure.
Nous avons déjà signalé que peu de résultats perturbatifs sont connus en régularité plus grande. En particulier, le lemme de Franks (qui est la motivation principale pour les résultats de ce chapitre) devient faux (voir [151, théorème D]). Nous renvoyons à [146] pour une discussion de la stabilité structurelle , .
Chapter 8 Points périodiques homocliniquement liés
Au chapitre 7, nous avons considéré séparément les orbites périodiques d’un difféomorphisme. Nous étudions à présent les orbites contenues dans une même classe de récurrence par chaînes : elles sont liées par la dynamique. Ceci permet d’une part de propager certaines propriétés vérifiées sur une partie à l’ensemble de la classe et d’autre part d’obtenir de nouvelles orbites périodiques comme moyenne d’orbites périodiques de la classe (spécification).
8.1 Spécification au sein d’une classe homocline (indice fixé)
Bowen a montré [41] que l’ensemble des orbites périodiques contenues dans un ensemble basique d’un difféomorphisme hyperbolique possède une propriété de spécification.
Définition 8.1.
Un ensemble d’orbites périodiques a la propriété de spécification si pour tout et pour toute collection finie d’orbites , il existe vérifiant : pour toute suites finies et , il existe une orbite périodique appartenant à et des entiers tels que :
-
–
pour tout et ;
-
–
appartient au -voisinage de pour tous et .
Pour les ensembles hyperboliques, l’entier ne dépend pas des orbites . Le résultat de Bowen a été généralisée [32] aux classes homoclines.111 La notion de spécification définie dans [41] est plus générale, puisqu’elle autorise à travailler avec des segments d’orbites qui ne sont pas périodiques. La définition proposée par [32], sous le terme de “transition”, est, elle aussi, un peu différente : elle décrit les cocycles linéaires au-dessus d’une famille d’orbites périodiques.
Proposition 8.2 (lemme 1.9 de [32]).
Pour tout point périodique hyperbolique , l’ensemble des orbites périodiques hyperboliques homocliniquement reliées à possède la propriété de spécification.
Les cocycles linéaires au-dessus d’une familles d’orbites périodiques ayant la propriété de spécification permettent plus de perturbations que les cocycles linéaires généraux étudiés au chapitre 7. (Il devient possible de remplacer une orbite périodique par une orbite périodique passant une grande proportion de temps proche de . La nouvelle orbite ressemble à , mais tout événement qui apparaît le long de l’orbite de apparaît un grand nombre de fois le long de l’orbite de .) On obtient une version plus forte du théorème 7.3.
Théorème 8.3 (Bonatti-Díaz-Pujals).
Pour tout , il existe tel que toute famille d’orbites périodiques de ayant la propriété de spécification satisfait l’un de ces deux cas :
-
–
il existe une décomposition -dominée non triviale au-dessus de ,
-
–
il existe une orbite dans et une -perturbation de la différentielle de le long de tels que le produit soit une homothétie.
8.2 Cycles hétérodimensionnels
Une autre bifurcation introduite dans [109] et mettant en jeu les variétés invariantes d’orbites périodiques s’est révélée importante (voir [34, chapitre 6]). Elle permet en particulier d’obtenir une propriété de spécification entre points périodiques d’indices différents.
Définition 8.4.
Deux orbites périodiques hyperboliques forment un cycle hétérodimensionnel si leurs indices sont différents et si et ne sont pas vides.
Ce type de bifurcation a été étudié intensivement notamment par L. Díaz et ses collaborateurs. Bien sûr, l’ensemble des difféomorphismes ayant un cycle hétérodimensionnel forme une partie maigre de . On peut toutefois renforcer la définition précédente.
Définition 8.5.
Deux orbites périodiques hyperboliques forment un cycle hétérodimensionnel robuste s’il existe des ensembles hyperboliques transitifs contenant respectivement et , tels que pour tout difféomorphisme proche de , on a et pour les continuations hyperboliques de et .
La section 7.9 présente des difféomorphismes avec cycles hétérodimensionnels robustes.
Connexions fortes.
Nous présentons maintenant un cadre qui permet d’obtenir un cycle hétérodimensionnel par perturbation. Considérons le cas où est muni d’une structure partiellement hyperbolique avec et supposons que pour tout voisinage de et tout , il existe un difféomorphisme proche de et une orbite périodique contenue dans dont l’exposant central appartient à et telle que et s’intersectent. On peut alors créer un cycle hétérodimensionnel en appliquant la remarque suivante.
Lemme 8.6.
Soit une orbite périodique ayant un unique exposant nul et telle que et s’intersectent. Il existe alors un difféomorphisme -proche ayant un cycle hétérodimensionnel.
Proof.
Par perturbation, on crée au voisinage de deux orbites périodiques ayant des exposants respectivement positifs et négatifs dans la direction centrale et connecté par un segment central. L’intersection entre et permet d’obtenir une intersection entre et . Voir la figure 8.1. ∎
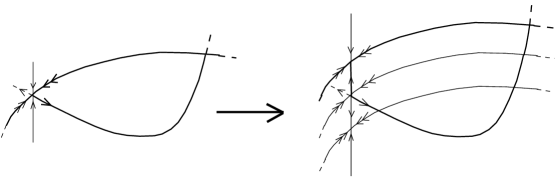
Nous dirons qu’une orbite périodique possède une connexion forte lorsque et s’intersectent.
Connexions fortes généralisées.
Nous donnons maintenant un mécanisme plus général que le lemme précédent pour engendrer des cycles hétérodimensionnels (voir par exemple [51]).
Lemme 8.7.
Considérons une classe homocline vérifiant :
-
–
il existe une décomposition dominée telle que et coïncide avec la dimension stable de ,
-
–
la variété stable forte tangente à coupe en un point différent de ,
et supposons qu’il existe des orbites périodiques homocliniquement reliées à ayant des exposants centraux arbitrairement proches de .
Il existe alors un difféomorphisme -proche ayant un cycle hétérodimensionnel.
Nous dirons qu’une classe homocline possède une connexion forte généralisée si elle vérifie les deux propriétés du lemme précédent.
8.3 Spécification au sein d’une classe homocline (indice variable)
Afin de travailler avec des orbites périodiques d’indices différents nous affaiblissons la propriété de spécification.
Définition 8.8.
Un ensemble d’orbites périodiques a la propriété du barycentre si pour tous , et , il existe appartenant à et des parties disjointes tels que :
-
–
et ;
-
–
appartient au -voisinage de (resp. de ) pour tout (resp. ).
Pour un difféomorphisme -générique, la propriété du barycentre est vérifiée [4] au sein des classes homoclines.
Théorème 8.9 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe homocline de , l’ensemble des orbites périodiques de contenues dans a la propriété du barycentre.
La démonstration reprend des arguments perturbatifs de [33, 6] : considérons deux orbites périodiques de périodes , contenues dans . En utilisant la proposition 7.2, on peut toujours supposer que leurs valeurs propres sont réelles et de multiplicité égale à . On peut alors perturber et obtenir un difféomorphisme pour lequel et sont reliée par un cycle hétérodimensionnel (voir la section 3.3).
On peut supposer de plus que le cycle est linéaire : il existe , et des cartes , au voisinage de et tels que
-
–
dans les cartes , l’application est affine et sa différentielle est diagonale ;
-
–
il existe un itéré négatif (resp. ) dont l’orbite négative reste proche de (resp. ) et un itéré positif (resp. ) dont l’orbite positive reste proche de (resp. ) tels que l’application (resp. ) est affine au voisinage de (resp. ) et sa différentielle est diagonale.
Pour tous suffisamment grands, on crée alors par perturbation de au voisinage de , une orbite périodique de période qui possède itérés consécutifs dans et itérés consécutifs dans . Par construction l’indice de l’orbite crée est compris entre ceux de et . De plus, pour un ouvert de difféomorphismes, intersecte la variété stable de l’une des orbites et intersecte la variété instable de l’autre. Puisque pour tout difféomorphisme -générique au voisinage de les classes homoclines de et coïncident, il existe un difféomorphisme proche de pour lequel appartient à cette classe.
8.4 Application (1) : indices des classes homoclines
Corollaire 8.10 ([33, 6]).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe homocline de , l’ensemble des indices des orbites périodiques de contenues dans est un intervalle de .
En combinant ce résultat avec le théorème 7.15, on obtient l’existence de fibrés centraux de dimension au-dessus des classes homoclines loin des tangences homoclines.
Corollaire 8.11 (Gourmelon [63]).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe homocline de l’une des deux propriétés suivantes est vérifiée.
-
–
possède une décomposition dominée
telle que et sont respectivement l’indice minimal et l’indice maximal de et chaque fibré est de dimension .
-
–
Il existe une orbite périodique homocliniquement reliée à et une perturbation de telle que la continuation hyperbolique de a une tangence homocline.
8.5 Application (2) : mesures génériques portées par une classe homocline isolée
Voici d’autres conséquences tirées de [4].
Corollaire 8.12 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe de récurrence par chaînes de , qui est isolée dans , toute mesure de probabilité invariante supportée sur est limite faible de mesures de probabilité supportées sur des orbites périodiques de .
En effet, la propriété est vérifiée pour les mesures ergodiques d’après le lemme de fermeture ergodique (théorème 4.1). Les orbites périodiques appartiennent nécessairement à . Les mesures invariantes non ergodiques sont approchées par des barycentres de mesures ergodiques et on conclut en utilisant la propriété du barycentre.
On en déduit le résultat suivant, démontré par Sigmund [163] dans le cas des ensembles hyperboliques localement maximaux transitifs et annoncé par Mañé [94].
Théorème 8.13 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe de récurrence par chaînes de , qui est isolée dans , l’ensemble des mesures de probabilité invariantes supportées dans contient un Gδ dense de mesures qui sont :
-
–
ergodiques,
-
–
de support total (),
-
–
d’entropie nulle,
-
–
hyperboliques,
-
–
et dont la décomposition d’Oseledets en -presque tout point s’étend à l’espace tangent au-dessus de en une décomposition dominée.
Voici une conséquence du théorème précédent et de la proposition 5.10.
Corollaire 8.14 (Abdenur-Bonatti-Crovisier).
Pour toute classe homocline isolée d’un difféomorphisme -générique et toute mesure générique supportées sur , presque tout point possède une variété stable et une variété instable.
Utilisant la spécification, Díaz et Gorodetski [52] obtiennent l’existence de mesures ergodiques non hyperboliques.
Théorème 8.15 (Díaz-Gorodetski).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout toute classe homocline contenant des points périodiques d’indices différents contient également une mesure invariante ergodique ayant au moins un exposant de Lyapunov nul.
8.6 Application (3) : dynamique universelle
Pour , notons la boule standard fermée unité de et l’espace des plongements préservant l’orientation de dans l’intérieur d’elle-même, muni de la topologie , .
Un difféomorphisme est -universel si sa dynamique contient les dynamiques associées à une partie dense d’éléments de . Donnons une définition plus précise.
Définition 8.16.
Considérons un entier . Un difféomorphisme est -universel au voisinage d’un ensemble compact invariant par si pour tout ouvert et tout voisinage de , il existe un plongement et un entier vérifiant :
-
1.
l’image de dans est disjointe de ses premiers itérés,
-
2.
les ensembles , sont contenus dans ,
-
3.
est contenu dans et l’application définie sur appartient à .
Lorsque nous dirons simplement que est -universel.
Remarque 8.17.
-
1.
Si est -universel au voisinage de , l’application l’est également puisque pour tout difféomorphisme , il existe tel que l’image de la boule standard de rayon par contient dans son intérieur et l’application coïncide avec sur .
-
2.
Les dynamiques génériques -universelles sur une variété de dimension sont les dynamiques génériques les plus compliquées puisqu’elles contiennent toutes les pathologies associées aux difféomorphismes génériques de : lorsque , une telle dynamique possède une infinité de puits et de sources, des cycles hétérodimensionnels robustes, des tangences homoclines robustes,…
Voici un critère [27] d’existence de dynamique universelle.
Théorème 8.18 (Bonatti-Díaz).
Il existe un Gδ dense de dont les difféomorphismes sont -universels au voisinage de toute classe homocline vérifiant les propriétés suivantes :
-
–
n’a pas de décomposition dominée non triviale,
-
–
contient des orbites périodiques dont le jacobien à la période est de module strictement plus grand que , et des orbites dont le jacobien moyen à la période est de module strictement plus petit que .
Idée de la démonstration.
On utilisera le lemme élémentaire suivant (voir [77, Chapitre 8]).
Lemme 8.19.
Pour tout , et tout élément , il existe une application différentiable telle que
-
–
pour tout , est un difféomorphisme de qui coïncide avec l’identité hors d’une partie compacte de ;
-
–
est l’identité de ;
-
–
la restriction de à coïncide avec .
Démonstration du lemme.
On peut se ramener au cas où fixe .
On construit tout d’abord une application de classe telle que est l’identité sur et coïncide avec sur . En effet, on peut choisir un chemin différentiable dans entre et paramétré par . Pour , on définit comme restriction à de l’application .
En différentiant l’application on obtient un champs de vecteurs de la forme . En l’étendant au moyen d’une partition de l’unité, on définit un champs de vecteurs dépendant du temps sur à support compact. L’application est alors le flot associé. ∎
Considérons un voisinage ouvert de et un élément .
En utilisant le théorème 8.9, on déduit qu’il existe dans un ensemble dense de points périodiques dont le jacobien est positif et dont le jacobien moyen à la période est arbitrairement proche de . On peut aussi choisir cet ensemble pour qu’il ait la propriété de spécification. Puisque n’a pas de décomposition dominée, il existe (théorème 8.3) une telle orbite périodique et une perturbation arbitrairement petite de pour laquelle est une homothétie. Puisque le jacobien moyen à la période de l’orbite de est proche de , on peut aussi perturber pour que soit l’identité de . Une nouvelle perturbation permet de créer un plongement vérifiant les propriétés 1 et 2 de la définition 8.16 et telle que coïncide avec l’identité sur .
D’après le lemme 8.19, il existe une famille de difféomorphismes de et tels que , coïncide avec sur et pour tout le support du difféomorphisme soit contenu dans la boule de rayon . On choisit alors un entier suffisamment grand pour que chaque difféomorphisme pour soit arbitrairement proche de l’identité de en topologie . Nous avons ainsi fragmenté le difféomorphisme :
On peut perturber en un difféomorphisme ayant les mêmes propriétés sauf que coïncide avec la rotation d’angle sur . Si est suffisamment grand, cette perturbation de est suffisamment petite. Il existe une boule disjointe de ses premiers itérés par : c’est l’image de la boule standard de rayon par une homothétie . Sur , pour , on remplace par la composition
Par construction, cette application est une petite perturbation de dans . Si l’on pose , la boule est -périodique, disjointe de ses premiers itérés et le plongement envoie sur une boule et vérifie sur .
Puisque est dense dans , nous avons montré que pour tout difféomorphisme ayant une classe homocline vérifiant les hypothèse du théorème 8.18, pour tout voisinage de , pour tout ouvert non vide , il existe une perturbation de et un plongement tel que les propriétés 1, 2, 3 de la définition 8.16 soient satisfaites. On conclut la démonstration par un argument de généricité. ∎
Les constructions de la section 7.9 montrent que pour toute variété de dimension , il existe un ouvert non vide de difféomorphismes ayant une classe homocline qui vérifie les propriétés du théorème 8.18. Voici une conséquence.
Corollaire 8.20.
Pour toute variété de dimension , il existe un ouvert non vide et un Gδ dense de formé de difféomorphismes qui sont -universels au voisinage d’une classe homocline .
Les dynamiques -universelles impliquent l’existence de classes apériodiques.
Proposition 8.21 (Bonatti-Díaz).
Pour , il existe un Gδ dense tel que tout difféomorphisme -universel possède un ensemble non dénombrable de classes apériodiques qui sont stables au sens de Lyapunov pour et pour .
Proof.
Il existe un ouvert de difféomorphismes ayant une classe homocline vérifiant les propriétés du théorème 8.18. En appliquant inductivement le théorème 8.18, on en déduit qu’il existe une suite de plongements et d’entiers tels que pour tout :
-
–
l’image est disjointe de ses premiers itérés et vérifie pour pair et pour impair ;
-
–
le supremum des diamètres des ensembles pour et tend vers lorsque ;
-
–
pour pair et pour impair appartiennent à ;
-
–
la suite est décroissante.
L’intersection décroissante
possède une base de voisinages attractifs pour et une base de voisinages attractifs pour . Par conséquent est une classe de récurrence par chaînes qui est stable au sens de Lyapunov pour et . Par construction elle n’a pas de point périodique.
Remarquons que dans chaque orbite on peut choisir deux orbites et disjointes. Il existe donc une collection non dénombrable de suites ayant les propriétés énoncées ci-dessus qui engendrent des classes apériodiques deux à deux disjointes. ∎
Remarque 8.22.
Les classes apériodiques ainsi obtenues sont des odomètres. En particulier, leur dynamique est minimale, uniquement ergodique.
8.7 Mélangeurs, obtention de bifurcations robustes
Dans le cadre des dynamiques -génériques, Bonatti et Díaz ont identifié [27, 30] un mécanisme (les mélangeurs) permettant de construire des cycles hétérodimensionnels robustes. On peut se demander si tout difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel peut être approché par un difféomorphisme ayant un cycle hétérodimensionnel robuste.
Théorème 8.23 (Bonatti-Díaz).
Il existe un Gδ dense tel que, tout ayant deux orbites périodiques hyperboliques d’indices différents et contenues dans une même classe de récurrence par chaînes possède un cycle hétérodimensionnel robuste.
Le cycle hétérodimensionnel robuste est contenu dans un petit voisinage de la classe . (Dans les bons cas, il appartient à la classe.)
Bonatti et Díaz ont annoncé [31] pouvoir rendre robuste une tangence homocline liée à une classe homocline ayant plusieurs indices. Ceci complète le théorème 7.15.
Théorème 8.24 (Bonatti-Díaz).
Il existe un Gδ dense tel que pour tout et toute classe homocline contenant un point périodique d’indice différent de , la dichotomie (robuste) suivante est vérifié :
-
–
possède une tangence robuste,
-
–
il existe une décomposition dominée telle que .
8.8 Problèmes
Au cours des chapitres 7 et 8, nous avons obtenu des résultats d’existence d’orbites périodiques par bifurcation de la dynamique au sein d’une classe de récurrence par chaînes . Nous pouvons distinguer trois sortes d’orbites périodiques :
-
–
les orbites périodiques contenues dans la classe ,
-
–
celles qui sont proches de en topologie de Hausdorff,
-
–
celles contenues dans un voisinage de .
a) Complétude des indices.
Par exemple, le corollaire 8.10 donne des informations sur l’ensemble des indices d’une classe homocline. Nous pouvons naturellement formuler des questions sur l’ensemble des indices des orbites périodiques contenues dans un voisinage d’une classe homocline. Le problème de l’existence de classes pelliculaires (question 6.5) consiste à décrire le lien entre l’ensemble des indices d’une classe et l’ensemble des indices des orbites périodiques proches de la classe.
Question 8.25.
Supposons que vérifie une condition -générique et soit une classe de récurrence par chaînes.
-
–
Supposons que soit limite de Hausdorff d’orbites périodiques d’indice et . Est-elle également limite d’orbites d’indice pour tout ?
-
–
Supposons qu’une partie de soit limite de Hausdorff d’orbites périodiques d’indice . Est-ce également le cas de la classe toute entière ?
b) Dynamique au sein des classes homoclines.
Il serait très intéressant d’étendre le corollaire 8.12 aux classes homoclines non isolées. Les résultats de ce chapitre montrent que l’on peut se ramener au cas des mesures ergodiques.
Question 8.26.
Supposons que vérifie une condition -générique et soit une classe homocline de .
Les mesures ergodiques supportées par sont-elles limites faibles de mesures de probabilité invariantes supportées par des orbites périodiques de ?
Un tel “lemme de fermeture ergodique au sein des classes homoclines” permettrait par exemple de répondre à la question 7.19 ainsi qu’à la question 4.13 pour les classes homoclines.
Nous avons une compréhension relativement fine des orbites périodiques à l’intérieur d’une classe homocline, mais la dynamique reste mal comprise, en particulier les questions de théorie ergodique.
Question 8.27.
Considérons une classe homocline d’un difféomorphisme -générique. Existe-t-il une mesure d’entropie maximale ?
c) Importance des cycles hétérodimensionnels.
Tous les exemples connus de dynamiques robustement non hyperboliques possèdent un cycle hétérodimensionnel. Bonatti et Díaz [30] ont conjecturé que c’ést toujours le cas.
Conjecture d’hyperbolicité (Bonatti-Díaz).
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme qui est hyperbolique ou possède un cycle hétérodimensionnel robuste.
Cette conjecture concerne exclusivement la topologie puisqu’elle n’est pas vérifiée par les difféomorphismes des surfaces (du fait du phénomène de Newhouse). Une étape dans cette direction serait de montrer que la présence de tangences homoclines implique l’existence de cycles hétérodimensionnels.
On peut énoncer des versions semi-locales de cette conjecture.
Question 8.28.
Supposons que vérifie une condition -générique.
Est-ce que tout voisinage d’un ensemble transitif par chaîne non hyperbolique contient un cycle hétérodimensionnel robuste ?
Est-ce que toute classe homocline non hyperbolique contient un cycle hétérodimensionnel robuste ?
d) Dynamique sur les surfaces.
Le théorème 3.7 montre que sur toute variété de dimension supérieure ou égale à , il existe des ouverts de difféomorphismes non hyperboliques. Cette question reste ouvert en dimension . Smale a conjecturé 222Je n’ai pas trouvé de trace de cette conjecture sur les surfaces. Au début des années 1960, il a explicitement posé le problème de la densité des dynamiques structurellement stables [166]. Dans ses textes récents [173, 174], Smale conjecturait la densité des dynamiques hyperboliques pour les endomorphismes en dimension . que ce n’était pas le cas. C’est un cas particulier de la conjecture d’hyperbolicité.
Conjecture (Smale).
Lorsque , l’ensemble des difféomorphismes hyperboliques est dense dans .
e) Tangences robustes.
Par analogie avec les cycles hétérodimensionnels [30], on aimerait savoir dans quelle mesure un difféomorphisme présentant une tangence homocline est approché par des difféomorphismes ayant des tangences robustes.
Question 8.29.
Considérons un ouvert qui contient un ensemble dense de difféomorphismes présentant une tangence homocline. Existe-t-il un difféomorphisme dans qui possède une tangence robuste ?
Question 8.30.
Considérons un difféomorphisme -générique qui est limite de difféomorphismes ayant une tangence homocline. Existe-t-il une classe homocline sans décomposition dominée avec ?
Question 8.31.
Considérons un difféomorphisme -générique et une classe homocline n’ayant pas de décomposition dominée avec . Est-ce que possède une tangence robuste ?
Sur les surfaces, le théorème 7.9 montre qu’il n’y a pas de tangence robuste et une réponse positive à la question 8.29 entraînerait la conjecture de Smale. Une approche possible consiste à contrôler les points critiques de la dynamique : il résulte du travail de Pujals et Sambarino [148] que les difféomorphismes de surface génériques et non hyperboliques possèdent des classes sans décomposition dominée. Lorsque la dynamique sur une telle classe est dissipative (le jacobien de toute mesure invariante est strictement négatif), Pujals et Rodriguez-Hertz [147] ont introduit un ensemble critique : un ensemble fermé tel que tout compact invariant transitif qui ne le rencontre pas est un puits ou possède une décomposition dominée.
Chapter 9 Dynamique loin des tangences homoclines : modèles centraux
L’un des objectifs de ce chapitre est l’étude des dynamiques qui ne peuvent pas être approchés par des difféomorphismes ayant des tangences homoclines. Une motivation est la conjecture de Palis présentée en section 9.1.
Un aspect fondamental de cette approche consiste à comprendre la dynamique le long d’un fibré de dimension un. Lorsque les exposants de Lyapunov sont nuls pour toute mesure invariante, la dynamique de l’application tangente donne très peu d’informations. Nous développons de nouveaux outils, introduits dans [49, 50] pour obtenir des propriétés d’hyperbolicité topologique ou pour trouver des obstructions à l’hyperbolicité qui apparaissent sur les orbites périodiques.
Nous utilisons les modèles centraux pour montrer [49] que tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme Morse-Smale ou par un difféomorphisme ayant une intersection homocline transverse. Nous établissons un résultat [50] en direction de la conjecture de Palis : tout difféomorphisme qui ne peut pas être approché dans par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel est partiellement hyperbolique : l’ensemble récurrent par chaînes se décompose en un nombre fini d’ensembles compacts invariants partiellement hyperboliques dont le fibré central est de dimension au plus égale à deux. Finalement, nous étudions les quasi-attracteurs des dynamiques génériques loin des tangences homoclines : en particulier, J. Yang a montré [187] que ce sont des classes homoclines.
9.1 Mécanismes versus phénomènes
Un des buts de l’étude des difféomorphismes -génériques est de structurer l’espace des difféomorphismes en fonction des types de dynamiques qui apparaissent. Voir [160, 172]. Par exemple, les difféomorphismes hyperboliques peuvent être classés en trois ouverts de complexité croissante : les difféomorphismes Morse-Smale, les difféomorphismes structurellement stables et les difféomorphismes -stables. Plus généralement, on cherche des parties (de préférence ouvertes) de l’espace des difféomorphismes pour lesquelles la dynamique peut être décrite globalement, avec un degré de précision variable : on peut simplement chercher à décrire la décomposition en classes de récurrence par chaînes (Est-elle finie ? sans classe apériodiques ?…) ou vouloir comprendre la dynamique au sein de chaque classe de récurrence par chaînes.
Une autre approche consiste à caractériser les ouverts précédément introduits en exhibant des obstructions qui apparaissent dans leur complémentaire. Par exemple, nous verrons en section 9.10 que l’ensemble des difféomorphismes ayant une intersection homocline non triviale est dense dans le complémentaire de l’ensemble (ouvert) des dynamiques Morse-Smale.
On cherche des obstructions qui soient simples et faciles à détecter (en général mettant en jeu des orbites périodiques). Elle ne décrivent pas la dynamique de façon satisfaisante puisque ce sont souvent des bifurcations locales, mais elles peuvent engendrer une modification importante de la dynamique. Une telle décomposition de l’espace des difféomorphismes en parties possédant un ensemble dense de bifurcations et en ouverts de dynamiques globalement bien décrite est appelée par E. Pujals décomposition par mécanismes et phénomènes.
9.2 Caractérisation des dynamiques hyperboliques
Un autre exemple de dichotomie est une des conjecture proposée par Palis [115, 116, 117] qui cherche à caractériser l’ouvert des dynamiques hyperboliques.
Conjecture (Palis).
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme qui présente une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
Nous verrons au chapitre 10 que cette conjecture a été résolue sur les surfaces par Pujals et Sambarino. Une réponse positive à la conjecture d’hyperbolicité entraînerait la conjecture de Palis. (Précisons toutefois que la conjecture de Palis a été également formulée en régularité , et que la conjecture d’hyperbolicité n’est pas satisfaite dans ce cadre.) Nous allons voir maintenant que cette conjecture peut être généralisée d’une autre façon.
Notation.
Par la suite, nous noterons l’ensemble des difféomorphismes ayant une tangence homocline et l’ensemble de ceux qui possèdent un cycle hétérodimensionnel.
La conjecture de Palis est vérifiée si l’on se restreint aux difféomorphismes dont le nombre de classe de récurrence par chaînes est robustement fini (voir [1, 59]).
Théorème 9.1 (Abdenur,Gan-Wen).
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme ayant l’une des propriétés suivantes :
-
–
est hyperbolique,
-
–
présente un cycle hétérodimensionnel,
-
–
possède une infinité de classes de récurrence par chaînes.
Proof.
Considérons un difféomorphisme qui ne peut pas être approché par un difféomorphisme ayant une infinité de classes de récurrence par chaînes. Quitte à le perturber, on peut supposer qu’il vérifie une condition de généricité. En particulier, ses classes sont des classes homoclines et tout difféomorphisme proche de possède exactement classes de récurrence par chaînes.
Supposons que la classe (non triviale) n’est pas hyperbolique. Nous montrons que par perturbation, il est possible de créer au voisinage de un point périodique d’indice différent de l’indice de . Par hypothèse le point appartient à la même classe que et une nouvelle perturbation permet alors de créer par perturbation un cycle hétérodimensionnel (section 3.3).
Si la décomposition du fibré tangent au-dessus des orbites périodiques homocliniquement reliée à en espaces stables et instables n’est pas uniformément dominée, le théorème 7.3 permet de conclure directement.
Si possède une décomposition dominée avec , et si par exemple le fibré n’est pas uniformément contracté, il existe une mesure ergodique supportée sur ayant un exposant de Lyapunov selon positif ou nul. Le théorème 4.1 et son addendum permettent alors de créer un point périodique d’indice strictement plus petit que . ∎
Nous avons déjà mentionné l’existence de difféomorphismes -génériques dont le nombre de classes de récurrence par chaînes n’est pas fini. Les exemples connus sont toujours associés à la présence de tangences homoclines et Bonatti a conjecturé [21] que c’est toujours le cas. Cette nouvelle conjecture entraînerait donc la conjecture de Palis.
Conjecture de finitude (Bonatti).
Il existe un ouvert dense de formé de difféomorphismes dont le nombre de classes de récurrence par chaînes est fini ?
Newhouse, Palis-Viana et Romero [108, 123, 158] ont montré que l’on obtient une infinité de puits ou de sources pour certains difféomorphismes proches des tangences homoclines. Une réponse positive à la conjecture de finitude donnerait une réciproque en topologie en répondant à la question suivante.
Est-ce que tout difféomorphisme -générique présentant le phénomène de Newhouse peut être approché par un difféomorphisme ayant une tangence homocline ?
9.3 Dynamiques non critiques
La discussion qui précède motive l’étude des difféomorphismes (non hyperboliques) loin des tangences homoclines. Nous connaissons plusieurs classes d’exemples :
-
–
certaines dynamiques de type “dérivé d’Anosov” décrites en section 5.10,
-
–
les dynamiques proches du temps d’un flot d’Anosov ou du produit d’un difféomorphisme d’Anosov par l’identité sur le cercle [27].
Une classe d’exemples est fournie par la construction de Mañé (section 5.10). La démonstration du théorème 9.1 nous montre que, pour de telles dynamiques, toute classe homocline non hyperbolique est accumulée par des points périodiques d’indices différents. La question principale consiste alors à comprendre si ces points appartiennent tous à une même classe (on obtient ainsi des cycles hétérodimensionnels par perturbation) ou si le difféomorphisme possède une infinité de classes distinctes.
Pour des dynamiques loin des tangences homoclines, le théorème 7.6 montre que la décomposition du fibré tangent en espaces stables et instables au-dessus des orbites périodiques est uniformément dominée. Le théorème 7.1 implique que tout fibré qui n’est pas uniformément contracté ou dilaté permet de changer l’indice d’orbites périodiques. Une réponse positive à la conjecture de finitude permettrait donc de répondre affirmativement au problème suivant (voir [6]).
Question 9.2.
Existe-t-il un Gδ dense de formé de difféomorphismes dont toutes les classe homoclines ont une décomposition dominée
où et sont uniformément contractés et dilatés et où et sont respectivement le plus petit et le plus grand indice de la classe ?
9.4 Ensembles minimaux non hyperboliques
Considérons un difféomorphisme non hyperbolique. Il possède un ensemble transitif par chaînes qui n’est pas hyperbolique. On peut choisir minimal pour l’inclusion : un tel ensemble est alors appelé ensemble minimal non hyperbolique.
Lorsque appartient à , le théorème 5.17 implique le résultat suivant [60] qui est une première réponse locale à la question 9.2.
Théorème 9.3 (Gan-Wen-Yang).
Pour tout difféomorphisme non hyperbolique appartenant à un Gδ dense de , tout ensemble minimal non hyperbolique admet une décomposition dominée
telle que et sont uniformément contractés respectivement par et et chaque fibré central est de dimension .
Pour tout , l’ensemble est limite de Hausdorff d’une suite d’orbites périodiques dont l’exposant de Lyapunov le long de est arbitrairement proche de . Lorsque , est contenu dans une classe homocline et on peut choisir les orbites dans .
En particulier lorsque est loin des cycles hétérodimensionnels, une classe homocline possède un unique indice (section 3.3). La dimension centrale est donc égale à ou .
Corollaire 9.4 (Wen [182]).
Pour tout difféomorphisme non hyperbolique appartenant à un Gδ dense de , tout ensemble minimal non hyperbolique admet une décomposition dominée de type ou , telle que et sont uniformément contractés respectivement par et et chaque fibré central ou est de dimension .
Dans le deuxième cas, est contenu dans une classe homocline d’indice .
Démonstration du théorème 9.3.
Le corollaire 7.7 implique que pour tout , l’ensemble des points périodiques de d’indice a une décomposition dominée telle que . En particulier, le théorème 5.17 s’applique.
Si est contenu dans une classe apériodique (en considérant par exemple la décomposition dominée triviale ) seul le troisième cas du théorème 5.17 peut avoir lieu : contient un ensemble partiellement hyperbolique ayant un fibré central de dimension . Puisque est un ensemble minimal non hyperbolique, il coïncide avec .
Si est contenu dans une classe homocline , le théorème 5.17 assure que l’ensemble des indices de est un intervalle. Ceci entraîne l’existence d’une décomposition dominée
telle que les fibrés soient de dimension et telle que ne contienne pas de point d’indice ou . On peut supposer de plus que et sont minimales pour ces propriétés.
Si n’est pas uniformément contracté au-dessus de , nous envisageons les trois cas du théorème 5.17.
-
–
Le premier cas n’apparaît pas puisque ne contient pas de point d’indice .
-
–
Dans le second cas, contiendrait des points périodiques d’indice ayant un exposant de Lyapunov stable proche de . Puisque est une classe homocline, l’ensemble de ces points périodiques est dense dans . Le théorème 5.17 implique alors que possède une décomposition dominée telle que . Ceci contredit la minimalité de .
-
–
Dans le troisième cas, l’ensemble est partiellement hyperbolique et la dimension du fibré central vaut .
Nous obtenons donc une décomposition dominée où et sont uniformément contracté et dilaté et où chaque fibré est de dimension et n’est pas uniformément contracté ni dilaté.
Si l’on suppose que , le troisième cas du théorème 5.17 n’a pas lieu. Le théorème appliqué à la décomposition pour montre alors que est contenu dans une classe homocline ayant des orbites périodiques d’indice supérieur ou égal à . Appliquons le théorème à la décomposition pour :
-
–
dans le premier cas du théorème, possède aussi des orbites périodiques d’indice et, d’après le théorème 8.9, contient des orbites périodiques dont le -ème exposant est arbitrairement proche de ;
-
–
dans le second cas, nous concluons directement que possède des orbites périodiques dont le -ème exposant est arbitrairement proche de .
∎
Passage du local au global.
Nous souhaitons étendre la décomposition dominée donnée par le théorème 9.3 sur l’ensemble minimal non hyperbolique à toute la classe de récurrence par chaînes contenant .
Pour chaque décomposition dominée sur donnée par ce théorème, il existe une suite d’orbite périodiques qui convergent vers en topologie de Hausdorff et dont l’indice est égal à . On peut espérer utiliser la transitivité par chaînes de pour construire une suite d’orbites périodiques ayant le même indice que les orbites mais convergeant vers . (Ce serait le cas si les questions 8.25 ou 8.26 admettaient des réponses positives.) Si le difféomorphisme est loin des tangences homoclines, le corollaire 7.7 impliquerait alors que la décomposition s’étend à toute la classe .
La construction d’une telle suite d’orbites périodiques est délicate et fait l’objet des résultats principaux de ce chapitre. Si l’on sait montrer que les orbites périodiques appartiennent à la classe , nous concluons directement puisque coïncide alors avec la classe homocline et contient une orbite périodique du même indice que qui est -dense dans pour tout .
9.5 Modèles centraux
a) Définition
Afin de décrire la dynamique centrale pour un ensemble ayant une décomposition dominée avec , nous introduisons le modèle suivant.
Définition 9.5.
Un modèle central est une paire formée
-
–
d’un espace compact métrique , (sa base),
-
–
d’une application continue ,
satisfaisant les propriétés suivantes :
-
–
;
-
–
est un homéomorphisme local au voisinage de : il existe une application continue telle que et coïncident avec l’identité respectivement sur et ;
-
–
est un produit fibré de la forme .
Puisque n’est pas préservé, la dynamique hors de n’est pas toujours bien définie. C’est pourtant cette partie qui nous intéresse ici.
Définition 9.6.
-
–
Un sous-ensemble est une bande si pour tout , l’intersection est un intervalle.
-
–
Une bande ouverte qui satisfait est dite attractive pour .
-
–
Un intervalle avec est un segment récurrent par chaînes s’il est contenu dans un ensemble compact invariant transitif par chaînes .
Des arguments similaires à ceux de Conley pour obtenir le théorème 1.1 donnent un critère d’existence de bandes attractives.
Proposition 9.7 (proposition 2.5 de [49] et proposition 2.2 de [50]).
Considérons un modèle central dont la base est transitive par chaînes. Il y a cas disjoints possibles.
-
–
Les ensembles stables et instables par chaînes de ne sont pas triviaux. De façon équivalente, il existe un segment récurrent par chaînes.
-
–
Les ensembles stables et instables par chaînes de sont triviaux. De façon équivalente, il existe une base de voisinages de par bandes attractives pour et une base de voisinages de par bandes attractives pour .
-
–
L’ensemble instable par chaînes est trivial, l’ensemble stable par chaînes contient un voisinage de . Il existe alors une base de voisinages de par bandes attractives.
-
–
L’ensemble stable par chaînes est trivial, l’ensemble instable par chaînes contient un voisinage de . (C’est le cas symétrique du précédent.)
En particulier, l’existence d’un segment récurrent par chaînes est une propriété locale au voisinage de .
b) Modèles centraux en dynamique différentiable
Considérons un ensemble compact -invariant ayant une décomposition dominée avec .
Définition 9.8.
Un modèle central est associé à s’il existe une application continue ayant les propriétés suivantes :
-
–
;
-
–
sur ;
-
–
les applications pour forment une famille continues de plongements de dans ;
-
–
pour tout , la courbe est tangente à .
Deux cas peuvent être distingués :
- – Le cas orientable.
-
Il existe une orientation continue de préservée par . Ceci permet de définir les fibrés en demi-droites et .
- – Le cas non orientable.
-
Lorsque est transitif par chaînes, la dynamique induite par sur le fibré unitaire associé à est encore transitif par chaînes.
Considérons une famille de plaques localement invariante et tangente à , donnée par le théorème 5.2. La dynamique de se relève par en une dynamique localement définie au voisinage de la section . Dans le cas orientable, on note et les fibrés s’identifient à , et respectivement. Dans le cas non orientable, on note l’espace unitaire de et on considère l’application surjective définie par . Ceci entraîne l’existence d’un modèle central pour .
Proposition 9.9 (proposition 3.2 de [49]).
Associé à un ensemble compact invariant ayant une décomposition dominée avec , il existe un modèle central . Lorsque est transitif par chaînes, on peut choisir transitive par chaînes :
-
–
dans le cas non orientable, l’ensemble coïncide avec l’espace unitaire de et est la restriction de la projection ;
-
–
dans le cas orientable, l’application est un homéomorphisme et on peut choisir l’orientation de chaque courbe compatible avec .
c) Classification des dynamiques centrales
Supposons que soit transitif par chaînes. Considérons une famille de plaques localement invariante et la dynamique induite par sur un voisinage de la section dans .
Nous obtenons les cas suivants, non disjoints en général (voir la figure 9.1).
- – Le type (R), récurrent par chaînes.
-
Pour tout , il existe un point et un segment contenant tel que tous les itérés , , soient de longueur bornée par et tel que est inclus dans un ensemble transitif par chaînes contenu dans le -voisinage de .
Une telle courbe est appelée segment central de .
- – Le type (N), neutre par chaînes.
-
Il existe une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs (i.e. ) et une base de voisinages répulsifs.
- – Le type (H), hyperbolique par chaînes.
-
Il existe une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs pour (le cas attractif) ou pour (le cas répulsif) et dont l’image par est respectivement contenue dans l’ensemble stable par chaînes ou dans l’ensemble instable par chaînes de .
- – Le type (P), parabolique par chaînes.
-
Nous sommes alors dans le cas orientable. Trois possibilités apparaissent.
- – Le type (PSU).
-
Quitte à renverser l’orientation sur , il existe une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs pour et qui se projettent par dans l’ensemble stable par chaînes de ; il existe également une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs pour et qui se projettent par dans l’ensemble instable par chaînes de .
- – Les types (PSN) et (PUN)
-
respectivement. Quitte à renverser l’orientation sur , il existe une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs pour (resp. ) et qui se projettent par dans l’ensemble stable (resp. instable) par chaînes de ; il existe également une base de voisinages ouverts de la section qui sont attractifs (i.e. ) et une base de voisinages de qui sont répulsifs.
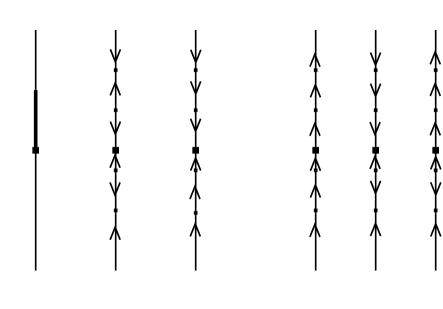
Le type de la dynamique centrale de dépend pas du choix d’une famille de plaques .
Proposition 9.10 (Corollaire 2.6 de [50]).
Considérons un ensemble compact invariant transitif par chaînes muni d’une décomposition dominée avec et deux familles de plaques localement invariantes tangentes à . Alors les types de dynamiques centrales associés à coïncident.
Les types du fibré seront donc définis comme étant les types de dynamiques centrales associé à un choix de famille de plaques centrales localement invariantes.
9.6 Lorsqu’un fibré est dégénéré
Nous nous intéressons au cas où le fibré est dégénéré : dans les bons cas, l’ensemble est un puits ou bien le fibré est “topologiquement répulsif”.
Proposition 9.11 (proposition 2.7 de [50]).
Considérons un ensemble compact invariant transitif par chaînes muni d’une décomposition dominée avec . Si est de type (N), (H)-attractif ou (P), l’ensemble contient un point périodique.
En particulier si est un difféomorphisme Kupka-Smale, le fibré ne peut pas avoir les types (P) ou (N). S’il est de type (H)-attractif, l’ensemble est un puits.
Si satisfait une condition de généricité, le type (R) ne peut pas non plus apparaître111Voir [50, proposition 4.3] ; l’énoncé suppose uniformément contracté, mais la démonstration ne l’utilise pas.. On en déduit la proposition suivante.
Proposition 9.12.
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact invariant transitif par chaînes muni d’une décomposition dominée avec , alors ou bien est un puits, ou bien est de type (H)-répulsif.
Lorsque est de classe , Pujals et Sambarino remplacent l’hypothèse de généricité par un argument “à la Denjoy-Schwartz”. En voici une re-formulation.
Théorème 9.13 (Pujals-Sambarino, section 3.3 de [148] et théorème 3.1 de [149]).
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une décomposition dominée avec et une famille de plaques localement invariante tangente à . Si est de classe , l’un des cas suivants se produit.
-
a)
contient un point périodique dont l’exposant selon est négatif ou nul.
-
b)
contient une courbe fermée tangente au fibré et invariante par un itéré , . La dynamique sur la courbe est conjuguée à une rotation irrationnelle.
-
c)
La dynamique centrale de est stable au sens de Lyapunov pour :
-
–
pour tout , il existe tel que pour tout , les itérés négatifs du -voisinage de dans sont tous de taille inférieure à ;
-
–
pour tout , il existe tel que le -voisinage de dans est contenu dans l’ensemble instable de .
-
–
Remarque 9.14.
Lorsque est transitif par chaînes, on peut compléter le cas c) de la proposition précédente et garantir que le fibré est de type (H)-répulsif, comme pour la proposition 9.12.
En effet, la dynamique centrale ne peut posséder de bandes attractives contenues dans un voisinage arbitrairement petit de la section (puisque, d’après l’item c), chaque point de possède une variété instable tangente à ).
Il ne peut y avoir non plus de segment transitif par chaînes : d’après le théorème 3.1 de [149], quitte à remplacer par son ensemble -limite, est une courbe périodique bordée par un point périodique hyperbolique d’indice et un point périodique ayant un exposant négatif ou nul selon . Il doit alors exister une pseudo-orbite de segments centraux au-dessus d’une pseudo-orbite de vérifiant et . Ceci implique que contient un point périodique ayant un exposant négatif ou nul selon .
9.7 Dynamique centrale récurrente par chaînes
Lorsque est partiellement hyperbolique avec un fibré central récurrent par chaînes, on en déduit facilement que certaines orbites périodiques sont contenues dans la classe de récurrence par chaînes de .
Proposition 9.15 (section 3.3 de [49] et proposition 4.1 de [50]).
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension et de type (R),
alors tout voisinage de contient une orbite périodique appartenant à la même classe de récurrence par chaînes que .
Plus précisément, il existe un voisinage de tel que pour tout segment central de ayant ses itérés contenus dans , pour tout point qui n’est pas une extrémité et pour toute orbite périodique hyperbolique ayant un point suffisamment proche de ,
-
–
l’orbite est contenue dans la classe de récurrence par chaînes de ;
-
–
il existe arbitrairement proche de tel que les variétés fortes et de la continuation de pour s’intersectent.
La démonstration s’appuie sur l’idée suivante : l’union des variétés stables et instables locales fortes des points de définissent des variétés topologiques de dimension et . Si est proche de , les variétés et intersectent respectivement et . Par conséquent appartient à la classe de récurrence par chaînes de . Le lemme de fermeture pour les pseudo-orbites permet alors de créer une intersection entre et . Voir la figure 9.2.
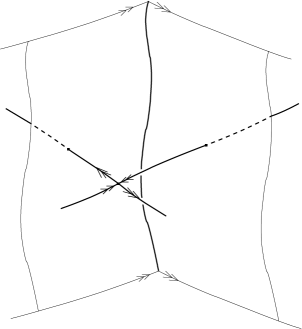
Parfois, le même argument s’applique sans que l’ensemble soit partiellement hyperbolique.
Proposition 9.16 (proposition 4.2 de [50]).
Si appartient à un Gδ dense de et si est une classe homocline ayant une décomposition dominée telle que
-
–
est uniformément contractée,
-
–
est de dimension et de type (R),
-
–
contient des orbites périodiques dont l’exposant de Lyapunov le long de est arbitrairement proche de ,
la classe contient alors des points périodiques d’indice .
9.8 Le type hyperbolique par chaînes et situations similaires
a) Dynamique centrale hyperbolique par chaînes
Comme dans le cas d’une dynamique hyperbolique, les ensembles partiellement hyperboliques ayant un fibré central hyperboliques par chaînes sont contenus dans une classe homocline.
Proposition 9.17 (section 3.4 de [49] et proposition 4.4 de [50]).
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension et de type (H)-attractif,
il existe alors, dans tout voisinage de , une orbite périodique d’indice contenue dans la classe de récurrence par chaînes de .
Idée de la démonstration.
Considérons une suite d’orbites périodiques qui s’accumule sur une partie de . Puisque est de type (H)-attractif, il existe une famille de plaques tangentes à qui sont piégées et contenues dans l’ensemble stable par chaînes de . La famille s’étend aux points des orbites (pour suffisamment grand).
Considérons un point proche d’un point périodique appartenant à une orbite . La plaque intersecte en un point . Puisque la famille est piégée et puisque est périodique, appartient à l’ensemble stable d’une orbite périodique, . Si l’indice de est égal à , on définit . Sinon, intersecte l’ensemble stable d’un autre point périodique , d’indice . Dans tous les cas, appartient à l’ensemble stable par chaînes de . On remarque que puisque est piégée, appartient aussi à . Puisque et sont proches, on en déduit que intersecte et en particulier l’ensemble stable par chaînes de . Par conséquent et ont la même classe de récurrence par chaînes. ∎
b) Ensembles non vrillés
Dans le cas parabolique, l’ensemble est “hyperbolique par chaînes d’un côté”. On peut appliquer le même raisonnement lorsque la dynamique de “voit” l’hyperbolicité par chaînes dans la direction centrale : c’est le cas sauf si la géométrie de est “vrillée”.
Considérons un ensemble compact invariant muni d’une structure partiellement hyperbolique , telle que ne soient pas dégénérés et telle que .
On peut prolonger continûment le fibré sur un voisinage de . Si l’on considère une boule suffisamment petite rencontrant , le fibré est orientable. Deux points distincts et proches sont en position vrillée si l’on peut joindre à et à par deux courbes tangentes à ayant la même orientation. (En particulier, lorsque et s’intersectent, et sont en position vrillée.) Voir la figure 9.3. Cette notion dépend du choix d’un prolongement , mais est bien définie lorsque la distance tend vers .
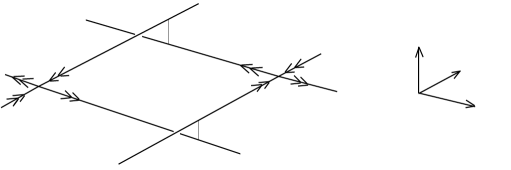
Définition 9.18.
L’ensemble est vrillé s’il existe tel que toute paire de points vérifiant est en position vrillée.
La démonstration de la proposition 9.17 entraîne le résultat suivant.
Proposition 9.19 (section 3.4 de [49] et proposition 4.4 de [50]).
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension et de type (PSU) ou (PSN),
-
–
n’est pas vrillé,
il existe alors, dans tout voisinage de , une orbite périodique d’indice contenue dans la classe de récurrence par chaînes de .
c) Dynamique centrale piégée
Nous avons vu que lorsque le fibré central de est hyperbolique par chaînes, l’ensemble est contenu dans une classe homocline. Des hypothèses plus faibles entraînent par le même argument l’existence d’une classe homocline non triviale au voisinage de .
Proposition 9.20.
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension et de type (H)-attractif, (PSN) ou (N),
-
–
n’est pas une orbite périodique,
il existe alors, dans tout voisinage de ,
-
–
une orbite périodique d’indice dont la classe homocline est non triviale,
-
–
un point ,
tels que intersecte .
9.9 Les autres types
a) Ensembles vrillés
La géométrie des ensembles vrillés permet de créer une intersection entre les variétés invariantes fortes d’un point périodique.
Proposition 9.21 (proposition 3.2 de [50]).
Considérons un ensemble compact partiellement hyperbolique vrillé . Si contient un point non périodique, alors pour tout voisinage de et de , il existe ayant une orbite périodique telle que les variétés fortes et s’intersectent.
Une première étape consiste à créer une orbite périodique proche de . En reprenant la démonstration du lemme de fermeture, on s’assure que l’orbite ainsi obtenue est “presque vrillée” : pour tous points proches, les variétés fortes et d’une part ainsi que et d’autre part, peuvent être reliées par des courbes tangentes à un fibré central et dont la longueur est arbitrairement petite par rapport à la distance entre et .
On peut alors appliquer l’argument de [35, section 6.1] ou [49, théorème 3.18] pour les orbites périodiques vrillées : on choisit une paire de points distincts qui minimise la distance . Les variétés et contiennent des points et proches. On obtient les propriétés suivantes :
-
–
la distance est arbitrairement petite par rapport aux distances de à et , car est “presque vrillée” ;
-
–
la distance est arbitrairement petite par rapport aux distances de aux autres points de , car si est proche de , il possède des itérés futurs proches de , contredisant le fait que est minimale.
Une perturbation élémentaire de permet d’envoyer sur , sans perturber l’orbite , l’orbite passée de , ni l’orbite future de . Par conséquent les variétés fortes et pour s’intersectent.
b) Dynamique centrale neutre
Si est de type N et est strictement contenu dans un ensemble transitif par chaînes, alors ou bien est contenu dans une classe homocline ayant des orbites périodiques faibles, ou bien on peut créer un cycle hétérodimensionnel par perturbation.
Proposition 9.22 (proposition 5.1 de [50]).
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension et de type (N),
-
–
est strictement contenu dans sa classe de récurrence par chaînes,
alors, l’un des deux cas suivants se produit.
-
1.
est contenu dans une classe homocline d’indice ou qui possède des orbites périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
-
2.
Pour tout voisinage de , il existe une perturbation de ayant une orbite périodique contenue dans telle que et s’intersectent.
La démonstration est bien plus délicate que pour les propositions précédentes. En voici une idée grossière (qui ne fonctionne que dans certains cas). Fixons un point appartenant à la classe de récurrence par chaînes de . Il existe des orbites qui quittent un voisinage arbitraire de pour atteindre (par itérations passées ou futures) un voisinage arbitraire de . Les orbites qui s’échappent d’un petit voisinage de suivent l’“ensemble instable par chaînes local” de . Puisque la dynamique centrale est piégée ( est de type (N)) on s’attend à ce que l’ensemble instable par chaînes local de soit réunion de plaques pour . Il est donc possible (dans certains cas) par perturbation de créer hors de une intersection entre deux variétés et , avec . Si l’on considère une orbite périodique suffisamment proche de en topologie de Hausdorff, on peut alors créer une intersection entre les variétés et .
c) Ensembles instables par chaînes
On peut espérer que tout point de la classe de récurrence par chaînes contenant est accumulé par des orbites périodiques d’indice . Le résultat suivant est démontré dans [133, section 5], voir aussi [187] et [50, proposition 1.10]. La démonstration n’utilise pas les modèles centraux.
Proposition 9.23 (Potrie).
Si appartient à un Gδ dense de et si est un ensemble compact transitif par chaînes ayant une décomposition dominée telle que
-
–
et sont uniformément contractés par et respectivement,
-
–
est de dimension ,
-
–
l’exposant de Lyapunov le long de de toute mesure supportée par est nul,
alors, pour tout , il existe un voisinage de tel que tout point vérifiant :
-
–
appartient à l’ensemble instable par chaînes local de , i.e. pour tout , il existe une -pseudo-orbite contenue dans qui joint à ;
-
–
appartient à la classe de récurrence par chaînes de ,
vérifie également :
-
est limite d’une suite de points périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov appartient à .
9.10 Application (1) : dynamique simple versus intersections homoclines
Nous avons démontré dans [49] un résultat plus faible que la conjecture de Palis, également conjecturé par Palis dans [114, 115, 116, 117]. Nous avons introduit au chapitre 1 les difféomorphismes Morse-Smale : leur dynamique est très simple puisque leur ensemble récurrent par chaînes est fini. À l’opposé, les difféomorphismes ayant une classe homocline non triviale possèdent une infinité d’orbites périodiques : ce sont les difféomorphismes qui possèdent une intersection homocline transverse, i.e. une orbite périodique hyperbolique dont les variétés invariantes et ont un point d’intersection transverse.
Théorème 9.24 (Crovisier).
L’espace contient un ouvert dense qui est l’union disjointe de deux ouverts :
-
–
est l’ensemble des difféomorphismes Morse-Smale,
-
–
est l’ensemble des difféomorphismes qui possèdent une intersection homocline transverse.
Ce résultat découle de [126] en dimension , de [148] en dimension et a été démontré initialement par Bonatti-Gan-Wen [35] en dimension . Il implique que l’intérieur de l’ensemble des difféomorphismes d’entropie non nulle a la même adhérence que et que l’intérieur de l’ensemble des difféomorphismes d’entropie nulle a la même adhérence que . Voir aussi [148, 57] pour une discussion de l’entropie dans le cas des dynamiques sur les surfaces et comparer au théorème de Katok [80] qui implique qu’un difféomorphisme de surface ayant une entropie non nulle a toujours une intersection homocline transverse.
Démonstration du théorème 9.24.
Remarquons qu’un difféomorphisme ayant une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel peut être perturbé en un difféomorphisme ayant une intersection homocline transverse. Par conséquent, il nous suffit de considérer un difféomorphisme loin des bifurcations homoclines. Nous pouvons également supposer que appartient à un Gδ dense de fixé à l’avance : nous supposerons en particulier que vérifie la propriété de Kupka-Smale.
Si est hyperbolique, l’ensemble récurrent par chaînes se décompose en un nombre fini de classe homoclines. Si toutes les classes homoclines sont triviales, l’ensemble récurrent par chaînes est fini et, puisque est un difféomorphisme Kupka-Smale, pour tous , l’intersection est transverse : par conséquent est Morse-Smale. Si l’une des classes homocline n’est pas triviale, possède une intersection homocline transverse.
Si n’est pas hyperbolique, il possède un ensemble minimal non hyperbolique . Puisque vérifie la propriété de Kupka-Smale, n’est pas une orbite périodique et par conséquent si est contenu dans une classe homocline, possède une intersection homocline transverse. Nous pouvons donc supposer que est contenu dans une classe apériodique. D’après le corollaire 9.4, possède une structure partiellement hyperbolique avec . D’après les propositions 9.15, 9.17, 9.20, si le fibré est de type (R), (H) ou (N), ou si n’est pas vrillé et est de type (P), possède une classe homocline non triviale et une intersection homocline transverse. Si est vrillé, la proposition 9.21 permet de construire une intersection homocline transverse. Dans tous les cas appartient donc à l’adhérence de . ∎
9.11 Application (2) : étude des quasi-attracteurs
On peut utiliser les modèles centraux pour obtenir des propriétés sur les quasi-attracteurs des difféomorphismes génériques loin des tangences homoclines : J. Yang a montré [187] que ce sont des classes homoclines. Voici une version légèrement améliorée de son résultat.
Théorème 9.25 (Yang).
Pour tout difféomorphisme dans un Gδ dense de , tout quasi-attracteur est une classe homocline .
De plus, si est l’indices minimal des orbites périodiques qu’il contient, possède une décomposition dominée telle que :
-
–
est de dimension et est de dimension ou ;
-
–
est uniformément contracté, est de type (H)-attractif ;
-
–
si est de dimension et non uniformément contracté, il existe des orbites périodiques dans dont l’exposant de Lyapunov le long de est arbitrairement proche de .
Proof.
Soit un quasi-attracteur. Nous pouvons supposer que ce n’est pas un ensemble hyperbolique et considérer un sous-ensemble non hyperbolique minimal . D’après le théorème 9.3, possède une décomposition dominée avec . Nous pouvons supposer que a été choisi pour que la dimension soit minimale.
Affirmation.
est une classe homocline qui contient des orbites périodiques
-
–
qui sont arbitrairement proches de en topologie de Hausdorff,
-
–
ou dont l’indice est inférieur ou égal à ,
-
–
ou dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
Proof.
Lorsque , d’après le théorème 9.3, est une classe homocline contenant des orbites périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de . Nous supposons donc que et considérons le type de .
Lorsque est de type (R) ou (H), les propositions 9.15, 9.17 entraînent directement que est une classe homocline qui contient des orbites périodiques contenues dans des voisinages arbitrairement petits de .
Lorsque est de type (N) ou (PSN), la proposition 9.20 montre que l’ensemble instable de s’accumule sur une orbite périodique contenue dans un voisinage arbitraire de . Puisque est un quasi-attracteur, il contient et est une classe homocline.
Nous nous plaçons finalement dans le cas où est de type (PSU) ou (PUN). L’ensemble possède un modèle central (correspondant à l’une des orientations du fibré ) pour lequel il existe des voisinages arbitrairement petits de qui sont répulsifs et contenus dans l’ensemble instable par chaînes de .
En particulier, pour tout voisinage de , et tout , il existe une courbe tangente à en telle que pour tout et tout , il existe une -pseudo-orbite contenue dans qui joint à . Puisque est un quasi-attracteur, il contient et la proposition 9.23 s’applique.
Fixons proche de . Tout point proche de est limite d’une suite d’orbites périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov appartient à . Nous pouvons supposer que converge en topologie de Hausdorff vers un ensemble compact invariant qui, d’après le corollaire 7.7 possède une décomposition dominée avec . Deux cas sont possibles.
-
–
Si n’est pas uniformément contracté, puisque a été choisie minimale, le théorème 5.17 montre que est une classe homocline contenant des points périodiques d’indice inférieur ou égal à .
-
–
Si est uniformément contracté, les variétés stables fortes de dimension des orbites sont de taille uniforme : pour suffisamment grand, intersecte donc la variété instable forte (de dimension ) d’un point proche de . Puisque est un quasi-attracteur, il contient . Nous en déduisons que est une classe homocline qui contient des orbites périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
Dans tous les cas l’affirmation est démontrée. ∎
Considérons l’indice minimal des points périodiques contenus dans . D’après le corollaire 7.7, il existe une décomposition dominée avec . Si est uniformément contracté, nous obtenons la conclusion du théorème 9.25 avec et .
Si n’est pas uniformément contracté, nous appliquons le théorème 5.17. Le premier cas du théorème n’apparaît pas puisque est minimal.
-
–
Dans le second cas, on obtient une décomposition dominée sur avec .
-
–
Dans le troisième cas, il existe un ensemble minimal avec structure partiellement hyperbolique tel que et tel que toute orbite périodique proche de a un exposant de Lyapunov central proche de . Puisque est minimal, ne contient pas d’orbite périodique d’indice inférieur ou égal à . D’après l’affirmation, la classe contient donc des orbites périodiques dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de . Nous obtenons à nouveau une décomposition dominée sur avec .
Dans les deux cas, se décompose et contient des orbites périodiques dont l’exposant de Lyapunov le long de est proche de . Le fibré est uniformément contracté : dans le cas contraire on pourrait répéter le raisonnement et conclure que contient des points périodiques d’indice strictement inférieurs à .
Puisque contient des orbites périodiques hyperboliques d’indice , le fibré ne peut être que de type (H)-attractif ou de type (R). La proposition 9.16 montre que le type (R) n’apparaît pas puisque ne contient pas de point périodique d’indice . ∎
Ceci permet de répondre aux questions 3.14 et 4.12 pour les difféomorphismes loin des tangences homoclines.
Corollaire 9.26 (J. Yang [187]).
Pour tout difféomorphisme dans un Gδ dense de , la réunion des ensembles stables des orbites périodiques est dense dans .
Corollaire 9.27 (Potrie [133]).
Si est connexe, pour tout difféomorphisme dans un Gδ dense de , toute classe de récurrence par chaînes qui est stable au sens de Lyapunov pour et coïncide avec .
Bonatti, Gan, Li et D. Yang [39] on donné récemment une réponse aux questions 3.15 et 3.16 dans ce cadre.
Théorème 9.28 (Bonatti-Gan-Li-Yang).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , chaque quasi-attracteur est un attracteur essentiel.
J. Yang montre également [186] que loin des tangences homoclines le phénomène de Newhouse n’a lieu qu’au voisinage de classes homoclines particulières.
Théorème 9.29 (J. Yang).
Pour tout difféomorphisme dans un Gδ dense de , si est la limite de Hausdorff d’une suite de puits , est contenu dans une classe homocline ayant des points périodiques d’indice dont le plus grand exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
Proof.
D’après le corollaire 5.9, les puits ne sont pas -uniformément contractés à la période pour un entier . Puisque est générique, on déduit du théorème 7.1 que est limite de Hausdorff d’une suite de puits ayant un exposant de Lyapunov arbitrairement proche de . D’après le corollaire 7.7, possède donc une décomposition dominée avec . De plus n’est pas uniformément dilaté. Le théorème 5.17 implique donc que l’un des cas suivants se produit.
-
–
est contenu dans une classe homocline ayant des orbites périodiques d’indice dont le plus grand exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
-
–
contient un ensemble minimal dont les exposants de Lyapunov le long de pour toute mesure invariante supportée sur sont nuls. La proposition 9.17 entraîne alors que est contenu dans une classe homocline ayant des orbites périodiques d’indice arbitrairement proches de . En particulier, contient des orbites périodiques d’indice dont le plus grand exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de .
Le théorème est démontré dans tous les cas. ∎
9.12 Application (3) : loin des cycles hétérodimensionnels
Théorème 9.30 (Crovisier).
Tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de est partiellement hyperbolique : son ensemble récurrent par chaînes se décompose en un nombre fini d’ensembles compacts disjoints . Chaque ensemble , , possède une décomposition dominée qui est partiellement hyperbolique et telle que chaque fibré central est de dimension ou .
De plus,
-
–
les classes homoclines de sont hyperboliques par chaînes,
-
–
si est une classe homocline ayant un fibré non hyperbolique, elle possède des orbites périodiques homocliniquement reliées à avec un exposant de Lyapunov le long de arbitrairement proche de ,
-
–
les classes apériodiques ont une dynamique minimale et un fibré central de dimension et de type (N).
Remarque 9.31.
Nous verrons en section 10.4 que les fibrés et ne sont pas dégénérés, sauf dans le cas des puits et des sources (qui sont en nombre fini).
Proof.
Considérons tout d’abord un ensemble minimal ayant une structure partiellement hyperbolique avec telle que toute mesure invariante supportée sur ait un exposant central nul. D’après la proposition 9.21 et le lemme 8.6, l’ensemble n’est pas vrillé. D’après les propositions 9.15, 9.17 et 9.19, si est de type (R), (H) ou (P), tout voisinage de contient une orbite périodique contenue dans la classe de récurrence par chaînes de . En particulier, est contenu dans une classe homocline ayant des points périodiques d’indice ou et dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de . Lorsque est de type (N) et que est strictement contenu dans sa classe de récurrence par chaînes, nous obtenons la même conclusion d’après la proposition 9.22. Ainsi satisfait l’un des cas suivants.
-
–
est contenu dans une classe homocline ayant des points périodiques d’indice ou et dont le -ème exposant de Lyapunov est arbitrairement proche de ,
-
–
ou coïncide avec sa classe de récurrence par chaînes et est de type (N).
Considérons à présent une classe de récurrence par chaînes de . Si est une classe apériodique, elle contient un ensemble minimal non hyperbolique dont le fibré central est de dimension . D’après le corollaire 5.13, toutes les mesures supportées sur ont un exposant de Lyapunov selon qui est nul. Nous pouvons donc appliquer la discussion du premier paragraphe et conclure que et que le fibré central est de type (N).
Si l’on suppose que est une classe homocline , elle possède un unique indice. D’après le corollaire 7.7, elle supporte une décomposition dominée telle que coïncide avec la dimension stable de . Si n’est pas uniformément contracté, on peut appliquer le théorème 5.17.
-
–
Nous excluons le premier cas puisque possède un unique indice.
-
–
Dans le second cas, la classe possède des points périodiques ayant un exposant stable proche de .
-
–
Dans le troisième cas, la classe contient un ensemble minimal non hyperbolique . Le premier paragraphe montre que la classe contient des orbites périodiques ayant un exposant central proche de . Puisque , l’exposant central est un exposant stable.
Nous concluons (des deux derniers cas) que le fibré se décompose avec . En reprenant le raisonnement avec le fibré , nous en déduisons que est uniformément contracté. Puisque la classe contient des points périodiques pour lesquels est un fibré stable, le type de ne peut pas être (N), (P) ou (H)-répulsif. D’après la proposition 9.16, il ne peut être de type (R). Il est donc de type (H)-attractif. Le même raisonnement montre que est uniformément dilaté ou se décompose en avec et est de type (H)-répulsif. On en déduit que est hyperbolique par chaînes. ∎
Nous obtenons aussi un résultat [51] sur la structure des quasi-attracteurs (comparer au théorème 9.25).
Corollaire 9.32 (Crovisier-Pujals).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , les quasi-attracteurs sont des classes homoclines hyperboliques par chaînes ayant une structure partiellement hyperbolique avec ou .
Proof.
Considérons une classe apériodique . D’après le théorème précédent, elle possède une structure partiellement hyperbolique avec . De plus est de type (N). La proposition 9.20 implique alors que l’ensemble instable de coupe la variété stable d’une orbite périodique. On en déduit que ne contient pas sa variété instable et n’est donc pas un quasi-attracteur.
Un quasi-attracteur est donc une classe homocline hyperbolique par chaînes . Nous devons montrer qu’elle n’admet pas de fibré non hyperbolique de dimension de type (H)-répulsif. Si c’était le cas, il existerait des orbites périodiques homocliniquement reliées à ayant un exposant de Lyapunov le long de positif et arbitrairement proche de . Puisque satisfait une condition de généricité, il existe des points périodiques d’orbites homocliniquement reliées à avec une demi-variété centrale tangente à arbitrairement courte : l’autre extrémités de la variété centrale de est bordée par un point périodique pour lequel est un fibré stable. On en déduit que a une variété stable de dimension plus grande que celle de . Puisque est un quasi-attracteur, il contient la variété instable de : par conséquent il contient . La classe contient donc des points périodiques d’indices différents. La section 3.3 montre alors qu’il existe des perturbation de qui possèdent un cycle hétérodimensionnel. C’est une contradiction. La classe n’a donc pas de fibré non hyperbolique de type (H)-répulsif. ∎
Nous terminons par un premier résultat vers la finitude des quasi-atracteurs.
Proposition 9.33 (Crovisier-Pujals).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , l’union des quasi-attracteurs non-triviaux est fermée.
Nous verrons en section 10.4 que l’on peut enlever l’hypothèse que les quasi-atracteurs sont triviaux.
Proof.
Considérons une suite de quasi-attracteurs non triviaux qui converge en topologie de Hausdorff vers un ensemble compact invariant , contenu dans une classe de récurrence par chaînes . Nous devons montrer que est un quasi-attracteur. D’après le théorème 9.30, est partiellement hyperbolique. Nous notons son fibré instable fort.
Affirmation 1.
est une classe homocline .
Proof.
Supposons par l’absurde que est une classe apériodique. Elle a une décomposition dominée , avec et de type (N). La proposition 9.11 implique que est non dégénéré. Pour grand, le fibré est également défini au-dessus des ensembles . Puisque les ensembles sont des quasi-attracteurs, ils sont saturés en variétés instables fortes tangentes à . Par passage à la limite, est également saturé en variétés instables fortes. Ceci contredit la proposition 9.20 puisque ne contient pas de points périodiques. ∎
Affirmation 2.
Nous pouvons nous ramener au cas où la dimension stable de est strictement inférieure à celle des points périodiques des classes .
Proof.
Supposons que la dimension instable de est inférieure ou égale à celle des classes . Considérons des familles de plaques définissant sur une structure de classe hyperbolique par chaînes. Elles s’étendent également au-dessus des quasi-attracteurs .
Si est uniformément dilaté, les quasi-attracteurs sont saturés en plaques de .
Sinon, il y a une décomposition et l’on peut aussi considérer une famille de plaques centrales tangentes à et piégées par . Nous remarquons que les plaques pour sont contenues dans . En effet, si ce n’était pas le cas il existerait un point périodique homocliniquement relié à l’orbite de dont la variété instable ne contient pas entièrement la plaque : il existe un point périodique qui borde la variété instable de . Puisque est un quasi-attracteur, il contient la variété instable de et donc le point . Cependant le point est d’indice différent de l’indice de et la section 3.3 montre que l’on peut créer un cycle hétérodimensionnel par perturbation. C’est une contradiction.
Dans les deux cas les quasi-attracteurs sont saturés en plaques . Par passage à la limite c’est aussi le cas de .
D’après le lemme 5.19, il existe un ensemble dense de points périodiques homocliniquement reliés à l’orbite de tels que et . Il existe un tel point proche de dont la variété stable intersecte transversalement une plaque centre-instable de . On en déduit finalement que contient la variété instable de . D’après la section 3.3, est un quasi-attracteur. Ceci conclut la démonstration. Par conséquent, nous sommes ramenés au cas où la dimension instable de est strictement plus grande que celles des classes . ∎
Nous en déduisons que a une décomposition dominée avec telle que est de type (H)-répulsif au-dessus de et de type (H)-attractif au-dessus des quasi-attracteurs . Nous allons montrer que ceci mène à une contradiction.
On considère un point et on fixe un petit voisinage de . En utilisant l’expansion uniforme le long de , on en déduit que pour tout grand, il existe une orbite de qui évite le voisinage . D’après le théorème de densité (corollaire 2.8), il existe une orbite périodique contenue dans un petit voisinage de qui évite . En considérant des plaques centre-stable piégée suffisamment petites au-dessus de la dynamique proche de , on montre que contient une orbite périodique rencontrant les mêmes plaques centre-stable que . Par conséquent l’orbite périodique évite l’ouvert .
Affirmation 3.
Pour tout assez grand, il existe un voisinage de formé de difféomorphismes pour lesquels les continuations de et s’intersectent.
Proof.
D’après l’affirmation précédente, est un fibré stable de . Il existe donc un point tel que pour tout on ait . La domination entre et implique alors que est contenue dans l’ensemble stable de . Par ailleurs, est contenu dans l’adhérence de la variété . On en déduit que et ont un point d’intersection transverse , i.e. . Cette propriété est robuste aux petites perturbations dans . ∎
Pour grand, rencontre un voisinage arbitrairement petit de . Par ailleurs, la variété rencontre tout voisinage de pour un entier . Le lemme de connexion permet de créer une perturbation , -proche de , telle que et s’intersectent. On en déduit que et sont liés par des orbites hétéroclines de . Puisque leurs indices diffèrent, nous avons créé un cycle hétérodimensionnel, ce qui est une contradiction. ∎
Chapter 10 Hyperbolicités topologique et uniforme
Ce chapitre traite de la conjecture de Palis. Nous savons (théorème 9.30) que les difféomorphismes loin des bifurcations homoclines sont partiellement hyperboliques. Nous devons à présent montrer que les fibrés centraux des dynamiques partiellement hyperboliques du théorème 9.30 sont des fibrés uniformément contractés ou dilatés.
La conjecture de Palis a été résolue sur les surfaces par Pujals et Sambarino [148].
Théorème 10.1 (Pujals-Sambarino).
Lorsque est de dimension , tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme hyperbolique ou par un difféomorphisme ayant une tangence homocline.
En dimension supérieure, nous avons montré avec Pujals [51] que, loin des bifurcations homoclines, sur un ouvert dense de la dynamique se comporte comme une dynamique hyperbolique. Plus précisément, un difféomorphisme est dit essentiellement hyperbolique s’il possède un nombre fini d’attracteurs hyperboliques dont l’union des bassins est dense dans , ainsi qu’un nombre fini de répulseurs hyperboliques dont l’union des bassins est denses dans .
Théorème 10.2 (Crovisier-Pujals).
Tout difféomorphisme peut être approché dans par un difféomorphisme essentiellement hyperbolique ou par un difféomorphisme qui présente une tangence homocline ou un cycle hétérodimensionnel.
La démonstration du théorème 10.1 (et ses généralisations) repose essentiellement sur un argument de distorsion et utilise pour cela le passage en régularité . Le démonstration du théorème 10.2 est plus géométrique : c’est pour cette raison que l’on obtient seulement l’hyperbolicité des attracteurs et que l’on ne contrôle pas la dynamique sur les pièces de type “selle”.
10.1 Hyperbolicité des fibrés extrêmes
Nous avons vu en section 9.6, qu’au-dessus d’un ensemble transitif par chaînes qui n’est pas un puits, un fibré extrême de dimension est “topologiquement hyperbolique” (il est de type (H)). Dans certains cas, il est possible de démontrer qu’il est uniformément hyperbolique.
Sur les surfaces, la symétrie entre et permet [148] d’obtenir l’hyperbolicité de .
Théorème 10.3 (Pujals-Sambarino).
Lorsque est de dimension , pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , tout ensemble compact invariant ayant une décomposition dominée non triviale est hyperbolique.
Ceci entraîne la conjecture de Palis sur les surface.
Démonstration du théorème 10.1.
Considérons un difféomorphisme qui ne peut pas être approché par un difféomorphisme ayant une tangence homocline. Nous pouvons l’approcher par un difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de . D’après le théorème 9.30, chaque classe de récurrence par chaînes de possède une décomposition dominée non triviale, elle est donc hyperbolique d’après le théorème précédent. ∎
Ce résultat se généralise [150] en dimension supérieure lorsque est uniformément contracté.
Théorème 10.4 (Pujals-Sambarino).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , toute classe homocline ayant une décomposition dominée avec et uniformément contracté est hyperbolique.
Nous avons étendu [51] ces travaux dans un cadre où n’est plus uniformément contracté : nous supposerons à la place que est finement piégée et qu’il existe une famille de plaques localement invariante tangente à (rappelons que d’après la section 5.9, une telle famille de plaques est essentiellement unique) et telle que pour tout l’intersection est totalement discontinue.
Théorème 10.5 (Crovisier-Pujals).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de et toute classe homocline ayant une décomposition dominée avec et vérifiant :
-
–
est finement piégée,
-
–
il existe une famille de plaques localement invariante et tangente à telle que est totalement discontinu pour tout ,
le fibré est uniformément dilaté ou est un puits.
Remarque 10.6.
Ces résultats restent vrais pour des ensemble compacts invariants contenus dans une variété localement invariante normalement hyperbolique. Par exemple, si est une surface et si possède une décomposition dominée tangente à non triviale, alors est un ensemble hyperbolique.
10.2 Technique de Mañé-Pujals-Sambarino
Mañé avait démontré un résultat similaire [95] pour les endomorphismes du cercle. Pour les difféomorphismes en dimension plus grande, l’idée est d’exploiter la contraction (topologique ou uniforme) le long des plaques tangentes à pour “quotienter” la dynamique dans la direction centre-stable et se ramener ainsi à un cadre essentiellement unidimensionnel.
Les théorèmes 10.3, 10.4 et 10.5 sont la contrepartie de résultats non perturbatifs en classe . Nous considérons donc dans la suite un difféomorphisme et un ensemble compact invariant muni d’une décomposition dominée avec . Nous supposerons que :
-
a)
pour tout point périodique de , le fibré est uniformément dilaté ;
-
b)
ne contient pas de courbe fermée simple tangente à , invariante par un itéré de .
En effet, si l’on suppose que est un difféomorphisme Kupka-Smale, tous les points périodiques qui ne vérifient pas la première condition sont des puits et les courbes de la seconde condition sont normalement hyperboliques et portent une dynamique très simple. En retirant toutes les courbes (en nombre fini), tous les puits de et leur bassins, on se ramène aux conditions énoncées ci-dessus.
On démontre alors que est uniformément dilaté au-dessus de par une “récurrence” : on se ramène aisément à un ensemble ayant la propriété supplémentaire suivante :
-
c)
Pour tout sous-ensemble compact invariant , le fibré est uniformément dilaté.
Nous introduisons également une famille de plaques piégées tangente à .
La démonstration comporte plusieurs étapes.
-
1) Hyperbolicité topologique.
En utilisant que pour tout sous-ensemble, est uniformément dilaté, on montre qu’il existe une famille de plaques localement invariante et tangente à telle que lorsque . C’est cet argument, de type Denjoy-Schwartz, qui permet de démontrer le théorèm 9.13.
-
2) Construction de boîtes markoviennes.
On construit alors une “boîte” munie d’une lamination centre-instable, i.e. une réunion de courbes contenues dans des plaques de telle que est d’intérieur non vide dans . Nous demandons également à de vérifier des propriétés de type “rectangles de partitions de Markov”.
-
3) Hyperbolicité uniforme.
En induisant dans , les propriétés markoviennes de , la contraction topologique des plaques de et un contrôle de distorsion montrent alors que en tout lorsque .
Les étapes 1) et 3) sont identiques pour chacun des théorèmes 10.3, 10.4 et 10.5 mais la partie 2) est spécifique.
-
–
Dans le cas des surfaces, on exploite le fait que les plaques et sont de dimension pour chercher à construire un rectangle géométrique bordé par deux plaques de et deux plaques de .
-
–
Dans le cas où le fibré est uniformément dilaté, il est possible de construire une partition de Markov pour la classe homocline . La boîte est construite à partir de l’un des rectangles de la partition.
-
–
Dans le cas où est seulement finement piégée, l’hypothèse de discontinuité dans les plaques permet à nouveau de construire une partition adaptée. Plus précisément, pour tout , il existe un ensemble compact vérifiant :
-
i)
pour on a ou ,
-
ii)
pour tout , on a ,
-
iii)
varie continûment en topologie de Hausdorff avec .
La boîte s’obtient alors en fixant , en considérant des segments de courbes contenus dans les plaques pour à extrémités contenues dans deux plaques et proches de .
-
i)
10.3 Classes homoclines à plaques centre-stables discontinues
Nous énonçons à présent dans le cadre des ensembles hyperboliques un résultat non perturbatif qui permet de satisfaire l’hypothèse topologique du théorème 10.5.
Théorème 10.7 (Crovisier-Pujals).
Considérons un ensemble hyperbolique localement maximal muni d’une décomposition dominée avec . Alors l’un des trois cas suivants se produit :
-
–
est contenu dans une sous-variété localement invariante tangente à ;
-
–
possède une connexion forte généralisée ;
-
–
pour tout l’intersection est totalement discontinue.
Ce résultat s’étend aux classes homoclines hyperboliques par chaînes.
Théorème 10.8 (Crovisier-Pujals).
Considérons une classe homocline et une décomposition dominée avec telle que et soient finement piégés par et respectivement. Alors l’un des trois cas suivants se produit :
-
–
est contenue dans une sous-variété localement invariante tangente à ;
-
–
possède une connexion forte généralisée ;
-
–
il existe une famille de plaques localement invariante et tangente à telle que pour tout l’intersection est totalement discontinue.
Idée de la démonstration.
Supposons sans connexion forte généralisée.
Affirmation.
Il n’existe pas d’ensemble connexe non réduit à un point et contenu dans une variété stable forte.
Proof.
Supposons le contraire. Nous utilisons les deux propriétés suivantes.
-
–
En itérant négativement, on obtient des ensembles connexes de diamètre arbitrairement grand dans les feuilles stables fortes.
-
–
Les projections de par holonomie le long des plaques centre-instables, préservent les feuilles stables fortes : en effet, si l’image de par holonomie est contenue dans une plaque centre-stable et rencontre plusieurs variétés stables fortes, on choisit un point périodique proche de et on en déduit que la plaque centre-instable de rencontre . Les itérés lorsque convergent vers une partie connexe non triviale contenue dans . Ceci contredit l’hypothèse sur .
En transportant par holonomie sur une variété stable d’orbite périodique contenue dans , ces propriétés impliquent que rencontre sur un ensemble connexe non trivial, contredisant l’hypothèse que n’a pas de connexion forte généralisée. ∎
Supposons que contienne un ensemble connexe non trivial contenu dans une plaque centre-stable. Puisque intersecte chaque variété stable forte selon un ensemble totalement discontinu, est un graphe au-dessus de la direction centrale : c’est une courbe.
Considérons à présent une orbite périodique ayant un point proche de . La projection de sur la plaque centre-stable de défini une nouvelle courbe ; puisque n’intersecte pas , cette courbe contient . En itérant, on obtient également une courbe en chaque point de . Puisque contient un ensemble dense de points périodiques, on construit par passage à la limite une courbe en chaque point de .
Supposons que n’est pas contenue dans une variété tangente à . D’après le théorème 6.2, il existe deux points tels que . Soit un point périodique proche de . La projection par holonomie de sur la plaque centre-stable de coupe en un point de appartenant à . Nous avons à nouveau contredit l’existence d’une connexion forte généralisée. Par conséquent, les composantes connexes de dans les plaques centre-stables sont triviales. ∎
10.4 Application : non dégénérescence des fibrés uniformes
Corollaire 10.9 (Crovisier-Pujals).
Pour tout difféomorphisme appartenant à un Gδ dense de , toute classe de récurrence par chaînes qui n’est pas un puits ou une source possède une structure partiellement hyperbolique avec fibrés stables et instables forts non dégénérés.
Proof.
Nous appliquons le théorème 9.30 sur la structure partiellement hyperbolique des classes de récurrence par chaînes.
Considérons une classe apériodique. Elle possède une structure partiellement hyperbolique avec central de dimension de type (N). La proposition 9.11 montre alors directement que les fibrés uniformes sont non dégénérés.
Considérons une classe homocline non hyperbolique : elle admet une structure partiellement hyperbolique de la forme ou . Dans le premier cas, le théorème 10.4 montre que et ne sont pas dégénérés si la classe n’est pas un puits ou une source. Dans le second cas, la classe est hyperbolique par chaînes avec une décomposition . Si est dégénéré, le théorème 10.8 montre que l’on est dans l’un des cas suivants.
- –
-
–
La classe possède une connexion forte. Si le fibré n’est pas uniformément contracté, il existe des orbites périodiques homocliniquement reliées à ayant un exposant selon arbitrairement faible d’après le théorème 9.30. On déduit du lemme 8.7 que l’on perturber le difféomorphisme pour créer un cycle hétérodimensionnel. C’est à nouveau une contradiction.
-
–
La classe est totalement discontinue le long des plaques centre-stables.
On applique alors le théorème 10.5 et on en déduit que est uniformément dilaté. ∎
Corollaire 10.10 (Crovisier-Pujals).
Tout difféomorphisme dans un Gδ dense de , possède au plus un nombre fini de puits et de sources.
Proof.
Une suite de puits ou de source doit s’accumuler sur une partie d’une classe de récurrence par chaînes qui n’est ni un puits ni une source. ∎
10.5 Hyperbolicité des quasi-attracteurs
Voici un nouveau résultat sur la géométrie des ensemble hyperboliques : quitte à perturber, l’existence de variété stables fortes rencontrant la classe en plusieurs points peut être détectée sur les orbites périodiques. Ceci reprend un travail antérieur de Pujals [144, 145].
Théorème 10.11 (Crovisier-Pujals).
Soit un attracteur hyperbolique avec une décomposition dominée , .
Il existe alors une perturbation de telle que
-
–
ou bien pour tout ,
-
–
ou bien possède une connexion forte généralisée.
Ce résultat s’étend aux classes hyperboliques par chaînes.
Théorème 10.12 (Crovisier-Pujals).
Soit un quasi-attracteur qui est une classe homocline avec une décomposition dominée , telle que est finement piégé.
Il existe alors une perturbation de telle que
-
–
ou bien pour tout ,
-
–
ou bien possède une connexion forte généralisée.
Nous pouvons à présent terminer la démonstration du théorème 10.2.
Démonstration du théorème 10.2.
Par symétrie, il suffit de traiter le cas des attracteurs.
Nous savons d’après le théorème 9.32 que chaque quasi-attracteur qui n’est pas un ensemble hyperbolique est une classe homocline avec une décomposition dominée , . Nous pouvons alors appliquer le théorème 10.12. Dans le premier cas, le théorème 6.2 montre que est contenue dans une sous-variété localement invariante tangente à . Le théorème 10.4 et la remarque 10.6 impliquent alors que est un ensemble hyperbolique. Dans le second cas, puisque possède des orbites périodiques faibles homocliniquement reliées à , il existe d’après le lemme 8.7 une perturbation de admettant un cycle hétérodimensionnel : c’est une contradiction. Nous avons donc montré que tous les quasi-attracteurs sont des ensembles hyperboliques.
10.6 Classification des connexions fortes
Abordons maintenant certains arguments importants de la démonstration du théorème 10.12.
Proposition 10.13.
Considérons une classe homocline ayant les mêmes propriétés qu’au théorème 10.12. Elle satisfait alors l’un des cas suivants :
-
a)
il existe -proche de tel que, pour tout appartenant à la continuation de pour , on ait ;
-
b)
il existe -proche de ayant une connexion forte généralisée ;
-
c)
il existe deux points périodiques homocliniquement reliés à l’orbite de , et un ouvert de difféomorphismes -proche de tels que pour tout il existe deux points distincts et dans avec ;
-
d)
il existe un point périodique homocliniquement relié à l’orbite de et pour tout difféomorphisme -proche de deux points dans tels que .
Idée de la démonstration lorsque est un ensemble hyperbolique.
Nous pouvons supposer qu’il existe dans avec car sinon nous sommes dans le cas a).
Fixons une famille de plaques centre-instables et une petite constante . Nous comparons alors les variétés instables et en projetant sur la plaque centre-instable de par l’holonomie le long des variétés stables fortes. Trois cas sont possibles.
- – Intersection transverse.
-
Il existe dans avec tels que la projection intersecte les deux composantes connexes de .
- – Intégrabilité jointe.
-
Il existe dans avec et tels que et coïncident dans .
- – Intersection strictement non transverse.
-
Pour tout avec , la projection est disjointe de l’une des composantes connexes de et intersecte l’autre.
Dans le cas transverse, on choisit périodiques proches de et respectivement. Par continuité du feuilletage instable, nous sommes dans le cas c).
Dans le cas de l’intégrabilité jointe, on choisit périodique proche de . Sa variété stable locale coupe et en deux points . On a . Pour tout difféomorphisme -proche , les continuations hyperboliques de pour appartiennent toujours à la variété stable locale . Si appartient à la variété pour tout proche de , nous sommes dans le cas d). Si n’appartient plus à la variété , on considère un arc entre et dans un petit voisinage de dans . Puisque est accumulé par des points périodiques de , nous en déduisons qu’il existe tel que appartient à la variété instable d’un tel point périodique. Nous obtenons donc une connexion forte généralisée (cas b).
Il reste à examiner le cas strictement non transverse. Puisqu’il n’y a pas d’intersection transverse, les points avec ne sont accumulés par que d’un seul côté de (voir la figure 10.1). De tels points sont appelés points de frontière stable forte.
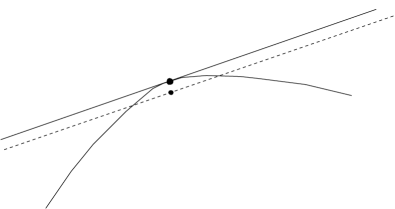
Lemme 10.14.
Les points de frontière stable forte appartiennent à la variété instable d’un point périodique qui est un point de frontière stable forte. Ces points périodiques frontière sont en nombre fini.
Considérons les points périodiques frontière stable forte de et leur variétés instables locales. S’il existe un arc de difféomorphismes proches de et un point tel que
-
–
appartient à une autre variété ,
-
–
appartient à la composante connexe de dans laquelle accumule ,
nous concluons comme précédemment que l’un des difféomorphismes a une connexion forte. Nous sommes dans le cas b).
Dans le cas contraire, s’il existe un difféomorphisme -proche de tel que toutes les intersections sont disjointes, nous sommes dans le cas a).
Finalement, il existe un ouvert de difféomorphismes proche de en topologie et deux points , tels que pour tout les variétés et s’intersectent. Nous sommes alors dans le cas c). ∎
10.7 Connexions de variétés instables périodiques
Nous discutons à présent le cas c) du théorème 10.12 (dans le cadre hyperbolique) et montrons que l’on peut perturber pour obtenir une connexion forte.
Proposition 10.15.
Considérons un attracteur hyperbolique avec une décomposition dominée telle que . Supposons qu’il existe deux points périodiques et, pour tout -proche de , deux points distincts et de tels que .
Il existe alors -proche de et périodique tel que intersecte .
Idée de la démonstration.
Soient :
-
–
une constante qui minore la dilatation des itérés positifs de le long de ,
-
–
une constante qui minore la domination entre et ,
-
–
l’exposant de Lyapunov de l’orbite de le long de .
Quitte à le remplacer par un difféomorphisme proche, nous pouvons supposer que est de classe et linéaire au voisinage de . Nous pouvons supposer également que est disjoint de puisque dans le cas contraire le lemme de connexion permet de créer par perturbation une intersection entre et et de conclure directement la démonstration de la proposition. Nous noterons et des variétés locales de et contenant respectivement.
Connexion à retours lents.
Nous dirons que la connexion est à retours lents s’il existe des échelles arbitrairement petites telles que le temps d’entrée pour et dans la boule est supérieur à pour une certaine constante . Dans ce cas, nous perturbons dans la boule pour obtenir un difféomorphisme tel que appartienne à la plaque centrale de . La distance entre et vérifie où ne dépend que de la taille de la perturbation autorisée.
Après perturbation les continuations et de appartiennent à et à mais ne coïncident pas nécessairement avec et . On a les estimées
où sont les temps d’entrée de et dans .
Puisque est de classe , l’holonomie du feuilletage stable fort (défini sur un voisinage de ) est hölderienne [143] : il existe tels que
Nous comparons également les holonomies pour et pour :
où est le temps d’entrée de dans .
Puisque , on a
Par conséquent lorsque
Les temps d’entrée sont essentiellement les mêmes car est la continuation de et appartiennent à une même variété stable forte. Nous notons . Puisque , la connexion entre et est brisée par perturbation lorsque pour une certaine constante , ce qui est le cas puisque la connexion est à retours lents.
Considérons un arc de difféomorphismes proche de et joignant à . Par continuité, il existe un difféomorphisme tel que intersecte la variété instable d’un point périodique de proche de . Ceci conclut la démonstration de la proposition dans ce cas.
Connexion à retours rapides.
Dans ce cas, pour tout , le temps de retour de et dans la boule est inférieur à . Ceci implique le lemme clé suivant.
Lemme 10.16.
Il existe et arbitrairement grand tel que :
-
–
est à distance inférieure à de ,
-
–
les itérés , , sont à distance supérieure à de .
Proof.
Considérons la suite des plus proches retours de près de lui même. Nous fixons un voisinage de l’union des variétés stables et instables locale de l’orbite de . Nous supposons que l’orbite passée de est contenue dans , mais . Pour chaque retour de près de lui-même, nous notons le segment d’orbite maximal contenu dans .
Pour chaque , la longueur est de l’ordre de , où est la distance entre et la variété . En effet, puisque est disjoint de , les retours près de et de se font le long de la direction centrale unidimensionnelle. Puisque est linéaire au voisinage de , la distance est de l’ordre de .
Par hypothèse nous avons donc
Posons
Pour petit, nous choisissons tel que pour tout on ait
Nous choisissons ensuite arbitrairement grand pour que
Pour tout nous avons et donc
Nous posons et . Puisque appartient à , nous avons . On a bien
et pour tout ,
Le lemme est donc démontré avec et . ∎
Pour conclure la démonstration de la proposition 10.15 dans ce cas, nous considérons un disque contenu dans la variété stable forte de et contenant et . Pour tout point et tout retour près de , le rayon de est très petit devant la distance de à : si est le temps de passage près de l’orbite de , la distance est de l’ordre de et le rayon de est inférieur à , où majore la contraction de le long de .
Choisissons comme dans le lemme précédent : est contenu dans une boule centrée en et de rayon très petit devant les distances à des images , . Il existe donc une perturbation de près de telle que . On en déduit que possède un point périodique dont la variété stable forte contient . Puisque n’a pas été perturbé, et s’intersectent.
∎
10.8 Connexions contenues dans une variété stable périodique
Pour terminer la démonstration du théorème 10.11, nous devons expliquer comment perturber dans le cas d) de la proposition 10.13 afin de créer une connexion forte.
Proposition 10.17.
Considérons un ensemble hyperbolique localement maximal muni d’une décomposition dominée avec . Supposons qu’il existe périodique et deux points de et tels que pour tout proche de les continuations et vérifient .
Il existe alors un arc de difféomorphismes -proche de et des points tels que traverse lorsque varie.
On obtient la connexion forte en remplaçant par un point périodique proche.
Nous supposerons pour simplifier que est un point fixe et (quitte à remplacer par un difféomorphisme proche) que la dynamique est linéaire au voisinage de . Dans une carte, est de la forme :
où sont des applications linéaires contractantes et appartient à . Nous notons la dimension du fibré .
Dans la variété stable locale (qui coïncide avec localement), le feuilletage stable fort coïncide avec le feuilletage en sous-espaces affines parallèles à .
Il existe un point d’orbite distincte de celles de et . Fixons un disque de qui contient . Quitte à remplacer par un itéré négatif, nous pouvons supposer que tous ses itérés négatifs sont contenus dans le voisinage linéarisant de . Par petite perturbation, nous pouvons redresser et le feuilletage stable fort dans : le disque est alors contenu dans un plan parallèle à et est le feuilletage en sous-espaces parallèles à .
Nous comparons à présent les espaces instables aux points de proches de : nous nous intéressons ainsi aux angles entre deux espaces instables dans la direction centrale, i.e. à l’angle entre leurs projections dans l’espace de coordonnées .
En remplaçant par des itérés positifs, sont arbitrairement proches de .
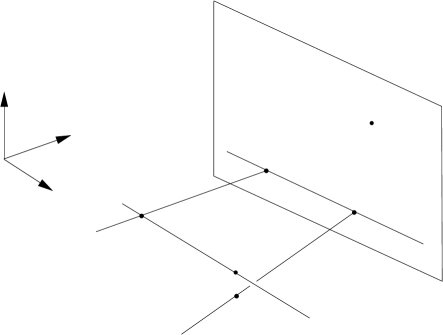
Nous fixons une petite constante . Nous perturbons au voisinage de en un difféomorphisme de sorte que coïncide avec au voisinage de sur mais est envoyé sur un espace faisant un angle avec .
La norme de la perturbation peut être rendue arbitrairement -petite si le support de la perturbation est contenu dans un voisinage arbitrairement petit de . En revanche l’angle est donné par la taille de la perturbation . On en déduit que les continuations restent arbitrairement proches de . Par conséquent, fait un angle proche de avec et ; l’espace un angle arbitrairement petit avec et .
Les itérés pour grand s’accumulent sur et recoupent en deux points . Pour grand les vecteurs et sont proches de et . Soit la projection de sur la plaque centre-instable de , par l’holonomie le long des variétés stables fortes. Voir la figure 10.2.
Les orbites positives de par et coïncident. Par conséquent la variété stable forte locale de est la même pour et pour : c’est un sous-espace affine parallèle à . On en déduit que les vecteurs et ont la même direction. Par conséquent pour , fait un angle proche de avec et .
Considérons à présent un arc de difféomorphismes en faisant varier l’angle : par continuité nous pouvons assurer que la direction du vecteur traverse , en projection dans l’espace de coordonnée . On en déduit que traverse . ∎
10.9 Continuation des classes hyperboliques par chaînes
Pour généraliser les raisonnements des sections précédentes dans le cas des classes hyperboliques par chaînes (i.e. dans le cadre du théorème 10.12), nous avons besoin de définir la notion de continuation de la classe (qui ne pose pas de problème dans le cadre hyperbolique).
On considère une classe de récurrence par chaînes qui est une classe homocline avec une structure partiellement hyperbolique , , telle que est finement piégée. Pour tout -proche de , la classe homocline est contenue dans un petit voisinage de , possède la même structure partiellement hyperbolique, et reste hyperbolique par chaînes (théorème 5.20).
Remarquons que possède un ensemble dense de points périodiques pour lesquels l’exposant de Lyapunov central est uniformément majoré par une constante strictement négative, et il existe également une famille de plaques tangente à , piégée, telle que pour chaque point .
Lemme 10.18.
Il existe un voisinage de formé de difféomorphismes pour lesquels la continuation hyperbolique de chaque point est bien définie et tels que l’ensemble est dense dans .
Définition 10.19.
Pour , deux points , ont la même continuation s’il existe une suite de telle que converge vers et converge vers .
Le lemme 10.18 implique que pour tout et tout , il existe ayant la même continuation que . Cette notion ne dépend pas du choix de l’ensemble de points périodiques . En général la continuation d’un point n’est pas unique mais si ont la même continuation que , alors et appartiennent à la même plaque centre-stable.
Pour les difféomorphismes loin des connexions fortes, chaque point possède au plus deux continuations. En effet, si sont des continuations de , on introduit trois suites , , dans telles que leurs continuations pour convergent toutes vers et leurs continuations pour convergent vers respectivement. Si est un arc de difféomorphismes dans joignant à , il existe ayant une connexion forte pour l’un des points périodiques considérés. Nous allons donner un énoncé plus précis.
Pour chaque , nous introduisons , l’ensemble des paires où est un point de et est une orientation de telle que est accumulé par dans la composante de déterminée par . C’est une partie du fibré unitaire associé à . La dynamique de s’étend donc en une dynamique sur . On introduit aussi la projection telle que .
Proposition 10.20.
Considérons une classe de récurrence par chaînes de qui est une classe homocline non triviale munie d’une structure partiellement hyperbolique avec et telle que est finement piégé. Supposons aussi que pour tout difféomorphisme -proche de , la classe n’a pas de connexion forte.
Il existe alors un voisinage de tel que pour tout on ait les propriétés suivantes.
-
–
(Relèvement.) L’application est surjective et semi-conjugue et .
-
–
(Continuation du relèvement.) Pour tout , il existe un unique tel que et ont la même continuation et les orientations sur et sur coïncident. Ceci définit une bijection
-
–
(Continuation de la projection.) Pour tout et ayant la même continuation il existe tel que et .
Chapter 11 Centralisateurs de difféomorphismes
Nous utilisons les résultats des chapitres précédents pour décrire le centralisateur des difféomorphismes de classe dans le groupe . Dans [25, 26] nous montrons que le centralisateur d’un difféomorphisme -générique est trivial, i.e. coïncide avec le groupe engendré par . Ceci répond à une conjecture de Smale [173, 174]. Pour obtenir ce résultat, nous devons avoir une bonne description de la dynamique globale : on peut donc voir ce chapitre comme un test de notre compréhension des dynamiques -génériques. La démonstration nécessite de savoir perturber un difféomorphisme en préservant sa dynamique topologique mais en modifiant la dynamique de son application tangente. Par ailleurs, dans [24] nous construisons un ouvert non vide de et une partie dense de constituée de difféomorphismes dont le centralisateur est non dénombrable, donc non trivial.
11.1 Difféomorphismes commutant
Si sont des difféomorphismes qui commutent, préserve l’ensemble des orbites de ainsi que les invariants dynamiques différentiables et topologiques de . Un argument facile de transversalité (voir [61, proposition 4.5]) montre que pour tout -uple générique avec et , le groupe est libre. Ceci motive la question suivante posée par Smale [173, 174].
Considérons une variété connexe compacte sans bord et pour tout difféomorphisme , définissons son centralisateur
Il contient le groupe cyclique . Nous disons que a un centralisateur trivial si .
Question 1 (Smale).
Pour , considérons l’ensemble des difféomorphismes ayant un centralisateur trivial.
-
1.
Cet ensemble est-il dense dans ?
-
2.
Cet ensemble contient-il un Gδ dense de ?
-
3.
Cet ensemble contient-il un ouvert dense de ?
Ce problème remonte au travail de Kopell [81] qui a donné une réponse complète pour et : dans ce cas, l’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial contient un ouvert dense.
En dimension plus grande, la description du centralisateur demande une compréhension fine de la dynamique globale : puisqu’un élément du centralisateur d’un difféomorphisme peut coïncider avec l’identité sur certaines parties de , nous devons tenir compte des orbites pour d’une partie dense de . Seules certaines classes de difféomorphismes ont été traitées.
-
–
En régularité , l’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial contient un ouvert dense de l’ensemble des difféomorphismes possédant un puits ou une source et satisfaisant l’axiome et la condition de transversalité forte [124]. Sur le tore , il contient un ouvert dense de l’ensemble des difféomorphismes d’Anosov [125] (voir aussi [54]). Il contient aussi un Gδ dense d’un ouvert de difféomorphismes partiellement hyperboliques avec fibré central de dimension [43].
- –
Nous avons obtenu une réponse complète à la question de Smale en classe .
Théorème 11.1 (Bonatti-Crovisier-Wilkinson [26]).
Il existe dans un Gδ dense formé de difféomorphismes ayant un centralisateur trivial.
Théorème 11.2 (Bonatti-Crovisier-Vago-Wilkinson [24]).
Il existe un ouvert non vide de et une partie dense formée de difféomorphismes ayant un centralisateur non dénombrable. En particulier l’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial ne contient pas un ouvert dense de .
Dans le cas conservatif (lorsque qu’une forme volume ou une forme symplectique est préservée), l’analogue du théorème 11.1 reste vrai [25]. L’analogue du théorème 11.2 reste vrai dans le cadre symplectique mais nous n’avons pas de construction pour l’espace des difféomorphismes préservant une forme volume.
11.2 Stratégie pour montrer que le centralisateur est trivial
a) Centralisateur localement trivial
Bien souvent, la première étape pour montrer que le centralisateur d’un difféomorphisme est trivial consiste à montrer qu’il est “localement trivial”.
Définition 11.3.
Le centralisateur d’un difféomorphisme est localement trivial si pour tout , il existe un ouvert dense et une application localement constante telle que pour tout .
Dans [81], le contrôle de la distorsion de la dérivée des applications est un des ingrédients principaux pour montrer que le centralisateur est trivial. Dans le cadre des difféomorphismes génériques, nous devons changer d’argument puisque la distorsion n’est pas bornée : curieusement, c’est cette fois le fait que la distorsion explose qui nous permet d’amorcer la démonstration.
Propriété (MDM∖Ω).
Un difféomorphisme satisfait la propriété de mauvaise distorsion sur l’ensemble errant, s’il existe une partie dense telle que pour tout et tous , appartenant à des orbites différentes, il existe tel que
Propriété (MD).
Un difféomorphisme satisfait la propriété de mauvaise distorsion sur les variétés stables (MD) si, pour toute orbite périodique hyperbolique , il existe une partie dense (pour la topologie intrinsèque de ) telle que pour tout et tous , appartenant à des orbites différentes, il existe tel que
D’après les théorèmes 2.1 et 2.2 ainsi que les résultats de la section 3.3, les propriété suivantes sont -génériques :
-
1.
toutes les orbites périodiques sont hyperboliques ;
-
2.
des orbites périodiques distinctes ont des valeurs propres distinctes ;
-
3.
pour toute composante connexe appartenant à l’intérieur de l’ensemble non-errant , il existe une orbite périodique telle que est contenue dans l’adhérence de .
Conséquence.
Proof.
Les propriétés (MD) permettent d’“individualiser” les orbites : si satisfait la propriété (MDM∖Ω), alors tout difféomorphisme doit préserver chaque orbite de . Ceci permet de construire la fonction de la définition 11.3 sur . Sur l’ensemble errant, la fonction doit être localement constante. Par conséquent, s’étend continûment sur tout (en particulier, elle est constante sur chaque composante de l’ensemble errant).
Si satisfait la propriété (MD), le même argument s’applique à la variété stable de toute orbite périodique hyperbolique préservée par ; en particulier et coïncident aux points de l’orbite et est constante sur toute la variété stable. Puisque les orbites périodiques de ont des valeurs propres distinctes, fixe individuellement chacune d’entre elles et l’on peut donc appliquer la propriété (MD). Pour toute composante connexe de , il existe une orbite périodique telle que est contenue dans l’adhérence de . On en déduit que s’étend continûment en une fonction localement constante sur . ∎
La première étape vers le théorème 11.1 consiste donc à montrer le résultat suivant.
Théorème 11.4.
Il existe un Gδ dense de formé de difféomorphismes qui satisfont les propriétés (MDM∖Ω) et (MD).
La propriété (MD) peut s’obtenir comme variante des arguments de [177, 178]. La propriété (MDM∖Ω) est beaucoup plus délicate à obtenir. En effet, les points d’une même variété stable d’orbite périodique ont la même dynamique future, proche d’une application linéaire. Au contraire dans l’ensemble errant les orbites distinctes peuvent avoir des comportements très différents. La démonstration de ce résultat utilise la notion de perturbation fantôme (section 11.3 plus bas) mais nous ne l’expliquons pas ici.
b) Du local au global
Nous introduisons une nouvelle propriété.
Propriété (GD).
Un difféomorphisme satisfait la propriété de grande dilatation sur un ensemble si, pour tout , il existe et pour tous et , il existe tels que
Conséquence.
Soit un difféomorphisme d’une variété connexe de dimension et l’ensemble de ses points périodiques. Supposons que ait un centralisateur localement trivial, ait toutes ses orbites périodiques hyperboliques et satisfait la propriété (GD) sur . Alors a un centralisateur trivial.
Proof.
Considérons dans le centralisateur de et . Puisque le centralisateur de est localement trivial, on a où est une fonction localement constante sur un ouvert dense de . La propriété (GD) permet de borner par . Puisque les orbites périodiques de sont hyperboliques, l’ensemble des points périodiques de période inférieure à est fini. Considérons à présent une collection d’ouverts d’union dense dans et telle que sur . Sur , les ensembles sont deux à deux disjoints. Puisque est connexe, seul un des ensembles est non vide. Ceci montre que pour un certain entier . Le centralisateur de est donc trivial. ∎
Pour obtenir le théorème 11.1, nous montrons l’énoncé suivant.
Théorème 11.5.
Soit un difféomorphisme dont les points périodiques sont hyperboliques. Il existe arbitrairement proche de tel que la propriété (GD) soit satisfaite sur .
De plus,
-
–
et sont conjugué par un homéomorphisme de , ;
-
–
pour tout orbite périodique de , les dérivées de le long de et de le long de sont conjuguées ;
-
–
si satisfait les propriétés (MDM∖Ω) et (MD), alors les satisfait également.
c) Densité et généricité
Nous pouvons déduire des sections précédentes qu’il existe un ensemble dense de difféomorphismes de ayant un centralisateur trivial. En effet, on peut perturber tout difféomorphisme pour que les propriétés génériques 1, 2 et 3 de la section a) ainsi que (MDM∖Ω) et (MD) soient satisfaites. On perturbe ensuite en un difféomorphisme donné par le théorème 11.5 qui satisfait la propriété (GD). Les propriétés 1, 2, (MDM∖Ω) et (MD) sont préservées. Puisque et sont conjuguées, la propriété 3 l’est également. Ceci implique que le centralisateur de est trivial.
Nous ne pouvons pas obtenir la généricité des difféomorphismes à centralisateur trivial de cette façon puisque la propriété n’est pas vérifiée sur un Gδ dense. Pour conclure nous faisons un argument de généricité : pour des raisons de compacité, nous travaillons avec l’espace des homéomorphismes bilipschitziens . Les raisonnements des sections précédentes permettent de montrer que l’ensemble des difféomorphismes ayant un centralisateur trivial dans forme une partie dense de . En utilisant la proposition 2.9, nous en déduisons qu’il contient un Gδ dense, ce qui conclut la démonstration du théorème 11.1.
11.3 Perturbations fantômes
Nous présentons à présent quelques ingrédients importants pour la démonstration du théorème 11.5. Certains de ces arguments sont aussi utilisés pour obtenir le théorème 11.4.
Le théorème 11.5 permet de perturber un difféomorphisme pour changer la dynamique de son application tangente sans changer la classe de conjugaison topologique de . Pour cela, nous considérons des domaines ouverts et un entier tels que les itérés soient deux-à-deux disjoints. La perturbation de est conjuguée à par un difféomorphisme qui coïncide avec l’identité hors de l’union des , . Pour la construire, nous modifions sur les ouverts pour un certain entier et nous utilisons les domaines restants pour compenser la perturbation de sorte que et coïncident sur . Une telle modification est appelée perturbation fantôme de .
Pour modifier les propriétés de l’application tangente , il est commode de pouvoir supposer que les composantes connexes de chaque ouvert , sont petites de sorte que y soit proche d’une application linéaire. Par ailleurs, afin de modifier la dynamique le long de l’orbite de tout point non périodique, nous souhaitons que contienne un itéré de chaque point . C’est exactement ce que permet le théorème 3.4 d’existence de tours topologiques.
Après avoir effectué une telle perturbation fantôme, les dynamiques des applications tangentes et restent conjuguées par . Pour modifier effectivement la dynamique, nous introduisons une suite de perturbations fantômes convergeant dans vers un difféomorphisme . On l’obtient en conjuguant successivement par une suite de difféomorphismes . En choisissant la taille des composantes connexes du support de chaque application suffisamment petite, nous garantissons que la suite converge vers un homéomorphisme de qui conjugue et .
11.4 Problèmes
Nous n’avons pas obtenu d’analogue au théorème 11.2 dans le cadre conservatif.
Question 11.6.
Considérons une forme volume sur .
Existe-t-il un ouvert non vide de l’espace
des difféomorphismes préservant et une partie dense dont les éléments
ont un centralisateur dans non trivial ?
Les théorèmes 11.1 et 11.2 suggèrent que la topologie de l’ensemble des difféomorphismes à centralisateur trivial doit être compliquée et motive les questions suivantes.
Question 11.7.
- 1.
-
2.
Est-ce un ensemble borélien ?
(Voir [55] pour une réponse négative dans le cadre mesurable.) -
3.
L’ensemble est fermé. Quelle est sa topologie locale ? Est-il localement connexe ?
Pour démontrer le théorème 11.1, nous exhibons des propriétés dynamiques qui impliquent que le centralisateur est trivial. Ceci illustre l’existence de liens entre la dynamique d’un difféomorphisme et ses propriétés algébriques dans le groupe . En voici un autre exemple : la relation de Baumslag-Solitar , où est un entier, implique que les points périodiques de ne sont pas hyperboliques.
Question 11.8.
-
1.
Considérons un groupe finiement engendré où est une partie génératrice et les sont des relations. Quelle est la taille de l’ensemble des difféomorphismes tels qu’il existe un morphisme injectif satisfaisant ? Le théorème 11.1 implique que cet ensemble est maigre lorsque est abélien (ou même nilpotent) et différent de .
-
2.
Existe-t-il un difféomorphisme tel que pour tout le groupe engendré par et est lorsque ou le produit libre ?
References
- [1] F. Abdenur, Generic robustness of spectral decompositions. Ann. Sci. École Norm. Sup. 36 (2003), 213–224.
- [2] F. Abdenur, Attractors of generic diffeomorphisms are persistent. Nonlinearity 16 (2003), 301–311.
- [3] F. Abdenur, C. Bonatti, S. Crovisier, Global dominated splittings and the Newhouse phenomenom. Proceedings of the AMS 134 (2006), 2229–2237.
- [4] F. Abdenur, C. Bonatti, S. Crovisier, Nonuniform hyperbolicity for -generic diffeomorphisms. ArXiv:0809.3309 (2008). À paraître à Israel J. Math.
- [5] F. Abdenur, C. Bonatti, S. Crovisier, L. Díaz, Generic diffeomorphisms on compact surfaces. Fundamenta Mathematicae 187 (2005), 127–159.
- [6] F. Abdenur, C. Bonatti, S. Crovisier, L. Díaz, L. Wen, Periodic points and homoclinic classes. Ergodic Theory & Dynam. Systems 27 (2007), 1–22.
- [7] F. Abdenur, C. Bonatti, L. Díaz, Non-wandering sets with non-empty interiors. Nonlinearity 17 (2004), 175–191.
- [8] R. Abraham, J. Robbin, Transversal mappings and flows. W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam (1967).
- [9] R. Abraham, S. Smale, Nongenericity of -stability. Global analysis I, Proc. Symp. Pure Math. AMS 14 (1970), 5–8.
- [10] E. Akin, M. Hurley, J. Kennedy, Dynamics of topologically generic homeomorphisms. Mem. Amer. Math. Soc. 164 (2003).
- [11] D. Anosov, A. Katok, New examples in smooth ergodic theory. Ergodic diffeomorphisms. Transactions of the Moscow Mathematical Society 23 (1970), 1–35.
- [12] N. Aoki, The set of Axiom A diffeomorphisms with no cycles. Bol. Soc. Brasil. Mat. 23 (1992), 21–65.
- [13] M.-C. Arnaud, Le “closing lemma” en topologie . Mém. Soc. Math. Fr. 74 (1998).
- [14] M.-C. Arnaud, Création de connexions en topologie . Ergodic Theory & Dynam. Systems 31 (2001), 339–381.
- [15] M.-C. Arnaud, Approximation des ensembles -limites des difféomorphismes par des orbites périodiques. Ann. Sci. École Norm. Sup. 36 (2003), 173–190.
- [16] M.-C. Arnaud, C. Bonatti, S. Crovisier, Dynamiques symplectiques génériques. Ergodic Theory & Dynamical Systems 25 (2005), 1401–1436.
- [17] M. Asaoka, Hyperbolic sets exhibiting -persistent homoclinic tangency for higher dimensions. Proc. Amer. Math. Soc. 136 (2008), 677–686.
- [18] J. Auslander, Generalized recurrence in dynamical systems. Contributions to Differential Equations 3 (1964), 65–74.
- [19] F. Béguin, S. Crovisier, F. Le Roux, Construction of curious minimal uniquely ergodic homeomorphisms on manifolds: the Denjoy-Rees technique. Ann. Sci. École Norm. Sup. 40 (2007), 251–308.
- [20] G. D. Birkhoff, Nouvelles recherches sur les systèmes dynamiques. Memoriae Pont. Acad. Sci. Novi Lyncaei 1 (1935), 85–216 and Collected Math. Papers, vol. II, 530–659.
-
[21]
C. Bonatti,
On robust tangencies.
International workshop on Global Dynamics beyond Uniform Hyperbolicity, Beijing 2009,
http://www.math.pku.edu.cn/teachers/gansb/conference09/BeijingAout2009.pdf. - [22] C. Bonatti, S. Crovisier, Récurrence et généricité. Invent. Math. 158 (2004), 33–104.
- [23] C. Bonatti, S. Crovisier, Central manifolds for partially hyperbolic set without strong unstable connections. En préparation.
- [24] C. Bonatti, S. Crovisier, G. Vago, A. Wilkinson, Local density of diffeomorphisms with large centralizers. Ann. Sci. École Norm. Sup. 41 (2008), 925–954.
- [25] C. Bonatti, S. Crovisier, A. Wilkinson, -generic conservative diffeomorphisms have trivial centralizer. J. Mod. Dyn. 2 (2008), 359–373.
- [26] C. Bonatti, S. Crovisier, A. Wilkinson, The generic diffeomorphism has trivial centralizer. Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 109 (2009), 185–244.
- [27] C. Bonatti, L. Díaz, Persistence of transitive diffeomorphims. Ann. Math. 143 (1995), 367–396.
- [28] C. Bonatti, L. Díaz, Connexions hétéroclines et généricité d’une infinité de puits ou de sources. Ann. Scient. Éc. Norm. Sup. 32 (1999), 135–150.
- [29] C. Bonatti, L. Díaz, On maximal transitive sets of generic diffeomorphisms. Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 96 (2003), 171–197.
- [30] C. Bonatti, L. Díaz, Robust heterodimensional cycles and -generic dynamics. J. Inst. Math. Jussieu 7 (2008), 469–525.
- [31] C. Bonatti, L. Díaz, Abundance of -robust tangencies. Prépublication. ArXiv:0909.4062.
- [32] C. Bonatti, L. Díaz, E. Pujals, A -generic dichotomy for diffeomorphisms: weak forms of hyperbolicity or infinitely many sinks or sources. Ann. of Math. 158 (2003), 355–418.
- [33] C. Bonatti, L. Díaz, E. Pujals, J. Rocha, Robustly transitive sets and heterodimensional cycles. in Geometric methods in dynamics. I. Astérisque 286 (2003), 187–222.
- [34] C. Bonatti, L. Díaz, M. Viana, Dynamics Beyond Uniform Hyperbolicity. Springer, Berlin, 2004.
- [35] C. Bonatti, S. Gan, L. Wen, On the existence of non-trivial homoclinic classes. Ergodic Theory & Dynam. Systems 27 (2007), 1473–1508.
- [36] C. Bonatti, S. Gan, D. Yang, On the Hyperbolicity of Homoclinic Classes. Discrete Contin. Dyn. Syst. 25 (2009), 1143–1162. Prépublication IMB Dijon, 2008.
- [37] C. Bonatti, N. Gourmelon, T. Vivier, Perturbations of the derivative along periodic orbits. Ergodic Theory & Dynam. Systems 26 (2006), 1307–1337.
- [38] C. Bonatti, M. Li, D. Yang, On the existence of attractors. Prépublication. ArXiv:0904.4393.
- [39] C. Bonatti, S. Gan, M. Li, D. Yang, Lyapunov stable classes and essential attractors. En préparation.
- [40] C. Bonatti, M. Viana, SRB measures for partially hyperbolic systems whose central direction is mostly contracting. Israel J. Math. 115 (2000) 157–193.
- [41] R. Bowen, Periodic points and measures for Axiom diffeomorphisms. Trans. Amer. Math. Soc. 154 (1971), 377–397.
- [42] R. Bowen, Equilibrium states and the ergodic theory of Axiom A diffeomorphisms. Lect. Notes in Mathematics 470, Springer-Verlag (1975).
- [43] L. Burslem, Centralizers of partially hyperbolic diffeomorphisms. Ergod. Th. & Dynam. Sys. 24 (2004), 55–87.
- [44] C. Carballo, C. Morales, M.-J. Pacifico, Maximal transitive sets with singularities for generic vector fields. Bol. Soc. Brasil. Mat. 31 (2000), 287–303.
- [45] M. Carvalho, Sinaï-Ruelle-Bowen measures for -dimensional derived from Anosov diffeomorphisms. Ergodic Theory Dynam. Systems 13 (1993), 21–44.
- [46] C. Conley. Isolated Invariant Sets and the Morse Index. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 38, American Mathematical Society, Providence. RI (1978).
- [47] S. Crovisier, Perturbations of -diffeomorphisms and dynamics of generic conservative diffeomorphisms of surface. In Dynamiques des difféomorphismes conservatifs de surfaces : un point de vue topologique., 1–33, Panorama et Synthèses, 21, Soc. Math. France, Paris (2006).
- [48] S. Crovisier, Periodic orbits and chain-transitive sets of -diffeomorphisms. Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 104 (2006), 87–141.
- [49] S. Crovisier, Birth of homoclinic intersections: a model for the central dynamics of partially hyperbolic systems. Prépublication. ArXiv math.DS/0605387 (2006).
-
[50]
S. Crovisier, Partial hyperbolicity far from homoclinic bifurcations.
Prépublication.
ArXiv:0809.4965 (2008). - [51] S. Crovisier, E. Pujals, Essential hyperbolicity versus homoclinic bifurcations. En préparation.
- [52] L. Díaz, A. Gorodetski, Non-hyperbolic ergodic measures for non-hyperbolic homoclinic classes. Ergodic Theory & Dynam. Systems 29 (2009), 1479–1513.
- [53] L. Díaz, E. Pujals, R. Ures, Partial hyperbolicity and robust transitivity. Acta Math. 183 (1999), 1–43.
- [54] T. Fisher, Trivial centralizers for axiom A diffeomorphisms. Nonlinearity 21 (2008), 2505–2517.
- [55] M. Foreman, M, D. Rudolph, L. Weiss, On the conjugacy relation in ergodic theory. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 343 (2006), 653–656.
- [56] J. Franks, Necessary conditions for stability of diffeomorphisms. Trans. Amer. Math. Soc. 158 (1971), 301–308.
- [57] S. Gan, Horseshoe and entropy for surface diffeomorphisms, Nonlinearity 15 (2002), 841-848.
- [58] S. Gan, A generalized shadowing lemma. Discrete and Continuous Dynamical Systems 8 (2002), 627–632.
- [59] S. Gan, L. Wen, Heteroclinic cycles and homoclinic closures for generic diffeomorphisms. In Special issue dedicated to Victor A. Pliss on the occasion of his 70th birthday. J. Dynam. Differential Equations 15 (2003), 451–471.
- [60] S. Gan, L. Wen, D. Yang, Minimal non-hyperbolicity and index completeness. Discrete Contin. Dyn. Syst. 25 (2009), 1349–1366.
- [61] Ghys, É., Groups acting on the circle. L’Enseign. Math. 47 (2001), 329–407.
- [62] N. Gourmelon, Adapted metrics for dominated splittings. Ergodic Theory & Dynam. Systems 27 (2007), 1839–1849.
- [63] N. Gourmelon, Generation of homoclinic tangencies by -perturbations. Prépublication Université de Bourgogne (2007), Discrete Contin. Dyn. Syst. 26 (2010), 1–42.
- [64] N. Gourmelon, A Franks’ lemma that preserves invariant manifolds. Prépublication IMPA (2008).
- [65] C. Gutierrez, A counter-example to a closing lemma. Ergodic Theory Dynam. Systems 7 (1987), 509–530.
- [66] C. Gutierrez, On -closing for flows on 2-manifolds. Nonlinearity 13 (2000), 1883–1888.
- [67] C. Gutierrez, On the -closing lemma. The geometry of differential equations and dynamical systems. Comput. Appl. Math. 20 (2001), 179–186.
- [68] B. Hasselblatt, A. Katok, Introduction to the modern theory of dynamical systems. Cambridge University Press (1995).
- [69] S. Hayashi, Diffeomorphisms in satisfy Axiom A. Ergodic Theory & Dynam. Systems 12 (1992), 233–253.
- [70] S. Hayashi, Connecting invariant manifolds and the solution of the -stability and -stability conjectures for flows. Ann. of Math. 145 (1997), 81–137 et Ann. of Math. 150 (1999), 353–356.
- [71] S. Hayashi, A make or break lemma. Bol. Soc. Brasil. Mat. 31 (2000), 337–350.
- [72] S. Hayashi, Stability of dynamical systems. Sugaku Expositions 14 (2001), 15–29. Traduction de Sugaku 50 (1998), 149–162.
- [73] M. Herman, Sur les courbes invariantes par les difféomorphismes de l’anneau. Astérisque 103–104, (1983).
- [74] M. Herman, Exemples de flots hamiltoniens dont aucune perturbation en topologie n’a d’orbites périodiques sur un ouvert de surfaces d’énergies. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 312 (1991), 989–994.
- [75] M. Herman, Différentiabilité optimale et contre-exemples à la fermeture en topologie des orbites récurrentes de flots hamiltoniens. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 313 (1991), 49–51.
- [76] M. Herman, Some open problems in dynamical systems. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. II (Berlin, 1998). Doc. Math. 1998, 797–808.
- [77] M. Hirsch, Differential topology. Graduate Texts in Mathematics 33, Springer-Verlag, New York-Heidelberg (1976).
- [78] M. Hirsch, C. Pugh, M. Shub, Invariant Manifolds. Lecture Notes in Mathematics 583, Springer Verlag, Berlin (1977).
- [79] M. Hurley, Attractors: persistence, and density of their basins. Transactions AMS 269 (1982), 247–271.
- [80] A. Katok, Lyapunov exponents, entropy and periodic orbits for diffeomorphisms. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 51 (1980), 137–173.
- [81] N. Kopell, Commuting diffeomorphisms. In Global Analysis, Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XIV, AMS (1970), 165–184.
- [82] I. Kupka. Contributions à la théorie des champs génériques. Contrib. Differential Equations 2 (1963), 457–484.
- [83] K. Kuratowski, Topology II, Academic Press - PWN - Polish Sci. Publishers Warszawa (1968).
- [84] F. Ledrappier, Quelques propriétés des exposants caractéristiques. In École d’été de probabilités de Saint-Flour, 1982. Lecture Notes in Math. 1097 (1984), 305–396.
- [85] S. Liao, An extension of the closing lemma. Beijing Daxne Xuebao 2 (1979), 1–41.
- [86] S. Liao, Obstruction sets. I. Acta Math. Sinica 23 (1980), 411–453.
- [87] S. Liao, Obstruction sets. II. Beijing Daxue Xuebao 2 (1981), 1–36.
- [88] S. Liao, On the stability conjecture. Chinese Ann. Math. 1 (1980), 9–30.
- [89] S. Liao, An existence theorem for periodic orbits. Acta Sci. Natur. Univ. Pekinensis 1 (1979), 1–20.
- [90] S. Liao, Qualitative Theory of Differentiable Dynamical Systems. China Science Press (1996). (Traduction en Anglais des articles précédents.)
- [91] J. Mai, A simpler proof of closing lemma. Sci. Sinica Ser. A 29 (1986), 1020–1031.
- [92] R. Mañé, Contributions to the stability conjecture. Topology 17, 397–405.
- [93] R. Mañé, An ergodic closing lemma. Ann. of Math. 116 (1982), 503–540.
- [94] R. Mañé, Oseledec’s theorem from the generic viewpoint. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Warsaw, 1983) vols. 1-2, 1269-1276, (1984).
- [95] R. Mañé, Hyperbolicity, sinks and measure in one dimensional dynamics. Commun. Math. Phys. 100 (1985), 495–524 et Comm. Math. Phys. 112 (1987), 721–724.
- [96] R. Mañé, Ergodic Theory and Differential Dynamics. Springer-Verlag, New York (1987).
- [97] R. Mañé, On the creation of homoclinic points. Inst. Hautes études Sci. Publ. Math. 66 (1988), 139–159.
- [98] R. Mañé, A proof of the stability conjecture. Inst. Hautes études Sci. Publ. Math. 66 (1988), 161–210.
- [99] C. Morales, M.-J. Pacifico, Lyapunov stability of -limit sets. Discrete Contin. Dyn. Syst. 8 (2002), 671–674.
- [100] C. Moreira, There are no -stable intersections of regular Cantor sets. Prépublication. ArXiv:0901.3131.
- [101] J. Moser, Stable and random motions in dynamical systems. Annals of mathematics studies 77, Princeton university Press (1973).
- [102] J. Munkres, Obstructions to the smoothing of piecewise-differentiable homeomorphisms. Ann. of Math. 72 (1960), 521–554.
- [103] S. Newhouse, Nondensity of axiom on . In Global analysis I, Proc. Symp. Pure Math. AMS 14 (1970), 191–202.
- [104] S. Newhouse, Hyperbolic limit sets. Trans. Amer. Math. Soc. 167 (1972), 125–150.
- [105] S. Newhouse, Diffeomorphisms with infinitely many sinks, Topology 13 (1974), 9–18.
- [106] S. Newhouse, Quasi-elliptic periodic points in conservative dynamical systems. Amer. J. Math. 99 (1977), 1061–1087.
- [107] S. Newhouse, Lectures on dynamical systems. In Dynamical systems, CIME. Lect., Bressanone 1978, Progress in Mathematics 8, Birkäuser (1980), 1–114.
- [108] S. Newhouse, The abundance of wild hyperbolic sets and nonsmooth stable sets for diffeomorphisms, Publ. Math. I.H.E.S. 50 (1979), 101–151.
- [109] S. Newhouse, J. Palis, Cycles and bifurcation theory. Trois études en dynamique qualitative. Astérisque 31 (1976), 43–140.
- [110] F. Oliveira, On the generic existence of homoclinic points. Ergod. Th. & Dynam. Sys. 7 (1987), 567–595.
- [111] F. Oliveira, On the genericity of homoclinic orbits. Nonlinearity 13 (2000), 653–662.
- [112] J. Palis, A note on -stability. in Global Analysis I, Proc. Sympos. Pure Math. 14, A.M.S. Providence R. I. (1970).
- [113] J. Palis, On the -stability conjecture, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 66, (1988), 211–215.
- [114] J. Palis, On the contribution of Smale to dynamical systems. In From Topology to Computation: Proceedings of the Smalefest, Berkeley 1990, Springer (1993), 165–178.
- [115] J. Palis, A global view of dynamics and a conjecture on the denseness of finitude of attractors. In Géométrie complexe et systèmes dynamiques, Astérisque 261 (2000), 335–347.
- [116] J. Palis, A global perspective for non-conservative dynamics. Ann. I. H. Poincaré 22 (2005), 485–507.
- [117] J. Palis, Open questions leading to a global perspective in dynamics. Nonlinearity 21 (2008), T37–T43.
- [118] J. Palis, W. de Melo, Geometric theory of dynamical systems. An introduction. Springer-Verlag, Berlin (1982).
- [119] J. Palis, C. Pugh, Fifty problems in dynamical systems. In Dynamical systems, Warwick 1974. Lecture Notes in Math. 468 (1975), 345–353.
- [120] J. Palis, C. Pugh, M. Shub, M. D. Sullivan, D, Genericity theorems in topological dynamics. In Dynamical systems (Warwick 1974). Lecture Notes in Math. 468 (1975), 241–250.
- [121] J. Palis, S. Smale, Structural stability theorem. Global analysis I, Proc. Symp. Pure Math. AMS 14 (1970), 223–232.
- [122] J. Palis, F. Takens, Hyperbolicity and Sensitive Chaotic Dynamics at Homoclinic Bifurcations. Cambridge studies in advanced mathematics 35, Cambridge University Press (1993).
- [123] J. Palis, M. Viana, High dimension diffeomorphisms displaying infinitely many periodic attractors. Ann. Math. 140 (1994), 207–250.
- [124] J. Palis, J.-C. Yoccoz, Rigidity of centralizers of diffeomorphisms. Ann. Sci. École Norm. Sup. 22 (1989), 81–98.
- [125] J. Palis, J.-C. Yoccoz, Centralizers of Anosov diffeomorphisms on tori. Ann. Sci. École Norm. Sup. 22 (1989), 99–108.
- [126] M. Peixoto, Structural stability on two-dimensional manifolds. Topology 1 (1962), 101–120 et Topology 2 (1963) 179–180.
- [127] Y. Pesin, Characteristic Lyapunov exponents and smooth ergodic theory. Russian Mathematical Surveys 324, 55-114, (1977).
- [128] D. Pixton, Planar homoclinic points. J. Differential Equations 44 (1982), 365–382.
- [129] V. Pliss, On a conjecture of smale. Differ. Uravn. 8 (1972), 262–268.
- [130] R. Plykin, Sources and sinks of A-diffeomorphisms on surfaces. Math. Sb. (N.S.) 94(136) (1974), 243–264, 336.
- [131] H. Poincaré, Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. Acta Math. 13 (1890), 1–270.
- [132] H. Poincaré, Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, tome III. Gauthier-Villars (1899).
- [133] R. Potrie, Generic bi-Lyapunov homoclinic classes. Prépublication. ArXiv:0903.4090.
- [134] R. Potrie, M. Sambarino, Codimension one generic homoclinic classes with interior. ArXiv:0806.3036. À paraître au Bull. Braz. Math. Soc..
- [135] C. Pugh, The closing lemma. Amer. J. Math. 89 (1967), 956–1009.
- [136] C. Pugh, An improved closing lemma and a general density theorem Amer. J. Math. 89 (1967), 1010–1021.
- [137] C. Pugh, On arbitrary sequences of isomorphisms in . Trans. Amer. Math. Soc. 184 (1973), 387–400.
- [138] C. Pugh, Against the closing lemma. J. Differential Equations 17 (1975), 435–443.
- [139] C. Pugh, A special closing lemma. In Geometric dynamics (Rio de Janeiro, 1981), Lecture Notes in Math. 1007 (1983), 636–650
- [140] C. Pugh, The hypothesis in Pesin theory. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 59 (1984), 143–161.
- [141] C. Pugh, The connecting lemma. J. Dynam. Differential Equations 4 (1992), 545–553.
- [142] C. Pugh, C. Robinson, The closing lemma, including Hamiltonians. Ergod. Th. & Dynam. Sys. 3 (1983), 261–313.
- [143] C. Pugh, M. Shub, A. Wilkinson, Hölder foliations. Duke Math. J. 86 (1997), 517–546.
- [144] E. Pujals, On the density of hyperbolicity and homoclinic bifurcations for 3D- diffeomorphisms in attracting regions. Discrete Contin. Dyn. Syst. 16 (2006), 179–226.
- [145] E. Pujals, Density of hyperbolicity and homoclinic bifurcations for attracting topologically hyperbolic sets. Discrete Contin. Dyn. Syst. 20 (2008), 335-405.
- [146] E. Pujals, Some simple questions related to the -stability conjecture. Nonlinearity 21 (2008), T233–T237.
- [147] E. Pujals, F. Rodriguez-Hertz, Critical points for surface diffeomorphisms. J. Mod. Dyn. 1 (2007), 615–648.
- [148] E. Pujals, M. Sambarino, Homoclinic tangencies and hyperbolicity for surface diffeomorphisms. Ann. of Math. 151 (2000), 961–1023.
- [149] E. Pujals, M. Sambarino, Integrability on codimension one dominated splitting. Bull. Braz. Math. Soc. 38 (2007), 1–19.
- [150] E. Pujals, M. Sambarino, Density of hyperbolicity and tangencies in sectional dissipative regions. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 26 (2009), 1971–2000.
- [151] E. Pujals, M. Sambarino, On the dynamics of dominated splitting. Ann. of Math. 169 (2009), 675–740.
- [152] J. Robbin, A structural stability theorem, Ann. of Math., 94, (1971), 447–493.
- [153] C. Robinson, structural stability implies Kupka-Smale. In Dynamical systems, Proc. Sympos. Univ. Bahia, Salvador 1971, Academic Press (1973), 443–449.
- [154] C. Robinson, Generic properties of conservative systems I & II. Amer. J. Math. 92(1970), 562–603 et 897–906.
- [155] C. Robinson, Closing stable and unstable manifolds on the two sphere. Proc. Amer. Math. Soc. 41 (1973), 299–303.
- [156] C. Robinson Structural stability of -diffeomorphisms. J. Diff. Equ., 22, (1976), 28-73.
- [157] C. Robinson, Dynamical Systems, Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos. CRC Press (1994).
- [158] N. Romero, Persistence of homoclinic tangencies in higher dimensions. Ergod. Th. & Dynam. Sys., 15, (1995), 735–757.
- [159] M. Shub, Topological transitive diffeomorphism on . Lect. Notes in Math. 206 (1971), 39–40.
- [160] M. Shub, Stability and genericity for diffeomorphisms. Dynamical systems, Proc. Sympos., Univ. Bahia, Salvador, (1971), 493–514.
- [161] M. Shub, Structurally stable diffeomorphisms are dense. Bull. Amer. Math. Soc. 78 (1972), 817–818.
- [162] M. Shub, Stabilité globale des systèmes dynamiques. Astérisque 56, Société Mathématique de France, Paris (1978).
- [163] K. Sigmund, Generic properties of invariant measures for Axiom A diffeomorphisms. Invent. Math. 11 (1970), 99-109.
- [164] C. Simon, A 3-dimensional Abraham-Smale example. Proc. Amer. Math. Soc. 34 (1972), 629–630.
- [165] S. Smale, Morse inequalities for a dynamical system. Bull. Amer. Math. Soc. 66 (1960), 43–49.
- [166] S. Smale, Dynamical systems and the topological conjugacy problem for diffeomorphisms. Proc. Internat. Congr. Mathematicians (Stockholm, 1962), 49–496.
- [167] S. Smale, Stable manifolds for differential equations and diffeomorphisms. Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 17 (1963), 97–116.
- [168] S. Smale, Diffeomorphisms with many periodic points. Differential and combinatorial topology, Princeton Univ. Press (1965), 63–80.
- [169] S. Smale, Structurally stable systems are not dense. Amer. J. Math. 88 (1966), 491–496.
- [170] S. Smale, Differentiable dynamical systems. Bull. Amer. Math. Soc. 73 (1967), 747–817.
- [171] S. Smale, The -stability theorem. In Global Analysis I, Proc. Sympos. Pure Math. 14, A.M.S. Providence R. I. (1970).
- [172] S. Smale, Stability and genericity in dynamical systems. Séminaire Bourbaki Vol. 1969/70, exposé 374. Lecture Notes in Mathematics 180 (1971).
- [173] S. Smale, Dynamics retrospective: great problems, attempts that failed. Nonlinear science: the next decade (Los Alamos, NM, 1990). Phys. D 51 (1991), 267–273.
- [174] S. Smale, Mathematical problems for the next century. Math. Intelligencer 20 (1998), 7–15.
- [175] F. Takens, On Zeeman’s tolerance stability conjecture. Lecture Notes in Math., 197, (1971), 209–219.
- [176] F. Takens, Tolerance stability. Lecture Notes in Math., 468, (1975), 293–304.
- [177] Y. Togawa, Generic Morse-Smale diffeomorphisms have only trivial symmetries. Proc. Amer. Math. Soc. 65 (1977), 145–149.
- [178] Y. Togawa, Centralizers of -diffeomorphisms. Proc. Amer. Math. Soc. 71 (1978), 289–293.
- [179] L. Wen, The closing lemma for endomorphisms with finitely many singularities. Proc. Amer. Math. Soc. 114 (1992), 217–223.
- [180] L. Wen, A uniform connecting lemma. Discrete Contin. Dyn. Syst. 8 (2002), 257–265.
- [181] L. Wen, Homoclinic tangencies and dominated splittings. Nonlinearity 15 (2002), 1445–1469.
- [182] L. Wen, Generic Diffeomorphisms away from homoclinic tangencies and heterodimensional cycles. Bull. Braz. Math. Soc. 35 (2004), 419–452.
- [183] L. Wen, The selecting lemma of Liao. Discrete Contin. Dyn. Syst. 20 (2008), 159–175.
- [184] L. Wen, Z. Xia, A basic perturbation theorem. J. Diff. Eq. 154 (1999), 267–283.
- [185] L. Wen, Z. Xia, connecting lemmas. Trans. Amer. Math. Soc. 352 (2000), 5213–5230.
- [186] J. Yang, Newhouse phenomenon and homoclinic classes. Prépublication. ArXiv:0712.0513.
- [187] J. Yang, Lyapunov stable chain recurrent classes. Prépublication. ArXiv:0712.0514.
- [188] J. Yang, Ergodic measures far away from tangencies. Prépublication IMPA A629 (2009).
- [189] J.-C. Yoccoz, Introduction to hyperbolic dynamics. In Real and complex dynamical systems, NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci. 464 (1995), 265–291.
- [190] J.-C. Yoccoz, Travaux de Herman sur les tores invariants. Séminaire Bourbaki 754, Astérisque 206 (1992), 311–344.
- [191] E. Zehnder, Homoclinic points near elliptic fixed points. Comm. Pure Appl. Math. 26 (1973), 131–182.
Index
- Anosov, difféomorphisme item 1
- attracteur
- axiome A §1.6
- centralisateur §0.2
- classe
-
closing lemma Théorème 2.7
- ergodic Théorème 4.1
- cocycle linéaire périodique §7.1
-
conjecture
- d’hyperbolicité Conjecture d’hyperbolicité, Conjecture d’hyperbolicité
- de finitude Conjecture de finitude, Conjecture de finitude
- de Palis Conjecture, Conjecture
- de Smale Conjecture, Conjecture
- faible de Palis 0.3.b La conjecture faible de Palis., §9.10
- connecting lemma Théorème 2.10
-
connexion forte §8.2
- généralisée §8.2
- critique, dynamique item –
-
cycle §1.6
- hétérodimensionnel §3.4, Définition 8.4
- hétérodimensionnel robuste Définition 8.5
- décomposition dominée §5.1
- dérivé d’Anosov, difféomorphisme §5.10
- domaine de perturbation §a)
- ensemble
- exposant de Lyapunov §5.5
-
famille de plaques Définition 5.1
- finement piégée item –
- localement invariante Définition 5.1
- piégée item –
- filtration §1.2
- généricité §2.1
- hétérodimensionnelle, dynamique item –
- homocliniquement reliées, orbites §1.5
-
hyperbolicité
- difféomorphisme Définition 1.3
- en volume Théorème 7.13
- ensemble §1.4
- essentielle Chapter 10
- mesure §5.5
- partielle §5.1
- ponctuelle Définition 5.4
- segment d’orbite Définition 5.11
-
indice §1.4
- complétude §8.8
- Kupka-Smale, difféomorphisme §2.2
-
lemme de connexion Théorème 2.10
- pour les pseudo-orbites Théorème 3.1
- lemme de connexion globale Théorème 4.4
-
lemme de fermeture Théorème 2.7
- ergodique Théorème 4.1
- lemme de Franks Théorème 2.2
- lemme de perturbation Théorème 2.5
- lemme de sélection §5.7
- mécanismes et phénomènes §0.3, §9.1
- mélangeur §3.4, §8.7
-
modèle central Définition 9.5
- type §c)
- modéré, difféomorphisme item –
- Morse-Smale, difféomorphisme Définition 1.5
- ouvert attractif §1.2
- perturbation élémentaire Lemme 2.3
- perturbation fantôme §11.3
- phénomène de Newhouse §3.4, §7.6
- phénomènes et mécanismes §0.3, §9.1
-
pistage
- faible Corollaire 4.5
- généralisé Théorème 5.12
- pseudo-orbite §1.1
- puits §1.4
- quasi-attracteur §1.3
- récurrence par chaînes §1.1
- sauvage, difféomorphisme item –
- segment récurrent par chaînes item –
- selle §1.4
- source §1.4
- spécification §8.3, Définition 8.1
- stabilité
- support, d’une perturbation §2.9
-
tangence homocline Définition 7.5
- robuste Définition 7.8
- théorème de densité Corollaire 2.8
- théorème fondamental de la dynamique Théorème 1.1
- tour topologique §b)
- transition footnote 1
- transitivité §1.1
- transversalité forte item (transversalité forte), item (transversalité forte)
- universel, difféomorphisme §0.3, Définition 8.16
- variété stable forte §5.4
- vecteur de Lyapunov §5.5