Compactifications polygonales d’un immeuble affine
Résumé
We define a compactification of an affine building indexed by a family of partitions of the director space of one of its appartments . This compactification is similar to Satake’s compatification of a symetric space, and it generalizes the quite well known polygonal compactification of an affine building in the sense that it is independant of the action of a group on the building, and that it allows some variations depending on the choice of the partition of . The different choices will mainly lead to different subgroups of the Weyl group acting on the border of . Along the proofs, we get some results to help one find subsets of the building wich are included in an apartment, for exemple we prove that two sector facets can always be reduced so that they fit in one apartment.
Résumé
A partir d’une décomposition en cônes de l’espace directeur d’un appartement d’un immeuble affine localement fini, on définit une compactification de l’immeuble semblable à la compactification de Satake d’un espace symétrique. Comme cas particuliers de cette construction, on retrouve la compactification polygonale classique telle que décrite dans [Lan96] ou ses généralisation décrites dans [Wer07]. Un intérêt de la construction présentée ici est qu’elle est totalement géométrique: elle est indépendante de l’existence d’un groupe agissant sur l’immeuble. On prouve au passage plusieurs résultats permettant d’identifier certaines parties de l’immeuble qui sont incluses dans un appartement, par exemple on prouve que deux facettes de quartier sont, quittes à être réduites, incluses dans un même appartement.
1 Introduction
Le but de cet article est de présenter une construction purement géométrique de la compactification polygonale d’un immeuble affine localement fini, comme celle décrite par Landvogt [Lan96]. On s’affranchit totalement de l’usage d’un groupe agissant sur l’immeuble, ce qui permet de définir une compactification pour les quelques immeubles qui pourraient ne pas être associés à un groupe muni d’une BN-paire.
On propose également une généralisation: on définit toute une famille de compactifications, indexée par l’ensemble des partitions de l’espace directeur d’un appartement en cônes assujettis à certaines conditions.
Parmi elles se trouvent la compactification polygonale classique définie dans [Lan96] ou [GR06] ainsi que celles décrites par Annette Werner dans [Wer07].
Décrivons rapidement l’espace obtenu. L’adhérence de chaque appartement sera l’espace compact obtenu en rajoutant à l’infini un polygone, dont chaque face sera un complexe de Coxeter avec comme groupe un sous-groupe du groupe de Weyl de l’immeuble. On peut choisir n’importe quel polygone stable par le groupe de Weyl vectoriel, mais pour un choix quelconque, la structure de complexe de Coxeter sera triviale sur de nombreuses faces. La compactification de l’immeuble est obtenue en étendant la compactification d’un appartement de référence, d’une manière qu’on prouvera être unique dans la majorité des cas. Le bord ainsi rajouté à l’immeuble est en fait une réunion d’immeubles affines, dont les groupes de Coxeter sont des sous-groupes du groupe de Coxeter de l’immeuble de départ. Le choix de la décomposition en cônes au départ détermine lesquels de ces sous-groupes interviennent.
Par ailleurs, quelques résultats intermédiaires peuvent avoir leur intérêt propre, certains sont valides dans le cadre d’un immeuble quelconque. Il s’agit principalement des résultats de la partie 4, qui donnent des critères pour s’assurer qu’une partie d’un immeuble est incluse dans un seul appartement. On prouve notamment que deux galeries tendues sont, quitte à être réduites, incluse dans un même appartement (du système complet d’appartements), puis on généralise au cas d’une galerie tendue et d’une cheminée. Ceci prouve par exemple que deux facettes de quartiers quelconques contiennent des sous-facettes incluses dans un même appartement, généralisant le résultat similaire déjà connu pour les quartiers (voir par exemple la proposition (9.5) de [Ron89]). Quelques résultats classiques sur l’enclos d’une partie sont également prouvés, dans le cas d’une partie ne coupant aucune chambre.
Dans la partie, 2, on énonce et on analyse brièvement les conditions requises sur une décomposition en cônes de l’espace directeur d’un appartement pour définir une compactification de l’immeuble. Dans la partie suivante, on définit la compactification d’un appartement. L’interlude de la partie 4 permet d’énoncer les quelques résultats nécessaires à la suite qui peuvent avoir un intérêt propre. La partie 5 définit l’ensemble qui sera l’immeuble compactifié, la partie 6 définit la topologie sur cet ensemble et prouve les propriétés attendues, en particulier la compacité. Dans la partie 7, on vérifie que la compactification de l’immeuble ainsi définie est unique lorsqu’une compactification d’un appartement est fixée et que l’immeuble provient d’un groupe muni d’une donnée radicielle. Cela fournit un moyen simple de comparer cette compactification avec d’autres, comme celles définies dans [Lan96],[GR06] et [Wer07]. Enfin, la partie 8 décrit le bord qu’on vient de rajouter à l’immeuble: il s’agit d’une réunion d’immeubles affines de dimensions inférieures.
2 La donnée initiale
2.1 Conventions, notations
Un immeuble sera vu a priori comme un complexe simplicial vérifiant les axiomes classique ([Bro89], [Tit74]), ou comme un complexe polysimplicial comme dans [BT72]. Chaque appartement est un complexe de Coxeter, dont on note le groupe de Coxeter. Ce groupe est indépendant de à isomorphisme près. Lorsqu’on choisit une chambre de , les réflexions par rapport aux cloisons de forment une partie de telle que est un système de Coxeter. La classe d’isomorphisme de est caractérisée par un diagramme appelé diagramme de Coxeter. Son ensemble de sommets est en bijection avec , et les sommets correspondant aux réflexions et sont reliés si et ne commutent pas. On précise alors sur l’arête l’ordre de . Ce diagramme ne dépend pas du choix de ni de .
On définit sur l’ensemble des facettes le type, c’est une fonction à valeur dans qui permet de caractériser les orbites des facettes d’un appartement sous l’action du groupe de Weyl. Les isomorphismes entre appartements préservent le type, par définition.
L’ensemble des chambres de est muni d’une distance à valeur dans , appelée -distance. En fait, est totalement déterminé par l’ensemble de ses chambres muni de sa -distance, c’est d’ailleurs le point de vue adopté dans [Ron89].
Nous nous intéressons principalement aux immeubles affines. Dans ce cas, on identifie à sa réalisation géométrique affine, qui est un espace métrique complet dans laquelle les appartements sont des espaces affines euclidiens, les groupes de Coxeter des groupes de transformations orthogonales affines, et les isomorphismes entre appartements des isométries. Voir [Bro89], chapitre VI, [BT72], [Tit86], [Par00],[Rou08]. C’est cet espace qu’on se propose de compactifier. Si est un appartement, le groupe est engendré par les réflexions orthogonales par rapport à des hyperplans appelés murs ([Bou68]). Les murs définissent une partition de dont les parties sont identifiées aux facettes de , les chambres étant les facettes de dimension maximale.
On note l’espace directeur de , c’est lui aussi un complexe de Coxeter dont le groupe est l’ensemble des parties vectorielles des éléments de . Il est engendré par les réflexions orthogonales par rapport aux murs de , qui sont les espaces directeurs des murs de . Les murs de définissent une partition de en cônes convexes appelés facettes de Weyl ou facettes vectorielles. Ces parties sont identifiées aux simplexes du complexe de Coxeter .
Il existe un système de racine tel que les murs de sont les noyaux des racines et dont est le groupe de Coxeter affine associé, au sens de [Bou68], 2.5.
Si on fixe une chambre de Weyl , on note, pour la racine correspondante (donc ). Alors est une base de et . De plus, dans le diagramme de Coxeter de , deux sommets et sont reliés si et seulement si n’est pas orthogonale à . En considérant ce diagramme comme un simple graphe, on définit les notions de connexité habituelles.
Lorsqu’on passe du point de vue complexe simplicial au point de vue géométrique d’un immeuble affine, le vocabulaire change un peu:
Un complexe simplicial est en particulier un ensemble muni d’une relation d’ordre. On notera généralement cette relation, et on dira que est inclus dans lorsque . Mais lorsque dans un immeuble affine, alors dans la réalisation géométrique est inclus dans l’adhérence de , avec si et seulement si . En général, .
De plus, dans un complexe simplicial, la facette maximale inférieure à et à , notée est appelée l’intersection de et . Dans la réalisation géométrique, l’adhérence de est égale à l’intersection des adhérences de et , mais ne s’exprime pas de manière directe en fonction de et (en fait, est l’intérieur de dans ).
Si est un mur et une chambre dans un système de Coxeter , on notera le demi-appartement fermé délimité par et contenant . Sauf précision, un demi-appartement signifiera un demi-appartement fermé. Un demi-appartement peut aussi être défini à l’aide de deux chambres adjacentes et , ou d’une racine (on voit a priori les racines comme des formes affines sur un appartement) et d’un entier : on notera la réunion des chambres fermées plus proches de que de , et .
Soient et les deux demi-appartements définis par un mur dans un appartement . On dira que deux parties et de sont séparées par si et , ou l’inverse. On notera alors (Donc par exemple, quel que soit ). On dira que ces parties sont séparées strictement par si en outre et .
L’enclos d’une partie dans un appartement est l’intersection de tous les demi-appartements fermés de contenant . On la note .
Lorsque et sont deux appartements ayant au moins une chambre en commun, on peut naturellement identifier avec . Lorsque la dimension de est moindre, on ne peut qu’identifier un sous-espace de avec un sous-espace de , voici comment on procède:
Les sous-espaces et sont canoniquement isomorphes. On identifie alors ces deux sous-espaces, et on note l’espace obtenu . Cet espace vérifie la propriété suivante: si est un troisième appartement, si et sont deux isomorphismes qui coïncident sur un ensemble , alors l’espace directeur de est inclus dans , et pour tout , on a .
Cette ”intersection des espaces directeurs” ne vérifie pas l’associativité, en fait l’écriture n’a même aucun sens, car n’est pas uniquement défini au moyen de la structure vectorielle de et , mais bien de la structure d’espaces affines de et . (Une notation comme serait sans doute plus appropriée.)
Remarque: Dans la suite, ne signifiera pas en général l’espace directeur de .
2.2 Cônes convexes
Dans cet article, tous les cônes seront supposé convexes a priori. Un cône vectoriel convexe dans un -espace vectoriel est un sous-ensemble de stable par addition et multiplication par un scalaire strictement positif. Tout cône vectoriel contient dans son adhérence. Si est un espace affine dirigé par , un cône convexe affine de est un sous-ensemble de de la forme où et est un cône convexe de .
Lorsque est un cône de ne contenant pas de droite (on dit aussi ”cône pointu”), alors l’écriture est unique, ce qui permet de définir comme étant le sommet de , noté .
Le cône vectoriel est quand à lui toujours bien déterminé, on l’appelle la direction de . Deux cônes ayant la même direction sont dit parallèles. Si est un cône parallèle à et , alors est un sous-cône parallèle de , et on abrège ”sous-cône parallèle” en ”scp”.
Remarque: Dans [BT72], deux parties d’un appartement égales à translation près sont appelées équipollentes au lieu de parallèles.
2.3 Décomposition d’un appartement en cônes
On fixe désormais un appartement . On notera son groupe de Coxeter, et son groupe de Coxeter vectoriel. On choisit un ensemble de parties non vides de vérifiant les propriétés suivantes:
(H1) . (Le symbole signifie ”réunion disjointe”.)
(H2) est fini.
(H3) .
(H4) Chaque élément de est décrit par un système d’équations et d’inéquations linéaires: pour tout , il existe , , tels que . En particulier, chaque élément de est un cône convexe, ouvert dans son support.
(H5) Le bord d’un cône de est une réunion d’autre cônes de , qu’on appelle les faces de .
(H6) Si et si est une face de , alors .
Lorsqu’on parle du bord d’un cône, on sous-entend ici le bord dans l’espace vectoriel qu’il engendre. Pour un cône vérifiant (H4), qui est donc ouvert dans , on a .
A partir de ces données, on va définir une compactification de . Dès qu’on voudra l’étendre en une compactification de , il faudra en outre supposer:
(H7) est stable par le groupe de Weyl vectoriel .
2.4 Conséquences directes des hypothèses sur
Chaque élément de est un cône convexe, ouvert dans l’espace vectoriel qu’il engendre.
De plus, est le seul cône à contenir , donc aucun élément de ne contient de droite, ce qui permet de définir les sommets des cônes affines de direction un élément de .
Remarque: La condition (H3) a en fait pour unique but de permettre de définir le sommet d’un cône pour faciliter les raisonnements dans la suite, mais elle semble superflue. Étudions brièvement le cas général. Soit le cône contenant . Comme est un cône ouvert dans , on a , c’est-à-dire que est un espace vectoriel. Comme l’adhérence de tout cône vectoriel contient , par (H5) on voit que est dans le bord de chaque élément de . On vérifie alors que chacun de ces éléments est stable par addition par , on peut donc tout quotienter par pour obtenir un espace vectoriel muni d’une décomposition en cônes vérifiant cette fois toutes les hypothèses (H1) - (H6). Si est le bord qu’on va définir dans la section 3, alors la même procédure appliquée à et conduirait à rajouter exactement le même bord. En fait, la condition (H3) impose de rajouter à un bord de codimension 1 et non supérieure.
Lorsque est une famille de formes linéaires définissant comme dans la quatrième hypothèse sur , on notera juste
La famille est nécessairement génératrice de sans quoi ou une de ses faces contiendrait un sous-espace vectoriel de non réduit à .
Lorsque est une face de , alors il existe une famille telle que:
2.5 Exemples
Un premier exemple de telle décomposition de en cônes est la décomposition en facettes de Weyl, notée . Les cônes affines dont les directions sont dans sont les facettes de quartier, et la compactification qu’on obtiendra alors est la compactification polygonale classique, décrite dans [Lan96].
Un exemple un peu plus général est celui considéré par Annette Werner dans [Wer07], où il s’agit grosso modo d’enlever à la décomposition en facettes de Weyl les cloisons d’un certain type. C’est cet exemple que je développe ici.
2.5.1 Décompositions en cônes obtenues à partir d’une partie de
On fixe une chambre de Weyl , soit l’ensemble des réflexions par rapport aux cloisons de , de sorte que les facettes de sont typées par les parties de . Soit une partie de , l’idée est de rassembler les chambres séparées par une cloison de type avec . Pour assurer la convexité, il faut penser à rajouter alors les facettes de dimension plus petite qui se trouvent entre plusieurs chambres rassemblées. Pour s’assurer que (H5) et (H6) seront vérifiées, il faut aussi rassembler les facettes bordant plusieurs chambres rassemblées, lorsqu’elles engendrent le même espace vectoriel. On arrive à la définition suivante:
Définition 2.5.1
Si une facette de Weyl de de type , on note la réunion de et des facettes de son bord de type inclus dans .
Si et sont deux facettes d’une même chambre fermée, avec de type et de type , alors est incluse dans si et seulement si est la réunion de et d’une partie de disconnectée de . Donc une facette n’est incluse dans aucun , avec si et seulement si son type ne contient aucune composante connexe incluse dans . Une telle facette sera dite admissible. On dira également que son type est admissible, de sorte qu’une facette est admissible ssi son type est admissible.
Définition 2.5.2
Si est une facette admissible de , on pose .
On pose ensuite .
Remarque: Conformément à la notation déjà introduite, l’ensemble des facettes de Weyl est .
Proposition 2.5.3
L’ensemble est un ensemble de cônes, qui vérifie les hypothèses (H1)-(H2) et (H4-H7). Chaque facette de Weyl est incluse dans un unique cône de , qu’on notera . Lorsque ne contient aucune composante connexe de , alors vérifie également (H3).
Démonstration:
Les points (H2), et (H7) sont évidents, (H3) est vrai si et seulement si est une facette admissible, ce qui équivaut bien au fait que ne contient aucune composante connexe de . Il est également clair que , et pour prouver (H4) et (H5), il suffit de considérer des éléments de du type , avec une facette admissible de .
On commence par (H4). Soient l’ensemble des racines délimitant . Soit et la facette de de type , alors
et
Notons et . Montrons que . En attendant, notons ce dernier ensemble. C’est un ensemble délimité par des murs, donc une réunion de facettes. De plus, pour tout et tout , , on voit donc que est stable par .
Pour montrer que , il suffit donc de montrer que . Soit , il vérifie déjà les conditions , . Soit et . On sait que est une base du système de racines de . Or, , et . Donc , avec . Il apparaît ainsi que . Donc .
Montrons l’inclusion inverse. Soit , il existe tel que , . Comme est stable par , , et ainsi vérifie toutes les inégalités prouvant qu’il appartient à . Donc .
A présent, prouvons que chaque facette de Weyl est incluse dans un unique cône de . Ceci impliquera directement (H1) car les éléments de sont des réunions de facettes de Weyl.
Soit une facette de Weyl, incluse dans deux éléments de , disons et . En translatant tout par un élément de , on peut supposer . Soit le type de et celui de . Il existe et tels que et . Comme , et sont des facettes de , ceci implique en fait . Le type de s’écrit donc où et sont des parties de disconnectées respectivement de et de . Soit une composante connexe du type de , elle est incluse soit dans soit dans . De deux choses l’une: soit et alors ne peut être incluse dans car est admissible, soit et alors elle ne peut être incluse dans . On voit donc que est la réunion des composantes connexes de incluses dans , est la réunion des autres composantes connexes. Le même raisonnement est valable pour et , ce qui prouve et . D’où et . Il reste à regarder et . On sait que , et . D’où , d’où . De même, . Ce qui prouve que est incluse dans un unique cône de .
Prouvons (H5). Soit une facette de Weyl admissible qu’on peut supposer incluse dans , soit son type. Comme est une union de facettes de Weyl, son bord l’est aussi. Soit une facette de Weyl bordant . Quitte à translater par un élément de qui stabilise , on peut supposer , et donc . Comme est ouvert dans , on a même . Notons le cône de contenant , il s’agit de prouver que . Soit le sous ensemble de obtenu en retirant au type de toutes ses composantes connexes incluses dans . Soit la facette de de type , alors est admissible et , donc . Si est une composante connexe de incluse dans alors est une réunion de composantes connexes de incluses dans , d’où car est admissible. Ceci prouve que , et donc . Ensuite, car et . Et comme car , on a d’où .
Il ne reste plus qu’à prouver (H6). Soit une face d’un cône . Comme dans le paragraphe précédent, on peut supposer que et sont des facettes admissibles de . Soit le type de et le type de . Nous procédons par récurrence sur , en commençant par montrer l’hérédité.
On suppose donc . Comme , il existe . Soit la facette de de type , elle est admissible. Par récurrence on a . De plus, est une face de , différente de car est admissible et ne peut donc être incluse dans . Donc par récurrence, . La combinaison des deux égalités donne bien .
Traitons maintenant le cas . Dans l’égalité , l’inclusion est évidente.
Soit , cela signifie, d’après la description de obtenue pour prouver (H4):
-
—
pour tout ,
-
—
pour tout et , .
Et le but est de prouver:
-
—
pour tout ,
-
—
pour tout et , .
Parmi ces inégalités, celles qui ne sont pas directement dans la liste des hypothèses sont les lorsque:
et lorsque .
Soit un tel indice et . En particulier, . Soit tel que . Comme est admissible, .
Alors , et d’où d’après les hypothèses . Mais:
Comme et , on a . Il reste donc .
Mais car et . De plus, si était orthogonal à , il serait orthogonal à , ce qui est exclus. Ainsi, , ce qui entraîne .
2.5.2 Comparaison avec [Wer07]
On peut dès à présent vérifier de façon élémentaire que les partitions de en parties convexes définies dans [Wer07] sont précisément du type précédent. Ces parties sont définies, pour l’immeuble de Bruhat-Tits d’un groupe avec un corps local, à partir d’une représentation linéaire fidèle et de dimension finie de , mais ne dépendent en fait que de la facette de Weyl de dans laquelle se trouve le plus haut poids de une fois fixée une base du système de racine ([Wer07] théorème 4.5). Soit le type de cette facette (il est indépendant de ). Comme est fidèle, ne contient pas de composante connexe de . Pour la base du système de racines correspondant à la chambre , on a . Nous allons vérifier que la partition de définie dans [Wer07] est .
Soit une base du système de racines et . Il est immédiat d’après la définition donnée dans [Wer07] (définition 1.1) que y est dit admissible si et seulement si il existe admissible (au sens défini plus haut) tel que .
Les parties définies dans [Wer07] sont notées pour une base du système de racines et une partie admissible. Ce sont des réunions de facettes de Weyl ([Wer07], proposition 4.4), ouvertes dans leur support, qui réalisent une partition de stable par le groupe de Weyl . Soit la base correspondant à , et une partie admissible. Soit la facette de de type , avec , nous allons voir que . Pour commencer, la proposition [Wer07] 4.4 montre que .
Montrons que est stable par . Soit , alors la facette de de type est incluse dans . Or est ouverte dans son support, qui est et donc qui est stable par . Alors doit contenir la facette . D’où , d’où stabilise . On déduit de ceci que .
Pour l’autre inclusion, soit . En choisissant de manière générique, on peut s’assurer que ne rencontre que des facettes de dimension . Soit la première facette différente de rencontrée par ce segment en partant de . Comme , par convexité de , on obtient que . Comme est de codimension dans , le type de est , avec . Alors la facette est incluse dans , et elle contient ”la suite” du segment , c’est à dire un intervalle ouvert tel que est connexe. On a , et (car ces deux cônes contiennent la facette ). On peut appliquer la proposition [Wer07] 4.4, dans la chambre , on obtient que est la réunion des facettes de de type inclus dans . Alors la prochaine facette rencontrée par le segment est de type , avec , elle est bien incluse dans , la facette de dimension maximale suivante est qui est aussi dans car . Ainsi de suite, on vérifie que tout le segment est inclus dans (puisque ne rencontre qu’un nombre fini de facettes).
2.5.3 Dessins, autres exemples
Voici les dessins de quelques décompositions en cônes de l’appartement vectoriel de type . On note et les réflexions par rapport aux cloisons de la chambre de base.
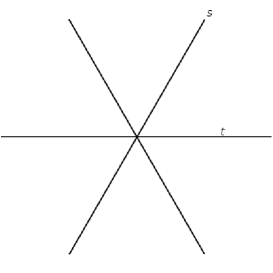
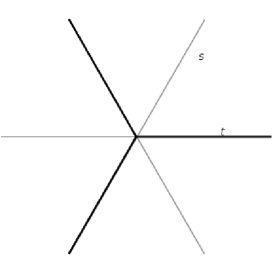
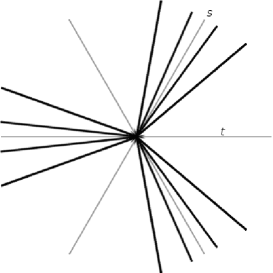
3 Compactification de
3.1 L’ensemble
Définitions 3.1.1
-
—
Un -cône affine dans est un cône dont la direction est dans . On note l’ensemble des -cônes affines de .
-
—
Deux -cônes affines sont équivalents lorsqu’ils sont parallèles et que leur intersection est non vide. L’intersection contient alors un autre -cône affine, parallèle aux deux premiers. On note , ou juste lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté.
Proposition 3.1.2
La relation ”être équivalent” est une relation d’équivalence sur .
Remarquons également que les relations ”être un sous-cône” et ”être un sous-cône parallèle” sont des relations d’ordre.
Définition 3.1.3
On pose . Pour , on note , ou juste lorsqu’aucune confusion n’est possible, la classe de . Et si avec , , on appelle le cône directeur ou la direction de (il est uniquement déterminé).
Pour , on note l’ensemble des points de de cône directeur , c’est la ”façade” de type de l’appartement . La projection est notée ou juste . Lorsqu’un cône de direction est fixé, on pourra noter pour simplifier .
Proposition 3.1.4
Soit . La façade est un espace affine isomorphe à , et son espace vectoriel directeur est .
Lorsqu’un cône vectoriel s’écrit avec une famille de formes linéaires, alors les , s’identifient à des formes linéaires sur , elles forment même une famille génératrice de . Quand aux , , on sait qu’elles envoient tout représentant de tout point de sur un voisinage de dans , on dira donc qu’elles prennent la valeur sur .
3.2 Topologie sur
3.2.1 Définitions
Définition 3.2.1
Soit l’ensemble des voisinages de dans stables par le groupe de Weyl . Pour un tel voisinage, et , on pose:
C’est l’ensemble des points de ayant un représentant inclus dans .
Lorsqu’il n’y aura pas d’ambiguïté, je noterai juste .
Remarque: Comme le produit scalaire de est -invariant, les boules de centre sont des exemples d’éléments de .
Proposition 3.2.2
Il existe une unique topologie sur telle que pour tout , l’ensemble des pour et soit une base de voisinage de .
Démonstration:
Il suffit de vérifier que pour tout , , , il existe et tels que . Mais comme , contient un autre représentant de . Soit , alors , d’où .
Remarque: La fonction ainsi définie est croissante en les deux variables: si et alors et .
On remarque aussi qu’on peut remplacer par n’importe quelle base de voisinages de dans , on obtiendra alors encore une base de la même topologie sur . On peut notamment choisir une base dénombrable de voisinages de , ensuite si on se limite par exemple aux cônes dont les coordonnées du sommet sont rationnelles, on obtient une base dénombrable de la topologie de : est à base dénombrable d’ouverts, les caractérisations par des suites sont possibles.
Afin de pouvoir raisonner à l’aide de suites dans la suite, on va donner une caractérisation des suites convergentes. Commençons par le lemme suivant:
Lemme 3.2.3
Soit et soit un système d’équations et d’inéquations déterminant . Soit . Soit une suite dans telle que pour , et pour .
Alors à partir d’un certain rang, les sont dans .
Preuve du lemme:
La seule difficulté provient du fait que est une famille génératrice mais pas forcément libre de . Soit maximal tel que soit libre. Soit ensuite tel que soit une base de .
Il existe tel que .
Pour assez grand, on a pour . Soit alors tel que pour et pour . Le point est alors dans , et il suffit de vérifier que .
Or pour tout , . Comme tout est combinaison linéaire des , on obtient que pour tout . Enfin, est borné, donc pour tout , aussi. Comme tend vers , on vérifie bien que est positif dès que est assez grand.
Il est maintenant facile de prouver la caractérisation des suites convergentes suivante:
Proposition 3.2.4
Soit une suite de dont tous les éléments ont la même direction . Soit . Alors converge vers si et seulement si les deux conditions suivantes sont réalisées:
-
—
est une face de .
-
—
Pour toute famille de formes linéaires telle que et on a pour et pour . (Il existe une telle famille car est une face de ).
Démonstration:
On commence par supposer que tend vers . Si n’est pas une face de , alors il existe une forme linéaire telle que et , et un vecteur tel que . Donc contient un voisinage de l’infini (dans ), et il en va de même de tous les pour un représentant d’un . Il est donc impossible qu’un tel soit inclus dans un ensemble de la forme dès que est borné, il est alors impossible que soit dans le voisinage de correspondant. Et contient bien des éléments bornés, prendre par exemple des boules.
Soit ensuite un ensemble de formes linéaires tel que et .
Soit , montrons que tend vers . Soit , il existe tel que . Et pour assez grand, donc a un représentant inclus dans . Mais , car . On en déduit que . On a ainsi prouvé que
Soit , vérifions que tend vers l’infini. Soit . Comme est un voisinage de l’infini, il existe tel que . Soit tel que . Comme est un autre représentant de , à partir d’un certain rang, doit être dans . Et cela implique .
A présent, supposons que les deux conditions sont vérifiées par la suite et montrons qu’elle converge alors vers .
Comme contient un voisinage de pour tout , on peut choisir un point d’un représentant de pour tout , de sorte que les suites tendent vers . Les suites pour et pour tendent quand à elle obligatoirement vers les et , respectivement. Soit , qu’on peut supposer ouvert, et soit un représentant de , on peut supposer . On a pour tout , car et diffèrent d’un élément de . Alors le lemme indique que est dans à partir d’un certain rang. Mais comme est un point d’un représentant de , est un représentant de . Et , avec un ouvert, et implique que . D’où .
Ceci étant vrai pour tout ouvert, et pour tout , cela prouve la proposition.
3.2.2 Séparation
Proposition 3.2.5
L’espace topologique est séparé.
Démonstration:
Soient et dans , , et soient , des représentants. Il faut trouver , et tels que . D’après la définition de , il suffit de s’assurer que .
Pour commencer, supposons que , c’est-à-dire que et sont parallèles. Alors car sinon on aurait puis . Soient et des formes linéaires sur telles que et . Soit tel que , , soit une boule centrée en telle que . Alors , et conviennent.
Étudions maintenant le cas où . Alors . Les adhérences de ces deux cônes ne sont pas égales, supposons par exemple , soit . Pour tout , . Soit une forme linéaire séparant et : supposons par exemple et . Alors , et pour assez grand, et sont séparés par un hyperplan , . Quitte à choisir encore un peu plus grand, on peut supposer que , et , . Soit alors tel que , on a , ce qui achève la preuve.
3.2.3 L’inclusion canonique
Définition 3.2.6
Soit : . Cette fonction est bien définie car . Il est immédiat qu’elle est injective. On l’appelle l’injection canonique de dans .
Proposition 3.2.7
L’injection canonique est continue, ouverte, d’image dense dans . De plus, pour , et , .
Démonstration:
L’assertion découle directement des définitions. On voit alors que si est ouvert, est ouvert. Comme une base de la topologie de est constituée des pour ouvert, ceci prouve que est continue.
L’image est dense: si , alors pour tout ,
Enfin est ouverte car les ensembles de la forme , , forment une base de voisinages de et ont pour image les .
On identifie donc au moyen de à un ouvert dense de . Une fois cette identification faite, on peut remarquer l’égalité suivante: , ,
3.2.4 Compacité
Proposition 3.2.8
L’espace topologique est compact.
Démonstration:
Il reste à montrer que toute suite admet une valeur d’adhérence. Soit donc une suite dans . Comme est fini, on peut supposer que tous les ont une même direction . Fixons une origine et identifions et . Alors chaque a un représentant inclus dans un cône de . Comme est fini, on peut supposer qu’il existe tel que chaque a un représentant dans . On a forcément .
Choisissons un système d’inéquations pour :
les étant une famille génératrice de . Un système d’inéquations de est alors de la forme:
où est une partition de . Pour , on a pour tout puisque les ont un représentant inclus dans . Et pour , on a .
Quitte à extraire une sous-suite de , on peut supposer que pour tout , soit converge vers une limite , soit tend vers . Soit et ( pour ”convergent” et pour ”non convergent”).
Posons
Nous allons maintenant montrer qu’il existe tel que , , puis que puis enfin que la suite converge vers . Nous aurons besoin du lemme suivant:
Lemme 3.2.9
Soit un espace vectoriel de dimension finie, une famille génératrice finie dans , une suite dans vérifiant , est bornée, et , tend vers . Alors il existe tel que , et , .
Preuve du lemme:
On montre le lemme par récurrence sur le cardinal de . On peut supposer que les coordonnées des selon sont toujours non nulles.
Si alors convient.
Si , soit l’élément de . Soit . Alors pour , , et pour tout . Tous les convergent donc, et comme la famille des est génératrice de , la suite admet une limite dans . Et cette limite vérifie clairement les conditions requises.
Supposons maintenant . Quitte à prendre une sous suite de , il existe une énumération telle que:
-
—
, .
-
—
, la suite converge.
On pose alors , la suite converge vers une limite . Cette limite vérifie pour tout , et elle a au moins une coordonnée () strictement positive. Soit .
En retirant aux un multiple convenable de , et en prenant éventuellement encore une sous suite, on peut rendre bornées un ensemble non vide de nouvelles coordonnées, avec , sans changer les , et en s’assurant que les qui ne sont pas devenue bornées tendent toujours vers l’infini. Alors par hypothèse de récurrence, il existe qui annule les , et tel que pour . Alors convient, ce qui prouve le lemme.
montrons l’existence d’un tel :
Posons pour . Si la famille est libre, l’existence de ne pose aucun problème. Soit tel que soit une sous famille libre maximale de . On peut alors trouver tel que pour . Si alors est combinaison linéaire des , . Disons . En appliquant cette égalité aux et en passant à la limite, on obtient . Donc . Ainsi, convient bien.
montrons que :
Pour montrer que , il faut montrer que . On a , et est l’intérieur de Vect. Donc est une des faces de , d’après les hypothèses faites sur . En fait, la seule difficulté est de montrer que . On va pour ce faire construire directement un point de à partir de la suite .
Pour tout , on peut choisir un point d’un représentant de de sorte que et pour tout . On a alors pour dans , pour et pour . Alors le lemme prouve l’existence d’un point de .
Montrons que la suite converge vers :
Résumons: on dispose d’une famille génératrice de , indexée par , avec:
-
—
pour .
-
—
tend vers pour .
-
—
pour .
-
—
tend vers pour .
De plus et , et donc .
Nous sommes donc exactement dans la situation de la proposition 3.2.4, et la suite tend vers .
3.3 Structure du bord de
3.3.1 Prolongement des automorphismes
Pour que les automorphismes de se prolongent en des homéomorphismes de , il est nécessaire de supposer que est stable par le groupe de Weyl vectoriel (hypothèse (H7)), ce que nous ferons dorénavant. Un tel prolongement est forcément unique puisque est dense dans .
Proposition 3.3.1
Soit , et soit :
.
Alors est un homéomorphisme bien défini de qui prolonge , c’est donc l’unique prolongement continu de à .
Démonstration:
Si , alors car préserve . Donc préserve . On voit également que préserve la relation d’équivalence donc est bien défini. Comme de plus est bijectif sur , on obtient que est bijectif.
Soit , et un voisinage de , montrons que contient un voisinage de . On calcule: . Mais donc
, qui est un voisinage de . Donc est continue.
Comme est compact (donc en particulier séparé), est automatiquement fermée, c’est donc un homéomorphisme.
Bien entendu, l’action de sur s’étend elle aussi de la même manière en une action par homéomorphismes sur . L’action affine et l’action vectorielle sont compatibles au sens suivant: si envoie sur , si est sa partie vectorielle, alors envoie sur et est bien la partie vectorielle de .
3.3.2 Coeurs de cônes
Pour faire le lien entre les cônes de et les facettes de Weyl vectorielles, la notion du coeur d’un cône développée dans ce paragraphe est utile. Il s’agit d’attacher à un cône de une facette vectorielle, ou une partie de facette vectorielle, qui le caractérise.
rappel: Dans un complexe de Coxeter abstrait, si est une facette, alors est le complexe de Coxeter formé de toutes les facettes supérieures à , c’est-à-dire telles que .
Pour définir la notion similaire dans le cadre de la réalisation géométrique d’un immeuble abstrait, nous prenons les conventions suivante: si est un cône inclus dans une facette de Weyl, on appelle étoile de dans et (parfois juste ) l’union de toutes les chambres fermées contenant . C’est un cône convexe fermé d’intérieur non vide. L’étoile de a la propriété que tout mur coupant son intérieur doit contenir . De plus, si est un isomorphisme alors .
Si avec un cône inclus dans une facette de Weyl, on pose .
Définition 3.3.2
Soit , soit le stabilisateur de . On pose , c’est le coeur de .
Voici quelques propriétés simples du coeur d’un cône. Remarquons qu’on obtient des informations non triviales sur les cônes de , en particulier sur leurs stabilisateurs dans .
Proposition 3.3.3
Soit . Alors:
-
1.
, .
-
2.
est un cône vectoriel convexe non vide.
-
3.
Si , alors .
-
4.
est inclus dans l’intersection des murs coupant , et contient les réflexions par rapport à ces murs.
-
5.
, c’est à dire qu’un élément de stabilise ssi il fixe .
-
6.
est inclus dans une facette de Weyl.
-
7.
.
-
8.
(amélioration de 4.) est égal à l’intersection de et des murs coupant , et est le sous groupe de Coxeter engendré par les réflexions selon ces murs.
-
9.
Si et si , alors il existe une facette de Weyl telle que .
Démonstration:
-
1.
Comme , les points fixes de sont . D’où .
-
2.
L’ensemble des point fixes d’une application linéaire est un cône vectoriel convexe. Et aussi. Donc est une intersection de cônes vectoriels convexe, c’en est donc un aussi. Soit . Comme est fini, on peut définir comme le barycentre de . Par convexité de , , et c’est un point fixe pour . Donc .
-
3.
Ceci est clair car .
-
4.
Soit un mur coupant , soit la réflexion selon . Comme est stable par , . Mais fixe au moins un point de , donc , donc et . Alors .
-
5.
Soit . Si alors fixe par définition. Réciproquement, si fixe , alors fixe au moins un point de , donc (on a déjà fait ce raisonnement).
-
6.
Il s’agit d’abord de prouver que pour tout mur vectoriel , est soit inclus dans , soit inclus dans un des deux demi-appartements ouverts délimités par . Mais c’est une conséquence de la convexité de et du quatrième point. Ensuite, d’après le point précédent, il suffit de vérifier que , où est la facette de Weyl contenant . Ceci découle du fait que préserve l’ensemble des facettes de Weyl, et que si stabilise une facette, alors il la fixe.
-
7.
Soit une chambre fermée coupant . Montrons que contient . Supposons par l’absurde qu’il existe . Soit , alors . Soit tel que . On a car . Alors est dans un mur qui borde et qui ne contient par . Mais , donc coupe , donc d’après le quatrième point, . En particulier, , d’où , ce qui est une contradiction.
-
8.
Notons la facette de Weyl contenant . Alors , c’est un sous groupe de Coxeter de , engendré par les réflexions selon les murs contenant . Mais ces murs sont justement les murs coupant (utiliser 4.), d’où la seconde partie de 8. On sait alors de plus que est l’ensemble des points fixes de , et aussi l’intersection des murs contenant . On obtient alors que puis que et l’intersection de et des murs coupant .
-
9.
Si , alors , d’où le résultat.
Lorsque , n’est pas forcement inclus dans une facette de Weyl. On peut néanmoins poser . Ceci contient , par le point 7. de la proposition. On notera alors, si , .
Exemples
-
—
Dans le cas où est l’ensemble des facettes de Weyl de , on a , pour tout .
-
—
Dans le cas où comme dans 2.5, si est une facette admissible de de type , alors par définition, . D’autre part, il est clair que . Il est facile de vérifier qu’en fait . Dès lors, le coeur de est la facette de de type . De manière plus générale, si est une facette admissible, alors est la sous-facette de Weyl de de type .
- —
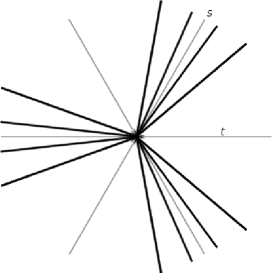
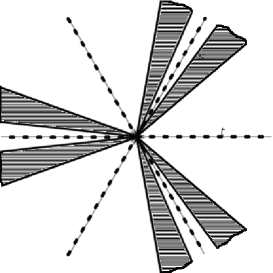
Pour finir, définissons le coeur d’un cône affine:
Définition 3.3.4
Soit un cône affine. On définit alors , c’est le coeur de .
Le coeur d’un cône affine est toujours caractéristique du cône:
Proposition 3.3.5
L’ensemble des coeurs de cône affine possibles est . Et chacun de ces coeurs est le coeur d’exactement un cône affine.
Démonstration: Il est évident que chacun des , pour et le coeur d’un cône vectoriel est le coeur d’un cône affine. Étudions l’unicité. Supposons avec . Comme et sont des sous-cônes de et , ils ne contiennent pas de sous-espace vectoriel non trivial et ont donc chacun un unique sommet, tout comme et . On peut alors conclure, d’après la définition du coeur d’un cône, que le sommet de est aussi celui de , de même pour . Comme , on obtient que tous ces sommets sont égaux. D’où , puis d’après l’étude du cas vectoriel, d’où enfin .
Définition 3.3.6
Soit un coeur de cône dans . On appelle cône affine de engendré par l’unique tel que .
Voici quelques propriétés immédiates du coeur d’un cône affine:
Proposition 3.3.7
Soit . Alors:
-
—
Si est un coeur tel que et , alors le cône engendré par est inclus dans . Si et , alors le cône engendré par est inclus dans .
-
—
Pour tout , si et seulement si fixe .
3.3.3 Structure de complexe de Coxeter vectoriel sur une façade
Fixons un cône . Dans ce paragraphe, on notera la façade de de type . C’est un espace affine dont l’espace directeur est . On munit du produit scalaire obtenu en l’identifiant avec . Nous commençons par étudier la structure de . Notons la projection sur , et sa partie vectorielle.
Soit l’ensemble (fini) des murs vectoriels contenant . Si , alors est un hyperplan de . Nous dirons que les , pour sont les murs de . La fonction :
est injective, nous permettant d’identifier à l’ensemble des murs de . Cet ensemble de murs fait de un complexe de chambres, nous voulons prouver qu’il s’agit en fait d’un complexe de Coxeter. Il nous reste donc à trouver un groupe de Coxeter agissant simplement transitivement sur l’ensemble des chambres de .
Rappelons que le groupe agit sur et que le stabilisateur de est . Pour , on note l’application induite sur . Le groupe préserve et le produit scalaire de , c’est le candidat naturel comme groupe de Coxeter de . Montrons que c’est effectivement un groupe de Coxeter et qu’il agit simplement transitivement sur l’ensemble des chambres de . On observe la suite exacte courte:
D’après le paragraphe précédent, est le fixateur dans de , ou encore le fixateur de la facette de Weyl contenant . Choisissons une chambre contenant dans son adhérence, soit le système générateur de formé des réflexions par rapport aux murs de . Alors il existe tel que . De plus, .
Comme préserve le produit scalaire sur , les éléments de stabilisent et . Dans une base adaptée, leurs matrices sont du type , où est la matrice de restreint à et est la matrice de restreint à , c’est aussi la matrice de .
Soit , est diagonalisable et préserve les espaces et . On peut donc choisir une base adaptée comme précédemment en imposant en plus que et soient diagonales. Le spectre de est composé d’un seul et les autres valeurs propres sont , donc soit est une réflexion et , soit est une réflexion et .
Notons l’ensemble des réflexions de se trouvant dans le premier cas, c’est-à-dire qui agissent sur et fixent . Notons l’ensemble des réflexions se trouvant dans le second cas, qui fixent et donnent une réflexion sur .
Alors , , et est injective. De plus, tout élément de commute avec tout élément de et est engendré par et .
Par conséquent, , avec ( et sont deux parties disjointes du diagramme de Coxeter de ). En particulier, est un groupe de Coxeter.
A présent, on vérifie que le complexe de chambres défini par sur est isomorphe au complexe de Coxeter . On dispose d’une fonction -équivariante de dans les chambres de : il s’agit de la fonction qui a une chambre dans associe la chambre de contenant .
Cette fonction est injective car les murs de contiennent tous les points fixes de donc en particulier , donc ce sont tous des éléments de . Deux chambres distinctes dans sont donc séparées par un mur de , elles donnent donc deux chambres distinctes dans .
Enfin vérifions que est surjective. Toutes les réflexions par rapport à un mur de sont des éléments de . Comme ces dernières agissent transitivement sur les chambre de et comme est -invariante, on obtient bien la surjectivité.
Résumons:
Proposition 3.3.8
Soit , alors l’espace vectoriel directeur de la façade est muni d’une structure de complexe de Coxeter où:
-
—
les murs sont les hyperplans du type où est un mur de contenant .
-
—
le groupe de Coxeter est (isomorphe à avec les notations précédentes).
Si est une chambre fermée contenant , alors ce complexe de Coxeter est isomorphe à , via l’application la chambre de contenant .
Remarque: Ce complexe de Coxeter n’est pas forcément essentiel. Le cas extrême est atteint lorsque est une droite, incluse dans une chambre. Alors , donc est trivial comme complexe de Coxeter, et pourtant il est de dimension .
En fait, est essentiel .
En particulier, est essentiel si est une réunion de facettes de Weyl.
Dans la décomposition , le premier facteur est donc le groupe de Coxeter de . Concernant le deuxième facteur, on montre facilement le résultat suivant:
Proposition 3.3.9
Soit le supplémentaire orthogonal de dans , de sorte qu’en identifiant avec , on a , et la somme est orthogonale.
Alors les murs de contenant contiennent soit , soit . On sait déjà que les premiers induisent les murs de , les second définissent un complexe de Coxeter sur , dont le groupe de Coxeter est . Ce complexe de Coxeter est essentiel.
En terme de diagrammes de Dynkin, disons que si est le diagramme de , (qu’on identifie à un sous-diagramme de ) est obtenu en enlevant les noeuds de correspondant au type de la facette de Weyl contenant . Le diagramme obtenu est séparé en deux parties non reliées, le digramme de et le diagramme de .
Notons que si le diagramme de est connexe, alors ou doit être trivial, c’est-à-dire sans mur, ce qui correspond aux situations suivantes:
-
—
trivial . Comme , ceci équivaut en fait à donc à .
-
—
trivial contient une chambre.
3.3.4 Structure de complexe de Coxeter affine sur une façade
A présent, soit . Alors est un ensemble discret d’hyperplans.
Le sous-groupe de qui stabilise la façade est . Ce sous-groupe contient les symétries par rapports aux murs de , il préserve la structure euclidienne de et cet ensemble d’hyperplans. En notant l’élément de induit par , on voit donc que agit sur en préservant , et qu’il contient les réflexions orthogonales par rapport aux hyperplans de .
Ceci suffit à prouver que définit un complexe de Coxeter affine sur , et que contient le groupe de Coxeter correspondant.
Définition 3.3.10
L’ensemble des facettes de est la réunion des ensembles de facettes de chacune de ses façades.
3.4 Compactification de chaque appartement
Soit un appartement de soit un isomorphisme et sa partie linéaire.
On notera encore l’ensemble des , . Comme deux isomorphismes entre et diffèrent d’un élément du groupe de Weyl , le choix de n’intervient pas dans cette définition. De la même manière, on notera encore l’ensemble des , , ou si l’on préfère, l’ensemble des voisinage de dans stables par .
Comme dans la partie précédente, on définit l’ensemble des cônes affines de , le compactifié de , l’ensemble des façades de , la fonction qui à un cône de et un élément de associe un voisinage dans , le coeur d’un cône, etc…
Un isomorphisme entre deux appartements induit un isomorphisme entre chacun de ces objets pour et l’objet correspondant pour . Il s’étend notamment en un unique homéomorphisme de sur , noté encore . Explicitement, on a .
Pour toute façade de , induit une isométrie entre et , cet homéomorphisme induit une bijection entre les murs de et ceux de , c’est donc un isomorphisme de complexes de Coxeter.
Dans la suite, on appellera isomorphismes d’appartements compactifiés les applications telles qui sont des homéomorphismes entre deux appartements compactifiés qui induisent sur chaque façade un isomorphisme de complexe de Coxeter.
4 Quelques résultats généraux sur les immeubles
Le but principal de cette section est de donner des critères permettant de s’assurer qu’une partie de est incluse dans un appartement. Les résultats de 4.1 sont vrais dans un immeuble quelconque, nous cesserons donc pour cette partie de supposer affine.
A défaut d’une réalisation affine, il sera toujours possible d’utiliser la réalisation comme cône de Tits d’un complexe de Coxeter quelconque. Il s’agit d’un cône convexe dans un espace vectoriel de dimension finie dont le sommet est . Les murs de correspondent à des hyperplans vectoriels de (qui rencontrent l’intérieur de ), les facettes sont des cônes convexes de sommet , les facettes de dimension sont des cônes ouverts dans un sous-espace vectoriel de dimension (voir [Bou68] 4.6).
La notation pour une facette dans un complexe de Coxeter représentera l’intersection des murs de qui contiennent . Si est un complexe de Coxeter affine, identifié à sa représentation affine, alors , et si est un complexe de Coxeter quelconque identifié à son cône de Tits, alors .
On rappelle d’abord quelques résultats classiques, sur lesquels s’appuie toute la suite:
Proposition 4.0.1
Soit un immeuble, de système de Coxeter . Son système complet d’appartement est l’ensemble des parties de isomorphes au complexe de Coxeter de .
A partir de cette proposition, on montre le résultat fondamental suivant (voir [Ron89], théorème 3.6 page 31):
Théorème 4.0.2
Soit un ensemble de chambre de , isométrique pour la -distance de à une partie de . Alors il existe un appartement du système complet d’appartements de contenant .
On note immédiatement deux conditions équivalentes à celle donnée par le théorème:
Corollaire 4.0.3
Soit un ensemble de chambres dans . Les conditions suivantes sont équivalentes:
-
—
Pour tout , , où est la -distance de .
-
—
Trois chambres quelconques de sont incluses dans un même appartement.
-
—
Il existe un appartement contenant .
Voici deux situations particulières où s’applique ce théorème:
Corollaire 4.0.4
-
—
Si est une galerie tendue (pas forcément finie), alors est contenu dans un appartement du système complet d’appartements de .
-
—
Si est un demi-appartement délimité par un mur , et si est une chambre de dont une cloison est incluse dans , alors est inclus dans un appartement du système complet d’appartements de .
Enfin, voici une version assez générale du résultat parfois appelé « lemme fondamental des immeubles »:
Lemme 4.0.5
Soient et des complexes de chambres. On suppose que dans , toute cloison est dans au plus deux chambres. Soit une chambre de et une chambre de . Alors il existe au plus un morphisme de complexes de chambres injectif de dans qui envoie sur .
En particulier, si et , un tel morphisme est forcément l’inclusion.
4.1 Parties closes dans un appartement
Voici quelques rappels sur la notion de partie close, principalement issus de [BT72] pour le cas affine. Pour le cas général considéré ici, on peut se reporter à [Ré02] 5.4.3. On donne une preuve de deux résultats classiques, à savoir la clôture de l’intersection de deux appartements et l’existence d’un isomorphisme entre deux appartements fixant leur intersection dans le cas général où l’intersection des appartements ne contient pas forcément de chambre.
Définition 4.1.1
(rappel) Une partie dans un appartement est dite close si c’est une intersection de demi-appartements de . Si est une partie quelconque de , on note (ou juste ) et on appelle enclos de la plus petite partie close contenant . C’est aussi l’intersection de tous les demi-appartements de contenant .
Proposition 4.1.2
Si est la fermeture d’un ensemble de chambres, alors est clos si et seulement si contient toutes les galeries minimales entre deux éléments de .
Démonstration:
Le sens est clair. Pour l’autre sens, il s’agit de montrer que si est une chambre de qui n’est pas dans , alors il existe un mur séparant de toutes les chambres de .
Soit une galerie minimale de à . Alors et . Soit le mur entre et . Soit , si séparait et alors il existerait une galerie minimale entre et passant par , ce qui impliquerait que , ce qui est impossible. Donc sépare et .
Cette proposition permet une définition de la clôture dans , pour des ensembles de chambres, cohérente avec la précédente:
Définition 4.1.3
Un ensemble de chambres de est dit clos s’il contient toutes les galeries minimales entre deux de ses chambres. L’enclos d’un ensemble de chambres est le plus petit ensemble de chambres clos le contenant.
La proposition précédente prouve que si est un ensemble de chambres inclus dans un appartement , alors est clos (au sens 4.1.3) si et seulement si est clos dans (au sens 4.1.1).
L’enclos d’une partie, même convexe, d’un appartement n’est pas toujours évidente. Par exemple dans un appartement de type on trouve facilement des parties convexes de toute dimension non nulle, dont l’enclos contient des chambres qui n’ont aucun point en commun avec la partie de départ.
4.1.1 Projection
Pour étudier la clôture d’ensembles de facettes qui ne sont pas forcement l’adhérence d’un ensemble de chambre, la notion de projection est très utile. Rappelons-en les principales propriétés.
Définition 4.1.4
Soit un complexe de chambres, soient et deux simplexes de . On appelle projection de sur et on note l’intersection des chambres finales de toutes les galeries minimales de à .
Proposition 4.1.5
Soit un complexe de Coxeter, et , deux simplexes de . Alors:
-
—
-
—
Soit la chambre terminale d’une galerie minimale de à , et soit l’ensemble des murs contenant et . Alors est l’intersection de et des murs de .
-
—
L’étoile de est formée des chambres terminales des galeries tendues de à et des intersections de ces chambres. Son groupe de Coxeter, c’est-à-dire est le groupe engendré par les réflexions selon les murs de .
-
—
avec égalité si et seulement si .
Remarque: La dimension d’une facette dans un complexe de Coxeter est son nombre de sommet. Ceci coïncide avec la dimension de dans le cône de Tits, et avec la dimension de plus dans une réalisation affine si est de type affine et irréductible. Dans le cas non irréductible, la représentation affine de contient des polysimplexes qui engendrent un espace de dimension moindre que leur nombre de sommets moins .
Cependant, la proposition est encore vraie dans ces cas si on remplace la dimension d’une facette par la dimension de l’espace affine qu’elle engendre.
Démonstration:
Pour le premier point, soit un demi-appartement délimité par le mur et contenant et . Soit une galerie minimale de à , si n’est pas incluse dans , alors en la pliant le long de on obtient une autre galerie minimale de à qui elle est incluse dans . La chambre finale de cette galerie contient , d’où . Ceci prouve que .
Passons au second point. Soit une galerie tendue de à avec et . Soit , notons la réflexion selon . Alors est aussi une galerie minimale de à , donc . Nous prouvons ainsi que .
Pour montrer l’inclusion réciproque, il s’agit de prouver que toute galerie tendue de à se termine par une chambre contenant . Soit une telle galerie. Il suffit de prouver que les murs séparant de sont dans . Si est un tel mur, il contient donc en particulier . De plus, il ne peut couper ni ni sans quoi on pourrait réduire ces galeries par un pli le long de . Donc sépare de , donc contient , et en particulier . Ceci prouve que , et conclut la démonstration du second point.
Notons l’ensemble des chambres terminales de galeries tendues de à . Notons aussi le groupe engendré par les réflexions selon un mur de . Nous venons de voir que tout mur séparant deux chambres de est dans . Nous avons vu juste avant que stabilise . Ceci entraîne que , et que contient toutes les galeries tendues entre deux de ses éléments. De plus, l’action de sur est simplement transitive puisque celle de sur les chambres de l’est.
Soit l’ensemble des réflexions selon les murs de bordant . Si , soit une galerie tendue de à , elle est incluse dans . Le premier mur qu’elle rencontre correspond à une réflexion , et alors . On prouve ainsi par récurrence que est engendré par , c’est donc le sous-groupe parabolique de correspondant à la chambre et aux réflexions . C’est donc le fixateur de la facette de fixée par . Mais , c’est l’intersection des chambres de , et par définition, c’est . Au final, , et est l’ensemble des chambres de . Ceci prouve le troisième point.
Pour le dernier point, on considère la réalisation géométrique de comme cône de Tits.
Soit l’ensemble des murs de qui bordent , ils correspondent à une famille d’hyperplans linéairement indépendants (au sens où les formes linéaires les définissant sont indépendantes). Nous avons vu que est l’intersection de et des murs de , d’où . Comme tous ces murs contiennent , on a , d’où .
Le cas d’égalité est atteint lorsque tous les murs contenant contiennent également . On a alors . Réciproquement, si , alors tous les murs contenant contiennent aussi et donc sont dans . Au vu du point précédent, est l’ensemble des murs contenant . On a donc d’où .
4.1.2 Les parties closes sont des complexes de chambre
Proposition 4.1.6
Une partie close dans un complexe de Coxeter est un complexe de chambre.
Démonstration:
Soit une partie close dans un complexe de Coxeter .
Soit un simplexe de , choisissons un simplexe de dimension maximale dans . La proposition 4.1.5 montre que est inclus dans et est de dimension supérieure à celle de . Comme est de dimension maximale, les dimensions sont en fait égale, ceci prouve que est inclus dans un simplexe de dimension maximale.
Il reste à prouver qu’entre deux simplexes de de dimension maximale existe une galerie dans . Soient et deux tels simplexes, on procède par récurrence sur la distance, dans , entre et .
Si , cela signifie que et sont inclus dans une même chambre de . Soit alors la plus petite facette de contenant et , elle est incluse dans donc dans . Comme et sont de dimension maximales dans , on a , d’où . La galerie de longueur formée uniquement de la chambre relie à .
Si , soit , , une galerie tendue dans de à . Comme , le simplexe est de codimension dans (c’est une cloison de ). Maintenant est une chambre de adjacente à et strictement plus proche dans de que . Ce qui conclut la récurrence.
Le cas particulier d’une intersection de murs est intéressant, puisqu’on prouve alors qu’il s’agit d’un complexe de chambre ”au plus mince”:
Lemme 4.1.7
Une intersection de murs dans un complexe de Coxeter est un complexe de chambres dans lequel une cloison est incluse dans au plus deux chambres.
Démonstration:
Soit un ensemble de murs dans un complexe de Coxeter , et leur intersection. En particulier, c’est une partie close de donc un complexe de chambres.
Soit une cloison de . On considère la réalisation géométrique comme cône de Tits du complexe de Coxeter formé des simplexes de contenant .
La facette minimale de est , elle correspond à dans le cône de Tits. Les chambres de contenant correspondent à des demi-droites issues de . Nous voulons montrer qu’il ne peut y avoir qu’au plus deux telles demi-droites.
Les demi-appartements de contenant soit contiennent soit contiennent dans le mur qui les bordent et induisent alors un demi-appartement de . Ceci prouve que est égale à l’intersection des demi-appartements de induits par les demi-appartements de contenant et dont le bord contient . Donc est une partie close de . Dans , c’est l’intersection de avec des demi-espaces, c’est donc un convexe. Donc si est une chambre de contenant , alors , en identifiant et à leurs images dans . Ainsi les chambres de contenant sont, dans , des demi-droites issues de incluse dans la droite : il n’y en a que deux possibles.
Ce dernier résultat permet de prouver la caractérisation géométrique des parties closes suivante:
Proposition 4.1.8
Soit un complexe de Coxeter, sa réalisation comme cône de Tits dans l’espace vectoriel . Soit un ensemble de facettes dont l’image dans est fermée et convexe. Alors est une partie close.
Remarque:
-
—
Réciproquement, une partie close de est clairement convexe et fermée dans , et égale à une union de facettes.
-
—
Ce résultat est encore vrai dans le cadre d’un complexe de Coxeter affine en remplaçant la réalisation comme cône de Tits par la réalisation comme espace affine (et en remplaçant dans la preuve par ).
Preuve du lemme:
On identifie à son image dans .
Soit une facette de dimension maximale. Soit . Pour tout , le segment est contenu dans . Comme est une facette maximale de , ce segment doit rester, au voisinage de , dans . Donc . Ceci prouve que .
A présent, soit une facette qui n’est pas incluse dans , montrons qu’il existe un mur tel que .
Soit , . Comme est fermée, il existe tel que . Quitte à déplacer le point dans , on peut supposer que est dans une facette de dimension dim. Il existe un mur tel que , vérifions que convient. S’il existait un point tel que , alors le segment serait inclus dans . Mais il existe au plus deux facettes de dimension incluses dans et contenant dans leur adhérence, par le lemme 4.1.7. Or et coupent deux telles facettes distinctes. Ceci prouve qu’il y en a deux, et qu’elles sont dans . Mais ceci contredit la définition de car l’adhérence de leur réunion contient un voisinage de dans inclus dans .
4.1.3 Intersection de deux appartements
Proposition 4.1.9
L’intersection de deux appartements et est une partie close de et de .
Démonstration:
Soit une facette maximale dans , c’est à dire une facette qui n’est incluse dans l’adhérence d’aucune autre facette incluse dans . Montrons que .
Soit une facette dans . Soient et deux galeries minimales de à , l’une dans l’autre dans (deux galeries minimales entre deux facettes ont forcément la même longueur). Soit une galerie minimale de à et un appartement la contenant. On a puisque est une facette maximale dans , et toutes les chambres de contiennent .
Soit , est une galerie minimale entre et dans . Si est l’isomorphisme de sur fixant , les murs séparant et sont les images par des murs de séparant et . Si est un tel mur, ne sépare pas et puisque . Donc , sans quoi une des galeries ou traverserait et ne serait donc pas minimale. Il reste donc à prouver que l’intersection de ces murs est , ou de manière équivalente, que l’intersection des murs de traversés par est .
Soit le système générateur du groupe de Coxeter de formé par les réflexions selon les cloisons de . Soit le type de , le fixateur de dans . Soient les murs traversés par , les réflexions correspondantes, et le groupe qu’elles engendrent. Il suffit de montrer que . Pour commencer, puisque est un mur de et que fixe . Notons . Ensuite, on a , avec . On constate alors que fixe . En continuant ainsi jusqu’à , on constate que où les sont des éléments de qui fixent , c’est à dire des éléments de . Il ne reste plus qu’à prouver que chaque élément de apparaît dans . Soit , supposons par l’absurde que . Soit la facette de type , c’est une facette strictement plus grande que , et elle est fixée par toutes les . Elle est donc fixée par toutes les , mais ceci entraîne que , et cela contredit l’hypothèse de maximalité sur .
Nous avons ainsi prouvé que . On peut conclure par récurrence sur la longueur de .
Si , alors est une chambre. Il est alors bien connu que dans ce cas, est l’adhérence d’un ensemble de chambres, et que toute galerie minimale entre deux chambres de est incluse dans . Donc est clos.
Si , utilisons le corollaire 4.0.4 pour trouver un appartement contenant un demi-appartement de délimité par ainsi que et . Cet appartement contient le mur de définit par , il contient donc en particulier , donc . Donc . Par hypothèse de récurrence, et sont deux parties closes de , donc est close dans . Mais il existe un isomorphisme de sur qui fixe , donc en particulier , ce qui conclut la preuve.
4.1.4 Isomorphisme entre deux appartements
Proposition 4.1.10
Soient et deux appartements, alors il existe un isomorphisme fixant . De plus, si est un isomorphisme fixant une facette de dimension maximale de , alors fixe .
Démonstration:
Par 4.1.9 et 4.1.6, est un complexe de chambre. Soit une chambre de . Soient et des chambres de et , respectivement, contenant . Soit un appartement contenant . En composant un isomorphisme de sur fixant puis un isomorphisme de sur fixant , on obtient un isomorphisme fixant . Montrons que fixe .
Le dernier point de la proposition 4.1.5 montre que et . Or , d’où . Comme est un complexe de chambre ”au plus mince”, par 4.1.7, et que induit un morphisme injectif entre et le ”lemme fondamental des immeubles” 4.0.5 montre que fixe .
4.2 Cheminées
La notion de cheminée permettra d’utiliser pleinement le théorème 4.5.2 (ci-dessous). Nous en donnons ici une définition ainsi que les propriétés élémentaires. On suppose dorénavant que est affine.
Lemme 4.2.1
Soit un appartement, une facette de , une facette de . Alors les points de restent à distance bornée de .
De plus, si est une autre facette de , une autre facette de telles que , alors .
Preuve du lemme:
Soit des formes affines sur telles que soit une base du système de racines de avec et telles que les murs de de direction sont les pour . Alors:
en appelant, pour , la partie entière de et pour , le plus petit entier supérieur à .
Le troisième ensemble est une intersection de demi-appartements donc une partie close, donc contient . Il est de plus égal à avec . Comme est une base de et qu’elle reste bornée sur , on déduit que est borné. Mais est également borné, on voit alors facilement que les points de sont à distance bornée de . Et ceci reste en particulier vrai pour les points de .
Maintenant si , cela signifie qu’il existe . Alors . Pour un point de , les points de la forme sont dans et peuvent être rendus arbitrairement éloignés de , car est borné. Ceci contredit que .
Définition 4.2.2
-
—
Une cheminée dans un appartement est une partie de de la forme , où est une facette de et une facette de . La facette est uniquement déterminée par d’après le lemme 4.2.1, on l’appelle la direction de .
-
—
Soient et deux cheminées. On dira que est une sous-cheminée de lorsque . On dira que est une sous-cheminée pleine, abrégé en scp, lorsque de plus et ont la même direction et .
On abrège de la même manière sous-cheminée pleine et sous-cône parallèle, mais les deux notions ont à peu près le même sens, l’une dans le cadre des cônes affines et l’autre dans le cadre des cheminées.
Proposition 4.2.3
Soit une cheminée dans , soit une facette de incluse dans . Alors , c’est donc une sous-cheminée de .
Démonstration:
Soit un demi-appartement de contenant , montrons qu’il contient . Ceci n’est pas tout à fait évident car , et donc n’est pas forcément incluse dans . Soit , tels que . Nous savons déjà que . Soit , , montrons que . Dans le cas contraire, nous aurions et , d’où . Choisissons alors un point quelconque , on aura car , mais pour un réel assez grand. ceci contredit le fait que . Donc .
Le lemme suivant permet dans certains cas de se ramener à des cheminées dont la base est une chambre.
Lemme 4.2.4
Soit une cheminée. Soit une chambre dont l’adhérence contient , et . Alors toute sous-cheminée pleine de contient une sous-cheminée pleine de .
Preuve du lemme: Soit une scp de . Le cône contient une scp de , et pour montrer que , il suffit de prouver qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare strictement de . Soit un tel mur. Comme et sont deux parties incluse dans , si sépare strictement de , alors doit séparer strictement deux parties de . Mais c’est impossible pour un mur dont la direction contient .
Définition 4.2.5
Soit une cheminée. Une demi-droite caractéristique de est une demi-droite dont l’extrémité est dans et dont la direction est incluse dans (en particulier, ).
Remarque: Si est une demi-droite, alors est une cheminée dont est caractéristique.
Proposition 4.2.6
Soit une cheminée dans un appartement . Soit une demi-droite caractéristique de . Alors:
-
—
-
—
est l’intersection des murs contenant
-
—
Si est une demi-droite incluse dans , alors est une scp de .
Démonstration:
Pour le premier point, la proposition 4.2.3 prouve que . Pour montrer l’autre inclusion, soit un demi-appartement contenant , montrons qu’il contient . Soit le sommet de , sa direction, de sorte que . Le fait que est dans prouve que contient . Et le fait que contient une demi droite dirigée par prouve que . Mais est inclus dans , et est une racine, d’où . On obtient alors , d’où .
Pour prouver le second point, soit l’ensemble des murs contenant . Soit , alors est dans les deux demi-appartements délimités par , donc est dans l’intersection de ces deux demi-appartements, c’est-à-dire dans . Ceci prouve que .
Pour l’inclusion réciproque, comme la répartition des murs de est discrète, il existe qui n’est inclus dans aucun autre mur que ceux de . Soit la distance minimale entre et un mur n’appartenant pas à , on a encore par la répartition discrète des murs. Alors la boule dans de centre et de rayon est incluse dans , ce qui prouve que
.
Enfin pour le troisième point, il faut montrer que . Ceci provient directement du point précédent.
Remarque: Guy Rousseau définit les cheminées comme l’enclos dans d’une demi-droite, et d’un germe de segment de même origine. Dans le cas d’un immeuble où les murs sont répartis de manière discrète, c’est une définition équivalente au vu de la proposition qui précède.
Ainsi, une cheminée peut-être caractérisée par une demi-droite. Nous allons maintenant voir qu’une demi-droite est incluse dans une galerie tendue, ce qui permettra de ramener les raisonnements sur les cheminées à des raisonnement sur les galeries tendues.
Proposition 4.2.7
Soit une demi-droite et son origine, ou un segment et une extrémité de . Alors pour toute chambre contenant dans son adhérence, il existe une galerie tendue commençant par contenant dans son adhérence. De plus, l’adhérence de toute chambre ou cloison de cette galerie rencontre .
Preuve du lemme:
Soit l’ensemble fini des murs contenant . Soit l’intersection de tous les demi-appartements pour . La demi-droite est incluse dans . Elle est découpée en segments d’intérieur non vide (pour la topologie induite sur ), et chacun de ces segments est inclus dans une unique chambre fermée incluse dans . En effet, si un tel segment est inclus dans deux chambres, alors il existe un mur séparant ces chambres et contenant ce segment. Comme le segment est d’intérieur non vide, contient , donc , donc au plus une des deux chambres est dans . Soient ces segments, rangés de manière que le sommet de soit dans et que , . Soient les chambres correspondantes, est bien la chambre donnée dans l’énoncé. Pour , soit une galerie minimale entre et . C’est une galerie incluse dans car est clos. On définit enfin comme la concaténation des auxquels on a retiré leurs dernières chambres, c’est à dire , pour éviter qu’elles n’apparaissent deux fois de suite. Cette galerie contient bien , il reste à vérifier qu’elle est tendue.
Remarquons pour commencer que puisque , les murs de ne séparent pas les chambres de . Supposons qu’il existe un mur coupant deux fois , entre et puis entre et . Il existe et tels que et . Toutes les chambres de contiennent dans leur adhérence le point de , donc contient aussi ce point. De même contient le point de . Mais ne peut contenir deux points distincts de sans contenir , donc . Alors coupe deux fois, mais c’est impossible puisque est une galerie minimale.
4.3 Inclusion d’une partie d’appartement et d’une chambre dans un appartement
On suppose dorénavant munit de son système complet d’appartements.
Considérons une galerie tendue de longueur . Soit un appartement contenant , le but est d’étudier quelles parties de sont incluses dans un appartement contenant également . On peut supposer que n’est pas dans . Soit le mur de contenant la cloison . Alors d’après le corollaire 4.0.4, chacun des deux demi-espaces de délimités par est inclus dans un appartement contenant également . Soit un tel appartement contenant un demi-appartement de et . On définit comme étant le mur de contenant la cloison . Alors chacun des demi-appartements de peut être inclus dans un appartement contenant . Mais ces demi-appartements contiennent en quelque sorte des quarts d’appartement de . En continuant ainsi jusqu’au bout de la galerie , on prouve la:
Proposition 4.3.1
Soit un appartement et une chambre. Soit la longueur minimale entre une chambre de et . Alors il existe un découpage de en parties fermées, (certaines pouvant être vides) tel que
-
—
est obtenu en coupant en deux le long d’un mur, puis en coupant chacun des demi-appartements obtenus encore en deux le long d’autres murs, et en répétant cette opération encore fois
-
—
chaque élément de est inclus dans un appartement contenant également .
Remarque: Cette proposition est vraie dans un immeuble quelconque.
Voici deux résultats qui seront très utiles par la suite directement obtenus grâce à cette proposition.
Corollaire 4.3.2
-
—
Soit une galerie tendue infinie. Soit une chambre de . Alors il existe et un appartement contenant et tous les pour .
-
—
Soit une facette de quartier, et une chambre. Alors il existe un scp de qui est inclus dans un appartement contenant également .
Pour prouver ce corollaire, il suffit de remarquer que si est un appartement contenant , si est un mur de alors un des deux demi-appartements de définis par contient tous les à partir d’un certain rang, car une galerie tendue ne peut être coupée deux fois par un même mur.
Et de la même manière, si contient , alors un des demi-appartements définis par contient un scp de .
Nous voulons maintenant préciser la proposition 4.3.1, en déterminant certaines zones de qui seront obligatoirement incluses dans un élément de la partition . Pour cela, il s’agit d’identifier des parties de qui ne seront jamais coupées par un mur ”séparant de ”. Commençons par donner un sens précis à ceci:
Proposition 4.3.3
Soit , soit une galerie tendue telle que , avec un intervalle de contenant . Soit un appartement contenant , et un isomorphisme fixant . Soit une partie de , connexe, contenant , telle qu’aucun pour un mur de traversé par ne sépare strictement deux points de .
Alors il existe un appartement contenant .
Démonstration:
On construit par récurrence une suite d’appartements telle que pour tout , on ait .
Pour , convient. Supposons à présent construit, avec tel que . Soit le mur de contenant . Si nous prouvons que ne coupe pas alors ceci entraînera que , et le corollaire 4.0.4 prouvera l’existence d’un convenable.
Supposons par l’absurde que rencontre . Soit l’isomorphisme fixant (il est unique car contient la chambre ). Alors rencontre . Mais , ou est l’isomorphisme fixant . Et est un mur de coupant . Ceci contredit les hypothèses, et prouve donc l’existence de .
Chaque contient en fait , car est une partie close. Et est égal à l’adhérence de l’ensemble de ses chambres car il contient une chambre. A présent, pour tout triple de chambres incluse dans , il existe contenant . Ceci prouve, en utilisant le corollaire 4.0.3 l’existence d’un appartement contenant .
Passons à présent à quelques situations particulières où s’applique ce résultat.
Définition 4.3.4
Soit un appartement et un cône inclus dans une facette de . Soit un cône de direction . On appelle base de , et on note l’intersection de et des demi-appartements contenant un voisinage de pour la topologie induite sur .
Cette définition est indépendante de l’appartement contenant choisi. De plus, comme les murs de sont répartis de manière discrète, contient un voisinage de pour la topologie induite sur . En particulier, la base de contient une base affine de , pour tout appartement contenant . Dis autrement, . Enfin, est inclus dans une facette de .
Remarque: Cette définition sera utilisée en 6 pour définir la topologie sur l’immeuble compactifié.
Proposition 4.3.5
Soit un appartement, une facette de non triviale, , on note . Soit la base de .
Soit un autre appartement contenant , et un isomorphisme fixant .
Soit une facette de incluse dans et telle qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare strictement de .
Alors pour toute chambre incluse dans , il existe un appartement contenant .
En particulier, pour tout point de , il existe un appartement contenant , et .
Remarque:
-
—
et sont indépendants du choix de .
-
—
Comme contient une base affine de , on a en fait . Cependant, pour les démonstrations de cette sous-partie, il me parait plus clair de ne pas faire cette identification, c’est-à-dire de distinguer de .
-
—
Dans la suite, on pourra noter le cône opposé à , et de manière générale si est un cône ne contenant pas de droite, .
Démonstration:
Soit une chambre de , coupant et dont l’adhérence contient .
Soit une galerie tendue entre et . Si est un appartement contenant , et un isomorphisme fixant , alors est une facette de , les seuls murs de dont la direction contient et qui séparent de contiennent ou , et enfin . On est ainsi ramené au cas où l’intersection des deux appartements considérés contient la chambre .
Soit , c’est un connexe contenant , il faut maintenant vérifier que pour tout mur de , ne coupe pas .
Soit un tel mur. Alors sépare strictement et , donc coupe . Si en plus coupe alors il coupe donc en particulier l’intérieur de . Ceci implique puis . Mais alors ou . Le premier cas est exclus car sépare strictement de . Quand au second cas, il implique , ce qui empêche que coupe .
Dans la variante suivante de ce résultat, on veut obtenir un appartement contenant . Pour cela
on peut renforcer l’hypothèse sur les murs dont la direction contient , en imposant par exemple que les seuls murs séparant de contiennent .
Cependant, nous nous contenterons de l’hypothèse , qui présente l’avantage qu’en poussant un tout petit peu le raisonnement, on arrive à trouver un appartement contenant non seulement , mais en fait . Ceci donne le résultat:
Proposition 4.3.6
Soient , , , , , comme précédemment.
Alors il existe un appartement contenant
Démonstration:
On commence, comme pour la preuve précédente, par se ramener au cas où contient une chambre. Soient et deux chambres contenant , incluses respectivement dans et . Soit une galerie entre et . En utilisant fois le corollaire 4.0.4, on trouve une suite d’appartements tels que (en notant et ) et tels que contient un demi-appartement délimité par le mur de contenant . Or ce mur contient , on vérifie alors par une simple récurrence que pour tout , contient .
Soit : cet appartement contient et une chambre de . Soit fixant , alors .
Soit une demi-droite dans passant par , dont la direction est intérieure à , et dont l’origine est dans . Elle est donc incluse dans . Soit une galerie tendue le long de , donnée par la proposition 4.2.7 telle que . Soit . Pour pouvoir appliquer la proposition 4.3.3, il nous reste à prouver que pour tout mur traversé par , ne coupe pas .
Soit un tel mur, il coupe sans la contenir, donc , d’où et ne peut couper .
Notons et les deux demi-appartements de délimités par en choisissant . Soient et les demi-appartements de correspondants, nous avons alors . Passons du côté de : nous savons que et . Donc . Ainsi, ne coupe pas .
D’après la proposition 4.3.3, il existe un appartement contenant . Alors d’où . Mais : c’est une conséquence de la proposition 4.2.6 (en fait est égal à la cheminée ). Comme , la proposition est prouvée.
4.4 Rétractions par rapport à deux chambres adjacentes
Nous étudions ici comment change une rétraction lorsqu’on remplace la chambre de base par une chambre adjacente.
Proposition 4.4.1
Soient et deux chambres adjacentes dans un appartement . Soit la cloison et le mur de contenant , la réflexion selon . Soient encore et . Alors pour toute chambre ,
-
—
ou bien .
-
—
Si est du même côté de que alors .
-
—
Si est du même côté de que alors les deux possibilités peuvent survenir, et on a si et seulement si est dans l’enclos de et .
on peut aussi énoncer un résultat un peu moins précis mais plus clair:
Corollaire 4.4.2
On reprend les hypothèses de la proposition. Alors si et seulement si il existe un appartement contenant , et .
Remarque: Le sens du corollaire est de toute façon une conséquence directe de la définition d’une rétraction.
Démonstration:
Soit un appartement contenant et , soit l’isomorphisme fixant . Alors .
Si est du même côté de que alors est du même côté de que . En vertu du corollaire 4.0.4, il existe un appartement contenant , et , ce qui prouve que .
Dans l’autre situation, appelons la chambre adjacente à le long de dans . Cette chambre est donc dans l’enclos de et de . Si alors , et sont dans un même appartement, d’où et est bien dans l’enclos de et de . Il ne reste donc qu’à vérifier que si alors et n’est pas dans l’enclos de et . Le deuxième point est prouvé car nous disposons d’un appartement, qui contient et , mais pas sans quoi il y aurait trois chambres contenant dans .
Pour prouver le premier point, constatons que la formule est vraie lorsque . Soit le demi appartement délimité par et contenant , donc également . Par le corollaire 4.0.4, il existe un autre appartement contenant et . Si est l’isomorphisme correspondant, alors et l’égalité devient . Restreignons et à : nous obtenons deux morphismes de complexe de chambre injectifs de dans , qui coïncident en . Comme est convexe, ceci entraîne que et coïncident sur .
4.5 Inclusion de deux galeries tendues dans un appartement
4.5.1 Le théorème
Définition 4.5.1
Soit une galerie. Une sous-galerie de est une galerie obtenue en enlevant un nombre fini de chambres à . Dans le cas où et où est tendue, une sous-galerie de est donc de la forme pour un .
Théorème 4.5.2
Soient et deux galerie tendues. Alors il existe une sous-galerie de et une sous-galerie de qui sont incluses dans un même appartement.
Démonstration:
Notations:
Soit un appartement contenant . Pour , soit , le mur de entre et , la réflexion selon , de sorte que pour tout et pour toute chambre de , on a en vertu de la proposition 4.4.1 ou . Remarquons que par continuité de , la même formule s’applique pour le calcul de pour deux chambres adjacentes, sauf dans le cas où ces deux chambres sont projetées par sur des chambre adjacentes à .
Choisissons un point spécial pour identifier et . Quitte à réduire , cette galerie est incluse dans une chambre vectorielle . Grâce à la proposition 4.3.1, on voit que, quitte à la réduire, la rétraction d’une galerie tendue est une galerie tendue. En particulier, est incluse à translation près dans une chambre vectorielle. Choisissons une chambre vectorielle à distance maximale de contenant un translaté de . Notons enfin la distance entre la chambre et . Comme le complexe de Coxeter vectoriel est fini, les sont majorées par une certaine constante .
plan de la preuve:
Pendant cette démonstration, nous allons étudier en quoi peut différer de . Nous verrons qu’il y a trois cas à distinguer: soit et coïncident sur presque toutes les chambres de , soit elles diffèrent sur un nombre infini de ces chambres et , soit elles diffèrent sur un nombre infini de ces chambres et . Nous allons commencer par traiter le cas où seul le premier cas intervient (préliminaire 1). Ensuite, nous allons vérifier que les trois cas cités sont effectivement les seuls possibles, nous en profiterons pour analyser un peu plus en détail le deuxième cas (préliminaire 2). Alors nous verrons qu’on peut réduire pour se ramener à une situation où le deuxième cas n’apparaît pas, puis qu’on peut la réduire une seconde fois pour que le troisième cas n’apparaisse plus non plus.
Préliminaire 0: le cas très facile:
Supposons que pour tout et pour toute chambre de , . Cela implique par le corollaire 4.4.2 que , et sont inclus dans un même appartement pour tout et . Par ailleurs, quitte à réduire , on peut supposer que est incluse dans un appartement contenant aussi . L’égalité des -distances est alors réalisée dans le cas où , avec , et dans le cas où , avec et (et bien sûr aussi dans le cas ou ). Le cas , et , s’obtient aisément par récurrence sur . Le dernier cas est avec , il se traite à partir des cas précédents: .
Il ne reste plus qu’à appliquer le théorème 4.0.2: et sont incluses dans un même appartement.
Préliminaire 1: le cas facile:
Supposons que pour tout , pour toutes les chambres de sauf un nombre fini (ce nombre pouvant a priori varier avec ). Nous allons construire par récurrence une sous-galerie de de sorte que et soient dans la situation très facile du préliminaire 0. Plus précisément, nous allons construire pour tout une sous-galerie de telle que , , . Pour des raisons techniques, nous allons imposer en outre que est une galerie tendue. Ensuite, nous vérifierons que la suite est stationnaire à partir d’un certain rang, alors la ”limite” de cette suite conviendra.
Commençons par choisir pour une sous galerie de telle que est tendue. Supposons ensuite construite , et construisons . Supposons qu’il existe tel que . Par la proposition 4.4.1, est dans le demi-appartement . Comme par hypothèse seul un nombre fini de chambres de vérifient , il existe tel que . Nous pouvons choisir et adjacentes, c’est à dire . Alors est une galerie de longueur 2 dans , donc . Mais donc est impair. En effet induit une involution sur l’ensemble des murs séparant et , et cette involution n’a qu’un point fixe, , car un mur stabilisé par ne peut séparer un point et son image par . Il y a donc un nombre impair de murs séparant et .
Ainsi , les deux chambres et sont de part et d’autre de , et . Comme est tendue, elle ne peut couper une autre fois: et sont donc les seuls indices adjacents tels que et . Nous en déduisons que la première formule est vraie pour tous les indices inférieurs à , et la seconde pour tous les indices supérieurs à (en particulier, ). Nous avons donc une description précise de la situation: une partie finie de est dans le demi-appartement , et c’est précisément cette partie qui va être déplacée lors du passage à . On pose , et cela conclut la construction de la suite .
Il reste à vérifier qu’au cours de cette construction, il n’y a qu’un nombre fini d’étapes où on a réellement retiré des chambres à pour obtenir . Soit l’ensemble des indices tel que est différent de . Nous allons montrer qu’il ne peut y avoir deux indices et dans tels que , ce qui prouvera que est fini puisque l’ensemble des murs vectoriels est fini. Supposons par l’absurde l’existence de tels et , avec . Lors de la construction de , on a fait en sorte que soit inclus dans . Comme est tendue et , . D’après la construction, la galerie est une sous galerie de , elle est donc incluse dans . Mais cela implique alors que et cela contredit le fait que . Ce qui prouve le cas facile.
Préliminaire 2: que se passe-t-il lorsque pour un nombre infini de chambres de ?
Il s’agit à présent d’étudier ce qui se passe lorsque pour un nombre infini de chambres de , c’est à dire pour toutes les chambres de à partir d’un certain rang, puisque est tendue à partir d’un certain rang. Supposons que (c’est le seul cas qu’il est utile d’étudier, comme nous allons le voir).
Tout d’abord, est à partir d’un certain rang dans le demi appartement .
Par ailleurs, est alors à translation près dans la chambre , donc . Cela signifie que sépare et . Mais est un translaté de dans la direction de . (Pour résumer les placements des différentes parties étudiées par rapport aux deux murs et , je note: , où symbolise le mur .) Le point qui nous intéresse est celui-ci: un translaté de est dans donc dans et un autre translaté est dans donc dans . Cela implique que reste à distance bornée de , au sens où il existe un majorant à la distance entre une chambre de et .
Alors est un majorant de la distance entre et pour les chambres . Ceci implique que est incluse à translation près dans la même chambre vectorielle que , c’est-à-dire dans . Mais comme , on trouve que et on peut choisir .
le coeur de la démonstration:
Lorsque pour presque toutes les chambres de , il est clair que , et qu’on peut choisir . Lorsque pour un nombre infini de ces chambres, nous venons de voir que implique que et qu’on peut encore supposer .
Donc la fonction est croissante. Comme elle est bornée par , elle est constante à partir d’un certain rang. Quitte à raccourcir , on peut la supposer constante. Nous sommes alors pour tout soit dans le cas étudié dans le préliminaire 2, soit dans le cas pour presque toutes les chambres de . En particulier on peut supposer que pour tout , . Il s’agit bien sûr de se ramener à présent au cas du préliminaire 1.
Soit la facette vectorielle égale à l’intersection de tous les murs vectoriels à distance bornée desquels reste . Soit l’ensemble des murs vectoriels contenant , soit . Nous allons montrer que pour tout , est égal à l’ensemble des murs à distance bornée desquels reste .
Commençons par . Soient les murs à distance bornée desquels reste , il s’agit en fait de vérifier que . Soient des formes linéaires tels que . Soit un mur dans . Alors est combinaison linéaire des . Mais chaque est bornée sur , donc est également bornée sur , c’est à dire que reste à distance bornée de .
Supposons à présent le résultat vrai au rang . Si et ne diffèrent que sur un nombre fini de chambres de , le résultat reste évidemment vrai au rang . Sinon, nous sommes dans le cas étudié dans le préliminaire 2. Donc reste à distance bornée de , et par hypothèse de récurrence, , et . L’ensemble des murs à distance bornée de est donc , mais ceci vaut puisque fixe .
On utilise maintenant la compactification de définie par facettes vectorielles de Weyl (c’est à dire la compactification polygonale classique). Soit la projection de sur l’espace affine . On prend comme origine dans pour l’identifier à son espace vectoriel directeur. L’ensemble s’identifie (via ) à l’ensemble des murs vectoriel de , est le groupe de Coxeter vectoriel. L’ensemble des murs affines de est mur affine de et , et si on notera encore au lieu de . Enfin, si vérifie alors agit sur en préservant les murs, notons l’automorphisme affine induit par sur . (Attention: la fonction n’est pas injective et n’est pas forcement dans le groupe de Coxeter de .)
Chaque galerie est tendue à partir d’un certain rang, et reste à distance bornée des murs de , elle ne coupe donc qu’un nombre fini de murs parallèles à un mur de . Donc à partir d’un certain rang, sa projection sur reste dans une unique chambre de , notons cette chambre .
Les chambres vectorielles et sont également projetées dans des chambres vectorielles de (de manière pas nécessairement surjective a priori), qu’on notera encore et pour simplifier. Nous avons vu lors du préliminaire 2 que sépare et , si pour un nombre infini de chambres de . Comme , est un mur de , et la relation ” sépare et ” est encore vraie dans . On a de plus dans ce cas que . Mais est un translaté de dans la direction de , donc sépare et . Ceci entraîne que est strictement plus proche de que , au sens où pour toute chambre incluse dans , .
Et s’il existe tel que , alors la suite des est constante pour . Car si , il n’est plus possible que sépare de , donc plus possible que .
Nous avons donc prouvé que la suite est finalement stationnaire. Nous pouvons raccourcir de sorte qu’elle soit complètement stationnaire. Cela implique que pour tout , seulement pour un nombre fini de chambres de . Mais c’est précisément le cas, facile, du préliminaire 1: la preuve est faite.
4.5.2 Conséquences
Nous voici en mesure d’énoncer les résultats les plus forts de cette partie. Nous allons voir par exemple qu’étant donnés deux cônes affines et , il existe un appartement contenant non seulement des sous-cônes parallèles de et , mais encore un ”épaississement” de ces sous-cônes parallèles. Précisément, contiendra des cheminées de direction et , contenant des scp de et et dont les bases sont des chambres (4.5.4).
Pour commencer, le théorème permet de prouver que deux demi-droites peuvent être réduites pour être incluses dans un même appartement:
Proposition 4.5.3
Soient et deux demi-droites. Alors il existe et deux demi-droites incluses respectivement dans et et un appartement tel que . Dès lors, contient .
Ceci permet de traduire le théorème en terme de cheminées:
Proposition 4.5.4
Soient et deux cheminées, dans les appartement respectifs et . Alors il existe et deux sous cheminées pleines qui sont incluses dans un même appartement.
Démonstration:
Soient et des demi-droites caractéristiques de et . Soit contenant une demi-droite incluse dans et une demi-droite incluse dans . Alors contient qui est une scp de et qui est une scp de .
Le même procédé permet quelques variations:
Proposition 4.5.5
-
1.
Soit une cheminée et une chambre, alors il existe un appartement contenant et une scp de
-
2.
Soient deux cônes et où et sont inclus dans des facettes de Weyl. Alors il existe un appartement contenant des sous-cônes parallèles et de et .
-
3.
Soit comme au point précédent, et soit une chambre, alors il existe un appartement contenant et un scp de .
Démonstration:
-
1.
Soit une demi-droite caractéristique de , une galerie tendue la contenant dans son adhérence. D’après 4.3.2, il existe contenant et une sous-galerie de , alors contient et une scp de .
-
2.
Soit et avec et . Soit et , des sous-demi-droites de et tels que . Alors . Mais nous savons que où est la facette affine contenant le sommet de et est la facette vectorielle contenant la direction de , c’est-à-dire . Alors . De plus, contient le sommet de , qui est un point de . Donc au final, contient un scp de . De même, contient un scp de .
-
3.
Ce point est semblable aux précédents.
Faisons tout de suite le lien avec les coeurs de cônes affines:
Corollaire 4.5.6
Soient et deux cônes affines. Alors il existe un appartement contenant un scp de et un scp de .
Ceci provient du fait que et sont des cheminées.
Remarque: Tout ceci généralise le fait bien connu que deux quartiers contiennent des sous-quartiers inclus dans un même appartement ([Ron89] proposition 9.5 page 121).
4.6 Systèmes d’appartements
Rappelons que selon les conventions adoptées ici, un immeuble est muni par définition d’un système d’appartements, de sorte que rigoureusement, l’immeuble étudié devrait être dénoté par , n’étant que l’ensemble sous-jacent. Si la définition des facettes est indépendante du système d’appartements choisis, celle des quartiers et autres cônes lui est au contraire très liée.
Jusqu’ici, nous avons toujours supposé que était le système complet d’appartements, mais il peut être intéressant de noter que les résultats précédents sont encore vrais pour d’autres systèmes d’appartements (la construction d’un compactifié de ne sera cependant possible qu’en munissant de son système complet d’appartements). Nous allons étudier ici le cas d’un système d’appartements qui permet la définition d’un immeuble sphérique à l’infini , c’est-à-dire que deux quartiers de contiennent toujours des sous-quartiers contenus dans un même appartement de . Un tel système d’appartements pourra être qualifié de ”cohérent” ou ”double” car c’est le type de système d’appartement qui provient d’un système de Tits double selon la terminologie de [BT72] 5.1.3.
Fixons avant tout un peu de formalisme ( est toujours le système complet d’appartements):
Définition 4.6.1
Un système d’appartements pour est un sous-ensemble de tel que deux chambres de sont toujours incluses dans un élément de .
La proposition suivante est alors immédiatement vérifiée:
Proposition 4.6.2
-
—
Si est un système d’appartements pour , alors est un immeuble.
-
—
Soit et une partie bornée de . Alors il existe contenant .
Définition 4.6.3
Un système d’appartements pour est dit double, ou cohérent, si pour tous quartiers et de , il existe des sous-quartiers et ainsi qu’un appartement tels que .
D’après la proposition 4.5.5, le système complet d’appartements est double.
Pour tout système double d’appartements, on peut définir l’immeuble sphérique à l’infini , voir [Wei09].
On fixe à présent un système double d’appartements. La proposition suivante est la proposition 10.28 de [Wei09] (où un système d’appartements est par définition double, et où un système ”plein” est un système où la conclusion de la proposition suivante est vraie), elle affirme que le deuxième point du corollaire 4.0.4 est encore vrai dans :
Proposition 4.6.4
Soit un demi-appartement de , et une chambre ayant une cloison dans , alors il existe tel que .
Voici les grandes lignes de la démonstration:
Soit la cloison de incluse dans , on peut supposer que contient un sommet spécial . Alors l’immeuble à l’infini est isomorphe à l’ensemble des facettes de quartier de sommet , et l’application est un morphisme surjectif.
Soit contenant , soient et les chambres de contenant , avec , . Soit la chambre opposée à dans .
Soient , , les quartiers inclus dans , de sommet , contenant , et respectivement, ces quartiers définissent des chambres à l’infini , et . L’intersection de et est la cloison de correspondant au cône inclus dans , de sommet et contenant .
Nous voulons à présent montrer qu’il existe une chambre telle que . Ceci provient de [Wei09] 29.53, on reproduit ici l’argument.
Soit contenant et , soit l’opposée de dans , donc il existe une galerie minimale de à passant par , de longueur égale au diamètre de et de . Soit telle que . Comme est un morphisme de complexes de chambres, on a , mais comme est déjà maximale, on a en fait égalité. Donc et sont opposées, et il existe une galerie reliant à de même type que . Cette galerie est alors envoyée par sur , par conséquent on peut choisir pour sa deuxième chambre.
Ensuite, il existe tel que l’appartement à l’infini contient et , donc contient des scp de et . Comme ces quartiers sont opposés en , contient en fait et donc en particulier . D’autre part, contient toute galerie tendue de à , et il en existe une qui passe par . Donc contient un scp de , mais comme contient le sommet de , on obtient . Alors par clôture de , .
Corollaire 4.6.5
Le résultat de 4.3.1 est encore vrai pour un immeuble muni d’un système double d’appartements.
Les corollaires de la proposition 4.3.1 sont eux aussi encore vrais pour un système double d’appartements, si on part d’une galerie tendue ou d’une facette de quartier déjà incluse dans un appartement de :
Corollaire 4.6.6
-
—
Soit une galerie tendue incluse dans un appartement de et une chambre, alors il existe contenant et une sous-galerie de .
-
—
Soit une facette de quartier dans un appartement de et une chambre, alors il existe contenant et un scp de .
La proposition 4.5.4 reste elle aussi vraie dans un système double d’appartements:
Proposition 4.6.7
Soient et deux cheminées de , alors il existe contenant des sous-cheminées pleines de et .
Démonstration:
Soient des appartements contenant et , respectivement.
Quitte à raccourcir et , il existe un appartement dans le système complet d’appartements tel que . Par le lemme 4.2.4, on peut supposer que et ont pour bases des chambres, disons et . Soient et des droites caractéristiques pour et ; le fait de supposer que les bases de ces cheminées sont des chambres entraîne que contient un voisinage de , pour . En particulier, contient un ouvert, ce qui fournit un isomorphisme canonique entre et .
Notons , pour et .
Quitte à déplacer à l’intérieur de , on peut supposer que pour assez grand, est dans une chambre de . En raccourcissant et , on peut supposer que c’est le cas pour tout .
Soit la chambre correspondant à dans . Alors et sont deux quartiers de , et il existe contenant des sous-quartiers et . Montrons que contient .
Soit . Il existe tels que et . On peut donc prolonger de manière unique le segment en un ensemble , dans l’appartement d’un côté et dans de l’autre, de sorte que et soient des demi-droites. Comme et , on voit que et sont deux demi-droites (non vides).
Montrons que est une droite. On note et , donc est un segment non trivial. Soit , on commence par montrer que est une géodésique.
Soit une chambre de telle que contient un segment non trivial de , et soit la rétraction . Alors est une demi-droite dans .
Soient , notons (resp. ) la longueur de la partie de entre et (resp. de entre et ). Alors, en utilisant successivement que est une demi-droite, que induit une isométrie sur et sur et que diminue les distances: . Par conséquent, pour tous . Comme en est une, ceci prouve que est une géodésique, grâce à l’égalité .
Ainsi, et sont des géodésiques. Soit une chambre de telle que contient un segment non trivial de , alors est une droite de . Le même raisonnement que précédemment prouve maintenant que est une géodésique, donc une droite.
Comme contient deux demi-droites opposées de , il contient , donc en particulier . Donc , d’où .
Corollaire 4.6.8
-
—
Soit une cheminée de , et une chambre, alors il existe contenant et une scp de .
-
—
Soient et deux cônes de direction incluse dans une facette de Weyl, alors il existe contenant un scp de et un scp de .
-
—
Soient et deux galeries, chacune incluse dans un appartement de . Alors il existe contenant des sous-galeries de et .
Démonstration: Les deux premiers points forment l’analogue de 4.5.5, ils sont clairs. Le troisième point est l’analogue de 4.5.2 à ceci près qu’il faut bien supposer et incluse à priori dans des appartements de . Pour le prouver, il suffit de montrer le lemme suivant:
Lemme 4.6.9
Soit une galerie tendue infinie dans un appartement . Alors il existe une cheminée contenant une sous-galerie de et telle que toute scp de contient une sous-galerie de .
Preuve du lemme:
Pour toute racine vectorielle , une et une seule des trois possibilités suivantes est vérifiée (les racines sont vues ici comme des demi-appartements):
-
1.
Il existe une racine de direction contenant une sous-galerie de , et toute racine de direction ne contient qu’une nombre fini de chambres de .
-
2.
Il existe une racine de direction contenant une sous-galerie de , et toute racine de direction ne contient qu’une nombre fini de chambres de .
-
3.
Il existe une racine de direction telle que et contiennent des sous-galeries de . Une telle racine est alors unique.
Soit l’ensemble des racines affines obtenues dans le cas , soit le premier indice tel que . Pour chaque racine vectorielle dans le cas , soit la plus petite racine contenant , soit l’ensemble de ces racines. Soit la facette vectorielle . Alors la cheminée convient.
4.7 Parallélisme
La notion de cheminée permet, grâce à la proposition 4.5.4, d’étendre la notion de parallélisme à des cônes qui ne sont pas forcément dans le même appartement:
Définition 4.7.1
Soient et deux cônes chacun inclus dans une facette de quartier, de sorte qu’il existe un appartement contenant des scp et de et . On dit que et sont parallèles lorsque est parallèle à dans cet appartement.
On vérifie facilement que la définition est indépendante des scp et de l’appartement choisi: si et sont parallèles, alors dès que deux scp et sont inclus dans un même appartement , est un translaté de .
Nous savons qu’il existe toujours un appartement contenant des scp de et lorsque et sont (inclus dans) des facettes de quartiers. Lorsque , on peut encore améliorer ce résultat: il existe un appartement contenant un des deux cônes en entier. On peut même remplacer un des deux cônes par une cheminée.
Proposition 4.7.2
Soient deux facettes de quartier parallèles, et où est une chambre contenant dans son adhérence (donc ). Alors il existe un appartement contenant et un scp de .
Démonstration:
Soit un appartement contenant une scp de et un scp de . Soit un scp de inclus dans . Comme , et que est un cône d’intérieur non vide, doit couper . Soit . Soit une chambre vectorielle, contenant dans son adhérence et telle que . Alors . Or, par la proposition 4.3.5, il existe un appartement contenant , donc en particulier, est un scp de inclus dans . Si est un appartement contenant , la clôture de implique que est également incluse dans .
Remarque: Si et ne vérifient pas mais seulement , alors le résultat de la proposition est encore vrai.
Proposition 4.7.3
Le parallélisme est une relation d’équivalence.
Démonstration:
Il est évident que le parallélisme est une relation réflexive et symétrique, montrons la transitivité. Soit et trois cônes inclus dans des facettes de quartiers. On peut supposer et inclus dans un appartement , et inclus dans un appartement contenant un scp de . Montrons que . On remarque que puisque le parallélisme à l’intérieur d’un appartement fixé est une relation d’équivalence, s’il existe un appartement contenant un scp de chacun des trois cônes , et alors le résultat est vrai.
Soit le sommet de et celui de . Soit une galerie minimale entre une chambre de contenant dans son adhérence et une chambre de contenant dans son adhérence. On raisonne par récurrence sur la longueur de .
Si , alors et sont dans une même chambre fermée . Alors . Mais la clôture de ceci dans contient , d’où . Alors contient , et , et dans , est translaté de et est translaté de . Ceci implique que .
Supposons . Soit et le cône de parallèle à (et donc à ) de sommet . Soit contenant et un scp de . Alors , d’où par convexité, . Alors la galerie est de longueur , elle part d’une chambre de contenant le sommet de , et , nous pouvons utiliser l’hypothèse de récurrence pour obtenir que . Enfin, si est la cheminée dans , il existe , avec un scp de (proposition 4.7.2). Par convexité de , . Et par transitivité du parallélisme à l’intérieur de , .
5 Construction de
On procède de la même manière que pour la construction de : l’ensemble sera un ensemble de cônes quotienté par la relation d’équivalence signifiant que deux cônes ont une intersection de dimension maximale. Ensuite ces cônes, légèrement élargis, fourniront une base de voisinage de la topologie.
5.1 Préliminaires
Voici regroupés quelques résultats techniques qui serviront plusieurs fois dans la suite.
Lemme 5.1.1
Soient , soient et deux isomorphismes qui coïncident sur une facette . Alors il existe qui fixe et tel que , .
Preuve du lemme:
Soit fixant . Alors pour tout , on a . On pose : fixe bien , donc convient.
Proposition 5.1.2
Soient , , un cône inclus dans une facette de Weyl, et une partie d’une facette de . On suppose que est incluse dans , contient une base affine de et que .
On considère un point inclus dans un appartement tel que . On suppose que est envoyé par un isomorphisme fixant dans une partie de de la forme , où est convexe et incluse dans . On suppose également que et est stable par le fixateur de dans , qu’on note .
Si est une autre partie incluse dans une facette, telle que , et , si est un appartement contenant et et si est un isomorphisme fixant , alors .
Remarque: Par continuité, on obtient directement que si vérifie , alors .
Dans le cas où et sont des chambres (c’est le cas essentiel comme on va le voir dès le début de la preuve), cette proposition s’exprime beaucoup plus clairement:
Corollaire 5.1.3
Soient , et comme dans la proposition. Soit une chambre de telle que et une autre chambre telle que . Soit un point de tel que alors .
Démonstration de la proposition
Soit une galerie tendue de à , notons la rétraction sur centrée en . Comme contient une base de , est stable par . On déduit alors du lemme précédent que , et que le résultat sera prouvé si nous prouvons que . Montrons par récurrence que pour tout , , le cas est déjà vu.
Soit , supposons . Soit le mur de contenant . Si sépare, pas forcément strictement, et , alors on est dans la disposition: . Alors la proposition 4.4.1 affirme que .
Dans l’autre cas, on a , et . Notons la réflexion selon , les deux possibilités ou sont alors possibles. Dans le premier cas, on a évidemment , étudions le second cas. On note , donc .
Soit tel que . Comme est un mur d’une galerie minimale entre et , il ne peut contenir , donc il existe tel que , on peut supposer . Par ailleurs, avec ce choix de signe pour , on a . Mais et . Ceci entraîne que coupe , et donc que . En particulier, et donc .
Soit l’unique point de l’intersection (le cas où est trivial, on a alors ). Par convexité de et comme , . Nous savons que , et donc que . Ensuite pour le scalaire adéquat. C’est alors une simple application du théorème de Thalès que de vérifier que , d’où par convexité.
Lemme 5.1.4
Soit un appartement, avec un scp de . Alors coupe le coeur , et donc il existe un scp de dont le coeur est un scp de .
Preuve du lemme:
Soit et les sommets des deux cônes. Soit le stabilisateur de dans le groupe de Weyl de . On définit une action de sur en imposant que est un point fixe. Alors . Soit . Le point est bien . Comme , il est dans , et l’écriture prouve qu’il est aussi dans . donc , ce qui prouve le lemme.
5.2 Cônes dans l’immeuble
Définition 5.2.1
Soit un appartement, et . Le cône de correspondant au cône de est :
où est un isomorphisme quelconque de sur fixant .
On note l’ensemble de tous ces cônes pour tous les choix de et de possibles.
Le choix de dans la définition n’importe pas puisque deux choix diffèrent d’un automorphisme de fixant donc stabilisant .
Il est clair que si et sont des cônes tels que , alors : le coeur du cône affine suffit à déterminer le cône de l’immeuble. Dit autrement, si contient , alors où est le cône de de coeur . Nous verrons plus tard que réciproquement, un cône d’immeuble définit un unique coeur de cône affine.
Lemme 5.2.2
Soit , avec . Soit un appartement contenant , et un isomorphisme fixant . Alors .
Preuve du lemme:
L’inclusion est vraie par définition de . Montrons .
Soit . Par définition, il existe un appartement contenant et et tout isomorphisme de sur fixant envoie dans . Soit un isomorphisme fixant et . Alors est un isomorphisme fixant . Donc , donc .
Lemme 5.2.3
Soient tels que est un scp de . Alors .
Preuve du lemme:
Remarquons que pour montrer qu’un point appartient à , il suffit de trouver un appartement contenant .
Soit le sommet de et celui de . Il n’y a qu’un nombre fini de murs parallèles à séparant strictement et , soit ce nombre. On raisonne par récurrence sur .
Si , soit , et un appartement contenant . Comme , le lemme précédent indique que , en particulier, . Dès lors, on peut trouver une chambre de telle que et la proposition 4.3.5 prouve qu’il existe contenant . Par convexité et fermeture de , contient aussi (car dans ). On conclut que .
Si , soit un mur parallèle à séparant strictement et . Soit , alors est scp de , et est scp de . De plus, le nombre de murs parallèles à séparant strictement et est strictement inférieur à , de même que le nombre de murs parallèles à séparant strictement et . Donc par hypothèse de récurrence, et , d’où le résultat.
Remarque: Il n’est pas vrai que si sans que .
5.3 Coeur d’un cône d’immeuble
Lemme 5.3.1
Soit , et un scp de . Soit un appartement contenant , soit un isomorphisme fixant . Soit , alors . Plus précisément, si contient et , alors il existe un isomorphisme de sur , fixant et envoyant sur .
Preuve du lemme:
Soit . Soit un isomorphisme fixant l’intersection . Alors est un isomorphisme de sur qui vérifie . Il suffit donc de prouver que fixe pour prouver le lemme. Mais fixe , donc fixe . Donc fixe , ce qui contient .
Proposition 5.3.2
Si et sont deux cônes tels que , alors .
Démonstration:
D’après la proposition 4.5.4, il existe un appartement contenant des scp et de et . Soient les cônes engendrés par et . Nous allons commencer par montrer que .
Supposons par l’absurde que ce n’est pas le cas, donc . Il est alors impossible que et , d’après les hypothèses mises sur . on peut donc supposer qu’il existe .
Soit le sommet de , celui de . Soit un isomorphisme fixant , alors est le cône de engendré par , c’est donc un scp de . Par le lemme 5.2.3, , mais , d’où .
De la même manière, soit un isomorphisme fixant . Alors est un scp de , et on obtient que .
Nous déduisons en particulier que , . Et comme est un scp de , . Pour tout réel , . Comme , on a . Donc pour lambda assez grand, .
Comme , il existe un appartement contenant . Soit un isomorphisme fixant , en particulier fixe et . Alors est un isomorphisme qui fixe , et donc , ce qui contient . Nous savons dans cette situation que , d’où , mais , d’où la contradiction.
Nous avons donc prouvé que , nous allons maintenant montrer que les sommets et de et coïncident. En utilisant la proposition 4.7.2, on peut supposer que contient en entier, donc , on peut même supposer que . On peut également supposer que contient un scp de . En résumé, contient un scp de et un scp de , et ces deux scp sont parallèles. L’égalité a donc un sens (et est vraie), dans .
Soit un isomorphisme fixant . D’après le lemme précédent, et . La seconde égalité implique . Or est un cône vectoriel de coeur , puisque fixe et . Donc , et .
Nous arrivons ainsi aux deux relations: et . Par unicité du sommet de , ceci implique . On utilise enfin la version précise du lemme précédent: soit un appartement contenant et , il existe un isomorphisme fixant et tel que . Mais puisque , d’où .
En particulier, , et par convexité de , et , et enfin on peut calculer, dans ou dans : .
Cette proposition permet les définitions suivantes:
Définitions 5.3.3
-
—
Le coeur d’un cône de l’immeuble est . On le note .
-
—
On appelle sommet de le sommet de , on le note .
-
—
Deux cônes sont dit parallèles lorsque , ceci définit une relation d’équivalence sur .
-
—
Si sont deux cônes parallèles avec , on dit que est un sous-cône parallèle de , et on abrège sous-cône parallèle en scp. Ceci définit une relation d’ordre sur .
Lemme 5.3.4
Soient tels que est scp de . Alors il existe un appartement contenant .
Preuve du lemme:
Nous savons déjà qu’il existe (proposition 4.7.2) un appartement contenant et un scp de . Il existe aussi contenant , ceci car . Alors , d’où par convexité, , et donc .
5.4 Équivalence de cônes, l’ensemble
Nous définissons maintenant une relation d’équivalence sur l’ensemble des cônes de l’immeuble d’une manière tout à fait semblable à la définition de la relation d’équivalence sur l’ensemble des cônes affines de .
Définition 5.4.1
Deux cônes sont équivalents lorsqu’il existe qui est un scp de et de . On note alors .
Le lemme 5.2.3 montre que si alors .
Lemme 5.4.2
Soient , alors si et seulement si et .
Preuve du lemme:
Si , il est clair que et que (car ).
Supposons maintenant que et que . Soit , soit et des appartements tels que et . Nous pouvons alors construire deux cônes: et . Ces deux cônes sont parallèles, donc il existe contenant et un sous-cône parallèle de . Par convexité de , on voit qu’en fait . Donc et sont deux cônes parallèles, inclus dans et de même sommet: . Soit tel que . Il est à peu près clair que , mais je détaille quand même le raisonnement:
Soit tel que . Alors , puis . Soit tel que , alors et . Comme , on conclut par le lemme 5.2.3 que . On procède de même pour prouver que .
Proposition 5.4.3
La relation ”être équivalent” est une relation d’équivalence sur .
Démonstration:
Cette relation est symétrique et réflexive, montrons qu’elle est transitive. Soient tels que et . Soit un scp de et , et un scp de et . Il nous suffit de trouver un cône qui soit un scp de et de . Et comme nous savons déjà que , grâce au lemme précédent, il suffit de prouver que .
Quitte à remplacer par un scp, il existe un appartement contenant . Le lemme 5.1.4 appliqué à et dans l’appartement prouve l’existence d’un scp de dont le coeur est un scp de . De même, il existe un scp de dont le coeur est aussi inclus dans .
Ainsi et sont deux scp du même cône , leur intersection contient donc un troisième scp de (il suffit de vérifier que ). Si est le cône de correspondant à ce coeur, alors est un scp de donc de donc de , ainsi que de donc de donc de . Ce qui prouve que .
Nous pouvons enfin définir l’ensemble :
Définition 5.4.4
On pose . Si , on note la classe d’équivalence de pour .
Notons enfin ce petit résultat:
Lemme 5.4.5
Soit , et . Soit tel que . Alors il existe un scp de tel que est un scp de .
5.5 Injections canoniques
Définitions 5.5.1
-
—
Soit : . C’est l’injection canonique de dans .
-
—
Pour tout appartement , soit : . C’est l’injection canonique de dans .
Quelques mots pour s’assurer que ces définitions sont licites:
-
—
Pour , il faut vérifier que , . C’est le cas car si est dans l’appartement , alors , et .
-
—
Nous avons déjà vu que si alors ce qui montre que est bien définie.
Proposition 5.5.2
Les injections canoniques sont injectives.
Démonstration:
Il est clair que est injective. Soit , pour montrer que est injective, on considère deux cônes tels que . C’est à dire que . Donc il existe qui est scp de et . Par le lemme 5.3.4, il existe contenant . En utilisant le lemme 5.1.4 dans , on obtient un nouveau cône qui est scp de et dont le coeur est inclus dans , donc dans . Alors notant , on voit que est scp dans de et , et donc .
6 Topologie sur
6.1 Définition
Définition 6.1.1
Soit , soit contenant . On note et on appelle base de la base de . De même, si , on notera la base de .
La définition de la base d’un cône dont la direction est dans une facette vectorielle est donnée en 4.3.4.
Maintenant, nous avons besoin d’un moyen de définir un voisinage de dans les espaces directeurs de tous les appartements à la fois. Nous avons déjà défini comme étant l’ensemble des voisinages de dans , où est l’appartement de référence choisi au début, stables par le groupe de Weyl de , . Alors si , si est un isomorphisme quelconque, l’image est indépendante de l’isomorphisme choisi. Nous pouvons ainsi identifier à un voisinage de dans l’espace directeur de n’importe quel appartement. Et si est un isomorphisme, nous pouvons écrire , .
Définition 6.1.2
Soit , tel que , , et , stable par . On pose
L’union est prise sur tous les appartements qui contiennent , et est un isomorphisme qui fixe .
Remarque: Il aurait pu paraître plus naturel de prendre l’union des , mais le fait de prendre l’intersection avec permettra d’utiliser la proposition 4.3.5.
Le sous groupe de qui fixe fixe aussi , puisque contient une base affine de , et donc il stabilise , et sa partie vectorielle est un sous-groupe de et donc stabilise . Ceci permet de vérifier que le choix de n’importe pas.
Si est un autre appartement contenant , et si alors . Ceci permet la définition:
.
Lemme 6.1.3
On garde les notations précédente. Si est un appartement contenant , et si est un isomorphisme qui fixe , alors . En particulier, .
Preuve du lemme: Si , alors il existe un appartement contenant et un isomorphisme fixant tel que . On choisit alors fixant , comme fixe , on a . D’où .
On peut maintenant définir les ensembles qui seront la base de voisinage de la topologie sur :
Définition 6.1.4
Soit , et . On pose
Lorsqu’il n’y a pas de risque de confondre avec un voisinage d’un point dans un appartement compactifié, on pourra juste noter .
Pour , on note .
Lemme 6.1.5
Soient et alors:
-
—
-
—
si , alors
-
—
si , alors
-
—
si est scp de , alors .
Preuve du lemme:
Les trois premiers points sont évidents.
Pour le quatrième point, on choisit un appartement contenant et (lemme 5.3.4). On note le cône engendré par dans , et le cône engendré par , donc est un scp de . Il ne reste plus qu’à appliquer la même méthode que celle utilisée dans cette situation pour prouver que (en 5.2.3).
On commence par supposer qu’aucun mur de , parallèle à ne sépare strictement et . Soit , il existe et fixant , tel que . En particulier, . D’après la proposition 4.3.5, il existe un appartement contenant . Soit fixant , donc en particulier . Comme , , donc .
S’il existe un mur parallèle à et séparant strictement et , soit . Par récurrence, on a et .
Proposition 6.1.6
Il existe une unique topologie sur telle que pour tout , soit une base de voisinages de .
Démonstration:
Il faut montrer pour tout , que , que , , et que , , tel que . Les deux premières assertions sont claires.
Soit donc et . Soient et tels que et .
Comme , il existe qui est scp de et de . Soit , on a bien . Alors, et d’après le lemme, .
Notons tout de suite ce résultat évident, mais important:
Proposition 6.1.7
Soit . Alors se prolonge en un homéomorphisme de , en posant .
6.2 Lien avec la topologie de
Nous allons maintenant faire le lien entre les voisinages du type dans l’immeuble et les dans un appartement. La seule petite difficulté provient du fait que dans la définition de on fait intervenir et non juste comme dans les .
Définition 6.2.1
Soit , et , on note
Proposition 6.2.2
Soit . Alors l’ensemble des , pour et est une base de voisinage de la topologie sur
Démonstration: Déjà, quels que soient et , on a . Il reste à vérifier que est un voisinage de .
Soit borné et inclus dans . Comme est un cône d’intérieur non vide, il existe tel que . Alors donc , et donc est bien un voisinage de .
Étant donnés un cône et un appartement contenant , il existe un unique élément de dont le coeur est image de par un isomorphisme d’appartements fixant . Nous noterons ce cône car il est en fait égal à . Si contient un cône tel que , c’est-à-dire si contient , alors n’est autre que . La propriété principale de est que pour tout , .
Nous voici en mesure d’écrire un voisinage de base de en fonction des voisinages de base des appartements:
Proposition 6.2.3
Soit , , borné. Alors
L’union est prise sur tous les appartements de qui contiennent .
Démonstration:
On commence par l’inclusion ””. Soit tel que , notons . Soit , soit un représentant de inclus dans . Comme , tout ce que nous devons montrer est que .
Lemme 6.2.4
Soit , borné et stable par , et tels que . Alors il existe un scp de tel que .
Preuve du lemme: On va appliquer la proposition 5.1.2, avec , et . Il nous faut choisir de manière à ce que , . De plus, pour que la conclusion de la proposition 5.1.2 nous soit utile, il faut que .
Comme , il existe une facette de Weyl tel que . Soit alors la base du cône , de sorte que et . Soit un scp de tel que .
Soit , soit contenant , et fixant . Alors la proposition 5.1.2 prouve que , en particulier, . Comme fixe qui contient , ceci prouve que .
6.3 est séparé
Proposition 6.3.1
L’espace topologique est séparé.
Démonstration:
Soient et deux points distincts de . D’après la proposition 4.5.5, il existe , et tels que et . D’après le lemme 5.2.3, . Comme est séparé et que , on peut, quitte à restreindre et à des scp, supposer qu’il existe tel que . Quitte à remplacer par une boule incluse dans , on peut supposer que est convexe.
On peut encore restreindre à un scp pour s’assurer que . Alors nous pouvons utiliser la proposition 5.1.2 pour obtenir que : soit , soit contenant et , soit fixant , alors la proposition 5.1.2 affirme que , donc . Ceci implique directement que : nous avons obtenu un voisinage de et un de qui sont disjoints.
6.4 est à base dénombrable d’ouverts
Lorsque est localement fini, ou plus généralement lorsque chaque cloison n’est pas incluse dans plus qu’un nombre dénombrable de chambres, la topologie qu’on vient de définir est à base dénombrable d’ouverts. Voici en quelques mots pourquoi.
Tout d’abord, pour calculer , seuls , et comptent. Or, pour un sommet fixé, il n’existe qu’un nombre fini de bases le contenant. L’hypothèse sur implique qu’il n’y a qu’un nombre dénombrable de points de à coordonnées rationnelles (en fixant une chambre de référence, et une base affine dans cette chambre). Donc en prenant tous les sommets à coordonnées rationnelles dans , toutes les bases correspondantes à ces sommets, et tous les voisinages de dans de la forme , on obtient une base de voisinages pour la topologie de qui est dénombrable.
6.5 Injections canoniques
6.5.1 L’injection
Proposition 6.5.1
L’injection canonique est telle que, pour tout , on a . De plus, elle est continue, ouverte et d’image dense.
Démonstration:
Soient , et . On a alors , donc .
L’autre direction est (encore plus) claire.
Il est maintenant clair que l’image de est dense dans .
Montrons que est ouverte. Soit un ouvert, . Il existe un voisinage de dans , inclus dans qui est une boule dans , . La boule dans est stable par le groupe de Weyl de , donc . Il est de plus clair que . (Ici, et ).
Nous allons vérifier que : ce sera alors bien un voisinage de dans .
L’inclusion découle directement de l’égalité . Pour l’autre inclusion, il suffit de remarquer que puisque est borné, si alors .
Enfin, montrons que est continue. Soit un ouvert de , soit . Il existe un voisinage de inclus dans de la forme . Alors . Il reste à prouver que contient un voisinage de dans . Or contient une boule , donc qui est un voisinage de dans .
Nous pouvons donc identifier à l’ouvert dense . La relation devient alors
6.5.2 Les injections
Proposition 6.5.2
Soit , alors l’injection canonique est telle que, pour tout , borné, il existe un scp de tel que . Cette injection est de plus continue et fermée.
En particulier, c’est un homéomorphisme de sur son image qui est un fermé compact de .
Démonstration:
Soit , , borné. Soit , ce qui signifie que quitte à remplacer par un scp, on a . Alors . Donc .
Pour l’autre inclusion, notons . On choisit un scp de tel que , ceci existe car est borné et est un cône convexe et d’intérieur non vide. Alors . Vérifions que convient.
Soit , on peut supposer que d’où . On peut aussi imposer que . Alors en utilisant la proposition 5.1.2 (prendre , , ), on vérifie que , d’où .
La continuité de est alors immédiate. Le fait que est fermée provient alors de la compacité de et de la séparation de .
Nous pouvons dsormais identifier un appartement compactifié à un fermé compact de . La proposition 4.5.5 nous permet de prouver une généralisation de l’axiome indiquant que deux chambres doivent être incluses dans un même appartement:
Soit une chambre de et , alors il existe contenant et un scp de . Donc . De même, si et sont deux points du bord de , il existe contenant un scp de et un scp de , et alors .
Lemme 6.5.3
Soient et des facettes de ou des points de , alors il existe un appartement tel que . (Ici, on identifie à dans le cas où est un point.)
6.6 Rétractions
Nous avons vu que si est un appartement et , alors s’étend de manière unique en un homéomorphisme de sur lui-même, puis que si est un isomorphisme, alors s’étend de manière unique en un homéomorphisme de sur , qu’on note encore . Les rétractions peuvent aussi s’étendre à :
Proposition 6.6.1
Soit , et une chambre de , soit la rétraction sur de centre . Alors s’étend de manière unique en une fonction continue de sur .
Démonstration:
Soit , nous savons qu’il existe tel que . Soit fixant , alors , il est donc naturel de poser . Pour que cette définition soit valide, il faut s’assurer que si est un autre appartement tel que et si fixe , alors .
Soient et des représentants de . Alors et , et , . Il nous faut donc vérifier que .
Quitte à raccourcir et , il existe un appartement contenant .
Quitte à raccourcir encore , on peut supposer, dans : . On peut raccourcir maintenant , pour obtenir que, dans , .
Supposons dans un premier temps qu’aucun mur de ne sépare strictement de . Soit . Alors, en notant un isomorphisme de sur fixant , si est un mur de séparant strictement et , ne peut séparer strictement deux points de . La proposition 4.3.3 permet donc de trouver un appartement contenant . Les -cônes engendrés par et dans sont équivalents. Soit fixant , alors et . Il s’ensuit que les cônes engendrés par et sont équivalents dans . Mais ces cônes sont exactement et .
Pour traiter le cas général, nous allons construire dans une suite de coeurs qui ne sont séparés par aucun mur, et qui engendrent des cônes équivalents.
La projection de sur la façade envoie et dans deux facettes bien déterminées. Soit une galerie dans entre ces deux facettes.
On note et les cônes engendrés par et dans . D’après 3.3.3, après avoir choisi un système de générateurs de adapté, on a une partition , où est le type de , est l’ensemble des réflexions de fixant et le type des réflexions fixant . Si est une cloison de de type inclus dans , le mur de correspondant, alors . Par conséquent, ne peut séparer de , car . Ainsi le type de la galerie est inclus dans .
On définit à présent la suite de coeurs et la suite de cônes par récurrence. En plus des conditions déjà citées, on requiert que lorsque est pair.
On pose , . Ensuite si et sont construits pour un indice pair, soit la réflexion, dont la direction fixe qui relève la réflexion de définie par la cloison . La cloison est de type un élément de , donc , stabilise et fixe . Soit le sommet de , par hypothèse de récurrence, , donc , et . Soit le mur fixé par , donc , et soit le projeté orthogonal de sur . Alors , et .
On pose alors et . Ces deux cônes sont équivalents à . On pose ensuite et . Les deux coeurs et sont projetés dans la même chambre fermée de , ce qui signifie qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare strictement de . Mais comme ces deux coeurs sont parallèles de direction , un mur dont la direction ne contient pas ne peut de toute façon pas les séparer, donc aucun mur ne sépare strictement de . De même, et sont projetés dans la même chambre fermée , donc aucun mur ne sépare strictement de .
Ainsi et vérifient les conditions requises. On construit ainsi les suites et . Alors est projeté dans la même chambre fermée que et , il ne reste donc plus qu’à poser et pour obtenir une suite de cônes de équivalents allant de à telle que les coeurs de deux cônes consécutifs ne sont séparés strictement par aucun mur.
Nous avons que dans ces conditions, deux coeurs consécutifs ont des scp dont les images par sont des coeurs de cônes de équivalents. Donc et ont des scp et envoyés par sur des coeurs de cônes de équivalents. Mais et , on a donc prouvé que . Ceci prouve que est bien définie.
Montrons qu’elle est continue. Comme est ouvert dans , et que est continue, la continuité de est acquise en tout point de . Il s’agit donc de montrer, pour , pour et pour un voisinage de dans , que contient un voisinage de .
Soit tel que , soit fixant . Comme n’est pas réduit à un point (), on peut le raccourcir pour s’assurer que . Un voisinage de dans est , vérifions qu’il est inclus dans . Soit et fixant tels que , il faut montrer que .
Nous savons que , donc en utilisant la proposition 4.3.5, on voit qu’il existe contenant . Soit fixant , en particulier, fixe donc . Ensuite fixe , donc .
L’unicité de découle de sa continuité et de la densité de dans .
A présent, nous pouvons nous contenter de noter à la place de .
Les résultats obtenus pour les rétractions de peuvent souvent s’étendre aux rétractions sur . Voici ce que devient la proposition 4.4.1 (l’énoncé est un peu différent de celui sur les rétraction dans car il faut prendre en compte la possibilité que ):
Proposition 6.6.2
Soit , et deux chambres adjacentes dans , le mur les séparant, la réflexion selon . Soit et . Soit , alors:
-
—
Soit , soit .
-
—
Si alors .
-
—
Si et si , alors il existe un appartement contenant , et .
Démonstration:
Les deux premiers points découlent de la proposition 4.4.1, et de la continuité de , et .
Pour le troisième point, on répète quasiment la preuve de la proposition 4.4.1. Supposons , soit tel que . Supposons que et montrons qu’alors . Soit fixant , alors . Soit la chambre de , voisine de le long de (en fait, ), puisque . Il existe un appartement contenant . Cet appartement contient dans son adhérence car il contient , et il ne contient pas . Soit fixant , on a . On a aussi . Alors et coïncident sur , puis sur donc en .
6.7 Compacité
Pour l’instant, la notation est définie pour un cône dans un appartement et une partie de . On définit à présent, si est une facette dans un appartement et si est une partie de stable par les parties vectorielles des éléments de ,
L’union est prise sur tous les appartements contenant , et est un isomorphisme de vers fixant dont le choix n’importe pas.
Avant de prouver la compacité de , vérifions cette conséquence de la proposition 4.2.7:
Lemme 6.7.1
Soit un appartement, et une partie convexe et ouverte de . Soit la réunion de toute les facettes de qui rencontrent . Alors pour toute chambre de , et tout point , il existe une galerie tendue de à qui reste dans .
Preuve du lemme: Soient , alors . Comme est ouvert, on peut supposer que ne rencontre que des chambres et des cloisons (aucune facette de dimension inférieure) et que n’est inclus dans aucune direction de mur de . Soit une galerie le long de , commençant par , donnée par la proposition 4.2.7. L’adhérence de chaque chambre de coupe . Soit une de ces chambres, rencontre soit soit une de ses cloisons. Mais si elle rencontre une de ses cloisons, disons , on ne peut avoir car est la direction d’un mur. Alors rencontre aussi ( est forcément dans ). Comme est convexe, et .
Il est temps de montrer que est compact
Théorème 6.7.2
Si l’immeuble est localement fini, alors l’espace est compact.
Démonstration:
Comme nous savons déjà que est séparé et à base dénombrable d’ouverts, il ne reste plus qu’à montrer qu’il est séquentiellement compact. Soit une suite dans , trouvons lui une valeur d’adhérence.
Première étape
Quitte à remplacer par une sous-suite, il existe , , une chambre de , et une chambre de tels que converge vers , et , .
Commençons par choisir dans au hasard, et notons . Comme est compact, on peut supposer que la suite converge vers une limite . On peut aussi supposer que tous les sont dans une même façade de , c’est à dire qu’ils ont tous la même direction . Soit un représentant de , alors . On peut de plus choisir de sorte que . Comme un voisinage de dans est inclus dans , on peut supposer que tous les ont un représentant inclus dans . Mais est une réunion finie de chambres fermées, donc il existe chambre de telle que contient une infinité de , on peut supposer qu’il les contient tous. Bien sûr, cela implique que contient tous les .
Pour conclure la première étape, il ne reste plus qu’à s’assurer que , ce qui, puisque revient à s’assurer que coupe . Pour l’instant, est inclus seulement dans . Soit une chambre à distance minimale de dont l’adhérence coupe .
Nous allons maintenant prouver par récurrence sur que s’il existe , , , et dans la même configuration que , , , et le sont actuellement, avec , alors il existe , , , et comme requis pour conclure la première étape.
Si la conclusion est immédiate, , , et conviennent.
Si , soit une galerie minimale entre et , et soit le premier mur traversé, soit la symétrie de selon , notons et .
Si pour une infinité d’indices , alors on peut passer à une sous-suite pour supposer que pour tout . Alors il suffit de remplacer par pour pouvoir appliquer l’hypothèse de récurrence.
Par contre, dans l’autre cas, on peut supposer que pour tout . Alors la suite des ne vérifie plus du tout les hypothèses demandées, il va falloir changer d’appartement.
D’après la proposition 6.6.2, cette situation n’est possible que si pour tout , . De plus, pour tout , il existe alors une chambre voisine de et de , et un appartement dont l’adhérence contient , et . Comme est supposé localement fini, il n’y a qu’un nombre fini de chambres voisines à et à , on peut donc remplacer par une sous-suite pour qu’il existe une chambre fixe , voisine de et telle que pour tout , il existe tel que .
Soit un appartement contenant et , et soit fixant . Nécessairement, . Alors , . Comme de plus , on peut appliquer l’hypothèse de récurrence à , , , , et . Ceci conclut la première étape.
Seconde étape:
On note la rétraction obtenue dans la première étape. On montre à présent que soit la suite admet une valeur d’adhérence dans , soit il existe une galerie tendue dans issue de et une suite telle que pour tout , pour tout , , et . On peut enfin imposer que , .
On note .
On commence par regarder le cas où . Dans ce cas, , et est un voisinage de dans , il contient donc tous les à partir d’un certain rang. Mais est une union finie de chambres fermées, donc c’est un compact, et la suite a une valeur d’adhérence dans donc dans .
Supposons à présent que .
Par le lemme 6.7.1, il existe une galerie minimale de à telle que , coupe .
On choisit ensuite une demi-droite , et on prolonge par une galerie tendue dont l’adhérence contient (proposition 4.2.7). Vérifions qu’on peut s’assurer que pour . Notons l’ensemble des murs contenant , alors la construction faite dans la proposition 4.2.7 est telle que chaque chambre de la galerie est incluse dans . Par ailleurs, est un convexe, délimité par un nombre fini de ses hyperplans d’appui, et ces hyperplans ont pour direction un mur de . Notons l’ensemble des hyperplans d’appui de qui contiennent .
Il suffit de montrer que pour les chambres contenant un segment de dans leur adhérence, car alors nous pourrons relier deux telles chambres par une galerie dont chaque chambre coupe , et la construction donnée dans la preuve de la proposition 4.2.7 consiste exactement à définir d’abord les chambres contenant un segment de dans leur adhérence, puis à relier ces chambres par des galeries tendues arbitraires. Soit une de ces chambres, soit un segment de inclus dans . Les hyperplans d’appui de sont des murs en nombre fini, et ceux contenant doivent contenir et sont donc des éléments de . Par conséquent, il existe un voisinage de tel que . De la même manière, les hyperplans d’appui de qui contiennent doivent contenir car . Donc il existe un voisinage de tel que . Il ne reste plus qu’à vérifier que est d’intérieur non vide. Notons , nous savons que est d’intérieur non vide puisque contient un point disons de . De plus, et est convexe. Il ne reste plus qu’à relier à par une droite pour finalement obtenir un point intérieur à .
Ceci permet d’obtenir que pour tout . Vérifions que la galerie est tendue. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un mur qui sépare de et d’une chambre avec . Mais et , d’où . En particulier , mais ceci est impossible puisque est une galerie minimale de à .
Donc la galerie obtenue est bien tendue.
Pour tout , soit . La suite tend vers . Donc pour tout , les sont inclus à partir d’un certain rang dans . Vérifions qu’en fait ils sont dans . Soit , un représentant de est inclus dans où est une facette vectorielle dont l’adhérence contient et . Disons avec .
On calcule alors: . Or donc et . Mais nous savons d’autre part que . Donc , et .
Ainsi, pour tout , les sont inclus dans à partir d’un certain rang. En passant à une sous-suite, on peut supposer que , .
Par ailleurs, en déplaçant un peu les on peut obtenir une suite convergeant vers et telle que . Ceci conclut la seconde étape.
Troisième étape
On suppose maintenant que n’a pas de valeur d’adhérence dans . Montrons qu’il existe une sous-suite de , et une galerie tendue telle que , que pour tout , et que les pour sont dans l’adhérence de .
Ici, on note pour un isomorphisme de sur un appartement contenant et qui fixe . On remarque que puisque est une chambre, on a en fait , et l’adhérence de ceci vaut (pour vérifier l’inclusion non évidente, utiliser le lemme 6.5.3 pour inclure un point et dans un même appartement).
On commence par montrer par récurrence que pour tout , il existe et une sous-suite de satisfaisant aux conditions demandées.
D’après la première étape, tous les sont dans . Donc convient bien.
Ensuite, supposons construits.
Comme et coupe , en utilisant la proposition 4.3.5, on trouve un appartement tel que . Soit fixant , comme , pour , on voit que . Or est une chambre adjacente à , et il n’y a qu’un nombre fini de telles chambres. On peut donc passer à une sous suite de pour que tous les soient dans un même avec une chambre adjacente à dont l’image par est . Il ne reste plus qu’à poser .
Enfin, on prend la sous-suite de définie par . Le couple satisfait aux conditions demandées par l’étape 3. Pour ne pas alourdir les notations, dans la suite on notera .
quatrième étape
Soit un appartement contenant , soit fixant , soit . Montrons que tend vers .
Soit un voisinage de . Comme est un voisinage de , il existe un entier tel que et tel que , . Soit , montrons que .
Comme coupe et , la proposition 4.3.5 indique l’existence d’un appartement tel que . Dès lors, on a les égalités: , d’où . Mais comme coupe , on peut appliquer la proposition 5.1.2, qui prouve que si un appartement fermé contient et , et si fixe , alors . Ceci entraîne bien que .
7 Unicité de la construction
On suppose dans cette partie que , muni de son système complet d’appartements, est l’immeuble obtenu à partir d’une donnée radicielle valuée discrète comme dans [BT72]. Rappelons brièvement quelques notations.
On choisit un appartement , ainsi qu’un sommet spécial , qui permet d’identifier et ainsi que et les formes affines sur s’annulant en . Il existe un système de racine , éventuellement non réduit, sur , et pour tout , il existe un sous-groupe discret de tel que les murs de sont les pour et .
Un groupe agit sur , pour tout et , il existe un sous-groupe de qui fixe le demi-appartement ainsi que toutes les chambres ayant une cloison dans son intérieur. Pour et , on a , donc la réunion est un groupe. Le groupe agit transitivement sur l’ensemble des appartements contenant . Le groupe est engendré par les , pour et ainsi que par un autre sous-groupe noté qui fixe .
Ces sous-groupes vérifient les axiomes d’une donnée radicielle valuée. On suppose de plus l’axiome sur les commutateurs des vérifié au sens fort: pour tout avec , pour tout , ,
Le groupe est muni de la topologie de la convergence simple sur , c’est-à-dire qu’une base de voisinages de est l’ensemble des fixateurs de parties bornées. Alors l’action de sur est continue.
Cette situation se retrouve en particulier lorsque est l’immeuble de Bruhat-Tits d’un groupe réductif sur un corps local non archimédien.
Nous allons montrer dans ce cas qu’une fois fixée une compactification de de la manière présentée dans la partie 3, il n’existe en fait qu’une seule manière de l’étendre en une compactification de sur laquelle agit par homéomorphisme.
Le fixateur dans d’un produit d’éléments de divers sous-groupes radiciels est dans certains cas facile à déterminer:
Proposition 7.1
Soient des racines deux à deux non colinéaires, soit . On suppose que contient au moins une chambre. Alors .
Remarque: Pour des racines dans un sous-système réduit et positif de , l’hypothèse ”non colinéaires” devient juste ”distinctes”.
Démonstration:
On note . Pour chaque , l’ensemble des points fixes de est un demi-appartement délimité par un mur de direction .
La première inclusion est claire.
Soit , montrons que n’est pas fixé par .
On remarque pour commencer qu’il est impossible que soit fixé par et tous les sauf un.
Soit une chambre incluse dans . Comme est ouvert dans , on peut choisir tel que ne rencontre pas d’intersection de murs. Si était fixé par , alors le serait aussi. Or le segment sort de en coupant un seul mur, disons . Donc contient un point qui est dans . Donc est fixe par tous les sauf , ce qui est impossible.
Rappelons ce résultat (voir [BT72] 7.4.33), exprimant que lorsqu’un élément de fixe une grande boule dans un appartement, alors il fixe une petite boule de même centre dans l’immeuble. On note la boule dans de centre de rayon , et la boule dans .
Proposition 7.2
Il existe une constante dépendant uniquement de telle que pour tout , et , si et sont tels que et si , alors fixe .
preuve:
Pour , notons le maximum, de sur la sphère unité, et soit .
Soient et tels que .
Soit le groupe engendré par les pour , , et tels que et chaque contient . Montrons que les éléments de fixent . Déjà, pour le vecteur qui maximise sur la sphère unité, on a d’où . Soit maintenant et comme dans la définition de . Alors . Ceci entraîne que la boule est incluse dans . Comme , on obtient le résultat voulu.
A présent, soit , et une chambre de coupant . Soit une galerie tendue avec . Soit la rétraction sur de centre . Il existe , et tels que et contient donc . Ensuite il existe , , tels que , et contient donc encore . On obtient finalement , , tels que . Notons .
Comme coupe , on a . Le fait que chaque commutateur soit dans permet de prouver par un calcul classique que , et donc que fixe . Alors d’où puis .
Corollaire 7.3
Soient et deux appartements, on suppose qu’il existe et tels que contient la boule où est la constante de la proposition. Alors il existe tel que , et fixe .
Démonstration:
Par conjugaison, on peut supposer . Le groupe engendré par les tels que est transitif sur les appartements contenant et il fixe d’après 7.2.
Et voici la proposition annoncée:
Proposition 7.4
Soit un espace topologique compact contenant , tel que est ouvert dense dans .
On suppose que l’adhérence de l’appartement de référence , qu’on note est homéomorphe à par un homéomorphisme fixant . On note cet homéomorphisme.
On suppose que l’action de sur s’étend en une action continue sur . Alors il existe un homéomorphisme qui est -équivariant et qui fixe .
Remarque: Par densité de dans , et par densité de dans , les applications et sont uniques si elles existent.
Démonstration:
Si est un appartement de , on notera son adhérence dans . Les deux clôtures d’appartements et sont alors homéomorphes, par un unique homéomorphisme qui vaut , où est tel que .
Il est donc naturel de vouloir définir une fonction de la sorte:
:
, pour et .
Montrons que est bien définie: soient et tels que et montrons que . En remplaçant par , on se ramène au cas où . Soient un représentant de et un représentant de . Quitte à les réduire, il existe contenant . Soient et des demi-droites incluses dans et de directions incluses dans et , de sorte que est l’unique point dans de et est l’unique point dans de . Ainsi, et ont le même point limite dans , qui est . Comme est homéomorphe à par un homéomorphisme fixant , on en déduit que et ont le même unique point limite dans .
Le point limite de dans est et comme est séparé, c’est aussi l’unique point limite de dans donc en particulier dans . De même, l’unique point limite de dans est , donc par continuité de , le point limite de dans , donc dans est . Ceci prouve que .
Donc est bien définie. C’est une fonction -équivariante qui fixe , elle induit l’unique homéomorphisme de sur pour chaque appartement . Comme deux points quelconques de sont toujours inclus dans l’adhérence d’un même appartement (lemme 6.5.3), ceci entraîne que est injective. Il ne reste plus qu’à montrer que est continue: elle sera alors fermée par compacité de et séparation de , et son image sera un fermé de contenant c’est-à-dire lui-même.
Soit , montrons que est continue en . Le cas où est évident, et par -équivariance de , on se ramène au cas où . Au total, on peut supposer .
Soit un ouvert de contenant . Notons l’action de sur . Par continuité de , et parce que , il existe un voisinage ouvert de dans et un voisinage ouvert de dans tel que . Soit . Alors . Il reste à prouver que contient un voisinage de dans .
Soit un représentant de . On peut supposer que est le fixateur dans d’une partie bornée, de la forme , avec et , on peut même imposer , où signifie .
Soit la constante donne par la proposition 7.2. Soient l’ensemble des parties d’appartement égales à la clôture de et d’une boule de centre de rayon , c’est-à-dire:
Cet ensemble est fini car l’ensemble des sous-complexes simpliciaux de est fini.
On choisit alors une famille d’appartements tels que , .
Pour tout , induit un homéomorphisme entre et . Comme , . De plus, est un voisinage de dans , donc est un voisinage de dans . Il contient donc un ensemble de la forme , avec et , ( est défini en 6.2.1). Comme , on peut supposer que (voir 5.1.4). Soit un scp de tel que . Soit .
Alors , et est un coeur de cône affine. Soit le cône engendré par , c’est un scp de donc et est un voisinage de dans . Nous savons que pour tout , . Montrons que , cela conclura la preuve.
Soit , il suffit de montrer qu’il existe et tel que .
D’après la proposition 6.2.3, il existe un appartement contenant et un représentant de , tel que , où est un isomorphisme fixant . Quitte à réduire , on peut supposer inclus dans un des quartiers de la forme avec une chambre de . Comme a été choisi dans , il est dans , donc aucun mur de dont la direction contient ne sépare strictement et . La proposition 4.3.5 permet de conclure à l’existence d’un appartement contenant .
Ensuite, la proposition 4.3.6 prouve qu’il existe un appartement contenant . En particulier, contient et , donc , ce qui contient . De plus, nous avons supposé , ce qui entraîne que .
Soit tel que .
Par le corollaire 7.3, il existe tel que , fixe et . En particulier, .
Enfin, si est un isomorphisme fixant , alors , où est le cône engendré par dans . Comme et , on obtient , d’où .
Ce résultat prouve que les compactifications de définies par A. Werner dans [Wer07] sont identiques à celle présentée ici pour les décompositions en cône décrites en 2.5. En effet, nous avons déjà vu que la décomposition définie dans [Wer07] était égale à , et nous avons défini la compactification de à partir de exactement de la même manière que dans [Wer07].
En particulier, les compactifications de [Lan96] et [GR06] coïncident avec celle présentée ici pour la décomposition en cônes de Weyl vectoriels.
8 Description de
Dans cette partie, on vérifie principalement une propriété attendue de , à savoir que son bord est réunion d’immeubles affines, dont les groupes de Coxeter sont des sous-groupes de Coxeter de .
8.1 est une réunion d’immeubles
Lemme 8.1.1
Soient , soient , . Si est dans la même facette de que alors et et sont dans la même facette de .
Notons cette facette, elle est donc incluse dans . Il existe un isomorphisme dont le prolongement à dans envoie la façade de contenant sur la façade de contenant et fixe .
Enfin, si , sont tels que , alors .
Preuve du lemme: Si et dans une même facette de , cela signifie qu’il existe tels que et , avec et tels qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare au sens large de . C’est-à-dire qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare de ni ne contient l’un sans contenir l’autre.
D’autre part, donc il existe tel que .
On choisit un appartement contenant, quitte à les raccourcir, et . Nous allons montrer que , c’est-à-dire qu’il existe un scp de dont le coeur est inclus dans . Il suffit de montrer que . (Pour une compactification polygonale classique, où , c’est automatique.)
On décompose en somme orthogonale de trois sous-espaces comme dans 3.3.9: , où est le supplémentaire orthogonal de dans .
Notons la projection orthogonale sur , alors est un cône convexe qui engendre et qui est stable par son groupe de Coxeter. Comme est essentiel, ceci implique que .
Il existe donc un point tel que . En rajoutant à un élément assez grand de , on peut aussi s’assurer que . Vérifions que . Supposons qu’un mur sépare strictement et . Disons que et . Alors et . Mais comme , ceci implique , c’est-à-dire . Mais nous savons qu’un tel mur soit contient soit contient . Le premier cas est impossible car il implique et nous avons supposé qu’aucun mur dont la direction contient ne sépare et . Quand au second cas, il implique que s’annule sur . Mais comme , il est alors impossible que sépare et .
Ainsi, est un scp de et son coeur est inclus dans donc dans . Ceci prouve que . En choisissant un isomorphisme qui fixe , et donc , on vérifie que et sont dans la même facette de . Alors comme précédemment, on peut trouver un scp de dont le coeur est dans donc dans . On obtient alors que et et sont dans la même facette de .
Il ne reste plus qu’à choisir un isomorphisme fixant , et donc , et à poser pour obtenir un isomorphisme de sur dont le prolongement à fixe . Il est immédiat que , donc . La définition de est indépendante de , et les raisonnements que nous venons d’effectuer prouvent que fixe toute la facette de contenant .
Remarque: Comme et sont fermés, contient en fait . Et comme est continu, il fixe .
Lorsque , mais que contient un cône , un cône avec , on peut quand même, comme dans la preuve précédente, en passant par un appartement contenant un scp de et un scp de , prouver qu’il existe un isomorphisme de sur qui induit un isomorphisme entre et . Ceci prouve le
Lemme 8.1.2
Soient et deux appartements, , tels que . Alors il existe un isomorphisme induisant un isomorphisme de sur , tel que .
On définit l’ensemble des facettes de comme étant la réunion des ensembles de facettes de chaque appartement compactifié. Le lemme montre que deux facettes sont disjointes ou égales, et que si un appartement contient un point d’une facette, alors il contient toute la facette, et son adhérence.
Comme un immeuble, vérifie les assertions suivantes:
Proposition 8.1.3
-
—
-
—
Pour deux facettes et , il existe contenant les deux.
-
—
Si contient deux facettes et , alors il existe un ”isomorphisme d’appartements compactifiés” fixant et .
Mais bien sûr, les ne sont pas des complexes de Coxeter.
Démonstration:
Le premier point vient directement de la définition de . Le second est conséquence du lemme 6.5.3 et du fait que lorsqu’un appartement compactifié contient un point d’une facette, alors il contient toute cette facette.
Prouvons le troisième point. En remplaçant et un point inclus dans et un point inclus dans , on se ramène au cas où et sont deux points.
Soit un représentant de dans , et un représentant de dans . Soient une demi-droite incluse dans l’intérieur de dans , et une demi-droite incluse dans l’intérieur de dans . En choisissant des galeries, dans et , le long de ces demi-droites (proposition 4.2.7), puis en choisissant un appartement contenant des sous-galeries de ces galeries, on obtient un appartement dont l’intersection avec contient un scp de et au moins une chambre disons . L’intersection de avec contient un scp de et une chambre . Quitte à réduire et , on suppose .
A présent, soit un isomorphisme fixant . Alors est la restriction à de la rétraction . Lorsqu’on étend et par continuité à et , on obtient et car , d’où et .
De la même manière il existe qui fixe , alors convient.
Définition 8.1.4
Soit , on note . On appellera la façade de l’immeuble de type .
Bien sûr, ne dépend que de la classe de parallélisme de , et même que de la classe de parallélisme de . Si est un appartement contenant , si est le cône engendré par , on notera indifféremment , , ou même .
Proposition 8.1.5
Pour tout , est un immeuble affine. Ses appartements sont les pour tous les appartements contenant un cône tel que .
Démonstration:
Chaque est un complexe de Coxeter affine, et la réunion de ces complexes de Coxeter est bien .
Si et sont deux appartements contenant des cônes et tels que , alors , et le lemme 8.1.2 prouve l’existence d’un isomorphisme entre et . Ainsi, tous les (présumés) appartements de sont isomorphes.
Soient et deux facettes de . Par la proposition 8.1.3, il existe un appartement tel que . Alors et sont inclus dans des façades de , disons et , avec . On peut choisir représentant un élément de et représentant un élément de . Alors , d’où est un appartement de qui contient .
Enfin, soient et deux (présumés) appartements de , supposons que contienne deux facettes et , et cherchons un isomorphisme de sur fixant . Par la proposition 8.1.3, il existe un isomorphisme d’appartements compactifiés fixant . Alors induit l’isomorphisme cherché entre et .
Si est un appartement contenant un cône tel que , alors est unique (car le parallélisme est une relation d’équivalence: si est un autre cône avec , alors ). Ceci autorise la
Définition 8.1.6
Si est un appartement contenant un cône tel que , on note .
La projection de sur sera notée ou , ou juste , , selon le niveau de précision requis.
Donc en résumé, il y a trois notations pour le même objet: , et .
Remarque: L’immeuble n’est pas forcément essentiel. Par exemple, si est contenu dans une chambre de Weyl vectorielle, alors est un seul appartement, sans mur (voir la remarque de 3.3.8).
Maintenant qu’on sait que les façades sont des immeubles, on peut montrer d’autres résultats dans la même veine, par exemple:
Proposition 8.1.7
Soit , soient deux appartements contenant des cônes parallèles à . Alors il existe un isomorphisme qui fixe .
8.2 Bord d’une façade
On vérifie ici que chaque façade peut être compactifiée tout comme nous avons compactifié , et que le résultat est homéomorphe à une réunion que nous préciserons, de plusieurs façades de .
On fixe à présent un cône .
8.2.1 Compactification de
Choisissons un appartement contenant , soit la projection . Soit , alors est un complexe de Coxeter affine et le groupe vectoriel associé est isomorphe via la projection à .
On pose .
Lemme 8.2.1
Soit dont est une face, c’est-à-dire . Alors est stable par , c’est-à-dire .
Remarque: En fait, car est ouvert dans et .
Preuve du lemme: C’est immédiat si on fixe une description de et de sa face en termes d’équations et d’inéquations linéaires comme en 2.4, mais voici une preuve élémentaire.
Soit et . Comme est ouvert dans , il existe tel que la boule dans soit incluse dans . Ensuite donc il existe , de norme inférieure à tel que . Alors .
Proposition 8.2.2
L’ensemble vérifie les conditions requises pour définir une compactification de . De plus, l’application est une bijection entre l’ensemble des cônes de ayant comme face et .
Démonstration:
On commence par les points évidents: est fini, il contient , et il est stable par le groupe de Weyl .
Montrons que . Comme le terme de droite est stable par homothéties, il suffit de montrer qu’il contient un voisinage de . Par conséquent, il suffit de montrer que, dans , contient un voisinage d’un point de . Soit . Si est un cône ne contenant pas dans son adhérence, alors (car est une réunion disjointe de cônes dans ). Il existe donc un voisinage de dans qui ne coupe pas . Comme est fini, le nombre des ainsi définis pour variant parmi les cônes dont n’est pas une face est fini, et leur intersection est un voisinage de inclus dans . Nous avons prouvé que .
Montrons que cette union est disjointe. Soit et deux éléments de , où sont des cônes ayant comme face. Supposons que contient un point, écrivons ce point sous la forme avec . Alors il existe tels que et . Mais il existe tels que et . Alors le point est dans , d’après le lemme. Ceci entraîne que , donc .
Ceci montre également que l’application est bijective.
Le petit raisonnement qu’on vient de faire fonctionne aussi dans le cas de cônes affines, il donne le résultat suivant, qu’on note pour utilisation ultérieure:
Lemme 8.2.3
Soit deux cônes affines tels que borde et . Si , alors .
Passons à la description des cônes à l’aide d’un système d’équations et d’inéquations. Soit ayant comme face. Soient telles que
Les pour définissent des formes linéaires sur . Vérifions que . L’inclusion ”” est claire. Réciproquement, un point de l’ensemble de droite est de la forme avec , pour et pour , et nous voulons montrer qu’il existe tel que . On s’aperçoit qu’il suffit de choisir assez grand.
Nous avons donc obtenu une description de en système d’équations et d’inéquations linéaires comme requis.
Passons aux deux conditions portant sur les faces d’un cône.
Soit , vérifions que son bord est la réunion d’autres cônes de . Soit , soit le cône contenant . Nous allons montrer que . On choisit pour que . Pour tout , il existe un point de à distance inférieure à de . Cela signifie qu’il existe , tels que et . On décompose avec , on impose en outre que . Alors et .
La suite a une valeur d’adhérence , a priori dans . Mais en fait, cette suite reste dans , et par le lemme 8.2.1 appliqué à et à ses faces. Donc . La suite aussi admet comme valeur d’adhérence, car et . Donc . Comme , est une face de : . D’où . Mais comme , on arrive à .
Ainsi, est une réunion d’autres cônes de .
Enfin, il reste à montrer que , et nous savons que . Par conséquent, il suffit de montrer que et . Les deux égalités, pour et sont similaires, on ne traite que celle concernant . L’inclusion vient de la continuité de . Pour l’autre inclusion, il suffit de montrer que est fermé, ce qui revient à montrer que est fermé. On reprend les comme au paragraphe précédent, on vérifie alors que , c’est bien fermé.
L’avant dernier paragraphe de la preuve prouvait en fait:
Lemme 8.2.4
Si sont bordés par et si est une face de , alors est une face de .
Nous pouvons donc compactifier à l’aide de la décomposition en cônes de l’appartement . On note provisoirement l’espace obtenu, si est un appartement de , on note sa compactification.
Vérifions rapidement que ne dépend pas du choix de l’appartement :
Proposition 8.2.5
Soit un appartement de , soit le cône de engendré par un coeur parallèle à , soit la projection. Alors l’ensemble des cônes vectoriels de est .
Démonstration:
Par définition, ceci est vrai pour . Pour quelconque, l’ensemble des cônes vectoriels de est où est un isomorphisme de complexes de Coxeter dont le choix n’importe pas.
Comme , il existe tel que (lemme 8.1.2). Alors induit un isomorphisme entre et , on peut choisir comme étant égal à cet isomorphisme. On a alors , et on vérifie que .
Pour finir, étudions le lien entre le coeur d’un cône bordé par et le coeur de :
Proposition 8.2.6
Soit un cône bordé par , soit un appartement de . Alors
-
—
.
-
—
-
—
Si est de direction , alors .
Démonstration:
Notons et fixons tel que .
Soit , montrons que . Il faut donc montrer que est fixé par . Soit , on identifie à un élément de , ce qui assure déjà que est encore bordé par . Et comme , on obtient par la deuxième partie de la proposition 8.2.2 que . Alors par définition de , et donc .
Passons au second point. Si est une facette de Weyl dans dont l’adhérence contient , alors . Notons la facette de Weyl de qui contient , nous venons de prouver que son adhérence contient , elle contient donc toute la facette de Weyl contenant , et cette facette contient par le premier point. Donc et . Ce qui prouve .
Montrons l’autre inclusion: soit une facette de Weyl de dont l’adhérence contient . Soient des racines de , identifiées à des racines de s’annulant sur , telles que . Alors contient et .
Il existe une facette de incluse dans , de dimension maximale, et dont l’adhérence contient (proposition 3.3.3, point 9). Alors contient un cône inclus dans , tel que . Il existe des racines telles que . On ne rajoute aucune condition du type car est choisi de dimension maximale. S’il existe tel que , alors induit un mur de , qui ne peut couper . Donc , puis , ce qui signifie que la condition est inutile pour définir . On peut donc supposer que pour tout , .
Alors, pour tout , il existe tel que . Comme , on a automatiquement et pour tout . En sommant tous ces , on obtient tel que pour tout , . Alors pour tout , il existe tel que , et ceci prouve que . Comme , on a , donc .
Enfin, pour le dernier point, il faut montrer que est dans chaque demi-appartement de contenant un voisinage de dans . Notons un tel demi-appartement, est un mur de , identifié à un mur de dont la direction contient . Soit ouvert de tel que , alors . Ainsi est un demi-appartement de contenant le voisinage de dans . Ceci entraîne que , donc que .
L’inclusion réciproque du premier point n’est en général pas vraie, mais c’est presque tout comme, car le fait que implique que est inclus dans la même facette de Weyl que celle contenant . En terme de cônes affines, on obtient le
Corollaire 8.2.7
Soit un appartement de , soit un cône bordé par un cône parallèle à . Alors .
On ne peut pas dire directement la même chose pour les bases, car est définie comme l’intersection de avec des demi-appartements fermés. Il se pourrait donc a priori que soit inclus dans un bord de la facette de Weyl contenant . Mais ce n’est pas le cas. En effet, si est un mur contenant , alors le mur correspondant contient et donc , d’où finalement . On peut donc énoncer le
Corollaire 8.2.8
Soit un appartement de , soit bordé par un cône parallèle à . Alors .
8.2.2 comme réunion de façades de
On montre ici que est homéomorphe à la réunion de et d’autres façades de .
On pose:
On dira que est l’ensemble des cônes de bordés par .
Proposition 8.2.9
L’espace topologique est homéomorphe à la réunion des pour .
L’homéomorphisme est donné par:
:
Un point d’un appartement compactifié est envoyé sur le point de égal à , où est un relevé de dans , c’est à dire , et .
De plus, fixe .
Démonstration:
est bien défini:
Pour commencer, soit un appartement de , soient et deux cônes équivalents dans , soient des relevés, montrons que . On a égalité des directions: , donc par la deuxième assertion de la proposition 8.2.2. Et donc le lemme 8.2.3 s’applique: . Donc .
Passons au cas général: soit , soient et deux appartements de , soit et tels que . Soient et des relevés. Alors
Il existe et tels que , , , , et . D’après la proposition 3.3.3, point 9, il existe une facette de quartier et une autre telles que et . On choisit et minimales. Soit contenant un scp de et un scp de , montrons que contient alors le coeur d’un scp de et le coeur d’un scp de .
Il y a deux possibilités: soit et alors est la facette de Weyl contenant et donc , soit est disjoint de , alors est la plus petite facette fermée contenant , alors pour n’importe quel et . Dans tous les cas, . Donc tout scp de contient un point de , alors par le lemme 8.2.1. Ceci prouve que contient le coeur d’un scp de . De même, contient le coeur d’un scp de . Notons et les cônes engendrés par ces coeurs, ainsi et .
Comme contient également un cône parallèle à , il contient un cône parallèle à et fournit donc un appartement de . Nous voulons montrer que , et pour cela il suffit de montrer que . En raison du cas particulier traité au début de la preuve, il suffit de prouver que . Ce sera fait si nous prouvons que et . Bien sûr les deux égalités sont similaires, vérifions juste la première.
Quitte à remplacer par le scp engendré par , et par la projection sur du cône obtenu, on peut supposer , et . L’intersection est fermée, donc contient . Or contient car donc est stable par addition avec . Donc . Et, d’après le corollaire 8.2.7, .
On peut maintenant choisir un ”isomorphisme d’appartements compactifiés” qui fixe . Alors . Ainsi, est l’image de par un isomorphisme d’appartements qui fixe , donc et ont le même coeur, et donc .
Ceci achève de prouver que est bien définie.
Prenons note de ce résultat, que nous avons montré au passage car il resservira:
Lemme 8.2.10
Soient tels que et . Alors il existe un appartement , il existe tels que et sont des scp de et , et sont parallèles à et , et .
De plus, si est un appartement de contenant et un cône parallèle à , si , alors . Et similairement pour et .
Remarque: En appliquant ce lemme au cas où et , on vérifie que si et , alors .
est surjective: Soit . Il existe un appartement et un cône tel que et borde . Alors et .
est injective:
Soient , , , et supposons que . Soient , des relevés, alors . Quitte à raccourcir et , on peut supposer grâce au lemme 8.2.10 qu’il existe , tels que , et . Alors , c’est-à-dire que contient un scp de et de . Alors l’image par de ce scp est un scp de et de , donc . Mais le lemme affirme en outre que et similairement pour . Ceci implique que donc .
est continue:
Soit un point d’un appartement compactifié de . Fixons un relevé de et un ouvert de sorte que est un voisinage de , et les voisinages obtenus de la sorte forment une base de voisinages de . Montrons que contient un voisinage de , précisément, nous allons montrer que . Soit un cône tel que .
Soit , soit un représentant de . Alors est bordé par , donc d’après la proposition 4.7.2, il existe contenant et un scp de , on peut supposer lui-même. L’intersection contient alors et donc par le corollaire 8.2.8. Soit induisant un isomorphisme fixant . Alors (voir
6.2.3). On a , il reste donc à vérifier que .
Soit un représentant de inclus dans . Comme , il existe tel que . Mais alors , donc d’après la proposition 8.2.6, il existe tel que . Alors . On choisit le relevé de dont le sommet est , donc , car est dans le bord de (lemme 8.2.4). Ceci prouve que , donc est continue.
est fermée car est compact et est séparé.
fixe : Soit , soit un appartement contenant , soit un représentant de , on a . On a et un relevé de dans est . Donc .
Ainsi, est compact, donc fermé dans . De plus, est dense dans , donc est dense dans . D’où le
Corollaire 8.2.11
L’adhérence de dans est .
On peut donc identifier, au moyen de , la compactification de à la clôture de dans .
Références
- [Bou68] Nicolas Bourbaki. Groupes et algèbres de Lie, chapitres IV,V,VI. Hermann, Paris, 1968.
- [Bro89] Kenneth S. Brown. Buildings. Springer verlag, 1989.
- [BT72] François Bruhat and Jacque Tits. Groupes réductifs sur un corps local I, données radicielles valuées. Publ. Math. I.H.E.S, 41:5–184, 1972.
- [GR06] Yves Guivarc’h and Bertrand Remy. Group theoretic compactification of Bruhat-Tits buildings. Ann. Scient. Ec. Norm. Sup., 39:871–920, 2006.
- [Lan96] Erasmus Landvogt. A compactification of the Bruhat-Tits building. Springer lecture note in Math, 1619, 1996.
- [Par00] A. Parreau. Immeubles affines: construction par les normes et étude des isométries. Contemporary Math., 262:263–302, 2000.
- [Ron89] Mark A. Ronan. Lectures on buildings, volume 7 of Perspectives in math. Academic Press, 1989.
- [Rou08] Guy Rousseau. Euclideans buildings. Séminaires et congrès de la SMF, 18, 2008.
- [Ré02] Bertrand Rémy. Groupes de Kac-Moody déployés et presque déployés, volume 277. Astérisque, 2002.
- [Tit74] Jacques Tits. Buildings of spherical types and finite BN-pairs. Springer lecture note in math, 386, 1974.
- [Tit86] Jacques Tits. Immeubles de type affine. Springer lecture note in math, 1181:159–190, 1986.
- [Wei09] Richard M. Weiss. The structure of affine buildings, volume 168 of Annals of Math. Studies. Princeton university press, 2009.
- [Wer07] Annette Werner. Compactifications of Bruhat-Tits buildings associated to linear representations. Proc. London Math. Soc., 95:497–518, 2007.
Cyril Charignon
Institut Élie Cartan
Unité mixte de recherche 7502
Nancy-Université, CNRS, INRIA
Boulevard des aiguillettes
BP 70239
54506 Vandoeuvre lès Nancy cedex (France)
cyril.charignon@iecn.u-nancy.fr